samedi, 20 juillet 2019
VIALATTE ET LA CHALEUR
Parcourant, en façon de révision estivale, les chroniques d'Alexandre Vialatte compilées par sa grande amie Ferny Besson et publiées par la maison Julliard (treize volumes, je crois), il m'arrive de tomber, une fois de plus ébahi (mais c'est toujours une fois de plus et toujours ébahi), sur quelque aperçu saisissant de bon sens et de vérité, à propos de quelque curiosité littéraire ou esthétique, condensé dans une formule définitive.
Cette fois, c’est dans Pas de H pour Natalie (Julliard, 1995) que j’ai trouvé la pépite. A propos de Céline, ce pestiféré. Il est en train de parler des grands maîtres en littérature. Qui sont marqués d’une propriété étonnante : ils sont « réconfortants », ils offrent un « schnaps aux autres hommes », il y a, dans leur écriture « quelque chose de roboratif ».
Attention : « Ce réconfort peut se trouver dans le plus noir pessimisme s’il est inspiré par autre chose qu’une mécanique à fabriquer des mots. Quoi de plus décourageant, objectivement, que Céline ? Quoi de plus amer que sa vision des hommes ? Quoi de plus malodorant que ses châteaux de bouse de vache qui se reflètent dans un flot de purin ? Mais ils sont si monumentaux, il a fallu pour les bâtir tant d’enthousiasme, de verve, de génie créateur, qu’il emporte l’admiration, le rire, le déchaînement lyrique ».
Et c’est là que je fais mon pointer de pure race, vous savez, ce chasseur qui, quand il renifle le faisan blotti dans le buisson, s'immobilise de façon si soudaine qu'il semble changé en statue de pierre : je marque l'arrêt, pile en sursaut : « D’autant plus qu’une telle amertume ne peut être le fait que d’une égale déception, et pour être tellement déçu il faut s’être fait des hommes une idée bien grandiose. Il faut les avoir trop aimés. »
Là je dis : admirable de justesse. A peine quelques mots, et voilà Céline tout entier, avec sa littérature du dépit amoureux, de la rage du déçu qui ne cesse d’injurier son idéal, parce qu’il lui en veut à mort de n'avoir pas tenu ses promesses, pire : de s'être désintégré sous ses yeux, laissant l'adolescent exalté devant le cadavre puant du paradis promis. Une leçon d'analyse littéraire : au cœur du sujet, sans contorsions cérébrales.
Et Vialatte élargit son propos : « Résumons-nous : si, comme le disait Gide, ce ne sont pas les bons sentiments qui font la bonne littérature, c'est tout de même, de façon ou d'autre, le cœur qui passionne le débat. Il faut que le lecteur sente derrière le talent je ne sais quelle épaisseur ou quelle chaleur humaine, quelle vitalité contagieuse, quel "amour" disait Goethe (j'aimerais dire "allégresse").
Il y a des œuvres et des auteurs, qu'on touche comme des serpents ou comme des mécaniques ; ils refroidissent la main comme le fer ou le boa. Je crois que les grands auteurs sont les grands mammifères : ils ont le sang chaud, le poil fourni, la robe luisante. Touchez-les en hiver, la main revient réchauffée.
Pourquoi tant d’œuvres passent-elles si vite malgré le vernis du badigeon, ou même le papier à fleurettes, malgré le talent pour employer le mot qui convient ? C'est qu'il est tendu sur du vide, sur un lattis, ou sur un mur lépreux. On ne sent pas, sous cette pellicule, le frémissement du cuir, la chaleur animale. Si vous tapez dessus, le papier crève. Au contraire, attrapez Dickens, Rabelais, Saint-Simon ou Montaigne ; frappez fortement sur la croupe, et c'est comme un grand cheval qui se met à marcher ; la vapeur lui sort des naseaux, son pas égal et fort fait résonner le village ; montez dessus et vous irez loin. »
Alexandre Vialatte évoque ensuite, pour illustrer son espèce de théorie littéraire (Vialatte n'a pas de théorie littéraire, mais une attitude morale, en fin de compte), la personne de Marie-Aimée Méraville, qui vient d'être enterrée à Condat : « Courageuse, modeste, auvergnate », femme obscure et bel écrivain qui a enseigné toute sa vie à Saint-Flour, pour qui il éprouve de l'admiration, pour la raison même qu'il vient de développer. « Je ne sais, mais la plupart des morts tendent aux vivants, du fond de la tombe, une main glacée. Méraville leur tend une main chaude. » Le vrai lecteur est une caméra thermique.
On n'arrive pas à définir ce qui donne à une œuvre l'animation de l'existence palpitante. Mais quand on est en présence, on le sait, point, c'est tout. Mine de rien, en quelques mots, Alexandre Vialatte vient de répondre à la vieille question : « Qu'est-ce que la littérature ? – C'est la chaleur animale. »
***
"Considérations sur la tombe de Marie-Aimée Méraville" est paru dans La Montagne le 24 septembre 1963.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, littérature française, pas de h pour natalie, marie-aimée méraville, dickens, rabelais, saint-simon, montaigne, louis-ferdinand céline, ferny besson, éditions julliard
mercredi, 20 avril 2016
MONTAIGNE ET LA VANITÉ

Je me replonge régulièrement dans les Essais de Montaigne, ou plutôt dans l’anthologie que je me suis fabriquée quand je les ai lus in extenso il y a quelques années. C’est le livre III que je préfère. C’est là en effet que Montaigne formule explicitement la raison qui est à l’origine de ma préférence. Plus précisément dans le chapitre IX, intitulé « De la vanité ». Il y dit en vérité de drôles de choses.
Car Montaigne inscrit sous le terme de « vanité » l’activité même qui le fait écrire les Essais (pardon à Montaigne : je me permets de "corriger" l’orthographe – dont il avoue au demeurant qu’il ne s’en soucie guère) : « Il n’en est à l’aventure aucune plus expresse que d’en écrire si vainement. Ce que la divinité nous en a si divinement exprimé devrait être soigneusement et continuellement médité par les gens d’entendement. Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans travail, j’irai autant qu’il aura d’encre et de papier au monde ? Je ne puis tenir registre de ma vie par mes actions : fortune les met trop bas ; je le tiens par mes fantaisies. [Et voici le meilleur.] Si ai-je vu un gentilhomme qui ne communiquait sa vie que par les opérations de son ventre : vous voyez chez lui, en montre, un ordre de bassins de sept ou huit jours ; c’était son étude, ses discours ; tout autre propos lui puait. Ce sont ici ["ici", ça veut dire qu'il parle des Essais], un peu plus civilement, des excréments d’un vieil esprit, dur tantôt, tantôt lâche et toujours indigeste ». On a bien compris : Montaigne écrit les Essais comme d’autres vont au cabinet d’aisance (qu’il appelle quelque part « garde-robe »). Peu de chance qu’on trouve un tel passage dans Lagarde et Michard.
Puis, après avoir dénoncé ce grammairien de l’antiquité, qui « remplit six mille livres du seul sujet de la grammaire », en assortissant sa remarque d’un jugement sévère (« Tant de paroles pour les paroles seules ! »), il conclut ainsi le paragraphe : « La corruption particulière du siècle se fait par la contribution particulière de chacun d’entre nous : les uns y confèrent la trahison, les autres l’injustice, l’irreligion, la tyrannie, l’avarice, la cruauté, selon qu’ils sont plus puissants ; les plus faibles y apportent la sottise, la vanité, l’oisiveté, dont je suis ».
Si c’est dit sincèrement (peut-on être sûr ?), c’est admirable.
Il explique aussi, plus loin, comment il se fait que le contenu du chapitre est parfois en complet décalage avec le titre qui l’annonce (III, 6, intitulé "Des coches", est à cet égard un exemple flagrant) : « Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière ; souvent ils la dénotent seulement par quelque marque, comme ces autres titres : l’Andrie, l’Eunuque, ou ces autres noms : Sylla, Cicéron, Torquatus. J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades ».

Imaginer cet homme qui se décrit volontiers comme lent, presque un peu balourd, en train de virevolter « à sauts et à gambades » est assez réjouissant.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, montaigne, les essais de montaigne, lagarde et michard
vendredi, 19 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 2
2/2
 De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.
On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.
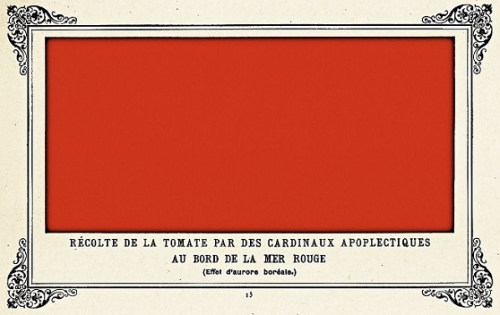
Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?
Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).
Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.
Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.
Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.
Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).
Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.
Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.
Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil
mardi, 12 novembre 2013
QUE FAIRE DE L'ACTUALITE ?

MONUMENT AUX MORTS DE JOYEUSE, ARDÈCHE
SCULPTURE DE GASTON DINTRAT
****
Ce n’est pas que je me pose plus de questions qu’il n’est convenable pour vivre heureux, mais je me dis que les lecteurs qui me font l’amabilité, et pour quelques-uns l’amitié de rendre visite à ce blog se demandent peut-être pourquoi, depuis quelque temps (ça va finir par se compter en mois), j’ai quasiment cessé de découper ici le fruit de quelques réflexions qui me viennent au sujet – disons-le crânement sans nous dissimuler l’ampleur démesurée de l’ambition et peut-être de la prétention –, de la marche du monde, du sens de l’existence ou de l’état moral et intellectuel de la société (en toute simplicité, n’est-ce pas) dans laquelle nous vivons.
Ne nous voilons pas la face : je faisais ici mon petit « Café du Commerce ». Autrement dit je passais bien du temps à refaire le monde, un peu comme tout un chacun le fait à un moment ou à un autre, au comptoir ou à la terrasse, en charriant, désinvolte, des mots trop gros pour passer au tamis des intelligences moyennes comme sont la plupart des nôtres. Pour être honnête, je dois dire (à ma décharge ?) que mes propos se muaient de plus en plus souvent en incursions de plus en plus insistantes dans la chose littéraire (Philippe Muray, Montaigne, Hermann Broch et surtout, depuis cet été, Henri Bosco, dont j’ai maintenant presque achevé le tour du monde de l’œuvre).
Ce n’est pourtant pas que j’ai cessé de réagir aux fantaisies, désordres et monstruosités offertes « en temps réel » par l’actualité de la vie du monde. Tiens, pas plus tard que ce matin, dans l’émission d’Alain Finkielkraut, j’ai bondi sur ma chaise en entendant les propos de Philippe Manoury, tout en abondant dans le sens de son interlocuteur Karol Beffa. Les duettistes se disputaient (très courtoisement) au sujet de la « musique contemporaine ».

La question était de savoir pourquoi le public met la marche arrière quand il s’agit d’acheter des billets d’entrée aux concerts des « musiques savantes d’aujourd’hui », au point que les programmateurs « modernistes » ou même « avant-gardistes » sont obligés d’entrelarder dans des proportions variables leurs programmes classiques d’œuvres en « création mondiale ».
La dose de « musique innovante » doit être savamment calculée, pour donner au plus grand nombre l’impression d’être cultivé, mais ouvert à ce qui s’invente au présent. Une façon confortable d’être tout à la fois « conservateur » et « progressiste », si tant est qu’on puisse parler de progrès dans les formes esthétiques. A la fin du concert, les payeurs de leur place ont à cœur de faire un triomphe à tout le monde, histoire de rentabiliser psychologiquement le prix payé et d’éviter de se dire qu’on a gaspillé son argent.
Plus les applaudissements sont nourris, plus le retour sur investissement social était justifié, en quelque sorte. Je dis "social" parce que je crois qu'il y a beaucoup de souci de paraître (et de paraître branché) chez ceux qui courent aux concerts contemporains.
Karol Beffa a bien raison de dire qu’après le sérialisme intégral et la dictature dodécaphonique, les compositeurs n’ont plus osé écrire de la musique que l’auditeur aurait eu plaisir à chanter si elle avait comporté cette chose désuète qu’on appelait, avant les progrès de la modernité, la MELODIE.

Et Philippe Manoury a bien tort de répliquer qu’il met n’importe qui au défi de chanter une seule mélodie de Charlie Parker au saxophone : Mimi Perrin et les Double Six sont là pour prouver qu’il est même possible de placer en virtuose des mots sur des mélodies virtuoses. Quand je parle de la mélodie, je pense à cette part de la musique que monsieur tout le monde n'a aucun mal à s'approprier. Les duettistes ne parlent donc pas de la même chose.
Philippe Manoury a ensuite cette déclaration qui sonne comme un aveu : « Les compositeurs d’aujourd’hui se préoccupent de nouveau de la réception de leur musique ». D’abord et d’une, c’est bien de reconnaître qu’auparavant (disons depuis la révolution Schönberg) les compositeurs se fichaient éperdument de ce que pouvait ressentir l’auditeur en entendant leur musique.

Appelons cela « musique de laboratoire » ou « musique expérimentale », où le laborantin laborieux considère l’auditeur comme un simple cobaye. Le problème de la « musique contemporaine » est que la majorité des cobayes persistent à se rebiffer et à refuser d’entrer dans les éprouvettes. Et qu’on n’aille pas me soutenir que les dits cobayes ont tous tort au motif qu’ils ne montent pas dans le train royal du « Progrès » de la culture.
Quand ils forment l’immense majorité, il n’est pas sûr qu’on puisse en conclure que « la musique contemporaine souffre d’un déficit de communication » (vous pouvez remplacer la musique par l’Europe ou la réforme des retraites, car l’argument est souvent utilisé en politique par les gens au pouvoir) : quand les gens rejettent en masse quelque chose qu’on veut leur faire avaler, il y a fort à parier que ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas compris. C’est précisément parce qu’ils ont fort bien compris qu’ils n’en veulent pas.
Voilà ce que je dis, moi !
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, gaston dintrat, café du commerce, littérature, henri bosco, montaigne, hermann broch, musique contemporaine, répliques, alain finkielkraut, philippe manoury, karol beffa, avant-garde, dodécaphonisme, musique sérielle, charlie parker, mimi perrin, double six, arnold schönberg
jeudi, 11 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE (fin)

LE PEINTRE ANTON RÄDERSCHEIDT ET SON EPOUSE, PAR AUGUST SANDER
***
Cette fois, promis, c’est la dernière halte chez Montaigne, ses Essais et leur Livre III. Je commence par deux petites gourmandises, dont la première prolonge la note d’hier sur le mariage : « Socrate, à qui on demandait ce qui était le plus commode, de prendre ou ne prendre point de femme : ʺLequel des deux on fasse, dit-il, on s’en repentiraʺ » (III, V, Sur des vers de Virgile). Certains diront que Rabelais avait déjà conclu dans ce sens, quoique de façon moins compendieuse, puisque tout son Tiers Livre, et une partie de son Quart Livre, et même du Cinquième, développent à l’envi l’hésitation inquiète de Panurge quant à savoir s’il doit ou non prendre femme (Pantagruel lui déclare gentiment : « Et je vous vois bien en point, selon ces trois sorts : vous serez cocu, vous serez battu, vous serez volé », Tiers Livre, XII).
La deuxième gourmandise se trouve juste quelques pages plus loin, dans le même chapitre : « Zenon, parmi ses lois, réglait aussi les écarquillements et les secousses du dépucelage », Zénon dont Montaigne affirme par ailleurs : « On dit que Zénon n’eut affaire à femme qu’une fois en sa vie : et que ce fut par civilité, pour ne sembler dédaigner trop obstinément le sexe ». On imagine bien la dame, après avoir reçu le coup : « Monsieur, vous daignâtes me baiser et consentîtes à me besogner, mille grâces vous soient rendues, vous êtes fort civil ! ».
Toujours à propos des joies du sexe, Montaigne y va de sa sévérité : « Nous mangeons bien et buvons comme les bêtes, mais ce ne sont pas actions qui empêchent les opérations de notre âme. En celle-là nous gardons notre avantage sur elles ; celle-ci met toute autre pensée sous le joug, abrutit et abêtit par son impérieuse autorité toute la théologie et philosophie qui est en Platon ; et même il ne s’en plaint pas. Partout ailleurs vous pouvez garder quelque décence : toutes autres opérations supportent des règles d’honnêteté ; celle-ci ne se peut pas seulement imaginer, si ce n’est vicieuse ou ridicule. Trouvez-y, pour voir, une façon de faire sage et discrète. Alexandre disait qu’il se reconnaissait comme mortel principalement par cette action et le dormir : le sommeil suffoque et supprime les facultés de notre âme ; la besogne les absorbe et dissipe de même ». Pas besoin, je pense, de préciser de quelle « besogne » il s’agit.
Le paragraphe qu’il consacre à l’esprit des filles, spécialement averti dès le plus jeune âge des choses de l’amour et du sexe, n’est pas à dédaigner : « Nous les dressons dès l’enfance aux entremises de l’amour : leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu’à ce but. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre chose que le visage de l’amour, ne fût-ce qu’en le leur représentant continuellement pour les en dégoûter ». Jusque-là, rien de bien épastrouillant, comme dirait Marcel Proust.
Vient l’anecdote familiale : « Ma fille (c’est tout ce que j’ai d’enfants) est en l’âge auquel les lois excusent les plus échauffées de se marier [la formule est délectable !] ; elle est d’une complexion tardive, mince et molle, et a été par sa mère élevée de même d’une forme retirée et particulière : elle ne commence encore qu’à se déniaiser de la naïveté de l’enfance. Elle lisait un livre français devant moi. Le mot de fouteau s’y rencontra, nom d’un arbre connu [hêtre] ; la femme qu’elle a pour sa conduite l’arrêta tout court un peu rudement, et la fit passer par-dessus ce mauvais pas. Je la laissai faire pour ne troubler leurs règles, car je ne m’empêche aucunement de ce gouvernement : la police féminine a un train mystérieux, il faut le leur laisser. Mais si je ne me trompe, le commerce de vingt laquais n’aurait su imprimer en sa fantaisie, de six mois, l’intelligence et usage et toutes les conséquences du son de ces syllabes scélérates, comme fit cette bonne vieille par sa réprimande et interdiction ». Encore une histoire qui a échappé à Villeroy et Boch, euh non, Roux et Combaluzier, zut, Boileau et Narcejac, crotte de bique, voilà : Lagardémichar. Ouf, j’y suis arrivé.
La fin du passage : « Mon oreille se rencontra un jour en lieu où elle pouvait dérober aucun des discours faits entre plusieurs femmes sans soupçon : que ne puis-je le dire ? Notre Dame ! (fis-je) allons à cette heure étudier des phrases d’Amadis et des registres de Boccace et de l’Arétin pour faire les habiles ! Il n’est ni parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres : c’est une discipline qui naît dans leurs veines [citation latine : ʺet Vénus elle-même les a inspiréesʺ, Virgile],que ces bons maîtres d’école que sont nature, jeunesse et santé, leur soufflent continuellement dans l’âme ; elles n’ont que faire de l’apprendre, elles l’engendrent ».
Comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre ce que se disent entre elles les filles quand elles sont sûres de ne pas être entendues, je ne peux, hélas, que confirmer le propos de l’auteur : les conversations entre garçons, sur ce plan, oscillent de la surenchère frimeuse au propos de sacristain pieux. Quant à Pierre Arétin (1492-1556), on ne peut pas dire que ce soit de la petite bière éventée qu'il fait couler dans ses Ragionamenti, comme on peut le voir ci-dessous, sur la gravure illustrant un des épisodes.

ELLE AIME VISIBLEMENT ÇA
Et que pensez-vous de cette sucrerie : « Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie qu’un pucelage ; et est le vœu de la virginité le plus noble de tous les vœux, comme étant le plus âpre : ʺLa puissance du diable est dans les reinsʺ, dit S. Jérôme » ? Et qu’en pensent messieurs Lagardémichar ?
Pour conclure cette trop longue série, je dédie la citation suivante à tous les syndicalistes, à tous les militants de partis, à tous les petits soldats des « associations » qui ont pour noble objectif de faire avancer la cause des « minorités visibles » sur la voie du « progrès » (si vous voyez ce que je veux dire) :
« La plupart des choses du monde se font par elles-mêmes ».
Oui vraiment, je la dédie à tous ceux qui sont convaincus que, sans leur « lutte », rien n’avancerait, et qui se croient les moteurs sans lesquels l’humanité s’endormirait et régresserait. On va dire que j’exagère, et j’avoue bien volontiers que c’est vrai. Je le fais même exprès.
Cela dit, si je regarde l’histoire du mouvement ouvrier, le calendrier rétrospectif de ce que l’on a appelé les « conquêtes sociales », depuis la journée de 15 heures (dimanche compris) jusqu’à celle de 10 heures (loi du 30 mars 1900), puis de 8 heures augmentée des congés payés (Léon Blum, 1936, La Belle équipe, Jean Gabin, …) ; et si je regarde l’inversion de ce processus depuis les années 1970, et l’invraisemblable facilité (rétrospective) avec laquelle les « conquêtes » ont été progressivement grignotées, je finis par me poser des questions.
Les « luttes », parfois violentes, la combattivité des militants et des syndicats ont eu beau s’y opposer, les bastions ouvriers (Renault Vilvoorde, les « Conti », Pétroplus, Peugeot Aulnay, la liste est interminable) sont tombés. Et « pendant le combat, la chute continue ». Le résultat est là : précarisation, chômage, baisse du pouvoir d’achat, etc. On est visiblement en bout de course du processus d’embourgeoisement relatif de la « classe ouvrière ». Et je dirais presque, avec Montaigne, que personne n’y peut rien.
Je me demande en effet, pour illustrer la phrase de Montaigne, si les progrès sociaux ne se sont pas contentés d’accompagner, grosso modo – et en fin de compte assez régulièrement –, les progrès des techniques, qui, au rythme des « gains de productivité », permettaient aux responsables de laisser tomber (sans que leur portefeuille eût trop à en souffrir), du haut de la table où ils n’ont jamais cessé de festoyer, les miettes capables de calmer les ardeurs revendicatives.
N’est-ce pas l’abbé Félicité Robert de Lamennais (mort en 1854) qui disait : « Donnez au malheureux les bribes tombées de votre table » ? L'ouvrier armé d'un couteau face au patron armé de son gros cigare ne seraient-ils finalement que des personnages en train de jouer des rôles sur des scènes de théâtre ?
Ce petit raisonnement, qui vaut évidemment ce qu’il vaut, je l’envoie pacifiquement dans les gencives de DB, qui me disait avec une sorte de jubilation masticatoire : « Je suis en lutte », alors que, tout en se déclarant communiste, elle venait toujours dans des tenues recherchées et qu’elle était propriétaire d’un bel appartement au cœur bourgeois du 6ème arrondissement de Lyon, à proximité immédiate du Parc de la Tête d’Or.
Bourgeoise et communiste, j’attends encore qu’elle me donne une explication qui ne soit pas complètement tire-bouchonnée.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, montaigne, littérature, rabelais, pantagruel, panurge, tier livre, essais de montaigne, sexe
lundi, 08 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE
Je continue ma petite promenade dans les Essais de Montaigne, en empruntant non l’autoroute « lagardémichar », mais en flânant par les chemins buissonniers que j’y ai tracés pour mon propre compte, et par les « ronds de sorcière » (les ramasseurs de mousserons me comprendront) où je me suis arrêté pour cueillir.
Parlant de l’attitude de certains hommes face à la mort (De juger de la mort d’autrui, II, XIII) et, ayant cité le cas d’un homme trop faible pour se poignarder : « Au rebours, Ostorius, lequel, ne se pouvant servir de son bras, dédaigna de n’employer celui de son serviteur à autre chose qu’à tenir le poignard droit et ferme, et, se donnant le branle, porta lui-même sa gorge à l’encontre, et la transperça ». La conclusion vaut son pesant d’épices, tournée magistralement par la plume de l’auteur : « C’est une viande, à la vérité, qu’il faut engloutir sans mâcher, si l’on n’a le gosier ferré à glace ». Il a pas le sens de l’image, Montaigne ? Et peut-être une terrible jubilation devant cet héroïsme.
Tiens, revenons aux femmes : « Nous avons appris aux Dames de rougir oyant seulement nommer ce qu’elles ne craignent aucunement à faire ; nous n’osons appeler directement nos membres, et ne craignons pas de les employer à toute sorte de débauche ». Les « Dames » d’aujourd’hui, en société, n’ont plus de ces pudeurs désuètes. La femme d'aujourd'hui, normale, je veux dire, normalement féministe, c'est-à-dire férue d'égalité des sexes, c'est-à-dire devenue aussi machiste que le macho, la femme d'aujourd'hui, dis-je, ne rougit plus, ou alors elle a honte.
Et cette autre anecdote, absolument délicieuse, dans le même chapitre (De la présomption, II, XVII), au sujet d’un homme qui a longtemps mené une « vie de bâton de chaise » et qui finit par se marier (« faire une fin » ?) : « Il se maria bien avant en l’âge, ayant passé en compagnon sa jeunesse : grand diseur, grand gaudisseur. Se souvenant combien la matière de cornardise lui avait donné de quoi parler et se moquer des autres, pour se mettre à couvert, il épousa une femme qu’il prit au lieu où chacun en trouve pour son argent, et dressa avec elle ses alliances : ʺBonjour, putain ! – Bonjour, cocu !ʺ ». Y a-t-il besoin d’expliquer « gaudisseur » et « cornardise » ?
J’aime énormément (même chapitre, je n’y peux rien) ce propos qui, après un début d’apparence laborieuse, débouche sur un magnifique hommage : « Le monde regarde toujours vis-à-vis ; moi je replie ma vue au-dedans, je la plante, je l’amuse là. Chacun regarde devant soi ; moi, je regarde dedans moi, je me considère sans cesse, je me contrôle, je me goûte. Je connais des hommes assez, qui ont diverses parties belles : qui, l’esprit ; qui, le cœur ; qui l’adresse ; qui, la conscience ; qui, le langage ; qui, une science ; qui, une autre. Mais de grand homme en général, et ayant de telles pièces ensemble, ou une en tel degré d’excellence qu’on s’en doive étonner, ou le comparer à ceux que nous honorons du temps passé, ma fortune ne m’en a fait voir nul. Et le plus grand que j’aie connu au vif, je dis des parties naturelles de l’âme, et le mieux né, c’était Etienne de la Boétie : c’était vraiment une âme pleine et qui montrait un beau visage à tout sens ; une âme à la vieille marque et qui eût produit de grands effets, si sa fortune l’eût voulu, ayant beaucoup ajouté à ce riche naturel par science et étude ».
Pour moi, c’est une des plus belles pages que Montaigne ait écrites. Une « âme à la vieille marque », quelle formule magnifique. Il est regrettable que le poncif en la matière se résume à la « lagardémichardise » : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi » (De l’amitié, I, XXVIII). Nous sommes tous plus ou moins lagardémichardisés. Qui ferait révérence, aujourd'hui, aux « âmes à la vieille marque » ? Et qu'on n'aille pas, pour me contredire, exhumer le cadavre de Stéphane Hessel.
Au sujet de La Boétie, on trouve encore quelques remarques dans III, IV : « Je fus autrefois touché d'un puissant chagrin, selon ma complexion, et encore plus juste que puissant : je m'y fusse perdu à l'aventure si je m'en fusse simplement fié à mes forces. Ayant besoin d'une véhémente diversion pour m'en distraire, je me fis, par art, amoureux, et par estude, à quoi l'âge m'aidait. L'amour me soulagea et retira du mal qui m'était causé par l'amitié ». Si l'on ajoute le chapitre XXIX du Livre I (Vingt et neuf sonnets d'Estienne de la Boetie, que Montaigne supprima à l'époque pour ne pas faire double emploi avec la publication en volume de ces poèmes), c'est tout, je crois, ce qu'on trouve au sujet de ce parangon de l'amitié que formèrent Montaigne et La Boétie.
Vous voulez savoir ce que Montaigne a de commun avec Molière ? C’est la haine de la médecine et des médecins : « Que les médecins excusent un peu ma liberté, car, par cette même infusion et insinuation fatale, j’ai reçu la haine et le mépris de leur doctrine : cette antipathie que j’ai à leur art m’est héréditaire. Mon père a vécu soixante-quatorze ans, mon aïeul soixante et neuf, mon bisaïeul près de quatre-vingts, sans avoir goûté aucune sorte de médecine. La médecine se forme par exemples et expérience ; aussi fait mon opinion.
En premier lieu, l’expérience me la fait craindre : car, de ce que j’ai de connaissance, je ne vois nulle race de gens si tôt malade et si tard guérie que celle qui est sous la juridiction de la médecine. Leur santé même est altérée et corrompue par la contrainte des régimes. Les médecins ne se contentent point d’avoir la maladie en leur gouvernement, ils rendent la santé malade, pour garder qu’on ne puisse en aucune saison échapper à leur autorité ». Excusez la longueur des citations dans la présente note, c’est un peu commandé par le texte lui-même. Et goûtez « si tôt malade et si tard guérie ».
A propos de la médecine, certains diront peut-être qu’elle n’a plus rien à voir aujourd’hui avec celle du temps de Montaigne. Je répondrai seulement que, certes, les progrès dans le diagnostic, dans le traitement des maladies sont incontestables, mais que ce dont parle Montaigne a moins à voir avec une quelconque efficacité technique de la médecine qu’avec la relation, d’une part, entre le médecin et son malade (il exerce son autorité sur lui), et d’autre part, entre la personne et son propre corps, comme si Montaigne voyait une insupportable démission, un abandon de souveraineté personnelle, dans le fait de s’en remettre à quelqu’un supposé savoir, juste pour aller mieux. Et, si possible, guérir.
Philippe Muray parle très bien (Le XIXème siècle à travers les âges) de cette volonté de guérir les autres qui anime par exemple George Sand, et de cette obsession d'aller mieux, qui pousse les gens à s'en remettre à des guérisseurs qui, tout bien pesé, s'avèrent être de vulgaires charlatans, gourous et autres escrocs du coeur, de l'esprit et de l'âme, pour soulager le portefeuille de ceux qui attendent un peu de soulagement. Tartuffe était peut-être l'hypocrisie personnifiée, mais il était surtout et avant tout un escroc convoitant le bien d'Orgon, et y serait parvenu si Molière n'avait placé la pirouette finale pour que ça finisse bien tout en flattant le roi.
Ce qui choque Montaigne, dans le rapport des gens avec les médecins, c’est l’abandon de leur liberté entre les mains des « spécialistes » et des « experts », un peu comme, dans le discours du Grand Inquisiteur de Karamazov, les chrétiens qui n’ont rien de plus pressé que de se soumettre à une autorité au lieu de vivre la liberté apportée par le Christ. Comme il le dit ailleurs (II, XVII) : « Mes conditions corporelles sont en somme très bien accordantes à celles de l’âme. Il n’y a rien d’allègre : il y a seulement une vigueur pleine et ferme ». Ce qui m’amuse beaucoup (disons : jusqu’à un certain point), c’est ce qu’il dit des « coliques » dont il a gravement souffert.
Moi qui ai comme lui croisé la route de ces « coliques frénétiques », j’approuve ses railleries à l’encontre des « crottes de rat pulvérisées, et telles autres singeries qui ont plus le visage d’un enchantement magicien que de science solide ». Il est vrai que le lithotriteur n’existait pas, mais que dois-je penser, quand j’entends tel homme de l’art – bien vivant – me déconseiller formellement le lait et le chocolat, tandis que tel autre m’ordonne des infusions et décoctions de je ne sais plus quelles plantes, et qu’un troisième voit dans l’oseille, l’asperge et la rhubarbe les causes certaines de mes problèmes de concrétions calcaires dans les rognons ? Que savent-ils exactement ?
Notre rapport à la science a fait de celle-ci une autorité supérieure, mais mettez en présence et écoutez, je ne sais pas moi, trois économistes proposant leurs solutions pour sortir de la crise, trois politiciens soucieux de restaurer la France dans sa grandeur, ou trois climatologues (dont un climatosceptique) discutant du réchauffement anthropique de la planète, moi je vous le dis : on n’est pas sortis de l’auberge rouge.
Parce que l’autorité supérieure en question, elle est pulvérisée en une multitude d’options diverses et contradictoires. Les experts eux-mêmes ont l'embarras du choix. Allez vous y retrouver, dans ces conditions. Plus personne ne sait, et l’on croule sous les boussoles qui se contredisent.
Nous savons à la fois trop de choses pour ne pas donner aux optimistes cet air de confiance niaise et sans limite qui s'épanouit sur le groin de leur suffisance, et trop peu de choses pour comprendre l'infinité des interactions qui forment le vivant, et pour avoir conscience des conséquences de nos actes (OGM, gaz de schiste et tout le bataclan). Dès lors, ces conséquences nous échappent pour l'essentiel, y compris aux experts et autres spécialistes. Marchand de boussoles, tiens, peut-être un créneau porteur, vous ne croyez pas ?
Montaigne m’a au moins appris quelque chose de tout à fait actuel : que sait-on de source sûre ? Qui sait quelque chose ? A quoi doit servir ce que l'on sait ? Il m’a appris que l’homme d’aujourd’hui est finalement d’une arrogance imbécile, alors qu’un minimum de modestie, je dirais même d'humilité devant le monde devrait être la règle unique. La vraie faiblesse qui est la nôtre, c’est que nous possédons les moyens irrésistibles (parce que techniques) de faire passer notre arrogance dans la réalité, au risque de la détruire. L'arrogance de l'homme d'aujourd'hui, elle est dans la puissance technique qu'il est en mesure de mettre en oeuvre. L'ivresse de toute-puissance qui caractérise la psychologie infantile.
Il est certain que Montaigne était pénétré de la même idée que les Grecs de l’antiquité classique, qui appelaient cette infraction, ce péché d’orgueil si vous voulez, du nom d’ὓβρις (hybris, tout ce qui dépasse la mesure). Et peut-être est-ce un symptôme révélateur que l’adverbe « trop » soit mis à toutes les sauces dans le langage actuel (« C’est trop cool, trop bon, trop fort ! »). En occident (et grâce à lui, partout ailleurs), le viol de la juste mesure est consommé depuis longtemps.
On s’en est mis plein la lampe. Mais qui a déjà vu une cuite carabinée sans gueule de bois carabinée consécutive ? L’humanité l’attend encore, sa gueule de bois consécutive. Selon toute probabilité, elle sera sévère. A mon avis, la cellule de dégrisement est déjà en vue.
Jacques Lacan, qui n'a pas dit que des conneries, disait : « Le réel, c'est quand on s'y cogne ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, montaigne
dimanche, 07 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE

COUPLE BOURGEOIS, PAR AUGUST SANDER
***
Montaigne fut le premier écologiste. Je ne l’affirme pas, je le prouve : « Mais, quand je rencontre, parmi les opinions les plus modérées, les discours qui essaient à montrer la prochaine ressemblance de nous aux animaux, et combien ils ont de part à nos plus grands privilèges, et avec combien de vraisemblance on nous les apparie, certes, j’en rabats beaucoup de notre présomption, et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait à dire, si y a-t-il un certain respect qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle ». Qui y trouverait à redire ?
Peut-être Carolyn Christov-Bakargiev, responsable d’une foireuse foire d’art contemporain (« arcon » en abrégé, opposé à l’ « art temporain », je crois que la dame sévit à la Documenta de Kassel), qui a par ailleurs rédigé une Déclaration des Droits des plantes (elle travaille même sérieusement à leur faire accorder le droit de vote, des élections locales jusqu'à l'ONU) : elle trouverait Montaigne d’une insupportable pusillanimité. Une femme tonique, une merveilleuse éradicatrice de civilisation, à l'image exacte des canons de l'époque où elle a été condamnée, hélas, à exister.

ELLE A POURTANT L'AIR NORMAL, MADAME CAROLYN CHRYSTOV-BAKARGIEV
Dans l’Apologie de Raymond Sebond (II, XII), Montaigne tourne dans tous les sens la question de ce qui différencie l’homme de l’animal. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas convaincu que l’homme est un animal si différent que ça des autres animaux : « ceux qui entretiennent les bêtes se doivent dire plutôt les servir qu’en être servis ».
On n’est pas plus net, ce me semble, et la hiérarchie établie par la doxa biblique, le Vatican et la Sorbonne latinisante entre les êtres vivants n’est, aux yeux de Montaigne, qu’une manifestation d’arrogance dérisoire. Pascal Picq et tous ses copains de l’abolition des frontières entre l’homme et l’animal doivent hoqueter de bonheur en voyant se profiler à l'horizon la tombe à venir de l’humanité. Et toc ! Pascal Picq voit une amorce du politique dans les rituels tribaux des groupes de chimpanzés, c'est vous dire ce qui nous pend au nez. Moi je dis à Pascal Picq : « Ben mon pote, on n'est pas sortis de l'auberge espagnole ». Remarquez que Sarkozy en chimpanzé (avec Hollande en Cheetah ?), ça n'aurait rien de bien défrisant. Notez que "cheetah" veut dire "guépard" (d'après mon dictionnaire).
Marcel Gauchet, dans Le désenchantement du monde (1985), rappelle que « le christianisme est la religion de la sortie de la religion ». Je soupçonne quant à moi le sieur Michel de Montaigne d’y être pour quelque chose. Vous voulez une preuve ? Prenez le chapitre XVI du Livre II des Essais (De la gloire) : « Le marinier ancien disait ainsi à Neptune en une grande tempête : Ô Dieu, tu me sauveras si tu veux ; tu me perdras si tu veux. En attendant, je tiendrai mon timon toujours ferme et droit ».
La Fontaine, au siècle suivant, a dit la même chose autrement : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Eh oui, l’homme chrétien n’attend plus passivement le bon vouloir de la providence : il fait quelque chose pour faire advenir la providence. L'action humaine entre en action. C'est une révolution, car c’est le début de la fin du christianisme. Si l’homme doit agir pour que le Ciel l’aide, c’est que le Ciel n’est pas tout-puissant, et que l’homme est devenu impatient, et il s'agace de cette bizarre impuissance du Ciel à combattre le Mal qui le menace. La remarque de Montaigne, comme celle de La Fontaine, c’est une marque du slogan futur : « Deviens ce que tu fais ». Dit autrement : agis, et tu seras sauvé. Tout le monde actuel, quoi, à part le "sauvé", vu la façon dont tourne ce qui reste de la nature. Mais comme dit l'autre (c'est toujours "l'autre") : il suffit d'y croire.
Et l'on se demande pourquoi nous sommes déchristianisés !!! Je le disais : avec Montaigne, le ver est dans le fruit : il voit l'homme non plus comme l'exclusive créature de Dieu, mais comme l'une parmi toutes les autres. Une sorte de « primus inter pares ». Avec Montaigne, le vrai n'est plus légitime. Tout simplement parce que, avec Montaigne, il n'y a plus de vrai de vrai.
Montaigne n'est peut-être qu'un symptôme de la montée en puissance qui attend l'Occident au tournant, mais ce ver dans le fruit que j'y vois, cette démission de légitimité du vrai, c'est exactement au même rythme qu'il croque dans la pomme que nous sommes. Le « canard du doute », qu'on trouve dans Les Chants de Maldoror, d'Isidore Ducasse, alias Comte de Lautréamont. Comme dit Maldoror : « Je te salue, vieil océan ! ».
Voilà : je te salue, vieil océan.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, montaigne, les essais de montaigne, littérature, écologie, carolyn christov-bakargiev, art contemporain, documenta kassel, apologie de raymond sebond, pascal picq, sarkozy, françois hollande, marcel gauchet, le désenchantement du monde
samedi, 06 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE

COUPLE D'INDUSTRIELS, PAR AUGUST SANDER
***
Je pioche dans mon anthologie personnelle des Essais de Montaigne : « Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu’elle porte, et ai raison, car j’en ai vu des effets très-dommageables » (I, XXIII, De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue). Cette pathologie tout uniment avouée porte un nom savant : c’est le misonéisme, c’est-à-dire la haine de tout ce qui est nouveau. S'il recevait comme nous sur le crâne le déluge de nouveau dont tous les marchands de la terre et autres planètes voisines nous assaillent, dans quel état respiratoire se trouverait-il ?
J’aime bien ceci : « Tout ainsi qu’en l’agriculture les façons qui vont avant le planter sont certaines et aisées, et le planter même ; mais depuis que ce qui est planté vient à prendre vie, à l’élever il y a une grande variété de façons et difficulté : pareillement aux hommes, il y a peu d’industrie à les planter ; mais, depuis qu’ils sont nés, on se charge d’un soin divers, plein d’embesognement et de crainte, à les dresser et nourrir » (I, XXVI, De l’institution des enfants). Messieurs et bien chers frères, sachons rester humbles : pour ce qui est des hommes, "il y a peu d'industrie à les planter". Il n'a malheureusement pas tort. Heureusement, il dit quelque part ailleurs : « Madame, j'espère que vous avez eu autant de facilité à le faire sortir que de plaisir à le faire entrer » (cité de mémoire).
Au sujet du « devoir conjugal », Montaigne conseille aux maris la modération sexuelle « à l’accointance de leur femme ». Car « il y a de quoi faillir en licence et débordement », dont il craint les pires dommages. Et il conclut sur ce point : « Qu’elles apprennent l’impudence au moins d’une autre main. Elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m’y suis servi que de l’instruction naturelle et simple. (…) Certaines nations, et entre autres la Mahumétane, abominent la conjonction avec les femmes enceintes ; plusieurs aussi, avec celles qui ont leurs flueurs » (I, XXX, De la modération). Le Kama-Sutra débridé, ce n'est pas son affaire, on a bien compris. Mais "qu'elles apprennent l'impudence d'une autre main" ! Franchement, il a de ces formules ! Tout le monde aura compris "flueurs", je pense.
Montaigne décrit ainsi son blason : « Je porte d’azur semé de trèfles d’or, à une patte de lion de même, armée de gueules, mise en face » (I, XLVI, Des noms). Traduction de l’héraldique, qui est un langage, un art et une science : sur fond bleu, un champ de trèfles jaunes, sur lequel est posé horizontalement une patte de lion dont les griffes sont rouges, comme le montre l’illustration. Je ferai éventuellement quelque chose sur le langage du blason, m'étant arrivé de voir mes modestes propos publiés dans de modestes revues modestement savantes.

Montaigne n’aimait pas la nouveauté (voir plus haut), ce qui lui faisait parfois manquer singulièrement de flair : au combat, il aime mieux se fier à la qualité de son épée (et de son bras) qu’au « boulet qui échappe de notre pistole, en laquelle il y a plusieurs pièces, la poudre, la pierre, le rouet, desquelles la moindre qui viendra à faillir, vous fera faillir votre fortune ». Il ajoute pour faire bonne mesure : « et sauf l’étonnement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprivoisé, je crois que c’est une arme de fort peu d’effet, et espère que nous en quitterons un jour l’usage ». Comme quoi, mon Mimi (Montaigne se prénomme Michel, nobody's perfect), tout le monde peut se tromper : que dirais-tu si tu lisais nos journaux, entre les écoliers américains abattus par dizaines de milliers, les escrocs politiques français par centaines de milliers, les rebelles syriens par millions et les journalistes russes sous le règne de Poutine par milliards ?
J’aime bien l’anecdote suivante, concernant une de ses amies, que Montaigne rapporte dans De l’ivrognerie (II, II) : la dame est veuve et chaste. Un beau jour, catastrophe, horreur, enfer et damnation, elle est enceinte, il n’y a pas de doute. Bravant le risque de la honte, elle fait demander au coupable, par le biais du curé en chaire, de se dénoncer, promettant de lui pardonner « et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. Un sien jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble ». Je traduis « indécemment » par « le cul à l'air » ...ou pire.
Ah le vin ! Je note ici que ce n’était pas un valet de pâturage, mais de labourage : comme dit la chanson : « Emmener sa femme au champ pour la…bourer ». C’est peut-être à cela que Sully pensait, en évoquant les mamelles de la France, allez savoir ? Montaigne achève ainsi une digression où il est question de son père (« Pour un homme de petite taille, plein de vigueur et d'une stature droite et bien proportionnée ») : « Revenons à nos bouteilles ».
Et cette autre histoire gaillarde, où il conte « le bon mot que j’appris à Toulouse, d’une femme passée par les mains de quelques soldats : Dieu soit loué, disait-elle, qu’au moins une fois en ma vie je m’en suis soûlée sans péché » (II, III, Coustume de l’île de Cea). J'adore ce cri du coeur : "Je m'en suis soûlée sans péché !". Presque une apologie du viol, vous ne trouvez pas ? On ne risque pas de trouver ces quelques histoires dans Lagarde et Michard. On va peut-être dire que je les choisis exprès ? Et moi, impavide, je rétorque : « Ben tiens, je vais me gêner ! ».
Maintenant, je voudrais m’adresser à tels grands-pères de ma connaissance, qui se mettent à fondre comme beurre en casserole chaude et deviennent gagas quand le petit-fils les regarde dans les yeux, grave comme un pape le jour de la messe de Pâques : grands-pères fondus et gagas, lisez donc le chapitre VIII du Livre II des Essais de Montaigne. Son titre ? De l’affection des pères aux enfants. Il me semble que c’est en mesure de décoiffer quelques chauves. Montaigne s’adresse (respectueusement) à madame Geoffroy d’Estissac :

« Comme, sur ce sujet de quoi je parle, je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine nés, n’ayant ni mouvement en l’âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas soufferts volontiers nourris près de moi. Une vraie affection et bien réglée devrait naître et s’augmenter avec la connaissance qu’ils nous donnent d’eux ; et lors, s’ils le valent, la propension naturelle marchant du même pas que la raison, les chérir d’une amitié vraiment paternelle ; et en juger de même, s’ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle ». J'insiste sur "s'ils le valent". En clair : si le bébé montre en grandissant qu’il mérite notre affection, allons-y, mais s’il ne la mérite pas, n’y allons pas. Autrement dit : c’est au gamin de prouver qu’il mérite d’être aimé. Que penserait Montaigne de l'actuelle divinisation de l'enfant ?

CES DEUX VIGNETTES SONT TIRÉES DE DINGODOSSIERS 1, DE GOSCINNY ET GOTLIB
Mais ce n’est pas fini. Il conclut même très fort : « Il en va fort souvent au rebours ; et le plus communément nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous ne faisons auprès de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes ». Ce n’est peut-être pas gentil pour les guenons. Notez que Montaigne ne s’exclut pas de la réaction niaise de l’adulte face au bébé. Peut-être même qu’il s’agace de réagir ainsi. Eh oui, ma pauvre dame, on ne fait pas toujours comme on veut.
Voilà ce que je dis, moi, aux grands-pères de ma connaissance !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, les essais de montaigne, de l'institution des enfants, blason, armoiries, lagarde et michard
vendredi, 05 juillet 2013
POURQUOI J'AI LU MONTAIGNE

COUPLE, PAR AUGUST SANDER
***
Alors pour finir : « Mon Montaigne à moi, c’est quoi ? » (sur l'air célèbre d’Edith Piaf). La réponse à la question, tout le monde connaît, c’est : « Je suis toujours à la fête ». Mon Montaigne à moi, c’est devenu une anthologie. Mon anthologie. Ou ce que vous voulez, appelez ça épitomé, miscellanées, chrestomathie, analectes, je n’y vois aucun inconvénient. J’accepte même « florilège », c’est vous dire si j’ai l’esprit large.
Parfaitement, je me suis fait ma collection de citations de Montaigne. Je vous rassure, elle ne ressemble guère à ce dont monsieur Lagarde et monsieur Michard ont toléré la présence dans leur relevé laborieux des balises du parcours obligé du lycéen. Je ne dis pas que mes quarante-cinq pages A4 leur feraient toutes dresser leurs trois cheveux sur leur crâne chauve, mais ils seraient horrifiés à l’idée qu’on puisse en mettre quelques-unes sous les yeux de la jeunesse. Et pourtant, ils auraient à y gagner. Je parle des yeux des lycéens.
Tiens, pour mettre en appétit, vous apprécierez ceci : « Les outils qui servent à décharger le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger nos rognons. Et ce que, pour autoriser la toute puissance de notre volonté, Saint Augustin allègue avoir vu quelqu’un qui commandait à son derrière autant de pets qu’il en voulait, et que Vives, son glossateur, enchérit d’un autre exemple de son temps, de pets organisés suivant le ton des vers qu’on leur prononçait, ne suppose non plus pure l’obéissance de ce membre : car en est-il de plus indiscret et tumultuaire ». On trouve ça au chapitre XXI du livre I, intitulé De la Force de l'imagination, p. 102-103.
Trois cents ans avant que Joseph Pujol, le virtuose du pet volontaire (nom de scène : « le Pétomane», à partir de 1891) se produisît devant des salles combles de Parisiens en délire ! « Premièrement, il faisait le Pet de la jeune fille timide, puis le Pet de la couturière, le Pet du monsieur bègue, etc. Ensuite, écartant les basques de son habit rouge et, tirant de sa petite culotte un tuyau de caoutchouc, fumait une cigarette ... par sa bouche postérieure », écrivent Jean Feixas et Romi dans Histoire anecdotique du pet (Ramsay/Pauvert). Il jouait aussi à la flûte "Au Clair de la lune" et "Le Roi Dagobert". Mais revenons à Montaigne.

Pour faire bonne mesure : « Joint que j’en sais un si turbulent et revêche, qu’il y a quarante ans qu’il tient [retient] son maître à péter d’une haleine et d’une obligation constante et incessante, et le mène ainsi à la mort ». L’édition de 1595 ajoute cette fragrance délicate de méthane intestinal : « Et plût à Dieu que je ne le susse que par les histoires, combien de fois notre ventre par le refus d’un seul pet, nous mène jusqu’aux portes d’une mort très angoisseuse ; et que l’Empereur qui nous donna liberté de péter partout, nous en eût donné le pouvoir ». J'en conclus que Lagarde et Michard se sont privés d’un moyen facile de motiver les adolescents à la lecture de Montaigne.
Rien ne serait plus efficace au lycée pour faire comprendre qu’il est dangereux de réprimer chez l’homme, par souci de convenance, ce qui vient de la nature. C’est ce qui est arrivé à Claude Chabrol, qui a eu un « malaise vagal », parce qu’il retenait un énorme pet (qu'il commit finalement sur le brancard qui l'emportait à l'hôpital), par pure courtoisie pour Sacha Distel, qui poussait des roucoulades interminables à la fin d’un banquet (c'est Claude Chabrol lui-même qui raconte l'épisode).
Il était culturellement intolérable à Lagarde et Michard de ne pas infliger au lycéen le ciseau des censures paralysantes qu’eux-mêmes avaient subies étant jeunes, comparables au rituel de la piqûre du TABDT (ou DTTAB) imposé aux jeunes recrues du service militaire, quand il y en avait encore un (une piqûre qui paralyse l’épaule, enfin c’était à l’époque d’Hérodote ou d'Hippocrate pour le moins).
Mon anthologie à moi, si quelque hiérarque éducatif de la technostructure ministérielle en prenait incidemment connaissance, serait en deux temps trois mouvements déclarée hérétique et brûlée séance tenante en place de Grève, s’il existait encore une « Place de Grève », et si l’on brûlait encore les livres. Aujourd’hui, c’est moins spectaculaire : il suffit de ne pas en parler. Le mutisme sur un grand livre est devenu plus efficace qu’un incendie volontaire. Ou que son étude par Lagarde et Michard.
Parce que je vais vous dire : la philosophie de Montaigne, je m’en tamponne le coquillard. Non, ce n'est pas vrai, mais c’est vrai qu’apprendre les étapes de son trajet philosophique (pyrrhonien ou sceptique ?) n’est pas le plus sûr moyen de provoquer (et de ressentir) l’intérêt. Pour mon compte, je voulais, en ouvrant une bonne fois pour toutes le bouquin, savoir ce que ce monument avait à me dire. À me dire à moi. Personnellement. Je l’ai dit : n’avoir en perspective que « ce qu’il faut savoir » (tous les vade-mecums de la terre), cela suffit à me décrocher la mâchoire à force de bâiller.
Quand le « Commendatore » lance son invitation (c’est chez Mozart) : « Verrai tu a cenar meco ? », Don Giovanni répond : « Verro » (« Viendras-tu manger en ma compagnie ? – Je viendrai »). Pendant ce temps, Leporello souffle : « Oibo ; tempo non ha, scusate ». N'étant pas Commandeur, j’ai invité Montaigne à ma table, et je dois dire que nous avons devisé agréablement, même si nos propos n’auraient en aucun cas pu être insérés dans le Lagarde et Michard 16ème.
Il faut bien dire que les deux auteurs, riches rentiers du manuel scolaire connu sous l'appellation « lagardémichar », ont réduit à presque rien, sinon quelques poncifs, l’incroyable et riche matière contenue dans les 1116 pages du livre. Mais pouvaient-ils faire autrement ? Et est-il possible d'enseigner vraiment les Lettres ? J'en doute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, humanisme, anthologie, lagarde et michard, essais de montaigne, bac de français, claude chabrol, philosophie, don giovanni, joseph pujol, pétomane
mardi, 04 juin 2013
QUI EST NORMAL ?

WILLIAM CLAXTON PHOTOGRAPHIA, ENTRE AUTRES, LES GRANDS DU JAZZ.
ICI, SA MAJESTÉ CHET BAKER. AH ! "MY FUNNY VALENTINE" ! MÊME MILES DAVIS, QUI A LONGTEMPS FAIT SA CHOCHOTTE, A FINI PAR Y VENIR, A "MY FUNNY VALENTINE".
***
Episode précédent : les institutions sont donc faites, selon les thuriféraires stipendiés ou non de la modernité urgente, pour s'adapter aux désirs successifs et changeants des populations. Il n'y a plus de vérité absolue. L'humanité est devenue un énorme, permanent et profond sable mouvant conceptuel.
Quand on parle de norme, de normal et d’anormal, il s’agit de bien identifier la personne à laquelle on a à faire. On appellera « progressistes » tous ceux qui s’efforcent de faire « bouger » les choses, à force de « transgressions » de la norme, qui veulent « briser » les « tabous », et qui s'en prennent à tout ce qui emprisonne l’individu dans le « carcan d'intolérances » dues au crétinisme des « gens normaux ».
En face de ces enthousiastes de « l’empire du Bien », on appellera « nouveaux réactionnaires » (Philippe Muray en est une des figures principales) tous ceux qui se cramponnent à des valeurs plus anciennes, immobiles, a priori suspectes au plus grand nombre, du seul fait qu’elles avaient cours avant, ce qui les dévalue irrémédiablement, forcément et par principe. Il s’agit d’envoyer aux oubliettes les tenants de ce qui existe, puisque ce qui existe a le défaut rédhibitoire d’avoir existé. « Du passé faisons table rase ! », leur crie la « modernité » en colère.
De là (aux environs de mai 1968), datent ces slogans fulgurants d’audace : « Changez ! », « Bougez ! ». Sous-entendu : ce que vous êtes, ce que vous pensez, la façon dont vous vivez, c’est de la merde. Ce que vous êtes aujour'hui n'est que de l'étron infâme et informe, laissez-vous façonner, sculpter par les temps nouveaux qui viennent vous libérer de toutes les pesanteurs. Léger, léger, léger. Ce qui était ne doit plus être. Ce que vous étiez doit se soumettre à la nouvelle loi : la transformation perpétuelle de l'un dans l'autre.
Sous-entendu aussi : ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas est figé, froid, cadavérique. La voilà, la norme énorme d’aujourd’hui : menace de mort. Et l’anormal, d’avance condamné, c’est celui qui, s’en tenant à de l’existant, refuse obstinément d’ « avancer » du même pas que les autres sur la voie lumineuse du merveilleux et impérieux « Progrès ». Pour rester vivant, paraît-il.
Pourquoi faut-il changer, au fait ? Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut, parce que le monde aujourd'hui est comme ça, parce que ..., parce que ... Finalement, quand tu réfléchis, tous ces adeptes du respect de l'identité qui se ruent sur le changement d'identité pour rester quelque chose, ça finit par faire bizarre. Moi qui croyais qu'une vérité, quelle qu'elle fût, se remarquait au fait qu'elle était durable. Quelle désillusion !
Eh bien si c’est comme ça, je me sens furieusement « anormal ». Mais alors là attention : du genre anormal assumé, endurci, récidiviste et irrécupérable. Pour un peu, j'en deviendrais presque arrogant. Et pour montrer que les anormaux comme moi ne pèchent pas par ignorance de ce qui se passe sous leurs yeux, je propose d'organiser prochainement (ben oui, c'est l'époque, la Fête de la Musique est dans pas longtemps, ça ferait de l'animation), un de ces quatre, une splendide « Anormal Pride » ?
Puisqu'il s'agit de nos jours de s'affirmer à travers des « marches des fiertés », il n'y a aucune raison pour que les anormaux de mon espèce, redressant leur front suppliant vers des cieux qui braquent leurs yeux intransigeants sur leurs errances coupables, n'aient pas enfin, à leur tour, leur moment de fierté, eux qui sont invités en permanence à revêtir des imperméables gris pour raser les murs en espérant passer inaperçus, courbés sous le poids de la honte.
Le plus curieux dans l'affaire, c'est qu'une telle « marche des fiertés » des nouveaux anormaux serait potentiellement en mesure de réunir une majorité de citoyens. Mais qui est désormais fier d'être normal ? Il n'y a pas à être fier d'être normal, puisque c'est normal d'être normal. C'est là le drame.
 Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.
Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.
C’est vrai qu’aujourd’hui vous ne commencez à vous sentir mériter d'exister que si une caméra de la télé, branchée sur le direct, est présente pour vous le confirmer. Quand on a ainsi « mérité l'événement », l'existence en prend une densité et une saveur nouvelles. Quand je pense que le pauvre Sartre croyait avoir compris et être capable d’expliquer toute l’époque dans Huis-clos, avec son : « L’enfer c’est les autres » ! Juste de quoi rire un peu, somme toute, avec le recul.
Quand les gens trouvent qu’il ne se passe rien chez eux, d’abord, comprenez qu’ils ne connaissent pas leur bonheur, ensuite entendez qu’il ne s’y donne aucun spectacle, qu’aucune « animation » ne vient l’ « animer », que le Tour de France ne s’y est jamais arrêté, que Gérard Collomb, merdelyon, n’a jamais eu l’idée d’y organiser les « Nuits Sonores » que le monde entier nous envie, et toute cette sorte de choses.
Que dirait Montaigne aujourd’hui, lui qui affirmait : « Je suis desgousté de la nouvelleté » (Essais, I, 23), et qui répondait à un ami qui se plaignait de n’avoir « rien fait » de sa journée : « Eh ! Avez-vous pas vécu ? » ? Aujourd’hui ? Montaigne aurait tout faux. Il n’aurait rien compris à la loi de la modernité : « Changez ! », « Bougez ! ».
Comme si les gens, dans ces occasions, oubliaient que leur existence ne s’est pas interrompue malgré l’absence de tout événement extérieur ou de toute caméra de télé. La population se sentirait-elle à ce point vide ?
Bon sang mais c'est bien sûr : c'est donc pour ça que marchands de smartphones dernier cri avides de deniers et politiciens avides de bouts de papier imprimés à leur nom s’entendent à merveille pour faire croire au vulgum pecus que, sans leurs initiatives, prises en vue du bien de tous (la FÊTE conjuguée à tous les temps et à tous les modes), l’existence de tous serait un désert, un espace inutile occupé par le vide intersidéral.
« Mais elle est passée où, la vie intérieure ? », se demande l’anormal attardé, perdu au milieu de ce nulle part en carton pâte, en attendant que passe l'improbable « Anormal Pride ». L’anormal attardé ne se rend même pas compte qu’il vient encore de proférer un gros mot. Si, il s'en rend compte, hélas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, william claxton, chet baker, jazz, miles davis, my funny valentine, normal, anormal, progrès, civilisation, transgression, l'empire du bien, philippe muray, mai 68, homo festivus, festivus festivus, élisabeth lévy, jean-paul sartre, huis clos, l'enfer c'est les autres, fête, montaigne, essais de montaigne
vendredi, 05 octobre 2012
REVENIR AU BEL CANTO ?
Pensée du jour : « Si les élections permettaient vraiment de changer les choses, il y a longtemps qu'elles auraient été interdites ».
BERTOLT BRECHT
Qu’est-ce que je reproche, principalement, à la « musique contemporaine » ? Pourquoi, en fin de compte, me suis-je détourné de la création la plus actuelle, dont j’ai si longtemps été un adepte ô combien fidèle, voire exalté, et que, pour cette raison, je connais assez bien ? C’est très simple : je lui reproche de ne plus pouvoir être chantée par n’importe qui, n’importe où, dans la rue, dans la voiture, sous la douche. Une musique produite par un corps humain.
J’en ai tiré un enseignement, qui ne vaut certes que ce qu’il vaut, mais qui vaut aussi tout ce qu’il vaut : ce qui n’est pas CHANTABLE en dehors d’un "bac + 12" obtenu au Conservatoire Supérieur, même adoubé par les pairs, même validé par l’institution, même décrété par les autorités médiatiques, n’est pas de la musique humaine. C’était devenu pour moi une conviction. J’en ai fait un principe. Ai-je tort ? C'est possible.
Je me suis dit un jour que c’était bizarre, en définitive. Quoi, pendant tant de siècles, des gens extrêmement savants ont composé de la musique dans l’unique but de procurer du plaisir à ceux qui devaient l’écouter ? De leur flatter l'oreille ? Et puis un jour l’artiste, promu chercheur scientifique, a décidé, du fond de ce qui était devenu son laboratoire, que l’auditeur devait désormais se plier à sa volonté à lui ? Au nom du Progrès ? Au nom de l’Histoire (qui forcément avance, comme on sait) ?
Et ne venez pas me rappeler que BEETHOVEN avait déjà fait le coup (« Est-ce que je me soucie de vos boyaux de chat, quand l'inspiration me visite ? », lançait-il furibond à SCHUPPANZIGH, le violoniste qui a créé la plupart de ses quatuors, et qui se plaignait de certaines difficultés). Chez BEETHOVEN, qu'on se le dise, ça chante sans arrêt, même si, dans ses oeuvres pour voix (prenez Christus am Ölberg, par exemple) l'écriture va toujours se percher assez haut.
L’injustice faite à l’artiste par la société bourgeoise, dès ce moment, révulse les bonnes âmes. Le premier « Salon des Refusés » remonte à 1863, la première exposition impressionniste à 1874, la première édition des Poètes maudits, de PAUL VERLAINE (« pauvre lélian ») à 1884. Une trouvaille digne d'un grand publicitaire, entre nous, ce "maudits".
Le fanatisme de la technique fonctionne comme une idéologie, dont la propagande s’empare pour mieux s’emparer des esprits. JULES VERNE laisse libre cours à son enthousiasme technophile dès l’année 1863 (Cinq semaines en ballon). GUSTAVE EIFFEL, avec le même enthousiasme, envahit le ciel de Paris en 1888.
Il n’est plus possible de ne plus courber la tête devant le Dieu Progrès. L’inventeur devient la figure privilégiée du bienfaiteur de l’humanité. Ce qu’il trouve, du moment que c’est nouveau, ne saurait apporter que le Bien. L’innovation fait figure de sacrement laïque. Le brevet industriel devient l’emblème privilégié et prioritaire du Génie Humain.
Et ce qui vaut dans les techniques et l’industrie se transporte sans difficulté dans les arts : musique, peinture, sculpture, poésie, tous les arts sont sommés de se soumettre à la dictature de l’innovation. Il faut, sous peine de disparaître dans les profondeurs abyssales de la poubelle du passé, adhérer au mouvement qui porte irrésistiblement l’humanité vers le PLUS, selon le précepte bien connu : « Plus qu'hier et bien moins que demain ».
C’est en 1896 qu’ont lieu les premiers « Jeux Olympiques » modernes, qui proclament fièrement : « citius, altius, fortius » (plus vite, plus haut, plus fort, ça interroge salement, je trouve). Ce que le très vulgaire (je parle du vulgarisateur) FRANÇOIS DE CLOSETS traduira plus tard par « toujours plus ! ».
C’est quand j’ai compris la logique de cette Histoire que je me suis mis à regimber, à renâcler, à me soustraire à la musique "contemporaine". Cela m’a demandé un effort épouvantable. Pensez que j’ai été nourri au lait de l’Humanisme et des Lumières. L’humanisme de RABELAIS, de MONTAIGNE, de RONSARD. Les Lumières, principalement, de DIDEROT et de ROUSSEAU. Le Progrès, oui, parlons-en, du "Progrès".
Ajoutez, je veux bien, la prise de la Bastille et l’Egalité des citoyens devant la loi. C’est tout cet édifice qui est tombé en ruine, quand j’ai compris la logique de cette Histoire. Cette logique d’une certaine idée du « Progrès ». Je ne m'en suis pas remis. La faute à HANNAH ARENDT, JACQUES ELLUL, PHILIPPE MURAY et quelques autres lectures, beaucoup trop tardives.
L’artiste est donc sommé de faire du neuf, sous peine de ne pas exister. Le nouveau ne sera plus jamais fortuit : le nouveau est désormais le Saint Graal. Le but ultime. La Pierre Philosophale. Depuis, on n’arrête plus. On est harcelé par le nouveau. Quelque chose qui est là, du seul fait qu’il existe, est désormais vieillot. Ce qui est d’hier ne saurait être d’aujourd’hui. Ce qui est d’"avant" est interdit de "maintenant". Périmé. Sans parler du mouvement de "dynamisme" économique imprimé par l' « obsolescence programmée », théorisée dans les années 1920.
C’est sûr, je réhabiliterai un jour prochain ce qu’un « vulgum pecus » nuisible et inconscient appelle un « stéréotype ». Car si l’on y réfléchit un moment, qu’est-ce qui nous impose de « changer » (notez la construction « absolue », je veux dire le verbe sans complément) ? « CHANGEZ », entend-on de toute part. En même temps, il est amusant d'entendre le refrain exactement contraire : « SOYEZ VOUS-MÊME » ("venez comme vous êtes", serine une publicité).
J’ai oublié le jour où est apparue, dans le ciel des démocraties européennes, l’exigence de « réforme ». Mettons trente ou quarante ans. « La France est incapable de se réformer », entend-on constamment. Mais réformer quoi ? Dans quel but ? Avec quelle intention ? Qui le sait ? Personne, je crois bien. Qu’est-ce qu’elle recouvre, finalement, cette haine du stéréotype ? Peut-être bien la haine de ce qui est, vous ne croyez pas ? Mais c'est vrai : comment pourrait-on aimer ce monde, tel qu'il est ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bertolt brecht, musique, musique contemporaine, littérature, poésie, humanisme, siècle des lumières, beethoven, schuppanzigh, paul verlaine, poètes maudits, salon des refusés, impressionnisme, jules verne, gustave eiffel, tour eiffel, jeux olympiques, françois de closets, rabelais, montaigne, diderot, rousseau, hannah arendt, jacques ellul, philippe muray
mercredi, 22 août 2012
LA METHODE VIALATTE 1/5
Pensée du jour : « Aussi les pères de famille avisés attachent-ils par une corde courte au piquet central de la tente les grand-mères et les enfançons. Une barrière de barbelés isole du monde ces radeaux de la Méduse. Un haillon vert y sèche à côté d'une loque rose. La vache vient, contemple et s'étonne, le prisonnier se souvient et passe, le promeneur regarde et fuit épouvanté. C'est ce qu'on appelle un camping de vacances ».
Alexandre Vialatte
***
Je m’adresse aujourd’hui – j’aime autant annoncer la couleur –, à ceux de mes lecteurs que je déboussole, que je décontenance, que je dépayse, que sais-je, que je dérange, déroute, voire désarçonne ou désoriente (j’en ai d’autres dans la musette, au cas où …, par exemple « agace ») par la tentation à laquelle je cède un peu trop volontiers, de me laisser, faute de rigueur intellectuelle, embarquer dans des « arabesques », comme les appelle Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-Tombe, c'est-à-dire des « digressions » (« parabases », pour les amateurs).
La digression, parfaitement, voilà l’ennemi, paraît-il. Je me propose de traiter le sujet en tant que tel, dignement, et de le traiter d’une manière formellement idoine à la matière. « Il ne faut pas confondre la forme et le fond », proclamait pourtant, affolé, Monsieur René Bady, dans un des cours les plus mouvementés (il n'avait jamais eu autant d'auditeurs) de sa tranquille histoire de professeur d’université. Il reste l’auteur d’une thèse de doctorat qui est restée dans les mémoires : tout le monde se souvient de De Montaigne à Bérulle. La modernité lui a répliqué : « La forme doit épouser le fond ».
Le pauvre homme, qui était admirablement humble et catholique, ne s’y est pas retrouvé. Le garnement infernal que je fus se souvient des cours sur l’ode au 16ème siècle (aussi, a-t-on idée !) : le cours durait quelques minutes, avant d’être sommairement exécuté par les ballons bondissant de mains en mains. Malheureux René Bady ! Tout perclus de savoirs précieux, mais sortis de l’usage et du respect, il rangeait tristement ses notes sérieuses et quittait l’amphithéâtre, accompagné de nos aboiements féroces et déracinés.
Cette série de notes se propose rien de moins que de faire l'éloge du contournement, de la trajectoire déviée, de l'embardée poétique et du désir de musarder en route au lieu d'aller bêtement d'un point à un autre en TGV. Car ces lecteurs bienveillants, mais exigeants, me reprochent de faire comme les parents du Petit Poucet, je veux dire de vouloir les perdre dans la forêt. L'enjeu est de taille, on en conviendra.
Je réponds d’urgence à ce reproche, dans un premier temps, que les cailloux blancs ne manquent jamais chez moi pour retrouver le râtelier parental, même quand il n’y a rien à y ruminer. Je veux dire que ma flèche ne perd jamais de vue le centre de la cible, ni le terme final de sa trajectoire ondulante et sinusoïdale. Que le Nord est toujours inscrit au fronton de ma boussole capricieuse.
Dans un deuxième temps, je dirai que la tentation est une chose trop sérieuse pour ne pas appeler une réponse vigoureuse et adéquate. Il faut y réagir vivement pour en prévenir les effets néfastes. La tentation ? Quelle horreur ! Le mieux est donc d'y céder aussitôt qu’elle se présente. Et de réserver les éventuelles velléités de résistance pour des combats plus formidables et plus essentiels.
Cette solution lumineuse, simplissime et fructueuse me fut dévoilée un beau jour, en dehors des adventicités naturelles du quotidien, dans un petit livre que je recommande vivement : La Papesse Jeanne, d’Emmanuel Rhoïdès (ou Roïdis, éditions Actes-Sud). Je ne l’aurais sans doute jamais lu s’il n’avait pas été traduit en français par Alfred Jarry en 1900 et des poussières.
Revigorant, et même coruscant. Je le confesse : il prêche une morale que les normes admises, certes, désavoueraient, mais qui le fait de façon si aimable, et sur un ton si espiègle que les normes elles-mêmes se disent qu'au fond, pourquoi pas ?
Les esprits perspicaces ont déjà perçu la digression qui me tend les bras : c’est quoi, cette histoire de « Papesse Jeanne » ? Pour vous montrer que le pire n’est pas toujours sûr, sachez que, pour une fois, je ne céderai pas à la tentation. Même si vous aimeriez bien en savoir plus. Le devoir avant tout. Plus tard peut-être. En attendant, voici une photo prise à l'époque des faits relatés (et qui illustre le scandale).
Dans un troisième temps, qu’on se le dise, si la notion de « digression » (ou d’« excursus ») existe, ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Or, il faut savoir que tout ce qui a été inventé par l’homme depuis la nuit des temps, l’homme s’en est servi, de la fourchette à la bombe atomique, en passant par le pédalo, la pince à épiler, le ticket de métro, l’assiette anglaise et le soc de charrue. Mais sait-on encore ce qu’est une « assiette anglaise » ?
J’ajoute que, si c’est à ma disposition, je serais bien bête de ne pas en profiter : après tout, la digression n’est pas faite pour les chiens. C’est vrai, ça : un chien, même mal éduqué, ne digresse jamais. La digression est hors de portée du règne animal. Le règne animal se déroule en ligne droite. Enfin je crois.
Et comme la digression est gratuite, elle est dans mes moyens. Dans le jardin où l’on cultive toutes les fleurs de rhétorique de la création, « chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite » (Georges Brassens, pour retrouver le titre, je vous laisse faire).
De toute façon, dit Antonin Artaud (c’était avant les électrochocs aimablement et doctrinalement administrés par le docteur Ferdière, dans son service psychiatrique de Rodez) : « Il n’y a pas d’art au Mexique, et les choses servent ». Il était en villégiature chez les Indiens Tarahumaras, dont il appréciait le plat principal, le cactus nain appelé « peyotl », chargé de forces mystérieuses. Après tout, c’est peut-être au peyotl qu’il la doit, Artaud, son « exaltation » ?
Pour la suite de la digression, merci d'attendre à demain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, chroniques de la montagne, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, digression, parabase, méandre, montaigne, déviation, petit poucet, la papesse jeanne, emmanuel rhoïdès, alfred jarry, morale, brassens, antonin artaud, rhétorique, docteur ferdière, peyotl, cahiers de rodez, tarahumaras, drogue
jeudi, 16 août 2012
A BAS LES HERETIQUES ! (3)
Pensée du jour : « L'estomac d'un Espagnol ne dure pas à notre forme de manger, ni le nôtre à boire à celle des Suisses ». Michel de Montaigne, Essais, III, 13

Résumé : les autorités catholiques de Rome ont passé beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre les formes incorrectes de la foi, pour empêcher les populations de croire en Dieu d'une manière hétérodoxe, voire incontrôlable. C'est ce que déclare en 1847 l'abbé GUYOT, auteur d'un Dictionnaire des hérésies.
Il va même jusqu’à énumérer les sectes qui selon lui ont d'ores et déjà démembré la doctrine luthérienne : synergistes (pour qui « l’impulsion de la grâce est accompagnée de la coopération de la volonté humaine »), substantiaires (pour qui « le péché originel est devenu la substance même de l’homme »), osiandrites, indifférents (emmenés par MELANCHTON), stancaristes, majoristes (qui « renouvelaient le semi-pélagianisme », ce sont des choses qui gagnent à être sues), antinomiens (qui « conclurent à la suppression de toute foi religieuse »), syncrétistes (dont les promoteurs furent persécutés, apprend-on non sans un certain effroi, par les protestants eux-mêmes), hubérianistes (selon qui « tous les hommes sont justes »), origénistes, millénaires, invisibles, ubiquistes (qui se sont opposés, il faut le savoir, aux sacramentaires), piétistes (vulgaires « dévots fanatiques »), anabaptistes, sociniens, ainsi qu’une « foule d’autres sectes, aussi peu constantes dans leur forme respective que l’astre des nuits ».
Comment voulez-vous, sous ce Niagara de sectes, que MARTIN LUTHER continue à respirer ? Certes, l’abbé GUYOT, charitablement, se livre à cette énumération avec une visible et onctueuse délectation sadique : visiblement, ce déluge qui semble emporter la grande hérésie vers les ténèbres n’est pas pour déplaire au saint abbé.
Il faut reconnaître, quand vous regardez le protestantisme, vous ne savez plus où donner de la tête. Cela grenouille (de bénitier) à qui mieux-mieux. C’est de l’enchevêtrement de vers de terre dans lequel une éléphante normale ne reconnaîtrait pas ses souriceaux, ni le pommier les cerises tombées à son pied.

Hélas, là où l’abbé GUYOT se met les deux gros orteils dans les deux yeux jusqu’à la pendule de grand-papa, c’est que MARTIN LUTHER, non content de ne pas être mort des dissidences qui ont fractionné sa nouvelle religion, en est sorti plus remuant et ressuscité que jamais. Les sectes protestantes sont, non pas des meurtres du père, mais autant de gouttes de sa semence.
Chacune des sectes énumérées ci-dessus pas loin porte le même ADN que MARTIN LUTHER. Pauvre abbé GUYOT, quand même. Il ne s’est même pas rendu compte que, loin de faire disparaître le protestantisme, la pullulation des sectes scissipares du luthéranisme en avait étendu la contagion partout sur la planète, à commencer par les tout nouveaux Etats-Unis.
Il reste qu’on trouve dans le livre du bon abbé des noms de sectes d’un ardent effet poétique. J’aime assez celles qu’il rassemble sous l’appellation de « Bulgares ». Ce ne sont que « patarins », « turlupins » « cathares », « bogomiles », « joviniens », « albigeois ». Et que pensez-vous des « pétrobrusiens » ? Ne sont-ils pas délicieux ? GUYOT fulmine contre toutes sortes de « manichéens », de « henriciens », de « novateurs », condamnés en 1176 « au concile de Lombez, dont les actes se lisent au long dans Roger de Hoveden ». Je signale par ailleurs aux amateurs d'anecdotes lexicales que, à partir du mot « bulgare », le français a formé « bougre » pour désigner tout homme qui se livrait à la sodomie.
Que reproche aux « bulgares » Notre Sainte Mère l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine ? De proclamer la vérité d’erreurs aussi manifestes que les suivantes : « Que les maris qui vivaient conjugalement avec leurs femmes ne pouvaient être sauvés ; que les prêtres qui menaient une mauvaise vie ne consacraient point ; qu’on ne devait obéir ni aux évêques, ni aux ecclésiastiques qui ne vivaient point selon les canons ; qu’il n’était point permis de jurer en aucun cas, et quelques autres articles qui n’étaient pas moins erronés ».
On croit rêver, n’est-ce pas ? Ainsi – si j’ai bien compris –, le mari ne doit pas remplir de « devoir conjugal », et le clergé doit marcher au son du canon. Et je ne parle pas des « frérots » ou « fraticelles », ni des « dulcinistes », et encore moins des « apostoliques » (franchement, on ne sait plus à qui se fier) : « Pour lors, ils avaient secoué toute honte : ils disaient qu’on n’est parvenu à l’état de liberté et de perfection que quand on peut voir sans émotion le corps nu d’une personne de sexe différent ». Le Ciel me préserve de secouer un jour toute honte !
Si l’on m’y pousse, je révélerai toutes les turpitudes commises par les « abécédaires » ou les « omphalophysiques » (nom par lequel on a probablement voulu désigner les « hésichastes », mais cela va sans même le dire). A la lettre « O » du dictionnaire, on trouve par ailleurs dénoncés les « ophites », les « opinionistes », les « orbibariens » et – accrochez-vous aux poignées et aux barres – les « optimistes ». Je vous jure que c’est vrai : c’est page 257. Je ne suis donc pas le seul à dénoncer les optimistes. Cela me fait chaud au coeur, et je me sens moins seul.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérésie, religion, croyance, foi, église, protestantisme, catholicisme, pape, schisme, montaigne, catholique romain, dieu, secte, dicitonnaire, martin luther, jean calvin
vendredi, 18 mai 2012
ELOGE DE MAÎTRE RABELAIS
Comme promis (« Compromis, chose due », disait COLUCHE en parlant des femmes), aujourd’hui, j’attaque Maître FRANÇOIS, alias ALCOFRIBAS NASIER. Bien sûr, que c’est RABELAIS. Que puis-je dire, au sujet de RABELAIS ? Si je disais que j’ai l’impression que j’ai du rabelais qui me coule dans les veines, je ne serais pas très loin de la vérité, mais ce ne serait sans doute pas très bon pour ma réputation (quoique …).
Pourquoi ? Mais à cause de la réputation de grand buveur devant l’éternel, qu’il traîne depuis toujours, pas complètement à tort, probablement. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas sa lecture qui vous empêchera de passer à l’éthylomètre avant de prendre le volant. Tout ça pour dire que parmi les auteurs français que ma prédilection m’a amené à cultiver de préférence aux autres, je l'avoue aujourd'hui, c’est RABELAIS qui vient en tête.
En confidence et par parenthèse, je peux vous dire aussi que celui qui vient en queue s’appelle PIERRE CORNEILLE, mais ça, c’est dû à la longue malédiction qui a poursuivi ce malheureux génie depuis un épouvantable Cinna étudié en classe de 5ème, sous la férule de Monsieur LAMBOLLET, au lycée Ampère. J’imagine que c’était au programme. Je vous jure, Cinna à douze ans, il y a de quoi être dégoûté des mathématiques. Euh, j’ai dit une bêtise ?
« Prends un siège, Cinna, et assieds-toi par terre, Et si tu veux parler, commence par te taire ». Non, je déconne, ce n’est pas Auguste qui dit ça à Cinna, c’est nos esprits mal tournés d’élèves mal élevés qui brodaient. Forcément, c’est ça qui m’est resté. Mais ça doit être du genre de la « pince à linge » des Quatre Barbus et de la 5ème symphonie de BEETHOVEN.
Si, j’ai quand même retenu « Je suis maître de moi comme de l’univers », parce que je vous parle d’un temps où l’on apprenait par cœur. Je crois bien que c’est dans la bouche d’Auguste. Mais CORNEILLE m’a collé à la semelle gauche (il paraît que ça porte bonheur !), parce que plus tard, j’ai dû me farcir Sertorius, et puis Suréna, et ce traumatisme, franchement, je ne le souhaite à personne. Et je n’ai rien dit d’Agésilas et d’Attila : « Après l’Agésilas, hélas, mais après l’Attila, holà ! ». Même que ce n’est pas moi qui le dis, c’est BOILEAU, alors.
Résultat des courses, il m’est resté un automatisme : de même que Gaston Lagaffe éternue dès qu’on prononce le mot « effort », de même, dès que j’entends le nom de CORNEILLE, je bâille. Bon je sais, la blague est un peu facile, mais avouez qu’il fallait la faire, celle-là, et c’est d’autant plus vrai que ce n’est pas faux. Et puis si, par-dessus le marché, ça désopile la rate, on a rien que du bon.
Mais foin des aversions recuites – et injustes comme sont toutes les vendettas, et je ne vais pas passer ma vie à assassiner CORNEILLE qui, après tout, ne m’a jamais empêché de vivre, malgré des dommages monumentaux à mon égard, pour lesquels je n’ai jamais reçu d’intérêts –, revenons à RABELAIS.
Le portrait ci-dessus est donné pour celui de RABELAIS en 1537. Il tranche avec tout ce qu'on connaît, et l'on est pris de doute. Pourtant, je me rappelle la collection de portraits accrochés dans un des bâtiments de La Devinière, la maison natale : beaucoup ressemblaient à l'officiel, de plus ou moins loin, il est vrai. Mais quelques-uns étaient de la plus haute fantaisie, faisant parfois de l'auteur une sorte de nègre.
Je ne vais pas refaire mon chapitre sur Lagarde et Michard, avec leur damnée tendance à tout tirer vers le sérieux, le pontifiant et l'asexué, bref, le SCOLAIRE (« ce qu’il faut savoir »), mais il est sûr que si on veut jouir de RABELAIS, c’est dans le texte qu’il faut aller. Et pour y aller, j’espère qu’on m’excusera, il faut avoir envie de jouir. C’est un aveu. Tant pis. J’espère qu’à mon âge, il ne me coûtera pas trop cher.
RABELAIS ? C’est ma respiration. C’est mon espace vital. C’est comme un socle. Je n’y peux rien, ça s’est fait malgré moi, comme ça, sans que j’y prête la main, c’est certain. RABELAIS m’a appris une chose : la JOIE est le centre nerveux, le cœur et le muscle de l’existence. Tout le reste est résolument secondaire, accessoire, décoratif, facultatif, marginal, subsidiaire, superfétatoire et, disons le mot, superflu. Ce que je trouve chez RABELAIS me ramène toujours à la JOIE.
Il serait d’ailleurs peut-être plus exact de dire que j’ai satisfait dans RABELAIS ce besoin d’éprouver la JOIE. C’est ce même genre de besoin vital qui m’a rendu récemment jubilatoire, proprement et absolument, la lecture de Moby Dick. Mais c’est vrai, je ne sais pas encore tout, et je ne suis pas sûr d’en savoir plus « quand fatale [sonnera] l’heure De prendre un linceul pour costume » (Le Grand Pan, GEORGES BRASSENS).
C’est sûr, MONTAIGNE me touche, mais c’est un homme qui s’écoute. Beaucoup de passages plaisants, c’est sûr (je me suis efforcé d’en indiquer à plusieurs reprises ici même), mais il y a à mon goût trop de gravité chez MICHEL EYQUEM, petit châtelain de Montaigne. En comparaison, RABELAIS, je vous jure, existe concrètement, jovial et fraternel. Dès qu’il vous aperçoit, il vous invite à sa table. C’est une tout autre vision de l’humanité.
Une humanité qui converse gaiement autour d’une table couverte de plats ventrus et de flacons vermeils. Une humanité qui parle de la vraie vie, poétique et réelle, qui est forcément celle de tout homme. Poétique, parce que tout homme rêve et que tout rêve est poétique. Réelle, parce que lire les livres de RABELAIS est une excellente recette pour apprendre à renoncer sans regret à devenir maître du monde. Il y a tout ça, dans l’œuvre de FRANÇOIS RABELAIS.
Voilà ce que je dis, moi.
Et ce n'est pas fini.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, françois rabelais, montaigne, pierre corneille, cinna, lycée ampère, français, beethoven, la pince à linge, les quatre barbus, gaston lagaffe, lagarde et michard, moby dick, georges brassens
lundi, 14 mai 2012
ENCORE UNE LOUCHE DE MONTAIGNE (fin)
Restons encore un peu en compagnie de MONTAIGNE, dans les Essais et dans sa "librairie".

On trouve, au chapitre « De l’ivrognerie » (Livre II), en dehors d’un certain nombre de considérations très sages (MONTAIGNE est quelqu’un qui tient par-dessus tout à rester mesuré), une histoire digne d’être retenue.
De l’ivrognerie.
Et ce que m’apprit une dame que j’honore et prise singulièrement, que près de Bordeaux, vers Castres où est sa maison, une femme de village, veuve, de chaste réputation, sentant les premiers ombrages de grossesse, disait à ses voisines qu’elle penserait être enceinte si elle avait un mari. Mais, du jour à la journée croissant l’occasion de ce soupçon et en fin jusques à l’évidence, elle en vint là de faire déclarer au prône de son église que, qui consentirait à reconnaître ce fait en l’avouant, elle promettait de le lui pardonner, et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. Un sien jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble.
Elle est pas mignonne, l’histoire ? Une variante, en quelque sorte, de la chanson « Emmener sa femme au champ pour la…bourer ». « Qu’il s’en était pu servir ». Et on nous raconte que ce furent des époques puritaines ? Qu’est-ce que c’est que cette fable ? J’ai plutôt l’impression que le puritanisme a rarement été aussi actuel (le puritanisme est copain comme cochon, comme l’avers avec le revers, avec tout ce qui porte l’étiquette X).
Le passage suivant est beaucoup plus moral, mais il jette un drôle de jour sur la façon dont nous (moi le premier) nous extasions au-dessus du berceau d’un nouveau-né. N’y a-t-il pas quelque ressemblance avec ce que nous faisons devant le chiot ou le chaton que la chienne ou la chatte a mis bas quelque temps avant ? MONTAIGNE parle, quant à lui, de « guenon ». Sûr que ça fait plus exotique.
Chapitre VIII : De l’affection des pères aux enfants. (A madame d’Estissac.)
Comme, sur ce sujet de quoi je parle, je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine encore nés, n’ayant ni mouvement en l’âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas soufferts volontiers nourris près de moi [d’où le recours à la nourrice]. Une vraie affection et bien réglée devrait naître et s’augmenter avec la connaissance qu’ils nous donnent d’eux ; et lors, s’ils le valent, la propension naturelle marchant quant et [du même pas que] la raison, les chérir d’une amitié vraiment paternelle ; et en juger de même, s’ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle. Il en va forcément au rebours ; et le plus communément nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous ne faisons après de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes.
« S’ils le valent » : au moins c’est clair, le sentiment paternel est loin d’être naturel, comme le bruit s’en est colporté depuis JEAN-JACQUES ROUSSEAU (que cela n’a jamais empêché de mettre à l’Assistance les enfants qu’il a eus avec THERESE LEVASSEUR), et comme le montre ELISABETH BADINTER dans L’Amour en plus (1980). Est-ce que c’est MONTAIGNE qui est un salopard ? Est-ce que c’est nous qui sommes fondus gaga ?
Ce qui m’impressionne ici, c’est qu’il attend pour se faire une opinion que l’enfant ait assez grandi pour montrer aux yeux de tous quelle forme allait prendre l’être en devenir qu’il était exclusivement au départ. Nous, qui vivons à une époque qui se met à plat-ventre devant l’enfant, à l’époque de l’ « enfant au centre du système », de l’enfant-roi, ne pouvons plus guère, me semble-t-il, comprendre un tel propos.
Le plus drôle, c’est que nous nous chagrinons, plus tard, de l’écart éventuel entre l’enfant espéré et l'être accompli. MONTAIGNE, lui, n’attend rien de précis. Il attend de voir ce que ça va donner, le gamin. HANNAH ARENDT ne dit pas autre chose, dans La Crise de la culture, quand elle conteste radicalement qu’il existe un quelconque « monde de l’enfance », qui serait autonome, et insiste sur la nécessité de ne voir dans un enfant qu'un être humain en devenir. Rien de moins, certes, mais rien de plus.
Il y a bien du ridicule dans le seul fait d'avoir pensé qu'il fallait absolument que les instances internationales signassent une mirifique "Déclaration des Droits de l'Enfant". Tiens, mettez-y le nez ici, pour voir, et vous comprendrez pourquoi les Français ont rejeté la Constitution Européenne : il faut une formation juridique au moins de bac + 12 pour s'y retrouver, et rien que pour arriver jusqu'au bout.
Mais il est vrai que MONTAIGNE ignorait tout de ce qu’est un « marché », découpé en divers « segments » (5-9 ans, 9-12 ans, etc.), la consommation, et tous les objets qui se proposent en permanence d’irriguer notre besoin de bonheur, ce qui est de toute évidence un progrès incommensurable.
Voilà ce que je dis, moi.
Ce sera tout pour cette fois.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montaigne, littérature, essais de montaigne, librairie de montaigne, ivrognerie, relations parents enfants, jean-jacques rousseau, thérèse levasseur, assistance publique, élisabeth badinter, l'amour en plus, hannah arendt, la crise de la culture
dimanche, 13 mai 2012
ENCORE UNE LOUCHE DE MONTAIGNE
Allez, encore une petite louche de MONTAIGNE, du qu’on ne trouve pas dans le sacralisé « Lagarde et Michard ». Vous voulez que je vous dise ? Il faut être handicapé de la littérature pour être nostalgique de ça. Ça, qui vous apprenait ce qu’il faut savoir, et qui vous dégoûtait par avance de ce que, peut-être, vous auriez eu envie de découvrir.

Mais enfin, si c'est notre jeunesse, il y en a que la nostalgie remplit. Vous avez dit nostalgie ? Pas moi, en tout cas. Je ne me tourne pas vers le passé au motif qu'il figurerait le temps où j'étais heureux (quelle blague!), mais je vois le présent, et je pressens l'avenir, et je vois que tout ça n'est guère encourageant. Mais je m'interdis de désespérer les « générations montantes ». Je leur souhaite quand même bon courage. Et lucidité, si l'envie leur en prend.
Moi, j’ai eu la chance d’avoir un professeur d’exception en seconde, première et terminale, j’ai nommé PIERRE SAVINEL. Entre autres travaux d'érudition, il a traduit La Guerre des Juifs, de FLAVIUS JOSÈPHE (Editions de Minuit). Entre parenthèses, je ne comprends pas que les manuels de français, de deux choses l'une, expurgent les textes, ou alors les choisissent vierges de toute « impureté » (= sexe et pipi-caca).
Remarquez que l'esprit mal tourné de l'adolescent moyen est parfois en mesure d'ajouter du piment dans les plats les plus fades. Prenez, dans Lagarde et Michard XVIIIème, l'extrait intitulé « Poétique des ruines » (DIDEROT), c'est page 222, et lisez-le en ayant bien soin de remplacer le mot "ruines" par le mot "fesses", et vous verrez que la substitution ne manque ni de sel, ni de pertinence, comme nous l'avions réjouissamment testé à l'époque.
Expurgé ? Si vous prenez, dans Lagarde … 16ème siècle l’extrait de la bataille de l’abbaye de Seuillé (RABELAIS, Gargantua, 27), vous aurez bien les détails concernant l'amour des moines pour le vin (mais aussi leur lâcheté), mais aucun élève n’a jamais lu : « Si quelqu’un gravait [grimpait] en un arbre, pensant y être en sûreté, icellui de son bâton empalait par le fondement ».
« Empalait par le fondement, m’sieur, qu’est-ce que ça veut dire ? – Euh, … tout ce que je peux vous dire, c’est que ça doit faire assez mal ». Il faut savoir que le dit bâton est le manche qui sert à porter la croix aux processions (« long comme une lance, rond à plein poing et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées »), bâton dont le moine Frère Jean des Entommeures (= des Ravages) a fait une arme de destruction massive. En plus de les éveiller, ça enrichirait le vocabulaire des jeunes, ainsi que la polysémie du mot « fondement ».

"EUH... JE PEUX VOUS DIRE QUE ÇA DOIT FAIRE ASSEZ MAL"
Quant au choix des extraits, je ne dis pas, bien sûr, qu’il faut focaliser l’attention des adolescents sur le croustillant ou le scatologique, d’abord parce qu’il n’y en a pas partout, et loin de là. Mais les dits adolescents se feraient une idée moins solennelle, dévitalisée et scolaire de la littérature si l’on ne s’interdisait pas de jeter un œil sur, précisément, ce qui intéresse l’adolescence au premier chef.
Ils seraient peut-être plus nombreux à ouvrir des « classiques ». Tout se passe comme si les concepteurs de manuels étaient convaincus que la littérature était coupée de la vie, alors qu’elle en est une des émanations les plus authentiques (« les plus scientifiques », disait même le père JEAN CALLOUD, qui raffolait des chocolats de chez BONNAT). Tout se passe comme s’ils n’avaient pas compris ce qu’est la littérature, comme s’ils ne l’aimaient pas.
C’est vrai qu’une chape de pudeur semble s’être abattue sur l’expression du croustillant et du sale à partir du 17ème siècle. Voir pour cela, dans Carmen de MERIMEE, ce que recouvre la formule « et le reste », dans la bouche de Don José parlant de la femme qu’il aimait, formule qui saute à pieds joints sur les nombreux détails sur lesquels s'attardaient STENDHAL, MERIMEE ou FLAUBERT dans leur Correspondance. Et ce serait la même chose, si on lisait correctement RACINE ou DIDEROT. Croyez-vous que CORNEILLE ne savait pas ce qu’il disait, en écrivant : « Et le désir s’accroît quand l’effet se recule » ?
On me dira que c’est pour ça que ma prédilection va à Maître FRANÇOIS RABELAIS, à son jeu de mots sur « à Beaumont le Vicomte » (contrepèterie facile), à une recette de Panurge (« une manière bien nouvelle de bâtir les murailles de Paris », Pantagruel, 15), au lion qui ordonne au renard de remplir de mousse la « blessure » que la vieille vient de se faire entre les jambes (croit-il), et tout une pallerée de belles histoires. On me le dira, et j’en conviendrai. On me dira peut-être aussi que je ferais mieux de parler de RABELAIS, ce en quoi on aura tout à fait raison. C’est une très bonne idée. J’y songe. Promis, je vais m’y mettre.
En attendant cet heureux jour, contentons-nous, pour aujourd’hui, de quelques paragraphes rigolos et sympathiques tirés des Essais. Le premier est très gentil, et prouve que le cheval était inconnu en Amérique avant l’arrivée des Blancs.
Chapitre XLVIII : Des destriers.
Ces nouveaux peuples des Indes, quand les Espagnols y arrivèrent, estimèrent, tant des hommes que des chevaux, que ce fussent ou Dieux ou animaux, en noblesse au-dessus de leur nature. Aucuns, après avoir été vaincus, venant demander paix et pardon aux hommes, et leur apporter de l’or et des viandes, ne faillirent d’en aller offrir autant aux chevaux, avec une toute pareille harangue à celle des hommes, prenant leurs hennissements pour langage de composition et de trêve.

N'EST-CE PAS, QUE C'EST BEAU ?
Le second est un peu plus « costaud ». Il paraît que les Américains « tamponnent », alors que les Français « essuient ». Je vous laisse juges.
Chapitre XLIX : Des coutumes anciennes. [Sur la volatilité des modes.]
Ils mangeaient comme nous le fruit à l’issue de table. Ils se torchaient le cul (il faut laisser aux femmes cette vaine superstition des paroles) avec une éponge ; voilà pourquoi SPONGIA est un mot obscène en Latin ; et était cette éponge attachée au bout d’un baston, comme témoigne l’histoire de celui qu’on menait pour être présenté aux bêtes devant le peuple, qui demanda congé d’aller à ses affaires [aux toilettes] ; et, n’ayant autre moyen de se tuer, il se fourra ce baston et éponge dans le gosier et s’en étouffa. Ils s’essuyaient le catze [le cul] de laine parfumée, quand ils en avaient fait : « At tibi nil faciam, sed lota mentula lana. »
Traduction du latin : « Je ne te ferai rien [mais pour te punir de ton insatiable avarice, quand j’aurai lavé mes mains] ma mentule (ma verge) t’ordonnera de la lécher », comme quoi d'anciens adolescents peuvent regretter de ne pas avoir fait assez de latin (j’ai restitué les derniers vers de l’épigramme de MARTIAL, qu’on a tort de ne pas faire lire, je vous assure que c’est excellent pour l’imagination).
Tiens, ça me fait penser à cette stèle qu’on peut voir au Musée Gallo-Romain de Lyon, au dos de laquelle figure ce graffiti gravé (en latin, évidemment) : « Je ne baise pas, j’encule ». C’était le très discret, assez petit et très charmant, très classique, mais très correct et sûrement très chaste Monsieur AUDIN qui me l’avait fait découvrir. Il m’avait surpris, le brave homme. Comme quoi le graveleux n’est pas forcément incompatible avec la pruderie qu’une vaine apparence a posée sur le visage.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, montaigne, essais, lagarde et michard, nostalgie, pierre savinel, la guerre des juifs, flavius josèphe, éditions de minuit, sexe, pipi-caca, diderot, rabelais, gargantua, frère jean des entommeures, moines, adolescence, jean calloud, carmen, mérimée, stendhal, flaubert, racine, corneille, françois rabelais, essais de montaigne
lundi, 30 avril 2012
MONTAIGNE, ON S'EN PAIE UNE TRANCHE ?
Aujourd'hui, comme promis, ce sera du juteux, du qu'on n'étudie pas au lycée, ça c'est sûr, même que c'est bien dommage, non plus que le chapitre 26 du Tiers Livre de RABELAIS, qui fait un tour exhaustif de toutes les sortes de « couillons », liste qui se termine par « couillon hacquebutant, couillon culletant ». Mais il est entendu que RABELAIS est beaucoup plus porté sur la chose que MONTAIGNE, comme on va le voir.
Les Essais de MONTAIGNE sont composés de trois livres. Je ne vais pas vous embêter avec des considérations lourdes et pontifiantes. Juste ceci : le Livre I comporte 57 chapitres (environ 300 pages type Pléiade), le Livre II, 37 (450 pages) et le Livre III, 13 (330 pages). Comme si la pompe avait mis du temps à s’amorcer : des petites notes pour commencer, de vrais petits livres pour finir. C’est progressivement qu’il s’est pris au jeu.
Aujourd’hui, juste quelques paragraphes rigolos, sur la femme, le genre d’animal qu’elle est, et ce qu’elle doit être dans le mariage. On ne trouve évidemment pas ce genre d’extraits, non plus, dans le Lagarde et Michard. C’est bête, parce que je suis sûr que ça encouragerait les adolescents à lire MONTAIGNE.
Rien que pour l’idée rassurante qui leur dirait que les idées qui leur viennent quand ils regardent les filles, non seulement sont normales, mais que les filles et les femmes, pour ce qui est du désir et de la connaissance des choses de l’amour, les battent à plate couture. Parce que c’est vrai qu’un garçon, jusqu’à un âge, ce n’est, sur ce plan, qu’un gros niais. Et il y a fort à parier que le verbe « déniaiser » a été inventé pour les garçons. Enfin pas que.
Livre I, Chapitre XXX : De la moderation [l’auteur parle des relations entre le mari et la femme].
Je veux donc, de leur part, apprendre ceci aux maris, s’il s’en trouve encore qui y soient trop acharnés ; c’est que les plaisirs mêmes qu’ils ont à l’accointance de leurs femmes, sont réprouvés, si la modération n’y est observée ; et qu’il y a de quoi faillir en licence et débordement, comme en un sujet illégitime. Ces enchériments deshontés que la chaleur première nous suggère en ce jeu, sont, non seulement indécemment, mais dommageablement employés envers nos femmes. Qu’elles apprennent l’impudence au moins d’une autre main. Elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m’y suis servi que de l’instruction naturelle et simple.
Mai 1968, avec son « Jouir sans entraves », n’est pas encore passé par là. On a compris : madame MONTAIGNE se contentait de ce que MICHEL EYQUEM lui donnait. Et il lui donnait peu. « Qu’elles apprennent l’impudence d’une autre main ». C’est une question qui le tarabuste, parce qu’il y revient plus tard.
Livre III, Chapitre V : Sur des vers de Virgile. [Où il est un peu question des vers de Virgile, mais aussi et surtout d’autre chose.]
Pour MONTAIGNE, le mariage doit découler de la raison et non du désir personnel, surtout du désir amoureux. Il est pour les mariages décidés en dehors des personnes, parce que c’est d’abord une convention sociale.Il n’est pas question de se laisser aller au plaisir conjugal : « Une femme honnête n’a pas de plaisir », dit la chanson de JEAN FERRAT. Enfin, on parle ici d’il y a 450 ans, il ne faut pas l’oublier.
Aussi est-ce une espèce d’inceste d’aller employer à ce parentage vénérable et sacré les efforts et les extravagances de la licence amoureuse, comme il me semble avoir dit ailleurs (voir ci-dessus). Autrement dit, le mariage est chose trop noble pour y mêler le plaisir.
L’intéressant vient : Il faut, dit Aristote, toucher sa femme prudemment et sévèrement, de peur qu’en la chatouillant trop lascivement le plaisir la fasse sortir hors des gonds de raison. Ce qu’il dit pour la conscience, les médecins le disent pour la santé : qu’un plaisir excessivement chaud, voluptueux et assidu altère la semence et empêche la conception ; disent d’autre part, qu’à une congression [coït] languissante, comme celle là est de sa nature, pour la remplir d’une juste et fertile chaleur, il s’y faut présenter rarement et à notables intervalles, [« afin qu’elle saisisse avec avidité les dons de Vénus et qu’elle les cache plus profondément » c'est en latin] (Virgile, Géorgiques). Je ne vois point de mariages qui faillent plutôt et se troublent que ceux qui s’acheminent par la beauté et désirs amoureux. Il y faut des fondements plus solides et plus constants, et y marcher d’aguet ; cette bouillante allégresse n’y vaut rien.
On a compris. D’ailleurs il dit quelque part qu’il « s’accointe » avec sa femme juste avant de sombrer dans le sommeil, le soir. On ne peut pas dire que ça rigolait. Comme homme, MONTAIGNE devait être passablement ennuyeux. Il pose même la question : combien de fois par jour ? La reine d’Aragon, dit-il, préconise six « rapports » par jour, mais le grand législateur grec de l’antiquité parle de trois par mois. On devine où va la préférence de MONTAIGNE.
Quel mauvais ménage a fait Jupiter avec sa femme qu’il avait premièrement pratiquée et jouie par amourettes ? C’est ce qu’on dit : Chier dans le panier pour après le mettre sur sa teste.
Pour lui, c’est certain, la femme est par nature un animal lubrique. Et ça commence très tôt, chez les fillettes et jeunes filles. Tiens, toujours dans le même chapitre :
Nous les dressons des l’enfance aux entremises de l’amour : leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu’à ce but. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre chose que le visage de l’amour, ne fût qu’en le leur représentant continuellement que pour les en dégoûter.
Autrement dit, les filles ne pensent qu’à ça. Le péché d’Eve n’est pas loin. Vient alors une anecdote.
Ma fille (c’est tout ce que j’ay d’enfant) est en l’âge auquel les lois excusent les plus échauffées de se marier ; elle est d’une complexion tardive, mince et molle, et a été par sa mère élevée de même d’une forme retirée et particulière : si qu’elle ne commence encore qu’à se déniaiser de la naïveté de l’enfance. Elle lisait un livre français devant moi. Le mot de « fouteau » s’y rencontra, nom d’un arbre connu [hêtre] ; la femme qu’elle a pour sa conduite, l’arrêta tout court un peu rudement, et la fit passer par-dessus ce mauvais pas. (…) Mais, si je ne me trompe, le commerce de vingt laquais n’eût su imprimer en sa fantaisie, de six mois, l’intelligence et usage et toutes les conséquences du son de ces syllabes scelerées [scélérates], comme fit cette bonne vieille par sa réprimande et interdiction.
Et ce passage, alors ? Mon oreille se rencontra un jour en lieu où elle pouvait dérober aucun des discours faits entre elles sans soupçon : que ne puis-je le dire ? Nostredame ! (fis-je) allons à cette heure étudier des phrases d’Amadis et des registres de Boccace [auteur de contes « libres »] et de l’Arétin [auteur d'oeuvres érotiques] pour faire les habiles. Il n’est ni parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres : c’est une discipline qui naît dans leurs veines, [« et Vénus elle-même les a inspirées », Virgile], que ces bons maîtres d’école, nature, jeunesse et santé, leur soufflent continuellement dans l’âme ; elles n’ont que faire de l’apprendre, elles l’engendrent.
« Une discipline qui naît dans leurs veines », parfaitement. Enfer et damnation, j’aurais dû m’en douter. C’était donc ça. Les filles savent tout. Les garçons sont des niais. Et ce n’est pas la mixité qui a changé les choses, puisqu’elle les a aggravées.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, montaigne, rabelais, tiers livre, essais de montaigne, lagarde et michard, de la modération, jean ferrat, sexe, plaisir, devoir conjugal, femme
samedi, 28 avril 2012
MONTAIGNE ? UNE PREMIERE TRANCHE
MONTAIGNE – ESSAIS LIVRE I – Chapitre XXVI : De l’institution des enfans.
Bon, comme c’était promis, je suis bien obligé de tenir parole. MONTAIGNE, en voici la première tranche. Comme c’est une viande assez dense, il faut y aller à petite dose. Et puis, l’assaisonner. Aujourd’hui, vous aurez droit à un assaisonnement « spécial école France 21ème siècle ».
Si ce disciple se rencontre de si diverse condition, qu’il aime mieux ouyr une fable que la narration d’un beau voyage ou un sage propos quand il l’entendra ; qui, au son d’un tabourin qui arme la jeune ardeur de ses compagnons, se détourne à un autre qui l’appelle au jeu des batteleurs ; qui, par souhait, ne trouve plus plaisant et plus doux revenir poudreux et victorieux d’un combat, que de la paume ou du bal avec le pris de cet exercice : je n’y trouve autre remede, sinon que de bonne heure son gouverneur l’estrangle, s’il est sans tesmoins, ou qu’on le mette patissier dans quelque bonne ville, fust-il fils d’un duc, suivant le precepte de Platon qu’il faut colloquer les enfans non selon les facultez de leur pere, mais selon les facultez de leur ame.
Là, j’ai laissé l’orthographe telle quelle. En gros et pour résumer, MONTAIGNE propose d'abandonner le cancre à son sort : si, en toute chose, il préfère l'amusement aux choses sérieuses, qu'il aille au diable.

LA TOUR OÙ MONTAIGNE AVAIT SA "LIBRAIRIE"
J’aime beaucoup ce passage méconnu, que j’ai déjà cité ici (ce n’est pas dans Lagarde et Michard qu’on le trouverait). MONTAIGNE y va très fort, qui déclare sans sourciller que l’élève rétif à tout enseignement est un bon à rien, que le cancre absolu n’a rien à faire à l’école et qu’il serait absurde de faire quelque effort que ce soit pour lui apprendre quoi que ce soit. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Il n’y a plus qu’à tirer l’échelle.
Espérons qu’« étrangle » est une boutade (l'auteur est prudent : "s'il est sans témoin" est délicieux). Quant au « pâtissier », MONTAIGNE ne pouvait certes prévoir que s’il nous fallait aujourd’hui orienter vers la profession tous les élèves incivilisables, il faudrait instaurer un « ordre des pâtissiers », chargé de faire respecter un strict « numerus clausus », sous peine d’avalanche pâtissière.
Jetons à présent un œil sur le paysage éducatif actuel, et sentons ce qu’il nous reste de cheveux se dresser sur nos têtes. Que voyons-nous ? Que penserait MONTAIGNE de ce qu'est devenue l'instruction publique ? Autrement posé : combien d'élèves actuels faudrait-il étrangler ?
Un système où – je crois que c’est LIONEL JOSPIN qui avait popularisé la formule – l’élève « est au centre du système », où l’on parle de « communauté éducative », où les enseignants sont sommés de « prendre en compte le projet de l’élève », où ils sont sommés de plaire à leur classe, où le cours commence par une négociation qui consiste à obtenir de la classe, d’une part le silence, d’autre part l’autorisation de lui faire cours, si elle le veut bien.
Où l’élève qui lance une craie sur l’enseignante et celui qui en traite une autre de « pute » peuvent attendre tranquillement que le conseil de discipline se réunisse, dans six mois, peut-être pour prendre éventuellement, après avis de toute la « communauté éducative », une sanction, assortie du sursis pour commencer.
Bref, appelons tout ça, si vous le voulez bien, « le voyage dans la lune ».
Et si l’on compare la façon dont un cours se passe dans les systèmes éducatifs européens à ce qu’on voit, par exemple, au Congo Brazzaville, en Chine ou au Japon (selon des témoignages directs), non seulement on comprend, mais on explique aussi de façon lumineuse pourquoi l’enseignement français fait lentement et inexorablement naufrage.
La France oublie, ce faisant, qu’elle a dû sa relative primauté parmi les nations, entre autres, à l’ambition éducative démesurée qu’elle a manifestée à travers les lois sur l’instruction obligatoire (1881-1882). Mais nul n'arrive à la cheville des réformateurs de tout poil pour ce qui est d'emballer et d'enrober le dit naufrage dans la rutilance somptueuse de discours sur les missions sacrées de l'école. Ah, pour ce qui est de l'enrobage dans le sucre des discours, ils sont forts. Tiens, un exemple. Vous savez comment, dans ce langage, il faut appeler un cancre ? « Un apprenant à apprentissage différé ». Je vous laisse savourer cette trouvaille extraordinaire.
Je ne vois pour eux qu'une issue : LE PAL.

On aura beau me bistourner dans tous les sens les boyaux de la tête, personne n’arrivera à me convaincre que l’élève est à l’école pour faire autre chose qu’apprendre (voir le chapitre « la crise de l’éducation » dans La Crise de la culture, d’HANNAH ARENDT, je vous épargne la digression, mais vous avez compris l'esprit). Qu'il soit souhaitable que le jeune s'épanouisse, rien de plus vrai, mais que cela doive se passer au sein de l'école, dans le cadre même de l'instruction publique, rien de plus scandaleusement faux.
Les philosophes « déconstructionnistes » auront beau déconstruire le principe d’autorité, sans lequel il n'est pas d'éducation possible ou envisageable, le juger historiquement arbitraire, psychologiquement abusif, sociologiquement intolérable … « et moralement indéfendable » (Le Tour de Gaule d’Astérix, p. 21, citons nos sources), ils n’empêcheront pas l’autorité, une fois qu’elle aura été définitivement mise hors d’état de nuire au sein de l’école, de régner plus despotiquement, plus tyranniquement à l’extérieur, dans la société, partout. Une fois sorti de l'enceinte scolaire, le jeune aura à faire face à la tyrannie du « principe de réalité », et il est facile de prédire que le contact sera rude.
En France, les gouvernements successifs, toutes tendances confondues, ont sciemment instrumentalisé les doctrines égalitaristes d’idéologues fanatiques (l’élève est l’égal du maître, d’ailleurs, il n’y a plus de « maîtres », l'élève doit construire lui-même son propre « parcours d’apprentissage », et autres « fariboles sidérales » (excellent et méconnu album de BD d'ALIAS, alias CLAUDE LACROIX) et sidérantes, comme « il faut apprendre à apprendre », il faut donner la priorité aux méthodes sur les contenus, etc.).
Et puis surtout, depuis 1975 en particulier, les gouvernements n’ont pas cessé de réformer, de réformer la réforme précédente, de réformer au carré et de réformer au cube, au point qu’aujourd’hui, plus personne ne sait par quel bout prendre l'animal monstrueux qu'est devenu le système éducatif français. Et certains vertueux font mine de s’étonner que le classement de la France (puisqu’on raffole des classements) régresse d’année en année, au plan international.
La RGPP (alias Révision Générale des Politiques Publiques, euphémisme alambiqué, masque et faux nez de la hache chargée de tailler en pièces ce qui s'appelait la Fonction Publique d'Etat, police, armée, enseignement, etc.) de NICOLAS SARKOZY (60.000 postes non renouvelés après départ en retraite depuis 2007) n’est pas négligeable, dans le processus, mais elle n’est que la dernière paire de banderilles allègrement plantée dans l’animal monstrueux gravement blessé, qui se démène de plus en plus faiblement face à ses multiples matadors, et qui avait pour nom « Instruction Publique ». « Requiescat in pace ».
Quoi ? Mais oui, je le sais, que récriminer comme ça est totalement vain. En plus, ça fait ringard, réactionnaire, et tout et tout. Moi, je dis que c’est moins réactionnaire que conservateur. Au vrai sens du mot « conservateur », comme on est conservateur de bibliothèque, de musée, des eaux et forêts ou des hypothèques. Ça s’appelle : conserver pour éviter que l’essentiel ne meure.
Voilà ce que je dis, moi.
Vous avez aussi compris que MONTAIGNE n’était qu’un prétexte. Promis, demain, ce sera plus frivole.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montaigne, littérature, société, éducation, instruction publique, éducation nationale, lionel jospin, communauté éducative, la crise de la culture, hannah arendt, astérix, le tour de gaule d'astérix, rgpp, nicolas sarkozy
jeudi, 26 avril 2012
DU MONTAIGNE ? COMBIEN DE TRANCHES ?
Aujourd'hui, promis, on se rapproche de Montaigne, dont on va apercevoir une oreille à l'horizon.
Je ne suis pas encore atteint par le mal inventé par Alois Alzheimer. Je me souviens que lorsque quelqu’un que j’aime bien, sans avoir conscience de ce qu’elle faisait, m’a dit que la boîte en bois qui était au grenier, avec les vieux papiers de famille dont certains remontaient à trois siècles, eh bien cette boîte, elle l’avait jetée au feu, je suis devenu fou, pendant un bon moment, j’ai vu noir, tout noir.
C'est comme si un ours m'avait arraché brutalement un membre, comme dans Le Concile de pierre, de Jean-Christophe Grangé. Comme si j'avais été amputé par surprise, à peu près comme ce que nous avions tous ressenti lors du cambriolage de la maison. Comme si on jetait de vieilles photos de choses et de gens qui furent familiers.
Alors moi, pour me préparer à attaquer Montaigne, voilà comment je m’y suis pris : j’ai commencé par le Rabelais de la Pléiade, avec les notes en bas de page. Certes, les notes de bas de page ralentissent la lecture, mais l’éclairent de façon bien plus pratique que celles renvoyées en fin de volume. Je déconseille formellement les « traductions » en français moderne, qui dévitalisent, qui anesthésient tout ce qui fait la force et le « jus » de Maître Alcofribas.
Quoi qu’il en soit, je peux vous dire que ça décrasse, comme galop d’essai. Si vous aimez le délire verbal, je conseille la harangue de Maître Janotus de Bragmardo (Gargantua, 19), l’émissaire chargé de demander à Gargantua de rendre les cloches de Notre-Dame, qu'il a piquées pour en faire des sonnettes au cou de sa jument, après avoir noyé 260.418 Parisiens (« sans les femmes et petitz enfans ») sous les flots de son urine (ce passage n'est pas dans Lagarde et Michard, je peux vous l'assurer).
Mais je conseille aussi et surtout la plaidoirie de Baisecul et Humevesne (« kiss my ass » = baise mon cul, et « sniffer of farts » = renifleur de pets), ainsi, évidemment, que la réponse tout à fait à la hauteur que leur fait Pantagruel (Pantagruel, 11 à 13) : André Breton et autres surréalistes, en plus de se prendre au sérieux comme des pontifes, auraient mieux fait de se cacher, avec leur pseudo-invention de l’ « écriture automatique ». Tiens, en voici un petit exemple (allez, je modernise l’orthographe, c’est Humevesne qui parle) :
« Mais, à propos, passait entre les deux tropiques, six blancs vers le zénith et maille par autant que les monts Riphées, avaient eu cette année grande stérilité de happelourdes, moyennant une sédition de balivernes mue entre les Baragouins et les Accoursiers pour la rébellion des Suisses, qui s’étaient assemblés jusqu’au nombre de bons bies pour aller au gui l’an neuf le premier trou de l’an que l’on livre la soupe aux bœufs et la clef du charbon aux filles pour donner l’avoine aux chiens ».
Enfoncés, Les Champs magnétiques, de Breton et Soupault, ce b-a-ba de l’écriture automatique, sacralisé par quelques ignares et collectionneurs spéculants, enfantillage laborieux, infantilisme et puérilité auprès de la prouesse de Rabelais dans ces trois chapitres.
Je signale en passant que le Docteur Faustroll, inventeur de la 'Pataphysique (« Tout est dans Faustroll », disait le satrape Boris Vian), possède dans sa bibliothèque 27 ouvrages qu'il est convenu d'appeler « Livres pairs », et que Rabelais est le seul a avoir l'insigne honneur de figurer sous son seul nom, sans la limitation à un seul titre de ses oeuvres, qu'Alfred Jarry inflige aux 26 autres. C'est bien tout Rabelais qu'il faut lire.
Après Rabelais, j’ai mis le nez dans Béroalde de Verville et son Moyen de parvenir. C’est déjà une autre paire de manches. Mais Michel Renaud, qui a dû tomber dedans quand il était petit, en a donné une édition jouissive (et remarquablement lisible) dans la collection « folio ». On ne peut pas vraiment résumer ce bouquin, qui fait figure d’OLNI (Objet Littéraire Non Identifié) dans la littérature française.
Disons que, de cette immense conversation désordonnée, qui se déroule autour d'une table plantureuse, lourdement garnie de plats et de dives bouteilles, je retiens le profond réservoir d'anecdotes truculentes, principalement sexuelles et scatologiques, et la guirlande des propos irrévérencieux à l’égard de toutes les autorités.
Je suis alors passé à Histoire d’un voyage en terre de Brésil, de Jean de Léry (au Livre de Poche). Ce calviniste grand teint raconte son équipée maritime jusque chez les Toupinambaoults, qui font, entre autres joyeusetés, cuire les morceaux de leurs ennemis sur leurs « boucans » (cf. boucanier). Il faut lire les propos du prisonnier qui sait qu'il va y passer et qui défie ses futurs bourreaux en se vantant de leur donner bientôt à manger la chair même de leurs propres parents, qu'il s'est, après une précédente bataille, fait un plaisir de dévorer.
« Vous les trouveriez couverts [les boucans] tant de cuisses, bras, jambes que autres grosses pièces de chair humaine des prisonniers de guerre qu’ils tuent et mangent ordinairement ».
Là on commence à pouvoir s’aventurer sur la haute mer de la vieille langue française. On est fin prêt. On peut attaquer la montagne de Montaigne (au fait, vous avez remarqué que lorsque Marcel Proust décrit la mer, il s’acharne, d’un bout à l’autre de La Recherche, à en faire un paysage de montagne ?).
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, montaigne, france, alzheimer, le concile de pierre, jean-christophe grangé, rabelais, alcofribas nasier, gargantua, pantagruel, janotus de bragmardo, lagarde et michard, andré breton, philippe soupault, docteur faustroll, alfred jarry, pataphysique, boris vian, béroalde de verville, le moyen de parvenir, michel renaud, histoire d'un votage en terre de brésil, jean de léry, cannibales, marcel proust
mercredi, 25 avril 2012
DU MONTAIGNE ? COMBIEN DE TRANCHES ?
Oui, j'en étais à la difficulté culturelle que représente aujourd'hui la syntaxe d'un auteur vieux de bientôt cinq siècles : MONTAIGNE. Une syntaxe riche, complexe et fleurie qui nous rend sa lecture difficile d'accès, à nous dont les phrases sont devenues tellement sèches, plates et pauvres. Notre époque semble donc éprouver de la haine pour la complexité.
Bon, autant vous prévenir, MONTAIGNE viendra, mais pas tout de suite. En attendant, voici au moins sa photo, prise autour de 1577.

Plus le réel échappe à notre emprise, je veux dire à notre emprise à nous autres, individus, plus notre langue s’appauvrit, plus nos phrases s’étiolent et cèdent à la marcescence qui accompagne la fleur dans sa procession du matin jusqu’au soir (vous savez, « la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil », même que ça commence par « Mignonne allons voir si »). Sauf que notre langue, ce n’est pas une fleur.
Et puis, si un individu ne peut plus grand-chose sur le monde qui l’entoure, il faut dire aussi que nous nous sommes laissés gagner par l’impression, peut-être la certitude que nous sommes de moins en moins des individus. Trop d’individus tue l’individu, en quelque sorte. J'ajoute que trop d'objets et trop de marchandises, ça vide aussi l'individu de sa substance. Comment voulez-vous, dans ces conditions, entrer dans MONTAIGNE, lui qui représente l’essence même, que dis-je : l’âge d’or de l’individu ?
Ce décharnement, qui donne leur épouvantable aspect étique de grandes filles anorexiques, voire cachectiques, aux phrases qui sortent de nos bouches, de nos plumes ou de nos pouces (eh oui !), certains l’attribuent à tous ces menus objets, devenus des prothèses de nos corps, que l’on dit porteurs de la crème des progrès techniques : le texto, le SMS, le tweet feraient selon eux subir une terrible cure d’amaigrissement à la syntaxe disponible dans les cerveaux actuels, dans l’état où les a laissés Monsieur PATRICK LE LAY, de TF1. C’est possible.
Je me demande quant à moi si la raison de cet appauvrissement n’est pas à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus inquiétante, pour ne pas dire tragique. Si on ne fait plus de la syntaxe à la petite scie d’artiste, de la phrase complexe au burin subtil de graveur, c’est peut-être qu’on n’a plus grand-chose à y mettre, dans la syntaxe. Pour articuler des idées au sein d’une phrase un tant soit peu complexe, encore faut-il en avoir, des idées.
Quand la matière du contenu du pot a séché, fût-elle fécale, elle devient dure et cassante, et tout à fait impropre à s’incurver dans les méandres sinueux d’un flux verbal (il fut un temps où l’on disait « raisonnement ») tant soit peu élaboré (je ne dis même pas « raffiné », notez bien). Quelque chose qui ressemble à du vivant qui sait vivre, quoi.
Ce qui découle de tout ça, c’est que notre passé nous devient étranger. Nous perdons la mémoire. Et je ne parle pas de l’orthographe (adjectifs de couleur, mots composés, consonnes doubles, etc.) ou de l’accord du participe passé. Je parle de la syntaxe. La syntaxe, qu'on se le dise, met de l’ordre dans la pensée, parce qu’elle met de l’ordre dans les phrases.
Nous sommes en mesure, à l’ère du numérique, d’archiver et de dater à la seconde près le moindre pet de notre pensée, ou de traquer une fourmi dans sa fourmilière, nous sommes matériellement capables de mémoriser tout ce qui arrive, et nous perdons notre langue, qui est tout simplement l’âme, la mémoire et le socle de notre civilisation.
De même que le christianisme fut, selon MARCEL GAUCHET (Le Désenchantement du monde, 1985), « la religion de sortie de la religion », dira-t-on que notre civilisation est celle de la sortie de la civilisation ?
N’y a-t-il pas quelque chose de symbolique dans le succès mondial grandissant remporté depuis vingt ans par la maladie d’Alzheimer, qui « vide » la personne de sa personne ? Car cette maladie de civilisation n'est pas une maladie de la mémoire, c'est une maladie de la personne. C'est autrement plus grave. Plus central. Plus terrible.
Les « maladies de civilisation » ne sont pas très nombreuses : il y eut le « tabès dorsalis » à partir du 16ème siècle. Tout le monde a reconnu le « mal français », ou « napolitain », dû à l’infection par le « tréponème pâle », autrement dit la syphilis, ou « grosse vérole » (par opposition à la « petite », celle qui touche Madame de Merteuil à la fin des Liaisons dangereuses, autrement dit la variole).
Le 19ème siècle fut celui de la tuberculose (voir SUSAN SONTAG, La Maladie comme métaphore (1978)). Le 20ème a vu émerger, croître et embellir le cancer. Sur la fin, il a produit le sida. N’oublions pas le nombre des cas d’autisme, qui a été multiplié par 17 en cinquante ans. Il n’y a donc aucune raison pour dénier à la maladie d’Alzheimer le droit de se développer massivement.

IL A L'AIR CONTENT, LE DOCTEUR
ALOIS ALZHEIMER,
D'AVOIR INVENTE UNE SACREE MALADIE
L’affaire est en marche : la France compte à peu près 900.000 malades (dont certain, illustre, occupe gracieusement un appartement de la famille HARIRI, 3 quai Voltaire, à Paris). Une telle adhésion au processus d'enrichissement pathologique ne saurait être considérée autrement que comme un encouragement pour l’avenir. La maladie d’Alzheimer est bien partie pour réaliser la promesse du chant, bien connu sous le titre de L’Internationale : « Du passé faisons table rase ». Comme on dit en Espagne : « Alegria ! Alegria ! ».
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, montaigne, politique, syntaxe, langue française, ronsard, mignonne allons voir si la rose, individu, patrick le lay, temps de cerveau disponible, marcel gauchet, le désenchantement du monde, alzheimer, vérole, syphilis, les liaisons dangereuses, choderlos de laclos, tuberculose, cancer, sida, autisme, rafic hariri, jacques chirac, l'internationale, du passé faisons table rase
mardi, 24 avril 2012
DU MONTAIGNE ? COMBIEN DE TRANCHES ?
Je préviens tout de suite, MONTAIGNE, ça va venir, mais pas tout de suite. Patience et longueur de temps, comme on dit.
Bon, je ne vais pas la ramener et faire le fier, car il n’y a pas de quoi, mais un jour, j’ai hardiment décidé de me colleter avec les Essais de MONTAIGNE. Je ne dirai pas que c’est un Everest. Je dirai plutôt que c’est une île, voire un archipel situé à quelque distance du continent, et que pour faire la traversée, il faut accepter de se mettre à l’eau et de faire le voyage. Et il se trouve qu’un jour, j’ai décidé de m’embarquer pour de bon.
Ce n’est pas un Everest, parce que pour l’Everest, les choses sérieuses commencent à 6000 mètres. Bien trop haut pour MONTAIGNE, qui n’aime guère quitter le plancher des vaches, si ce n’est pour monter à cheval. Ne parlons pas d’archipel. Je comparerais plutôt les Essais avec la carcasse du bœuf de boucherie : il y a les morceaux nobles : filet, aloyau, rumsteack, …, et les morceaux ignobles (désolé, c’est le contraire de noble ; bon, disons : « moins nobles » pour les amateurs d’euphémisme) : plat de côte, paleron, jarret …

Chez MONTAIGNE, on va dire qu’il y en a pour tous les goûts, qu’il y a à boire et à manger, qu’il y a les pleins et les déliés, les hauts et les bas, les jours avec et les jours sans. Il y a les essais tout petits, et puis il y a les essentiels. Et puis il y a l’éléphantesque chapitre 12 du Livre II, faussement intitulé « Apologie de Raimond Sebond » (174 pages à lui tout seul, en Pléiade).
En fait, c’est une très longue visite de ce qui, sur terre, tend à prouver que tout est relatif, à commencer par l’homme, comparé aux animaux, dont les performances, réelles ou fantasmées, y sont longuement vantées. Cette variété est d’autant plus délicate à saisir que mon essentiel à moi ne sera pas forcément celui de mon voisin. Il y a les petites choses, et puis il y a les grandes.
Et puis je vais vous dire autre chose : il y a les bondieuseries de passages obligés, les extraits « lagardémichardisés », « les cannibales », « de l’institution des enfants », « des coches ». La « tête plutôt bien faite que bien pleine » (je signale d’ailleurs que la phrase continue par « et qu’on y requît tous les deux », contrairement à ce que le lycéen moyen a d’habitude enregistré). Ça, c’est, en quelque sorte, le MONTAIGNE congelé, et réchauffé au four à micro-ondes.
« Des coches », parlons-en. Monsieur GENDROT (des manuels GENDROT et EUSTACHE) m’avait collé l’explication de texte. Je n’y avais strictement rien compris. Mais rien entravé, que dalle, que pouic. Et pour cause : le chapitre en question parle de tout sauf des « coches », mais ça, je l’ai su bien après. Les ai-je maudits, ces « coches » ! Pourtant, j’avais l’impression d’être normal, je vous jure.
Et puis ne nous voilons pas la face : il y a la langue, la grammaire, l’orthographe. Oh, MONTAIGNE ne s’affolait pas du tout, pour l’orthographe. Il ne s’embêtait pas, quand il voulait écrire « à cette heure », ça donnait « asteure », voire « asture ». Même VOLTAIRE, 200 ans après, écrivait le même mot différemment à quelques pages de distance. Reste que la langue du 16ème siècle, si on ne peut pas dire que c’est de l’ancien français (« Ha, Galaad, este vo ce ? – Sire ce sui je » ou « Au departir, andui son mornes », ça, c'est du 12ème siècle), ça reste ardu.
D’autant qu’il y a aussi les phrases. Important, les phrases. Contournées, ondulantes, sinusoïdales. Et il faut bien reconnaître que ça réclame un entraînement, une habitude. Quand on en manque, il se peut qu’arrivé au bout d’une, il faille revenir au début. La raison en est horriblement simple : c’est que nos phrases à nous, de nos jours d’aujourd’hui, sont désespérément simples, d’une platitude effrayante, d’une petitesse abyssale. Nos phrases privilégient le segment de droite, et le plus court possible, voire le point.
L’onomatopée, l’apocope font régner leur terreur : il faut élaguer, raccourcir, on vous dit. Pas de longueur : 140 signes au maximum. Pourquoi croyez-vous que les jeunes ne lisent plus les romans de BALZAC ? Des longueurs, on vous dit. Dès qu’on ajoute à la proposition principale une subordonnée relative, ça commence à s’agiter nerveusement dans les rangs. Quand on entre dans les complétives et les circonstancielles, on ne peut plus compter sur personne. Alors je ne vous dis pas la panique d’horreur d’affolement quand une participiale pointe une oreille. Et je n’ai même pas abordé le subjonctif imparfait.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, langue, montaigne, les essais de montaigne, éverest, apologie de raimond sebond, langue française, france, culture générale, orthographe, voltaire, ancien français, balzac, onomatopée, apocope, syntaxe, grammaire
samedi, 26 novembre 2011
MONTAIGNE DERRIERE MONTAIGNE
MONTAIGNE CACHÉ DERRIERE MONTAIGNE
On peut le regretter, mais c’est une vérité : Les Essais sont un livre très difficile d’accès pour des gens vivant au 21ème siècle. J’adore pourtant cette langue baroque, avec une syntaxe plus souple qu’un vieil adepte du yoga, et une liberté incroyable dans les trajectoires de phrases et même dans l’orthographe.
Petit exemple de liberté : quand il écrit « à cette heure », c’est tout simplement « asture ». La pensée sinue comme un chemin de montagne et, aussi sûr et infaillible que lui, arrive à son but. J’ai lu ce monument il n’y a pas si longtemps. Ce fut avec immense plaisir, je le dis nettement, même si certains trouveront que c’est un peu tardif.
Et pourtant MICHEL DE MONTAIGNE est un homme moyennement sympathique. Je dis cette énormité sur la seule base de ce que je peux savoir : Les Essais. D’un autre côté, si je peux proférer un tel sacrilège, c’est que l’auteur m’a procuré quelques éléments qui me permettent de forger un jugement. Je délaisse donc le jugement, et je remercie l’auteur pour les éléments.
Je préviens tout de suite : pas question de jouer les LAGARDE & MICHARD, nous sommes bien d’accord ? Je me suis quant à moi assez emmerdé pendant les cours du très estimable monsieur GENDROT (oui, celui des manuels bien oubliés GENDROT & EUSTACHE), qui m’avait collé une explication de l’extrait intitulé « Des coches » (Essais, III, 6).
Ce fut un naufrage, évidemment. Je n’avais rien compris au texte. Il faut dire que le chapitre n’aborde qu’incidemment le sujet donné par le titre, et fait principalement l’éloge des Indiens d’Amérique, en l’assaisonnant d’une diatribe contre les Conquistadors. J’ajouterai même que c’est systématique dans Les Essais : le contenu du chapitre a souvent un rapport tout à fait lâche et lointain avec le titre qui l’introduit.
Je signale qu’on y trouve aussi ce merveilleux passage (en orthographe moderne) : « Me demandez-vous d’où vient cette coutume de bénir ceux qui éternuent ? Nous produisons trois sortes de vent : celui qui sort par en bas est trop sale ; celui qui sort par la bouche porte quelque reproche de gourmandise ; le troisième est l’éternuement ; et, parce qu’il vient de la tête et est sans blâme, nous lui faisons cet honnête accueil ». Pourquoi ne le trouve-t-on pas dans LAGARDE & MICHARD ?
Ailleurs, il signale diverses choses qu’il ne peut accomplir que dans certaines conditions. Qu’on se le dise, MONTAIGNE ne peut « faire des enfants qu’avant le sommeil, ni les faire debout ». Il mange en n’utilisant guère de cuillère et fourchette. « Et les Rois et les philosophes fientent, et les dames aussi. »
Mais il veille quand même à délivrer une image favorable de sa personne, fût-ce à travers la crudité de certains détails : « On te voit suer d’ahan, pâlir, rougir, trembler, vomir jusqu’au sang, souffrir des contractions et convulsions étranges, dégoutter parfois de grosses larmes des yeux, rendre les urines épaisses, noires et effroyables, ou les avoir arrêtées par quelque pierre épineuse et hérissée qui te point et écorche cruellement le col de la verge, tout en t’entretenant avec les assistants d’une contenance commune (…) ». Oui, il avait des calculs rénaux.
Sur l’éducation des garçons récalcitrants, MONTAIGNE n’y va pas par quatre chemins. J’ai déjà cité, il y a longtemps, ce passage, mais je ne résiste pas au plaisir : en présence d’un élève qui ne veut rien savoir et préfère le bal à la bataille : « Je n’y trouve d’autre remède, sinon que de bonne heure son professeur l’étrangle, s’il est sans témoins, ou qu’on le mette pâtissier dans quelque bonne ville, fût-il fils d’un duc (…) » (Essais, I, 26). On ne se demande pas pourquoi ce n’est pas dans le LAGARDE & MICHARD.
MONTAIGNE, le sexe, les femmes.
C’est évidemment (!!!) dans le chapitre « sur des vers de VIRGILE » (Essais, III, 5) que l’on trouve des considérations sur les femmes et le sexe, mais aussi sur le mariage, qui ne manquent ni de bon sens, ni d’une furieuse modernité, ni d’un aspect croquignolet, à l’occasion. En gros, il ne comprend pas pourquoi les appétits féminins sont réprimés, alors que les hommes se permettent ce qu’ils veulent.
Je simplifie le raisonnement : « Il n’est passion plus pressante que le sexe, à laquelle nous voulons qu’elles résistent seules, non simplement comme à un vice de sa mesure, mais comme à l’abomination et exécration (…). Ceux d’entre nous qui ont essayé d’en venir à bout ont assez avoué combien c’était impossible, usant de remèdes matériels pour mater, affaiblir et refroidir le corps. Nous, au contraire, les voulons saines, vigoureuses (…), et chastes ensemble, c’est-à-dire à la fois chaudes et froides ». N’est-ce pas tout à fait équilibré ?
Quant aux filles, elles naissent et grandissent avec « ça » dans le sang : « Nous les dressons dès l’enfance aux entremises de l’amour : leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu’à ce but ». Il raconte que sa fille lisant à haute voix, prononça le mot « fouteau » (hêtre), aussitôt interrompue par la gouvernante, d’où il conclut que le mot est définitivement gravé dans l’esprit de la fillette, avec le sens redouté, précisément, par la gouvernante.
Il écoute un jour, fortuitement, une conversations « entre filles » qui se croient seules : « Notre-Dame ! Allons à cette heure étudier (…) BOCCACE et L’ARÉTIN [livres coquins] pour faire les habiles. Il n’est ni parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres : c’est une discipline qui naît dans leurs veines, que ces bons maîtres d’école, nature, jeunesse et santé leur soufflent continuellement dans l’âme ; elles n’ont que faire de l’apprendre, puisqu’elles l’engendrent ». Autrement dit : la femme comme le foyer de la concupiscence et comme la séductrice par essence. Eve et la pomme ne sont pas loin.
Il adhère au reproche fait au philosophe POLEMON, que sa femme traîna en justice parce qu’il se masturbait (« en un champ stérile ») plutôt que d’accorder son « fruit au champ génital ». Toujours sur les hommes, les femmes et le sexe, une petite chose délicieuse : « Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie qu’un pucelage ; le vœu de la virginité est le plus noble de tous les vœux, étant le plus âpre ».
« Les Dieux, dit PLATON, nous ont fourni d’un membre [viril] désobéissant et tyrannique qui, comme un animal furieux, entreprend par la violence de son appétit de soumettre tout à soi. De même aux femmes, un animal glouton et avide, auquel si on refuse aliment en sa saison, il devient forcené, impatient de délai et, soufflant sa rage en leur corps, obstrue les conduits, arrête la respiration, causant mille sortes de maux, jusqu’à ce que, ayant humé le fruit de la soif commune, il en ait largement arrosé et ensemencé le fond de leur matrice. »
C’est dans son chapitre « de l’ivrognerie » (II, 2) qu’il raconte l’anecdote dont se servira HEINRICH VON KLEIST pour sa nouvelle La Marquise d’O… : ayant perdu son mari longtemps avant, elle se retrouve enceinte. Quand la grossesse crève les yeux de tout le monde, elle fait annoncer à la messe qu’elle épousera le coupable s’il se dénonce. Son valet se dénonce, qui avait profité de l’occasion, car elle, « ayant bien largement pris son vin, était si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller ». Conclusion de MONTAIGNE : « Ils vivent encore mariés ensemble ».
Je ne me souviens plus du chapitre, je me demande si ce n’est pas dans Essais, II, 12 (« Apologie de RAYMOND SEBOND »), qu’on trouve, parmi bien des anecdotes marrantes sur ce qui différencie (ou non) les hommes des animaux, celle qui raconte l’histoire d’un éléphant (animal supposé éprouver des sentiments analogues à ceux des humains) qui, amoureux d’une femme, introduit un jour sa trompe dans le corsage de la belle, et se met à lui peloter les seins avec gentillesse, délicatesse et savoir-faire. Je précise que MONTAIGNE reproduit, à propos des animaux, d'innombrables légendes héritées de l'antiquité.
MONTAIGNE n’aime pas se sentir bousculé par la nouveauté. « Rien ne presse un Etat que l’innovation : le changement donne seul forme à l’injustice et à la tyrannie. »
Quand le pape décide d’instaurer le calendrier grégorien en 1582, il peste à sa manière : « Il y a deux ou trois ans qu’on raccourcit l’an de dix jours en France. Combien de changements devaient suivre cette réformation ! Ce fut proprement remuer le ciel et la terre à la fois. Ce néanmoins, il n’est rien qui bouge de sa place : mes voisins trouvent l’heure de leur semence, de leur récolte, l’opportunité de leurs négoces, les jours nuisibles et propices, au même point justement où ils les avaient assignés de tout temps. Ni l’erreur ne se sentait en notre usage, ni l’amélioration ne s’y sent » (chapitre « des boiteux », comme de juste, III, 11).
La nouveauté que constitue, relativement, l’arme à feu, le prend complètement en défaut : ce n’est visiblement pas sa planète, car il trouve que ces « nouveautés factices » sont là surtout pour faire du bruit et effrayer les effrayés, et ne leur attribue aucune efficacité.
C’est dans Essais, I, 48 : « Il est bien plus apparent de s’assurer d’une épée que nous tenons au poing, que du boulet qui échappe de notre pistole, en laquelle il y a plusieurs pièces, la poudre, la pierre, le rouet, desquelles la moindre qui viendra à faillir, vous fera faillir votre fortune ». Le pauvre n’imaginait certes pas la fertilité des cerveaux de messieurs COLT, SMITH, WESSON, MAUSER et autres sublimes mécaniciens.
« Et, sauf l’étonnement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprivoisé, je crois que c’est une arme de fort peu d’effet, et espère que nous en abandonnerons un jour l’usage ». Je ne pense guère exagérer en soutenant que le PROGRÈS TECHNIQUE laisse MICHEL DE MONTAIGNE carrément de marbre.
Conclusion :
« Les Allemands boivent quasi également de tout vin avec plaisir. Leur fin, c’est l’avaler plus que le goûter. »
Voilà ce qu'il dit, lui. Voilà ce que je dis, moi.
(Vous avez compris : parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ceci est pour LAGARDE & MICHARD, MONTAIGNE et LA BOETIE, et tout le fatras scolaire.)
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montaigne, littérature, plaisir, seizième siècle, les essais de montaigne, lagarde et michard, gendrot et eustache, conquistadors, femmes, virgile, désir sexuel, sexe, éducation, filles, garçons, boccace, l'arétin, platon, heinrich von kleist, apologie de raymond sebond
lundi, 31 octobre 2011
L'ENFANT ÜBER ALLES (4)
EPISODE 4 : Le psychologue et l’Enfant aux sortilèges
Troisième petite parenthèse (fulgurante).
« J’ai pas envie de faire ma page. J’ai envie d’aller me promener. J’ai envie de manger tous les gâteaux. J’ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l’écureuil. J’ai envie de gronder tout le monde ! J’ai envie de mettre Maman en pénitence… » Le personnage qui prononce ces fortes paroles, allez, appelons-le « L’Enfant », ça ne s’invente pas. En face de lui, préparant leur offensive, « Les Sortilèges ».
Le complot a été longuement machiné, patiemment ourdi en secret par un couple infernal : COLETTE pour les paroles, MAURICE RAVEL pour la musique, même si le bruit court que celui-ci en a pris largement à son aise avec le travail de celle-là. Bon, je résume l’argument : au début, l’enfant est méchant (« Je n’aime personne ! Je suis très méchant ! (…) Hourrah ! Plus de leçons ! Plus de devoirs ! Je suis libre, libre, méchant et libre ! »). A la fin : « Il est sage… si sage…Il est bon, il est sage… si sage… si sage… ». En gros, il était méchant, et il a retourné sa veste. Comme VIDOCQ qui, de bagnard, se retrouve chef de la police de sûreté.
Il faut dire qu’entre le début et la fin, il s’en est passé, des choses. La bergère et le fauteuil, et même la chaise de paille viennent sur la place Tahrir lui crier « Dégage ! » ; puis c’est au tour de l’horloge de crier « Casse-toi pauvre c… ! » ; la tasse et la théière ne sont pas en reste (« Ça-oh-râ toujours l’air chinoâ (…) Kek-ta fouhtuh d’mon Kaoua ? », c’est le texte véridique) ; les motifs du papier peint s’animent et protestent ; enfin bref, c’est tout son cadre familier qui n’en peut plus de ses abus de pouvoir, et qui brandit l’étendard, finissant par amener l’enfant à résipiscence, et à laisser s’exprimer la part de bonté qu’il cachait en lui.
« Tout est bien qui finit bien », comme il est dit à la fin du Trésor de Rackham le Rouge. Il y avait sûrement un tel fond de bonté chez le Tunisien ZINE EL ABIDINE BEN ALI, mais on ne lui a pas laissé le temps de l’exprimer (34 ans d’attente). Même chose pour le pauvre colonel libyen KHADAFI (42 ans). Mais lui il a toute la durée de l’au-delà pour que ça sorte. Il ne faut jamais dire « jamais ».
Mais il faut aussi dire que L’Enfant et les sortilèges, ça remonte à une époque où l’enfant n’avait pas encore été placé « au centre du système » (ça, c’est LIONEL JOSPIN quand il était sinistre de l’Education Nationale). L’enfant, là, il est comme la Sophie qui a des malheurs dans le livre de SOPHIA FIODOROVNA ROSTOPCHINA, plus connue comme épouse du comte EUGENE DE SEGUR, et donc comtesse par voie maritale et de conséquence. Dans Les Malheurs de Sophie, l’héroïne fait bêtise sur bêtise, des vraies. C’est sûr, l’enfant n’est pas idéalisé, c’est le moins qu’on puisse dire. Et c’est très bien comme ça.
Fin de la parenthèse fulgurante.
En fin de compte, c’est quoi, un enfant ? Je certifie ici, sur l’honneur, que je ne suis pas psychologue de profession, sinon, d’une part, je le saurais, et d’autre part, on m’aurait depuis longtemps rayé des tablettes et des cadres. Vous savez pourquoi ? A cause des « éléments de langage » qu’il faut avoir appris, du vocabulaire et de la syntaxe particuliers qu’il faut maîtriser, des « lunettes » spéciales qu’on vous colle sur le nez pour voir la vie, les gens, et donc les enfants.
Quatrième petite parenthèse (désolée)
Il m’est arrivé d’être assis à table juste à côté d’un psychologue. Il « intervient » dans l’établissement. Bon, c’est vrai qu’il ne faut pas généraliser à partir d’un seul « cas ». Mais c’est vrai aussi qu’il a déjà une tête un peu, disons, « spécifique ». Comment dire ? Du genre à examiner le macaroni sous tous les angles pour voir ce qu’il a dans le ventre avant de l’ingurgiter.
Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Dès les entrées, il me demande tout de go, et hargneusement, disons-le, si j’ai des enfants. Je lui réponds qu’en effet, j’ai eu la faiblesse de contribuer à ce genre de fabrication, et que j’ai besogné en vue de la repopulation. Mais que je n’ai pas fait ça tout seul. J’ajoute donc que j’ai tout fait pour que les bons moments qu’a durés ma contribution soient les plus plaisants, les plus mémorables possibles, pour moi bien sûr, mais aussi pour celle que la nature avait désignée pour le portage du fardeau qui devait en découler.
N’est-ce pas MONTAIGNE en personne qui, s’adressant à une femme enceinte sur le point d’exploser, lui souhaite d’avoir autant de plaisir à chier son marmot qu’elle en a eu à le concevoir (ce ne sont sans doute pas ses termes, encore que …, en tout cas, c’est l’idée) ? Ce sont des moments à entourer des soins les plus attentifs et les plus « tendres », tant il est désormais de notoriété publique que ce n’est qu’ensuite qu’apparaissent les contreparties exigées dans le « service après vente ».
Après tout : « Inter fæces et urinam nascimur », a dit SAINT AUGUSTIN en parlant du lieu qui voit les hommes naître à la lumière du jour et aux légères tribulations qui s’ensuivent. Quoi, traduire ? Vraiment ? Vous l’aurez voulu ! Ne venez pas vous plaindre : « Nous naissons entre la merde et l’urine ». C’est assez bien vu, je trouve.
Je reviens à mon propos. Le psychologue, apparemment, le suivait attentivement. C’est ainsi que nous arrivons au steak-haché-frites, le moment choisi pour me décocher : « Je vois. Donc, c’est sûr, vous élevez très mal vos enfants ! ». Pantois je suis, pantois je reste. Je crains d’avoir mal entendu, mais pas du tout : il me répète la phrase, il a mûrement choisi les mots, il a fait des études pour en arriver là.
Je le regarde, hésitant sur la suite à donner. Au moment où je veux reprendre le fil, il a déjà fini son yaourt et sa compote, se lève, saisit son plateau avant de disparaître. Je me dis alors qu’il n’est sans doute pas très heureux, et j’attaque mon demi Saint-Marcellin. Les psychologues, c’est comme l’andouillette beaujolaise : il y en a sûrement des bien.
Et c’est vrai, j’en ai rencontré d’autres par la suite, dont beaucoup avaient un air assez normal. Il faut bien dire, malgré tout, que c’est une drôle de profession que l’Occident a inventée là. Est-ce qu’elle remplace le métier de curé – à peu près disparu, celui-là – comme cela se susurre parfois ? Comme dit BOB DYLAN : « The answer, my friend, is blowing in the wind » (bis). Pas besoin de traduire, là, j’espère.
Est-ce qu’elle est indispensable à l’encadrement des enfants, des élèves ? Ce qui est sûr, c’est que l’étude et les soins de l’âme ont proliféré dans la société humaine comme les mouches sur une bouse appétissante. Bref rappel (je jure de ne pas insister et de ne pas faire mon balourd) : ψυχή, c’est l’âme, λόγος, c’est l’étude « scientifique », ίατρός, c’est celui qui soigne. Tout ça a donné, vous vous en doutez : « psychologue » et « psychiatre ».
Quelle maladie notre civilisation a-t-elle injectée aux vivants qu’elle a vu et fait naître pour qu’elle-même juge nécessaire de les prendre en charge ? Est-ce vraiment ce que MARCEL GAUCHET nomme le « désenchantement du monde », c’est-à-dire le nettoyage complet du ciel, de l’au-delà, en bref, de tout ce qui, autrefois, était placé « au-dessus » de l’humanité ? Mon pote ROLAND le pense. Mais lui, il dit qu’il faut revenir, justement, à ce « statu quo ante ». Est-il vraiment sérieux ? Ou bien sait-il que ce n’est pas possible, comme c’est le plus probable ?
Fin de la parenthèse désolée.
Alors je repose la question sur la table : qu’est-ce que c’est un enfant ? Je reprends la formule : c’est une personne future. Il n’y a pas à sortir de là. Autrement dit, ça suppose d’abord de le prendre au sérieux en tant que personne potentielle. De se comporter soi-même de façon responsable. J’arrête : je ne vais pas tarder à pontifier, à sentencier, bref, à dogmatiser. Mais je veux quand même dire que s’il y a quelque chose d’insupportable chez l’adulte, c’est quand il se dit qu’il faut être soi-même enfant pour « se mettre à la portée » de l’enfant.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : l'enfant et les sortilèges, maurice ravel, colette, enfant, éducation, trésor de rackham le rouge, comtesse de ségur, les malheurs de sophie, psychologue, montaigne, saint augustin, bob dylan, marcel gauchet

