vendredi, 19 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 2
2/2
 De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.
On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.
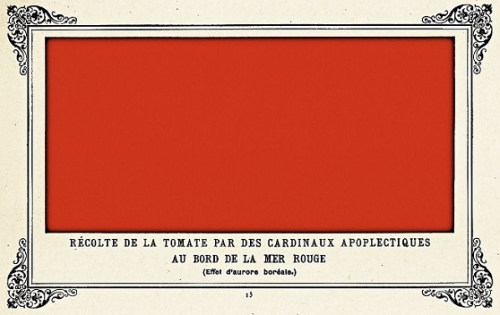
Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?
Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).
Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.
Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.
Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.
Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).
Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.
Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.
Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil
jeudi, 11 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE (fin)

LE PEINTRE ANTON RÄDERSCHEIDT ET SON EPOUSE, PAR AUGUST SANDER
***
Cette fois, promis, c’est la dernière halte chez Montaigne, ses Essais et leur Livre III. Je commence par deux petites gourmandises, dont la première prolonge la note d’hier sur le mariage : « Socrate, à qui on demandait ce qui était le plus commode, de prendre ou ne prendre point de femme : ʺLequel des deux on fasse, dit-il, on s’en repentiraʺ » (III, V, Sur des vers de Virgile). Certains diront que Rabelais avait déjà conclu dans ce sens, quoique de façon moins compendieuse, puisque tout son Tiers Livre, et une partie de son Quart Livre, et même du Cinquième, développent à l’envi l’hésitation inquiète de Panurge quant à savoir s’il doit ou non prendre femme (Pantagruel lui déclare gentiment : « Et je vous vois bien en point, selon ces trois sorts : vous serez cocu, vous serez battu, vous serez volé », Tiers Livre, XII).
La deuxième gourmandise se trouve juste quelques pages plus loin, dans le même chapitre : « Zenon, parmi ses lois, réglait aussi les écarquillements et les secousses du dépucelage », Zénon dont Montaigne affirme par ailleurs : « On dit que Zénon n’eut affaire à femme qu’une fois en sa vie : et que ce fut par civilité, pour ne sembler dédaigner trop obstinément le sexe ». On imagine bien la dame, après avoir reçu le coup : « Monsieur, vous daignâtes me baiser et consentîtes à me besogner, mille grâces vous soient rendues, vous êtes fort civil ! ».
Toujours à propos des joies du sexe, Montaigne y va de sa sévérité : « Nous mangeons bien et buvons comme les bêtes, mais ce ne sont pas actions qui empêchent les opérations de notre âme. En celle-là nous gardons notre avantage sur elles ; celle-ci met toute autre pensée sous le joug, abrutit et abêtit par son impérieuse autorité toute la théologie et philosophie qui est en Platon ; et même il ne s’en plaint pas. Partout ailleurs vous pouvez garder quelque décence : toutes autres opérations supportent des règles d’honnêteté ; celle-ci ne se peut pas seulement imaginer, si ce n’est vicieuse ou ridicule. Trouvez-y, pour voir, une façon de faire sage et discrète. Alexandre disait qu’il se reconnaissait comme mortel principalement par cette action et le dormir : le sommeil suffoque et supprime les facultés de notre âme ; la besogne les absorbe et dissipe de même ». Pas besoin, je pense, de préciser de quelle « besogne » il s’agit.
Le paragraphe qu’il consacre à l’esprit des filles, spécialement averti dès le plus jeune âge des choses de l’amour et du sexe, n’est pas à dédaigner : « Nous les dressons dès l’enfance aux entremises de l’amour : leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu’à ce but. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre chose que le visage de l’amour, ne fût-ce qu’en le leur représentant continuellement pour les en dégoûter ». Jusque-là, rien de bien épastrouillant, comme dirait Marcel Proust.
Vient l’anecdote familiale : « Ma fille (c’est tout ce que j’ai d’enfants) est en l’âge auquel les lois excusent les plus échauffées de se marier [la formule est délectable !] ; elle est d’une complexion tardive, mince et molle, et a été par sa mère élevée de même d’une forme retirée et particulière : elle ne commence encore qu’à se déniaiser de la naïveté de l’enfance. Elle lisait un livre français devant moi. Le mot de fouteau s’y rencontra, nom d’un arbre connu [hêtre] ; la femme qu’elle a pour sa conduite l’arrêta tout court un peu rudement, et la fit passer par-dessus ce mauvais pas. Je la laissai faire pour ne troubler leurs règles, car je ne m’empêche aucunement de ce gouvernement : la police féminine a un train mystérieux, il faut le leur laisser. Mais si je ne me trompe, le commerce de vingt laquais n’aurait su imprimer en sa fantaisie, de six mois, l’intelligence et usage et toutes les conséquences du son de ces syllabes scélérates, comme fit cette bonne vieille par sa réprimande et interdiction ». Encore une histoire qui a échappé à Villeroy et Boch, euh non, Roux et Combaluzier, zut, Boileau et Narcejac, crotte de bique, voilà : Lagardémichar. Ouf, j’y suis arrivé.
La fin du passage : « Mon oreille se rencontra un jour en lieu où elle pouvait dérober aucun des discours faits entre plusieurs femmes sans soupçon : que ne puis-je le dire ? Notre Dame ! (fis-je) allons à cette heure étudier des phrases d’Amadis et des registres de Boccace et de l’Arétin pour faire les habiles ! Il n’est ni parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres : c’est une discipline qui naît dans leurs veines [citation latine : ʺet Vénus elle-même les a inspiréesʺ, Virgile],que ces bons maîtres d’école que sont nature, jeunesse et santé, leur soufflent continuellement dans l’âme ; elles n’ont que faire de l’apprendre, elles l’engendrent ».
Comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre ce que se disent entre elles les filles quand elles sont sûres de ne pas être entendues, je ne peux, hélas, que confirmer le propos de l’auteur : les conversations entre garçons, sur ce plan, oscillent de la surenchère frimeuse au propos de sacristain pieux. Quant à Pierre Arétin (1492-1556), on ne peut pas dire que ce soit de la petite bière éventée qu'il fait couler dans ses Ragionamenti, comme on peut le voir ci-dessous, sur la gravure illustrant un des épisodes.

ELLE AIME VISIBLEMENT ÇA
Et que pensez-vous de cette sucrerie : « Je trouve plus aisé de porter une cuirasse toute sa vie qu’un pucelage ; et est le vœu de la virginité le plus noble de tous les vœux, comme étant le plus âpre : ʺLa puissance du diable est dans les reinsʺ, dit S. Jérôme » ? Et qu’en pensent messieurs Lagardémichar ?
Pour conclure cette trop longue série, je dédie la citation suivante à tous les syndicalistes, à tous les militants de partis, à tous les petits soldats des « associations » qui ont pour noble objectif de faire avancer la cause des « minorités visibles » sur la voie du « progrès » (si vous voyez ce que je veux dire) :
« La plupart des choses du monde se font par elles-mêmes ».
Oui vraiment, je la dédie à tous ceux qui sont convaincus que, sans leur « lutte », rien n’avancerait, et qui se croient les moteurs sans lesquels l’humanité s’endormirait et régresserait. On va dire que j’exagère, et j’avoue bien volontiers que c’est vrai. Je le fais même exprès.
Cela dit, si je regarde l’histoire du mouvement ouvrier, le calendrier rétrospectif de ce que l’on a appelé les « conquêtes sociales », depuis la journée de 15 heures (dimanche compris) jusqu’à celle de 10 heures (loi du 30 mars 1900), puis de 8 heures augmentée des congés payés (Léon Blum, 1936, La Belle équipe, Jean Gabin, …) ; et si je regarde l’inversion de ce processus depuis les années 1970, et l’invraisemblable facilité (rétrospective) avec laquelle les « conquêtes » ont été progressivement grignotées, je finis par me poser des questions.
Les « luttes », parfois violentes, la combattivité des militants et des syndicats ont eu beau s’y opposer, les bastions ouvriers (Renault Vilvoorde, les « Conti », Pétroplus, Peugeot Aulnay, la liste est interminable) sont tombés. Et « pendant le combat, la chute continue ». Le résultat est là : précarisation, chômage, baisse du pouvoir d’achat, etc. On est visiblement en bout de course du processus d’embourgeoisement relatif de la « classe ouvrière ». Et je dirais presque, avec Montaigne, que personne n’y peut rien.
Je me demande en effet, pour illustrer la phrase de Montaigne, si les progrès sociaux ne se sont pas contentés d’accompagner, grosso modo – et en fin de compte assez régulièrement –, les progrès des techniques, qui, au rythme des « gains de productivité », permettaient aux responsables de laisser tomber (sans que leur portefeuille eût trop à en souffrir), du haut de la table où ils n’ont jamais cessé de festoyer, les miettes capables de calmer les ardeurs revendicatives.
N’est-ce pas l’abbé Félicité Robert de Lamennais (mort en 1854) qui disait : « Donnez au malheureux les bribes tombées de votre table » ? L'ouvrier armé d'un couteau face au patron armé de son gros cigare ne seraient-ils finalement que des personnages en train de jouer des rôles sur des scènes de théâtre ?
Ce petit raisonnement, qui vaut évidemment ce qu’il vaut, je l’envoie pacifiquement dans les gencives de DB, qui me disait avec une sorte de jubilation masticatoire : « Je suis en lutte », alors que, tout en se déclarant communiste, elle venait toujours dans des tenues recherchées et qu’elle était propriétaire d’un bel appartement au cœur bourgeois du 6ème arrondissement de Lyon, à proximité immédiate du Parc de la Tête d’Or.
Bourgeoise et communiste, j’attends encore qu’elle me donne une explication qui ne soit pas complètement tire-bouchonnée.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, montaigne, littérature, rabelais, pantagruel, panurge, tier livre, essais de montaigne, sexe
vendredi, 05 juillet 2013
POURQUOI J'AI LU MONTAIGNE

COUPLE, PAR AUGUST SANDER
***
Alors pour finir : « Mon Montaigne à moi, c’est quoi ? » (sur l'air célèbre d’Edith Piaf). La réponse à la question, tout le monde connaît, c’est : « Je suis toujours à la fête ». Mon Montaigne à moi, c’est devenu une anthologie. Mon anthologie. Ou ce que vous voulez, appelez ça épitomé, miscellanées, chrestomathie, analectes, je n’y vois aucun inconvénient. J’accepte même « florilège », c’est vous dire si j’ai l’esprit large.
Parfaitement, je me suis fait ma collection de citations de Montaigne. Je vous rassure, elle ne ressemble guère à ce dont monsieur Lagarde et monsieur Michard ont toléré la présence dans leur relevé laborieux des balises du parcours obligé du lycéen. Je ne dis pas que mes quarante-cinq pages A4 leur feraient toutes dresser leurs trois cheveux sur leur crâne chauve, mais ils seraient horrifiés à l’idée qu’on puisse en mettre quelques-unes sous les yeux de la jeunesse. Et pourtant, ils auraient à y gagner. Je parle des yeux des lycéens.
Tiens, pour mettre en appétit, vous apprécierez ceci : « Les outils qui servent à décharger le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger nos rognons. Et ce que, pour autoriser la toute puissance de notre volonté, Saint Augustin allègue avoir vu quelqu’un qui commandait à son derrière autant de pets qu’il en voulait, et que Vives, son glossateur, enchérit d’un autre exemple de son temps, de pets organisés suivant le ton des vers qu’on leur prononçait, ne suppose non plus pure l’obéissance de ce membre : car en est-il de plus indiscret et tumultuaire ». On trouve ça au chapitre XXI du livre I, intitulé De la Force de l'imagination, p. 102-103.
Trois cents ans avant que Joseph Pujol, le virtuose du pet volontaire (nom de scène : « le Pétomane», à partir de 1891) se produisît devant des salles combles de Parisiens en délire ! « Premièrement, il faisait le Pet de la jeune fille timide, puis le Pet de la couturière, le Pet du monsieur bègue, etc. Ensuite, écartant les basques de son habit rouge et, tirant de sa petite culotte un tuyau de caoutchouc, fumait une cigarette ... par sa bouche postérieure », écrivent Jean Feixas et Romi dans Histoire anecdotique du pet (Ramsay/Pauvert). Il jouait aussi à la flûte "Au Clair de la lune" et "Le Roi Dagobert". Mais revenons à Montaigne.

Pour faire bonne mesure : « Joint que j’en sais un si turbulent et revêche, qu’il y a quarante ans qu’il tient [retient] son maître à péter d’une haleine et d’une obligation constante et incessante, et le mène ainsi à la mort ». L’édition de 1595 ajoute cette fragrance délicate de méthane intestinal : « Et plût à Dieu que je ne le susse que par les histoires, combien de fois notre ventre par le refus d’un seul pet, nous mène jusqu’aux portes d’une mort très angoisseuse ; et que l’Empereur qui nous donna liberté de péter partout, nous en eût donné le pouvoir ». J'en conclus que Lagarde et Michard se sont privés d’un moyen facile de motiver les adolescents à la lecture de Montaigne.
Rien ne serait plus efficace au lycée pour faire comprendre qu’il est dangereux de réprimer chez l’homme, par souci de convenance, ce qui vient de la nature. C’est ce qui est arrivé à Claude Chabrol, qui a eu un « malaise vagal », parce qu’il retenait un énorme pet (qu'il commit finalement sur le brancard qui l'emportait à l'hôpital), par pure courtoisie pour Sacha Distel, qui poussait des roucoulades interminables à la fin d’un banquet (c'est Claude Chabrol lui-même qui raconte l'épisode).
Il était culturellement intolérable à Lagarde et Michard de ne pas infliger au lycéen le ciseau des censures paralysantes qu’eux-mêmes avaient subies étant jeunes, comparables au rituel de la piqûre du TABDT (ou DTTAB) imposé aux jeunes recrues du service militaire, quand il y en avait encore un (une piqûre qui paralyse l’épaule, enfin c’était à l’époque d’Hérodote ou d'Hippocrate pour le moins).
Mon anthologie à moi, si quelque hiérarque éducatif de la technostructure ministérielle en prenait incidemment connaissance, serait en deux temps trois mouvements déclarée hérétique et brûlée séance tenante en place de Grève, s’il existait encore une « Place de Grève », et si l’on brûlait encore les livres. Aujourd’hui, c’est moins spectaculaire : il suffit de ne pas en parler. Le mutisme sur un grand livre est devenu plus efficace qu’un incendie volontaire. Ou que son étude par Lagarde et Michard.
Parce que je vais vous dire : la philosophie de Montaigne, je m’en tamponne le coquillard. Non, ce n'est pas vrai, mais c’est vrai qu’apprendre les étapes de son trajet philosophique (pyrrhonien ou sceptique ?) n’est pas le plus sûr moyen de provoquer (et de ressentir) l’intérêt. Pour mon compte, je voulais, en ouvrant une bonne fois pour toutes le bouquin, savoir ce que ce monument avait à me dire. À me dire à moi. Personnellement. Je l’ai dit : n’avoir en perspective que « ce qu’il faut savoir » (tous les vade-mecums de la terre), cela suffit à me décrocher la mâchoire à force de bâiller.
Quand le « Commendatore » lance son invitation (c’est chez Mozart) : « Verrai tu a cenar meco ? », Don Giovanni répond : « Verro » (« Viendras-tu manger en ma compagnie ? – Je viendrai »). Pendant ce temps, Leporello souffle : « Oibo ; tempo non ha, scusate ». N'étant pas Commandeur, j’ai invité Montaigne à ma table, et je dois dire que nous avons devisé agréablement, même si nos propos n’auraient en aucun cas pu être insérés dans le Lagarde et Michard 16ème.
Il faut bien dire que les deux auteurs, riches rentiers du manuel scolaire connu sous l'appellation « lagardémichar », ont réduit à presque rien, sinon quelques poncifs, l’incroyable et riche matière contenue dans les 1116 pages du livre. Mais pouvaient-ils faire autrement ? Et est-il possible d'enseigner vraiment les Lettres ? J'en doute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, humanisme, anthologie, lagarde et michard, essais de montaigne, bac de français, claude chabrol, philosophie, don giovanni, joseph pujol, pétomane
mardi, 04 juin 2013
QUI EST NORMAL ?

WILLIAM CLAXTON PHOTOGRAPHIA, ENTRE AUTRES, LES GRANDS DU JAZZ.
ICI, SA MAJESTÉ CHET BAKER. AH ! "MY FUNNY VALENTINE" ! MÊME MILES DAVIS, QUI A LONGTEMPS FAIT SA CHOCHOTTE, A FINI PAR Y VENIR, A "MY FUNNY VALENTINE".
***
Episode précédent : les institutions sont donc faites, selon les thuriféraires stipendiés ou non de la modernité urgente, pour s'adapter aux désirs successifs et changeants des populations. Il n'y a plus de vérité absolue. L'humanité est devenue un énorme, permanent et profond sable mouvant conceptuel.
Quand on parle de norme, de normal et d’anormal, il s’agit de bien identifier la personne à laquelle on a à faire. On appellera « progressistes » tous ceux qui s’efforcent de faire « bouger » les choses, à force de « transgressions » de la norme, qui veulent « briser » les « tabous », et qui s'en prennent à tout ce qui emprisonne l’individu dans le « carcan d'intolérances » dues au crétinisme des « gens normaux ».
En face de ces enthousiastes de « l’empire du Bien », on appellera « nouveaux réactionnaires » (Philippe Muray en est une des figures principales) tous ceux qui se cramponnent à des valeurs plus anciennes, immobiles, a priori suspectes au plus grand nombre, du seul fait qu’elles avaient cours avant, ce qui les dévalue irrémédiablement, forcément et par principe. Il s’agit d’envoyer aux oubliettes les tenants de ce qui existe, puisque ce qui existe a le défaut rédhibitoire d’avoir existé. « Du passé faisons table rase ! », leur crie la « modernité » en colère.
De là (aux environs de mai 1968), datent ces slogans fulgurants d’audace : « Changez ! », « Bougez ! ». Sous-entendu : ce que vous êtes, ce que vous pensez, la façon dont vous vivez, c’est de la merde. Ce que vous êtes aujour'hui n'est que de l'étron infâme et informe, laissez-vous façonner, sculpter par les temps nouveaux qui viennent vous libérer de toutes les pesanteurs. Léger, léger, léger. Ce qui était ne doit plus être. Ce que vous étiez doit se soumettre à la nouvelle loi : la transformation perpétuelle de l'un dans l'autre.
Sous-entendu aussi : ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas est figé, froid, cadavérique. La voilà, la norme énorme d’aujourd’hui : menace de mort. Et l’anormal, d’avance condamné, c’est celui qui, s’en tenant à de l’existant, refuse obstinément d’ « avancer » du même pas que les autres sur la voie lumineuse du merveilleux et impérieux « Progrès ». Pour rester vivant, paraît-il.
Pourquoi faut-il changer, au fait ? Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut, parce que le monde aujourd'hui est comme ça, parce que ..., parce que ... Finalement, quand tu réfléchis, tous ces adeptes du respect de l'identité qui se ruent sur le changement d'identité pour rester quelque chose, ça finit par faire bizarre. Moi qui croyais qu'une vérité, quelle qu'elle fût, se remarquait au fait qu'elle était durable. Quelle désillusion !
Eh bien si c’est comme ça, je me sens furieusement « anormal ». Mais alors là attention : du genre anormal assumé, endurci, récidiviste et irrécupérable. Pour un peu, j'en deviendrais presque arrogant. Et pour montrer que les anormaux comme moi ne pèchent pas par ignorance de ce qui se passe sous leurs yeux, je propose d'organiser prochainement (ben oui, c'est l'époque, la Fête de la Musique est dans pas longtemps, ça ferait de l'animation), un de ces quatre, une splendide « Anormal Pride » ?
Puisqu'il s'agit de nos jours de s'affirmer à travers des « marches des fiertés », il n'y a aucune raison pour que les anormaux de mon espèce, redressant leur front suppliant vers des cieux qui braquent leurs yeux intransigeants sur leurs errances coupables, n'aient pas enfin, à leur tour, leur moment de fierté, eux qui sont invités en permanence à revêtir des imperméables gris pour raser les murs en espérant passer inaperçus, courbés sous le poids de la honte.
Le plus curieux dans l'affaire, c'est qu'une telle « marche des fiertés » des nouveaux anormaux serait potentiellement en mesure de réunir une majorité de citoyens. Mais qui est désormais fier d'être normal ? Il n'y a pas à être fier d'être normal, puisque c'est normal d'être normal. C'est là le drame.
 Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.
Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.
C’est vrai qu’aujourd’hui vous ne commencez à vous sentir mériter d'exister que si une caméra de la télé, branchée sur le direct, est présente pour vous le confirmer. Quand on a ainsi « mérité l'événement », l'existence en prend une densité et une saveur nouvelles. Quand je pense que le pauvre Sartre croyait avoir compris et être capable d’expliquer toute l’époque dans Huis-clos, avec son : « L’enfer c’est les autres » ! Juste de quoi rire un peu, somme toute, avec le recul.
Quand les gens trouvent qu’il ne se passe rien chez eux, d’abord, comprenez qu’ils ne connaissent pas leur bonheur, ensuite entendez qu’il ne s’y donne aucun spectacle, qu’aucune « animation » ne vient l’ « animer », que le Tour de France ne s’y est jamais arrêté, que Gérard Collomb, merdelyon, n’a jamais eu l’idée d’y organiser les « Nuits Sonores » que le monde entier nous envie, et toute cette sorte de choses.
Que dirait Montaigne aujourd’hui, lui qui affirmait : « Je suis desgousté de la nouvelleté » (Essais, I, 23), et qui répondait à un ami qui se plaignait de n’avoir « rien fait » de sa journée : « Eh ! Avez-vous pas vécu ? » ? Aujourd’hui ? Montaigne aurait tout faux. Il n’aurait rien compris à la loi de la modernité : « Changez ! », « Bougez ! ».
Comme si les gens, dans ces occasions, oubliaient que leur existence ne s’est pas interrompue malgré l’absence de tout événement extérieur ou de toute caméra de télé. La population se sentirait-elle à ce point vide ?
Bon sang mais c'est bien sûr : c'est donc pour ça que marchands de smartphones dernier cri avides de deniers et politiciens avides de bouts de papier imprimés à leur nom s’entendent à merveille pour faire croire au vulgum pecus que, sans leurs initiatives, prises en vue du bien de tous (la FÊTE conjuguée à tous les temps et à tous les modes), l’existence de tous serait un désert, un espace inutile occupé par le vide intersidéral.
« Mais elle est passée où, la vie intérieure ? », se demande l’anormal attardé, perdu au milieu de ce nulle part en carton pâte, en attendant que passe l'improbable « Anormal Pride ». L’anormal attardé ne se rend même pas compte qu’il vient encore de proférer un gros mot. Si, il s'en rend compte, hélas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, william claxton, chet baker, jazz, miles davis, my funny valentine, normal, anormal, progrès, civilisation, transgression, l'empire du bien, philippe muray, mai 68, homo festivus, festivus festivus, élisabeth lévy, jean-paul sartre, huis clos, l'enfer c'est les autres, fête, montaigne, essais de montaigne
lundi, 14 mai 2012
ENCORE UNE LOUCHE DE MONTAIGNE (fin)
Restons encore un peu en compagnie de MONTAIGNE, dans les Essais et dans sa "librairie".

On trouve, au chapitre « De l’ivrognerie » (Livre II), en dehors d’un certain nombre de considérations très sages (MONTAIGNE est quelqu’un qui tient par-dessus tout à rester mesuré), une histoire digne d’être retenue.
De l’ivrognerie.
Et ce que m’apprit une dame que j’honore et prise singulièrement, que près de Bordeaux, vers Castres où est sa maison, une femme de village, veuve, de chaste réputation, sentant les premiers ombrages de grossesse, disait à ses voisines qu’elle penserait être enceinte si elle avait un mari. Mais, du jour à la journée croissant l’occasion de ce soupçon et en fin jusques à l’évidence, elle en vint là de faire déclarer au prône de son église que, qui consentirait à reconnaître ce fait en l’avouant, elle promettait de le lui pardonner, et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. Un sien jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble.
Elle est pas mignonne, l’histoire ? Une variante, en quelque sorte, de la chanson « Emmener sa femme au champ pour la…bourer ». « Qu’il s’en était pu servir ». Et on nous raconte que ce furent des époques puritaines ? Qu’est-ce que c’est que cette fable ? J’ai plutôt l’impression que le puritanisme a rarement été aussi actuel (le puritanisme est copain comme cochon, comme l’avers avec le revers, avec tout ce qui porte l’étiquette X).
Le passage suivant est beaucoup plus moral, mais il jette un drôle de jour sur la façon dont nous (moi le premier) nous extasions au-dessus du berceau d’un nouveau-né. N’y a-t-il pas quelque ressemblance avec ce que nous faisons devant le chiot ou le chaton que la chienne ou la chatte a mis bas quelque temps avant ? MONTAIGNE parle, quant à lui, de « guenon ». Sûr que ça fait plus exotique.
Chapitre VIII : De l’affection des pères aux enfants. (A madame d’Estissac.)
Comme, sur ce sujet de quoi je parle, je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine encore nés, n’ayant ni mouvement en l’âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas soufferts volontiers nourris près de moi [d’où le recours à la nourrice]. Une vraie affection et bien réglée devrait naître et s’augmenter avec la connaissance qu’ils nous donnent d’eux ; et lors, s’ils le valent, la propension naturelle marchant quant et [du même pas que] la raison, les chérir d’une amitié vraiment paternelle ; et en juger de même, s’ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle. Il en va forcément au rebours ; et le plus communément nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous ne faisons après de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes.
« S’ils le valent » : au moins c’est clair, le sentiment paternel est loin d’être naturel, comme le bruit s’en est colporté depuis JEAN-JACQUES ROUSSEAU (que cela n’a jamais empêché de mettre à l’Assistance les enfants qu’il a eus avec THERESE LEVASSEUR), et comme le montre ELISABETH BADINTER dans L’Amour en plus (1980). Est-ce que c’est MONTAIGNE qui est un salopard ? Est-ce que c’est nous qui sommes fondus gaga ?
Ce qui m’impressionne ici, c’est qu’il attend pour se faire une opinion que l’enfant ait assez grandi pour montrer aux yeux de tous quelle forme allait prendre l’être en devenir qu’il était exclusivement au départ. Nous, qui vivons à une époque qui se met à plat-ventre devant l’enfant, à l’époque de l’ « enfant au centre du système », de l’enfant-roi, ne pouvons plus guère, me semble-t-il, comprendre un tel propos.
Le plus drôle, c’est que nous nous chagrinons, plus tard, de l’écart éventuel entre l’enfant espéré et l'être accompli. MONTAIGNE, lui, n’attend rien de précis. Il attend de voir ce que ça va donner, le gamin. HANNAH ARENDT ne dit pas autre chose, dans La Crise de la culture, quand elle conteste radicalement qu’il existe un quelconque « monde de l’enfance », qui serait autonome, et insiste sur la nécessité de ne voir dans un enfant qu'un être humain en devenir. Rien de moins, certes, mais rien de plus.
Il y a bien du ridicule dans le seul fait d'avoir pensé qu'il fallait absolument que les instances internationales signassent une mirifique "Déclaration des Droits de l'Enfant". Tiens, mettez-y le nez ici, pour voir, et vous comprendrez pourquoi les Français ont rejeté la Constitution Européenne : il faut une formation juridique au moins de bac + 12 pour s'y retrouver, et rien que pour arriver jusqu'au bout.
Mais il est vrai que MONTAIGNE ignorait tout de ce qu’est un « marché », découpé en divers « segments » (5-9 ans, 9-12 ans, etc.), la consommation, et tous les objets qui se proposent en permanence d’irriguer notre besoin de bonheur, ce qui est de toute évidence un progrès incommensurable.
Voilà ce que je dis, moi.
Ce sera tout pour cette fois.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montaigne, littérature, essais de montaigne, librairie de montaigne, ivrognerie, relations parents enfants, jean-jacques rousseau, thérèse levasseur, assistance publique, élisabeth badinter, l'amour en plus, hannah arendt, la crise de la culture
dimanche, 13 mai 2012
ENCORE UNE LOUCHE DE MONTAIGNE
Allez, encore une petite louche de MONTAIGNE, du qu’on ne trouve pas dans le sacralisé « Lagarde et Michard ». Vous voulez que je vous dise ? Il faut être handicapé de la littérature pour être nostalgique de ça. Ça, qui vous apprenait ce qu’il faut savoir, et qui vous dégoûtait par avance de ce que, peut-être, vous auriez eu envie de découvrir.

Mais enfin, si c'est notre jeunesse, il y en a que la nostalgie remplit. Vous avez dit nostalgie ? Pas moi, en tout cas. Je ne me tourne pas vers le passé au motif qu'il figurerait le temps où j'étais heureux (quelle blague!), mais je vois le présent, et je pressens l'avenir, et je vois que tout ça n'est guère encourageant. Mais je m'interdis de désespérer les « générations montantes ». Je leur souhaite quand même bon courage. Et lucidité, si l'envie leur en prend.
Moi, j’ai eu la chance d’avoir un professeur d’exception en seconde, première et terminale, j’ai nommé PIERRE SAVINEL. Entre autres travaux d'érudition, il a traduit La Guerre des Juifs, de FLAVIUS JOSÈPHE (Editions de Minuit). Entre parenthèses, je ne comprends pas que les manuels de français, de deux choses l'une, expurgent les textes, ou alors les choisissent vierges de toute « impureté » (= sexe et pipi-caca).
Remarquez que l'esprit mal tourné de l'adolescent moyen est parfois en mesure d'ajouter du piment dans les plats les plus fades. Prenez, dans Lagarde et Michard XVIIIème, l'extrait intitulé « Poétique des ruines » (DIDEROT), c'est page 222, et lisez-le en ayant bien soin de remplacer le mot "ruines" par le mot "fesses", et vous verrez que la substitution ne manque ni de sel, ni de pertinence, comme nous l'avions réjouissamment testé à l'époque.
Expurgé ? Si vous prenez, dans Lagarde … 16ème siècle l’extrait de la bataille de l’abbaye de Seuillé (RABELAIS, Gargantua, 27), vous aurez bien les détails concernant l'amour des moines pour le vin (mais aussi leur lâcheté), mais aucun élève n’a jamais lu : « Si quelqu’un gravait [grimpait] en un arbre, pensant y être en sûreté, icellui de son bâton empalait par le fondement ».
« Empalait par le fondement, m’sieur, qu’est-ce que ça veut dire ? – Euh, … tout ce que je peux vous dire, c’est que ça doit faire assez mal ». Il faut savoir que le dit bâton est le manche qui sert à porter la croix aux processions (« long comme une lance, rond à plein poing et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées »), bâton dont le moine Frère Jean des Entommeures (= des Ravages) a fait une arme de destruction massive. En plus de les éveiller, ça enrichirait le vocabulaire des jeunes, ainsi que la polysémie du mot « fondement ».

"EUH... JE PEUX VOUS DIRE QUE ÇA DOIT FAIRE ASSEZ MAL"
Quant au choix des extraits, je ne dis pas, bien sûr, qu’il faut focaliser l’attention des adolescents sur le croustillant ou le scatologique, d’abord parce qu’il n’y en a pas partout, et loin de là. Mais les dits adolescents se feraient une idée moins solennelle, dévitalisée et scolaire de la littérature si l’on ne s’interdisait pas de jeter un œil sur, précisément, ce qui intéresse l’adolescence au premier chef.
Ils seraient peut-être plus nombreux à ouvrir des « classiques ». Tout se passe comme si les concepteurs de manuels étaient convaincus que la littérature était coupée de la vie, alors qu’elle en est une des émanations les plus authentiques (« les plus scientifiques », disait même le père JEAN CALLOUD, qui raffolait des chocolats de chez BONNAT). Tout se passe comme s’ils n’avaient pas compris ce qu’est la littérature, comme s’ils ne l’aimaient pas.
C’est vrai qu’une chape de pudeur semble s’être abattue sur l’expression du croustillant et du sale à partir du 17ème siècle. Voir pour cela, dans Carmen de MERIMEE, ce que recouvre la formule « et le reste », dans la bouche de Don José parlant de la femme qu’il aimait, formule qui saute à pieds joints sur les nombreux détails sur lesquels s'attardaient STENDHAL, MERIMEE ou FLAUBERT dans leur Correspondance. Et ce serait la même chose, si on lisait correctement RACINE ou DIDEROT. Croyez-vous que CORNEILLE ne savait pas ce qu’il disait, en écrivant : « Et le désir s’accroît quand l’effet se recule » ?
On me dira que c’est pour ça que ma prédilection va à Maître FRANÇOIS RABELAIS, à son jeu de mots sur « à Beaumont le Vicomte » (contrepèterie facile), à une recette de Panurge (« une manière bien nouvelle de bâtir les murailles de Paris », Pantagruel, 15), au lion qui ordonne au renard de remplir de mousse la « blessure » que la vieille vient de se faire entre les jambes (croit-il), et tout une pallerée de belles histoires. On me le dira, et j’en conviendrai. On me dira peut-être aussi que je ferais mieux de parler de RABELAIS, ce en quoi on aura tout à fait raison. C’est une très bonne idée. J’y songe. Promis, je vais m’y mettre.
En attendant cet heureux jour, contentons-nous, pour aujourd’hui, de quelques paragraphes rigolos et sympathiques tirés des Essais. Le premier est très gentil, et prouve que le cheval était inconnu en Amérique avant l’arrivée des Blancs.
Chapitre XLVIII : Des destriers.
Ces nouveaux peuples des Indes, quand les Espagnols y arrivèrent, estimèrent, tant des hommes que des chevaux, que ce fussent ou Dieux ou animaux, en noblesse au-dessus de leur nature. Aucuns, après avoir été vaincus, venant demander paix et pardon aux hommes, et leur apporter de l’or et des viandes, ne faillirent d’en aller offrir autant aux chevaux, avec une toute pareille harangue à celle des hommes, prenant leurs hennissements pour langage de composition et de trêve.

N'EST-CE PAS, QUE C'EST BEAU ?
Le second est un peu plus « costaud ». Il paraît que les Américains « tamponnent », alors que les Français « essuient ». Je vous laisse juges.
Chapitre XLIX : Des coutumes anciennes. [Sur la volatilité des modes.]
Ils mangeaient comme nous le fruit à l’issue de table. Ils se torchaient le cul (il faut laisser aux femmes cette vaine superstition des paroles) avec une éponge ; voilà pourquoi SPONGIA est un mot obscène en Latin ; et était cette éponge attachée au bout d’un baston, comme témoigne l’histoire de celui qu’on menait pour être présenté aux bêtes devant le peuple, qui demanda congé d’aller à ses affaires [aux toilettes] ; et, n’ayant autre moyen de se tuer, il se fourra ce baston et éponge dans le gosier et s’en étouffa. Ils s’essuyaient le catze [le cul] de laine parfumée, quand ils en avaient fait : « At tibi nil faciam, sed lota mentula lana. »
Traduction du latin : « Je ne te ferai rien [mais pour te punir de ton insatiable avarice, quand j’aurai lavé mes mains] ma mentule (ma verge) t’ordonnera de la lécher », comme quoi d'anciens adolescents peuvent regretter de ne pas avoir fait assez de latin (j’ai restitué les derniers vers de l’épigramme de MARTIAL, qu’on a tort de ne pas faire lire, je vous assure que c’est excellent pour l’imagination).
Tiens, ça me fait penser à cette stèle qu’on peut voir au Musée Gallo-Romain de Lyon, au dos de laquelle figure ce graffiti gravé (en latin, évidemment) : « Je ne baise pas, j’encule ». C’était le très discret, assez petit et très charmant, très classique, mais très correct et sûrement très chaste Monsieur AUDIN qui me l’avait fait découvrir. Il m’avait surpris, le brave homme. Comme quoi le graveleux n’est pas forcément incompatible avec la pruderie qu’une vaine apparence a posée sur le visage.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, montaigne, essais, lagarde et michard, nostalgie, pierre savinel, la guerre des juifs, flavius josèphe, éditions de minuit, sexe, pipi-caca, diderot, rabelais, gargantua, frère jean des entommeures, moines, adolescence, jean calloud, carmen, mérimée, stendhal, flaubert, racine, corneille, françois rabelais, essais de montaigne
lundi, 30 avril 2012
MONTAIGNE, ON S'EN PAIE UNE TRANCHE ?
Aujourd'hui, comme promis, ce sera du juteux, du qu'on n'étudie pas au lycée, ça c'est sûr, même que c'est bien dommage, non plus que le chapitre 26 du Tiers Livre de RABELAIS, qui fait un tour exhaustif de toutes les sortes de « couillons », liste qui se termine par « couillon hacquebutant, couillon culletant ». Mais il est entendu que RABELAIS est beaucoup plus porté sur la chose que MONTAIGNE, comme on va le voir.
Les Essais de MONTAIGNE sont composés de trois livres. Je ne vais pas vous embêter avec des considérations lourdes et pontifiantes. Juste ceci : le Livre I comporte 57 chapitres (environ 300 pages type Pléiade), le Livre II, 37 (450 pages) et le Livre III, 13 (330 pages). Comme si la pompe avait mis du temps à s’amorcer : des petites notes pour commencer, de vrais petits livres pour finir. C’est progressivement qu’il s’est pris au jeu.
Aujourd’hui, juste quelques paragraphes rigolos, sur la femme, le genre d’animal qu’elle est, et ce qu’elle doit être dans le mariage. On ne trouve évidemment pas ce genre d’extraits, non plus, dans le Lagarde et Michard. C’est bête, parce que je suis sûr que ça encouragerait les adolescents à lire MONTAIGNE.
Rien que pour l’idée rassurante qui leur dirait que les idées qui leur viennent quand ils regardent les filles, non seulement sont normales, mais que les filles et les femmes, pour ce qui est du désir et de la connaissance des choses de l’amour, les battent à plate couture. Parce que c’est vrai qu’un garçon, jusqu’à un âge, ce n’est, sur ce plan, qu’un gros niais. Et il y a fort à parier que le verbe « déniaiser » a été inventé pour les garçons. Enfin pas que.
Livre I, Chapitre XXX : De la moderation [l’auteur parle des relations entre le mari et la femme].
Je veux donc, de leur part, apprendre ceci aux maris, s’il s’en trouve encore qui y soient trop acharnés ; c’est que les plaisirs mêmes qu’ils ont à l’accointance de leurs femmes, sont réprouvés, si la modération n’y est observée ; et qu’il y a de quoi faillir en licence et débordement, comme en un sujet illégitime. Ces enchériments deshontés que la chaleur première nous suggère en ce jeu, sont, non seulement indécemment, mais dommageablement employés envers nos femmes. Qu’elles apprennent l’impudence au moins d’une autre main. Elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m’y suis servi que de l’instruction naturelle et simple.
Mai 1968, avec son « Jouir sans entraves », n’est pas encore passé par là. On a compris : madame MONTAIGNE se contentait de ce que MICHEL EYQUEM lui donnait. Et il lui donnait peu. « Qu’elles apprennent l’impudence d’une autre main ». C’est une question qui le tarabuste, parce qu’il y revient plus tard.
Livre III, Chapitre V : Sur des vers de Virgile. [Où il est un peu question des vers de Virgile, mais aussi et surtout d’autre chose.]
Pour MONTAIGNE, le mariage doit découler de la raison et non du désir personnel, surtout du désir amoureux. Il est pour les mariages décidés en dehors des personnes, parce que c’est d’abord une convention sociale.Il n’est pas question de se laisser aller au plaisir conjugal : « Une femme honnête n’a pas de plaisir », dit la chanson de JEAN FERRAT. Enfin, on parle ici d’il y a 450 ans, il ne faut pas l’oublier.
Aussi est-ce une espèce d’inceste d’aller employer à ce parentage vénérable et sacré les efforts et les extravagances de la licence amoureuse, comme il me semble avoir dit ailleurs (voir ci-dessus). Autrement dit, le mariage est chose trop noble pour y mêler le plaisir.
L’intéressant vient : Il faut, dit Aristote, toucher sa femme prudemment et sévèrement, de peur qu’en la chatouillant trop lascivement le plaisir la fasse sortir hors des gonds de raison. Ce qu’il dit pour la conscience, les médecins le disent pour la santé : qu’un plaisir excessivement chaud, voluptueux et assidu altère la semence et empêche la conception ; disent d’autre part, qu’à une congression [coït] languissante, comme celle là est de sa nature, pour la remplir d’une juste et fertile chaleur, il s’y faut présenter rarement et à notables intervalles, [« afin qu’elle saisisse avec avidité les dons de Vénus et qu’elle les cache plus profondément » c'est en latin] (Virgile, Géorgiques). Je ne vois point de mariages qui faillent plutôt et se troublent que ceux qui s’acheminent par la beauté et désirs amoureux. Il y faut des fondements plus solides et plus constants, et y marcher d’aguet ; cette bouillante allégresse n’y vaut rien.
On a compris. D’ailleurs il dit quelque part qu’il « s’accointe » avec sa femme juste avant de sombrer dans le sommeil, le soir. On ne peut pas dire que ça rigolait. Comme homme, MONTAIGNE devait être passablement ennuyeux. Il pose même la question : combien de fois par jour ? La reine d’Aragon, dit-il, préconise six « rapports » par jour, mais le grand législateur grec de l’antiquité parle de trois par mois. On devine où va la préférence de MONTAIGNE.
Quel mauvais ménage a fait Jupiter avec sa femme qu’il avait premièrement pratiquée et jouie par amourettes ? C’est ce qu’on dit : Chier dans le panier pour après le mettre sur sa teste.
Pour lui, c’est certain, la femme est par nature un animal lubrique. Et ça commence très tôt, chez les fillettes et jeunes filles. Tiens, toujours dans le même chapitre :
Nous les dressons des l’enfance aux entremises de l’amour : leur grâce, leur attifure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu’à ce but. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre chose que le visage de l’amour, ne fût qu’en le leur représentant continuellement que pour les en dégoûter.
Autrement dit, les filles ne pensent qu’à ça. Le péché d’Eve n’est pas loin. Vient alors une anecdote.
Ma fille (c’est tout ce que j’ay d’enfant) est en l’âge auquel les lois excusent les plus échauffées de se marier ; elle est d’une complexion tardive, mince et molle, et a été par sa mère élevée de même d’une forme retirée et particulière : si qu’elle ne commence encore qu’à se déniaiser de la naïveté de l’enfance. Elle lisait un livre français devant moi. Le mot de « fouteau » s’y rencontra, nom d’un arbre connu [hêtre] ; la femme qu’elle a pour sa conduite, l’arrêta tout court un peu rudement, et la fit passer par-dessus ce mauvais pas. (…) Mais, si je ne me trompe, le commerce de vingt laquais n’eût su imprimer en sa fantaisie, de six mois, l’intelligence et usage et toutes les conséquences du son de ces syllabes scelerées [scélérates], comme fit cette bonne vieille par sa réprimande et interdiction.
Et ce passage, alors ? Mon oreille se rencontra un jour en lieu où elle pouvait dérober aucun des discours faits entre elles sans soupçon : que ne puis-je le dire ? Nostredame ! (fis-je) allons à cette heure étudier des phrases d’Amadis et des registres de Boccace [auteur de contes « libres »] et de l’Arétin [auteur d'oeuvres érotiques] pour faire les habiles. Il n’est ni parole, ni exemple, ni démarche qu’elles ne sachent mieux que nos livres : c’est une discipline qui naît dans leurs veines, [« et Vénus elle-même les a inspirées », Virgile], que ces bons maîtres d’école, nature, jeunesse et santé, leur soufflent continuellement dans l’âme ; elles n’ont que faire de l’apprendre, elles l’engendrent.
« Une discipline qui naît dans leurs veines », parfaitement. Enfer et damnation, j’aurais dû m’en douter. C’était donc ça. Les filles savent tout. Les garçons sont des niais. Et ce n’est pas la mixité qui a changé les choses, puisqu’elle les a aggravées.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, montaigne, rabelais, tiers livre, essais de montaigne, lagarde et michard, de la modération, jean ferrat, sexe, plaisir, devoir conjugal, femme

