vendredi, 17 février 2017
POURRITURE JOURNALISTIQUE
Guillaume Erner avait invité dans son émission des « Matins » de France Culture, jeudi 16 février, un certain Henri Maler, fondateur de l’Acrimed (Action Critique Medias). Il a eu la malheureuse idée d’inviter, pour lui donner la réplique en deuxième partie, Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération. Je me rappelle une émission « Répliques » où Alain Finkielkraut avait invité Laurent Obertone, auteur de La France Big Brother, et le même Laurent Joffrin.
Le comportement de ce dernier pendant ce qui aurait dû rester un débat avait été absolument infect : c’est bien simple, Obertone n’avait pas pu prononcer une seule phrase entière, tellement Joffrin parlait en même temps que lui, l’interrompant et ne cessant de lancer des « piques » contre ses propos, si bien que l’auditeur n’avait pu entendre que des bribes de son discours, que le directeur de Libé avait soigneusement cisaillé et découpé en morceaux minuscules, les rendant impropres à la consommation.
De nouveau invité sur un plateau de France Culture, face à Henri Maler cette fois, Laurent Joffrin a réédité son opération de pilonnage permanent de l’adversaire. Il en a fait une méthode. Mais c’est une méthode de forban et de minable fripouille médiatique. Henri Maler a eu bien raison, entre deux tirs, de répéter qu'il n'y avait pas de débat.
Invité pour parler des problématiques tournant autour de l’exercice du journalisme aujourd’hui, Joffrin a commencé par éjecter la question générale pour la réduire au cas spécifique de Libération et de sa propre fonction au sein de cette rédaction-là, au prétexte qu’il ne pouvait parler que de ce qu’il connaissait (mon œil !). Ce qui ne l’a pas empêché d’ajouter un peu plus tard qu’il a occupé des postes au sein de neuf rédactions successives. Moyennant quoi, bien qu'ayant exercé des responsabilités et passé toute sa carrière dans le milieu, il n’a aucune idée globale sur l’exercice de la profession !!! Il a réussi à abaisser ce débat tant soit peu général à une toute médiocre querelle de personnes, ce dont l'autre invité Henri Maler n'avait strictement rien à faire. Joffrin ne supporte pas l’altitude, qu’on se le dise : il ne se déplace que le plus près possible du sol, le nez dans la bouse. Joffrin ne supporte pas qu'on lui mette le nez dans l'odeur produite par sa conception des métiers de la presse.
C’est le meilleur moyen pour empêcher la question principale d’être seulement formulée en termes intelligibles : peut-on émettre un discours critique sur la façon dont la profession du journalisme est pratiquée ? Dont elle est organisée et encadrée ? Dont elle est enseignée ? Une profession au sein de laquelle un tout petit nombre de gens détient l’autorité sur les rédactions (Henri Maler en compte une soixantaine, il y a trente mille journalistes en France). Une autorité qui les autorise à pondre des papiers qu’on appelle « éditoriaux ».
Ce sont les « éditorialistes ». Ils forment ce qu’Henri Maler appelle « l’éditocratie », vous savez, les seigneurs qui mangent à toutes les tables, et pissent dans la nuit la copie qui paraîtra le lendemain. Curieusement, l'exercice qu'on appelle en France la « revue de presse » ne consiste pas, en général, à faire une collecte d'articles (enquêtes, reportages, ...) particulièrement intéressants, mais à faire écho à ce qui est sorti de la plume des éditorialistes. Or qu'est-ce qui sort de leur plume ? Des informations ? Que nenni ! Non, il sort du commentaire. Et ça ronronne, ça tourne rond, ça tourne en rond.
Car ce commentaire, bien qu'il soit signé d'un nom, s'inspire plus ou moins des propos tenus à table hier au soir par divers convives : député, sénateur, chef d'entreprise, etc. On appelle « dîner en ville » cette habitude du journalisme mondain. C'est la raison pour laquelle tous les éditoriaux, sous leurs différences cosmétiques, se ressemblent, se miment les uns les autres, moulinent une seule et même matière, étant en réalité puisés à la même source. La dite source est située "en haut". D'où la jamais formulée prétention des éditorialistes à "faire l’opinion" : c’est aussi faux (voir le résultat de leur appel unanime au "oui" au référendum de 2005) qu’il est néanmoins vrai qu’ils exercent un pouvoir. Au moins occupent-ils le terrain, ce qui n'est pas un mince avantage (ne serait-ce que pécuniaire).
On me dira que c’est un pouvoir en vase clos, qui ne saurait donc étendre son emprise au-delà des parois du bocal. Certes, rétorqué-je, mais regardez les vieux poissons qui reviennent sur les écrans des aquariums télévisuels : Franz-Olivier Giesbert, Laurent Joffrin, Philippe Val, etc. Toujours les mêmes. Combien de ces vieux poissons dans le bocal, finalement ? Aussi vieux dans le métier que les politiciens qu'ils aiment à côtoyer. Et je pose la question : qu’est-ce qui les légitime, à la place d’où ils s’adressent au peuple, pour distribuer la bonne parole ? Réponse : rien. C’est le principe même du vase clos.
Parmi toutes ces têtes à se faire appliquer des tartes à la crème sur la figure, parmi toutes ces têtes à gifles ou à poing dans la gueule, parmi tous ces roitelets à jabot gonflable, Laurent Joffrin mérite une sorte de palme. Car il quintessencie en sa personne tout ce que mérite d’épluchures et d’œufs pourris l’élite journalistique régnante : l’arrogance, le cynisme, la mauvaise foi, le mépris de l’interlocuteur.
Laurent Joffrin est une belle figure de la bassesse professionnelle. Un concentré de tout ce qui a déconsidéré moralement le métier de journaliste. Certes, Balzac n'était déjà pas tendre à l’égard de celui-ci dans Illusions perdues, mais quelques plumes au 20ème siècle avaient pu faire croire à l'ennoblissement du métier par le sens de l’honneur dans son exercice (Albert Londres, Henri Béraud (si !), Joseph Kessel, Albert Camus, François Mauriac, …). Laurent Joffrin revient aux fondamentaux : il rend au caniveau la dignité et le rang d’auge à journalistes, où Lousteau (l'"ami" de Rubempré) se déplaçait avec son aisance de seigneur décavé.
Laurent Joffrin fait partie de la caste de ces mini-vizirs Iznogoud qui, avec leur redoutable douceur de Raminagrobis et sans vouloir devenir califes à la place du calife, font régner une mini-Terreur dans les rangs des subordonnés et sont passés maîtres dans l’art d’empêcher toute critique venue de l’extérieur, comme il l'a montré par deux fois sur France Culture, face à ses interlocuteurs. Pour ce qui est de l'intérieur du métier, l'omerta est aussi impérieuse dans le journalisme français que dans le peloton du Tour de France à propos du dopage. Ceux qui entrent dans le métier ont tellement peur de la précarité qu’ils passent sous toutes les fourches caudines qui se présentent. D’une certaine manière, on les comprend. Mais il est permis de le déplorer.
Il reste que, dans l’émission france-culturelle de Guillaume Erner du 16 février, la présence de Laurent Joffrin permet de comprendre pourquoi, si en soi la profession ne mérite aucun opprobre de principe, la façon dont elle est organisée et pratiquée par ses élites dirigeantes est un objet de mépris. Monsieur Guillaume Erner, pourquoi infliger une nuisance à l'auditeur ?
Et en observant l’espèce de complicité objective entre les élites politiques, les élites économiques et les élites journalistiques, je me dis qu’il n’y a pas de hasard si la presse quotidienne nationale (PQN) "jouit" d’un tel désamour du lectorat, puisqu’elle ne survit que grâce à des injections massives d’argent public, et pour véhiculer principalement la « parole d’en haut ». L'élite journalistique est aussi complètement déconnectée de la réalité populaire que l'élite politique et que l'élite économique : tant que l'argent rentre et que la situation est assurée, le mot d'ordre est : fi du petit peuple ! Diantre ! Palsambleu !
Comme le dit un proverbe bantou (chinois ?) : « Quand le poisson pourrit, ça commence par la tête ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalisme, journalistes, presse écrite, presse quotidienne nationale, pqn, henri maler, france culture, acrimed, action critique médias, alain finkielkraut, répliques finkielkraut, laurent obertone, la france big brother, laurent joffrin, journal libération, éditorialistes, journalisme de commentaire, franz-olivier giesbert, ma petite entreprise connaît pas la crise, référendum 2005, albert londres, henri béraud, joseph kessel, albert camus, françois mauriac, balzac illusions perdues, rubempré lousteau, vizir iznogoud, guillaume erner, entartage le gloupier, noël godin, france, politique, société, françois ruffin, journal fakir
lundi, 13 juin 2016
LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT ...
... OU : LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI
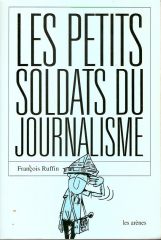 1/2
1/2
Je me rappelle avoir choqué un professeur d’université lors d’une conférence, quand je lui avais posé cette question : « Qu’est-ce que vous pensez du pouvoir journalistique ? ». Il m’avait répondu, péremptoire, avec une prestesse et un ton catégoriques : « Il n’y a pas de "pouvoir journalistique". Question suivante ? ». Ce n’est qu’ensuite que j’ai appris qu’il avait une relation, disons, privilégiée avec une journaliste qui travaillait dans la ville (initiales B.B.). Cela pouvait expliquer.
Pourtant, il est incontestable que, pour un journaliste, voir publier un article signé de son nom constitue, en même temps que la reconnaissance d’une maîtrise professionnelle, l’affirmation d’une sorte de « droit à dire le monde » qui, par « l’effet de présence » que produit la publication d’un document, manifeste l’exercice d’un pouvoir sur la représentation du monde qui en découlera pour le lecteur. Mais je ne vais pas faire mon Bourdieu.
On me dira que le lecteur ne mange que l'avoine qu’il a envie de trouver dans sa mangeoire, et que le picotin du Figaro n'a rien à voir avec le brouet que le lecteur trouve dans sa gamelle avec Libération, et réciproquement. Cela, certes, n’est pas faux. Mais nul ne peut nier qu’un article de journal, quelle que soit sa teneur, est en soi un cadrage d’une portion de réalité sur laquelle l’attention du lecteur est forcément attirée. Même si le signataire de l’article est forcé d’obéir aux consignes de son supérieur hiérarchique et de couler ce qu’il écrit dans le moule qu’il lui impose, l’effet au dehors ne change pas d’un iota, puisque produit par le simple fait d’être officiellement consacré au travers de la publication.
Mais je n’ai pas l’intention de supplicier davantage les petites mains qui noircissent les pages de nos quotidiens et magazines (en évitant de franchir les lignes du cadre qu’on leur a fixé), tant l’exercice de cette profession devenue misérable doit davantage attirer la commisération que le sarcasme. Et ce ne sont pas les grandes gueules d’éditorialistes qui me feront changer d'avis, eux dont les affirmations péremptoires toujours pleines de certitude et de suffisance truffent jour après jour des « revues de presse » qui rivalisent de complaisance envers les « confrères » haut placés dans la hiérarchie et qui, pour cette raison, ont le droit d'asséner leurs analyses comme autant de Vérités révélées.
Depuis l'Orphée aux enfers d'Offenbach, on a une idée de ce qu'est « l’Opinion Publique » (cf. ci-dessous). Offenbach a tout compris du dieu Sociologie et de ses prophètes Pierre Bourdieu et Patrick Champagne (cf. Faire l'opinion, de ce dernier).
Les insupportables « Grand Editorialistes » (Laurent Joffrin, Yves Thréard, Franz-Olivier Giesbert, Claude Imbert, Jacques Julliard, Nicolas Beytout et quelques autres), qui prétendent détenir les secrets de cette « Opinion Publique », sont en réalité les porte-voix en personne, les ministres plénipotentiaires de Sa Majesté le Système, qui a abattu ses griffes sur le monde.
S'il existe un vrai pouvoir journalistique, ce sont les "grands éditorialistes" nommés ci-dessus qui l'exercent. C'est par eux que passe le discours dominant, répercuté en longs échos dans tous les médias, en intime copinage avec les puissants des mondes politique et économique qu'ils côtoient très régulièrement, voire qu'ils tutoient (cf. le célèbre couple Anne Sinclair-Dominique Strauss-Kahn). Ignacio Ramonet, du Monde diplomatique, avait inventé une expression géniale pour désigner la chose : « La Pensée Unique » (titre l'article qui avait lancé la formule) qui, mise à toutes les sauces et réutilisée à satiété, à tort et à travers, fut malheureusement très vite vidée de son sens pour devenir un poncif éculé.
Ce sont des "grands éditorialistes" qui avaient appelé unanimement, en 2005, a voter « oui » au référendum, Serge July et Philippe Val compris. On a vu deux ans plus tard ce que Sarkozy faisait de la véritable opinion publique, celle qui s’exprime dans les urnes : il a posé son derrière sur le "Non" majoritaire pour l’étouffer sous le poids de son mépris. Pour se convaincre de la déliquescence de la corporation, il suffit de lire un petit livre paru en 2003 : Les Petits soldats du journalisme (Les Arènes, avec des dessins explicitement complices de Faujour) de François Ruffin.
François Ruffin, si l’on veut, est davantage militant que journaliste, mais ne chipotons pas : son livre vaut le coup d’être lu, ne serait-ce que pour les innombrables citations qu’on y trouve, et qui sont autant de proclamations de la nouvelle fonction que les grands organes de presse assurent, une fonction que je résumerais volontiers dans une formule du genre « dithyrambe en l’honneur de l'ordre établi, de la marchandise et de la société qu’elle engendre ». L'opération « Nuit Debout » et les actuelles grèves de la CGT et de FO ont été pour eux l'occasion de produire un nouveau festival de considérations haineuses sur des initiatives prises par d'impudents audacieux qui osaient agir en dehors des cadres définis par les gens en place.
Attention, je ne suis pas « Nuit Debout ». Il m’est arrivé d’entendre très récemment François Ruffin : c’était dans une émission de radio, lors d’un reportage place de la République, au cours d’une « Nuit Debout » parisienne. Pour être franc, la partie de son discours choisie pour diffusion par France Culture m’a bien fait rire. Me tapotant la tempe de l'index, je me suis dit que ce garçon prenait ses désirs pour des réalités et profitait de la « Nuit Debout » pour rêver tout éveillé et tenir des propos à tenir debout.
Il y a longtemps que les discours militants me laissent froid, quand ils ne me glacent pas. Les slogans du genre « Le monde doit changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout » ont amplement prouvé que, non seulement ils sont porteurs d’illusions, mais que ces illusions acquièrent à l’occasion une nocivité massacrante. Je n’ai pas vu Merci patron !, le film de François Ruffin qui est en train de faire un carton au box office. Ce canular aux dépens du milliardaire Bernard Arnault ne peut que me réjouir, mais de là à tirer de ce succès et de la "popularité" de « Nuit Debout » des conclusions anticipant quelque Grand Soir, non merci : je ne connais pas le magasin de chaussures où l'on vend les bottes de sept lieues capables de franchir le pas.
Ce qui m’a donné l’idée de relire le livre de François Ruffin, c’est une phrase que j’ai trouvée dans un vieux livre de Philippe Meyer, Pointes sèches (Seuil, 1992) : « Ne le répétez pas, mais il m’arrive de me demander si Panurge ne devrait pas être le saint patron des journalistes », qui regroupe des chroniques où l’auteur dresse le portrait de politiciens, en s’efforçant de faire sourire le lecteur sans trop écorcher les gens visés. Plusieurs furent lues à la télé ou à la radio, en présence de leur cible. La phrase me semble un résumé concentré de la situation actuelle de la profession. C'était bien vu, et même bien tapé.
"Mouton de Panurge", tout le monde sait à peu près ce que c'est. Vous connaissez l’histoire de ce navire bourré de touristes : à un moment, l’un d’eux, situé à tribord, s’écrie : « Oh, regardez ! ». Evidemment, tous ceux qui étaient accoudés au bastingage de bâbord se précipitent. On connaît la suite : le navire chavire. Le journalisme, en particulier politique, est spécialement atteint par ce cancer qui le ronge. On se souvient du char à foin camarguais où s’entassaient des dizaines de clampins, tous armés de micros ou d’appareils photo braqués en direction de Nicolas Sarkozy en train de parader tout fiérot sur son cheval blanc, lors de la campagne de 2007.

Bande de pauvres types ! Quel naufrage ! Quel troupeau ! Quelle lâcheté ! Quel avilissement ! Quelle misère, en vérité !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, presse quotidienne nationale, pqn, presse quotidienne régionale, pqr, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, éditions les arènes, journal le monde, journal libération, journal le figaro, offenbach orphée aux enfers, laurent joffrin, yves thréard, franz-olivier giesbert, claude imbert, jacques julliard, nicolas beytout, ignacio ramonet, le monde diplomatique, serge july, philippe val, france culture, film merci patron, philippe meyer pointes sèches, moutons de panurge, nicolas sarkozy, journalisme, journalistes, référendum 2005, pierre bourdieu, patrick champagne, faire l'opinion

