mercredi, 02 octobre 2019
CÉLESTE ALBARET
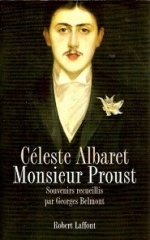 Je viens de lire un livre qui n’a pas de semblable. L’auteur de Monsieur Proust (Robert Laffont, 1973) n’est autre que Céleste Albaret, la femme qui n’a pas quitté l’écrivain pendant ses huit ou neuf dernières années d’existence. Je n’aurais pas lu ce livre si je n’étais pas auditeur de France Culture. La chaîne publique a en effet eu l’idée merveilleuse de diffuser, en une série de cinq émissions estivales de la série "La Grande traversée" (Philippe Garbit pour cette série), de larges extraits de l’interview au long cours (trois mois) que Céleste avait accordée à Georges Belmont en 1972. En fait, Céleste n'a pas écrit un mot du livre dont elle est l'auteur : elle les a parlés.
Je viens de lire un livre qui n’a pas de semblable. L’auteur de Monsieur Proust (Robert Laffont, 1973) n’est autre que Céleste Albaret, la femme qui n’a pas quitté l’écrivain pendant ses huit ou neuf dernières années d’existence. Je n’aurais pas lu ce livre si je n’étais pas auditeur de France Culture. La chaîne publique a en effet eu l’idée merveilleuse de diffuser, en une série de cinq émissions estivales de la série "La Grande traversée" (Philippe Garbit pour cette série), de larges extraits de l’interview au long cours (trois mois) que Céleste avait accordée à Georges Belmont en 1972. En fait, Céleste n'a pas écrit un mot du livre dont elle est l'auteur : elle les a parlés.
Des nombreuses heures (Belmont dit "soixante-dix", le producteur dit "quarante") de bandes magnétiques enregistrées par le journaliste-écrivain, le producteur france-culturiste Philippe Garbit a gardé entre sept et huit (29 juillet-30 juillet-31 juillet-1 août-2 août 2019). Des moments que je qualifie d'exceptionnels.
Je l'avoue uniment, platement, humblement : c'est la voix de cette femme extraordinaire qui m’a donné l’envie d’ouvrir le bouquin qui dormait sur un rayon, avec l'intégralité du contenu des enregistrements. Ce qui est étonnant, c’est précisément qu’on ne se lasse pas de l’écouter, tant sa voix de campagnarde invétérée débarquée à Paris pour cause de mariage (Odilon Albaret, qui était devenu le chauffeur attitré de Marcel Proust), sa jovialité, sa simplicité, sa gouaille, sa présence, son ton parfois péremptoire, ses fous-rires, son enthousiasme sont communicatifs. Lire le livre après ces quelques heures donne l'avantage unique d'accéder en lisant au ton carrément incommunicable sur lequel se passent les entretiens. Quelle bonne femme, Céleste Albaret !

Céleste et Odilon après l'engagement de celui-ci dans les services motorisés de l'armée française en guerre.
Interviewée à 82 ans, morte à 92 (Odilon est mort je ne sais plus quand, d'une crise d'urémie), elle revit devant le micro une expérience absolument unique : avoir tenu compagnie pendant huit années à un des plus grands écrivains de la littérature européenne, au moment où celui-ci décide de se retirer chez lui, à l’abri du monde, pour faire aboutir son grand projet littéraire : La Recherche du temps perdu. Étrangement, cette fille venue de la campagne profonde, qui se levait et se couchait avec les poules, se met, calquant brutalement son rythme de vie sur celui de Marcel Proust, à vivre la nuit et à dormir la journée, au moins jusqu'au réveil du patron, entre 14 et 18 heures selon les jours. Cette brutalité ne semble pas l'avoir traumatisée.
L’expérience l’a marquée tellement en profondeur qu’on peut dire qu’elle ne s’en est pas remise. Elle le dit à plusieurs reprises : elle vouait un véritable culte à Marcel Proust, en qui elle voyait l’incarnation de l'absolu du raffinement, de la haute distinction et de la courtoisie la plus délicate. Qu’on n’attende pas d’elle le plus petit reproche ou la plus petite once de critique : elle a trouvé, au 102 boulevard Haussmann, puis rue Hamelin, une sorte de paradis sur terre, certes gouverné par un tyran domestique, mais devant lequel elle n’a cessé d’être en adoration, et aux moindres caprices duquel elle déférait, soumise et aimante. On ne peut même pas dire qu’elle lui pardonnait ses défauts : à ses yeux, il n’avait pas de défaut. Elle s'est mise à genoux devant la statue au premier moment où celle-ci s'est présentée (de façon rigolote : « sans cravate et sans barbe »), mais l'extraordinaire, c'est que la statue le lui a bien rendu. Céleste Albaret, on ne sait comment, est devenue en peu de temps une composante indispensable du décor de l'écrivain.
Cette fille d’une campagne reculée (Auxillac en Lozère, où sa mère, dit-elle : « faisait la cuisine à l'âtre ») ne savait rigoureusement rien faire de ce qu’un « employeur » est en droit d’attendre. Proust lui-même le lui avait déclaré d'emblée en 1914, quand elle s'est installée à demeure chez l'écrivain : « Céleste, vous ne savez rien faire, mais soyez assurée que je ne vous demanderai jamais de faire quoi que ce soit ». Extraordinaire, non ? Comment est-elle devenue cette dame de compagnie, et même cette confidente littéraire en présence de qui Proust commençait à mettre en forme les observations qu’il rapportait de ses soirées ou de ses repas mondains ? Mystère. Il y a là une rencontre qui tient du miracle. C’en est au point que l’écrivain lui déclare un jour que si elle partait, il ne pourrait pas achever son chef d’œuvre.
Ce qui est sûr, c’est que Céleste existe intensément quand on l’entend dévider ses souvenirs. Mieux que dévider : elle revit puissamment ces huit années en les racontant, elle réagit aussi fort qu’à l’instant où les choses se passent. Par exemple, une nuit, l’écrivain l’envoie en mission (porter un message ou un livre, je ne sais plus). Quand elle revient auprès de son maître pour en rendre compte, elle lui avoue avoir donné cinq francs « à un sergent de ville » qui l'a guidée dans l'obscurité jusqu'à la bonne adresse (« un escalier bossu »). Proust part alors d'un grand éclat de rire, et elle, racontant la scène, éclate du même rire cinquante ans après : « Et il riait ! Il riait ! ». C’est cette absolue spontanéité-sincérité rétrospective qui m’a poussé à lire ce livre acheté en 2002. Je ne l'ai pas regretté.
L’image de Marcel Proust qui ressort du tableau peint par Céleste Albaret au cours de quarante (ou soixante-dix) heures d’entretien avec Georges Belmont est assez différente de celle que l’histoire littéraire en a construite. En particulier dans tout ce qui concerne sa vie quotidienne au cours de ses dernières années. D’abord la maladie : c’est comme malade qu’il a demandé à Céleste de le considérer et de le servir. On ne peut en effet pas dire que Proust jouissait d'une grande santé : contre son asthme, il pratiquait des fumigations, respirant les fumées d'une poudre qu'il enflammait et fuyant toutes les occasions de subir des crises très éprouvantes.
Après l'avoir suivi dans son dernier séjour à Cabourg, en 1914, au retour duquel (au niveau de Mézidon) il a une crise particulièrement violente, elle l'accompagne dans son choix définitif de vie recluse : il ne quittera plus guère sa chambre aux rideaux toujours fermés et aux murs revêtus de plaques de liège. A la lecture de ses souvenirs, je me suis souvent dit que Proust était un insupportable maniaque doublé d'un enfant capricieux, avec sa phobie des poussières, avec son « essence de café » que Céleste apprendra très vite à préparer méticuleusement, avec sa pile de mouchoirs sur sa table, mouchoirs qu'il jetait par terre après le premier usage, etc.

La chambre de Marcel, reconstituée. Noter la petite table avec sa pile de mouchoirs.
Pour Céleste Albaret, qui est tout sauf une universitaire ou une critique littéraire, pendant les huit années où elle a vécu auprès de Marcel Proust, celui-ci était guidé par une seule idée : achever la "Recherche". C'en est au point qu'à ses yeux, toutes ses sorties dans des soirées mondaines, tous ses soupers fins au Ritz, chez Larue ou ailleurs, toutes les visites qu'il rendait ou recevait, toutes ses pensées, tous ses gestes n'avaient qu'un seul et unique objectif : achever la "Recherche". Elle n'en démord jamais. Hors de toute considération universitaire, j'aime à penser qu'elle n'a peut-être pas tort.
Elle était seule présente, en compagnie du Dr Robert Proust, frère de Marcel, à l'instant où ce dernier mourut.
Une belle personne à coup sûr, Céleste Albaret.
Voilà ce que je dis, moi.
***
Et un matin (en fait, il est quatre heures l’après-midi), pages 402-403 : « Comme j’arrivais près du lit, il a tourné un peu la tête vers moi, ses lèvres se sont ouvertes et il a parlé. Depuis que je vivais auprès de lui, c’était la première fois qu’il m’adressait la parole au sortir de son réveil et avant d’avoir pris sa première tasse de café. Jusqu’à sa mort, cela ne s’est plus reproduit. J’ai été surprise malgré moi, et je suis restée là, en suspens. Il m’a dit :
- Bonjour, Céleste …
Un petit instant, son sourire a paru déguster ma surprise. Puis il a repris :
- Vous savez, il est arrivé une grande chose, cette nuit …
- Que s’est-il passé, Monsieur ?
- Devinez.
Il s’amusait beaucoup. Rapidement, dans ma tête, j’ai fait le tour de ce qui aurait pu arriver. Ce ne pouvait pas être une visite inattendue – je l’aurais su et entendu ; jamais il ne fût allé ouvrir lui-même la porte. Qu’il ait pu se relever pour sortir était également inconcevable ; jamais il n’eût décroché de ses mains son pardessus et son chapeau dans le vestiaire ; toujours il fallait que tout fût préparé. Tout en cherchant, j’inspectais du regard la chambre. Je me disais : "personne n’est venu ; il n’a pas demandé ses vêtements ; il n’est pas sorti ; il n’a pas grillé sa bouilloire électrique ; il n’a rien cassé ; tout est en place …"
J’ai dit :
- Monsieur, je ne vois pas du tout ce que cela peut être, je ne peux pas deviner. Cela doit être un miracle. Il faut que vous me l’appreniez.
L’air tout heureux et rajeuni, il jubilait comme un enfant qui a joué un bon tour.
- Eh bien, ma chère Céleste, je vais vous le dire. C’est une grande nouvelle. Cette nuit, j’ai mis le mot "fin".
Il a ajouté, toujours avec son sourire et cette lumière dans son regard :
- Maintenant, je peux mourir.
J’entends sa voix prononçant ces derniers mots : on aurait cru une explosion de satisfaction et de joie. »
Je plains l'universitaire sérieux qui tombe sur cette expression : "déguster ma surprise" !!! Est-ce que ça ne vaut pas le coup, vraiment, d'avoir vécu ce moment-là ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, marcel proust, la recherche du temps perdu, céleste albaret, georges belmont, céleste albaret monsieur proust, france culture, philippe garbit france culture, france culture la grande traversée, 102 boulevard haussmann, auxillac lozère
dimanche, 19 mai 2013
AU-DESSOUS DU VOLCAN 1

Je viens de relire le livre de Malcolm Lowry. Quand je l’avais lu – ça remonte à lure de lurette –, ç’avait été une commotion. Une véritable épreuve à traverser à la nage sans avoir appris à nager. A vrai dire, l’idée de commotion était ce que j’avais gardé de ce livre incroyable. Le titre a été retraduit en Sous le Volcan, mais je trouve que ça fait trop forge de Vulcain sous l'Etna, en train de forger le (si si, je vous jure) foudre de Jupiter.
A la réflexion, si je compare avec Ulysse de James Joyce, qui est unanimement célébré par tout ce qui compte dans le monde en matière d'autorité littéraire comme le nec plus ultra de la création littéraire au vingtième siècle, à égalité avec La Recherche et Le Voyage, j'ai bien envie de placer le Volcan de Lowry au-dessus du roman de Joyce, tant celui-ci m'apparaît comme un artefact intellectuel.
Extraordinaire si l'on veut, mais quand même un produit extrêmement cérébral, alors que le Volcan consiste en un plongeon héroïque et poétique jusque dans les tréfonds de l'existence et de la souffrance humaines. Pourquoi cérébral, me demandera-t-on ? A cause du parti-pris d'expérience formelle, qui révèle presque toujours un goût pour les joutes virtuoses et les défis intellectuels, avec sous-entendu : « Essaie d'en faire autant, tiens, t'es même pas cap ! ». Il y a là-dedans de la performance, de l'exploit sportif. C'est donc un peu gratuit, donc un peu vain.
Ce qui pourrait constituer la parenté des deux livres, ce serait peut-être d'illustrer deux voies de recherche possibles, qui sont aussi deux impasses littéraires, sauf qu'à mon avis, Lowry sait parfaitement qu'il se trouve dans une impasse, ce dont, pour Joyce, plus orgueilleux et sûr de sa supériorité, je ne suis pas sûr.
Une personne qui m’est proche, quand elle a reçu du livre Au-dessous du volcan l’autorisation de le lire enfin, après plusieurs tentatives infructueuses où il lui avait interdit de poursuivre au-delà de la page 12, m’a dit que pour sa part, c’était une plainte d’une immense tristesse qui lui parvenait de ses profondeurs.
Pour moi, la tristesse est un mot bien vague. Est-ce le sentiment éprouvé par le lecteur au spectacle de ce qui arrive au Consul Geoffrey Firmin ? Ou une tristesse qui émanerait de la narration elle-même, comme un effet esthétique voulu et élaboré par l’auteur ? Quoi qu’il en soit, curieusement, ce n’est pas cet aspect qui m’a procuré, quand j’ai refermé le livre, cette sorte d’enthousiasme et de jubilation qu’il ne m’a été donné qu’exceptionnellement d’éprouver (Le Temps retrouvé et Moby Dick font partie des derniers en date). Etrange, n’est-ce pas ?
Je parle bien sûr d’une émotion spécifiquement littéraire, du genre de ce qu’on ressent après avoir lu ce qu’on appelle un chef d’œuvre, un de ces Everest de la littérature qui donnent au lecteur – je ne trouve pas d’autre mot – un sentiment de gratitude. Je veux dire un de ces livres après lesquels on peut à bon droit se féliciter d’avoir vécu jusque-là, ne serait-ce que parce qu’il existe et qu’il parvient à ce miracle : procurer de la joie. Je pèse mes mots.
C’est vrai qu’a priori, Au-dessous du volcan n’est pas de ces livres qui prédisposent à l’optimisme. Mais je ne suis pas sûr que la littérature ait à jouer le rôle d’antidépresseur, non plus que de pousse-au-crime, ni d’encouragement au suicide. La littérature telle que je l’entends a pour objet de créer de la beauté, en s’efforçant de fabriquer un cadre et de donner un sens à l’existence humaine. Une œuvre d’art chargée à ras bord d’un poids de « vraie vie ». Et pas ailleurs, mais bien ici. De ce point de vue, la lecture du livre de Malcolm Lowry comble le lecteur que je suis.
Comme dans Les Passantes de Georges Brassens ou La Vierge à l’enfant et deux anges de Fra Filippo Lippi (visible aux Offices), l’adéquation miraculeuse (inexplicable) de la chose et du moyen par lequel elle est exprimée. Bon, j’arrête avec les comparaisons vaseuses, c’est juste pour dire le principe : quelque chose de rigoureusement unique se passe quand ce que veut dire un bonhomme entre en résonance parfaite avec sa façon de le dire. Quand l'unicité du fond qu'il y a mis épouse idéalement la forme qu'il a façonnée.
Ne serait-ce que pour ça, Au-dessous du volcan est un livre unique.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 23 août 2012
LA METHODE VIALATTE 2/5
2
Pensée du jour : « Janisson [personnage d'un roman de Jean-Claude Sordelli] mène une petite vie, plus seul qu'un croûton de pain tombé derrière une malle dans un grenier de chef-lieu de canton ».
Alexandre Vialatte
***
Résumé : pour faire l'éloge de la digression, je parlais d’un cactus mexicain et de son principal alcaloïde : peyotl, objet d’un rituel chez les Tarahumaras, et la mescaline, devenue, comme tous les psychotropes chez les occidentaux, une drogue, avec accoutumance et dépendance. Car la civilisation occidentale, en même temps qu'elle constitue pour le monde le poison violent qu'elle lui a inoculé de force, a inventé quelques moyens chimiques de lui échapper tout en en exprimant la vérité foncière.
La drogue dure est la vérité ultime de la civilisation occidentale.
On voit les effets de ce cactus sur l’esprit faible (mais malin) d’un petit escroc occidental des années 1970, nommé Carlos Castaneda, passé avec armes et bagages sous l'emprise du supposé sorcier Yaqui Don Juan Matus, comme il le raconte dans un livre qui m’a, au moins un temps, fasciné : L’Herbe du diable et la petite fumée (éditions Soleil Noir, la suite (interminable) se trouve chez Gallimard, l’herbe du diable étant, je crois me souvenir, le redoutable datura). J'en suis redescendu.
Car l’auteur a très bien su récupérer armes et bagages pour transformer ses expériences initiatiques et hallucinatoires (« Don Juan, ai-je vraiment volé ? », demande-t-il après avoir atterri) en retombées sonnantes et trébuchantes, aussi longtemps qu’il fut à la mode. S’il est mort, au moins est-il mort riche.
Revenons au peyotl, ce petit cactus. C’est après avoir absorbé un peu de son principal alcaloïde que Jean-Paul Sartre écrivit Les Séquestrés d’Altona (1959), pièce dans laquelle un des personnages apparaît récurremment sur scène en vociférant : « Des crabes ! Des crabes ! ». Ceci pour traduire l’hallucination qui ne le quitta plus guère après cette ingestion de mescaline (car c’était elle). Il voyait, dit-on, des homards autour de lui quand il marchait aux Champs Elysée. Moralité : sans crabe, pas d'existentialisme. Quel dommage que Sartre ait rencontré la mescaline !
On a compris pourquoi il a cette gueule hallucinée de crapaud désordonné et fiévreux. Et on comprend pourquoi tout Sartre est ennuyeux. C’est péremptoire, je sais. Mais j'ai été membre fondateur d'un "club des péremptoires". Cela tombe bien. La même drogue produisit de tout autres effets, et combien plus admirables, chez Henri Michaux.
Pour revenir à mon sujet, j’ajouterai donc, et c’est de la pure logique, que la digression fleurit où elle est semée, et que, jusqu’à plus ample informé, le pommier ne pond aucun œuf avant d’y avoir été obligé. Peut-être même encore après. La chose reste à confirmer. L’association d’idées, dans ce qu’elle a de plus arbitraire, personnel, soudain et momentané, est la règle souveraine de la digression.
C’est vrai, vous avez des gens uniquement préoccupés de l’unité, de la cohérence, de l’homogénéité de ce qui sort de leur plume. Des obsédés de la ligne droite, de la vue d'ensemble et du but à atteindre. La ligne droite qui explique le monde, la vue qui le synthétise, et le but qui le résout. Même qu'après, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Des aveuglés de la totalisation.
Eux, ils écrivent de gros traités ou bien de grands romans. Ils sont guidés par les principes de tiers-exclu et de non-contradiction. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, dont aucune adventicité parasite ne saurait les distraire ou les détourner. Ils sont en mission. Ils veulent tout dire. "Epuiser le sujet", l'expression est révélatrice.
A eux les grandes constructions. Je ne crache pas dessus, loin de là, car ça peut produire des chefs d’œuvre inoubliables : Guerre et paix (Tolstoï), Traité de l’argumentation (livre génial et profondément humaniste de Chaïm Perelman, dommage qu’il décourage les non-spécialistes, car il se lit comme on boit du petit lait (dont je parle en connaisseur), pour moi, c'est de la littérature), L’Homme sans qualités (Musil), La Recherche du temps perdu, et autres monuments monumentaux, que le notaire du Poitou stocke sur ses rayons, au lieu de les ouvrir.
C’est comme quand vous voyagez. Il y a ceux qui ne tolèrent de voir le monde que derrière les vitres d'une bétaillère de 80 têtes, et il y a ceux qui ne voudraient pour rien au monde se confier à autre chose que leur caprice. Je suis de ces derniers.
Les Japonais ne sauraient, pour venir voir la Joconde, se déplacer qu’en masses compactes et métronomisées, selon un agenda millimétré au quart de poil, où même les moments de « liberté » octroyés sont dûment inscrits par le tour-opérateur. Et il ne s’agit pas de sortir du cadre et de l’itinéraire. Ça ne plaisante pas.
Je préfère quant à moi annoncer à ma petite famille, un jour de 1989, sur l'herbe du camping Amsterdamsebos (ci-dessus), que l'année prochaine, on ira en Roumanie. Comment ? Par où ? Combien de temps ? Avec quels points de chute ? On aura bien le temps de voir, que diable, quand on sera sur place. C'est vrai que cette manière de faire comporte quelques inconnues, quelques imprévus, quelques incidents. Ah ça, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on préfère.
Car il faut bien dire que les voyages qui vous font « faire » la Turquie ou la Grèce en 10 jours, l'oeil sur la montre et le doigt sur le déclencheur photographique, tout comme les grands plans d'ensemble, les grandes constructions, les grandes explications définitives du monde (façon Kant), les grandes idées pour le transformer (façon Marx), et pour tout dire, les systèmes qui vous livrent le monde clé en main, tout le monde n'est pas fait pour. Je connais des allergiques.
Et que, face au voyage entièrement packagé et acheté prêt à l'emploi, comme face à l’énormité des ambitions encyclopédiques et totalisantes, appauvrissantes et accumulatrices, mesquines et simplificatrices, face à ces laboratoires où l’homme expérimente son absence ou sa destruction, il y a place pour le fragment, l'anecdote, le détail concret, la musarderie, le nez au vent, le chatoiement de la lumière dans le sous-bois. La vie.
Bref, il y a place pour Alexandre Vialatte (le voilà !), ses frères, ses cousins, sa parentèle. J'ai tendance à me sentir de cette famille. Il y a place pour la flânerie : sans but et curieuse de tout. Flânerie n'est pas vide ou désoeuvrement. Oui, appelons ça la vie. Quoi, au ras des pâquerettes ? Bien sûr. A quelle altitude croyez-vous vivre ? Relisez la dernière phrase des Essais de Montaigne : « Si avons-nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde si ne sommes assis que sus nostre cul ». Parfaitement, c'est la dernière phrase.
Ce n'est pas du haut d'un char d'assaut à touristes que vous aurez pu, un jour, comme ça, poser votre vélo sur le talus d’un chemin des « marais », et vous asseoir à penser à rien. La Bourbre est juste là. Et puis vous regardez quelques feuilles mortes, à deux mètres. Ça bouge, ma parole. Bizarre. Quelque chose grabote en dessous. Ça crisse. Vous ne rêvez pas. Et puis elle apparaît, la taupe, elle est sortie de ses souterrains pour varier le menu, elle en a assez, du sempiternel ver de terre.
Vous vous souviendrez même longtemps, dans la chair de vos doigts, de la défense acharnée qu'elle vous a opposée, quand l'idée saugrenue vous a pris de la capturer. Un conseil : méfiez-vous des dents. Même les griffes ne sont pas à négliger.
Alors je demande quelle théorie scientifique, quel système philosophique, quelle conclusion sur le sens de la vie ou l'existence de Dieu voulez-vous tirer de ça. Pas lerche ! Contentez-vous de saisir l'instant, voilà. Ce n'est pas Imanuel Kant qui peut se vanter d'avoir observé une taupe in vivo. En tout cas, il n’en fait pas état dans Critique de la raison pure. Selon moi, il a tort.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, alcaloïde, peyotl, tarahumaras, psychotrope, drogues dures, carlos castaneda, l'herbe du diable et la petite fumée, yaqui, don juan, jean paul sartre, théâtre, les séquestrés d'altona, mescaline, hallucination, henri michaux, association d'idées, léon tolstoï, guerre et paix, chaïm perelman, traité de l'argumentation, robert musil, l'homme sans qualités, la recherche du temps perdu, roumanie, kant, marx
dimanche, 25 décembre 2011
AU FIL DE "LA RECHERCHE" (1)
Je me replonge dans la lecture de ce monument littéraire qu'est La Recherche du temps perdu, de notre gloire nationale Marcel Proust. Pas à vitesse de croisière, mais à vitesse de caboteur, à la paresseuse, d'escale en escale, et surtout, je l'espère, avec une simplicité de néophyte. Il paraît que l'oeuvre est incontournable. On va bien voir.
Je l'ai déjà croisée, et davantage même que croisée, traversée, labourée, mais c'était à des fins "utiles", qui ne sont jamais innocentes, car elles orientent le lecteur dans une direction qu'il n'a pas choisie et prise spontanément. Il fallait alors que "j'en fasse quelque chose". Je me promets donc une approche empreinte de gratuité, et surtout dénuée de toute portée scolaire.
COMBRAY, EPISODE 1
Le début est quelque peu horripilant, à cause du personnage du narrateur, avec sa « sensibilité », sa fragilité nerveuse qui lui impose une curieuse addiction au baiser de sa mère, quand elle vient lui souhaiter bonne nuit dans son lit. Le petit Marcel en éprouve de si vives angoisses que le lecteur n’a guère envie de le prendre au sérieux ou en affection.
On pourrait même dire : arrête ton cinéma ! Ce que fait le père du petit Marcel. Ah, le désespoir du petit Marcel, quand il ne peut pas déposer, sur le duvet de pêche des joues de sa chère maman le doux baiser qui lui donnera le doux sommeil de la paix de l’âme ! Ah, l’infernale insomnie qui va le conduire jusqu’au matin à travers l’océan des angoisses, tout ça parce que monsieur Swann joue les invités !
Le dessin des personnages de la mère et du père est quand même assez schématique. La mère est tendre sans excès, et soucieuse d’éduquer son petit garçon selon de bons principes, et surtout sans montrer, surtout en public, une propension exagérée à lui démontrer son affection.
Le père, d’abord plus rude et expéditif en général, est plus enclin que son épouse, dans certains moments d’indulgence, à enfreindre les dits principes, par exemple lors d’une soirée en compagnie de Swann, où le gamin subit le verdict paternel d’avoir à monter se coucher aussitôt et sans espoir, et où finalement, la mère passera la nuit dans la chambre du fils, avec la bénédiction de papa.
Le père est plein de certitude et d’autorité. La mère pleine d’admiration pour son mari : « Où sommes-nous ? », demande-t-il, au retour d’une promenade longue et inconnue. Et quand il montre la petite porte qui ouvre sur le jardin en brandissant la clé, l’épouse fond littéralement de vénération devant des pouvoirs aussi magnifiques.
La grand-mère est peinte de façon assez drôle, avec sa manie du grand air qui la pousse, même sous la pluie, à faire des tours de jardin pendant que la famille s’est réfugiée au salon. Les deux grand-tantes, de leur côté, sont bien expédiées, sous la plume du narrateur.
Elles me font penser à des scènes du bien oublié Jacassin, de PIERRE DANINOS, qui s’est pourtant visiblement inspiré de PROUST. Des vieilles dames très cultivées, très racornies, et d’une subtilité tellement maladive qu’elle en devient hermétique. Les arrière-pensées se traduisent par des formules insidieuses et contournées, mais finalement très attendues, voire stéréotypées. Ce qui leur confère, en fin de compte, une forme de bêtise, visiblement voulue par l’écrivain, qui s’en donnera à cœur joie avec ce genre de cruauté quand il abordera le salon Verdurin.
Le soir où Swann vient passer un moment, alors qu’il vient de leur faire parvenir une caisse de vin d’Asti, elles se débrouillent pour lui adresser des remerciements et des compliments tellement allusifs et alambiqués qu’il n’a aucune chance de les percevoir comme tels. Comment pourrait-il comprendre que : « Il n’y a pas que monsieur Vinteuil qui ait des voisins aimables », s’adresse à lui ? Ce que le grand-père ne manque pas de souligner d’ailleurs.
Alors, l’épisode de la « madeleine » ? Eh bien je le trouve très savant, très bien amené et assez touchant. La façon dont il descend puiser en lui-même la source ancienne de l’émotion ressentie dans le présent est d’une véracité très forte : le barrage que fait l’intelligence à la remontée de ces vieilles sensations qui ont bâti la personne, l’effort de « déprise » auquel se livre celle-ci, les diverses résistances qu’oppose la mémoire, et puis « tout d’un coup », voilà que ça revient. Mais qu’est-ce que c’est moche et frustrant pour l’élève de n’avoir sous les yeux que la vingtaine de lignes qu’on lui impose d’habitude, alors que l’épisode s’étend sur quatre pages ! Quatre pages formidables.
Voilà ce que je dis, moi.
La suite une autre fois.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, la recherche du temps perdu, littérature, le jacassin, pierre daninos, swann, sonate de vinteuil
dimanche, 11 décembre 2011
J'AI LU "ULYSSE" DE JAMES JOYCE
Ne vous étonnez pas si l’entrée en matière est tortueuse et sinusoïdale. C’est qu’il s’agit de bien situer les choses, n’est-ce pas. En entrant dans le salon, vous n’aimeriez pas non plus constater que la lampe ne trône pas au milieu de son napperon et que les tableaux au mur piquent du nez. Je n’irai pas jusqu’à réclamer que tout soit tenu comme le palier de la pension où loge Harry Haller, le personnage du Loup des steppes, de Hermann Hesse : la logeuse est vraiment trop maniaque.
Sinon, vous pouvez vous dire qu’Erroll Garner rendait quasiment fous son bassiste et son batteur (mettons Eddie Calhoun et Denzil Best, pour cette fois) en commençant chacun de ses morceaux par des introductions où il errait pendant des temps variables entre diverses tonalités, avant de tomber sur la bonne, comme s’il l’avait vraiment cherchée. Du côté des « sidemen », ça fumait ! Loin de moi la prétention de me comparer, évidemment.
Alors voilà, selon Thomas Mann, la littérature du XXème siècle repose sur un trépied : Marcel Proust, et La Recherche du temps perdu ; Louis-Ferdinand Céline et Voyage au bout de la nuit, avec tout ce qui suit ; James Joyce, et Ulysse. J'avais lu les deux premiers, pas le troisième, jusqu'à, somme toute, une époque assez récente. J'hésitais, parce que le livre était entouré d'une aura sulfureuse. Vous connaissez mon rigorisme moral et le puritanisme altier de ma pudeur cénobitique. Il paraît que c'est parce que c'est plein de saletés et d'obscénités que l'auteur a beaucoup couru après les éditeurs pour être publié.
Donc, par acquit de conscience, j’ai acheté la nouvelle traduction de Ulysse, de James Joyce, celle que Gallimard a publiée en 2004 sous la direction de JACQUES AUBERT, qui était, voire est encore professeur à l’Université Lyon II. J’avais croisé JACQUES AUBERT il y a bien longtemps au monastère de La Tourette, à Eveux, célèbre pour avoir été conçu et dessiné par CHARLES-EDOUARD JEANNERET-GRIS, dit LE CORBUSIER. C’était dans les murs du centre THOMAS MORE.
C’est un très beau monastère, la preuve, le parc est vaste et magnifique. C’était à l’occasion d’un séminaire de DENIS VASSE. Oui, je l’avoue, j’ai traîné la coque de mon rafiot dans ces eaux-là, qui n’avaient pas l’air d’être trop hostiles à des barcasses novices comme la mienne. Je précise que, pour ce qui est de la psychanalyse – car c’est bien de cela qu’il s’agit – je le suis resté, novice, indécrottablement, au point de me demander parfois ce que je suis allé faire par là.
Bon, sans entrer dans trop de détails, j’étais tombé sur l’annonce d’un sujet qui m’intéressait, parce qu’il concernait un travail que je me proposais à l’époque de mener à bien, et que j’en attendais des informations utiles. Je dis bien : à l’époque. Drôle d’ambiance, je vous jure. Le psychanalyste, qui formait le gros de l’infanterie, grouillait pire que vermine, l’université avait délégué un beau bataillon de savants, dont je connaissais quelques-uns, et l’hôpital n’était pas en reste, avec une très présentable escadrille de médecins et infirmières. Oui, qu’est-ce que je faisais là ?
Je n’ai pas regretté, néanmoins. Oui, les repas servis à la cantine étaient d’une qualité tout à fait honorable, et les conversations réellement décontractées. Je n’avais pas encore chanté en compagnie de Michel Cusin, futur président de Lyon II (décédé il y a un ou deux ans, hélas) et collègue de Jacques Aubert, aussi brillant que lui. C’était sous la direction de Bernard Tétu, dans les Choeurs de l'orchestre de Lyon.
Il y avait encore Claude Burgelin, homme subtil, agréable et modeste. Sa femme, psychanalyste, qui écrit sous le nom de Béatrice de Jurquet (je conseille La Traversée des lignes, et Le Jardin des batailles), était présente. Il y avait enfin Adolphe Haberer, lui aussi de Lyon II. Oui, je sais, ça va finir par faire beaucoup de majuscules, mais c’est qu’il y a beaucoup de noms de personnes.
Denis Vasse, il faut quand même dire que c’était lui le maître des cérémonies. Il est possible que certains diraient « gourou ». Ce qui est sûr, c’est qu’avec lui aux commandes, l’auditoire avait intérêt à s’accrocher. Ce n’est pas n’importe qui, cet homme-là. Bien qu’il soit jésuite (oui oui, S. J.), il a écrit un des livres les plus merveilleux qu’il m’ait été donné de lire.
C’est L’Ombilic et la voix. Sous-titre : « Deux enfants en analyse ». C’est du costaud. Beaucoup trop costaud pour moi sur le plan technique : quand ça part dans le dur du psychanalytique, je le dis honnêtement, je suis complètement dépassé. Mais ce livre, je ne l’ai pas lu comme un exposé aride, non, je l’ai lu comme un roman. C’est le récit de deux aventures, des enfants emmurés au départ dans quelque chose que je ne saisis pas.
L’art (je ne trouve pas d’autre mot) de l’auteur est de faire alterner l’aridité des exposés et l’intensité des dialogues tenus au cours des séances entre l’enfant et lui. Et l’on perçoit, au fil du temps, qu’un petit être humain voit se fendiller une carapace, et sent l’air commencer à circuler autour de lui et en lui. L’impression qui s’en dégage, quand tu fermes le livre, est très puissante. La force vient sans doute aussi du fait que le texte est accompagné des dessins des gamins, et là, plus de doute : entre les premiers et les derniers, quelque chose de vital s’est passé. Bref, je ne comprends pas tout, mais ça percute fort. Je pourrai une autre fois dire quelques petites choses des deux séminaires auxquels j’ai participé.
Bref, tout ça pour dire que Jacques Aubert fit une communication. Dont je ne me souviens pas du premier, et encore moins du dernier mot. Mais de grande classe. Car c’est un homme très discret, mais de toute première force, et d’une envergure majestueuse. Tout ce qu’il faut faire pour arriver au but, c’est incroyable. Mais vous voyez que je ne pouvais pas faire autrement.
Voilà ce que je dis, moi.
Promis, demain, on arrive au livre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ulysse, james joyce, hermann hesse, le loup des steppes, erroll garner, thomas mann, marcel proust, louis-ferdinand céline, la recherche du temps perdu, voyage au bout de la nuit, jacques aubert, valéry larbaud, le corbusier, denis vasse, michel cusin, bernard tétu, claude burgelin, béatrice de jurquet, psychanalyse, l'ombilic et la voix

