mercredi, 02 septembre 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Signé Picpus.
Maigret a reçu un billet annonçant le meurtre d’une voyante à cinq heures : « Demain, à cinq heures de relevée, je tuerai la voyante. Signé : Picpus ». La voyante est effectivement tuée. Il trouve chez elle, derrière une porte fermée à clé, un type qui se présente comme M. Le Cloaguen, un chétif qui bredouille en répondant aux questions et visiblement à côté de ses pompes.
On apprendra qu’il est en fait le père de la « voyante », dans une autre vie, puis qu’il fut clochard sur la Côte d’Azur, puis qu’il a été « embauché » par Mme Le Cloaguen pour, dans un premier temps, emmurer le cadavre du vrai Octave Le Cloaguen dans la cave de la villa du midi (mort sans doute naturelle), et dans un deuxième temps, pour jouer le rôle du « mari » (de "substitution") de Mme Le Cloaguen. A l’état-civil, il s’appelle Picard.
C’est qu’un Argentin richissime avait, à une époque maintenant ancienne, fait une croisière à bord duquel le vrai mari de la dame exerçait comme médecin, et avait sauvé sa fille de la mort (maladie tropicale). En récompense de ce haut fait, l’Argentin avait alloué à Le Cloaguen une rente annuelle de 200.000 francs, mais rigoureusement personnelle et devant s’éteindre avec la mort du bénéficiaire.
On comprend que sa femme ait voulu à tout prix cacher la mort de son mari pour continuer à jouir de cet argent tombé du ciel. C’est la raison pour laquelle elle a jeté son dévolu sur cette sorte d’épave humaine, qui a vu là une occasion de finir ses jours de façon pas trop compliquée. Mais Mme Le Cloaguen est en réalité une furie, elle terrorise le pauvre diable, auquel elle tient la laisse très courte (« Vous êtes comme un chien en laisse … », lui lancera Maigret), lui donnant à peine à manger, le logeant dans une chambre misérable de son riche appartement et n’autorisant qu’une petite balade d’une heure chaque jour.
C’est d’ailleurs au cours d’une de ses promenades qu’il tombe sur sa fille perdue de vue depuis longtemps. Celle-ci survit grâce à son « métier » de « voyante ». Or c’est par là que le drame va se nouer : elle a un amant qui se fait appeler « M. Blaise », qui est en réalité à la tête d’une vaste entreprise de chantages en tous genres très rémunératrice.
Blaise a appris les dessous de la situation de Mme Le Cloaguen et s’apprête à mettre la main sur la rente qu’elle touche indûment, ayant appris l’histoire du cadavre emmuré dans la cave de la villa du midi. Jeanne, la voyante, redoute les menaces que ce nouveau chantage va faire peser sur la vie de son père, et s’apprête à tout révéler.
Blaise ne l’entend pas de cette oreille et fait venir Justin de la Côte d’Azur pour « régler » la situation. Or au moment où le malfrat frappe à la porte de la voyante pour exécuter son contrat, le père est en train de rendre visite à sa fille. Celle-ci l’enferme dans une sorte de cabinet, et fait entrer celui qui est venu pour la tuer. C’est là que Maigret découvrira le cadavre, en même temps que, éberlué, la présence du bonhomme, qui a forcément entendu la scène du meurtre.
Quand il finit de démêler l’écheveau assez diaboliquement emberlificoté, il fait face à une Mme Le Cloaguen intraitable : elle sait qu’elle ne risque qu’une peine légère devant le tribunal (simple escroquerie, n’est-ce pas, dont la fille de l'Argentin, c'est-à-dire la victime, désormais cinquantenaire, se soucie comme de sa première chemise) et le nargue avec effronterie.
Le titre du roman s’explique par les circonstances : un certain Mascouvin, qui fait partie de la bande, a décidé de prévenir la police, mais anonymement. C’est au chapitre VI que Maigret comprend l’astuce, au moment où il va boire un coup dans le café fréquenté par Mascouvin, sur un calendrier mural faisant la publicité d’une entreprise de déménagement située rue Picpus. Quel imbécile, ce Mascouvin, qui va jusqu'à se précipiter dans la Seine, mais seulement après avoir heurté de la tête une pile de pont qui passait par là. Il en réchappe.
J’ai passé sous silence les passages où, à l’auberge du Beau-Pigeon, à Morsang, M. Blaise se fait régulièrement passer pour un fondu de pêche au brochet, alors qu’en réalité il se les fait servir par un employé de l’auberge, après avoir pu rencontrer ses acolytes (Justin, qui fait la navette entre Paris et la Côte d'Azur) dans les hautes herbes des marais, bien à l’abri de tous les regards indiscrets. J'ai passé sous silence le personnage d'Emma, dont le tueur Justin est l'amant et qui a fait lanterner Maigret en faisant semblant de ne pas le reconnaître sur les photos. J'ai enfin passé sous silence le personnage de Mme Biron, soeur du vrai Le Cloaguen qui, à son arrivée dans l'appartement de sa belle-soeur, dévoile aussitôt la supercherie aux yeux de Maigret : Le Cloaguen n'est pas Le Cloaguen.
Une belle mécanique romanesque, bien huilée et, pour une fois, pas trop tirée par les cheveux.
(Château Terre-Neuve, Fontenay-le-Comte, 1941).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, signé picpus
lundi, 31 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Les Caves du Majestic.
Trois putains travaillaient dans le temps sur la Côte d’Azur, Gigi, Mimi et Charlotte. Mimi a eu un enfant de Prosper Donge, roux comme son père, mais elle a fait croire à M. Clark, un très riche Américain, que l’enfant est de lui. Etant amoureux, Clark a épousé Mimi. Ils vivent aux Etats-Unis. Au moment de l'action, Donge vit avec Charlotte, en banlieue parisienne et prend son vélo pour aller travailler.
Donge s’occupe de la "caféterie" (c'est le mot de Simenon pour la chose) du Majestic, et rentre le soir à son domicile, où il n’a que le temps de manger en compagnie de Charlotte avant que celle-ci n’aille prendre son service. Le comptable, Ramuel, a passé sa vie à faire des faux en écriture. Il tient un compte très précis de tout ce qui sort de la caféterie en direction des chambres. On apprendra qu'il a écrit des lettres à Mme Clark (Mimi) pour lui demander de l’argent, en imitant parfaitement l’écriture de Donge, le père de l’enfant. Il a pu lire furtivement une des lettres que celui-ci lui avait écrites : c'est cette occasion qui lui a donné l'idée d'une escroquerie rentable.
Mais voyant le couple américain s’installer au Majestic, il craint plus que tout une éventuelle rencontre entre Mimi et Prosper Donge, qui ferait éclater la vérité au sujet des demandes d’argent. Au moment supposé du rendez-vous que les anciens amants s'étaient donné dans le vestiaire du personnel, Ramuel l’étrangle et cache le cadavre dans un box du vestiaire réservé au personnel de l’hôtel. C'est qu'un pneu du vélo de Donge a crevé, ce qui a occasionné un retard de dix minutes (ailleurs dans le roman, Simenon parle d'un quart d'heure).
Donge découvre le cadavre. C’est lui le premier suspect, et Maigret l’envoie en prison, bien qu’il le croie innocent. Justin Colleboeuf, qui travaille aussi à l’hôtel (portier de nuit ?), a assisté au meurtre et menace Ramuel de le dénoncer : ce dernier le tue et pousse le cadavre dans le même placard n°89.
Charlotte, toute seule depuis l’incarcération de Prosper, fait venir Gigi, toujours prostituée, et droguée par-dessus le marché, pour avoir de la compagnie. Ramuel s’apprête à partir pour la Belgique pour toucher ses 280.000 francs, fruit de ses extorsions frauduleuses auprès de Mimi (Mme Clark).
Il s’est fait envoyer les chèques à une adresse fictive, où le courrier était réexpédié à une boîte postale privée acceptant les identités sous forme de simples initiales. Cette boîte est tenue par un drôle de personnage : « un vieux bonhomme répugnant », un « cloporte » (p.269-270). On apprendra qu’il s’appelle Jean-Baptiste Isaac Meyer : il est juif. Simenon a écrit le roman à Nieul-sur-Mer pendant l’hiver 39-40 (voir mon billet du 22 août).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, les caves du majestic
dimanche, 30 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Cécile est morte.
Au début, les collègues plaisantent Maigret au sujet de Cécile, cette jeune femme chargée d'un gros sac qui vient l'attendre en espérant qu'il la recevra.
Juliette Cazenove, qui vit à Fontenay-le-Comte, a un amant du nom de Dandurand, mais elle épouse Boynet, qui apporte l’héritage d’une riche famille. Le couple déménage pour Paris, où il est propriétaire d’un immeuble de cinq étages à Bourg-la-Reine, dont il occupe le dernier.
Mais un jour dans Paris, les deux amants se retrouvent et renouent leur relation. Lui tenait un office d'avoué, mais il a été rayé des listes parce qu'il avait la réputation d'aimer un peu trop les petites filles. Cette fois, Dandurand a à peine proposé à Juliette de supprimer le mari qu’elle approuve : ils vont l’expédier – pas trop vite – en lui faisant absorber régulièrement une petite dose de poison genre arsenic.
Le mari expédié sans conséquences judiciaires, Dandurand vient s’installer dans l’immeuble, mais au quatrième, car ils tiennent à ne pas donner l’éveil et se rencontrent toujours dehors. La particularité de l’immeuble est que l’on entend rigoureusement tout ce que font les voisins, et que Dandurand ne perd donc absolument rien de ce qui se passe dans l'appartement de Juliette.
Celle-ci avait, à la mort de leurs parents, recueilli les trois enfants de sa sœur. « Recueilli » est un bien grand mot : elle a réussi, à force de traitements dégradants, à dégoûter Gérard et Berthe, qui ne supportent pas la vie qu’elle leur fait, mais elle a gardé Cécile, qui est une trop brave fille qu’elle loge et dont elle abuse de la serviabilité. Berthe, de son côté, s’en sort plus ou moins, mais Gérard va de petit boulot en petit boulot et tire le diable par la queue. Or sa femme Hélène attend un bébé.
La tante Boynet fait de drôles d'affaires grâce aux relations peu recommandables de Dandurand : Maigret a eu à faire dans le passé à plusieurs de ces "messieurs" aux costumes rayés et aux bagouses ostentatoires. Dandurand apporte régulièrement des dizaines de milliers de francs provenant de la "collecte" des "loyers", qu’elle garde dans un tabouret bas couvert de tapisserie. Par précaution, la tante fait boire, les soirs de remise, une tisane à Cécile, mais additionnée de bromure qui la fait dormir, pour opérer dans la discrétion.
Or un soir, Gérard est venu demander de l’argent à Cécile, qui n’en a pas, mais qui a caché son frère sous le lit, puis qui lui donne à manger pain et fromage avec un verre de vin, mais aussi la tasse de tisane qui ne lui est pas destinée. Et pendant que Gérard roupille, Cécile entend le micmac des deux complices, entrouvre la porte et aperçoit le « coffre-fort » plein de billets. Quand l’homme est parti, elle vient demander de l’argent à sa tante. Refus catégorique. Cécile l’étrangle.
Dandurand, à l’étage en dessous, a tout entendu. Entrouvrant sa porte, il aperçoit Cécile et Gérard qui s’enfuient après avoir mis dans un sac toutes les paperasses compromettantes qu’ils ont prises dans le secrétaire. Gérard rentre chez lui. Cécile, chargée de son sac volumineux, se rend au quai des Orfèvres où elle veut se constituer prisonnière.
Mais Dandurand l’a suivie, demande à un petit voyou qui est là de lui dire que le commissaire Maigret l’attend, lui fait franchir une porte derrière laquelle Dandurand l’attend, l’étrangle et repart avec le sac. Inutile de dire que l’assassin ne l’emportera pas en paradis.
« Nieul-sur-Mer, hiver 1939-1940 ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, cécile est morte
samedi, 29 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
Maigret se fâche.
Maigret est à la retraite, il fait son jardin dans la maison qu’il habite à Meung-sur-Loire avec son épouse. Arrive une vieille dame en deuil, visiblement riche (voiture avec chauffeur) et habituée à commander. Elle a pris Maigret pour le jardinier. Elle lui ordonne de s’intéresser à la mort de sa petite-fille Monita, apparemment suicidée par noyade, mais elle n'en croit rien. Maigret s’habille et suit docilement cette Bernadette Amorelle, de la maison Amorelle et Campois, énorme entreprise qui règne sur les sablières et gravières de la Seine et diverses autres branches d’activités.
M. Amorelle est mort quelques années auparavant. Maigret descend à l’auberge de l’Ange, à Orsenne, tenue de façon très négligée par Jeanne, aidée de Raymonde, la servante. Il est aussitôt alpagué par Ernest Malik, un ancien condisciple du lycée de Moulins que ses camarades appelaient le Percepteur. C'est manifestement un personnage important de la localité. Malik tutoie d’emblée le policier. Il jouit d’une situation sociale opulente, mais tapageuse : le type même du self-made-man qui écrase les autres de sa supériorité.
L’assurance arrogante de Malik déplaît fortement à Maigret, qui accepte cependant l’invitation à dîner. Malik a deux fils : Jean-Claude, aussi arrogant et antipathique que son père, et Georges-Henry, que son père tient enfermé dans une chambre. L’adolescent était très intiment lié à sa cousine Monita, et peut-être même amoureux d’elle. Il a une sensibilité à vif.
Le lendemain, à nouveau invité à un repas où se trouveront le frère Charles et la belle-sœur (Aimée) de Malik, Maigret a une algarade violente avec celui-ci, qui va même jusqu’à la menace : il lui ordonne de rentrer à Meung-sur-Loire. Maigret, quoiqu'il n'exerce plus de fonction légale, s’empresse de n’en rien faire, à ses risques et périls.
Il apprendra que Malik a épousé la fille aînée de Mme Amorelle, alors que c’était la cadette, Aimée, qui était éperdument amoureuse de lui. Comme elle était trop jeune à ce moment-là, il a, quelques années plus tard, fait venir son frère Charles auprès de lui, un garçon falot, dépourvu de sa superbe assurance, et lui a fait épouser Aimée. Cette désormais belle-soeur lui voue toujours une adoration éperdue, et est prête à tout pour le servir.
Sans aucun scrupule, il a fait des enfants aux deux sœurs, et c’est en apprenant que Georges-Henry, dont elle était amoureuse, était son demi-frère que Monita a décidé de se suicider. Lui est prostré dans la terreur et la haine de son père. Maigret finira par l’apprivoiser avec l’aide de « Mimile du cirque », après l’avoir libéré de sa cave et avoir empoisonné les deux danois d’Ernest. Celui-ci les menace de son revolver, mais finalement les laisse partir.
C’est la vieille Mme Amorelle (quatre-vingt-deux ans) elle-même qui réglera son compte au salopard à coups de revolver. Elle a fini par admirer l’ancien commissaire. On doit le titre à la colère de Maigret devant la veulerie et la lâcheté de Campois, qui dirige théoriquement les sablières Amorelle et Campois, mais qui est en réalité sous la coupe d'Ernest Malik qui le terrorise après l'avoir progressivement dépouillé en douce. Pour empêcher Campois de parler à Maigret, il lui a "suggéré" de faire une croisière dans les fjords de Norvège, et le pauvre homme était en train de s'exécuter bon gré mal gré quand le commissaire s'est imposé.
Roman écrit à « Paris, rue de Turenne, juin 1945 ».
Simenon avait l'écriture facile : dix ou douze romans par an. Il avait minutieusement calibré son temps en fonction de la fabrication de ses œuvres. On peut s'en rendre compte grâce au calendrier annoté en vue de l'écriture de Le Chat (noté "Epalinges (Vaud), 5 octobre 1966") : sept jours pour l'écriture et quatre pour la révision une dizaine de jours plus tard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret se fâche
vendredi, 28 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
L'Ombre chinoise.
Oscar Couchet est un campagnard qui voulait réussir et gagner de l’argent. Marié à Juliette, il a longtemps partagé avec elle la vache enragée. Elle en avait marre de cette vie et, côtoyant Edgar Martin, fonctionnaire à l’Enregistrement, elle est devenue sa femme après avoir divorcé. Martin a une situation stable, mais il manque d’ambition en même temps qu’il est très lâche : une vraie larve. Couchet, au contraire, a fini par gagner énormément d’argent à la direction des « sérums Rivière » : il est millionnaire.
Or les laboratoires de l’entreprise sont situés au 61 de la place des Vosges, là précisément où Juliette et Edgar Martin ont leur appartement, et les anciens époux se croisent régulièrement, la femme toisant avec mépris cet homme qui a brillamment réussi. Il a épousé une femme Dormoy, d’excellente famille, et habite pour son compte un très bel appartement boulevard Haussmann. Ils ont très peu de relations.
Couchet a eu avec sa première femme un fils prénommé Roger qui, malgré les efforts déployés par sa mère pour lui donner une éducation, est devenu un propre à rien qui se drogue en compagnie de conquêtes féminines fugitives et tout aussi paumées. Roger finit par se jeter pas la fenêtre de l’hôtel.
A chaque fin de mois, Couchet passe à la banque pour retirer la paie des employés : 300.000 francs en billets neufs (des francs de 1931) qu’il entrepose provisoirement dans le coffre-fort qui se trouve dans son dos quand il est à son bureau. Un jour, la concierge de l’immeuble appelle la P.J. et fait venir le commissaire Maigret pour qu’il constate la mort de Couchet. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Le coffre est vide.
C’est Martin qui, au moment où Couchet s’est absenté pour pisser, est entré dans le bureau et a fait main basse sur l’argent. Mais il a oublié un de ses gants sur le bureau, l’imbécile ! C’est ce qu’a constaté Juliette Martin, qui, de sa fenêtre, l’a surveillé et n’a rien perdu de la scène. Elle prend le revolver, descend pour réparer l’étourderie de son crétin de mari. Manque de chance, Couchet est revenu des toilettes. Elle le tue, puis court vers les poubelles pour y dissimuler son arme. A M. Saint-Marc, l'ancien ambassadeur qui fait les cent pas dans la cour en attendant que sa femme ait accouché au premier étage, elle dira être venue rechercher une petite cuillère en argent.
Remontée dans son appartement, elle attend son mari qui, chargé des billets, mais complètement affolé par la situation, ne sait plus quoi faire. Il ne trouve rien de mieux à faire que de jeter les billets dans la Seine. On les retrouvera quelques jours plus tard flottant à la surface au barrage de Bougival. Fureur dévastatrice de l'épouse.
Couchet a rédigé un testament où il demande que sa fortune soit partagée à égalité entre ses « trois femmes » : Juliette Martin, sa première épouse, l’actuelle et la danseuse de cabaret qu’il entretient depuis un an. Maigret fait cueillir Martin au moment où il allait passer en Belgique, où son épouse comptait le rejoindre après avoir hérité. Quand elle se rend compte que Maigret a compris tout le scénario et que tout lui échappe, Juliette Martin devient folle. Elle est conduite à Sainte-Anne, pendant que son mari « sanglotait tout seul dans l’escalier vide ».
Roman écrit à Antibes, aux "Roches-Grises", en décembre 1931.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'ombre chinoise
jeudi, 27 août 2020
UN PETIT MAIGRET ...
... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.
L'Affaire Saint-Fiacre.
La comtesse de Saint-Fiacre assiste à la première messe, très matinale, à l’église de Saint-Fiacre, près de Moulins. C’est le Jour des Morts. Maigret est là. Il est né dans la maison du régisseur du château de Saint-Fiacre, régisseur qui n’était autre que son père à l’époque. Le vieux comte de Saint-Fiacre était très attaché aux traditions : pas de whisky dans l’armoire aux alcools. Le domaine occupait deux cents hectares.
Les affaires étaient florissantes. Mais, du jour où le comte est mort, tout a périclité. La comtesse s’est révélée une gestionnaire catastrophique, et les fermes, les terrains, le château lui-même ont été soit vendus, soit hypothéqués. C’est que Maurice de Saint-Fiacre est un bon à rien, qui mène une vie de barreau de chaise à Paris et qu’il réclame sans cesse de l’argent à sa mère, qui lui donne sans compter.
Maigret a reçu de la gendarmerie de Moulins un curieux papier annonçant qu’un crime doit être commis précisément dans l’église, pendant la première messe. Maigret n’a pas quitté des yeux la comtesse, qui était installée dans les stalles en bois du chœur. Rien de suspect apparemment ne s’est produit, et pourtant, à la fin de la messe, force est de constater que la comtesse est morte. « Arrêt du cœur », diagnostique le docteur Bouchardon. On apprend qu’elle avait le cœur très fragile.
L’attention de Maigret est attirée par l’absence du missel que la comtesse tenait dans les mains pendant la messe. Il finit par mettre la main dessus et, à la page du Jour des Morts, il trouve un papier imitant une coupure de journal, où l’on apprend que le comte s’était en réalité tiré une balle dans la tête. C’est cette « information » qui a provoqué l’arrêt du cœur. C’est donc un crime, même s’il n’est pas passible des tribunaux.
Le régisseur actuel, le vieux Gautier, déclare à Maigret qu’il n’a pas cessé de renflouer les affaires du château. Son fils Emile est employé au Comptoir d’Escompte de Moulins. Mais la comtesse entretenait des « relations » avec divers jeunes hommes successifs dont la fonction officielle était « secrétaire ». Jean Métayer était le « secrétaire » actuel, homme désagréable et fuyant. Maurice de Saint-Fiacre n’a rien à cacher, il est franc du collier.
C’est au chapitre X (beaucoup de Maigret se terminent au onzième) que se situe une scène d’anthologie : Maurice a convié tous les acteurs à un grand repas, alors que le cadavre de la comtesse, à l’étage, reçoit la visite de tout ce que la région compte de paysans. Et il se lance en pleine table dans un discours flamboyant, dans lequel il accroche successivement tous les convives (sauf le commissaire évidemment, auquel il ne cesse de faire signe sous la table du bout de la chaussure). Il n’épargne personne.
Il annonce qu’à minuit, l’assassin de la comtesse sera mort. Il a posé au milieu de la table un revolver chargé, à égale distance de tous. A un moment, n’y tenant plus, c’est le jeune Emile qui s’en saisit et qui fait feu. Maurice s’écroule, mais les balles étaient à blanc, et il ne tarde pas à ressusciter.
On aura appris au cours de cette scène formidable que c’est le vieux régisseur qui, au fur et à mesure des ventes, a tout racheté et que c’est donc lui le propriétaire de la majeure partie du domaine. Quant à son fils, c’est lui qui, sur une linotype du journal de Moulins, a composé le message assassin. Alors Maurice se livre sur la personne d’Emile à un cassage de gueule en règle. Quant au gigolo et à l’avocat qu’il avait fait venir (il figure sur le testament), ils s’esquivent sans tambour ni trompette. Pour finir, Maurice de Saint-Fiacre invite les gens présents à l’accompagner dans la chambre mortuaire pour une veillée funèbre autour de sa mère.
Roman écrit à Antibes, au "Roches-Grises", en janvier 1932.
08:26 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'affaire saint-fiacre
jeudi, 17 novembre 2016
THRILLER, POLAR ET NOIR
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
LES RIVIÈRES POURPRES
 J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.
J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.
Lire en série des Maigret, des San Antonio, voire des Manuel Vasquez Montalban (Roldan ni mort ni vif, La Rose d'Alexandrie, Le Quintette de Buenos Aires, ...) ou des Michael Connally (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, Les Egouts de Los Angeles) produit le même effet : ça rentre par un neurone, et ça sort par l’autre. Cette littérature n’est pas faite pour s'éterniser dans son lecteur et, pourquoi pas, le modifier, comme le font certains certains chefs d'œuvre.
Tout ça pour dire que, bien je ne me nourrisse pas que de lectures « sérieuses » ou de « grande littérature », et que moi aussi, j’aime juste passer de temps en temps « un bon moment », je n’en confonds pas pour autant ces différents registres, qui s'adressent à des niveaux, à des hauteurs très différents du lecteur : il y a une hiérarchie des valeurs littéraires, n'en déplaise aux "abatteurs de frontières". Moins ambitieux par principe, les « polars », « thrillers », « noirs » ne sont pas faits, au moins a priori, pour prendre racine durablement dans l’esprit de celui qui les prend en main. Ce sont des livres « à consommer ». Or on sait comment finit ce que nous consommons : au trou. Passons vite.
Car je viens de relire Les Rivières pourpres. C’est vrai que c’est le genre de livre qui « fait passer le temps », mais c’est du temps perdu. Inutile de partir à sa recherche. A cause de la structure particulière de tous les romans qui finissent sur le dévoilement du mystère ou de l’énigme, que l’auteur nous y livre l’identité du coupable, reconstitue l'enchaînement des faits et le rôle de chacun des personnages, ou qu’il expose la nature du complot qui a été mis en échec.
Ces livres (tout comme les films), dont l'intégralité du travail de construction de l'intrigue est orientée en direction d'une fin conçue comme la solution d'un problème, ces livres dont il ne faut surtout pas raconter la fin sous peine de passer pour un gougnafier qui vous savonne la planche de salut, ces livres qui perdent tout intérêt aux yeux de ceux qui ne l'ont pas lu dès qu'on vient de leur dire qui a tué, ces livres où le détective (le commissaire fait aussi ça très bien) est à l'arrivée tel qu'il était au départ, pli du pantalon et brushing compris (ragoût de mouton mitonné par Germaine toléré), ces livres ont moins de valeur que Lucien Leuwen ou Illusions perdues, où les personnages subissent jusque dans leur être l'action du temps, des autres et des événements. Il y a une trajectoire indéterminée dans la grande littérature. Dans le polar etc., il y a une boucle : le point d'arrivée était le point de départ. L'écrivain sait où il va, ce qu'il fait. Je simplifie. Je schématise. Je caricature. Je sais qu'il y a des exceptions. N'empêche que.

Je n'ai pas vu le film.
Dans Les Rivières pourpres, il s’agit d’un complot. Il y a des coupables. Beaucoup de coupables. Et très peu d'innocents, à commencer par le commissaire Niémans, qui s'occupe de l'affaire, capable de tuer un supporter de football trop violent. Même le lieutenant (on ne dit plus "inspecteur") Karim Abdouf, qui partage l'enquête avec lui, porte quelques menues peccadilles sur la conscience, et n'hésite pas au besoin sur les moyens à utiliser pour arriver à ses fins.
Prenez un beau complot, façonnez-le méticuleusement pour lui donner une forme définitive et présentable. C’est en général dans les dernières pages du roman que la grande explication vous sera donnée par un des principaux personnages, qui vous mettra sur la table la carte géographique de toute la machination et en reconstituera sous vos yeux éberlués la logique implacable.
Grangé vous place ici dans une université renommée située dans un patelin improbable (Guernon ne figure pas dans le répertoire des communes de France), non loin de Grenoble. Au sein de l’université est installée une caste archi-héréditaire de chercheurs brillants, qui vit depuis très longtemps en autarcie. Les mariages de plus en plus consanguins ont produit de véritables phénomènes intellectuels, mais en faisant de ces phénomènes des petites natures au plan physique. Mais aussi des malades mentaux.
Pour donner un coup de fouet régénérateur à cette fin de race, deux illuminés de la génération qui précède la présente ont élaboré un magnifique plan : un aide-soignant de la maternité et le chef de la bibliothèque universitaire. Le premier, à chaque fois qu'une des universitaires concernées va mettre bas, substitue au bébé celui d’une femme venant d’un village de montagne (Taverlay, lui aussi inconnu au bataillon), parce que c’est bien connu : les enfants d’universitaires ont des corps chétifs, alors que les petits montagnards sont des forces de la nature. Tout le monde sait ça. Ainsi va-t-on fabriquer des enfants qui auront à la fois un grand cerveau et un corps à toute épreuve : des savants et des alpinistes hors-pair. Je ne sais plus quel autre illuminé voulait collecter le sperme de tous les prix Nobel pour en féconder des femelles de compétition. C'est sur un tel fantasme que le bouquin est bâti.
Après l'école, les gamins intègrent l'université. C'est là que le bibliothécaire intervient. De son côté, il falsifie les états-civils pour dissimuler l’opération et s’arrange pour toujours placer (c'est lui qui assigne à chacun sa place) le même garçon en face de la même fille. Et devinez ce qui arrive : dans 70% des cas, ça finit par un mariage qui assurera la régénération de la race : si, si, c'est comme ça que ça marche ! Du moins à ce qu'on dit. Que l’aide-soignant et le bibliothécaire du bouquin soient de complets tarés mentaux, schizophrène ou paranoïaque, en tout cas des psychopathes accomplis, n’a finalement rien d’étonnant.
Si le bouquin souffre d’une faiblesse, c’est bien 1 - à cause de ce projet foireux, qui aboutit contre toute vraisemblance à la formation d'individus qui sont des forces de la nature (intellectuellement et physiquement), et 2 - à cause de cette invraisemblable façon de procéder, poursuivie inlassablement sur au moins deux générations. Conclusion : thèse, hypothèse, foutaise. C’est dommage, parce que, du coup, ça dégonfle tant soit peu la baudruche.
C’est d’autant plus dommage que tout le reste est absolument remarquable. Le commissaire déséquilibré qui a des crises de violence pure, le lieutenant Karim Abdouf en dreadlocks qui pique une voiture, la scène dans le caveau du cimetière de Sarzac (Lot ?), ça c'est de la peinture. Le découpage et la succession des séquences comme un montage cinématographique fiévreux, l’agencement des situations, les caractères des personnages comme leurs relations, la construction logique de l’édifice, tout cela s’emboîte à la perfection.
Techniquement, ce thriller-polar-noir est donc irréprochable, parce qu'il laisse espérer la découverte de quelque chose d'inouï, de grandiose, d'extraordinaire. A l'arrivée, on reste sur sa faim, un peu déçu de tomber sur une petite magouille improbable. Cela veut dire que l’ « idée » qui est au départ du roman, qui est admirablement servie par un « métier » incontestable, un métier de malade, genre M.O.F. (col tricolore) ou Compagnon du Tour de France, ne se situe malheureusement pas à la même hauteur que la mécanique savantissime artistement élaborée pour la mettre en valeur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, jean-christophe grangé, les rivières pourpres, le vol des cigognes, le concile de pierre, l'empire des loups, commissaire maigret, san antonio, michael connally, le poète connally, la blonde en béton, le cadavre dans la rolls, les égouts de los angeles, polar, roman noir, roman policier, thriller
jeudi, 26 mai 2016
FÉLICITÉ DE LA CROIX-ROUSSE
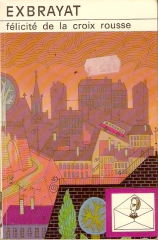 Félicité de la Croix-Rousse est un petit polar écrit en 1968 par Charles Exbrayat. L’intérêt de ce bouquin serait trop mince pour que quelqu’un d’un peu équilibré ose en faire état, si l’action ne se passait pas, précisément et exclusivement, sur le plateau de la Croix Rousse, si l’on excepte une excursion du policier dans les locaux du Progrès pour une consultation de vieux numéros. Si je l’ai rouvert, c’est uniquement parce qu’il y est question de Lyon, et en particulier de cette « Colline aux canuts », chère au cœur de Roland Thévenet, l’auteur d’une pièce de théâtre qui porte ce titre.
Félicité de la Croix-Rousse est un petit polar écrit en 1968 par Charles Exbrayat. L’intérêt de ce bouquin serait trop mince pour que quelqu’un d’un peu équilibré ose en faire état, si l’action ne se passait pas, précisément et exclusivement, sur le plateau de la Croix Rousse, si l’on excepte une excursion du policier dans les locaux du Progrès pour une consultation de vieux numéros. Si je l’ai rouvert, c’est uniquement parce qu’il y est question de Lyon, et en particulier de cette « Colline aux canuts », chère au cœur de Roland Thévenet, l’auteur d’une pièce de théâtre qui porte ce titre.
Ce n’est pas pour dire, mais Exbrayat, qui n’est que stéphanois (« Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d’un peu partout », La Plaisante sagesse lyonnaise, Catherin Bugnard : à noter qu’Exbrayat cite le nom de ce pseudonyme du politicien Justin Godard et même celui de l’Académie des Pierres Plantées qu’il avait fondée), connaît assez bien la Croix-Rousse, et pour un adepte de l’ASSE et du « chaudron » de Geoffroy-Guichard (celui-là même des Guichard-Perrachon qui ont fondé Casino), il n’en dit pas trop de bêtises. Ma foi, je n’en veux pas trop à Exbrayat de l’hommage que ce Vert, dans Félicité de la Croix-Rousse, rend à la capitale des Gaules, ou plus précisément à son quartier le plus ... à son quartier le plus .... Bref, le quartier que ce nom de Félicité caractérise à merveille (soit dit en toute objectivité, cela va de soi).
Son repérage des lieux est impeccable : le terrain de jeu de l’inspecteur (pardon, il faudrait dire l’O.P.) Darius Méjean se situe, d’est en ouest (du Rhône à la Saône), entre les rues Joséphin-Soulary et Chazière et, du nord au sud (de Caluire à la limite des « Pentes »), entre la rue Henri-Chevallier et le boulevard de la Croix-Rousse, où se trouve la poissonnerie « Les Pêcheurs réunis » (sans doute celle qui est devenue « Vianey »). Mais pourquoi faut-il que l’auteur fabrique de toutes pièces un « boulevard Carnot » ? Mystère.
Exbrayat a visiblement parcouru la Croix-Rousse, ce quartier inimitable, dont il rend finalement assez bien compte, pour un étranger, du « climat » particulier, de la place Commandant-Arnaud à la rue Victor-Fort, en passant par la rue Dumont, la rue Henri-Gorjus et la rue de Cuire (rue de Cuir en version imprimée !). J’imagine que c’est à des contraintes propres à la fiction qu’il imagine que la rue Henri-Gorjus possède un n°104 et la rue Chazière un n°326, rues qui, certes, ne sont pas les plus courtes, mais se gardent bien d’atteindre le n° 100 (ce numéro si présent dans les œuvres de jeunesse d’Alfred Jarry, à cause de l’aspect odoriférant et du « balai innommable » qui s’y rapportent).
L’autre côté sympathique de ce petit roman de Charles Exbrayat, c’est qu’il invente deux ou trois personnages de vrais Lyonnais de l’ancien temps, qui puisent leur vocabulaire dans la malle au trésor que constitue le Littré de la Grand’Côte. Voilà qui a dû faire plaisir en son temps aux mânes de Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu. Le meilleur dans le rôle du Lyonnais fondamental s’appelle ici Ulysse Nizerolles, balayeur des rues de son état, et copain de régiment de l’inspecteur (pardon : de l’O.P.) Méjean.
Voilà un personnage ! Obligé de limiter sa consommation quotidienne à cinq litres de vin, il a l’impression de ne pas être à la hauteur de son défunt père, ancien des chemins de fer, qui en éclusait huit. Les pages où Exbrayat donne la parole à Nizerolles donnent un festival de lyonnaiseries.
Jugez plutôt : « Et qu’est-ce que tu grabottes dans ce coin ? », « Il me rencontre en train de balayer les équevilles », « une salade de clapotons », « il s’est fait un peu trop serrer le corgnolon », « T’as vu quand ils ont assassiné la Ficelle ». Ah, la Ficelle ! La mienne, c’était pas celle de la rue Terme, c’était la « Ficelle Croix-Paquet », celle avec la passerelle,
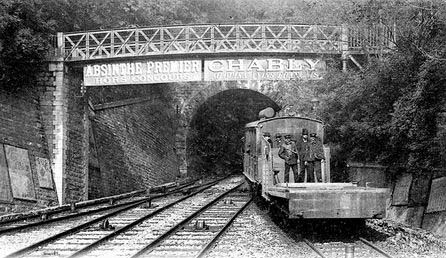
qu’on passait directement du jardin à la montée Saint-Sébastien, celle avec son « truck » à l’arrière, pour les animaux et les "encombrants" (comme on peut le voir ci-dessus).
Après le festival, le feu d’artifice : « perdre mon temps à bajafler », « elle est toujours à grollasser dans le coin pour apincher ce qui se passe », « mon Alfred, c’était une vraie charipe », « décancane pas, Darius », « la Marguerite, un vrai veson », « grand gognand », « j’ai pas le droit, le dimanche, de me bambaner avec des gones que je connais », « même maintenant, j’en suis encore tout coufle », « le garçon, il doit être pire que toutes ses sœurs réunies. Une bugne, quoi », « t’as bien tort de te bouliguer l’intérieur », « je me sens détrancané ». Ah non, ne comptez pas sur moi pour un glossaire. Trouver des notes de bas de page dans un polar, ce n’est pas courant. Ici, il n’en manque pas une.
On l’a compris, ce qui me plaît dans Félicité de la Croix-Rousse, c’est le côté très « couleur locale », l’ancrage dans le quartier dont je respire l’air depuis très longtemps, même si mon domaine, autrefois, était plutôt « les Pentes » que « le Plateau », du 16, rue Pouteau au gourbi du peintre Sorokine, des traboules que je connaissais par cœur (aucune n’était fermée) à la rampe métallique du passage Mermet, de P'tit Jo le clochard à l'église Saint-Polycarpe.
On peut ajouter à cette couleur locale les figures que l’auteur met en scène, en particulier la famille très particulière sur laquelle l’enquête se concentre. Les Sancourt, c’est cinq sœurs et un frère, tous restés vieux célibataires, tous racornis, tous séchés sur pied, qui semblent vivre sous la férule de l’aînée, Félicité. Nul n’a jamais osé franchir le pas de tomber amoureux. Et les deux velléités manifestées ont avorté. Mais c’est là-dessus que l’intrigue est fondée, alors …
Quant à l’inspecteur (pardon : l’O.P.) Méjean, à ses tribulations avec son chef le commissaire Blaise Bertrand, dit B.B., franchement, on s’en fiche un peu. Que les deux hommes se soient fâchés à cause d’un gratin dauphinois (faut-il ou non râper du fromage dessus ?), cuisiné par l’une des épouses et mal commenté par l’autre, je vois là un « running gag », rien de plus. Les tourments intérieurs et les scrupules de l’inspecteur (pardon : l’O.P.), ça fait plutôt remplissage que ça ne fait avancer l’action. Quant aux scènes à son domicile, en face à face avec l’épouse, je les trouve un peu épaisses.
Bref, tout ce qui se rapporte au côté policier du polar m’intéresse très moyennement, même si l'auteur dédie son livre « A Georges Simenon, notre maître ». Je garde l’évocation d’une Croix-Rousse vivante. Ce qui n’est, après tout, pas si mal.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman policier, polar, charles exbrayat, félicité de la croix-rousse, lyon, croix-rousse plateau, croix-rousse les pentes, catherin bugnard, la plaisante sagesse lyonnaise, justin godard, joséphin soulary, rhône saône, roland thévenet, la colline aux canuts, académie des pierres plantées, nizier du puitspelu, clair tisseur, le littré de la grand'côte, alfred jarry
mardi, 08 septembre 2015
MAIGRET HESITE
A l'occasion du nouvel an pataphysique (nous sommes présentement le 1 absolu de l'an 143 E.P., où le pataphysicien célèbre précisément la "Nativité d'Alfred Jarry"), qu'il me soit permis d'adresser au lecteur et à tous les Palotins tous mes vœux de prospérité morale et de santé mentale.

Autour de l' "herbe sainte", Alfred Jarry et le peintre Pierre Bonnard (mur peint au Grand-Lemps, 38690).
Sans entrer dans des considérations trop techniques, précisons que le calendrier pataphysique prend pour premier jour de l'année le premier (8 septembre 1873) jour d'existence d'Alfred Jarry. Il est réputé avoir formulé, juste avant de s'éclipser (un 2 novembre 1907 vulg., autrement dit "28 Haha E.P.", jour commémorant la "Fuite d'Ablou"), en guise de "dernière parole", cette immortelle demande : « Un cure-dents ».
*******************************************
Georges Simenon : Maigret hésite (tome XXVI, éditions Rencontre, 1973).
Cette fois, il s’agit d’un meurtre annoncé. Et ça interloque Maigret. Une lettre d’une grande courtoisie, presque neutre. Mais une lettre anonyme quand même, dans laquelle on lit : « Un meurtre sera commis prochainement ». Sa particularité est d’être écrite sur un papier très spécial, appelé « Vélin du Morvan » : « … un vélin épais et craquant … », dont l’en-tête a été soigneusement découpé. C’est précisément ce papier, qui n’est plus fabriqué que par un papetier, et acheté que par de rarissimes clients.
Maigret déboule donc chez Parendon comme un ours dans un jeu de quille, ce qui motive l’envoi de la deuxième lettre anonyme : il aurait dû respecter la marche à suivre indiquée et attendre d’être recontacté. Parendon est un juriste renommé, spécialisé dans le droit maritime, et qui s’occupe de grosses affaires. Des hommes importants viennent souvent le voir pour cela.
Pourtant l’homme ne paie pas de mine : il porte des lunettes « à verres très épais », Maigret serre « une petite main blanche qui semblait sans ossature », l’homme semble « petit et frêle, d’une curieuse légèreté ». Son épouse, qui s’est invitée sans prévenir au cours de l’entretien, déclare tout de go : « J’espère que vous n’êtes pas venu arrêter mon mari ?... Avec sa pauvre santé, vous seriez obligé de le mettre à l’infirmerie de la prison … ». Elle le considère comme une demi-portion, comme un gnome, comme une quantité négligeable. La charmante femme !
La secrétaire du monsieur est amoureuse de lui. Elle se nomme Mlle Vague. Elle ne lui refuse rien quand il a envie d’elle, au risque que Mme Parendon les surprenne en pleine action : la maison entière est garnie de tapis et moquettes à suffisance pour qu’elle puisse se déplacer sans être remarquée, et être ainsi au courant de tout ce qui s’y passe, à l’insu même des occupants. Le luxueux appartement de l’avenue de Marigny lui appartient, hérité de son père, M. Gassin de Beaulieu, lorsque celui-ci a pris sa retraite, se retirant dans son château de Vendée. L’époux n’a strictement rien changé aux meubles, aux objets, à la décoration. On dirait qu’il n’est pas chez lui.
M. Parendon a une manie, pardon : un « hobby ». Il est obsédé par l’article 64 du Code Pénal. Il s’est mis en tête de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le faire abroger. C’est l’article qui dit : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». Cela sous-entend peut-être dans son esprit que tout crime mérite châtiment, quel que soit l’état mental du criminel au moment des faits. Une sorte d’éthique fanatique de la responsabilité morale de l’homme dans tout ce qu’il fait. Pourquoi pas ?
En tout cas, Parendon n’a semble-t-il rien à cacher, puisqu’il fait savoir à tout le personnel que le commissaire pourra circuler à sa guise dans l’appartement et interroger chacun autant qu’il le jugera nécessaire. C’est ainsi qu’il s’entretient fort longuement avec la charmante Mlle Vague, qui répond sans fard à toutes ses questions, même les plus indiscrète. C’est évidemment cette femme qu’on retrouve égorgée.
Après lecture, les péripéties de l’enquête s’effacent assez vite. Simenon introduit dans son tube à essais un certain nombre de composés chimiques qui sont les personnages, pour observer comment tout ça réagit. Ici, la réaction est, selon moi, de basse intensité.
Une histoire somme toute anodine, peut-être à cause du choix des ingrédients : rien d’explosif.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alfred jarry, calendrier pataphysique, pierre bonnard, le grand-lemps, georges simenon, commissaire maigret, maigret hésite, roman policier, polar, code pénal, pataphysique
dimanche, 06 septembre 2015
MAIGRET A VICHY
MES LECTURES DE PLAGE 6
GEORGES SIMENON : MAIGRET A VICHY (vol. XXIV, Editions Rencontre, 1969)
Le commissaire, pour une fois, a quitté Paris. Le bon docteur Pardon, après lui avoir dit : « Je crois qu’une cure à Vichy vous ferait le plus grand bien … Un bon nettoyage de l’organisme … », lui a conseillé de prendre ses vacances dans la ville d’eau. Il s’astreint à la discipline qui va avec : le verre d’eau obligatoire et régulier, et pas d’excès de table. Au café, il va même jusqu’à renoncer à la bière, c’est dire s’il est obéissant. Et puis surtout, il passe une bonne partie du temps à marcher en compagnie de bobonne.
Mais voilà, un Maigret ne serait pas un Maigret s’il n’y avait pas un mort. Cette fois, c’est « la dame en mauve » qui s’y colle. Une femme que le policier – déformation professionnelle – avait prise dans son collimateur (comme par hasard). Il est vrai qu’elle n’était pas la seule : il y avait aussi un couple, lui petit et replet, elle grassouillette, peut-être une Belge (« teint clair », « cheveux presque jaunes », « yeux bleus à fleur de tête »).
A noter que, où qu’il soit, il y a toujours quelqu’un pour reconnaître en lui le « chef de la Sûreté ». Simenon imite ici Maurice Leblanc, qui faisait des relations spéciales entre Arsène Lupin et la presse un ressort à part entière de ses fictions : le gentleman-cambrioleur ne se sert-il pas des journaux pour narguer la police ou annoncer, hâbleur, son prochain méfait ?
Pourquoi l’auteur des Maigret ressent-il le même besoin, dans la fabrication du personnage, de lui dessiner une aura de célébrité, même s'il la subit davantage qu'il ne la cherche ? On lit ici : « Il rejeta le journal, sans colère, car il avait l’habitude de ce genre d’échos, … ». Il n'y a en effet guère d'épisodes de ses aventures où il ne soit question de journalistes ou de sa photo dans le journal. L'effet de mise en abyme fut-il recherché ? Ou accompagna-t-il plus simplement la renommée du commissaire et le chiffre des ventes des romans dont la couverture portait ce nom ? Passons.
Donc la « dame en lilas » a été étranglée. Il se trouve que le commissaire divisionnaire Lecœur, qui dirige la PJ à Clermont-Ferrand, a été inspecteur sous les ordres de Maigret. Le patron de l’hôtel interpelle ce dernier : « Alors, monsieur Maigret, on vous soigne à Vichy ! On va jusqu’à vous offrir un beau crime … ». Les retrouvailles avec l’ancien subordonné sont cordiales : Lecœur ne demande pas mieux que de mettre au travail son ancien patron.
L’étranglée s’appelait Mlle Lange. Qui était-elle ? C’est à la recherche de la vérité de la personne que le livre est consacré. Une vérité liée à un passé longtemps enfoui. Cela fait une histoire compliquée, embrouillée : Hélène Lange avait une sœur, prénommée Francine. Celle-ci déclare qu’elles ne s’aimaient guère, mais on s’apercevra que, loin de se haïr, elles formaient un tandem de complices remarquable d’efficacité.
En fait de dames respectables, les deux sœurs sont des créatures machiavéliques : elles ont été assez habiles pour faire croire à M. Pélardeau, digne industriel, marié à une femme à laquelle il demeure très attaché, qu’Hélène, qui était à son service et qui a entretenu une longue liaison avec lui, a eu un fils - qu'il lui fut impossible de reconnaître, pour des raisons de convenances sociales.
En fait, c’est Francine, femme aux amants innombrables et inconnue de l’industriel, qui est allée accoucher d’un garçon à Mesnil-le-Mont, secondée par sa sœur. Elles se sont mises d’accord pour faire croire à Pélardeau qu’il est le père. Ayant le sens des responsabilités, il a constamment et largement subvenu aux besoins de la soi-disant "fille-mère" (comme on ne dit plus) et de sa supposée progéniture.
C’est l’argent ainsi soutiré pendant les quinze années qui viennent de s’écouler qui a permis aux sœurs d’ouvrir un beau salon de coiffure à La Rochelle, puis à Hélène d’acheter la maison qu’elle occupait à Vichy. Le hasard d’une cure dans la ville d’eau a suffi pour que Pélardeau reconnaisse Hélène, la suive, et fasse tout pour lui faire dire où se trouvait leur fils supposé. La mort de la femme est quasiment accidentelle.
Le roman est remarquablement construit et conduit, dans la mesure où le dévoilement se fait longtemps laborieux, pour s’accélérer vers la fin. Une autre grande qualité de ce Maigret est l’intensité dramatique produite par les enjeux psychologiques : l’embarras et la pitié de Lecœur et Maigret pour cet homme, plus accablé, semble-t-il, du poids de ce long péché pour lequel il n’a cessé de payer en pure perte, que du crime qu’il vient de commettre. Et qui a tout ce temps vécu dans l’illusion (un mensonge) qu’il avait une descendance mâle, alors que l’union avec l’épouse légitime est demeurée stérile.
Je compte ce livre parmi les excellents Maigret.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : ces considérations ne m'empêchent pas de déplorer vivement l'énormité morphologique commise par Simenon dans le chapitre I (à la deuxième page du roman) : « La soirée était presque fraîche, après une journée lourde, et la brise faisait bruisser doucement le feuillage ... ». Comment diable a-t-il pu faire de "bruire" un verbe du premier groupe ?
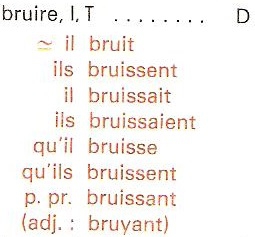
Bescherelle est catégorique ("D" pour "défectif").
Pauvre verbe "bruire" (ne pas confondre avec "bruir", du 2è groupe, qui veut dire "imbiber de vapeur, échauder") : on comprend que n'importe quel journaliste ignare prononce le plus naturellement du monde des phrases du genre : « La ville entière bruisse des rumeurs les plus folles », mais Simenon ! C'est impardonnable ! Honte sur vous, monsieur Simenon !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, commissaire lecoeur, maigret à vichy, docteur pardon, roman policier, polar, maurice leblanc, arsène lupin
samedi, 05 septembre 2015
LE VOLEUR DE MAIGRET
MES LECTURES DE PLAGE 5
GEORGES SIMENON : LE VOLEUR DE MAIGRET
Maigret, bêtement ennuyé par le cabas qu’une dame lui colle dans les tibias, se fait piquer son portefeuille. Il fumait sa pipe tranquillement sur la plate-forme d’un des derniers bus parisiens ainsi équipés. Le voleur s’est carapaté, puis perdu dans les petites rues du Marais. Aussi pourquoi le commissaire a-t-il la mauvaise habitude de mettre le portefeuille dans la poche revolver ? Il aurait dû écouter sa femme. C’est d’autant plus ennuyeux que celui-ci contient sa médaille officielle de commissaire, dont la perte est sanctionnée.
Surprise : le lendemain, il trouve sur son bureau une grosse enveloppe à son nom, contenant le portefeuille. Il n’y manque strictement rien. Puis c’est le voleur en personne qui lui téléphone et le convoque dans un café non loin de la rue Saint-Charles, dans le 15ème. François (parfois Francis) Ricain est un homme bizarre et compliqué, il fait des manières, il est affamé, il est inquiet, il n’a pas le sou. Il emmène le policier jusqu’à son logement (dans la rue citée), pour lui montrer le cadavre de son épouse, Sophie : il lui manque une partie du crâne. L’odeur est pénible.
François Ricain se croit promis à un bel avenir dans le cinéma : il écrit des scénarios de films. En attendant, il tape toutes ses connaissances pour payer son loyer, si bien qu’il doit de l’argent à un peu tout le monde. Il n’est pas le seul à croire en son talent : il y a un certain Dramin, lui aussi scénariste ; il y a Huguet, un photographe de presse ; il y a Maki, un sculpteur abstrait ; et puis il y a Carus, un producteur qui vit avec Nora, belle femme dont on apprendra que, sans ostentation, elle est une vraie femme d’affaires. Elle espère épouser Carus un jour. Tout ce petit monde se retrouve dans le restaurant tenu par Bob Mandille, un ancien cascadeur, et Rose Vatan, une ancienne chanteuse connue sous le nom de Rose Delval.
Petit roman offrant un coup d’œil sur le petit milieu vaguement artiste qu’on trouve associé au cinéma. On s’apercevra que les mœurs sont assez libres, que Sophie Ricain n’était pas précisément une oie blanche (elle aurait été vexée de ne pas se faire sauter par Huguet), que Ricain n’en pouvait plus de tirer la langue et de dépendre, pour sa subsistance de la bonne volonté de quelques-uns, qu’il pouvait haïr pour cela. Peut-être Sophie l’a-t-elle traité de maquereau ?
C’est un bon roman sans aspérités, dont l’intérêt repose sur l'inventaire méticuleux, façon "fouille en règle", un jour de grève du zèle, des caractéristiques du personnage principal, ce François Ricain, bourré d’incertitudes, d’orgueil et de contradictions.
Soit dit en passant, Maigret n'est jamais le personnage principal des aventures de Maigret : le commissaire n'est pas un "héros", mais une sorte d'éponge qui absorbe les ambiances, les petits faits, les types humains, puis qui les synthétise pour en extraire tout le suc de signification.
S'il fallait une métaphore pour définir Maigret, je dirais volontiers qu'il est un centre de gravité. Chaque Maigret est un effort, à chaque fois renouvelé, de donner du sens à un monde sans cesse incompréhensible. Et on aboutit chaque fois à la même conclusion : il n'y a rien à comprendre, il n'y a que les faits.
Au bout du compte, il reste une seule question : est-il vraisemblable qu'une petite balle de calibre 6,35 (entre 3,3 et 3,9 grammes), même tirée par un Browning de Herstal, ait emporté un morceau du crâne de la victime ? D’autant plus que quelqu’un parle à un moment (début) d’une arme de gros calibre.
Je n’en sais rien. Le doute m’habite.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maigret, littérature, littérature française, georges simenon, le voleur de maigret, roman policier, commissaire maigret, police judiciaire, quai des orfèvres, inspecteur janvier, inspecteur lucas
mercredi, 01 juillet 2015
MAIGRET ET L'AFFAIRE NAHOUR
Pour meubler un de ces moments nocturnes où le sommeil se refuse, j’ouvre à l'occasion un roman de Simenon. Un Maigret, mais pas forcément. En l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit réunir les circonstances les plus propices à sa juste appréciation. Toujours est-il qu’en lisant Maigret et l’affaire Nahour, j’ai été gêné par les ficelles de l’auteur, qui m’ont paru plus grosses que la normale.
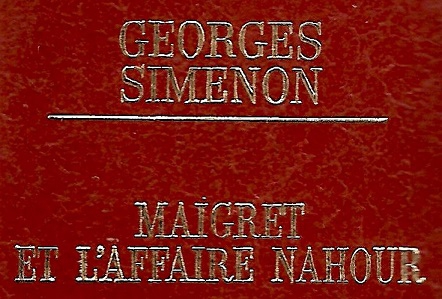
Tout est là mais, dirait-on, plus qu’à l’ordinaire. C’est bien une histoire du commissaire Maigret, mais comme fatiguée d’avoir à remplir son cahier des charges habituel. Comme ennuyée d’avoir à en passer par les ingrédients obligatoires, les uns éternels (la collection de pipes sur le bureau du quai des Orfèvres ; le demi qu’on fait monter de la brasserie Dauphine ; les petits plats de son épouse, ici une « choucroute alsacienne » (pléonasme) ; jusqu’à la célèbre « méthode Maigret » : « Il ne suivait aucun plan préconçu. Il allait devant lui, au hasard, en s’efforçant surtout de ne pas se forger d’opinion »), les autres liés aux circonstances (il fait – 12°, madame Maigret a tricoté une écharpe aussi épaisse et lourde que la place qu’elle occupe dans la narration, ah ! ces incontournables éléments du décor pour "faire vrai" !).
L’histoire, de son côté, est assez honnêtement tricotée, mais donne l’impression bizarre d’une action vibrionnante, comme d'une mouche prise sous une cloche de verre qui ne cesse de se heurter à la paroi. Les personnages, policiers comme suspects, ne cessent d’aller et venir d’un point à un autre. Un mécanique tournant à vide.
Et puis ce coupable impénétrable, impavide et dur comme le granit, qui ne changerait pour rien au monde le moindre iota à sa façon de se défendre, y compris devant le tribunal, au point d’amener Maigret à s’avouer vaincu dans la dernière phrase (« Au fond, [X] a gagné. ») bien que l’autre en ait pris pour dix ans, j’ai du mal à y croire : il jure dans le tableau, comme une couleur mal assortie.
Et puis cet assemblage de personnages qui mentent tous au début comme autant d’arracheurs de dents, et puis qui, sans qu’on sache bien pour quelle raison, se mettent à dire la vérité (enfin, il faudrait nuancer). Et puis la chantilly journalistique, pourquoi se met-elle à mousser abruptement, pour s’abouser un peu plus tard ? On ne sait pas trop (remplissage ?).
Tout ça fait des coutures un peu trop visibles : comme si le couturier ne s’était pas donné trop de mal. Comme s’il en avait marre, renâclant devant l’effort à faire pour les dissimuler avec soin. Un livre fait de pièces et de morceaux prêts à l’emploi, en quelque sorte, mais mal liés ensemble. On n’arrive pas à y croire. Voilà pour l’impression générale que m’a laissée Maigret et l’affaire Nahour.
Maintenant l’histoire : elle en vaut une autre. Tout se passe dans un milieu à (beaucoup de) pognon. Le père Nahour, banquier libanais, a deux fils. L’un a mis ses pas dans ceux du papa (banquier à Genève). L’autre (Félix Nahour) est devenu joueur dans des cercles plus ou moins professionnels, mais a commencé à gagner un argent fou en développant ses connaissances en mathématiques, en particulier le calcul des probabilités, passant beaucoup de temps à relever les numéros qui sortent à la roulette.
C’est lui, Félix, le mort du début : une balle d’assez gros calibre lui a fait un trou dans la carotide avant de se loger dans le crâne, occasionnant l’impressionnante flaque rouge dans laquelle la femme de ménage, Mme Bodin, l’a trouvé le matin en prenant son travail. Il a épousé plusieurs années auparavant une reine de beauté, Evelina, une Hollandaise un peu nunuche, mais allez savoir.
L’histoire commence chez le docteur Pardon, chez qui elle s’est rendue, accompagnée par un homme qui dit l’avoir secourue en bas de l’immeuble : le coup de feu qu’il dit avoir été tiré d’une voiture fait perdre beaucoup de sang à la femme. Pardon appelle Maigret après que le couple s’est discrètement éclipsé après son intervention. Au flic de démêler l’écheveau.
Il y a encore la bonne d’Evelina Nahour, Nelly. Il y a encore Anna Keegel, la vieille copine de confiance d’Evelina (à vrai dire, elle fait de la figuration). Il y a les deux enfants du couple, que le père a envoyés dans une pension de la Côte d’Azur et confiés à une nurse, sans que la mère s’en chagrine outre-mesure. Il y a le factotum de Félix Nahour, Fouad Ouéni, un Libanais de la montagne au statut nébuleux : tour à tour secrétaire, cuisinier, chauffeur, et rémunéré tous les trente-six du mois. Nahour l’emploie aussi à relever les numéros qui sortent à la roulette.
Je me trompe peut-être, mais Maigret et l’affaire Nahour, qui figure dans le peloton de queue des aventures du commissaire (il est daté du 8 février 1966, le dernier de 1972, le premier de 1931, ça fait donc trente-cinq ans que l’auteur traîne son personnage), montre que Simenon commence à en avoir soupé.
Comme s’il ne croyait plus lui-même à son personnage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret et l'affaire nahour, quai des orfèvres, littérature française, maigret brasserie dauphine
lundi, 11 mai 2015
LE DERNIER FRED VARGAS
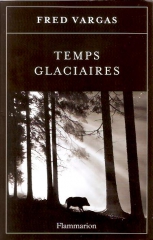 Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.
Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.
**************
Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.
être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.
L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.
Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.
De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.
J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.
Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.
Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.
Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.
Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.
L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.
A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.
Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.
Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.
Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.
Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?
Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.
Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».
Voilà ce que je dis, moi.
 Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!
Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers
jeudi, 17 juillet 2014
DU RIFIFI EN LAPONIE 2/2
Olivier Truc, Le Dernier Lapon, Métailié.
L’histoire est celle d’un grand malheur qui s’est abattu autrefois sur un village lapon, du fait même du « trésor » indiqué. Une vague légende rapporte qu’il s’agit d’or. Mais il ne s’agit pas d’or, comme le croit le vieil Olsen, un paysan, petit politicien véreux du coin, impatient de déposer une demande de licence, dans le seul but de s’approprier cette richesse démesurée.

Autant le savoir : les frontières, ici, n'ont aucun sens. Elles n'ont d'ailleurs commencé à exister que lorsque les industriels ont trouvé des ressources pour s'enrichir. Le territoire des Sami transcende les frontières, au point que les trois pays concernés ont créé un corps de police transfrontalier.
J'ai un peu traîné mes guêtres par là-haut, de Tromsø à Kirkenes (à deux pas de Mourmansk, en Russie), et de Narvik à Rovaniemi.
(La carte ci-dessus est celle qui figure dans le livre.)
C’est le géologue Racagnal, un Français, qui révèlera qu’il s’agit d’uranium. La roche est même d'une teneur proprement inouïe. Racagnal est une ordure sans scrupule en même temps qu’un géologue exceptionnel, qui travaille « à l’ancienne » et à l’instinct : il rigole bien quand Kallaway (qu’il surnomme Mickey) arrive en renfort et débarque de l'hélicoptère envoyé en urgence tout un matériel sophistiqué pour ne faire que confirmer ses conclusions.
Mais ce qu’il préfère (et qu'il ne perd jamais de vue), Racagnal, ce sont les filles de quinze ans environ. C'est plus fort que lui. C’est ce qu’a vite compris Brattsen le flic pourri, qui demande à la très jeune et jolie Ulrika d’être gentille avec le monsieur, histoire d’avoir barre sur lui (mais le vieil Olsen garde aussi une coupure de journal relatant un fait divers compromettant arrivé à Alta, où il est question du bonhomme).
L’histoire ? Le tambour lapon (rarissime) a été volé avant que qui que ce soit ait eu le temps de l’étudier, et même de le photographier. C’est un vieux Français qui voulait en faire don au musée local avant de casser sa pipe. Il était très jeune quand il a accompagné Paul-Emile Victor, en 1939, dans une mission d’exploration. Un chaman lapon lui avait fait cadeau de l’instrument.
On apprendra qu’un certain Flüger, géologue de son état, avait trouvé la mort au cours de l’expédition, soi-disant du fait d’une mauvaise chute, en réalité tué par le propre père du vieil Olsen, le paysan-politicien, qui a conservé dans son coffre secret la vieille carte géologique dressée autrefois par Flüger, où figurent les indications permettant de retrouver l’emplacement de l’ancienne mine.
Le problème, c’est que vient s’ajouter à l’histoire le meurtre de Mattis Labba, et que le vieil Olsen et le policier Brattsen font tout pour éloigner les enquêteurs de la piste de la mine, allant même jusqu’à faire destituer par des amis politiques « le Shérif », Tor Jensen, au profit de cet adjoint peu scrupuleux. Heureusement, la patrouille P9, qui comprend Klemet et Nina, garde (secrètement) le nez sur les traces, aidée (secrètement) par l’ancien commissaire. Ils reconstituent patiemment la chaîne en agençant les maillons l’un après l’autre.
La fin a d’autant plus à voir avec l’apocalypse que tous ceux qui participent à l’action convergent vers un point où va bientôt se déchaîner une tempête polaire. Disons que la folie des hommes rejoint la rage de la nature. Disons aussi que la mine n’ouvrira pas. Et que l’auteur ne clôt pas son livre sur un épilogue dressant un bilan général des différents destins croisés au cours du récit : Aslak s’enfonce pour ne pas en revenir dans les solitudes glacées, pendant que Klemet sanglote sur sa motoneige. Les autres, il n'en est plus question. On imagine que tout est rentré dans l'ordre.
Aslak, c'est lui "le dernier Lapon". Considéré par la vieille Berit Kutsi (qui en fut autrefois amoureuse) comme un saint, parce qu’il a épousé Aila malgré le viol subi à l’âge de quinze ans par un prospecteur étranger, qui aimait les filles très jeunes (tiens donc). Enceinte, elle n'a pas pu avorter, alors elle a tué son enfant à la naissance. Elle en est devenue folle, et sa folie consiste à pousser des cris effrayants, et à être dans l'incapacité d'assumer son existence.
Et non seulement Aslak lui est resté fidèle, mais il a tout fait pour préserver, en ce qui le concernait, le mode de vie traditionnel des Lapons, refusant toutes les facilités offertes par la technique moderne, à commencer par le scooter des neiges. Il accepte les hurlements sauvages qu'Aila pousse régulièrement, parfois pendant une journée entière. Mieux : il est aux petits soins pour elle, et l'entoure avec dévotion.
Il lui prépare du feu et des vivres pour huit jours quand il accepte de servir de guide au prospecteur Racagnal. S'il accepte, c'est parce que quand il l’a fait entrer sous sa tente, Aila a reconnu à son poignet la gourmette de l'homme qui l’avait violée jeune fille (avec l'inscription MOSO, pour MinO SolO, l'entreprise qui avait envoyé Racagnal). Mais même sans cela, quand l’autre est arrivé sur son scooter, la première chose qu’Aslak s’est dite, c’est que le Mal en personne venait de faire son apparition. Inutile de dire que les jours de Racagnal sont comptés. Et sa fin, je peux vous dire qu'elle n'est pas piquée des hannetons.
Au total, un livre agencé de main de maître, que le lecteur aurait tort de délaisser à cause de son volet ethnographique. Car l’auteur l’a construit en virtuose : techniquement, le puzzle est irréprochable. C'est du grand art. Il faut cependant surmonter sa répugnance à avaler l’épais documentaire qui alourdit indéniablement le récit. Y avait-il moyen de rendre l’exposé plus fluide, mieux intégré à l’action proprement dite ? Franchement, je ne sais pas.
Olivier Truc frappe très juste en nous emmenant sur la frontière qui nous sépare du monde ancien. Un monde quasiment disparu sous les chenilles d'acier du char de la "modernité" et des artifices de la technique. Si Klemet est le personnage principal, Aslak est un personnage absolument magnifique. Il n'occupe pourtant dans le récit qu'une place assez marginale, mais qui se révèlera cruciale au bout du compte.
Que se passe-t-il dans un individu (Klemet) quand l'acculturation est passée par là, le coupant radicalement du peuple dont il est issu ? Quand il est sans cesse confronté à la présence d'un homme intègre (Aslak), qui lui fait peur parce qu'il n'a jamais transigé sur ses principes, au prix de lourds sacrifices touchant les facilités de la vie offertes par le "progrès" ? Klemet est Lapon, mais il travaille dans la police norvégienne. Il ne vient pas d'une famille d'éleveurs. Il ne connaît pas les vieilles traditions de son peuple. Aslak, contre vents et marées, est resté petit éleveur de rennes, et éleveur « à l'ancienne ». Pénétré de l'esprit de ses racines.
Racines dont Klemet est coupé. D'ailleurs il s'en veut de sa lâcheté. Il s'en veut d'avoir trahi la promesse faite autrefois à Aslak de s'évader en sa compagnie de l'orphelinat. Au dernier moment, il a flanché : « Tu sais quoi ? hurla Klemet, dont les yeux s'emplissaient de larmes qui lui faisaient mal. On avait sept ans ! Bon Dieu, sept ans ». Mais ce n'est pas une raison pour que le remords ne le ronge pas, même cinquante ans après : « Mais nous devions le faire ensemble, Klemet. C'était notre promesse », répond Aslak. Rien de pire qu'une promesse non tenue pour foutre en l'air un homme normal.
Aslak s'enfonce alors et disparaît dans la nuit polaire, tandis que Klemet sanglote comme un enfant sur son scooter des neiges, sous le regard éberlué et impuissant de Nina.
Une enquête policière, un documentaire sur les mœurs actuelles et traditionnelles des Lapons, des rudiments de prospection géologique, un aperçu des mœurs politiques dans les pays nordiques, une critique en règle de la "civilisation", non, je ne regrette pas d'être entré là-dedans, ce qui n’est déjà pas si mal. Et le dénouement est d'une grande force. Ce qui est mieux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:03 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, olivier truc, éditions métailié, le dernier lapon, laponie, peuple sami, norvège, suède, finlande, paul-émile victor, roman policier, polar
mercredi, 16 juillet 2014
DU RIFIFI EN LAPONIE 1/2
Le Dernier Lapon, d'Olivier Truc, aux éditions Métailié, 2012.
J’ai dit du mal récemment du genre appelé « thriller » (voir ici même au 30 juin dernier). Le livre d’Olivier Truc, Le Dernier Lapon, pour un peu, parvient presque à atténuer ma naturelle aversion pour les récits qui se bornent à l’élaboration d’histoires se réduisant à elles-mêmes, et qui ne portent rien de plus grand et de plus fort qu’elles-mêmes. Rien qui les dépasse. Des récits qui donnent des livres dont l’essence est d’aider à passer le temps les gens qui s’ennuient dans les transports en commun.

J’ai dit il y a longtemps tout le bien que je pense des romans de Michel Houellebecq au motif que leur auteur nous propose un regard aigu et décapant sur le monde actuel. Sans complaisance, il nous parle du sens de ce qui non seulement se passe sous nos yeux, mais nous entraîne sans que nous y puissions rien, ou si peu que rien.
Le livre d’Olivier Truc se situe quelque part sur cette ligne d’horizon littéraire, même si l’on reste très en-deçà des œuvres de Houellebecq. Ce n’est pas pour rien que la maison Métailié en limite le champ à sa collection « Noir ». Passer de Houellebecq à Truc, c’est en quelque sorte descendre du général au particulier.
Ce qui sauve le livre à mes yeux et en fait un objet intéressant, ce sont, disons les cent dernières pages (sur 450), où l’auteur parvient excellemment à faire sentir la montée de la tension, jusqu’au dénouement. Mais celui-ci, il faut le mériter. Avant d’y arriver, il faut croquer l’espèce de traité d’ethnographie lapone dont Olivier Truc a entrelardé (et alourdi) son récit. Et puis bien mâcher. Puis avaler.
C’est sûr que ça part d’un sentiment louable. C’est sûr aussi que s’il ne fournissait pas au lecteur un minimum de clés d’interprétation, le fond de l’affaire policière nous échapperait. Pour le coup, je m’en veux presque d’avoir éprouvé, tout au long de l’ascension de ce bouquin un peu aride, une impression qui m'a rappelé celle éprouvée à la lecture du Théorème du perroquet, de Denis Guedj, « roman » qui se proposait rien de moins que d’initier (ou de convertir) le lecteur à la jouissance de la pratique des mathématiques.
J’avais trouvé le résultat bourratif au possible, le romanesque disparaissant sous l’amas compact de l’exposé. Je dis peut-être ça parce que je ne suis guère mathématicien (ceci dit pour euphémiser). Mais Denis Guedj avait peut-être voulu tenter pour les maths ce qu'un autre avait réussi pour la philo, en surfant sur la vague initiée par Le Monde de Sophie, le livre de Jostein Gaarder au succès foudroyant, qui faisait croire au lecteur qu'il avait tout compris à la philosophie en le refermant.
Avec Le Dernier Lapon, sans aller aussi loin, j'ai eu parfois l’impression, de me trouver d’un coup sur un banc d'école : ce qu'il faut savoir de la société traditionnelle lapone. L’art proprement littéraire du roman dépasse le documentaire et la transmission d'un savoir. A cet égard, désolé, je trouve qu’il y a une part de reportage dans Le Dernier Lapon, d’Olivier Truc, dans une proportion infime toutefois par rapport au livre de Denis Guedj, qui me reste, lui, carrément indigeste.
Tant mieux, car ce livre mérite malgré tout d'être visité. L’action se situerait en Amérique du Nord au début du 20ème siècle, l’esprit n’en serait modifié qu’à la marge. En tant que civilisation, les Lapons n'ont rien à envier aux Indiens d’Amérique du Nord. Surtout au moment où les vestiges de leur culture ancestrale en est venue à être conservée dans les musées (c'est-à-dire qu'elle est au moins moribonde, si ce n'est agonisante). Un musée ethnographique est un mausolée.
Et au moment où leurs descendants plus ou moins abâtardis ou corrompus ont oublié leurs racines, qu’ils soient tombés dans l’alcool, comme Mattis Labba, ou qu’ils aient accepté, de gré ou de force, une acculturation qui les prive de fait de leur passé, comme Klemet. Un seul résiste encore à la "civilisation". Il s'appelle Aslak. Tout le monde pense qu'il est fou. Il est simplement buté, fidèle à ses racines, du genre « et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ».
Klemet, Lapon d’origine, après des études à l’école de police de Kiruna, a intégré le corps de la police des rennes. Il fait tandem avec Nina, fraîche émoulue de l’école de police, et accessoirement féministe (on est en pays scandinave : les mecs ont intérêt à faire gaffe, cf. Julian Assange, coupable d'agression sexuelle à cause d'un préservatif déchiré au cours d'un rapport sexuel consenti).
Nina a grandi dans le sud de la Norvège ("civilisé"), elle arrive donc dans la ville de Kautokeino (voir carte demain) sans rien connaître de la culture des Lapons (on dit les « Sami »). Le commissaire de la police locale est surnommé « Le Shérif », il est du côté des bons. C'est même pour cette raison qu'il sera mis sur la touche par le clan des méchants.
Brattsen, son adjoint, est, lui, on s’en apercevra, du côté de ces derniers. Comme les méchants des westerns américains classiques – des alcooliques qui ne rêvent que de casser de l’Indien –, il méprise les Lapons. C’est un brutal borné, dont ce vieux gredin d'Olsen manipulera sans peine la marionnette.
Je ne vais pas résumer l’histoire. En gros, d’un côté on a le monde lapon, de l’autre la civilisation technique et matérialiste. Le lien entre les deux consiste en un très vieux tambour traditionnel. Ces tambours, il n'en reste dans le monde que soixante et onze exemplaires dûment répertoriés, parce que les pasteurs calvinistes chargés de la christianisation du pays n'y sont pas allés par quatre chemins pour tenter d'éradiquer le chamanisme avec ces instruments du diable : ils en ont fait passer des milliers par les flammes, je suppose que c'est la vérité.
La peau de ce tambour comporte une particularité sous la forme d'un dessin symbolique. Après maintes péripéties, on découvre qu’il raconte une histoire tragique en même temps qu’il indique le plan d’un « trésor ».
Rien de tel pour appâter, n’est-ce pas ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, olivier truc, le dernier lapon, éditions métailié, polar, roman policier, laponie, peuple sami
vendredi, 16 mai 2014
3/4 MAIGRET ECRIVAIN
Je commence à en avoir un peu assez de Maigret. C’est sûr que c’est intéressant d’en lire pas mal à la file, parce que ça permet de cerner la façon dont l’auteur s’y prend pour capturer le lecteur. Il est vrai que Simenon sait y faire. Mais à force le lecteur finit par ne plus voir que les trucs.
J’avais parlé des problèmes d’identité sur lesquels reposaient Pietr-le-Letton et M. Gallet, décédé, les deux premiers de la longue série consacrée au commissaire. Dans l’un, le jumeau dominé par l’envergure criminelle du frère qu’il assassine pour prendre sa place à la tête du réseau. Dans l’autre, le noble complètement décavé qui vend son nom prestigieux à un roturier, juste parce qu’il a besoin d’argent.
Et voilà que, pas loin du dernier épisode, Simenon nous refait le coup de deux romans qui se suivent et qui traitent du même thème : le meurtrier qui cherche à se faire prendre, qui irait presque jusqu’à supplier le commissaire de le coffrer. On trouve ça dans Maigret et le tueur et Maigret et le marchand de vin.
Avec des variantes, il ne faut pas exagérer. Dans le premier, le tueur est un obsessionnel qui a commencé à quatorze ans, avec un couteau suédois volé à son oncle, et qui croit « se libérer » en lardant sa victime, qui est un charmant jeune homme timide, juste poussé par la passion des voix humaines, qu'il collectionne sur bande magnétique dans les cafés parisiens. D'où de fructueuses fausses pistes, en particulier la bande des malfrats qui se fait coffrer en flagrant délit de cambriolage.
Alors que dans le second, c’est un minable qui a été horriblement humilié par la victime et qui n’aspirait qu’à en tirer vengeance. Il faut dire que le marchand de vin, type même du self-made-man qui s'est hissé jusqu'au sommet à la seule force de son poignet, est l'imbuvable absolu qui ne sait que prendre. J'ai un jour croisé la route d'un tel homme : il vaut mieux ne pas avoir besoin de ses services.
J’ajoute qu’après le portrait de parfait salaud que Simenon trace de la victime, le lecteur est appelé à éprouver quelque indulgence envers le coupable. Alors que dans le premier, le mec est un nul parfait, essentiel et congénital : on le plaint d'avoir tant de difficulté pour se donner l'impression d'exister. Un « meurtre gratuit » contre un « meurtre à mobile ». Il faut bien avouer toutefois que le manège des deux pour se faire prendre repose sur un argumentaire des plus mince (sic, ainsi orthographié après vérification dans mon Grevisse, 9ème édition).
Il y a autre chose qui finit par fatiguer, à la lecture des Maigret en série : la marche à suivre. Je n’ai rien contre le savoir-faire. Par exemple, dans mon restaurant préféré, j’en veux beaucoup au maître-queux d’avoir modifié sans me prévenir sa préparation du gras-double rissolé à la lyonnaise, raison pour laquelle cela fait des années que je ne mets plus les pieds « Chez Mounier », 1, rue des Marronniers, pour le punir de cette inqualifiable agression.
Un roman policier n’est toutefois pas un restaurant. Encore moins un « bouchon lyonnais ». De toute façon, la mère Mounier a quitté le service depuis lurette, alors … Je n’en ai pas moins gros sur la patate : le souvenir d’une jouissance, s’il n’est pas un appel à recommencer au présent, se dégrade en pure remembrance de vieillard idiot (formule d’Arthur Rimbaud, cf. Les Remembrances du vieillard idiot, de Michel Arrivé, Flammarion, 1977).
Croiser le souvenir d’anciens bons moments communs dans les yeux d’une accorte et joyeuse bougresse n’oblige-t-il pas à vérifier l’emploi du temps du soir, dans l’agenda ? Et à préparer le prétexte officiel ? Dites-moi que ce n’est pas vrai, tiens ! Revenons à nos boutons.
La marche à suivre, dans les Maigret ? Facile, Mimile ! Les romans consacrés à Maigret se découpent assez régulièrement en quatre étapes. Première étape : les faits, les lieux, un ou deux témoins. Si possible un meurtre banal, pour ne pas dire sordide (dans La Folle de Maigret, la mort par suffocation d’une charmante dame de quatre-vingt-six ans).
Dans la deuxième, les gens, le milieu et son ambiance. C'est là que Maigret renifle, tâtonne, s'imprègne, s'imbibe des données spécifiques de l'affaire, à la recherche d'un fil à tirer. Dans un troisième temps, Maigret, quoique pataugeant commence à démêler l’écheveau des relations que les circonstances ont établies entre les personnages, les adultères, les haines, les désirs. C’est le moment où le commissaire lève une partie du voile sur les passions spécifiques mises en jeu par l’histoire. La quatrième étape est classiquement consacrée à la synthèse de l’ensemble quelle qu’en soit la forme, confession du coupable ou explication du commissaire.
C’est par exemple le cas d’Un Crime en Hollande (1931), où Simenon se paie même le luxe d’une reconstitution du crime : c’est la vieille bigote protestante, la plus racornie, la plus prude et la plus insoupçonnable, qui a tué, trop jalouse de la jeune fille appétissante. Que voulez-vous, elle ne pouvait pas rivaliser : « Deux beaux seins, que la soie rendait plus aguichants, des seins de dix-neuf ans qui tremblaient à peine sous la blouse, juste de quoi les rendre plus vivants ». Simenon ne pourra pas nier qu’il a aimé les femmes, c’est sûr. Et particulièrement la chair fraîche.
Georges Simenon était un homme normal.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 15 mai 2014
2/4 MAIGRET JOURNALISTE
Le personnage de Maigret, disais-je dans un billet précédent (hier, si je ne me trompe), est un prétexte. Certes, le métier de Georges Simenon est d’écrire des romans. Mais il est aussi journaliste. La preuve cette série de 12 articles intitulée Escales nordiques, publiée par Le Petit journal du 1er au 12 mars 1931. Les titres en sont très rigolos, je tiens à le souligner. Voir plus bas pour confirmation du fait.
Je n’irai pas jusqu’à prétendre que les Maigret sont de mauvais romans policiers, ce serait idiot, ridicule et insoutenable. Mais il faut bien dire que l’intrigue de plusieurs de ceux que j’ai lus est bâtie sur une chute qui a tout l’air d’être parachutée. Je pense par exemple à l'extravagant nid d’espions qu’on trouve dans une boîte de nuit de Liège, dans La Danseuse du Gai Moulin. Une histoire pépère, planplan et apparemment minuscule.
Le fait que le crime crapuleux s’ajoute à l’affaire d’espionnage montre que Simenon est un maître du tricotage narratif. Il n’en reste pas moins que cette histoire de plans « d’un nouveau fusil-mitrailleur fabriqué à la FN de Herstal » et de mise à l’épreuve d’un apprenti espion par ailleurs richissime qui a le tort et la faiblesse de s’ennuyer dans la vie, garde des airs assez peu crédibles.
Je dirai que l’intrigue proprement policière (toujours bien tricotée) permet à l’auteur d’appâter son lecteur. C’est d’ailleurs ce qui émerge de temps à autre dans le récit à propos de la « méthode » que Maigret applique dans ses enquêtes. Cette méthode est précisément de ne pas en avoir. Enfin, pas vraiment. On ne peut pas dire en effet que les « deux phases » décrites dans La Guinguette à Deux Sous puissent en tenir lieu. Mettons plutôt une façon d’être qu’une façon de faire.
La première phase consiste pour Maigret à pénétrer dans l’ambiance spécifique dans laquelle baigne le milieu social ou géographique où va se dérouler l’affaire : « D’abord la prise de contact du policier avec une atmosphère nouvelle, avec des gens dont il n’avait jamais entendu parler la veille, avec un petit monde qu’un drame vient d’agiter ». Au cours de cette période, « la plus passionnante » pour le commissaire, « on renifle. On tâtonne ». Et quand le juge Poiret lui demande ce qu’il pense de l’affaire : « Je ne pense pas encore. Je tâtonne ». Ça, c’est dans Maigret et le tueur. Mais c’est quand même au chapitre deux, c'est-à-dire dans la partie initiale, où le commissaire patauge encore.
Revenons à La Guinguette … La deuxième phase peut ensuite débuter : « Brusquement on saisit un bout de fil et voilà la seconde période qui commence. L’enquête est en train. L’engrenage est en mouvement. Chaque pas, chaque démarche apporte une révélation nouvelle, et presque toujours le rythme s’accélère pour finir par une révélation brutale ». J’avais noté pour ma part cette impression de « tempo accelerando » (voir ici même au 29 avril) produite par la manière dont le commissaire conduit (semble conduire, car c'est évidemment le romancier qui tient les manettes) son enquête.
Georges Simenon semble construire ses Maigret comme fait un journaliste d’investigation quand il est en reportage. Et l’auteur fut un tel journaliste. Patrick Kéchichian le confirme en 2008 dans Le Monde (1er août) à propos du Simenon de 1935 débarquant à Tahiti : « Il allait y séjourner deux mois. Largement de quoi s’imprégner, dira-t-on, de cette autre réalité … ». Kéchichian commente ici une édition des textes journalistiques (Georges Simenon. Les Obsessions d’un voyageur, textes choisis et commentés par Benoît Denis). Je relève avant tout le verbe « s’imprégner ». Simenon le journaliste et Maigret le policier appliquent la même « méthode ».
Et dans le fond, les enquêtes de Maigret ne sont-elles pas, outre des intrigues policières bien ficelées (quoique plus ou moins convaincantes), des reportages dans les milieux les plus divers ? Celui des marins – d’eau douce ou au long cours – semble être une des prédilections de l’auteur : j’ai l’impression d’avoir fait un tir groupé, avec Au Rendez-vous-des-Terre-Neuvas, Le Chien jaune, Le Charretier de « La Providence », Le Port des brumes. Successivement Fécamp, Concarneau, les canaux, Ouistreham. C’est vrai que beaucoup de titres sont datés d’un « A bord de l’Ostrogoth » significatif : Simenon a navigué et la mer et les marins, il connaît.
Toujours est-il que l’imprégnation est à la base de la méthode de l’écrivain comme de celle du policier qu'il a imaginé.
Simenon reste journaliste en écrivant ses romans policiers. Et il fait un journaliste du commissaire devenu une grande figure de la littérature policière française. Les enquêtes de Maigret ressemblent un peu à des reportages.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : georges simenon, commissaire maigret, journalisme, presse, journaux, littérature, roman policier, quai des orfèvres, la danseuse du gai moulin, la guinguette à deux sous, maigret et le tueur, journal le monde, patrick kéchichian, au rendez-vous des terre-neuvas, le chien jaune, le charretier de la providence, le port des brumes
mardi, 29 avril 2014
REBONJOUR MONSIEUR MAIGRET
Ce doit être la fatalité, ou alors une malédiction, allez savoir. Depuis que j’ai fait le tour du monde de l’écrivain Henri Bosco, quand j’ouvre un bouquin d’un écrivain, je me sens obligé d’ouvrir les autres. Ça s’est passé comme ça avec Balzac, voilà que ça se reproduit avec Georges Simenon. Pour le moment, j'en suis à une dizaine de Maigret. Cela veut peut-être dire que j'y trouve un intérêt. Lequel ?
M. Gallet, décédé (1930)
Apparemment, c’est un crime : dans une auberge de Sancerre, un homme est mort. Non seulement il a la joue arrachée par une balle tirée d’une distance ce sept mètres, mais il a dans le flanc, l’entaille d’un poignard qui a touché le cœur. C’est M. Gallet, représentant de la maison Niel et Cie pour toute la Normandie, et à ce titre supposé à Rouen. Du moins si l’on en croit la carte postale expédiée de cette ville par son mari. Elle croit à une erreur.
Ce n’est pas une erreur. C’est une imposture : il y a douze ans que la maison Niel et Cie a remercié M. Gallet, douze ans que celui-ci fait semblant d’aller vendre sa camelote en simili-argent, alors qu’en réalité, sous l’alias de M. Clément, il écume toute l’aristocratie finissante quoique royaliste, pour lui soutirer des sous au prétexte de « défense de la cause ». Eh oui, M. Gallet alias Clément était devenu un vulgaire escroc.
En fait, quand il est né, M. Gallet ne portait pas ce nom, mais celui ô combien plus prestigieux de « de Saint-Hilaire ». Malheureusement, dernier rejeton de la famille, il s’est retrouvé tellement désargenté qu’il a accédé à la demande de l’ambitieux et dynamique Gallet de lui vendre son patronyme. J’espère que vous suivez : Saint-Hilaire n’est pas plus Saint-Hilaire que Gallet n’est Gallet, ni même Clément.
Pour faire simple, autant on avait, dans Pietr-le-Letton, le dévoilement d’une gémellité, source de la mystérieuse confusion d’identité entre deux frères, dont l’un était le chef de bandes internationales de perceurs de coffres et de murailles, autant on a, dans M. Gallet, décédé, une confusion d’identités reposant sur une substitution. Drôle quand même de constater que les deux premiers Maigret développent ce même thème de l’identité vue sous l’angle judiciaire, non ?
Même si la chute (la solution, si l’on veut) est pour le moins tirée par les cheveux. Ce jumeau de bandit qui a toujours été fasciné par son frère et qui pourtant, au début du bouquin, le tue dans les toilettes du train pour prendre sa place à la tête du réseau criminel, bon, je veux bien, mais bof. Quant à la façon dont le soi-disant « M. Gallet » organise son suicide de façon à faire porter les soupçons d’un crime sur le soi-disant « Saint-Hilaire », franchement, je me dis que Simenon pousse le bouchon.
Ce qui est rigolo, c’est que ces bouquins se lisent très bien malgré tout. La façon dont l’auteur semble mettre le lecteur à la place du commissaire et de lui donner ses yeux, ses oreilles, voire son cerveau, constitue selon moi la caractéristique principale de son « style ».
Cela me donne l’impression (je dis bien l’impression) d’en être toujours au même point que Maigret dans le suivi de l’enquête. Au moins au tout début. Même si je sais qu’à partir d’un moment, celui-ci prend de l’avance sur moi, que son pas s’accélère et que ses certitudes prennent une consistance pour des raisons qui nous échappent. Ce qui attire dans les Maigret tient peut-être tout simplement au rythme. Ou plutôt au tempo, d'abord plutôt lent (c'est quand Maigret patauge). Au deux tiers, on sent que la silhouette du commissaire se redresse, qu'il respire mieux, que ses épaules retrouvent leur carrure.
Bon, c’est sûr qu’il s’agit d’une technique : le romancier met son protagoniste et son lecteur sur la même ligne de départ, comme si celui-ci était l’égal du policier. Il entre de plain-pied dans l’histoire, familièrement en quelque sorte. A l’écrivain, ensuite, de lui démontrer qu’un bon flic façon Maigret, s’il est devenu un commissaire dont le nom apparaît régulièrement dans les journaux, c’est pour la raison qu’il a une forme de supériorité.
Je me demande si ce n’est pas ce mélange de proximité égalitaire (« mon semblable, mon frère... ») et d’ascendant distancié (« et voilà le travail, petit ! ») qui a fait le large succès du commissaire Maigret. Familiarité et supériorité, en somme.
Simenon, ce dragueur impénitent – qui déclarait sans forfanterie apparente avoir « possédé » 3000 femmes dans sa vie – a appliqué dans ses œuvres un principe analogue en littérature et en amour. Mettre le lecteur dans sa poche ou une femme dans son lit suivait la même marche à suivre.
D’une part tu t’intéresses à la mignonne en te mettant à sa portée et tu t’efforces de la mettre en valeur, d’autre part tu te débrouilles pour produire à la fois, à ton propre sujet, l’impression d’un mystère capable de la captiver et de la promesse de son dévoilement. On appelle ça la séduction. Ses polars semblent obéir à la même logique séductrice.
Ça a l’air simple, dit comme ça. La force de Simenon est d’avoir élaboré les principes de la chose et de les avoir mis en œuvre.
La théorie et la pratique, quoi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature policière, polar, roman policier, commissaire maigret, georges simenon
dimanche, 01 septembre 2013
SAN ANTONIO ÜBER ALLES
***
Mais revenons à nos san-antoniaiseries. Je le répète : dans un bon San Antonio, la langue jubile. Et le lecteur avec. C’est vrai que, tout bien pesé, ça ne pisse pas loin, c'est bas de plafond, c'est souvent ringard, mais au moins, d'abord ça fait plaisir, ensuite ça repose, enfin l'avantage, c'est que ça ne se hausse pas du col à toiser la populace du haut de son œil pincé comme un anus de gallinacé. Vous avez remarqué ? San Antonio, sodomiser des bestioles de la famille des syrphidés (ordre des diptères) n’est pas son fort. Ci-dessous, « parasyrphus lineola» (non, ce n'est pas une guêpe, c'est un syrphidé, je veux dire une mouche).
Ceux qui se haussent du col font juste croire qu'ils font partie de ces seigneurs en mie de pain qui se font passer pour des statues en marbre de Carrare ou de Paros et, pour arriver à leurs fins, ils arborent, entre leurs deux mâchoires en béton armé, le sourire californien, vous savez, celui qui est tout niaiseux de contentement, façon Beach Boys, celui qui a fait tant de tort aux moniteurs de ski entre Courchevel et Megève.
Eux, je prétends donc que ce n’est pas leur bouche, mais leur œil qui est en cul de poule. Pas mal trouvé quand même, non ? "Avoir l'œil en cul de poule" ? Je vais déposer la marque à l'INPI. Mais l'œil en cul de poule, m'est avis que ça doit leur faire mal quand ils l'ouvrent. Je ne leur ai jamais examiné le rectum, pour m’assurer s’il s’apparentait de préférence à l’un ou à l’autre orifice, mais si leur œil se mettait à déféquer en vous regardant, je n'en serais pas autrement étonné. Est-il, Dieu, possible de donner au spectateur une telle impression de chier, juste en soulevant la paupière pour vous envisager ? Je m'égare.
Remarquez pas tant que ça, si je me souviens d'un poème vaguement scatologique qui avait cours dans la famille à l'époque où il y avait des pots de chambre, au fond desquels était parfois peint un gros œil, façon : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Le poème familial finissait, pour sa part, ainsi : « L'œil était dans le fond et regardait mon père ». Bon, c'est sûr que ce n'est pas pour de pareils vers qu'on entre à l'Acadéfraise.
Pour revenir à La Vérité en salade, dès le nom de la personne qui demande le secours du fils de Félicie, sa « brave femme de mère », ça commence à carburer : Mme Bisemont (bise mon quoi ?). Un nom qui me fait penser à Votez Bérurier et à son immortel « Bellecombais, Bellecombaises », qui introduit sa harangue de candidat à la mairie de Bellecombe. Je ne m'en lasse pas.
Mme Bisemont est une vioque chargée comme un arbre de Noël de breloques en or massif, qui s’envoie en l’air avec un petit jeune, qui a lui-même une jolie copine, avec laquelle il imagine un stratagème pour soutirer un peu de compensation financière à son dévouement sexuel. Seulement, tout ça vire mal, et ça fait toute une histoire.
Vous avez remarqué que l’intrigue est présente, évidemment, chez San Antonio, sans ça il n’y aurait pas de roman, mais qu’elle devient parfois le cadet des soucis de l’auteur, en particulier quand il s’agit de résoudre l’énigme. Frédéric Dard se fiche souvent du dénouement comme de sa première étrangleuse à rayures (mettez "limace à carreaux lilas" si vous préférez). Comment ça finit, c’est le cadet de ses soucis, et il a, pour conclure, des manières parfois tout à fait cavalières.
Mais quand il est en forme, la langue frétille comme un gardon qu’un hameçon cruel vient de tirer des eaux trop claires de la Cérigoule. Voyez page 33 de La Vérité en salade. Je ne vais pas recopier la tirade, juste la fin : « Grandes premières en habit ! Petites dernières ! Balzac zéro zéro zéro un ! ». Soudain, l’esprit des amateurs de cinéma fait tilt ! Ils viennent de reconnaître un classique. Bon sang mais c’est bien sûr : « Jean Mineur publicité, 79 Champs Elysées », le petit mineur qui lance sa rivelaine à la fin de la séquence publicitaire, à l’entracte ! Dard, on peut dire que tout lui est bon. Peut-être parce que c'est un cochon ?
Pas la peine de faire l’éloge de San Antonio : il s’en occupe tout seul. Mais avant de terminer mon laïus, une révérence du côté de l’illustrateur favori de la série pendant les vingt premières années de son existence : Michel Gourdon (voir Viva Bertaga plus haut, et la grosse demi-douzaine montrée hier). Les illustrations de couverture ont acquis grâce à lui une homogénéité de ton, une cohérence qui vous fait repérer aussitôt les premiers tirages dans les boîtes des bouquinistes (bien vérifier cependant que la date de dépôt légal coïncide avec le copyright).
Personne n’est éternel, heureusement, et l’éditeur a été obligé de se tourner vers d’autres illustrateurs, avec plus ou moins de bonheur, il faut bien le dire. C’est sûr que le style Gourdon ne donne pas une idée juste du « ton » San Antonio, parce que ses images semblent prendre la chose au sérieux, et annoncer un polar comme tous les polars, bien carré. Or San Antonio n'est pas carré, il est tordu, il le sait et il le dit. Tenez, c'est dans lequel que le commissaire croise la route d'une belle nana qui a ceci de particulier qu'elle enlève sa culotte sans y mettre les mains ? Essayez pour voir. Je crois me souvenir que c'est une Israélienne, qui se paie un entre-deux avec Béru et San A.
Mais il ne faut pas oublier que les aventures du commissaire sont publiées dans la série « Spécial Police », et que la présentation obéit donc à certaines règles éditoriales. L’humour et les allusions salaces n’apparaîtront que plus tard en façade. Celles que j’apprécie sont celles qui rappellent les dessins que Pierre Etaix (oui, le cinéaste, le clown, le ...) avait faits pour Les Petits mots inconvenants (Balland), un livre rigolo de Jean-Claude Carrière : salaces, mais subtils et humoristiques.
Certes, le commissaire San Antonio est un vieux réac, un misogyne, un homophobe de première bourre (et je ne sais pas ce qu'il pense des Arabes), et c’est sûr qu’aujourd’hui, il ne pourrait plus déblatérer ses horreurs sur les gonzesses ou sur les fiottes (et fières de l'être) sans se prendre dans le buffet autant de procès que le malfrat récalcitrant encaisse de valdas défouraillées par le soufflant d’un argousin de littérature devenu un personnage quasiment historique. Mais c’est peut-être ce qui me le rend sympathique, justement. Je prends le risque des valdas. Il faut bien mourir de quelque chose, n'est-ce pas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, san antonio, frédéric dard, humour, langue française, polar, roman policier, bérurier, viva bertaga, michel gourdon, les petits mots inconvenants, jean-claude carrière, pierre étaix
vendredi, 30 août 2013
FREDERIC DARD ECRIVAIN

"LE SECRET DU NAVIRE : J'AI VU CLOUER SUR LA TABLE LA MAIN GRAISSEUSE DU MEXICAIN"
JOURNAL DES VOYAGES
***
J’ai donc lu récemment La Mort de Virgile, de Hermann Broch : les Grandes Jorasses par la face nord, sans assurance, en hivernale, en maillot de bain et en apnée. Ensuite j’ai lu Tante Martine, de Henri Bosco. Déjà, ça fait un choc, le passage de l’un à l’autre. Je devrais dire le basculement de l’un dans l’autre : du haut de la très haute montagne inhospitalière à l'oxygène raréfié, on descend dans les vallées parfumées de la Provence. Encore que, du moins me semble-t-il, l’esprit de Bosco et celui de Broch ne soient pas si étrangers l’un à l’autre qu’on pourrait le croire, en matière de quête spirituelle et de plongée dans l’insu.
Tout de même, à lire Bosco, on se sent presque en vacances par rapport à la contention radicale et verticale qu’exige Broch de son lecteur, tout au moins dans La Mort de Virgile. Tante Martine fait donc un peu figure de délassement, quand sa lecture intervient après. Mais Paul Valéry l’avait bien dit : « Ô récompense après une pensée / Qu’un long regard sur le calme des dieux ». C’est là qu’on se sent en vacances : Henri Bosco, c’est les vacances après Hermann Broch.
Les doigts de pied se mettent d’eux-mêmes en éventail, on est sur l’herbe douce, on commence à regarder les feuilles par en dessous et, de fil en anguille, après avoir apporté sa modeste contribution à l’augmentation de capital du contentement de la copine étendue à côté, sans se demander si l’appel d’offre était réglementaire, légal, ou même moralement défendable, on sombre dans cette délicieuse somnolence de l’être procurée par le farniente. La Cérigoule murmure pas loin, gardant au frais le reste de rosé de Provence. Même les oiseaux piquent un roupillon. On était venus pour ça.
Alors maintenant, essayez d’imaginer, à l’intérieur même de ces vacances, somme toute encore un peu studieuses, des sortes de vacances au carré. Car qui passe authentiquement ses vacances à ne rien faire ? Et ça se comprend. Ne faire strictement rien, rester étendu au soleil comme la limace sur la feuille de laitue, c’est s’exposer au pire risque qui menace l’humanité souffrante : se mettre soudain à penser. Qui aurait la témérité d’affronter le monstre ?
C’est là, au milieu des après-midi torrides, dans la touffeur des étés où déjà pointe à l’horizon l’horreur de la rentrée, que vous vous accrochez à la planche de salut : un livre ! Vous avez bien lu. Mais pas n’importe lequel. Les vacances au carré ne peuvent décemment se passer ailleurs que dans un volume édité par les éditions Fleuve Noir, dans la collection « Spécial Police », et plus précisément dans la série passée à la postérité sous l’appellation générique de SAN ANTONIO. Voilà, c’est dit.

Maintenant, ce n’est pas parce que le nom magique est lâché qu’il faut se précipiter à l’aveuglette. Dans les cent soixante quinze titres parus, on dira ce qu’on voudra, mais il y a du bon et du moins bon, il y a à boire et à manger, il y a de la chèvre et du chou, du haut et du bas, de la poire et du fromage, du ziste et du zeste, du chien et du loup. Entre nous et le pont de l’Alma, ma petite sœur n’irait pas plus y mettre la main que dans la culotte du zouave. Il y faut un minimum de prudence, de circonspection et de discernement.
Il faut bien dire que le bon Frédéric Dard ne l’était pas tout le temps, et il lui est arrivé plus d’une fois d’avoir des coups de mou dans le porte-plume. C’est forcé, c’est humain, c'est normal et c'est comme ça : le meilleur chroniqueur de presse, qui sue sang et eau pour fournir avant le bouclage les 1500 signes quotidiens qui font bouillir sa marmite, il y a forcément du déchet dans sa production. On ne peut pas toujours être au top, c’est l’évidence. Même chez Alexandre Vialatte, on trouve parfois que l'auteur ne s'est pas donné trop de mal. Un frustration, certes légère, mais indéniable, s'ensuit fatalement. On dira que c'est la vie.

Les deux numéros de « San Antonio » que je viens de lire en sont l’illustration éclatante. Prenez Du Mouron à se faire, je vais vous dire, c’est laborieux, ça se traîne, on n’y croit qu’à moitié, et surtout, pas une seule page de bravoure. Quelques petites crottes de formules sont tombées sur le macadam pour faire plaisir, mais on sent bien que le cœur n’y est pas.
On dira, pourquoi le commissaire est-il allé se planquer à Liège, je vous demande un peu ? D’abord c’est la Belgique, et rien que pour ça, l’auteur aurait dû y réfléchir à deux fois. Ensuite, c’est la ville natale d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), passé à la postérité pour un seul air de bravoure et de baryton, c’est dans Richard Cœur-de-Lion : « Ô Richard, ô mon roi, L’univers t’abandonne … » (pour les amateurs, cliquez ci-contre). Un baryton plus un richard : deux raisons d’éviter, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, polar, san antonio, bérurier, frédéric dard, hermann broch, henri bosco, la mort de virgile, tante martine, roman policier, fleuve noir, grétry, richard coeur de lion, belgique, musique, alexandre vialatte
mercredi, 01 mai 2013
DU CÔTE DES GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
C’est entendu, il y a littérature et littérature. D’aucuns le contestent d’ailleurs. D’autres parlent avec une certaine condescendance de littérature et de « sous-littérature ». Moi je dis qu’il faut de tout pour faire un monde. Je ne suis pas comme ces esthètes qui ne jurent que par le quatuor à cordes, et fichent le camp avec une grimace de dégoût dès qu’ils croient entendre de l’opéra ou de la symphonie (ceci est un message personnel, mais il sait ce que j’en pense).
Prenez n’importe quel bouquin de Georges Simenon, Maigret ou autre. Vous l’ouvrez, vous passez un bon moment, vous le refermez, vous l’oubliez. Voilà déjà quelque chose d’acquis : un peu de « sous-littérature », ça ne peut pas faire de mal. Et ça ne vous encombre pas la mémoire. Il ne viendrait à l’esprit de personne en général, et de Fabrice Luchini en particulier, d’apprendre par cœur Les Gens d’en face (1932, la même année que Voyage au bout de la nuit), parce que l'auteur lui-même serait très étonné que son ouvrage recélât des richesses poétiques insoupçonnées. Peut-être à l'insu de son plein gré ?
Prenez n’importe quel Arsène Lupin, maintenant. Notez qu’on ne se réfère qu’exceptionnellement au nom de Maurice Leblanc : un cas intéressant de personnage dont le lustre éclipse la personne de celui qui l’a fabriqué.
J’ai dévoré tous les Arsène Lupin. Une personne proche (coucou, M. !) en détenait la totalité des volumes (reliés en toile imprimée de couvertures d’originaux) sur une étagère de la « petite maison », première chambre à droite en haut de l’escalier. Eh bien je vais vous dire : Arsène Lupin, ça marche. A gauche, c'était la salle de bains. Je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas les lieux.
J'ai dévoré tous les Arsène Lupin. C’est sûr que je ne les lis plus aussi fraîchement qu’alors, parce que les ficelles m’apparaissent crûment, que le personnage du séducteur voulu par l'auteur est souvent horripilant et que les essais de psychologie auxquels il se livre sont devenus exaspérants. Mais enfin, ça coule comme une bière fraîche dans le gosier, à la terrasse du café principal d’Aiguilles une fin d’après-midi d’été au retour d'une grande bambane sur les sentiers caillouteux (« une pour la soif, une pour le goût »).
J’ai connu un Schotzenberger, un garçon sympathique au demeurant, qui, en dehors des traductions qu’il faisait de Sastro, un auteur espagnol, avait dépensé des trésors d’éloquence et d’argumentation, en présence de Roger Bellet, pour démolir Arsène Lupin (personnage, techniques narratives, nouvelles, romans), où il voyait de telles imperfections que tout ça ne pouvait être que raté de chez raté. Bref, on l’aura compris : il était bel et bien fasciné. Piégé. Pour un futur intello, ça la foutait mal. En fait, il voulait se racheter.
J’ouvre un Arsène Lupin de temps à autre. Pour me désennuyer de la lecture de Wilhelm Meister, par exemple. Je ne dirai pas que c’est le fin du fin de la jouissance littéraire. Certes. Mais quand tu es au sommet de l’Everest, tu n’aurais pas l’idée d’habiter là : il faut bien redescendre. Pareil pour le caviar : béluga, sévruga ou osciètre, tu n’aurais pas l’idée d’en faire ton petit déjeuner ordinaire. Au bout d’une semaine de ce régime, rien que l’idée de se lever te donne envie de vomir.
Et puis je vais vous dire, je viens de relire L’Agence Barnett et Cie, et je ne m’en porte pas plus mal. C’est déjà ça d’acquis. Je suis désolé, le match à répétition qui se joue entre Jim Barnett et le policier Béchoux me ravit. Jim Barnett est détective privé bénévole, faut-il le préciser ? Il ne se fait pas payer. Mais à la fin, allez comprendre, au nez et à la barbe de Béchoux (qui aimerait bien le coffrer), il se retrouve plus riche qu’avant, parce qu'il a réussi à barboter quelque chose au méchant de l'histoire. Béchoux est flic, j'avais oublié de le préciser. Même que Barnett s'offrira quinze jours de voyage sentimental avec Madame Béchoux. Moralité : c'est dur d'être flic.
Les Huit coups de l’horloge, ça me plaît bien aussi. Huit nouvelles mystérieuses pour les beaux yeux d'une jolie femme qui, ne voulant pas céder à Lupin sans combattre, le met au défi de résoudre autant d'énigmes. Des ordres impérieux auxquels il défère de bonne grâce, et toujours avec une grande classe.
La Barre-y-va est un roman bien fait, quoi qu’un vain peuple puisse récriminer. C’est sûr que les cheveux de la logique se font un peu tirer : Guercin, le gendre félon de M. Montessieux, se fait flinguer sans qu’il y ait crime. Heureusement, Leblanc ne s’appesantit pas sur les détails techniques du mécanisme mis au point par le beau-père pour tuer celui qui voudrait s’approprier la source d’où coule sa poussière d’or. Le génie de Raoul d’Avenac mettra bon ordre dans l’embrouillamini, et en plus il mettra au jour le tas d'or qui datait des Romains. Il faut oser raconter ça, mais quand c'est bien fichu ...
récriminer. C’est sûr que les cheveux de la logique se font un peu tirer : Guercin, le gendre félon de M. Montessieux, se fait flinguer sans qu’il y ait crime. Heureusement, Leblanc ne s’appesantit pas sur les détails techniques du mécanisme mis au point par le beau-père pour tuer celui qui voudrait s’approprier la source d’où coule sa poussière d’or. Le génie de Raoul d’Avenac mettra bon ordre dans l’embrouillamini, et en plus il mettra au jour le tas d'or qui datait des Romains. Il faut oser raconter ça, mais quand c'est bien fichu ...
Victor de la brigade mondaine est un roman à ficelle, bien sûr, mais qui garde un certain charme. On sait très vite que Victor est Arsène (pardon de dévoiler le poteau rose), et inversement, mais malgré les tours de passe-passe, le récit est efficace, et on avale la salade sans se poser trop de questions. On sait très vite que Bressacq n’est pas digne d'être Arsène Lupin, pour la raison simple qu’il tue (ou fait tuer), ce à quoi ne saurait descendre l’âme noble de notre gentleman cambrioleur.
On passera rapidement sur L’Homme à la peau de bique (pompé par-dessus l’épaule d’Edgar Poe quand il écrivait son Double assassinat rue Morgue) et sur Le Cabochon d’émeraude (pompé par-dessus l’épaule de Sigmund Freud, à cause du rôle donné à l’inconscient).
Moralité : on peut rester lucide sur les faiblesses, tout en prenant plaisir à suivre les voltiges et les rodomontades de ce personnage qui, qu’on le veuille ou non, reste bien installé au fond de nos imaginaires.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, roman policier, maurice leblanc, goossens, arsène lupin, georges simenon, maigret
jeudi, 30 août 2012
CHOURMO, SUITETFIN
Pensée du jour : « Il prend la plume, il va écrire à un ami ; il se rappelle soudain que cet ami est mort ; c'est pourtant avec lui qu'il partage les trois quarts des choses. A tel autre ; il est mort aussi. Et tel, et tel. Ils sont rangés sous terre, comme les livres, une fois lus, sur des rayons. L'humanité est une bibliothèque dont presque tous les livres sont lus. L'humanité est aux archives ».
ALEXANDRE VIALATTE
Nous parlions donc de Chourmo, de JEAN-CLAUDE IZZO. Ce qu’on savait, c’est que le père de Guitou, Gino, est mort (de mort violente), et que Gélou (son vrai prénom n’est jamais donné, et je déteste les diminutifs, les "bibiche", les "mon cœur", et autres niaiseries suspectes ; à la rigueur, votre sœur Gisèle, appelez-la Sophie, et n’en parlons plus, ça reste intéressant et affectueux) s’est maquée avec Alex, et que Guitou ne peut pas encadrer Alex, et qu’Alex le brutalise à l’occasion.
Mais comment le lecteur (Fabio Montale dit "je", c’est pratique : chaque rebondissement, c’est d’abord lui qui l’encaisse) aurait-il pu deviner qu’Alex, son nom complet, c’est Alexandre Narni, et que ce type est (avec Antoine Balducci) le porte-flingue de Sartanario, un parrain de la Camorra napolitaine (la même que dénonce ROBERTO SAVIANO dans Gomorra), et que c’est lui qui a dézingué, au tout début du bouquin, Hocine Draoui et, dans la foulée, Guitou ?
Même Gélou, sa propre compagne depuis 10 ans, croit qu’il est dans le marketing économique. En fait de marketing économique, c'est de l'arnaque à tous les étages. Sartanario le camorriste, vous savez quoi ? Il prête de l’argent (à blanchir) à qui veut monter une entreprise, mais à 25 %, et Alex est chargé de faire rentrer l’argent bonifié et de punir les mauvais payeurs. Mais le truc, à un taux pareil, c'est qu'il ne peut y avoir que des mauvais payeurs (voir le restaurant de Gino). La différence avec le Gobseck de BALZAC, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette : il y a le flingue d'Alex. On apprend d'ailleurs que c'est lui qui avait tué Gino, le légitime de Gélou.
Le pire, c’est que Guitou n’était même pas le fils de Gino, mais bien du truand Alex (andre Narni), dont on apprend qu’il a donc tué son propre rejeton, mais qu'il l’ignorait parce que Gélou ne lui avait jamais dit que c’était lui, le père (c’est vrai que seule la mère sait qui est le père, et encore, pas toujours).
Vous voyez le nœud ? Quasiment gordien, le nœud, non ? "Gordien", ça fait très bien, dans un paysage. Personne ne sait ce que c’est, donc tout le monde respecte. Et ignore généralement comment Alexandre l'a réglé (Le Grand, c'est d'un coup d'épée, Narni, d'un coup de pistolet). N’empêche, qu’est-ce qu’elle prend sur la calebasse en rien de temps, la frangine à Fabio Montale ! Son fils a été tué par son mec, qui est un tueur à gages. De quoi disjoncter bien net ? Eh bien non.
Eh ben oui que eh bien non, parce que tout le monde se retrouve dans le zen d’un temple bouddhiste, où Cûc, la femme d’Adrien Fabre, le père du Mathias qui a prêté la chambre à Guitou (j'espère que vous suivez), la même Cûc qui a pris le temps de faire une pipe à Montale, où Cûc, disais-je, a caché Mathias et Naïma.
C’est vrai que c’est sûr que c’est garanti, que là, ils étaient en sécurité : comment le camorriste napolitain aurait l'idée de fouiner chez les bouddhistes ? J’ai oublié de préciser qu’Adrien Fabre a assisté à l’exécution du début, et qu’il a été lui-même exécuté (il devenait de plus en plus tiède) : il devait sa brillante carrière d’architecte à l’argent sale et à l'influence secrète de la Camorra sur les marchés publics.
C'est le genre de livre optimiste, qui rétablit l’ordre du monde à la fin. Oui, parce que les méchants sont punis. Parce que Fabio Montale, quand il est au volant de la Saab, faut pas le chercher. Ou alors, il faut le suivre sur la route du col de la Gineste, en Safrane noire, par la D 559, avec la ferme intention de faire un tir au pigeon. A fond les manettes. La poursuite finale est assez bien écrite, où Montale se demande s'il préfèrera les spaghettis à la matricciana, une soupe de haricots et une daube bien marinée. Tout en taquinant à mort le frein et le changement de vitesses.
Au moment fatidique, la Safrane des méchants « me doubla et poursuivit sa route. Contre la rambarde en béton. Culbuta. Et partit dans les airs. Les quatre roues face au ciel. Cinq cents mètres plus bas, les rochers, et la mer ». L’ordre est donc rétabli, et d’autant mieux que les deux flics qui suivaient tant bien que mal dans leur R 21 minable et antique, rappliquent aussitôt pour lui dire que le commissaire Loubet avait bien fait les choses et que, de toute façon, les truands étaient cuits.
Quoi, j’ai raconté la fin ? Et alors ? Ceux qui l’ont lu, de toute façon, ils savent (à condition de s'en souvenir). Et ceux qui n’ont pas encore lu la trilogie marseillaise de JEAN-CLAUDE IZZO, c'est sans doute qu'ils n’en ont rien à battre, sinon, ce serait fait depuis longtemps.

UNE TÊTE DE PERE TRANQUILLE, NON ?
MOI, JE LE VERRAIS BIEN PROF D'ALLEMAND
Et puis en plus, ça montre qu’un livre dont la seule chose à faire est de ne surtout pas raconter la fin, c’est un livre dont le seul intérêt est dans le dénouement. Or, quand on raconte le dénouement et que ça dégoûte la personne, c'est qu'on est dans la littérature de consommation. S'il connaît la fin avant, le lecteur n'a plus besoin d'ouvrir le livre. C’est ça, la littérature policière. Et ça vaut, évidemment, pour le cinéma.
SIMENON écrivait neuf livres par an, assis à sa table tous les matins. Avec sa pile de crayons taillés la veille au soir. CELINE a mis quatre ans pour terminer Voyage au bout de la nuit. En tout il a écrit SEPT romans. En mettant, comme il dit, sa « peau sur la table ». SIMENON, il en a écrit 368. Et il s'est bien conservé. Vous la voyez, la différence ?
Le polar, c’est un mécanisme avant d’être de la littérature. THOMAS NARCEJAC (de BOILEAU & NARCEJAC, donc un connaisseur) le reconnaît : l’auteur de polar ne doit pas péter plus haut que son cul. Parce que son bouquin, c’est comme une rivière qui remonterait vers sa source : il est élaboré et construit à partir de la fin. Tout le reste de l’effort d'écriture, c’est de faire le plus d’effet possible sur le lecteur. Il fait des livres qui s'auto-détruisent.
Un grand livre, c'est le contraire : ça se développe dans le sens que la nature impose à l’eau : de la source à la mer. CELINE lui-même est saisi d’étonnement devant les rigoles, rus, ruisseaux, rivières et fleuves qui se mettent à couler et qui s’imposent à lui quand il écrit Féerie pour une autre fois, et qui font gonfler le volume des volumes. Il part dans les directions qui se présentent. Et surtout, il ne sait pas où il va aboutir.
L’intrigue de Le Rouge et le noir, c’est quoi ? Un jeune ambitieux séduit une aristocrate, puis une aristocrate, avant de tenter de tuer la première. Franchement, pas de quoi fouetter un chat. Juste un fait divers. Qu'est-ce que c'est, Madame Bovary ? Quelques adultères et un suicide à la campagne. Ça veut simplement dire que STENDHAL et FLAUBERT ont mis du gras, du muscle et du nerf autour des os du squelette, et que ça donne des êtres vivants. Mais attention, ça ne veut pas dire qu’il faut mépriser le polar. « Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. » Appelons ça « hiérarchie des valeurs », si vous n’y voyez pas d’inconvénient. J’ai dit un gros mot ?
Reste un truc, dans Chourmo, qui me chiffonne (pas trop) : le "je" de Fabio Montale sert à l’auteur pour des retours sur le passé amoureux de l’ancien flic qui a raté pas mal de choses. Bon, on a compris, il s’agit de « donner de l’épaisseur au personnage ». Moi je veux bien. Mais ça me fait un peu l’effet de l’usage du Front National dans le bouquin : ça n’apporte pas grand-chose, et même, ça fait perdre du temps. Bon, peut-être que le gars était payé à la page ?
C'est comme Honorine et Fonfon, je veux dire les personnages secondaires, dans le polar (tous les polars) : IZZO n'a pas tort de donner un peu de profondeur de champ à la photo. Mais s'il leur accordait plus d'importance, le centre de gravité du bouquin se déplacerait en direction de la grande littérature. Dans le polar, pour que l'intrigue avance (puisque c'est elle l'essentiel), il ne faut pas que les personnages en aient trop, de l'épaisseur. Côté psychologie, il faut en rester au dessin esquissé. Bon, finalement, admettons que l'auteur s'en sort bien. Le contrat est rempli.
Il reste aussi le tableau de Marseille, qu’on regarde de l’intérieur, en caméra subjective : « Je pris la rue Sainte-Barbe, sans mettre mon clignotant, mais sans accélérer non plus. Rue Colbert ensuite, puis rue Méry et rue Caisserie, vers les Vieux Quartiers, le territoire de mon enfance ». On suit bien. On passe par la rue de Lorette, dans le Panier. Place des Treize-Coins, juste derrière l’hôtel de police.
Le problème du polar, c’est que les ficelles, presque forcément, comme elles sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus visibles. Et que c’est pour ça qu'il appartient à ma catégorie des amours, disons, intermittentes. De la petite littérature. Même si ça donne de gros pavés, genre MICHAEL CONNALLY (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, ...) ou JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ (Le Concile de pierre, Le Vol des cigognes, ...). Je ne méprise pas du tout, mais « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, roman policier, polar, jean-claude izzo, chourmo, trilogie marseillaise, camorra napolitaine, marseille, fabio montale, roberto saviano, gomorra, balzac, safrane, georges simenon, louis-ferdinand céline, boielau narcejac, michael connally, jean-christophe grangé
mercredi, 29 août 2012
CHOURMO, JEAN-CLAUDE IZZO
Pensée du jour : « Mais, dès que le soleil reparaît, les dames se remettent nues au soleil ; ce sont de magnifiques personnes ; elles ont des cuisses monumentales, deux fois plus nombreuses que leurs corps qui sont étendus parallèlement sur de grandes plates-formes en bois au bord de la piscine de Levallois. On les voit du train, en passant ; ensuite on voit un grand cimetière ; et ensuite la fabrique de jambons Olida ».
ALEXANDRE VIALATTE
Je viens de relire Chourmo, de JEAN-CLAUDE IZZO. Dix ans après. Il ne m’en restait strictement rien, hormis la poursuite finale, spectaculaire, qui coûte la vie aux deux truands, et que j’ai eu bien du plaisir à retrouver. C’est un polar. Au rayon polar, c’est plutôt un bon. Il fait partie de la « trilogie marseillaise », pris en sandwich entre Total Khéops et Soléa. Solea, c’est un titre de MILES DAVIS, dans Sketches of Spain (hyperconnu). "Total Khéops", si je me souviens bien, ça a quelque chose à voir avec le chaos. "Chourmo", je l’ai lu, mais je ne m’en souviens déjà plus. Ce n’est peut-être pas si grave : vocabulaire djeunz d'il y a quinze ans.
Au bout de la trilogie, Fabio Montale, le héros, se fait dessouder. Il ne boira plus de Lagavulin. C’est un whisky. C'est son whisky. « Pungent and potent, with richly peaty, deep, smoky flavor. » Ça, c'est la publicité. Beaucoup trop tourbé (comme "peaty" l’indique) à mon goût, comme tous les Islay. C’est pour ça que je préfère les Speyside, ou « Triangle d’or », entre Inverness et Aberdeen (Glenfiddich, Glenfarclas, Glenlivet, Lands of Scotland, mais Arran n’est pas mal quand même …). On imagine mal un détective sans les pieds sur le bureau et un verre à la main (dans l'autre main, c'est la cigarette). Même Maigret se fait monter des bières.
Le roman policier, donc, j’aime bien. J’en ai lu beaucoup. A Corbeyssieu, il y avait plusieurs mètres de rayons, en haut de l’escalier de la « petite maison ». Le polar, c’est devenu un « genre » en soi, il paraît. Pour ainsi dire, une profession. C’est comme la science fiction. Le livre pour enfants. La bande dessinée. La littérature a fait des petits. Des sous-produits. La littérature s’est divisée. Et en se divisant, elle s'est hiérarchisée. Ce qui est bien, avec le polar, c'est que d'une lecture à l'autre, on oublie. C'est même sans doute fait pour ça.
Remarquez, la littérature divisée, ça ne date ni d’hier (une des meilleures blagues que je connaisse : « Quelle est la différence entre un pigeon ? – C’est qu’il ne sait ni voler », je sais, c'est réservé à une élite). EUGENE SUE, déjà. Et PAUL FEVAL. Et MICHEL ZEVACO. Et tous les feuilletonistes du 19ème siècle, très doués pour pisser de la copie jour après jour. « Populaire », on disait, avec une moue de mépris au coin de la lèvre.
Est-ce que ça disqualifie toute hiérarchie ? Non, mille fois non. Un livre qui vous fait passer un bon moment, c’est bien, mais ça n’a rien à voir avec un livre qui vous bouleverse. Encore moins avec celui qui change votre vie. Non, la littérature est aussi hiérarchisée que l’amour. Il y a les passades, le cul, vous ne vous rappelez ni le prénom, ni le visage. Une vague modalité du plaisir. Un élément du décor. A la rigueur la chaudepisse. Je parle d’avant le sida.
Et puis il y a le grand amour. Avec, entre les deux, toute la gamme des intensités possibles. Infiniment plus que neuf échelons, comme la pauvre échelle de Monsieur Richter. Oui, tout ça est très hiérarchisé, quoi qu'en dise et en pense notre époque, niveleuse acharnée, égalisatrice à la "je ne veux voir qu'une tête" (dit-elle en se fourrant le doigt dans l'oeil), uniformisatrice fanatique et raboteuse intégriste.
Le roman policier, c’est comme ces amours que vous avez plaisir à retrouver de temps en temps, mais que ça n’ira jamais plus loin. Vous deux le savez. Un attachement amoureux. Un point de repère. Mais ce n’est pas le grand amour, vous savez, ce soudain torrent de la passion qui vous embarque, puis qui vous laisse échoué, hébété, sur le trottoir d’un petit matin, quelque temps après, sans force, à vous demander ce qui vient de se passer. Un petit matin terrible et inoubliable.
Le roman policier, franchement, je n'imagine pas un instant que quiconque puisse ne lire que ça. Arrive à n'en pas sortir et à s'en contenter. Cela vaut pour la SF, la BD, etc. SAINT THOMAS D'AQUIN en personne ne disait-il pas doctement : « Timeo hominem unius libri » ? Il avait bien raison : je crains l'homme d'une seule sorte de livre. De même que je ne conçois pas qu'on puisse ne lire que de la grande littérature, ou n'écouter que de la grande musique. Le monde est trop divers pour que l'homme s'isole dans ce qu'on appelle trop commodément (et si pauvrement) une « passion ». Le timbre poste, l'étiquette de camembert, la plaque publicitaire émaillée.
Mon polar à moi n’est donc pas aussi ambitieux et dévorant qu'une passion amoureuse. Ce qu’il me faut, c’est un SIMENON (n'importe lequel des 368) de temps en temps, sinon un CHANDLER (La Dame du lac est formidable), ou un CHESTER HIMES (L'Aveugle au pistolet, par exemple, un livre qui a du poil aux pattes), ou un PETER CHENEY (qui a un peu mal vieilli). A la rigueur, La Chair de l'orchidée, de JAMES HADLEY CHASE (dont GEORGE ORWELL dit beaucoup de mal, et qui lui reproche, en tant qu'Anglais, de faire plus "trash" que les auteurs américains, juste pour vendre autant qu'eux).
Chourmo, c’est intéressant. C'est déjà pas mal. La faiblesse du bouquin ? Le Front National. Fabio Montale fait une phobie politique. Il arrache même, dans le bureau de son ancien collègue Pertin qu’il ne peut pas encadrer (que c’est même réciproque), une affiche vantant le syndicat de flics affilié aux méchants fachos. On sent que ça drague le lecteur de gauche. Attention, ça ne veut pas dire que je vote pour MARINE : déjà, avant qu'elle ouvre la bouche je me sens « tout fatigué de la vague MARINE » (Parfum exotique, les majuscules sont de moi). De toute façon, je ne vote plus, c'est un principe.
Je l'affirme en direct : le Front National, l’histoire n’en a pas besoin, même si l’auteur s’efforce de lui faire une place dans le scénario. Il a ménagé quelques diverticules, c'est normal, car il faut que le lecteur aille sur des voies de garage, avant d'être illuminé par la solution. Ici, le truc vicelard (magouille avec des islamistes de choc) ne marche pas très bien. Le militantisme affaiblit le polar. Et la littérature en général. C'est ma conviction.
Par contre (mon prof d’allemand, monsieur MOIROUD, nous serinait : « On ne dit pas "par contre", on dit "en revanche" ». Eh bien là, il l’a dans l’os, bien fait pour lui.), ce qui carbure au maximum, c’est le fond de l’intrigue, et j’avoue que ce genre de mécanique horlogère de précision, chaque fois, ça m’épate. Je vous raconte.
Guitou est l’ado chéri de sa mère Gélou (ces diminutifs … !). Pendant les vacances, il est tombé raide dingue de Naïma. Alors, comme il a dans le même temps fait la connaissance de Mathias, il se fait prêter pour une nuit sa chambre. D’abord, il pique 1000 francs dans la caisse de sa mère, pour aller de Gap à Marseille, qu'il se fait piquer à peine sorti de la gare. Seulement, c’est dans la même nuit qu’Hocine Draoui se fait trucider (un ennemi du FIS algérien). Juste à l’étage au-dessus. Et l’idiot, alerté par un bruit (le revolver était muni d'un silencieux), ouvre la porte, et c’est là qu’il reçoit la balle de 38 (9 mm, balle de 9,6 ou 10,2 g suivant option) qui ne pardonne rien.
Il faut savoir que Gélou est la sœur de Fabio Montale, l’ex-flic marseillais. Qui met du temps à comprendre que Guitou est mort, et qui est donc bien embêté pour sa soeur. On le serait à moins. Je passe sur les voies de dérivation de l’intrigue principale. Le problème essentiel qu’a à résoudre l’auteur de polar, c’est le timing. Quand doit-il donner au lecteur l’élément qui va le surprendre tout en faisant avancer la mécanique ?
JEAN-CLAUDE IZZO fait ça très bien.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude izzo, total kheops, chourmo, solea, trilogie marseillaise, marseille, roman policier, polar, lagavulin, feuilleton, eugène sue, paul féval, michel zévaco, hiérarchie des valeurs

