samedi, 07 avril 2018
5-LA PLANÈTE DES RICHES
30 décembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (17).
5/5
Inégalités, planète et nombre.
Au fait, pourquoi a-t-on appelé les années 1945-1975 les « Trente Glorieuses », la célèbre formule de Jean Fourastié ? On nous parle complaisamment de l’incomparable prospérité qu’ont connue les pays développés et du taux de croissance faramineux de l’activité économique. C’est vrai, évidemment. Je fais juste remarquer que cette prospérité et cette croissance sont concomitantes de cette autre vérité incontestable : ce furent sans doute les années les moins inégalitaires de l’histoire, comme cela apparaît clairement dans Le Capital au XXI° siècle de Thomas Piketty. Prospérité, croissance et redistribution dans un même bateau ! Bon dieu, mais c’est bien sûr ! Il suffisait d’y penser !
Sans être économiste, j'ai tendance à me dire que ce n'est pas une simple coïncidence et que, pour que les entreprises marchent du tonnerre de Dieu, il suffirait peut-être de donner aux populations le pouvoir d’achat qui permettrait à la machine économique de tourner à plein régime. De l'intérêt bien compris, en somme. Cesser de draguer et de gaver l'actionnaire (le soi-disant investisseur, mais vrai spéculateur : à vrai dire, trois mots devenus interchangeables, ou pas loin) pour mettre un peu d'huile dans les rouages de la vie des laborieux, pour qu'ils aient chaque matin envie de retourner au charbon parce que ça vaut le coup. Au lieu de se demander, comme beaucoup font actuellement, de quelle humeur sera la guillotine ce matin.
La voilà, la solution : modérer les inégalités de richesse, c’est bon pour tout le monde ! Pas le communisme, non, surtout pas cette façon militaire et policière de niveler par le bas : juste une redistribution convenable pour la prospérité de tous, avec des inégalités qui puissent avoir des airs acceptables. Des inégalités un tantinet justifiées (par le talent, le mérite, le travail, bref : des "valeurs", mais des vraies, pas des abstractions). Ce qu'il faut retenir ? Que pendant trente ans, les pays industrialisés ont magnifiquement crû et embelli en partageant (approximativement) les richesses produites entre ceux qui en fournissaient les moyens et ceux qui les produisaient par leur travail.
Et ça n’a pas si mal marché, en fin de compte, tant que l’activité est restée concentrée sur une quinzaine de pays industrialisés. Allez, soyons sympa : les trente-cinq membres de l’OCDE. Tant qu’ils sont restés entre eux, et aussi longtemps qu’a duré la croissance de ces marchés, jusqu'à ce qu'une majorité de gens aient acquis les premiers éléments du confort qui est le nôtre aujourd'hui. Bon, c'est vrai que, pendant tout ce temps, la prédation des ressources a continué joyeusement, mais enfin à destination d'un nombre limité de pays : trente-cinq pays, ça ne fait pas une planète. On pourrait se dire que ce qui a marché pour quelques-uns, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour tout le monde. Très belle idée, c'est sûr, mais il y a une sacrée arête en travers de ce gosier.
Car c'est vrai qu'on voyait bien, déjà, les dégâts que ça faisait. Bon, le principe de la pollution, s'il commençait à être bien identifié par quelques illuminés (Pierre Fournier et La Gueule ouverte, les premiers écolos, "nucléaire non merci", Malville, Philippe Lebreton, alias professeur Mollo-Mollo, ...), était tout aussi largement nié par les "autorités compétentes" qu'il était concrètement à l'œuvre. Mais tant que c'était dans les ailleurs que c'était pollué, vous comprenez ... avant qu'on se rende compte que ça se passait aussi chez nous (air, terre, eau, etc.). M'enfin, du moment que les affaires prospéraient ... on ne chipotait pas trop.
Malheureusement, une fois les marchés à saturation, il a bien fallu en ouvrir d’autres et, pour cela, donner un peu de pouvoir d'achat à ces "autres", pour qu'ils puissent acheter. C’est peut-être cette logique qui a lancé la mondialisation, avec son cortège de délocalisations et de concurrence de toutes les mains d’œuvre (mot d’ordre : alignement sur le plus bas salaire : Bangla Desh par exemple).
Je saute des étapes, mais l'axe directionnel est à peu près là. Bon, c'est vrai, pour assister comme aujourd'hui à la montée fulgurante des inégalités, il faut qu'il se soit passé quelque chose d'autre : il faudrait se demander aussi ce qui a permis une telle confiscation de la création de richesses par un petit nombre de cumulards infernaux. Sans doute le couple diabolique Reagan / Thatcher. Paul Jorion, de son côté, voit dans cette concentration de richesses une des principales menaces qui guettent.
Il serait aussi intéressant de se demander dans quelle mesure la saturation de marchés déjà gavés n'a pas été pour quelque chose dans la course à l'innovation à tout prix et dans tous les domaines, concurrence exacerbée oblige. Je dis ça en passant, mais il y aurait peut-être de quoi s'arrêter un moment.
Toujours est-il que, après le pouvoir d'achat, les "autres" ont voulu davantage, comme par exemple ce qu'on appelle des "transferts de technologie" : il a fallu exporter les savoir-faire, les techniques, les compétences, pour "conquérir" des marchés. Tant et si bien que les "autres", à commencer par la Chine, sont devenus des concurrents à part entière. Pas de chance, hein ! C'est la logique même du profit qui a donné à l'Occident la prééminence, et qui lui a, du même mouvement, ôté cette prééminence, en même temps que l'initiative et la créativité, l'invention et l'innovation. L'Occident a livré aux "autres" les secrets qui avaient fait sa domination. A quelques détails près, je trouverais presque qu'il y a quelque chose de christique dans cette façon de donner de soi. Sauf que ...
Sauf que, étendez aux deux cents pays du monde la façon de produire et de consommer des trente-cinq privilégiés, et le monde n’y résiste pas. Cela veut dire que, de toute façon, le "modèle économique" inventé en Europe, en plus d'être carrément inéquitable, n'était pas raisonnable. Et une fois que l'Amérique protestante et mercantile s'en est emparée, il s'est montré carrément déraisonnable et sans frein. Alors vous pensez, une fois étendu à tous les pays en quête de croissance, de confort et de bien-être, le modèle, il est devenu définitivement insensé, impraticable et suicidaire.
Alimenter en matière, puis en produits de consommation une aussi grosse machine à produire et à consommer revient à piocher sans mesure dans le capital. Pour simplement dire qu’elle fonctionne, cette économie-là est obligée de vendre les bijoux de famille : je veux dire la nature. Cette humanité-là dilapide, pille les ressources, elle tue la poule aux œufs d’or.
Le problème, avec les êtres vivants, c’est que ce sont des prédateurs, tous sans exception. A partir du moment où il faut vous nourrir pour « persévérer dans votre être », vous prenez le carburant qu’il vous faut où il se trouve : le plus disponible, le plus nutritif, le plus facile, le plus près, le plus faible. La preuve, regardez l'immigration du loup des Abruzzes, d'abord discrète et précautionneuse, qui s'est progressivement fait dévastatrice chez les brebis (les écolos peuvent gueuler, c'est quand même la vérité). Le scénario est toujours le même : prendre, manger, déféquer. Prédation, consommation, déjection. Où que vous regardiez, quand vous avez à faire au vivant, c’est le cycle, quasiment mécanique, aujourd’hui encore. Ni vous ni moi ne faisons exception à la règle, à la différence que notre ingéniosité nous a faits les royaux prédateurs de tout, y compris du loup, heureusement.
Aussi longtemps que vous avez par-ci par-là un bonhomme qui prélève dans son environnement de quoi « persévérer dans son être », qui consomme et qui abandonne ses déchets là où il les a faits, l’environnement est content : il fait ce pour quoi la nature du lieu l’a fait, il accueille un étranger pour un temps, et il possède tout ce qu’il faut pour digérer (recycler) ce qu’il laisse en partant. La question du nombre est primordiale. Comme disait l’autre (peu importe cet autre) : « Quand il y en a un, ça va, c’est quand il y en a beaucoup que ça pose problème ». Rien de plus vrai en l’occurrence. Comme disait Fernand Raynaud dans je ne sais plus quel sketch : « Vous prenez dix sages, vous les serrez, vous obtenez un fou ». Mais quel âge faut-il avoir pour se souvenir de Fernand Raynaud ?
L’humain c’est ça : clairsemé, il passe inaperçu ; serré, il prend des maladies. Tout seul ou presque, c’est à peine si on s’aperçoit de sa présence : il laisse si peu de traces qu’il faut quelques dizaines de milliers d’années pour que des fondus en dénichent dans des sols improbables : ici une molaire, là une mandibule, ailleurs un tibia ou une calotte crânienne. Quand, avec le nombre, il commence à en laisser beaucoup, on appelle ça des déchets. Car c’est quand il se concentre que ça ne va plus. La première chose à prévoir, quand on organise un rassemblement populaire, en même temps que le ravitaillement, c'est l’emplacement des « feuillées », vous savez, ces chiottes de campagne rustiques où règne la convivialité, sinon gare aux conséquences diverses.
Pour les véhicules à moteur, c’est pareil : l’époque des De Dion-Bouton, Delahaye, Hotchkiss, Rosengar, Delage (véhicules polluants s’il en est) fait figure d’âge d’or et de folklore vintage. Rien à voir avec aujourd’hui, où les habitants de New Dehli (Inde) sont obligés d’installer un brumisateur géant pour faire retomber au sol les particules fines offertes par les pots d’échappement. Et ceux de la vallée de Chamonix bénissent tous les jours le percement du tunnel, qui leur apporte fidèlement les fumées toxiques quotidiennement sorties des pots d’échappement de milliers de poids lourds (582.000 chambres à gaz roulantes sur l’année 2012 : je pense à l’usage qui était fait des camions et des pots d’échappement dans certains camps nazis). Mille mercis, le Nombre !
J’ai entendu je ne sais plus qui soutenir je ne sais plus où que la planète est idéalement faite pour cinq cents millions d’humains. On en est à sept milliards (en comptant les femmes et les petits enfants, comme faisait maître François Rabelais). Soit dit en passant, mille mercis à la Médecine, pour la grenade démographique qu’elle a dégoupillée et qui n’a pas fini d’exploser (les Nigériennes font six ou sept enfants chacune, dans un pays très pauvre qui compte 20 millions d'habitants : qu'adviendra-t-il en 2050, où on en prévoit 79 millions ?). Les grandes âmes entonnent régulièrement leur refrain préféré : « La Terre pourrait nourrir dix milliards d’individus … ». Il faut à peine les pousser pour qu’ils ajoutent : « … si … ». Si quoi ? Réponse : « Si l’on procède à un partage équitable des ressources ». Equitable ! Tu l’as dit, bouffi !!!
Équitable ? Même Bill Gates le philanthrope ne veut pas être équitable. Il veut faire le Bien, et que tout le monde le sache, c'est différent. Il veut écraser les pauvres de sa Bonté. En vérité qui, à part quelques gogos de consommateurs bobos, tient à favoriser un commerce équitable ? Eh bien voilà, c’est tout simple : c'est la raison pour laquelle personne n’est pas plus en mesure de lutter contre les inégalités que contre les atteintes irréversibles à l'état de la planète. Tout ce qui est au sommet de la pile est trop heureux de respirer un bon air pur, de se sentir du côté du Bien et d’orienter les décisions dans le sens favorable au maintien du statu quo. Tout ce qui est en bas a juste le tort d’être en bas : on respire moins bien, on est trop serré et on a trop de poids sur les épaules et pas assez sur les décisions pour faire bouger quoi que ce soit. Édifier un monde juste ? Vous n’y pensez pas ! Qui est là pour vous entendre ?
Car accessoirement, voilà aussi la raison pour laquelle la nature elle-même est mal partie : le pillage n’est pas près de s’arrêter. L'état économique des gens et l'état écologique de la planète sont promis au même sort. Ils sont indissolublement liés et, selon toute apparence, pas pour le meilleur. Une consolation quand même : quand tout sera fini, il n'y aura plus personne, après coup, pour pointer son "gros doigt grondeur" sur les cancres pour dire : « Personne ne pourra dire qu’on ne savait pas ». Il n'y aura plus un seul donneur de leçon.
On respire presque bien à cette idée.
Voilà ce que je dis, moi.
20:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieuthomas piketty, le capital au 21° siècle, cahuc et zylberberg le négationnisme économique, 15000 scientifiques, bernard maris, paul jorion, économistes atterrés, georgius en revenant de la revue, hcr, cicr, ccfd, unicef, msf, anne fretel, france culture, bande dessinée, hermann, hermann sarajevo tango, onu, boutros ghali, sarajevo, pierre fournier la gueule ouverte, philippe lebreton, professeur mollo-mollo, centrale de malville, économie, science économique, politique, société
lundi, 24 avril 2017
CHRONIQUES DE PAUL JORION
 1/2
1/2
Dans la vie, il n’y a pas que Saint-Simon, le cardinal de Retz (qui écrit lui-même parfois Rais) et leurs Mémoires. Je viens de lire le dernier livre paru de Paul Jorion. Il aime les titres à rallonge. Après Penser l’économie avec Keynes (billet des 28-29 sept. 2015) et Le Dernier qui s’en va éteint la lumière (billet des 28-29 mars 2016), voici Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie. Il y rassemble un assez gros ensemble de chroniques (environ quatre-vingts) parues ici et là – principalement dans Le Monde, de 2008 (les subprimes) à aujourd’hui. Ce qui ressort principalement, une fois le livre refermé, c’est la prodigieuse cohérence du regard que l’auteur porte sur les choses de l’économie (j’excepte les quelques dernières chroniques, de portée plus « morale » ou « philosophique »).
Une chose est sûre : l’économie n’est pas une science. Un ensemble de techniques et de recettes ne suffit pas à faire une science. L'économie est définitivement infoutue de constituer une science, puisqu'il lui manque l'essentiel : la capacité de prédire la survenue d'un phénomène. Les principaux acteurs actuels de l'économie (financiarisée) se foutent pas mal de la réalité, puisqu'ils sont seulement des joueurs, et qu'ils ne font que parier. Pour preuve, les échanges financiers sur les matières premières atteignent à l'occasion quarante fois le volume effectivement produit.
J’étais convaincu de tout cela avant même de connaître les travaux de Paul Jorion, pour la simple raison que les économistes, en même temps qu’ils font de l’économie, font en même temps, qu’ils le veuillent ou non, de la politique, puisque les modèles de systèmes économiques auxquels ils se réfèrent sont aussi, par force, des propositions d’organisation sociale et politique. Il ne saurait y avoir d’économie sans politique (de même, il n'y a pas d'historiens neutres, idem dans d’autres « sciences humaines »), puisqu'elle touche aux intérêts des personnes, donc a quelque chose à voir avec le pouvoir et sa distribution dans la société.
Cette évidence, qui fait l’objet d’une dénégation catégorique de la part des économistes « orthodoxes », amène Jorion à ne jamais écrire "science" économique sans guillemets. On n’est pas étonné non plus de voir l’auteur descendre en flamme, dans sa chronique du 27 septembre 2016, pp. 198-201, le livre de Cahuc et Zylberberg, Le Négationnisme économique (voir mon billet sur ce bouquin infâme au 4 octobre 2016), vulgaires bandits qui osent affirmer que l’économie est une science exacte, à égalité avec les vraies sciences « dures », authentiquement expérimentales, et qui se sert pour cela effrontément du livre de Naomi Oreskes et Erick Conway, Les Marchands de doute (voir billet des 26-27 février 2015). Le culot de Cahuc et Zylberberg consiste à faire faire une pirouette complète à l'argumentation d'Oreskes et Conway pour la retourner comme un gant - magie magie - en leur faveur. C'est à peu de choses près la définition psychiatrique de la perversion.
Jorion dénonce à bon droit l’arrogance des théories dominantes à présenter comme des mesures purement techniques des convictions foncièrement idéologiques, qui reposent en fin de compte sur le postulat que c’est l’homme qui est fait pour (et par) l’économie, et non l’économie qui doit avoir en vue le seul bonheur de l’humanité. Les théories économiques ne peuvent être politiquement neutres, étant par nature porteuses d'idéologie implicite. Le tour de passe-passe consiste à affubler l'idéologie du masque de la technique pure.
C’est sûr que quand Paul Jorion attaque les subtilités techniques de certains instruments économiques, je suis largué. Par exemple, si j’ai bien compris qu’il y a quelque chose de « diabolique », disons de profondément dangereux dans les « Credit Default Swaps » (CDS), mes connaissances en économie sont trop sommaires pour me permettre de remonter tout le fil de l’analyse qui mène à cette conclusion. De même pour ce qui différencie le CDO du CDO synthétique (instrument de dette) et diverses autres notions. Quoi qu'il en soit, je garde intactes les conclusions.
Après une introduction visant à légitimer la publication des chroniques en volume, Jorion répond aux questions de la revue Sciences critiques en 2016. A ce sujet, j’ai dit mon désaccord avec l’auteur (7 avril dernier) en ce qui concerne la façon dont il innocente la technique de ses conséquences désastreuses, refusant de voir en elle autre chose qu’une preuve du génie propre à l’humanité, au motif qu’il ne faut pas confondre l’instrument et l’usage qui en est fait par l’homme. Je réponds que si c'était le cas, cela voudrait dire que l'homme aurait inventé ses outils techniques sans jamais anticiper leurs destinations possibles. A-t-on idée ? C'est fort peu vraisemblable : fabriquerait-on en effet des outils, si l'on n'avait pas déjà une petite idée de ce à quoi ils pourraient servir ? Comme le dit Günther Anders, ce qui peut être fait sera fait. La conception et la fabrication de l'outil est inséparable de son usage, et même de tous ses usages possibles.
Ensuite, Jorion a regroupé ses textes en quatre chapitres, où ils se suivent dans l’ordre chronologique de parution : 1 - Que s’est-il passé ? 2 - Pourquoi cela s’est-il passé ? 3 - Les grands points de faiblesse. 4 - Que faire ? Un « épilogue » clôt l’ouvrage. On ne saurait être plus clair et pédagogique.
L’impression qu’a produite sur moi la lecture de ce livre, c’est que le monde actuel subit l'impitoyable dictature de l’économie. On assiste à la grande compétition de tous contre tous dans laquelle, face à une folle financiarisation qui s’est emballée comme un cheval furieux, le salaire et le salarié sont la seule et unique « variable d’ajustement » qui, si l’on considère le travail comme un « coût » et non comme un investissement ou comme une avance sur la valeur produite, tend à aligner sur les miséreux du Bangladesh (« Sommes-nous assez compétitifs face au Bangladesh ? », chronique du 17 mai 2016, p.253) la rémunération de tous ceux qui, y compris dans les pays « riches », ne possèdent que leur force de travail.
Globalement, le monde est moins pauvre, mais nous n’avons pas fini de voir exploser chez nous le nombre des pauvres. Les optimistes refusent de voir l'essentiel et de désigner les vrais responsables (huit individus possédant autant que la moitié pauvre de l'humanité), et font diversion en appelant ça "rééquilibrage", ajoutant à l'occasion "la roue tourne" ou "ce n'est que justice".
Ils refusent de voir à qui le crime profite, et profitera de plus en plus.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, politique, science économique, paul jorion, penser l'économie avec keynes, jorion le dernier qui s'en va éteint la lumière, se débarrasser du capitalisme est une question de surviebarrasse, john maynard keynes, journal le monde, crise des suprimes, cahuc et zylberberg, le négationnisme économique, naomi oreskes, erick conway, oreskes les marchands de doute, credit default swaps, cds
jeudi, 03 septembre 2015
PIKETTY ET LE CAPITALISME 1
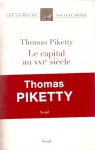 MES LECTURES DE PLAGE 3
MES LECTURES DE PLAGE 3
THOMAS PIKETTY : LE CAPITAL AU XXI° SIÈCLE
1/2
J’ai fini par en venir à bout, de ce pavé de 950 pages de texte. Le Capital au 21ème siècle, ça s’appelle. L’auteur se nomme Thomas Piketty. C’est un économiste. Il a une certaine célébrité. Son bouquin est un énorme succès de librairie, en particulier aux Etats-Unis, où il a fait un tabac et un débat. Il s’est permis de refuser la légion d’honneur (il a raison, quand tous les zéros virgule cinq peuvent l'obtenir). Il paraît qu’il est brillant.
Pour être franc, l’économie n’est pas ma tasse de thé. Comme disait Bernard Maris (assassiné le 7 janvier, en même temps que Cabu et les autres de Charlie Hebdo) dans Houellebecq économiste, c’est une discipline jargonnante et prétentieuse, dont les adeptes énoncent leurs sentences obscures sur un ton péremptoire. S’il y a une « science économique », ce qui n’est pas sûr, elle fait partie, comme toutes les « sciences humaines », des sciences molles, par opposition aux sciences dures. Un pataphysicien, même novice, l’opposera fort pertinemment aux « sciences exactes », en la rangeant parmi les « sciences inexactes ». Le Collège de 'Pataphysique a si bien défini la chose qu'il existe en son sein une « sous-commission des sciences inexactes ». L'économie pourrait à bon droit se prétendre l'archétype de toutes les sciences inexactes.
C’est d’autant plus juste que lorsqu’on met quatre économistes en présence pour parler d’un sujet quel qu’il soit touchant leur discipline, ils ne tardent pas à en venir aux mains. Pour une raison très simple : l’essence de l’économie est éminemment politique. Elaborer une théorie économique revient à proposer une vision du monde, une philosophie de la société, une conception de l’humanité, un modèle d'organisation des collectivités humaines. Autrement dit : à faire de la politique. Il ne saurait y avoir d'économie sans politique, sinon l'économie serait une pure et simple machine, ce qui n'est évidemment pas le cas.
A cet égard, il n'existe donc pas de théorie économique sans prise de position politique : grosso modo, il y a ceux qui veulent exclusivement que la "machine" économique fonctionne au mieux, et en face, il y a ceux qui voudraient que l'économie apporte un peu de bonheur aux hommes et produise un peu d'harmonie sociale. Disons : les mécaniciens et techniciens contre les humanistes et philosophes. Entre les deux, des tas de "moyens termes". Deux races d'économistes définitivement irréconciliables. Pour les premiers, l'économie est une fin en soi - disons le mot : une idole ; pour les seconds, l'économie est un moyen (parmi beaucoup d'autres) que se donne l'humanité pour améliorer son sort.
Ce à quoi s’efforce Thomas Piketty (qui fait plutôt partie des seconds) dans son très gros livre, c’est de retracer l’histoire des inégalités depuis le début de la révolution industrielle (mettons à partir de 1800 - 1700 sur certains points -) jusqu’à nos jours (le livre est paru en 2013). On ne résume pas un tel ouvrage, vous pensez bien. Je peux tout au plus retenir quelques idées saillantes.
Piketty pilote son navire en braquant son gouvernail sur la question des inégalités. Sa thèse principale est que, après avoir été radicalement corrigées après la deuxième guerre mondiale, les inégalités sont reparties à la hausse depuis quarante ans. Une hausse vertigineuse. Constat confirmé ces derniers jours par Joseph Stiglitz (prix soi-disant Nobel d'économie, parution de La Grande fracture le 2 septembre).
Mais d’abord ce qu’il faut savoir de la sacro-sainte « croissance économique ». Gavés des chiffres de la "croissance" depuis la révolution industrielle, nous avons fait semblant d'oublier que, depuis l’antiquité jusqu’à 1700, elle a été à peu près nulle (environ 0,1 % par an). Et que le monde ne s’en est pas plus mal porté, puisque la population n’a cessé de croître. J’ai du mal à comprendre pourquoi la croissance économique est liée à la croissance démographique. L’auteur y insiste lourdement au début. Après tout, plus il y a de bras, plus la production peut augmenter. C’est peut-être ça.
Piketty dit surtout qu’une croissance de 1 % par an est loin d’être négligeable, quand on la mesure sur le temps long. J’ai la flemme de chercher la page, mais le pourcentage au bout de trente ans paraît proprement incroyable. Il dit enfin qu’une croissance lente (1 %) est en gros la règle, et que des 10 % comme a montré la Chine dans les dernières années doivent être considérés comme un « rattrapage », un rééquilibrage par rapport aux pays plus anciennement favorisés. Curieux comme les gens s'affolent parce que le chiffre est tombé à 7%.
La première notion que l’auteur établit est le « rapport capital / revenu », c’est-à-dire le rapport entre le stock de la richesse possédée et le flux des richesses produites. Ce rapport est mesuré en « années de revenu national » (en général 5 ans dans les pays industrialisés). J’envisage sans problème la différence entre stock et flux. La notion de rapport me laisse plus perplexe : si j’ai bien compris, le « rapport capital / revenu » indique le degré de dynamisme économique qui anime une société. Ou alors sa productivité ? Remarque, c’est un peu la même chose, non ? Je n’insiste pas (et je laisse de côté l’équation « α = r x β »).
La deuxième notion que je retiens, c’est la façon dont l’auteur découpe la population en « quantiles », façon que je trouve particulièrement éclairante, dès lors qu’il s’agit d’examiner comment les différentes couches de population évoluent les unes par rapport aux autres au cours du temps, en matière de richesse.
Piketty distingue ainsi les 50% les moins favorisés, les 40% des « classes moyennes », et le « décile supérieur ». Il n’hésite d’ailleurs pas à découper ce dernier : il montre que l'enrichissement de ces 10 %-là, depuis les années 1970, profite aux 9%, mais encore davantage au 1% supérieur de ce décile, et de façon encore plus mirifique au 0,1% qui tient le haut du pavé dans ce décile des privilégiés de la fortune. Stiglitz confirme : 85 milliardaires détiennent aujourd'hui 50% (je crois que c'est le chiffre qu'il a prononcé) de la richesse mondiale.
Piketty montre en particulier que plus on est riche, plus on s’enrichit. Et c’est mécanique. Il donne l’exemple des trois plus grandes universités américaines (Harvard, Yale, Stanford, je crois), qui trouvent des ressources grâce aux dons d’anciens élèves, mais qui arrivent à un maximum de profit en plaçant les fonds qu’elles détiennent.
Or en cette matière, plus gros est votre gâteau, plus vous avez les moyens de vous offrir les services des spécialistes les plus pointus des marchés financiers : consacrer 1 million de dollars pour payer cette équipe de conseil qui va vous faire gagner 100 millions grâce à ses compétences, c’est virgule de guillemet (ah, Achille Talon !) et queue de cerise (ah, Gil Jourdan !), comparé au gâteau. Les universités plus modestes ont moins les moyens de faire de l’argent avec leur argent. Inversement, plus on en a, plus on peut en faire.
L’effet est donc mécanique : les plus riches parmi les riches creusent l’écart avec les suiveurs, y compris les déjà bien riches. Leurs patrimoines atteignent la stratosphère à vitesse accélérée (exemples de Bill Gates et Mme Bettencourt), gonflés qu’ils sont par les revenus qui leur tombent dessus, venus de leur capital ou de leur éventuel travail, et qu’ils ne sont pas en mesure de dépenser en totalité, même avec de la bonne volonté. Ne sachant plus comment claquer leur fric, ils sont obligés d’augmenter chaque année le montant de leur épargne, au risque d’augmenter leur fortune, vous vous rendez compte ? Une vraie guigne.
Au passage, ça explique peut-être les montants extravagants atteints par certaines œuvres d’art chez Sotheby’s ou Christies.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, thomas piketty, le capital au xxi siècle, bernard maris, houellebecq économiste, science économique, collège de 'pataphysique, politique, société, cabu, charlie hebdo
lundi, 30 mars 2015
IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"
2/2
Je parlais de l'infirmité des pompeusement nommées « Sciences Humaines », qui ne portent le nom de sciences que par abus de langage. L'expression porte probablement le stigmate de son origine : le scientisme, cette croyance absolue dans le pouvoir de la science de résoudre tous les problèmes de l'humanité, imprégna jusqu'au coeur la moindre fibre de la seconde moitié du 19ème siècle.
Flaubert l'a personnifié sous les traits du pharmacien Homais, dont il a fait le masque de la bêtise satisfaite, la bêtise de « celui qui sait ». Parlant de je ne sais plus qui, Clémenceau disait joliment : « Il sait tout, mais rien d'autre ». Flaubert a tout compris : Bouvard et Pécuchet, me semble-t-il, ayant fait le tour du savoir encyclopédique, reviennent humblement pour finir à la tâche que s'assignaient les moines copistes du moyen âge.
Les « sciences molles » (le Collège de 'Pataphysique les appelle plus justement les « Sciences Inexactes », par opposition aux « Sciences Exactes », dites dures qui, elles, s'efforcent à l'exactitude) se sont empressées de se ranger sous cette bannière, qui leur conférait une dignité dont elles n'auraient jamais osé rêver sur leurs seuls mérites.
Sans pouvoir toutefois effacer le stigmate que constitue l'adjectif qualificatif "humaines" : quand on est obligé d'ajouter l'adjectif, c'est que son absence porterait à confusion. Quand on entre dans une « Faculté des Sciences », aucun doute sur les disciplines qu'on y enseigne, d'où l'absence d'adjectif.
Mais tout le monde a laissé faire, par pitié envers les « Sciences Humaines », ces cousines disgraciées, qu'on invite de temps en temps, le dimanche, parce qu'il faut bien se montrer un peu magnanime avec le pauvre monde. Ainsi l'habitude a été prise, et j'imagine que le 20ème siècle n'a jamais voulu, osé ou pu rétablir la vérité. Monsieur Homais est entré au Collège de France et à l'Académie Française. Il fait autorité. Alors même qu'il faudrait peut-être renommer les « Sciences Humaines » les Sciences Fausses.
Car le vice rédhibitoire dont souffrent les « Sciences Humaines », c’est précisément l’Homme, avec ses désirs, ses calculs, son hypocrisie et sa sincérité, ses manœuvres, ses intérêts particuliers, ses audaces et ses peurs, ses haines et ses amours, ses constructions comme ses destructions, bref, sa LIBERTÉ. C'est-à-dire ce dont sont démunies les forces aveugles et déterminées de la nature.
Non, l’économie n’est définitivement pas une science. Je n’énonce pas une énormité obscène : écoutez pour vous en convaincre l’émission de Dominique Rousset, le samedi sur France Culture. Quel que soit le thème choisi (dans l’actualité), vous les entendez, au bout d’un temps plus ou moins long, se chamailler. Deux économistes ne seront jamais entièrement d'accord.
Je rêve de les voir un jour en venir aux mains et, pourquoi pas, s'entretuer, pour qu'on s'amuse un peu. Vous imaginez, un combat à la loyale, à l'épée, « sur le pré », entre John Maynard Keynes et Milton Friedman ? Mais ils ne sont pas assez fous pour cela : ils se disent qu'un tel spectacle tuerait la poule aux œufs d'or, le « métier ». Il faut rester "digne", et pour cela, courtois et bien élevé. Propre.
Leurs désaccords n'en sont pas moins irréductibles. Ceci pour une raison très simple : l'étiquette "économiste" dissimule en règle très générale une tout autre personne que celle qui se donne pour spécialiste de ceci, expert en cela, capable d'assener (si, si, sans accent, c'est légal !) à toute la population du public terrorisé les certitudes absolues qu'il a acquises dans le domaine dont il se déclare le maître.
Cette personne est celle du militant politique. Les théories sur lesquelles ces gens s'appuient sont l'exact reflet du système politique dans lequel ils rêvent de les appliquer. En gros, sur le ring où ils s'affrontent, ça donne John Maynard Keynes contre Milton Friedman. Traduction : l'intérêt général contre les intérêts privés. Marx contre le Capital, si vous préférez.
Un économiste neutre est aussi crédible que ma sœur en monstre du Loch Ness. Il n'y a pas d'économie a-politique, mais des modèles d'organisation sociale qui s'affrontent : où faut-il placer le point d'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt supérieur du corps social dans son entier ? A qui et à quoi donner la priorité ? L'entrepreneur ou la collectivité ? L'efficacité économique ou la justice sociale ? Quand commence l'accaparement de la richesse ? Comment une société décide-t-elle de la façon dont elle veut vivre ?
Soit dit en passant, la logique à l'oeuvre dans le système actuel, et qui tend à imposer sa volonté aux Etats, elle est limpide : mettez en face le chiffre toujours plus impressionnant des pauvres qui ont besoin des Restos du cœur ou des Banques alimentaires pour survivre et le chiffre toujours plus astronomique des fortunes amassées par le centile des plus riches de la planète. Cela vous donne une idée de la montée irrésistible de l'Injustice. Or on sait que l'injustice produit immanquablement, à plus ou moins long terme, la violence.
Pas d'économiste objectif, donc : une théorie économique ne peut faire autrement que d'être au service de l'idée qu'on se fait de la société. Vous pouvez aisément vérifier. S’ils sont, en gros, d’accord sur le constat (il suffit de lire les journaux, les statistiques du chômage, les fermetures d’usines, …), dès qu’on aborde l’analyse des causes ou les propositions de solutions, rien ne va plus. Il m’est arrivé d’entendre des disputes homériques entre les quatre « scientifiques » invités par Dominique Rousset. J’ai fini par les abandonner à leur triste sort. Pas d'économie sans choix de société. D'où leurs disputes interminables.
Imagine-t-on se disputer ainsi deux physiciens évoquant l’existence du « boson de Higgs », dont le LHC du CERN a apporté la preuve (deux vrais spécialistes du climat évoquant le « réchauffement climatique » feront très bien l’affaire) ? Et tout le monde est d'accord pour traiter d'hurluberlu indépassable ce « scientifique » arabe (ou musulman, je ne sais plus, peut-être les deux) qui vient de décréter que la Terre est plate. Résumons : il y a des acquis irréfutables de la Science. Il n'y a pas de preuve définitive en économie.
Si l'économie était une science, un consensus finirait par s’établir entre « experts », exactement de la même manière que s’est établi le consensus des milliers de scientifiques du GIEC sur le climat, après la recension faite de l'intégralité de la littérature scientifique consacrée au sujet. Je compte pour rien les vociférations du gouverneur de Floride, Rick Scott, qui interdit aux fonctionnaires de son administration de prononcer l’expression « réchauffement climatique » (Le Monde, 24 mars), et autres élucubrations des « climatosceptiques ».
A ce propos, on peut cliquer sur le lien avec l'article : je conseille vivement la vidéo - 2'07" - désopilante : il faut voir quelques sénateurs américains se payer une bonne tranche de rigolade aux dépens du gars interrogé, tout propre sur lui et souriant, tournant autour de la formule taboue, mais complètement emberlificoté dans le ridicule à cause de la consigne reçue de ne pas la prononcer.
Malheureusement, si l'économie n'est pas une science, trop de gens riches et puissants ont intérêt à ce que tout le monde le croie quand même, malgré tous les démentis que leur inflige la réalité. Avec l'appui de quelles complicités les « Usurpateurs » (titre du dernier livre de Susan George sur le même sujet, voir ici même, 17 mars) ont-ils réussi à imposer dans les esprits l'expression "Prix Nobel d'économie", au mépris pur et simple des volontés testamentaires d'Alfred Nobel ? Le testament instaure cinq prix (Physique, Chimie, Médecine, Paix, Littérature), pas un de plus. C'est ce que Bernard Maris dénonce en p. 15 de Houellebecq économiste, livre polémique, c'est certain, mais tout à fait salutaire et nécessaire.
Voire indispensable. Et peut-être même utile. « Économiste sérieux » est un oxymore. La seule spécialité de l'économiste : l'enfumage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, science économique, sciences humaines, flaubert, madame bovary, pharmacien homais, collège de pataphysique, collège de france, académie française, dominique rousset, france culture, john maynard keynes, milton friedman, karl marx le capital, restos du coeur, banques alimentaires, boson de higgs, cern lhc, réchauffement climatique, giec, gouverneur de floride rick scott, journal le monde, les usurpateurs susan george, prix nobel d'économie, michel houellebecq, houellebecq économiste, bernard maris, littérature
dimanche, 29 mars 2015
IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"
1/2
Parlant des économistes, qui a écrit ce qui suit ?
« La "secte" disait-on du temps de Louis XV, pour ricaner des économistes et de leurs raisonnements compliqués. Le mot est extraordinairement juste : il s’agit, dès le départ, d’une secte qui rabâche un discours hermétique et fumeux. On les respecte parce que l’on n’y comprend rien. La secte révère les mots abscons, l’abstraction et les chiffres. On opine à ses contradictions. »
Eh bien je vous le donne en mille : c'est un économiste. L’auteur s’appelle en effet Bernard Maris. Ce sont les premières lignes de son Houellebecq économiste (Flammarion, 2014, voir ici-même les 11 et 12 mars). C'est son dernier ouvrage paru avant l'assassinat.
On comprend que Maris, qui vient d’être tué par un fanatique, en compagnie de Cabu, Wolinski et les autres de Charlie Hebdo, n’était pas fait pour s’entendre avec Jean-Marc Sylvestre, Eric Le Boucher et autres adulateurs fanatiques du libéralisme économique à outrance, qui vont sûrement lui reprocher de cracher dans la soupe ou de scier la branche sur laquelle la profession est assise, d'où elle jette les pavés contondants de ses oracles.
Soit dit en passant, on sait que Cabu détestait les romans de Michel Houellebecq. Ce que confirme Dominique Noguez dans son Houellebecq, en fait (Fayard, 2003). Pour dire que l’équipe massacrée du journal était loin d’être monolithique.
Qu’est-ce qu’il leur met, Bernard Maris, aux économistes ! Tiens, pour preuve, voici la suite : « Comme jamais, notre époque est gorgée d’économie. Et si elle fuit le silence, shootée à la musique des supermarchés et au bruit des voitures tournant sur elles-mêmes, elle ne se passe plus non plus des rengaines de la "croissance", du "chômage", de la "compétitivité", de la "mondialisation". Au chant grégorien de la Bourse, ça monte, ça baisse, répond le chœur des experts, emploi, crise, croissance, emploi. "Dismal science", disait outre-Manche Carlyle. Lugubre science. Diabolique et sinistre, l’économie est la cendre dont notre temps se couvre le visage » (pp. 13-14).
Et si on trouve à la fin de son bouquin la phrase : « Il n’y a pas de science économique » (p. 146), il faut croire que c’est une conviction enracinée, puisque, toujours p. 14, il écrit, dans l’avoinée-maison dont il assaisonne le dos de ses confrères : « L’économiste est celui qui est capable d’expliquer "ex post" [drôle d’expression, je trouve, alors qu'on a le bien rodé "a posteriori" !] pourquoi il s’est, une fois de plus, trompé.
Discipline qui, de science, n’eut que le nom, et de rationalité que ses contradictions, l’économie se révélera l’incroyable charlatanerie idéologique qui fut aussi la morale d’un temps ».
Non, il n’y a pas de science économique. Tout au plus existe-t-il des recettes, des techniques, un catalogue de mécanismes, à la rigueur une méthodologie. Contrairement à l’astrophysique, mais comme toutes les « Sciences Humaines » (ethnologie, sociologie, psychologie, …), l’économie souffre d’un vice rédhibitoire : son incapacité congénitale à prédire.
Très fortes pour dresser un inventaire du monde connu, c’est-à-dire d’événements, de situations passés, pour faire un tour méticuleux du donné et d’en agencer les morceaux en édifices conceptuels, elles sont gravement sourdes, aveugles et muettes sur le monde à venir. Très douées pour observer, elles sont infirmes à pronostiquer.
Ce qui n'empêche nullement les économistes de vaticiner, d'augurer et de nous dire à satiété la bonne aventure, à coups répétés de « Il faut » incantatoires. L’objet des recherches, dans toutes les disciplines « humaines », appartient forcément à l’existant, c’est-à-dire au PASSÉ.
L’humanité ne saurait en aucun cas tirer des « Sciences Humaines » des règles de vie en société ou des modèles pour des systèmes politiques valables pour l’avenir, car quand on a fait le tour de la dite humanité (tour à jamais incomplet au demeurant), on se rend compte que, dans les dizaines de milliers d’ouvrages produits par les chercheurs en « Sciences Humaines » au cours du temps, on trouve absolument TOUT, en même temps que LE CONTRAIRE DE TOUT.
C'est ce qu'écrivait Paul Valéry à propos de l'histoire : « L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien car elle contient tout et donne des exemples de tout. C'est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré » (Regards sur le monde actuel).
Je suis d’accord.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bernard maris, science économique, économistes, michel houellebecq, llittérature, houellebecq économiste, éditions flammarion, charlie hebdo, cabu, wolinski, frères kouachi, jean-marc sylvestre, éric le boucher, ultralibéralisme, dominique noguez, houellebecq en fait, éditions fayard, sciences humaines, paul valéry, regards sur le monde actuel

