jeudi, 04 juillet 2019
OÙ C'EST, LA « FRANCE » ?


Je veux juste, dans ce petit billet, présenter brièvement deux ouvrages parus en 2017 et 2018, dont le face-à-face m’a paru tout à fait instructif dans la France d’aujourd’hui.
J’avais du mal à dire quoi que ce soit, séparément, de ces deux livres que j’avais lus à peu de distance, Jean-Pierre Le Goff signant un récit autobiographique pour dresser un portrait sociologique de La France du 20ème siècle de 1950 jusqu’à 1968 (Stock, 2018), alors que dans Civilisation (Gallimard, 2017), Régis Debray montre, de façon tout à fait convaincante (il s'appuie sur un maximum de faits concrets), comment les Américains, en gagnant la guerre contre Hitler en 1945, ont certes sauvé l’Europe de l’ouest, mais pour en faire une colonie en même temps qu'un marché lucratif et un glacis protecteur contre l'URSS.
Debray aurait pu ajouter en marge que la stratégie « bloc-contre-bloc » a produit le même résultat en Europe de l’est sous la coupe de la dite URSS : car, si le « Pacte de Varsovie » n’a disparu que parce que la « maison-mère » s’est effondrée, le principe était le même. On observe d’ailleurs que plusieurs ex-pays de l’est ont encore du mal à monter franchement dans le train lancé par l’Union européenne, et qu’ils gardent un pied en dehors sur nombre de sujets.
J'avais donc du mal à considérer chaque livre en lui-même, et puis un jour, je me suis dit qu'en fait, ils parlaient de la même chose. Effectivement, La France d’hier et Civilisation se complètent à peu près parfaitement, même si leurs perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Ils nous montrent les deux faces de la même médaille : pendant que Jean-Pierre Le Goff, nous raconte par le menu ce qui fut sa vie quotidienne en France, « Récit d’un monde adolescent. Des années 1950 à Mai 68 » (sous-titre de son livre), Régis Debray décrit avec précision le processus qui a fait de la France une sorte de protectorat américain (sous-titre : « Comment nous sommes devenus américains »).
Sur l’avers, une France d’autrefois qui vous a de ces airs obsolètes, vieillots, ringards et arriérés que ça fait pitié ; sur le revers, la France qui l’a remplacée, une France pimpante, dynamique et "moderne" qui, disons-le avec l’auteur, n’est plus la France : une France américanisée en largeur et en profondeur. Et cette France-là sera toujours EN RETARD aux yeux des adorateurs de l'horizon américain.
Dans la France qui ne se raconte pas d’histoires, même pour rire, aucun « village peuplé d’irréductibles Gaulois » ne « résiste encore et toujours à l’envahisseur ». Sur le territoire français réel, toutes les localités ressemblent au village de Sérum, dont le chef Aplusbégalix, une grosse brute qui fait penser aux "collabos" d'une certaine époque, est fier d’adopter les coutumes du colonisateur (dans Le Combat des chefs). Demandez-vous pourquoi Macron, se plaint d'un peuple de "Gaulois réfractaires" : plus vite il aura fini de nous américaniser, plus il sera content. Macron rêve de 67.000.000 d'Aplusbégalix.

Un Gaulois qui n'est ni "irréductible", ni "réfractaire". Le geste du bras droit est peut-être romain, mais pas que.
Le portrait par Goscinny des Gaulois « irréductibles, courageux, teigneux, têtus, ripailleurs, batailleurs et rigolards » est d’une veulerie complaisante et commerciale. Même si beaucoup de Français adorent, quand ils sont accoudés au bar, déclarer comme Obélix : « Ils sont fous ces Romains » (c’est l’ « anti-américanisme » dont certains Français accusent d’autres Français pour les faire taire), la réalité prouve à chaque instant que la France évoquée par Jean-Pierre Le Goff a été balayée par l’irrésistible vent venu d’outre-Atlantique, dont parle Régis Debray.
Je suis d’autant plus sensible au travail de Jean-Pierre Le Goff que la vie quotidienne qu’il raconte est exactement la même que la mienne, à quelques détails près : né en 1947, famille pauvre, son père était pêcheur dans le Cotentin, excellent élève, etc. Pas le même CV, mais des points de repère globalement si semblables qu’à certains moments de ma lecture, j’avais l’impression qu’il me racontait ma vie. Drôle d’impression en vérité.
Et je suis d’autant plus sensible à la lecture historique opérée par Régis Debray que ça fait très longtemps que j’en ai ras le bol de me faire traiter d’ « anti-américain » dès que je commence à émettre quelques critiques sur l'écrasant « abus de position dominante » exercé par les Etats-Unis pour éjecter les anciennes spécificités de la France (produits, culture, vision du monde, …) et les remplacer par du « made in USA ».
Renaud Camus, un "pestiféré" chez les bonnes âmes, a peut-être raison de parler de « Grand Remplacement » en parlant des Maghrébins et Africains. Mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'autre « Grand Remplacement » ? Celui qui l'a beaucoup plus lourdement précédé, avec l'adhésion enthousiaste des Français ? Pourquoi ne montre-t-il pas que ce qui faisait l'identité spécifique de la France a laissé la place à quelque chose de nouveau, une « France américaine » qui n'a plus grand-chose à voir ?
Architecture et urbanisme, façons de se nourrir (Mc Donald), musiques (jazz, rock, country, rap, ...), innovations technologiques, visibilité des « minorités », industrialisation de l'agriculture, cinéma (western, polar, dessin animé, ...), etc. : qu'est-ce qui, dans le pays actuel, n'est pas importé plus ou moins directement des Etats-Unis ? On entend très régulièrement des journalistes fascinés évoquer une "innovation" née sur le territoire américain, et annoncer sans honte son débarquement prochain en France.
Il s’agit en fait d’un composé impur dans lequel on trouve, certes, quelques îlots de résistance (lutte contre le franglais, patriotisme économique ou idéologique, drapeau, souverainisme, … : un vrai « village gaulois », ma parole !), mais nageant au milieu d’un océan d’emprunts, voire de plagiats, surfant sur la vague d’un grégarisme servile, et dont Régis Debray dresse la liste interminable sur un ton fataliste de vieux sage résigné (« Il faut subir ce qu’on ne peut empêcher », lit-on dans une nouvelle de Jorge Luis Borgès). L’étiquette France est toujours collée sur la bouteille, mais la piquette vient de Californie (oui, je sais, mais qui les a aidés à faire des vins buvables ?).
La tonalité des deux ouvrages est à peu près la même : Le Goff et Debray font, chacun de son côté, un constat, coloré d’une fleur nostalgique chez le premier, d'un paquet de regrets impuissants chez le second. Le Goff nous peint, dans une foule de détails concrets, une foule de façons de vivre qui apparaissent de nos jours essentiellement ringardes (= archaïques, arriérées, démodées, dépassées, obsolètes, périmées, rétrogrades, vieillottes, …) : une France dans laquelle le passé et la tradition jouaient encore leur rôle de forces agissantes.
Debray, de son côté, nous met sous le nez tout ce qui, dans notre vie quotidienne, nous semble absolument naturel et français d’origine, alors même que cela porte la marque du vainqueur de 1945, et nous rappelle les faits et les dates qui, avant même la deuxième guerre mondiale, auraient pu apparaître comme des signes annonciateurs de la future mutation. Par exemple, il signale que la reconnaissance de la suzeraineté américaine sur l'industrie de la photo et du cinéma date de 1925 et 1926 (p.86).
Deux livres qui, en proposant deux aperçus totalement différents, nous disent à peu près la même chose : il n'y a plus grand-chose de spécifiquement "français" dans la France d’aujourd’hui. Et ça vous étonne, vous, qu'il faille être facho pour être patriote et se réclamer du drapeau tricolore ? Et ça vous étonne, vous, qu'il faille aimer le football pour avoir envie de chanter la Marseillaise ? (ajouté le 6 juillet)
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre le goff, la france d'hier, régis debray, debray civilisation, éditions stock, éditions gallimard, amérique, usa, urss, états-unis d'amérique, europe, deuxième guerre mondiale, pacte de varsovie, europe de l'est, guerre froide, union européenne, anti-américanisme, astérix le gaulois, goscinny et uderzo, astérix le combat des chefs, irréductibles gaulois, emmanuel macron, france, société, sociologie
mercredi, 08 mai 2019
L'EUROPE ET NOS POLITICIENS
Notes sur l'état européen de la nation française.
Les journalistes français, les politiciens français, les politologues et autres politistes français, tous gens de jugement très sûr, nous ont rebattu les oreilles avec un grand mythe fondateur de l’idée d’Europe : « le couple franco-allemand ». Ah ça, on peut dire que tous ces braves gens, forcément bien intentionnés, n'en doutons pas, nous l'ont fait bouffer, le foin du mythe franco-allemand. Mais aujourd’hui, c’est fini. La grande réconciliation, c’était De Gaulle-Adenauer, ensuite nous avons eu la belle entente Giscard-Schmidt, puis le spectacle de la belle entente Mitterrand-Kohl (ah, Mitterrand capturant par surprise la main de Kohl ! était-ce à Douaumont ?).
Depuis, plus rien, ou plutôt plus personne. Visiblement, il y a quelque chose de pourri dans l’étroite union des piliers qui, à eux deux, formaient le socle granitique sur lequel allait s’élever l’astre resplendissant de l’idée européenne : l’Allemagne et la France. Les deux pays ne sont plus sur la même longueur d’onde, le « moteur de la construction européenne », après avoir toussé et hoqueté, s’est arrêté, l’Europe est en panne.
Je ne vais pas me lancer dans une analyse fouillée des raisons politiques, économiques ou idéologiques qui expliquent cette mise au point mort : je laisse aux « spécialistes », « experts » et tous les Diafoirus de profession le soin de développer ce genre de considérations savantes. Je veux juste, en citoyen ordinaire, exposer quelques observations qui me sont venues au fil du temps, en particulier sur la façon dont l’ensemble de la classe politique française considère l’implication de la France dans le processus de construction européenne. Je précise tout de suite que je ne me suis pas trop embarrassé de nuances. Que le lecteur ne soit pas trop scandalisé s'il me trouve quelque peu injuste.
Ma première remarque est pour observer que la construction européenne, et depuis fort longtemps, n'intéresse pas nos politiciens. On peut dire que, pris dans leur globalité, ils ne brillent pas par leurs motivations européennes. L'Europe, ils n'ont pas grand-chose à en faire. Peut-être, après tout, parce qu'ils ne se préoccupent guère du fait que la France ait ou non un destin. "D'accord pour envoyer à Bruxelles des sous-fifres ou des "seconds couteaux", mais ces raisins sont trop verts pour moi, tout juste bons pour agacer mes dents de grand fauve : je laisse la besogne à plus humble que moi." Qu'on se le dise, le politicien français considère la construction européenne de tout le haut de sa hauteur.
Si les politiciens français avaient pris au sérieux la construction européenne, il y aurait eu depuis fort longtemps un ministre d'Etat aux affaires européennes, et un ministre inamovible quelles que soient les alternances, et non pas de vagues secrétaires d'Etat obscurs et interchangeables. Il y aurait eu des luttes féroces et des rivalités épiques entre les ambitieux "cadors" de la politique française pour occuper cette place prestigieuse. Et les "ténors" de notre classe politique n'auraient pas eu la politesse exquise de laisser la place aux pauvres diables obligés de s'y coller en leur disant : "Après vous s'il en reste".
Accessoirement, les électeurs ne bouderaient peut-être pas autant les urnes s'il y avait eu dès le début des listes internationales de candidats pris dans tous les pays. Le fait que les listes de candidats soient nationales pour l'essentiel n'a pu qu'ajouter de la distance entre les populations et la nouvelle institution.
Il me semble que la raison de ce désintérêt des politiques est assez simple : ils ne trouvent aucun intérêt à s'engager dans un travail qu'ils considèrent avant tout comme fastidieux, et surtout où ils ne voient aucun moyen de faire carrière. Au contraire, en réduisant leur activité à l'hexagone, même sans parler de cursus fulgurant, juste en rendant le plus de services possible à des gens bien placés, après avoir bien usé leurs genoux dans les prosternations devant les puissants réels ou pressentis, ils gardaient l'espoir que ceux-ci auraient l'honnêteté de leur "renvoyer l'ascenseur" en leur procurant une sinécure confortable : Conseil d'Etat, Cour des Comptes, CSA, Conseil Economique et Social, jetons de présence dans des conseils d'administration, une direction à l'Institut du Monde Arabe (cas de Jack Lang : à qui cet ami de tout le monde n'a-t-il pas rendu de "petits services" ?), etc. : il n'y a pas que les parachutes qui soient dorés, il y a aussi beaucoup de pantoufles. Non, l'Europe n'intéresse nos politiciens en aucune manière, sinon à l'approche d'échéances électorales.
Cette façon de voir et de faire, dont je crois que le caractère principal est la médiocrité insigne, n’est pas pour rien, à mon avis, dans l’éviction progressive de la France des instances de décision dont procède l’orientation que doit prendre la construction collective. Car si la France pèse si peu aujourd’hui dans l’Union européenne, ce n'est pas seulement parce que celle-ci est passée de 6 à 28, c’est aussi parce que, à quelques notables exceptions près (Delors, Barnier, Moscovici, …), l’immense majorité de nos politiciens professionnels considèrent depuis très longtemps d’éventuelles responsabilités à Bruxelles ou Strasbourg au mieux comme des exils provisoires ou des punitions imméritées, au pire comme des oubliettes, en tout cas comme une tache sur leur CV de professionnels de la politique. Et ce n'est pas le choix de têtes de listes comme Loiseau ou Bellamy qui va pouvoir convaincre du contraire.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réputation globale des députés français au Parlement européen n’est pas bonne, beaucoup d'entre eux n'ayant pour seul souci que de revenir à Paris au bout d'un seul mandat. Au point que leurs collègues des autres pays (en particulier les Allemands) sont tout étonnés d’en revoir certains après l’élection suivante, et c’est seulement alors (et à la longue) que quelques-uns finissent par être pris au sérieux par les autres députés. La plupart, n’ayant aucune considération pour le travail d’édification des règles communes, sont tenus pour des jean-foutre (pour autant que je puisse m'en faire une idée).
Pour une majorité de politiciens français, en effet, être élu aux européennes signifie cinq ans de purgatoire, et cinq ans pour lesquels je serais curieux de consulter la feuille de présence aux assemblées et aux commissions. On se rappelle quelle avait été la rage de Rachida Dati quand Nicolas Sarkozy, pour je ne sais quelle raison profonde, l’avait bombardée tête de liste pour les Européennes de je ne sais plus quelle année (ça doit être facile à retrouver). Je signale en passant que la dame, en course pour la Mairie de Paris, touche toujours son indemnité européenne (j'imagine qu'elle est toujours une élue, bien qu'elle se garde d'en faire état). Je n'ai pas vérifié son taux d'absentéisme aux assemblées et réunions de Bruxelles ou Strasbourg (c'est que le 7ème arrondissement de Paris est si vaste !).
Combien sont-ils, ceux qui ne se représenteront pas le 26 mai après vingt ans de bons et loyaux services (quatre mandats, s'il vous plaît) dans les rangs de l’Assemblée européenne ? C’est le cas, paraît-il, de Pervenche Bérès et Alain Lamassoure, sûrement quelques autres : belle performance. J’ai bien l’impression que ces rares individus somme toute hors du commun font exception, dans un ensemble de personnes qui se jugent sûrement trop importantes sur le territoire national pour aller perdre leur temps et gâcher une belle carrière potentielle en allant s’enterrer à Bruxelles.
L’impression étrange que produit cette situation particulière, c’est d'abord l'incroyable confinement hexagonal de l'esprit qui habite l'ensemble de la classe politique française, mais c'est aussi la remarquable ambivalence qu'elle manifeste à l’égard de l’Europe. Car c’est une double unanimité chez les hauts responsables et autres personnels politiques : d’une main (souverainiste), quand le besoin (électoral) s’en fait sentir, ils dénoncent la bureaucratie tatillonne de Bruxelles, ses réglementations ridicules et ses décisions juridiques qui s’imposent au droit français (la Commission vient de mettre en demeure la France de privatiser tous ses barrages pour les mettre en concurrence) ; de l’autre main, ils ont tous, et à l’unanimité (le plus souvent sans le crier sur les toits), signé et fait ratifier les traités successifs qui engagent la France dans toujours plus de perte de souveraineté. Et la seule fois où ils ont demandé aux Français ce qu’ils en pensaient, ils se sont assis sur l’expression du vote populaire (2005). Je me trompe : il y a eu le "oui" à Maastricht (en 1992 ?).
L’Europe est mal foutue, c’est sûr. Elle n’est pas démocratique : on élit les députés, mais le Parlement a des pouvoirs limités : c’est la Commission (avec ses 34.000 fonctionnaires – c'est-à-dire non élus – grassement payés) qui a l’initiative des propositions. Elle se réduit à un simple espace de libre-échange économique dominé par une logique ultra-libérale implacable, où prospèrent impunément quantité de lobbies financièrement surpuissants au service de toutes sortes de firmes privées, mais aussi quelques paradis fiscaux qu'aucune discipline collective ne tracasse. De plus, la sacro-sainte règle de la « concurrence libre et non faussée », terrible aberration, outre qu’elle incite chaque pays à entrer en concurrence avec tous les autres, interdit au continent européen de devenir une véritable puissance capable de se doter elle-même de tous les attributs de la puissance.
Mais l’Europe que nous avons, cette Europe qui révolte le bon sens, ne serait peut-être pas ce n’importe quoi vaguement monstrueux, si les hommes politiques français avaient consenti à se donner un peu de mal pour édifier une autre Europe, plus conforme aux aspirations spécifiques et à l'histoire particulière des Français. Mais il aurait fallu pour cela qu'ils soient motivés et qu'ils se battent, il aurait fallu qu’ils travaillent, qu'ils se donnent de la peine, qu'ils déploient des efforts, enfin qu'ils acceptent de faire quelque chose pour leur pays. Qu'ils soient animés par le désir de le servir.
Là n’est peut-être pas la seule raison de la dilution, et même de la dissolution de la France dans le gloubi-boulga informe et ingouvernable que l'Europe est devenue. Mais il y a fort à parier que si les hommes politiques français avaient considéré la construction européenne comme une ouverture sur de belles et prometteuses perspectives et comme le champ de réalisation pour des projets enthousiasmants pour le pays et non comme un lieu de relégation pour politiciens ratés, le pays pèserait (et aurait pesé) davantage dans la définition des objectifs à atteindre et dans les orientations collectives. Et les électeurs français auraient des raisons de se rendre en masse aux urnes (on peut rêver), pour célébrer une Europe qui leur ressemblerait alors un peu plus.
Au lieu de ça, nous avons vu des pléiades de velléitaires sans caractère et sans énergie aller à Bruxelles à reculons et faute de mieux. Il aurait fallu que toutes les élites politiques du pays se mobilisent, se saisissent vigoureusement de la nécessité d’aller à Bruxelles pour conserver à la France la place éminente qu’elle occupait en Europe, de même que De Gaulle, après la guerre, avait conquis de haute lutte (grâce aussi à la mort de Roosevelt) le siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU qu’elle occupe encore (beaucoup se demandent comment ça se fait).
Dépourvus du minimum de fierté nationale et de combativité, ils ont été incapables de convaincre leurs partenaires que, en dehors du « modèle allemand », du « modèle suédois » et autres rengaines journalistiques complaisantes, il y avait peut-être une place pour le « modèle français ». L’incroyable répugnance préalable, le défaitisme objectif qui a guidé la classe politique française est sans doute pour quelque chose dans la destruction méticuleuse et longuement programmée de tout ce qui ressemblait à un « service public à la française ». Prompte à célébrer l'héroïsme de ses "Résistants" de la Guerre mondiale (1% de la population ?), la France, s'agissant de l'Europe, s'est mise à plat-ventre et a accepté sans combattre de se dissoudre, de renoncer à ce qui la rendait unique dans "le concert des nations", avant même d'avoir eu l'idée de lutter pour défendre son identité (allons, j'ose le mot).
La question qui me vient est de savoir à quel mystérieux facteur les Français doivent l'abyssale médiocrité de leur classe politique. Des administrateurs compétents, des gestionnaires habiles, des comptables scrupuleux, mais pas d'hommes d'Etat : voilà en résumé la composition du personnel qui gouverne le pays. Comme Diogène en d'autres temps, la France cherche en vain un homme qui sache vraiment ce que ça veut dire, la Politique (au sens noble du terme). Un homme qui serait en mesure de "se faire une certaine idée de la France". Et qui ne serait pas obsédé par les opportunités personnelles et par le "calcul de ce qui est possible" (petites ambitions médiocres de sous-chefs de bureau), mais habité par une véritable volonté de faire quelque chose de plus grand que soi (au hasard : la France).
Si les Français n'aiment guère l'Europe, c'est sûrement parce qu'ils ont compris que ce gros machin compliqué, administratif, inaccessible et incompréhensible a été fabriqué en dehors d'eux, loin d'eux, au-dessus de leurs têtes, malgré eux et de façon à bouleverser ou détruire leurs traditions les plus ancrées et leurs manières de voir, mais c'est aussi à cause de l'attitude craintive, équivoque et finalement décourageante d'une classe politique française, à qui l’Europe apparaissait sans doute comme une nécessité souhaitable, mais surtout comme un épouvantail qui ne méritait pas qu'on y investisse un maximum d'énergie et d'intelligence.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, nation, société, politique, élections européennes, de gaulle, konrad adenauer, giscard d'estaing, helmut schmidt, françois mitterrand, helmut kohl, allemagne, couple franco-allemand, diafoirus, union européenne, commission européenne, bruxelles strasbourg, conseil d'état, cour des compte, csa, jack lang, institut du monde arabe, jacques delors, michel barnier, pierre moscovici, parlement européen, rachida dati, nicolas sarkozy, pervenche bérès, alain lamassoure, emmanuel macron
dimanche, 25 mars 2018
QU’EST-CE QU’UN ÉCOLOGISTE ? 4/4
20 octobre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (4).
4
Alors tout bien considéré, qu'est-ce qu'un écologiste ? C'est un être malheureux, mécontent d'être malheureux, malheureux d'être mécontent. Selon moi, c'est un désespéré qui aime la vie, et qui est désespéré pour cette raison : il regarde le monde réel avec un peu trop de lucidité. C'est quelqu'un qui se raconte qu'il est peut-être encore possible d'arrêter la machine infernale et qui, pour la même raison, persiste à chercher, écrire, s'égosiller, courir, gesticuler, se démener, bref : "faire quelque chose", tout en étant persuadé que non, au point où l'on en est arrivé, c'est cuit, mais qui a verrouillé cette certitude dans le cabinet secret de tout au fond, dont il a jeté la clé au motif qu'il ne faut pas injurier l'avenir. "On ne sait jamais", se dit-il à la manière de ceux qui "n'y croient pas", mais que ça n'empêche pas, semaine après semaine, de remplir leur grille de loto.
Et puis s'il fallait cesser de vivre à chaque fois que meurt un proche, on serait mort depuis longtemps, se dit-il. Voilà : est un écologiste quelqu'un qui se prépare à porter deuils après deuils et qui, pour continuer à sourire à la vie, fredonne sans se lasser : « J'ai des tombeaux en abondance, Des sépultures à discrétion, Dans tout cimetière de quelque importance, J'ai ma petite concession. » (tonton Georges). D'une certaine manière, ce que je fais ici même présentement, c'est un peu "remplir ma grille de loto" : on ne sait jamais ! C'est vous dire l'état d'esprit.
Le tableau de la « mouvance » (« sensibilité » se porte aussi assez bien cette année) écologiste que j'ai essayé depuis quelques jours de dresser est sûrement incomplet, partiel et partial. J’ai seulement voulu en parcourir ce qui m’en a semblé les principaux aspects. Quel avenir ce tableau sommaire des préoccupations écologiques laisse-t-il entrevoir pour la planète ? J’ai envie de dire que, s’il y a une indéniable prise de conscience au sein de la communauté scientifique et parmi un certain nombre de voix en mesure de résonner dans les médias (je n'ai pas dit : en mesure de faire bouger les choses), le rapport des forces en présence et la lenteur pesante de l'évolution des consciences (ne parlons pas des intérêts en jeu, qui font résolument barrage) laissent mal augurer de nos lendemains.
Qu’est-ce qui autorise un tel pessimisme ? D’abord la faiblesse structurelle due à l’inorganisation du camp des défenseurs de l’environnement. J'ai dit pourquoi hier, en parlant de la relation au pouvoir. Car les défenseurs sont multiples et hétérogènes, aussi multiples et hétérogènes que les problèmes qui menacent la survie de la vie sur terre. Car il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie, il faut varier les plaisirs : il y a aussi l'agonie des sols cultivables de la planète, due à un productivisme agricole halluciné, qui consomme frénétiquement toutes sortes d'intrants chimiques (voir les travaux de Claude Bourguignon, ingénieur agronome) ; il y a, depuis trente ans en Europe, la division par cinq (- 80 %) des effectifs d'insectes volants, vous savez, ceux qui s'écrasaient sur les pare-brise, forçant l'automobiliste à s'arrêter souvent pour le nettoyer (je vous parle d'un temps que les moins de ...), catastrophe pour laquelle les scientifiques incriminent les mêmes intrants ; il y a la déforestation massive de certaines régions au profit de plantations autrement plus rentables (palmier à huile, eucalyptus, végétaux OGM, ...) ; il y a l'acidification de la surface des océans, qui rend problématique la survie des récifs coralliens et des planctons ; il y a l'empoisonnement de la chair des hommes par toutes sortes de molécules chimiques, qui n'est sûrement pas étranger à l'explosion des maladies chroniques, dont le cancer (les spécialistes parlent d'une épidémie : voir Notre Poison quotidien, de Marie-Annick Robin, La Découverte, 2013) ; il y a la mortalité humaine due à la pollution : neuf millions de personnes en 2015, selon une étude qui vient de paraître dans The Lancet, la grande revue scientifique britannique. Il y a ... Il y a ... Il y a ... Tout ça, ça fait des combats disparates, des luttes manquant de cohérence, des résistances tirant à hue et à dia. Cela ne fait pas une force.
Le changement climatique reste quand même la menace la plus globale et la plus visible (voir les ouragans récents, dont le dernier, certes dégradé en "tempête tropicale", a frappé l'Irlande (une tempête tropicale sur l'Irlande !!! Et peut-être bientôt « un oranger sur le sol irlandais », salut Bourvil), après avoir suivi une trajectoire qui sidère les météorologistes !), mais la guerre des hommes contre la planète a bien d'autres visages. Et cette guerre a été déclarée il y a un peu plus de deux siècles, quand les progrès techniques et le machinisme naissant ont opéré le passage d'une économie de subsistance à une économie de production de masse. Il paraît clair que l'accroissement de la puissance économique a été fidèlement suivie comme son ombre par un accroissement identique et synchrone de la pollution et de la dégradation des environnements. En bout de course, plus les pays du monde ont été nombreux à s'industrialiser, plus se sont multipliés les agents destructeurs. Plus l'homme a créé des richesses, plus il a nui à la nature.
C’est maintenant indéniable : la gravité et l’intensité des pollutions découlent directement de la croissance industrielle. C’est l’industrie sous toutes ses formes qui nous a donné les agréments dont nous jouissons depuis toujours. C’est l’industrie qui, pour nous offrir tant de biens, a opéré, dans le même mouvement, la dévastation de la biosphère, dont nous voyons aujourd’hui la gravité. La pollution est directement le prix que nous faisons payer à la planète pour acheter notre confort. Plus nous vivons confortablement, plus nous sommes nuisibles : voilà l'équation.
Pour être sûr de la chose, il suffit de regarder les changements intervenus en Chine depuis quarante ans : plus le pays s'est enrichi et industrialisé, plus massives ont été les pollutions. La Chine a expérimenté en quatre décennies ce que les pays anciennement industrialisés ont fait en deux siècles. Les atteintes à l'environnement sont à la mesure de la démesure du pays (l'Inde suit à petite distance : à eux deux, une petite moitié de l'humanité). Peut-être pour ça que c’est en Asie que la prise de conscience est la plus rapide au niveau de la population, peut-être aussi des dirigeants. C'est d'autant plus urgent que, si la planète pouvait supporter le "développement" à l'époque où il concernait cinq cent millions de "privilégiés", elle menace de crever la gueule ouverte au moment où chacune des sept milliards de fourmis qui encombrent sa surface se mettent à rêver de "vivre à l'américaine".
Quid des populations occidentales ? Laquelle (moi compris) est prête à renoncer à quoi que ce soit de son confort et de ses facilités quotidiennes ? Quid des industriels, lancés dans la féroce compétition mondiale ? Lequel est disposé à se rogner les griffes pour faire plaisir aux écologistes ? Quid des financiers, traders et autres spéculateurs, dont l’unique obsession est de faire grimper toujours le taux de leurs profits ? Lequel de ces vautours est prêt à dire : « J’arrête » ? Tout cela fait système : chacun des éléments tient à tous les autres et n’existe que parce que les autres existent. En un mot, chacun des éléments est solidaire de tous les autres. Quand une machine est ainsi construite, allez donc la mettre en panne ou, simplement, la ralentir dans sa marche.
Qu’y a-t-il en face de ce monstre compact ? Des forces dispersées, plus ou moins vaguement organisées. Le GIEC ? On demande aux scientifiques de conduire des recherches et de produire des rapports. Pas de prendre les décisions que ces rapports appelleraient. Les ONG ? Elles peuvent avoir une influence éventuelle, c’est certain, mais ont-elles seulement le pouvoir d'infléchir la trajectoire ? Greenpeace tire un feu d’artifice dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom ? La belle affaire : c’est mauvais pour l’image d’EDF, mais quoi d'autre ? Tout le monde a déjà oublié.
Les associations de militants ? Mais chacun des GPI ("Grands Projets Inutiles", genre ND des Landes, Lyon-Turin, …) voit se former à chaque fois des associations à objet spécifique, déconnectées de toutes les autres : comment ces forces éparpillées pourraient-elles se fondre en un ensemble qui pourrait rivaliser en cohérence et en puissance, mettons avec un animal aussi stratégiquement structuré que le Forum de Davos (on pourrait encore mieux parler du groupe Bilderberg, ou même de la Trilatérale, qui en est l'émanation), où les membres de la fine fleur des élites mondiales se tiennent par la barbichette, se serrent les coudes et ricanent au spectacle des petits agités qui prétendent les empêcher de danser en rond ? Les vaguelettes de surface n'ont jamais mis en danger les gros navires. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à observer la vitesse à laquelle la limace européenne s'achemine vers l'interdiction du glyphosate. Sans parler de la brusque volte-face du clown américain en matière de réchauffement climatique.
Que peut-on faire en définitive pour s'opposer efficacement au processus global de cet ordre des choses ? D'excellents esprits disent, au motif qu'il faut toujours "finir sur une note d'espoir" : « Il ne faut pas se décourager. Il faut garder l'espoir. Tout est toujours possible. Nul ne connaît l'avenir. » (Hubert Reeves, Paul Jorion et plein d'autres volontaristes). Mais je ne suis pas volontariste. Je suis de l'avis de Günther Anders parlant d'Ernst Bloch, l'auteur de Le Principe Espérance : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer ». Je crois au contraire qu'il faut avoir le courage de cesser d'espérer : l'espoir est une telle machine à entretenir l'illusion qu'il rend aveugle sur ce qui est possible, ici et maintenant. Cette philosophie n'est pas confortable, j'en conviens, mais c'est la seule qui vaille : cessons de nous projeter dans l'avenir, et occupons-nous du présent, si c'est possible.
Et au présent, que peut-on faire ? Pas grand-chose, je le crains. Et si lentement ! La tâche est démesurée, et chacun se demande par quel bout commencer et quel fil il faudrait tirer pour faire obstacle au pire. Toutes ces montagnes à soulever ! Et pour obtenir quel résultat ! Et si encore la "croissance" se déroulait dans une atmosphère paisible et tranquille ! Mais pensez-vous ! Partout, c'est la concurrence, la compétition, le conflit, la guerre. Non, franchement, tout bien considéré, c'est mal parti. La destruction fait partie du programme.
D’accord, je ne suis pas un optimiste, mais j’ai le pessimisme un peu argumenté malgré tout. Non, ça ne me console pas. Bien obligé de faire avec. Ce qui me console, c'est ce rouge du domaine Gallety 2015 (un Saint-Montan) qui arrosait l'autre jour un sublime brie à la truffe de chez Galland, en même temps que les amygdales de quelques lurons pas tristes.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologistes, georges brassens, ballade des cimetières, grille de loto, tonton georges, claude bourguignon, inra, ogm, monsanto, marie-annick robin, notre poison quotidien, changement climatique, pollution, chine, giec, étude du climat, centrale nucléaire cattenom, greenpeace, grands projets inutiles, lyon-turin, forum de davos, groupe bilderberg, trilatérale, union européenne, donald trump, domaine gallety, saint montan, notre-dame-des-landes
lundi, 27 juin 2016
L'INHUMAIN EST HUMAIN 1/2
Préambule :
Un peu comme le "Chat de Schrödinger" est à la fois vivant et mort, la Grande-Bretagne quantique a toujours été dans l'Europe et hors d'Europe. Maintenant que la majorité du peuple britannique a décidé d'abandonner cet état profondément duplice, parions que de son côté, la Grande-Bretagne (ne pas confondre avec le peuple) fera tout pour rester quantique : rester dehors et rester dedans.
Ce faisant, elle ne fera rien d'autre que ce que Sarkozy a fait avec notre référendum de 2005 : parions que la Grande-Bretagne va s'asseoir sur le vote du peuple britannique. Ils sont drôles, les Junker, les Hollande, à exiger que la GB envoie sa lettre de démission le plus rapidement possible : Cameron, Johnson et les autres s'apprêtent à appliquer scrupuleusement cette loi de la physique selon Fernand Raynaud : « Plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande ». Ils attendent tranquillement, narquois et souriants.
Le Marché Commun était déjà un sac de nœuds. Après l'entrée de la Grande-Bretagne, l'Union Européenne est devenue un sac de nœuds de vipères. L'élargissement à vingt-huit a transformé l'Europe en une espèce de gros machin informe, ingérable et d'une imperturbable perméabilité à tout. N'attendons pas du Brexit une clarification. Au contraire : parions que, d'ingérable, l'Europe est en passe de devenir impensable.
Une chose en tout cas n'est pas près de changer : ce n'est pas demain la veille que les peuples européens auront leur mot à dire sur la prise en charge de leur destin : comme le philosophe Jacques Rancière, je pense que les systèmes administratifs bureaucratiques que sont devenues les démocraties ne sont pas réformables.
************************
DANS LE JOURNAL DES VOYAGES :
DE L'ART D'ACCOMMODER LES MEURTRES

Quelque part au Dahomey.
Ci-dessus, les "Amazones".
Ci-dessous, les "massacres annuels".


Quelque part au Maghreb : la sœur du supplicié s'est immolée au pied de son frère.

Quelque part chez les "Peaux-Rouges" (l'un d'eux danse sur la berge).

Chez les pirates, quelque part sur les côtes africaines.

Quelque part à Téhéran.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande bretagne, brexit, david cameron, europe, union européenne, référendum, journal des voyages, jacques rancière
mercredi, 22 juin 2016
BRitishEXIT ? PAS TROP TÔT !!!
Pour des raisons sans doute de politique intérieure britannique qui échappent au bon sens du commun des mortels, les sujets de Sa Majesté sont invités à voter pour ou contre l’appartenance du Royaume à l’Union Européenne. Il serait temps, depuis le temps. Pourquoi les continentaux sont-ils allés faire des courbettes devant ces insulaires pour les supplier de bien vouloir se joindre à eux pour construire cet invraisemblable "machin" qu'on appelle l'Europe ? Pourquoi, devant les extravagantes conditions d'exception que ceux-ci posaient, ont-ils accepté de faire d'extravagantes concessions ? Ils savaient pourtant bien qu'il existait toutes les raisons de laisser les Anglais dans leur île.
Car la « City » de Londres est le plus gros, le plus grand, le plus puissant des paradis fiscaux du monde tant combattus par un célèbre Français qui s’est dit un jour d’égarement « ennemi de la finance » (discours du Bourget), alors qu’il en est un complice de tous les instants depuis que les électeurs lui ont dit « Amen ». Le Royaume est aujourd'hui une tête de pont de tout ce que la planète compte de grands banquiers et de la haute finance, puisque leur présence chez lui leur ouvre la porte de tout un continent.
La Grande Bretagne, c’est un paquet de dérogations au « droit de l’Union » (qu'ils ont d'ailleurs largement contribué à forger dans un sens ultralibéral fanatique), aux traités, etc. Les Anglais dérogent comme des fous quand il s’agit de s’introduire dans un groupe pour y exercer une influence sans en subir les lois. Depuis William Pitt, les Anglais sont passés maîtres dans l'art des renversements d'alliance pour empêcher l'avènement d'une puissance continentale.
"Contrôler sans dépendre", voilà la fière devise à laquelle ils se tiennent depuis deux siècles. La GB, qui veille jalousement sur sa souveraineté, veut bien s'associer, mais sans s'engager. Autrement dit, je veux bien tirer les marrons du feu, mais en ayant investi le minimum. L'Anglais dit : « I want my money back ».
Leur autre spécialité, c’est le « libre-échange absolu », absolument non régulé, c’est-à-dire la loi de la jungle, c’est-à-dire l’absence totale de lois s’appliquant à tous, au bénéfice d’innombrables contrats bilatéraux, qui font régner, comme on le sait, la loi du plus fort. Le peu de réglementation (je ne parle pas des normes, juste des échanges) imposé par la Commission européenne effarouche les milliardaires libertariens, ces ennemis de l'Etat et de l'autorité qui va avec, au point qu'ils ont financé le camp du Brexit. Les Américains ont poussé la chose à son paroxysme, et ont acquis dans la technique une virtuosité nonpareille.
Tous les traités signés, au nom de la France, par tous les responsables nationaux, qu’ils soient de gauche ou de droite, établissent la « concurrence libre et non faussée », qui programme dans son principe même la destruction des « services publics à la française », depuis longtemps déjà moribonds.
C’est ce qu’on appelle l’ultralibéralisme fanatique, qui ne vise rien d’autre que l’extinction définitive de tout « bien commun », c’est-à-dire l’avènement de la Grande Privatisation de Tout (y compris la brevetabilité illimitée du vivant), qui vise, comme son nom l’indique, à Tout introduire dans une logique de rentabilité, y compris, bientôt, l’air que les hommes respirent : il y aura ceux qui pourront payer et ceux qui ne pourront pas.
Alors les Anglais ? Mais qu’ils s’en aillent donc !
Boutons les Anglais hors d'Europe !
On n’aurait d’ailleurs jamais dû les y laisser débarquer.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : mais je suis prêt à parier que, la mort d’une députée aidant (juste un « loup solitaire » à tendance psychiatrique, vraiment ?), l'iounaïtid kinngdomme va nous taper l'incruste. « Alas ! Poor Yorick ! » (Hamlet, V,1). Oui, tout est possible, mon cher Watson, répondent les institutions européennes et leurs 10.000 lobbyistes accrédités, en chœur avec tous les Jérôme Kerviel qui sévissent à la City de Londres, en toute impunité.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brexit, grande-bretagne, angleterre, royaume-uni, william pitt, city de londres, paradis fiscaux, françois hollande, discours du bourget, union européenne, europe, commission européenne, i wanr my money back, ultralibéralisme, libre-échange, dérégulation, jérôme kerviel, politique, société
mercredi, 04 mai 2016
LES GANGSTERS AUX PARADIS
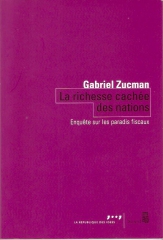 Dans un premier temps, tout ce qui grenouille autour de la finance mondiale (cabinets d’audits, avocats d’affaires, experts comptables, fraudeurs du fisc, en général considérés comme des gens très propres sur eux, parce qu’on ne demande jamais à voir l’intérieur) doit considérer Gabriel Zucman comme un communiste enragé, comme un véritable danger pour le « climat » de leurs affaires, petites et grosses.
Dans un premier temps, tout ce qui grenouille autour de la finance mondiale (cabinets d’audits, avocats d’affaires, experts comptables, fraudeurs du fisc, en général considérés comme des gens très propres sur eux, parce qu’on ne demande jamais à voir l’intérieur) doit considérer Gabriel Zucman comme un communiste enragé, comme un véritable danger pour le « climat » de leurs affaires, petites et grosses.
Et puis tous ces gens gravitant autour de l’argent réfléchissent un moment. Ce moment écoulé, ils sont convaincus que Gabriel Zucman est le type même du gars parfaitement inoffensif, et que leurs affaires ne sont pas près de pâtir de la publication de son livre, La Richesse cachée des nations (Seuil, 2013). C’est simple : ils se rendent compte que toutes les solutions que propose l’auteur pour mettre fin à la dictature que la finance impose à la marche du monde n’ont strictement aucune chance d’être un jour appliquées.
Juste le temps, on ne sait jamais, de prendre quelques précautions pour mettre le magot à l'abri des curieux et, on ne sait jamais, de « réactiver les réseaux » de leur influence, comme les journalistes français ont l'habitude de dire pour parler des intentions des hommes politiques soucieux de donner un coup d'accélérateur à leur carrière. Je goûte fort le cliché journalistique, je veux dire le lieu commun de la profession, dont je laisse à d'autres le soin de faire l'exégèse.
Pour tout dire, je goûte fort la façon débonnaire, ingénue et candide dont les journalistes français se font les échos et même les porte-voix des « éléments de langage » mis au point par les cabinets de communicants des hommes politiques. Une telle niaiserie bénévolente plaide en faveur de leur naïveté intrinsèque, en même temps qu'elle met en évidence la paresse intellectuelle et la pusillanimité qui règnent en maîtresses dans la profession.
Leur panique n’aura donc duré qu’un instant, qui a suffi pour qu’ils aperçoivent le gouffre qui les attendait si les grands Etats du monde s’entendaient pour mettre en œuvre les mesures proposées par l’auteur pour assainir le système financier qui enserre dans ses griffes le monde actuel, mesures d’une simplicité aveuglante et d’une radicalité insoutenable.
Que dit Gabriel Zucman dans ce tout petit livre percutant (114 p.) ? Il part de constats et d’analyses précis du phénomène d'évasion et de fraude fiscale, qui lui permettent d’évaluer les sommes qui échappent à l’impôt, c’est-à-dire qui constituent, à dire les choses comme il convient, un flagrant délit de vol de la richesse des Etats par les « ultrariches », ceux que Thomas Piketty nomme le « centile », voire le « millime » supérieur. Il arrive à 5.800 milliards d’euros. Le plus fort, c’est que c’est crédible, parce qu’argumenté.
Car comme son maître de thèse, Thomas Piketty en personne si j’ai bien compris, il peaufine à la petite scie les contours et les traits de sa méthodologie : ce que je dis n’est pas l’exacte vérité mais, en l’état actuel de la documentation disponible, c’en est la moins mauvaise approximation. Gabriel Zucman attend paisiblement le contradicteur. Il se conforme au précepte rayonnant de Jean-Sébastien Bach : celui qui travaillera autant que moi atteindra un résultat comparable.
Qu’est-ce qui permet aux fraudeurs de frauder le fisc ? Le secret bancaire. A cet égard, le cas de la Suisse est exemplaire. Le plus surprenant, c’est que l’auteur (on est en 2013, ça a peut-être évolué depuis) soutient que les concessions des banques suisses aux exigences de l’administration fiscale américaine sont de la poudre aux yeux : les Suisses auraient en effet multiplié les filiales délocalisées, qui diluaient à l’infini leur responsabilité dans les fraudes éventuelles des contribuables américains : « Une grande partie des banques domiciliées à Singapour ou aux îles Caïmans ne sont autres que des filiales d’établissements suisses » (p.33).
Tout commence donc en Suisse. Mais, dès qu’il a entendu dans l’air du temps souffler un vent mauvais (« contrôle », « régulation », « fiscalité », etc.), l’argent s’est fait pousser des ailes pour aller s’abriter sous des cieux plus cléments et moins regardants : Hong Kong, Iles Vierges britanniques, Panamá, Iles Caïmans, etc.
Gabriel Zucman décrit aussi avec précision les mécanismes sophistiqués qui permettent aux plus fortunés de la planète de soustraire leurs revenus aux mauvais appétits des Etats légitimes. D’abord la délocalisation de ses fonds, par l’ouverture de comptes « offshore » (expatriés).
Puis l’interposition entre les fonds et leur propriétaire de plusieurs couches de « sociétés-écrans » situées en divers « endroits sûrs » du monde, et dont la stratification permet de rendre invisible le possesseur en dernier ressort : « … bien que formellement domiciliées aux îles Vierges, les sociétés-écrans sont dans la plupart des cas créées depuis Genève ». Je passe sur les détails, pour arriver au plat de résistance : le Luxembourg.
S’il y a quelque chose à retenir de ce livre, en dehors des solutions proposées, c’est en effet le « cas luxembourgeois ». Gabriel Zucman n’y va pas par quatre chemins : « Colonie économique de l’industrie financière internationale, le Luxembourg est au cœur de l’évasion fiscale européenne et paralyse la lutte contre ce fléau depuis des décennies » (p.92).
Ce pays de 500.000 habitants a fait quelque chose d’absolument inouï : « Si le Luxembourg a réussi à devenir l’une des premières places financières mondiales, c’est en commercialisant sa propre souveraineté. A partir des années 1970, l’Etat s’est lancé dans une entreprise inédite : la vente aux multinationales du monde entier du droit de décider elles-mêmes de leurs propres taux d’imposition, contraintes réglementaires et obligations légales ».
Le pire, c'est que la richesse produite par l'industrie ne profite absolument pas au citoyen luxembourgeois, puisque, une fois déflaqué le montants des rapatriements financiers des multinationales installées là, il faut diminuer le PIB de 30% pour trouver ce qui va vraiment au pays.
Traduction : l’Etat luxembourgeois a accepté de disparaître en tant qu’Etat, pour se muer en commerçant. Il n’y a plus de nation luxembourgeoise. Il faudrait l’exclure de l’UE, nous dit l’auteur. J’attends les réactions des grands partenaires européens. Pour voir. A mon avis, Jean-Claude Junker peut dormir tranquille jusqu’à la fin des temps. Même chose en ce qui concerne l'échange automatique des données bancaires : le principe est magnifique, encore faut-il que tout le monde accepte de le mettre en pratique, si l'on veut qu'il devienne efficace.
L'efficacité. La faiblesse du livre, elle est là. Certes, Gabriel Zucman nous dit que rien n’y est utopique des propositions qu’il fait, mais il se garde d’examiner la question de savoir si celles-ci ont des chances de faire l’objet d’un consensus général. Première solution pour mettre fin à l’évasion fiscale : mettre en place un « cadastre financier mondial », calqué sur ce qui se fait en matière de propriété foncière : « … un registre mondial des titres financier indiquant sur une base nominative qui possède chaque action et chaque obligation ». Certes, certes. On peut rêver. J'imagine bien la ribambelle des prête-nom révéler l'identité des messieurs pour lesquels ils ont laissé utiliser leur nom.
Deuxième solution : créer un « impôt mondial sur le capital », un « impôt global progressif sur les fortunes ». Mais bien sûr, monsieur, tout le monde va se précipiter à la table mondiale pour signer. Là encore, on peut rêver. Troisième solution : un impôt mondial sur les sociétés. Je n’entre pas dans les détails, qu’on sache seulement que chacune de ces propositions est soigneusement étayée et argumentée par l’auteur.
Voilà. Un livre d’une solidité à toute épreuve pour ce qui est du constat, de l’analyse et des propositions. Le seul petit problème, c’est qu’on a l’impression qu’il a été rédigé sous la protection d’une bulle : il suffit de regarder où en sont les rapports de force et les processus en cours pour se dire que non, il n’a aucune chance d’en voir un jour le contenu transposé dans la réalité.
Et je doute fort que les "Panama papers" changent quoi que ce soit à la situation. Ni les "Nuits debout". Ni l'action opiniâtre de Paul Jorion.
C'est regrettable, mais.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriel zucman, la richesse cachée des nations, fraude fiscale, évasion fiscale, paradis fiscaux, thomas piketty, îles vierges britanniques, panama papers, luxembourg, jean-claude junker, grand-duché de luxembourg, europe, union européenne, ïles caïmans, société-écran, luxleaks, antoine deltour
dimanche, 24 avril 2016
UN LIVRE D’ISMAÏL KADARÉ
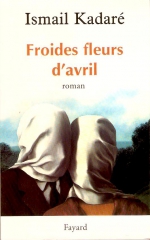 FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)
FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)
Il faut attendre le dernier chapitre de Froides fleurs d’avril, curieux livre de l’écrivain albanais, pour saisir le fond du projet de l’auteur. Drôle de roman, en vérité. On commence par suivre Mark Gurabardhi, le personnage principal, jusqu’à son atelier, où il s’apprête à accueillir son amie, dont il est en train de peindre le corps. Il est heureux de constater, quand elle se déshabille pour poser, qu’elle n’a pas touché à sa toison pubienne. Et puis, quand elle est devant lui, ils se disent que le tableau peut attendre : ils ont autre chose à faire.
Au deuxième chapitre, Ismaïl Kadaré interrompt brutalement son récit pour raconter une étrange légende : deux parents sont obligés, pour rembourser une dette impérieuse à des gens, de déférer à leur exigence de donner leur fille en épouse à un serpent. Horreur ! Et pourtant il faut en passer par là. On redoute pour la vie de la jeune femme au cours de la nuit de noces. Pourtant, au matin, elle sort de la chambre nuptiale plus belle et radieuse qu’elle n’a jamais été. Que s’est-il passé ?
Et la vie continue ainsi. Les parents sont soulagés et ravis de la façon dont les choses ont tourné, sans comprendre le pourquoi du comment, jusqu’à ce matin où leur fille sort de la chambre complètement défaite, livide, catastrophée : son époux a mystérieusement disparu. On ne tardera pas à en avoir le cœur net. Je ne révèle pas le secret, juste que ça fait penser à la fin de Lohengrin, et en même temps à l'histoire de la grenouille des contes qui se métamorphose en prince.
Alors le reste du bouquin, maintenant. Paru en 2000, il situe l’action dans une petite ville du nord de l’Albanie, dans la montagne : « B. ». Le dictateur est mort en 1985, le communisme quelques années plus tard, et le pays s’est alors complètement transformé. Pour devenir quoi ? Est-il enfin entré dans une ère de liberté, comme tout le monde l’a cru quand le Mur a été détruit à Berlin ? Hélas non. A-t-il retrouvé l’identité qui était la sienne avant la dictature ? Non plus. Alors quoi ?
Disons que l’Albanie est devenue un terrain d’exercice pour une sorte de n’importe quoi sans visage bien déterminé. D’un côté, l’auteur évoque les réseaux de « traite des blanches ». D’un autre côté, il parle de ces mystérieuses Archives de l’Etat, dissimulées, paraît-il, dans une grotte de la montagne, derrière une grosse porte métallique qui ne s’ouvre que si l’on dispose des trois clés. Il se dit même que le premier président élu y aurait organisé une petite expédition, et qu’il serait ressorti de là pâle comme un mort, après y être resté enfermé pendant trois heures. Qu’a-t-il bien pu découvrir ?
Par-dessus le marché, voilà que débarque la mythologie grecque, à laquelle Kadaré se réfère dans plusieurs de ses romans. Ici, il commence par Prométhée, le voleur de feu et bienfaiteur de l’humanité, mais c’est pour porter bientôt son attention sur Tantale, dont on connaît en général davantage le supplice que le crime commis. L’auteur retient, sans trop « solliciter » le mythe, qu’il a dérobé aux dieux le secret de l’immortalité pour l’apporter aux hommes. Au grand dam de la population olympienne.
Mais il cherche aussi du côté d’Œdipe et d'allégories sexuelles. C’est vrai que Mark se demande si son amie et modèle ne couche pas avec son frère, et que l’inceste, Œdipe, il connaît. Alors … Même si, pour finir, il prête à son personnage Mark une conviction contraire : « Il était persuadé d’avoir toujours su ce qui venait de l’élucider en lui : Œdipe n’avait pas tué son père. Jamais non plus il n’avait été l’amant de sa mère » (p.219). Mais le héros grec figure ici pour une tout autre raison : parmi tant de criminels qui ont régné, il est le seul à s’être repenti, puisqu'il s’est crevé les yeux, mais pour un crime qu’il n’avait donc pas commis. Cherche-t-il l’entrée de la grotte, cette métaphore du sexe de la mère, dans laquelle il voudrait retourner pour s’y enfouir à jamais ?
Kadaré écrit : « Tout tyran est une infinie potentialité de crimes ». Il vise ici tous ces dictateurs communistes Brejnev, Ulbricht, Enver Hodja, …) qui se donnent rendez-vous à l’entrée de la grotte de la montagne et qui eux, à la différence d’Œdipe, apparu en leur compagnie dans les jumelles de Mark, devenu pour l’occasion l’adjoint du commissaire, ne se sont jamais repentis.
Il faudrait aussi parler de cet incroyable braquage de la banque locale, dont les auteurs semblent introuvables. Il faudrait parler de quelques personnages, intéressants quoique secondaires. Il faudrait enfin parler de l’assassinat de Marian Shkreli, le directeur qui chapeaute l’administration qui emploie Mark : une seule balle en plein front, tirée par Angelin, le frère de son amie-modèle, comme stipulé, au bon vieux temps du Kanun, dans le « Livre du sang », qui réglemente avec précision le cycle des vengeances (le cadre narratif d’Avril brisé, du même auteur).
Mais ce meurtre peut-il être considéré comme une application du vieux Kanun ? Evidemment non : « Angelin des Ukaj a tiré sur Marian des Shkreli », non pas dans le strict respect des règles, mais pour obéir à des instructions d’un groupe de conspirateurs, instructions qu’il n’a même jamais reçues. Moralité : l’antique tradition, occultée par la férule communiste, ne saurait renaître de ses cendres. Elle est décomposée, malgré l’espoir de certains de la voir renaître.
Le plus "drôle", si l’on veut, c’est qu’Angelin accepterait de se livrer à la police albanaise, mais à condition que l’Etat en personne, en le condamnant à mort pour son crime "rituel", accepte de passer, au nom des règles du Kanun, pour le vengeur en dernier ressort de la mort de Marian Shkreli. Comme on pouvait s’y attendre, « L’Etat albanais refusait de conformer ses dispositions à celles du Kanun ».
Mais le motif du refus est encore plus cocasse : les autorités, pour justifier leur position, allèguent une curieuse raison : « Parmi les motifs invoqués figurait une directive tout juste arrivée du Conseil de l’Europe et qui semblait avoir un rapport indirect avec cette question ». L’Europe ! Mark n’en croit pas ses yeux : « Mark relut plusieurs fois le texte. Ses yeux s’arrêtèrent un long moment sur le mot "Europe" qui, du fait de l’extrême intensité avec laquelle il le fixait, lui parut frémir, puis s’estomper et tendre, eût-on dit, à s’effacer à jamais ». On comprend alors la signification du conte de la jeune femme épousant un serpent.
Ismaïl Kadaré conclut ainsi son roman sur une note aiguë d’euroscepticisme radical : l’Europe allant vers son évaporation ! Laissant les populations dans la désolation la plus complète. « Le peintre, sans trop savoir pourquoi, eut envie de pleurer ». Ainsi se clôt le roman.
Quinze ans après la parution, après la monnaie unique et après quelques péripéties croustillantes, on est bien obligé de conclure à la lucidité de ce regard. On entend aujourd’hui parler des Albanais à propos de trafic de drogue et de réseaux de prostitution.
Quant à l’Europe, mieux vaut garder un silence recueilli, comme on fait généralement devant une tombe.
Un petit livre (220 pages en gros caractères) d'une rare densité, où l'auteur concentre une matière complexe. Ismaïl Kadaré est un grand écrivain.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue de reproduire en couverture "Les amants" de Magritte. De deux choses l'une : soit la personne n'avait pas lu le livre, soit elle n'y a rien compris. Magritte ! Un petit affichiste de bazar ! A-t-on idée !
Pour voir mes billets sur La Niche de la honte, La Pyramide, Le Monstre, Le Palais des rêves, du même auteur.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, froids fleurs d'avril, magritte, europe, union européenne, eurosceptiques, kadaré la niche de la honte, kadaré la pyramide, kadaré le monstre, kadaré le palais des rêves, kadaré avril brisé
lundi, 11 avril 2016
YVES MICHAUD ET LA BIENVEILLANCE 3
 3
3
Ce qu’Yves Michaud, dans son deuxième chapitre, appelle le populisme, est causé selon lui par quatre fractures. Il fait d’abord allusion à une autre cause, beaucoup plus diffuse : les partis populistes (Front National, Cinq Etoiles, Podemos, Syriza) prospèrent sur l’impression des populations d’avoir perdu leur souveraineté, d’avoir de moins en moins de prise sur leur destin, de voir leur propre vie leur échapper. C’est du moins ainsi que je comprends ce paragraphe : « En fait, tous ces "partis" savent à peu près ce dont ils ne veulent pas : des "diktats" de l’Union européenne, du pouvoir des banques, de la crise, du chômage, de la retraite retardée, de la caste politique installée, du dégraissage des services publics – en ajoutant, pour la droite, les immigrés, les sans-papiers, les réfugiés, les islamistes. Ça fait des programmes d’opposition et de dénonciation, pas des programmes d’exercice du pouvoir » (p.63).
Les facteurs qui « désarticulent le champ social » sont donc les suivants : une fracture générationnelle (« économique, culturelle, technologique, de distribution de pouvoir et de rationalité ») ; une fracture ethnique (de souche / immigrés) ; une fracture "de classe" (riches / pauvres) ; une fracture éducative ("cognitive", dit aussi l’auteur, entre les formés et les tôt déscolarisés). L’inventaire de ces fractures fait peur à lui tout seul. Il en ajoute deux autres, « plus spécifiquement françaises » : une fracture entre ceux qui vivent à l’abri de l’insécurité et ceux qui y sont confrontés dans leur vie quotidienne ; une autre fracture, entre « personnes à statut protégé et celles exposées à la précarité » (les fonctions publiques / les autres). N’en jetez plus : ça fait beaucoup.
Je suis entièrement d’accord avec ce diagnostic inquiétant : la France souffre de « fractures multiples ». Quand un pays fait face à un tel champ de mines à fragmentation, l’impression qui domine, c’est le risque de démembrement. J'ajoute que ce risque est encore accentué par les particularismes revendicatifs émanant d’une kyrielle de « minorités » ou de « communautés » réclamant des « droits » spécifiques au nom de l’ « égalité ».
On l’a vu de façon saisissante au moment du vote de la loi éminemment clientéliste ouvrant l'institution du mariage aux homosexuels, qui a donné une idée approchante de ce qu'est une guerre civile, les morts en moins. Toute promotion d’une « minorité » au motif qu’elle subit une « discrimination » ou une « stigmatisation », et au nom d'une prétendue « égalité », est en soi un facteur de désunion. L’érection de la « discrimination » et de la « stigmatisation » au rang de délits pénaux est en soi un facteur de dissolution de l’unité nationale. Je sais que cette seule idée va passer pour une horreur, mais qu’on y réfléchisse : plus la collectivité fait droit à des groupes particuliers qui tirent à eux la couverture et font braquer les projecteurs médiatiques sur leur sort d’ « opprimés » spécifiques, plus elle accumule les clivages au sein de la population. Et plus elle amenuise les chances de cette population d'envisager pour elle dans sa globalité un avenir commun.
L’addition des fractures et la prolifération des particularismes revendicatifs constituent en soi une négation de tout rassemblement, de toute unité, de toute recherche de l’éventuelle et souhaitable entité surplombante – autrefois la nation, la patrie, … – capable d’englober tous les particularismes, tous ces sous-ensembles disparates, hétérogènes et, bien souvent, inconciliables. La République a désormais un cœur d'artichaut : les « minorités » viennent se servir, comme au supermarché.
En l’état actuel des choses, je ne vois pas par quel moyen qui que ce soit serait en mesure de « remembrer » la France. Deux solutions : soit dénicher l’homme d’assez vaste stature et carrure pour donner à penser aux gens qu’ils peuvent se rassembler autour de lui ; soit demander aux acteurs de la politique de faire abstraction de leurs calculs pour rechercher un consensus dans l’intérêt général. Vous avez déjà deviné ce que j’en pense. Mais je suis un affreux pessimiste.
Dans son troisième chapitre, consacré à la politique internationale, Yves Michaud commence par faire le tour de toutes les menaces qui se sont fait jour après la chute du mur et de l’empire soviétique, qui semblait promettre à la démocratie un avenir radieux. Il a fallu déchanter. Vingt-cinq ans après, force est de constater que le monde a rarement été aussi instable. Et l’Europe est devenue un monstre froid, mou et sans boussole (cf. Le Doux monstre de Bruxelles, de Hans Magnus Enzensberger).
Le reste du chapitre est consacré à la critique de l’idéalisme en politique internationale, au nom du réalisme (la « Realpolitik ») dans la manière d’aborder les rapports de force. Un bref historique de l’idéalisme politique en philosophie (Grotius, Kant) permet à l’auteur d’en discerner trois sortes : « … soit caricatural, soit léger, soit formel ». La première est celle portée par B.-H. Lévy (il faut sauver Benghazi !) ou B. Kouchner (il faut nourrir les Somaliens !). Michaud présente ainsi BHL : « Le bhlisme, du nom de Bernard-Henri Lévy, cinéaste, homme d'affaires et essayiste français » (p.95). J'aime beaucoup les trois facettes qu'il retient, et surtout l'omission d'une quatrième, la préférée du personnage, l'étiquette sous laquelle il s'était fait connaître. Portrait net et sans bavure.
La deuxième est « celle des militants et théoriciens des droits de l’homme et du monde des ONG », ceux qui vont sur le terrain, poussés par de nobles motivations et une vision optimiste, souvent irénique de l’humanité : « L’idéalisme cosmopolitique flotte aussi au-dessus de la réalité en refusant de voir que ses interventions ont plutôt tendance à enkyster les crises en installant les populations déplacées dans des situations de "réfugiés perpétuels" sur le mode des Palestiniens, des Sahraouis, des réfugiés du Darfour et du Soudan » (p.114). Il faut intervenir pour sauver les hommes partout où ils sont menacés, sans se poser d'autres questions. Cela s'appelle foncer tête baissée : tant pis pour les effets pervers, dont parle Yves Michaud.
La troisième est celle du droit international « cosmopolitique », qui a tant de mal à se mettre en place. On vient de voir une curieuse manifestation de cette justice supranationale : la CPI, à quelques jours d’intervalle, a condamné Radovan Karadzic, tête pensante si l’on veut, à quarante ans de prison, mais a acquitté Vojislav Seselj, le chef de milices serbes sans pitié.
Quoi qu’il en soit, la politique idéaliste a montré ses limites : « A plus long terme, le bilan est en réalité désastreux » (p.120). Tout simplement parce que « L’idéalisme politique méconnaît en fait les grandes déterminations de l’histoire » (p.121). Qu’il s’agisse des organisations socio-politiques traditionnelles, des croyances et religions, les données lourdes de la démographie.
Moralité : il faut que les bonnes âmes et les humanistes optimistes abandonnent leur nuage de bons sentiments et de grandes idées, redescendent sur terre et reprennent pied dans la réalité épineuse. La politique internationale ne se conduit pas à coups de jugements de moralité, attitude splendide et totalement inefficace.
La pauvre Caroline Fourest peut toujours asséner ses sentences vertueuses à l’encontre de Poutine, du roi d’Arabie et d’autres : ça ou cracher en l’air, ça revient au même. Un journaliste peut bien dénoncer le « double discours » de François Hollande, quand il appelle, d’une moitié de la bouche, les Africains à promouvoir l’état de droit et, de l’autre moitié, soutient Idriss Déby, ce dictateur à la Tchadienne au pouvoir depuis 1990. Ça ou faire des ronds dans l’eau …
L’appel d’Yves Michaud à faire preuve de réalisme dans la politique internationale est bien venu. Dans l’histoire, la morale et les intérêts des nations ont rarement fait bon ménage. Nos gouvernants n’ont pas toujours tort de veiller aux intérêts de la France.
Voilà ce que je dis, moi.
Suitetfin demain.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves michaud, contre la bienveillance, politique, société, france, union européenne, caroline fourest, françois hollande, tchad, idriss déby, ex-yougoslavie, serbie, bosnie, cpi, cour pénale internationale, radovan karadzic, vojislav seselj, vladimir poutine, hans magnus enntzensberger, ce doux monstre de bruxelles
lundi, 07 mars 2016
MAUDIT CODE DU TRAVAIL !
Qu’est-ce qui se passe autour du Code du travail ? Quel est l’enjeu des luttes féroces qui se livrent en haut lieu et en bas lieu à propos de ce « Code, l’unique objet de mon ressentiment » ? Un million et plus de signatures pour la pétition qui réclame le retrait du texte. Effervescence en ligne, panique du timonier, reculade gouvernementale, bref, encore une fois le même lamentable spectacle de la panouille intégrale qui sert de ligne directrice à François Hollande, depuis que l’inconséquence des Français l’a porté au pouvoir.
Je me moque de savoir ce qui se passe sous les jupes et dans les dessous peu affriolants des calculs politiques à court terme autour de cette affaire. Quelles seront les modifications acceptées par Manuel Valls ? Peu importe : ce qui compte, c'est le mouvement général dans lequel s'inscrivent toutes les remises en cause des "droits" des travailleurs, un peu partout en Europe et dans le monde. La consigne est partout la même : il faut s'aligner sur le plus bas.
Car on peut deviner ce qui se trame derrière les clameurs de Gattaz, du patronat et de tous ceux qui poussent, soit à la démolition pure et simple de ce monument de tracasseries qui empêche les chefs d’entreprise d’embaucher et de licencier à leur gré ; soit, ce serait un minimum, de simplifier les procédures, de garantir les droits des salariés tout en injectant du lubrifiant dans les rouages des entreprises.
On nous sort à tout bout de champ l’épaisseur du Code du travail, ses obscurités, ses contradictions, ses jurisprudences alambiquées, et on le compare au Code suisse, limpide, lui, et réglé comme un coucou.

Gaston Lagaffe en train de repeindre le coucou de son coucou suisse.

Gaston Lagaffe n'a rien compris au marché du travail.
Je veux bien croire qu’en matière d’emploi, un effort de clarification et de simplification des règles est nécessaire. Mais pour embêter les entreprises, il n’y a pas que ce maudit Code : il me semble que les normes (françaises, européennes) auxquelles elles doivent se conformer ne sont pas pour rien dans les tracasseries qu’elles subissent.
Et puis quand on nous parle de chômage et d’emploi, on nous raconte beaucoup de bobards. Le premier est que la complexité du Code est la cause du chômage : le Code a bon dos. Et si, Code ou pas Code, la France perdait des emplois, tout simplement, à cause de la diminution du travail productif ? Et puis Hollande gave le MEDEF de cadeaux. Et puis on nous serine : « Plus de flexibilité sera favorable à l’emploi ». Rien n’est moins sûr, monsieur Gattaz : où est-il votre million de créations ? Perdu en route.
Et puis prenez le déficit "astronomique" (paraît-il) de l’UNEDIC. Deux solutions simples pour résoudre le problème : primo, cesser de l’obliger à participer au financement de Pôle emploi ; deuxio, pénaliser les entreprises qui recourent abusivement aux contrats précaires pour occuper des postes indispensables, ce qui alourdit notablement sa barque.
Non, moi, ce que je vois se profiler derrière la guerre faite au Code du travail, c’est autre chose, et c’est plus grave. Car il faut savoir que, partout où ont été menées de « courageuses réformes du marché du travail » (Allemagne et Grande-Bretagne pour commencer), partout où l’on a « assoupli les règles », le nombre de travailleurs pauvres a explosé, et les inégalités se sont démesurément accrues. Et les "journalistes" perroquettent la doctrine officielle : ces pays ont un taux de chômage remarquablement faible. Moi, les statistiques, je n'admets que "celles que j'ai moi-même trafiquées" (Churchill).
Il ne suffit plus d’avoir le privilège de bénéficier d’un emploi pour espérer échapper à la pauvreté. Travailler plus pour gagner moins ! Sarkozy n'avait pas pensé à ça. Remarquez, il y avait déjà les éleveurs français qui payaient pour travailler, parfois jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ça montre la voie. Moralité : les dirigeants français sont en train d’admettre, de programmer et d’administrer l’appauvrissement des populations européennes. Les peuples ont perdu la guerre.
Ce qui se profile derrière la réforme du Code du travail, c’est ce que pointe Alain Supiot dans son excellent bouquin : La Gouvernance par les nombres (Fayard, 2015). Le message principal de l’ouvrage, enfin, ce que j’en retiens d’essentiel, c’est que le système économique que l’ultralibéralisme a installé (l’économie financiarisée au profit des seuls actionnaires) prévoit tout simplement d’abolir les lois qui régulent encore, pour un temps, la production et les échanges. Comme le dit le dirigeant d’une grande entreprise : « La régulation est un obstacle à l’innovation ». Ah, chère humanité, que serais-tu sans la déesse « Innovation » ?
Tout ce qui régule l’économie est considéré par les grands acteurs qui interviennent sur les « Marchés » comme un obstacle à la bonne marche des affaires. Il faut « déréguler », on vous dit, dans un régime de « concurrence libre et non faussée ». L’Europe qui est en place, pour le plus grand malheur de ses citoyens, est une illustration exacte du processus en cours. Les négociations secrètes qu’elle est en train de « conduire » avec les Etats-Unis (TAFTA ou TTIP) sont un pas de plus vers la disparition de toute régulation de la production et des échanges. Devinez au profit de qui ça se fera.
Comme le dit Alain Supiot, la loi (ce qu’il appelle « hétéronomie » : pourquoi pas ?) est ce qui s’impose indistinctement à tous les acteurs : elle surplombe, parce qu’elle a plus d’autorité et de pouvoir que tous les acteurs privés réunis. Tout le monde est contraint de s’y soumettre, et les infractions sont, en théorie, punies par les tribunaux. Or, dans le système que les plus grands acteurs privés de la production et des échanges sont en train d'installer, il est entendu que ce ne seront plus des lois qui gouverneront, mais des contrats. Kolossale finesse ! Vous avez compris : plus de règles qui s'imposent à tous indistinctement ! Tout est négociable ! Et comme dans toute négociation, on prévoit déjà de quel côté penchera la balance : celui du plus fort.
La grosse différence entre une loi générale et un contrat, c’est que la loi est universelle (dans la limite des territoires où elle s’applique), alors que le contrat se négocie : vous mordez le topo (comme dit San Antonio) ? Le contrat en lieu et place de la loi, cela signifie que ce qui se trame, autour du Code du travail (qui est une loi), c’est la Grande Privatisation de Tout. C'est la Grande Confiscation des Richesses par une élite minuscule. Cela signifie, par conséquent, la disparition du bien public, l’élimination de ce qui s’est appelé dans le passé le "bien commun". Cela signifie aussi l’effacement de ce qu’on appelle encore, par abus de langage, la « puissance publique ». Cela signifie que les populations seront mises aux prises avec les « forces du Marché », mais pieds et poings liés. Et avec la complicité active de ceux qui gouvernent.
Sale temps pour les humains en perspective.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j'entends à l'instant un nommé Pierre Cahuc, chercheur en économie, accuser son contradicteur de ne pas lui répondre sur le terrain de l'économie, mais de la politique. Il lui reproche de se référer à des articles parus dans des revues non académiques : « Lisez les revues académiques, jeune homme ». Eh, espèce de foutriquet, ravale tes mensonges. Tu crois vraiment que l'économie est une science exacte ? Tu crois qu'on va la gober, cette fable d'une pure discipline de laboratoire ? Et sur le plateau de France Culture, tout le monde a l'air d'accord pour ne pas parler de politique au moment où l'on parle d'économie. Le mensonge est là : il n'est pas possible de faire de l'économie sans faire en même temps de la politique. S'intéresser à l'économie, c'est se demander quel modèle de société on veut. Si ce n'est pas de la politique, ça !
Si l'économie n'est pas de la politique, je ne sais plus ce que parler veut dire !
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, économie politique, code du travail, loi el khomri, françois hollande, medef, union européenne, europe, unedic, alain supiot, la gouvernance par les nombres, ultralibéralisme, accord tafta, ttip, concurrence libre et non faussée, san antonio, gaston lagaffe, franquin, paul jorion, pierre cahuc, nicolas sarkozy, manuel valls, pierre gattaz, france culture, politique
jeudi, 09 juillet 2015
FEUILLETON GREC ? OU ALLEMAND ?
Il est intéressant, le feuilleton grec. Une excellente dramaturgie en tout cas. Je ne connais pas le metteur en scène, j’ignore qui est le producteur, mais j’apprécie les efforts indéniables accomplis par les différents protagonistes pour donner au spectacle, quand ils sont sur scène, son poids de rebondissements et de péripéties plus ou moins inquiétants quand on les met bout à bout.
Je ne tente pas de résumer le problème, auquel, je crois, plus personne ne peut aujourd’hui prêter un sens sur lequel les participants pourraient s’accorder. Ils ont tous choisi leur camp et pris leur parti. C’est l’opposition frontale. Une opposition politique, que je résumerai à la question suivante : l’Europe que nous voulons sera-t-elle de la gauche partageuse ou de la droite arrimée aux principes ultralibéraux de la « concurrence libre et non faussée » ?
Si j’avais à voter (à condition que le « projet européen » ait pris figure humaine, je veux dire déchargée du poids bureaucratique de la machine administrative, qui ne roule plus que dans sa propre direction), mon choix se porterait sur l’Europe partageuse, même si la perte de souveraineté me chiffonne, et plus loin et plus profond qu’aux entournures.
Je vois bien que la souveraineté nationale heurte de front l’exigence d’abandon de souveraineté que nécessiterait une Europe fédérale. J’imagine que le continent européen pourrait, sur les cartes géopolitiques qui sont en train d’être redessinées, arriver à être considéré comme une puissance. Mais certains n’en veulent en aucun cas. Le « libre-échange » suffit au plus grand nombre. Quelle saloperie de dérision !
Que veut l’Europe ? C’est simple, l’Europe ne veut rien, parce qu’il n’y en a pas, d’Europe. Ne me faites pas rire avec les institutions européennes, s’il vous plaît : quand il y a vingt-huit décideurs en action, il n’y a jamais de décision. L’Europe que les institutions européennes nous ont mijotée est l’ectoplasme d’un paralytique en phase terminale.
Cette Europe-là suscite la haine et le rejet. Et le mépris de l’institution et de ses partisans (et de ses bénéficiaires) pour les peuples soi-disant souverains est une preuve définitive que cette Europe-là se construit, d’une part, sans les peuples, d’autre part contre les peuples. Pendant ce temps, les vraies puissances se gaussent.
Si la Grèce quitte la zone euro, c’est parce que le retraité bavarois (dixit Arnaud Leparmentier, qui n’aime pas, mais alors pas du tout Thomas Piketty, sans doute un peu trop à gauche à ses yeux) ne veut plus débourser un centime pour ces enfants prodigues que sont les Grecs, qui ont jeté par les fenêtres le bon argent qu’il a consenti à leur prêter, en attendant un confortable retour sur investissement.
Angela Merkel, et surtout Wolfgang Schäuble, ministre des finances, ont entendu le retraité bavarois. Ils pensent aux prochaines élections : s’ils sont élus, c’est parce qu’ils ont promis. Plus un centime aux Grecs. Et puis il y a « l’opinion publique » (vous savez, ce personnage irrésistible d’Orphée aux enfers, de Jacques Offenbach), et ils reniflent les vents qui en émanent, et qui sentiront très mauvais pour leurs matricules s’ils contreviennent.
Ils n’ont pas lu l’intéressant papier publié dans Le Monde (daté 7 juillet), écrit par le chroniqueur « Planète » de la maison, Stéphane Foucart, intitulé « Une dette allemande ». Attention, rien à voir avec une ardoise que l’Allemagne aurait laissée chez quelque banquier. Non, il s’agit d’une dette contractée sur la santé des Allemands et de leurs voisins. Car il faut le savoir : l’Allemagne n’a cessé d’emprunter à nos vies, mais personne ne songe à exiger les énormes créances qu’il a en Allemagne, tant cette dette est invisible.
Il faut que ce soit un pool de chercheurs de haut niveau qui publie les résultats de toute une série d’études dans une revue « à comité de lecture » (pour dire le sérieux scientifique, donc la restriction, hélas, de la diffusion au seul public des spécialistes). Thème de ces études : « … évaluer le coût économique des dégâts sanitaires dus aux pollutions chimiques dans l’Union européenne ». C’est de ces travaux que rend compte l’article de Stéphane Foucart.
Les dégâts sont considérables : le 1,3 % du PIB des vingt-huit pays se traduit par un montant de 157 milliards d’euros par an. Et encore, si l’on préfère, « la partie haute de la fourchette surpasse les 260 milliards d’euros annuels ». On me dira : pourquoi pointer l’Allemagne du doigt ? Pour une raison simple, livrée par Foucart : « C’est simple : en Europe, la chimie, c’est l’Allemagne ». La chimie européenne s’appelle Bayer, BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik), … Des géants. Allemands.
Les Allemands sont au courant, puisque, « par le biais d’une de ses agences de sécurité sanitaire, l’Allemagne n’a eu de cesse d’entraver la mise en place de nouvelles réglementations européennes destinées à réguler les produits les plus problématiques – dits perturbateurs endocriniens ». Ah, les perturbateurs endocriniens ! Qui dira la poésie des phtalates, le lyrisme des néonicotinoïdes et autres « délicieuses petites choses » (l’expression est pour les vieux cinéphiles) ? C'est sûr, on peut dire merci à l'Allemagne !
Résultat des courses, en dix ans, ces « coûts collatéraux cachés » s’élèvent à « au moins 1570 milliards d’euros [pour] l’économie européenne ». Une somme que je n’arrive pas à concevoir. Et une somme totalement indolore pour tout le monde, puisqu’elle ne passe pas par les bilans des banques ou les budgets des Etats. Une somme qui nous a été empruntée sans que nous le sachions. Passez muscade. Les études épidémiologiques ne figurent pas encore au programme de ceux qui tiennent la calculette.
L’Europe allemande est une Europe dirigée par les comptables : ils ont l’œil fixé sur le « respect des règles » et le « respect des Traités ». Je ne dis pas qu’ils ont totalement tort, je dis juste que laisser les clés de la voiture à une profession myope par nature, c’est prendre un risque grave. Ça vous fait fantasmer, vous, une Europe devenue un service de comptabilité dont la seule fonction serait de garder l’œil sur les chiffres ? L'inventaire de la vaisselle en porcelaine après la scène de ménage ? Ah oui, qu'est-ce que ça donne envie de vivre ensemble !
Il paraît que les économistes ont baptisé ces coûts collatéraux cachés du doux nom d’ « externalités négatives » ! Tout le monde est heureux de l’apprendre. Allez, soyons intransigeants et inflexibles avec ces salopards de Grecs qui ont assez « fait danser l’anse du panier ». Qui sera aussi intransigeant avec cette Allemagne chimique, qui ne cesse depuis des dizaines d’années d’emprunter des sommes astronomiques à la santé physique des Européens, et surtout à l’avenir de cette santé ?
Stéphane Foucart examine pour finir la crédibilité de ces études. La réponse est affirmative. Leurs auteurs se sont en effet limités à "sept produits et familles chimiques (pesticides organophosphorés, plastifiants, etc.) et à trois catégories de troubles (système reproductif masculin, neurocomportementaux, obésité et diabète)" (citation approximative quant au texte, mais exacte quant au fond). Rien que du mesurable.
Foucart cite Mme Woodruff qui précise même, dans son éditorial du numéro de la revue JCEM qui a publié les études : « Ce qu’il faut retenir est que ce calcul de 157 milliards d’euros ne représente que la partie émergée du véritable fardeau attribuable aux polluants chimiques de l’environnement ».
Je sens que les occasions de rigoler ne vont pas manquer. Au fur et à mesure que des chercheurs débusqueront les « externalités négatives ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, dette grecque, allemagne, angela merkel, wolfgang schäuble, europe, union européenne, journal le monde, arnaud leparmentier, journalistes, économistes, thomas piketty, l'opinion publique offenbach, orphée aux enfers, stéphane foucart, une dette allemande, externalités négatives, industrie chimique, politique, france, société, concurrence libre et non faussée, écologie, défense de l'environnement, perturbateurs endocriniens, phtalates, néonicotinoïdes
dimanche, 03 mai 2015
L'ETAT DE DROIT FOUT LE CAMP
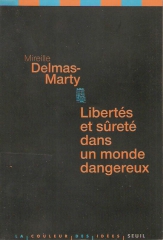 Y a pas que la littérature, dans la vie. Y a aussi des lectures sérieuses. « Nous l'allons montrer tout à l'heure » (air connu).
Y a pas que la littérature, dans la vie. Y a aussi des lectures sérieuses. « Nous l'allons montrer tout à l'heure » (air connu).
L’inconvénient des formations juridiques, c’est qu’elles donnent en fin de parcours aux étudiants une tournure d’esprit excessivement attachée à la « lettre » du droit. D’où une certaine rigidité intellectuelle. Je ne sais pas si vous avez jamais mis le nez dans le texte de la « Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant » (1989) : à vous dégoûter de faire des enfants.
Et je ne parle pas du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », de sinistre mémoire, dont le pavé particulièrement indigeste (191 pages découpées en un déluge de parties, de chapitres, de sections, d'articles et de paragraphes), envoyé à tous les Français en 2005, leur a été enfoncé de force, légalement et démocratiquement dans la gorge par Nicolas Sarkozy, un peu plus tard, parce qu'ils avaient "mal voté" la première fois.
Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010), le livre de Mireille Delmas-Marty n’échappe pas à cette rigidité. En revanche, si les formations juridiques ont l'inconvénient que j'ai dit, elles ont l'avantage qui en découle : précision et exactitude. On appellera ça la rigueur. Un certain aspect « scolaire », si l’on veut, dans l’effort de construction, un peu « dissertation », avec introduction générale, trois parties subdivisées et chaque fois introduites et conclues, et une conclusion générale. Personne ne peut se perdre sur un parcours aussi visiblement balisé. La supériorité indéniable de cette méthode, c’est son impeccable netteté.
Alors, de ce livre un peu ardu pour l'éternel néophyte que je suis dans la langue des juristes, je ne retiens pas tout. Je laisse en particulier de côté ce qui fait la complexité et les vents contraires qui agitent les relations entre les instances juridiques nationales, européennes et internationales, les subsidiarités, les conflits, les résistances.
Je garderai juste la convergence de vues entre l’auteur et un juge dont j’ai lu récemment Le Rapport censuré (Jean de Maillard, voir mon billet du 9 mars), au sujet du poids incroyable que pèsent les Etats-Unis dans le domaine des relations (judiciaires et autres) internationales. Si je voulais résumer en simplifiant, je dirais que les Etats-Unis, non seulement se permettent tout quand leurs intérêts sont en jeu (Guantanamo, Bagram, …), mais font pression sur les autres nations pour qu’elles adoptent les mêmes critères qu’eux dans la « lutte contre le terrorisme ». Traduction : ils les y obligent, au motif de la loi du plus fort (le juge Maillard parle des transactions commerciales en dollar, qui doivent impérativement passer par une banque américaine sous peine de).
Ce qui m’a en revanche intéressé au plus haut point dans le livre de Mireille Delmas-Marty, c’est tout ce qu’elle dit de l’évolution inquiétante du droit, qu’il soit national ou international. Et pas dans le sens de l’Etat de droit. Je le dis tout net : tout en n’étant pas juriste, j’ai trouvé passionnante l’analyse qu’elle fait de deux conceptions opposées du droit, qui renvoient à deux conceptions antinomiques de l’humanité, l’une de tradition « humaniste », l’autre de tradition « guerrière ». Les gens au courant trouveront sûrement "basique" cette petite leçon de philosophie du droit. Elle est à mon niveau.
En France, traditionnellement, la justice attend qu'un individu ait commis un délit ou un crime pour le juger et le condamner, après établissement irréfutable des faits. L’auteur appelle cela « le couple culpabilité / punition », ajoutant que cette « école pénale » est « fortement influencée par Kant et Beccaria », c’est-à-dire qu’elle repose sur « l’universalisme des droits de l’homme » (p. 84-85)
Mais elle repose aussi sur l'idée que l'individu, sauf circonstances spéciales, sait ce qu'il fait. Il est mû par la raison, il est libre, donc il est responsable. "Justiciable", comme on dit. Le corollaire, c’est que personne ne peut être poursuivi avant. C’est l’acte qui fait le délinquant. C’est l’infraction qui justifie la poursuite. C’est un individu particulier qui est présenté au juge ("individualisation de la peine").
Or il existe une « école pénale » qui prône des idées radicalement autres. Une école dont la philosophie repose sur une « anthropologie guerrière ». Une école « positiviste », qui fait de l'homme, non un être libre et responsable, mais un être entièrement déterminé. Une école fondée par un certain docteur Lombroso au tournant du 20ème siècle. Une école qui invente le concept de « criminel-né ». Un juriste allemand, Carl Schmitt (1932), ira jusqu’à formuler l’idée d’ « ennemi absolu ». Deux concepts qui semblent s'imposer de nos jours.
Cette école divise donc l'humanité en une masse de gens normaux d'une part, et d'autre part une catégorie d’humains naturellement prédisposés à commettre des crimes. Des humains dans lesquels le Mal est inné (à supposer que tous les autres en naissent exempts). Mais le soupçon peut se porter pratiquement sur n'importe qui, étant donné que cette prédisposition ne se porte pas sur le visage. La preuve, c'est la stupéfaction des voisins quand le père tranquille tue sa femme, ou autres circonstances tragiques.
Selon cette conception, on ne parle plus de « culpabilité », mais de « dangerosité potentielle ». On ne parle plus de « peines de prison », mais de « mesures de sûreté », aux contours éminemment flous, à durée indéfinie. Ce n'est plus ce que vous avez fait qui compte, mais ce qu'un collège d' « experts » vous aura jugé capable de commettre dans l'avenir.
Autrement dit, on passe du diagnostic (acte avéré) au pronostic (acte potentiel, virtuel ). Sarkozy, on s’en souvient, était même allé jusqu’à proposer un « dépistage » précoce (dès trois ans) de la dangerosité future des enfants. Si vous enfermez un type pour des actes qu’on l’imagine potentiellement capable de commettre, il passera sa vie derrière les barreaux, plus sûr moyen de ne jamais savoir s’il en aurait commis.
Autrement dit, dès la naissance, il y a les humains et les autres. Des « monstres », pourquoi pas. Souvent présentés comme tels, en tout cas. Cette conception est éminemment anti-humaniste. Je reste convaincu qu'Adolf Hitler, Staline, Pol Pot et consort ne sont pas des monstres inhumains, mais qu'ils font hélas partie de l'espèce humaine. Hitler et Pol Pot sont nos semblables. Je déteste l'idée, mais je la crois vraie. L'horreur est humaine, trop humaine.
De plus, Mireille Delmas-Marty pointe, chez Carl Schmitt, une tendance à assimiler dans la même personne l’ « ennemi absolu » et le « criminel-né ». C’est-à-dire qu’il fusionne potentiellement deux institutions : celle destinée à maintenir l’ordre et celle destinée à défendre le territoire national contre une attaque étrangère.
Maintien de l’ordre et guerre reviendraient alors à une tâche unique. Armée et police même combat, avec pour conséquence l'extension de la notion d' « état d'urgence » dans le temps et dans l'espace, avec toutes les restrictions à l' « état de droit » que cela suppose. Je pose la question : qu'est-ce que c'est, l'opération « Vigipirate » (à laquelle vient de succéder « Sentinelle ») ? La « loi renseignement » est du même tonneau.
Elle cite un certain Gunther Jakobs, qui réclame le droit pour la société de « se défendre par des mesures radicales comme l’internement de sûreté ou la création de camps du type de celui de Guantanamo ou de Bagram ». Le vocabulaire employé pour justifier aujourd'hui l'action de l'armée française en Afrique et ailleurs (« Sécurité » ? « Maintien de la Paix » ? « Guerre au terrorisme » ?) est assez élastique pour tout confondre.
Pour le coup, l'état d'urgence tend à se pérenniser, étant entendu que l'urgence devient une norme permanente. C'est comme la drogue : ça commence par le plaisir, ça continue par la dépendance, et après une phase d'accoutumance (augmentation incessante de la dose), ça finit par une overdose.
Ce qui ressort, en définitive, de tout le livre, c’est ce qu’on voit se développer dans toutes les directions depuis le 11 septembre 2001 : la collecte généralisée des données, en particulier des données personnelles. Le nœud coulant policier, dans le monde entier, se resserre autour du cou des individus, que ce soit pour des raisons commerciales (profilage algorithmique des habitudes des consommateurs) ou pour satisfaire le besoin toujours accru de sécurité collective (repérage de mots-clés supposés se rapporter au terrorisme).
Tout cela se passe avec la complicité des plus hautes instances juridiques (Conseil constitutionnel en France, Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, …) qui avalisent, non sans contradictions, des lois restreignant les droits, même si d’autres institutions font de la résistance (Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par exemple).
Bref, en plein débat sur la « loi renseignement », ce livre de 2010 est encore plus actuel, et devrait alerter les défenseurs de ce qui reste de l’ « état de droit ». Un témoignage de plus sur l’aspect peu ragoûtant du monde qui est en train de mijoter sur les fourneaux de tous les pouvoirs.
Merci madame, pour la confirmation. Total respect.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Je passe sous silence l'optimisme de commande que Mireille Delmas-Marty manifeste en conclusion. Elle préfère parier sur la raison des hommes et leur « communauté de destin », plutôt que sur la crainte que s'établissent des « sociétés de la peur ». Je veux bien. C'est son droit. En tant que grande universitaire, elle ne se sent peut-être pas le droit de faire autrement. On n'est pas obligé de partager cet optimisme, vu les évolutions actuelles sur de multiples terrains différents (politique, société, économie, écologie, ...).
09:00 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : france, société, politique, europe, union européenne, constitution européenne, référendum 2015, nicolas sarkozy, mireille delmas-marty, libertés et sûreté dans un monde dangereux, éditions du seuil, droits de l'homme, loi renseignement, manuel valls, jean de maillard, le rapport censuré, docteur lombroso, criminel né, carl schmitt, hitler, pol pot, 11 septembre 2001, cedh, cour européenne des droits de l'homme
vendredi, 19 octobre 2012
L'AVENIR DE L'IDENTITE NATIONALE
Pensée du jour : « Malheur à celui qui n'a pas mendié ! Il n'y a rien de plus grand que de mendier. Dieu mendie. Les anges mendient. Les rois, les prophètes et les Saints mendient ».
LEON BLOY
Ceci est la dernière note sur le sujet.
J’étais donc parti, le 14 octobre, sur une question d’une gravité philosophique qui n’a certainement échappé à personne : « Qu’est-ce que l’identité nationale ? ». Je répondais intrépidement : « sentiment d’appartenance » et « exigence de différenciation ». C’était mes deux idées de départ. Ce qui m’intéresse dans ces deux notions, c’est qu’elles marchent aussi bien au niveau individuel que national.
L’individu est un entrecroisement proprement inextricable de critères d’appartenance et de critères de différenciation (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse, etc.). La nation, c’est un peu pareil. A ce titre, la caractéristique principale de toute identité, c’est qu’elle se compose de données tout à fait indénombrables. Je dirais même « inépuisables ». Chercher à définir l’un ou l’autre de façon exhaustive est voué à l’échec. Et je trouve ça rassurant : la part de mystère de tout ce qui se rattache au vivant, en quelque sorte.
Maintenant, la question qui vient est : « Qu’est-ce qu’on fait de tout ça ? ». Je veux dire : de quel côté va-t-on tirer la question ? Beaucoup de problèmes du monde actuel en découlent. Ne parlons pas des Kurdes, peuple à cheval sur quatre Etats (le cas des Basques est analogue). Ne parlons pas des Ouïghours, peuple musulman égaré en Chine (mais aussi, que sont-ils allés faire dans cette galère ?).
Ne parlons pas des Ecossais, qui sont en train de préparer leur sécession de la couronne britannique. Ne parlons pas des Flamands ou des Slovaques. Ne parlons pas des Catalans, qui vivent sur un trou financier, mais que ça n’empêche pas de réclamer l’indépendance de la province. Et qui abolissent la corrida parce qu’ils la considèrent comme espagnole. Au fait, jusqu’où va la Catalogne, au nord de la frontière ? Perpignan ? Narbonne ? Je ne me rappelle plus où commencent les panneaux routiers bilingues.
Le point de départ de l’identité, c’est au total deux affirmations : « Nous sommes ce que nous sommes » (appartenance) et « Nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas » (différenciation). Ce qui veut dire : « Nous ne sommes pas ce que vous êtes ». Ça a l’air très bête, dit comme ça (deux atroces tautologies, pour ceux que ça intéresse), mais ça tient la route. Qui peut dire où se situe le point d’équilibre ? Y a-t-il seulement un point d’équilibre ? Ce qui est sûr, c’est qu’on peut choisir de tirer sur l’un ou sur l’autre des deux fils.
Si vous tirez le fil de l’appartenance, nul doute que vous englobez. Quoi ? Ce n’est pas le problème. Le problème, de ce côté-là, c’est que, plus vous englobez, plus vous risquez d’aller vers un ensemble hétérogène, au point, éventuellement, de passer par-dessus des différences irréductibles.
C’est ce qui s’est passé pour l’Empire Romain à l’époque de TRAJAN (53-117) : la plus grande extension, avant le démembrement (la "décadence"). C’est de l’ordre de la dénégation, du refoulement, de l’angélisme : prêcher à toute force, à genoux et les mains jointes, que l’unité règne. Par exemple, qu’est-ce qui est à l’œuvre, quand un blanc, dans une rue française, se fait traiter de « fromage blanc », ou pire, de « sale Français » ?
Si vous tirez le fil de la différenciation, nul doute que vous accusez l’épaisseur du trait qui sépare. ANDERS BERING BREIVIK, le Norvégien massacreur, a tiré ce fil-là (et tiré sur tous ceux qui militent pour une appartenance toujours plus grande, je veux parler d’une certaine gôche métissante à tout crin, vous savez, la tarte à la crème de tout ce qui se veut et se prétend « sans frontières »).
Il y a un début d’hostilité dans le simple fait d’exalter sa propre différence (la revendication dite « identitaire » : « Je ne suis pas ce que tu es », « Nous ne sommes pas ce que les autres sont », étrangère, pour l'instant, à toute idée de supériorité de "je" ou "nous" sur "tu" ou "les autres").
Le point extrême de la différenciation, c’est évidemment le concept de « pureté de la race », avec toutes les implications qu’on a pu observer dans l’histoire du 20ème siècle. L’autre point extrême, qu’on pourrait appeler « la grande appartenance », ou « tout est dans tout (et réciproquement) », c’est ce qui a été baptisé du noble nom de « métissage ».
Le grand laboratoire grandeur nature de la pureté de la race, c’est, comme chacun sait, l’Allemagne hitlérienne. Pas besoin d’épiloguer. Le grand laboratoire grandeur nature du métissage se trouve, quant à lui, en Amérique latine, sorte de concentré de tous les continents. L’Argentine n’a-t-elle pas eu un président nommé NESTOR KIRCHNER (nom germanique) ? Le Pérou, en 1990, a élu au même poste ALBERTO FUJIMORI (nom japonais). L'actuel Bolivien EVO MORALES AYMA (nom amérindien) est d’origine Aymara. Toute l’onomastique latino-américaine reflète ce qui a bouillonné dans ce chaudron.
Le problème de l’identité nationale française, tel qu’il se pose aujourd’hui, est là. Qu’elle se dilue, cela ne fait guère de doute. On peut faire pousser dans son jardinet les reliques que l’on veut. Mais à propos de l’identité nationale française, cela s’en va, si j’ose dire, par « en haut » et par « en bas ».
Par en haut, c’est évidemment toute la supranationalité qui tend à s’imposer aux membres de l’Union Européenne en général, à la France en particulier. Par en bas, c’est ce qui nous vient à la fois de la double nationalité (un petit peu) et du regroupement familial (très beaucoup). Ajoutons, pour faire bonne mesure, la naturalisation, et le million de nouveaux citoyens, qu'elle ajoute aux Français tous les 11 ans environ (à peu près 85.000 par an).
Qu’est-ce qui domine la scène, sur ce plateau ? Difficile à dire. D’un côté, vous avez JEAN-FRANÇOIS COPÉ (et une forte partie de l’UMP) qui parle de « racisme anti-blanc », et qui dénonce le fait d’arracher à un collégien (une collégienne ?) son pain au chocolat, sous prétexte qu’on est en ramadan. Visiblement, le monsieur en question tire sur le fil de la différenciation et privilégie l’aspect identitaire. Et c'est vrai que le laïciste que je suis réagit très mal à l'irruption du religieux (fortement teinté de politique) dans notre espace public.
De l’autre côté, vous avez FRANÇOIS HOLLANDE (et tout le Parti Socialiste, en plus de quelques gauchistes et chrétiens sociaux au grand cœur) qui, en tant qu’universaliste et « porteur de valeurs », propose d’accorder le droit de vote aux étrangers dans les élections locales.
Vous avez RESF (réseau « éducation sans frontières ») et autres associations humanistes, qui luttent contre les centres de rétention, l’expulsion des enfants d’immigrés scolarisés, le sort fait aux sans-papiers. Soit dit en passant, ce sont les mêmes qui s’apprêtent à défaire l’institution du mariage en l’ouvrant aux homosexuels, sous prétexte d’ « égalité ». C’est vraiment bizarre, ce que c’est devenu, « être de gauche » : éliminer à toute force tout ce qui différencie, hiérarchise, distingue, "discrimine".
Il me semble que c’est dans Les Origines du totalitarisme (Gallimard « Quarto », 2002) que HANNAH ARENDT déclare que l’époque de l’impérialisme (= déversement de capitaux et de populations européens superflus sur le reste du monde, environ 1850-1900) est celle du déclin des Etats-nations. Peut-être a-t-elle tort, après tout. Mais est-ce bien sûr ?
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que les capitaux sont en train d’achever la planète, et que les populations sont de plus en plus superflues. Alors, dans ce magma, vous pensez, l’identité nationale française ! …
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon bloy, littérature, france, nation politique, société, identité nationale, nationalité, etat, kurdes, basque, ouïghour, chine, écossais, flamands, catalans, catalogne, empire romain, trajan, anders breivik, norvège, métissage, argentine, nestor kirchner, pérou, alberto fujimori, bolivie, evo morales, amérindiens, union européenne, europe, jean-françois copé, ump, françois hollande, parti socialiste, hannah arendt, les origines du totalitarisme, identitaires, identité française
mercredi, 06 juin 2012
EURO URGENCE
Je glisse ce billet impromptu parce qu'il faut très vite diffuser la vidéo de cette conférence de MYRET ZAKI et ETIENNE CHOUARD, pour faire connaître à tout le monde les vrais ressorts de la guerre de l'euro qui est en train de se livrer, et qui a bien des chances de ruiner l'Europe. Attention : ça dure deux heures et demie. Mais ça en vaut la peine !!! Le titre exact est "L'Etat et les banques : les dessous d'un hold-up historique". C'est du brutal. Pour ceux qui n'ont pas le temps, n'allez pas jusqu'à l'intervention de ETIENNE CHOUARD, un peu trop exalté à mon avis, et concentrez-vous sur le quart d'heure de MYRET ZAKI. A mon avis, PAUL JORION lui-même est dépassé. C'est dire où on en est.
11:52 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : myret zaki, éienne chouard, économie, ultralibéralisme, banque, finance internationale, spéculation, union européenne, guerre économique

