dimanche, 24 novembre 2019
UN POISON EST UN POISON
LA SCANDALEUSE, L'INSUPPORTABLE CHARGE DE LA CHARGE DE LA PREUVE : UN POISON EST UN POISON.
Un des trucs les plus ahurissants, dans les « questions de société » tournant autour des problèmes d’environnement, est la sommation qui est faite aux défenseurs de l’environnement d’apporter la preuve juridique, donc la preuve scientifique, que c’est bien LE produit qu’ils incriminent qui est à l’origine de la grave maladie qui touche le technicien agricole qui a été payé pour le répandre.
En toute logique un peu humaniste, on attendrait plutôt que ce soit à l'inventeur de substances chimiques potentiellement dangereuses que devrait incomber l'obligation d'apporter la preuve scientifique (j'insiste : scientifique) que son produit n'a pas d'effets indésirables en dehors de son action sur la "cible" visée, en particulier qu'il ne représente pas une nuisance pour le reste de l'environnement ou une menace pour la santé des humains.
La logique et le simple bon sens, avant toute recherche de causalité entre un produit donné et une maladie contractée à son contact, commanderaient qu'on exige du producteur de chimie une preuve d'innocuité de son produit pour tout ce qui n'est pas la cible visée. Il faut imposer la charge de la charge (si si !) de la preuve à l'auteur du mal, selon le principe "pollueur-payeur". Oui, je sais, dire ça, c'est rêver tout debout.
Car j'ai tout faux : dans notre système où tout est fait pour favoriser le développement industriel, c'est à la victime potentielle ou éventuelle du produit mis sur le marché de prouver scientifiquement la nocivité de celui-ci et le lien de cause à effet qui existe entre celui-ci et la maladie dont il souffre. Un vrai scandale. Cette logique soi-disant juridique, c’est le comble du cynisme, de la perversion intellectuelle et de la mauvaise foi : celui qui fabrique le poison sait que c’est un poison.
Alors bien sûr, il vous affirme que, attention, c’est un bon poison, tout à fait capable d’éviter au cultivateur de courber l’échine pour arracher les mauvaises herbes ou de monter la garde devant ses champs le fusil à la main pour en interdire l’accès aux insectes ravageurs. Moi je dis : un poison est un poison.
On aura beau enrober la réalité de toutes les chamarrures les plus rutilantes, je reste accroché à ce truisme comme un morpion à son poil : un poison est un poison. Quoi, me réplique le chimiste, mais vous n’avez rien compris : ce n’est pas un poison destiné à exterminer les humains. Merci bien, que je lui rétorque, mais pouvez-vous fournir la preuve qu’il tue ce qu’il doit tuer à l’exclusion de tout autre être vivant ? Vous avez peut-être entendu parler de Marie-Monique Robin, qui a écrit Notre Poison quotidien (La Découverte-Arte éditions, 2011-2013). Voici ce qu’elle affirme : « Les pesticides ratent largement leur cible, mais n’épargnent pas l’homme » (p.113).
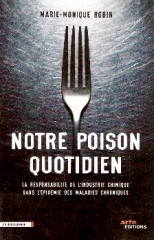
Le livre de Marie-Monique Robin vous dit tout.
Alors là, le chimiste est un peu embêté pour répondre : il faut savoir ce qu’on veut. Vous voulez nourrir les humains ? C’est que le chimiste sait ce qu’il a fabriqué : il n’a aucune envie qu’on lui rappelle le chaudron du diable d’où sont sortis tous ces charmants produits qu’on regroupe aujourd’hui sous le nom de « pesticides ». Ce que le chimiste n’aime pas trop qu’on rappelle, c’est que toutes ses belles inventions « agricoles » proviennent d’une seule et même matrice : les gaz de combat.
Et il faut rendre à César, je veux dire à Fritz Haber, la paternité de ces petits joyaux qui ont vu le jour au cours de la guerre de 1914-1918 : « Le 22 avril 1915, l’armée allemande lâche 146 tonnes de gaz à Ypres (Belgique) sous la direction du scientifique, qui n’hésite pas à se déplacer sur le front pour superviser les attaques chimiques. C’est lui qui a organisé l’installation secrète des 5.000 fûts de chlore, sur une distance de six kilomètres, et ordonné qu’on ouvre les robinets, à 5 heures du matin. » (Marie-Monique Robin, p.37). C’était pousser bien loin le patriotisme et la conscience professionnelle.
Non content d’avoir procuré aux militaires allemands de quoi éliminer sans effort leurs ennemis, il a théorisé l’action de ces substances, en établissant une équation, connue sous le nom de « loi de Haber » : « Pour chaque gaz de combat, la quantité C présente dans un mètre cube d’air est exprimée en milligrammes et multipliée par le temps T exprimé en minutes qui est nécessaire pour obtenir un effet létal sur l’animal expérimental inhalant cet air. Plus le produit C x T est petit, plus la toxicité du gaz de combat est grande » (id., p.39).
A noter que l’académie Nobel n’hésite pas à remettre en 1920 son prix de chimie à Fritz Haber, au titre de l’année 1918 « pour la synthèse de l’ammoniac à partir de ses éléments », ce qui suscite, selon M.-M. Robin, un « tollé dans la communauté scientifique internationale », outrée de voir récompensé un criminel de guerre.
Quoi qu’il en soit, le monsieur reste connu pour avoir, après la guerre, voué son énergie à venir en aide aux pauvres cultivateurs, confrontés à des ennemis implacables dans leur effort de production d’aliments pour les vivants : les herbes folles et les insectes ravageurs. Le sinistre Zyklon B lui-même est au départ un insecticide (breveté par Walter Heerdt, ancien collaborateur de Haber).
Pour retracer l’historique de la façon dont l’industrie chimique a imposé sa marque de fabrique à toute l’agriculture, je renvoie au livre absolument indispensable de Marie-Monique Robin. Je ne veux retenir ici que deux points : 1 – l’origine des pesticides agricoles est à chercher dans les gaz de combat inventés par l’industrie chimique allemande à partir de 1914 ; 2 – les pesticides agricoles ont été inventés à la base par un CRIMINEL DE GUERRE. Il faudrait que cela soit inscrit sur tous les bidons des saloperies que les agriculteurs actuels, de gré ou de force, répandent sur leurs cultures : CECI EST UN GAZ DE COMBAT INVENTÉ PAR UN CRIMINEL (vous verriez le succès sur les bidons de glyphosate).
La question suivante concerne les modalités d’arrivée dans les circuits commerciaux de ces substances dont tout le monde sait qu’elles sont faites pour tuer, en général de façon indiscriminée. Parce qu’il en faut, théoriquement, des autorisations officielles, pour mettre sur le marché des produits destinés à tuer. C’est sûr que la machine industrielle de la chimie dispose d’outils de persuasion sur les autorités politiques et administratives avec lesquels les sciences médicales ne sont pas en mesure de rivaliser. D’abord il faut du fric pour mener des études sérieuses et incontestables. Ensuite, il faut avoir laissé au temps le temps de produire ses effets sur les organismes vivants pour qu'on puisse éventuellement les mesurer. Enfin, il faut que quelqu'un ait eu l'envie, l'énergie et les appuis nécessaires pour s'engager dans la voie pénale s'il estime avoir été physiquement lésé.
De leur côté, les autorités politiques et administratives ne s’opposeront jamais à des innovations présentées comme apportant un progrès décisif dans les moyens de nourrir des masses de plus en plus massives de populations. D’une part, elles voient ce qu'elles considèrent peut-être comme l’intérêt général, de l’autre elles supputent les atouts nationaux dans la grande compétition économique internationale, où il serait stupide de se priver de cartes maîtresses. Elles se répètent peut-être ce vieux dicton : « Un petit mal pour un grand bien ». C’est pour ces deux raisons que les autorités autorisent.
Il y a, je crois, une dizaine d’années, on a parlé au sein des instances européennes de régulation d’un projet qui portait le doux nom de REACH. L’affaire consistait à établir une « carte d’identité » pour chacune des cent mille (100.000) molécules chimiques qu’on peut trouver sur le marché, histoire de mettre un peu d’ordre dans le merdier, je veux dire de classer les molécules en fonction de leur innocuité ou de leur nocivité sur la qualité de l’environnement et sur la santé humaine.
L’intention était belle et bonne : on allait enfin y voir un peu clair et savoir à quoi s’en tenir ! On allait enfin pouvoir se fier à une grille d'évaluation de l'efficacité de toutes ces molécules en libre circulation, à commencer par leur toxicité et leur éventuelle nocivité en dehors du cercle prescrit de leurs applications. Résultat de l'accouchement de la montagne promise : un souriceau malingre.
C’est là qu’intervient la puissance de feu de l’industrie chimique, en matière d’influence et d’entrisme dans les circuits administratifs et politiques européens qui mènent à la décision : interdire ou autoriser ? Et c’est là que la lâcheté des circuits administratifs et politiques va se donner libre cours : c’est vrai qu’il faut penser à la bonne santé des populations qui nous ont élus ("nous ne pensons qu'à ça"), mais d’un autre côté, si l’industrie est en bonne santé et si les affaires marchent, c’est aussi bon pour notre pays, serinent-ils la main sur le cœur.
Alors ? C'est ce qu’on appelle un « dilemme ». D’autant que les industriels ne manquent pas d’ « arguments » sonnants et trébuchants (ça dépend du niveau de responsabilité : « Une petite salle des fêtes ? », « Un terrain de sport ? », etc., difficile de refuser : c’est pour vos électeurs, donc tout bénef pour vous).
Ensuite ? C’est le problème de tous les vendeurs au porte-à-porte : savoir se présenter, trouver les mots, persuader. En français : habiller la chose réelle d’un costume impeccable pour la rendre présentable. Et si ça ne suffit pas, un chouïa d’intimidation, un doigt de chantage, un zeste de manœuvres en coulisse, et le tour est joué.
En l’occurrence, l’argument-massue consiste en une formule imparable et bien connue du temps du Général : moi ou le chaos ! Les paysans français le clament à tous les vents : sans glyphosate, on court à la catastrophe ! Et dans les circuits administratifs et politiques, en France et en Europe, ça marche ! Il n'est pas impossible que ce soit vrai, mais tout est dans la conception générale de l'agriculture (à taille industrielle ou humaine ?) et dans l'idée que l'on se fait de l'alimentation humaine.
A la fin des fins, qu’est-ce qui reste ? La réponse est brutale et sans ambiguïté : il reste les poisons. IL RESTE LES POISONS. La chose fait d'ailleurs les titres régulièrement dans les bulletins d'information : dernièrement, on a vu que 100% des volontaires ayant participé à une étude ont des urines parfumées au glyphosate (et qu'en est-il dans les cheveux ? Dans le sang ? Dans les glandes ? Dans l'intestin ? etc.).
Tout le travail de l’agriculture industrielle et de la chimie qui l’alimente consiste en ceci : faire admettre à la « société » un empoisonnement général, au prétexte que les doses sont infinitésimales. Autrement dit, il faut que les populations acceptent de se laisser empoisonner à petites doses si elles veulent continuer à manger. Tout le reste est littérature. Aucune civilisation avant la nôtre n'avait autant, je crois, fondé son existence sur la consommation universelle de poisons. Notre civilisation a innové en inventant l'empoisonnement général consenti.
Car pour les autorités et les industriels de la chimie, y a un « seuil d’admissibilité psychologique ». Les populations y étaient déjà prêtes, shootées à toutes sortes d'objets, de produits concrets et virtuels et de substances plus ou moins volatiles. Sachant cela, le concept a été vendu (efficacement) par l’industrie chimique aux responsables administratifs et aux décideurs politiques sous l’appellation flatteuse de « Dose Journalière Acceptable » (ou D.J.A. : les curieux peuvent trouver la preuve de l’imposture en lisant le chapitre 12 de Notre Poison quotidien de Marie-Monique Robin, pp.235-259). Mais les vigilants ont beau dire ça aux populations, celles-ci s'en foutent : il leur faut leur dose journalière (D.J.A.) de poison. Ce n'est pas pour rien qu'une nouvelle discipline a pris de l'ampleur au point que le mot s'est banalisé : l'addictologie (cannabis, casino, jeux vidéo, alcool, etc.).
Extension floue du dogme bien commode hérité de Paracelse « Seule la dose fait le poison », la D.J.A. a le gros défaut de faire abstraction de trois facteurs que les chimistes trouvent bien embêtants et qu’ils s’efforcent de glisser sous le tapis : 1 – l’action des très faibles doses (par exemple du Bisphénol A : M.-M. Robin, chapitre 18) ; 2 – le moment et la durée de l’exposition (femmes enceintes, techniciens agricoles, …) ; 3 – les interactions entre substances, dont la seule étude serait en soi un casse-tête méthodologique pour les scientifiques (on appelle aussi ces interactions « l’effet cocktail »).
Moralité : non seulement les industriels font tout pour mentir (minimiser et déguiser les risques qu’ils font courir à la santé des gens), mais en plus, ils gardent le silence le plus religieux sur les « menus détails » qui constituent autant de trous dans le tissu de la connaissance scientifique. Et ce sont ces imposteurs, appuyés en cela avec enthousiasme ou résignation par tous les responsables et décideurs, qui exigent de leurs accusateurs qu’ils fournissent une preuve irréfutable du lien de causalité entre leur produit et le cancer apparu vingt ans après chez le technicien agricole qui l’a consciencieusement répandu pendant toute la durée.
J’en conclus, avec maintenant pas mal de gens, qu’il y a dans cette façon de procéder quelque chose qui s'apparente au crime contre l’humanité. Mais un crime contre l'humanité commis avec le consentement des victimes.
Il faut trouver le moyen de criminaliser l'empoisonnement des sols et des populations par une industrie chimique innocentée avant tout examen de sa responsabilité. Un beau procès de Nuremberg en perspective. Dans combien de siècles ? Et combien d'accusés ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, marie-monique robin, notre poison quotidien, poison, protocole expérimental, dja, dose journalière acceptable
lundi, 02 avril 2018
DOCTEUR, COMMENT VA LE MONDE ?
27 février 2018
Des nouvelles de l’état du monde (19).
(Voir ici billet 18.)
Nous en étions ici : le monde va de mieux en mieux, disent les indécrottables optimistes ; le monde va vers sa perte, soutiennent les insupportables pessimistes. Pour en finir avec cette lutte fratricide et savoir une fois pour toutes qui a tort et qui a raison, en homme de l’art consciencieux, nous prenons quelques températures et quelques tensions à droite et à gauche, dans l’espoir que l’ensemble des données sera un indicateur fiable.
Nous étions donc en présence d’un patient : le monde. C’est au nombre des alertes qu’on évaluera son état de santé, c’est à l’intensité de l’effort humanitaire qu’on mesure la violence qui s’abat sur le monde, c’est à l’intensité du bruit qu’elles produisent qu’on mesurera l’étendue de la prise de conscience, et c’est à la vitesse dont les trajectoires s’infléchissent et dont les corrections s’effectuent que l’on supputera les chances de guérison. Aujourd’hui, on parle de l’état de santé physique de la planète.
2 – Le symptôme planétaire.
Oui, bien sûr, il y a le réchauffement climatique. On sait. On sait tout, en fait. Et c’est ça qui effraie le plus : le pire, avec le réchauffement, c’est qu’on sait tout, et que ça ne sert à rien. Oui, on nous bassine avec le réchauffement, mais il n’y a pas besoin d’avoir vu Al Gore sur scène, dans son film Une Vérité qui dérange, actionner son élévateur de chantier pour mettre en évidence la radicale rupture de pente de la courbe montrant l’augmentation vertigineuse (en rythme géologique) de la courbe des températures moyennes.
Le réchauffement, aujourd’hui, on est largement au courant : il suffit de regarder ce que sont devenus en quelques dizaines d’années, rien que chez nous, le glacier d’Argentière, la Mer de glace, le glacier des Bossons, le glacier de Taconnaz. Et puis la banquise. Et puis le Groenland. Et puis les glaciers de l’Himalaya. Et puis l’Antarctique. Et puis les Maldiviens, à qui il arrive d'avoir de l’eau jusqu’aux genoux. Oui, on sait que des centaines de millions de gens habitant dans les régions littorales du globe seront chassés de chez eux : devinez l’ailleurs où ils essaieront d’aller vivre mieux.
Le réchauffement, aujourd’hui, on sait aussi que c’est l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes : ici des sécheresses toujours pires que les précédentes, là des inondations de plus en plus catastrophiques, ailleurs des cyclones, ouragans ou typhons de plus en plus dévastateurs, jusque sous des latitudes jamais vues auparavant (l’Irlande à la fin de 2017). Chez nous, espèces animales et végétales migrent vers le nord. Un effet secondaire parmi d’autres : certains vins de la vallée du Rhône se mettent à titrer couramment 14,5°, et l’on a commencé à planter des vignes au sud de l’Angleterre ! Le réchauffement, ça se voit à l’œil nu !
Des cris d’alarme, oh ça, il y en a eu ! Mais encore aujourd’hui, on peut appeler ça « Vox clamans in deserto » : il y en a eu, des Bernard Charbonneau, des Jacques Ellul, des Günther Anders, pour alerter sur les dégâts humains, sociaux et environnementaux qu’entraîne la civilisation technicienne, mais ces voix ont crié dans le désert. Les Amis de la Terre, La Gueule ouverte, tous ceux qui voulaient vivre autrement, on les prenait en général pour des agités du bocal, des illuminés, des communautaristes barbus retournés à la terre, des antinucléaires fanatiques, des Larzaciens antimilitaristes. Quarante ans après, on sait qu’ils avaient raison, les allumés !
Et s’il n’y avait que le réchauffement, ce serait moins pire. Mais on sait aussi, depuis Chirac, que « les emmerdes, ça vole en escadrille ». Parce que la « civilisation technicienne » forme un système cohérent, dont les divers aspects, qui n’ont en apparence aucun lien entre eux (je dis à ma main droite d'ignorer ce que fait ma main gauche, et pareil pour les pieds, les narines, les oreilles, les yeux, ...), s’entendent comme larrons en foire pour produire des effets qui, loin de se contrarier, agissent de concert.
C’en est au point qu’on pourrait voir (rétrospectivement) dans toute l’histoire de notre si belle « civilisation technicienne » la simple histoire d'une destruction méthodique : à partir du moment où le propre, l’essence, le fondement, j’allais dire le destin de la civilisation s’incarne dans la technique, au point de s'y résumer, la limite de l’effort humain est abolie et les folies de l’homme peuvent alors se donner libre cours. Vue comme ça, l’histoire du « Progrès technique » après la révolution industrielle, c’est celle de la mise en œuvre d’une malédiction collective. L’histoire d’un suicide massivement consenti.
Ce n'est pas complètement faux : tant que la vitesse à laquelle on peut se déplacer n’est pas en mesure de dépasser celle du pas de l’homme ou du cheval (le vent sur mer), une nécessité absolue s’impose au monde, que nul génie de la technique n’a enfreinte depuis les origines. L’avènement du moteur (à vapeur, à pétrole, à ce qu'on veut) fait croire à l’humanité qu’elle est tout d’un coup entièrement et définitivement débarrassée de cette basse et humiliante contingence qui entravait ses ambitions. Comme dit l'autre, "Passées les bornes, y a plus de limites".
L’accélération constante de la vitesse à laquelle on se déplace abolit la frontière qui définit les limites de l’homme. Le moteur – multiplicateur de puissance – libère l’humanité de sa dépendance des forces naturelles. Avec le moteur, l’humanité n’en a plus rien à faire, de la nature. Le moteur, et avec lui l’alimentation en énergie, est une arme de destruction massive. L'homme se croit tout-puissant et fabrique une source d'énergie (le nucléaire) dont les dangers potentiels dépassent toutes les pauvres parades qu'il pourrait inventer pour en limiter les dégâts (Tchernobyl, Fukushima, et bientôt le site de Bure et ses réserves de radiations pour quelques milliers d'années à venir).
La différence avec toutes les époques qui ont précédé l'avènement de la société industrielle (vers 1750) est nette. Car si les activités humaines – mettons depuis le néolithique – provoquaient des nuisances, celles-ci (mégisseries, tanneries, ...), circonscrites dans un périmètre limité, n’avaient rien à voir avec ce qu’a apporté la production industrielle de biens destinés à satisfaire les besoins.
La notion de « besoin » elle-même s’est trouvée chamboulée : puisqu’on est capable de produire plus que le nécessaire (c’est-à-dire trop), grâce au moteur et à l’énergie, il est désormais nécessaire d’écouler la marchandise excédentaire, éveiller de nouveaux désirs, inventer des besoins. C’est le rôle de la publicité : susciter une consommation qui puisse justifier la production de biens en masse. Il faut se poser la question : « Qu’est-ce qu’on pourrait inventer qui puisse être vendu en masse aux masses ? ». Une façon de lancer la course désespérée à l’innovation la plus innovante.
Une société de gavés en même temps qu’une société de frustrés, puisque la limite du désir se situe toujours (un peu ou très) au-delà de l’envisageable. Même pas besoin de s’appesantir sur la marchandisation de tout, l’accumulation du capital et autres fadaises liées à la matérialisation infinie de la civilisation ou aux appétits de richesse : le franchissement indéfini des limites est inscrit dans la motorisation de l’espèce humaine. La saturation de l’espace disponible de la planète est inscrite dans la première révolution industrielle et dans la course à la production.
Tous les êtres et toutes les choses doivent être mis à contribution pour la grande marche vers le plus. Tout ce qui entrave l’augmentation et la croissance doit être combattu par tous les moyens. Tout ce qui permet de gagner en temps, en argent et en efficacité économique doit être privilégié. Tout ce qui est humain doit devenir fonctionnel, productif et lucratif, pour que l’humanité puisse un jour ressembler à la parfaite machine à produire. Tout ce qui est la Terre doit cracher des richesses.
Jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Il n'y a pas très longtemps (Le Monde, 14 novembre 2017), les scientifiques se sont mis à quinze mille (15.000) pour sonner le tocsin de l'urgence. 15.000 personnes qui savent de quoi elles parlent ont poussé un cri : il y a urgence !

En 2011, les éditions La Découverte (+ Arte éditions) publiaient Notre Poison quotidien, de Marie-Monique Robin, celle-là même dont un documentaire célèbre ferraillait contre la firme tentaculaire Monsanto. L'auteur énumère dans son livre bourré d'informations tout ce que les industriels de la chimie s'entendent pour injecter dans ce que nous mangeons, végétal ou animal.

En octobre 2017, François Jarrige et Thomas Le Roux vont plus loin (si l'on peut dire) : dans La Contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, ils disent (en très gros) que ce que nous appelons "pollution" n'est pas séparable de la mise en place de la production industrielle. Ils n'y vont pas de main morte, intitulant leur troisième partie "Démesure et pollution : un siècle toxique (1914-1973)".

C'est toute notre civilisation technique qui est dans l'erreur.
Voilà où nous en sommes : ça crie "Au fou !" de tous les côtés, et ça ne sert à rien. On sait tout. Tous ceux qui veulent savoir savent. Malheureusement, ceux qui savent n'ont aucun moyen d'action, et ceux qui pourraient faire ne veulent rien faire.
Alors docteur, comment va le malade ? Quel diagnostic au sujet du symptôme planétaire ?
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, l'état du monde, optimistes pessimistes, réchauffement climatique, pollution, écologistes, al gore une vérité qui dérange, fonte des glaciers, himalaya, glace groenland, banquise, phénomènes extrêmes, bernard charbonneau, jacques ellul, günther anders, les amis de la terre, la gueule ouverte pierre fournier, vox clamans in deserto, tchernobyl, fukushima, enfouissement déchets nucléaires, journal le monde, 15.000 scientifiques, marie-monique robin, le monde selon monsanto, notre poison quotidien, éditions la découverte, françois jarrige, thomas le roux, jarrige la contamination du monde
dimanche, 25 mars 2018
QU’EST-CE QU’UN ÉCOLOGISTE ? 4/4
20 octobre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (4).
4
Alors tout bien considéré, qu'est-ce qu'un écologiste ? C'est un être malheureux, mécontent d'être malheureux, malheureux d'être mécontent. Selon moi, c'est un désespéré qui aime la vie, et qui est désespéré pour cette raison : il regarde le monde réel avec un peu trop de lucidité. C'est quelqu'un qui se raconte qu'il est peut-être encore possible d'arrêter la machine infernale et qui, pour la même raison, persiste à chercher, écrire, s'égosiller, courir, gesticuler, se démener, bref : "faire quelque chose", tout en étant persuadé que non, au point où l'on en est arrivé, c'est cuit, mais qui a verrouillé cette certitude dans le cabinet secret de tout au fond, dont il a jeté la clé au motif qu'il ne faut pas injurier l'avenir. "On ne sait jamais", se dit-il à la manière de ceux qui "n'y croient pas", mais que ça n'empêche pas, semaine après semaine, de remplir leur grille de loto.
Et puis s'il fallait cesser de vivre à chaque fois que meurt un proche, on serait mort depuis longtemps, se dit-il. Voilà : est un écologiste quelqu'un qui se prépare à porter deuils après deuils et qui, pour continuer à sourire à la vie, fredonne sans se lasser : « J'ai des tombeaux en abondance, Des sépultures à discrétion, Dans tout cimetière de quelque importance, J'ai ma petite concession. » (tonton Georges). D'une certaine manière, ce que je fais ici même présentement, c'est un peu "remplir ma grille de loto" : on ne sait jamais ! C'est vous dire l'état d'esprit.
Le tableau de la « mouvance » (« sensibilité » se porte aussi assez bien cette année) écologiste que j'ai essayé depuis quelques jours de dresser est sûrement incomplet, partiel et partial. J’ai seulement voulu en parcourir ce qui m’en a semblé les principaux aspects. Quel avenir ce tableau sommaire des préoccupations écologiques laisse-t-il entrevoir pour la planète ? J’ai envie de dire que, s’il y a une indéniable prise de conscience au sein de la communauté scientifique et parmi un certain nombre de voix en mesure de résonner dans les médias (je n'ai pas dit : en mesure de faire bouger les choses), le rapport des forces en présence et la lenteur pesante de l'évolution des consciences (ne parlons pas des intérêts en jeu, qui font résolument barrage) laissent mal augurer de nos lendemains.
Qu’est-ce qui autorise un tel pessimisme ? D’abord la faiblesse structurelle due à l’inorganisation du camp des défenseurs de l’environnement. J'ai dit pourquoi hier, en parlant de la relation au pouvoir. Car les défenseurs sont multiples et hétérogènes, aussi multiples et hétérogènes que les problèmes qui menacent la survie de la vie sur terre. Car il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie, il faut varier les plaisirs : il y a aussi l'agonie des sols cultivables de la planète, due à un productivisme agricole halluciné, qui consomme frénétiquement toutes sortes d'intrants chimiques (voir les travaux de Claude Bourguignon, ingénieur agronome) ; il y a, depuis trente ans en Europe, la division par cinq (- 80 %) des effectifs d'insectes volants, vous savez, ceux qui s'écrasaient sur les pare-brise, forçant l'automobiliste à s'arrêter souvent pour le nettoyer (je vous parle d'un temps que les moins de ...), catastrophe pour laquelle les scientifiques incriminent les mêmes intrants ; il y a la déforestation massive de certaines régions au profit de plantations autrement plus rentables (palmier à huile, eucalyptus, végétaux OGM, ...) ; il y a l'acidification de la surface des océans, qui rend problématique la survie des récifs coralliens et des planctons ; il y a l'empoisonnement de la chair des hommes par toutes sortes de molécules chimiques, qui n'est sûrement pas étranger à l'explosion des maladies chroniques, dont le cancer (les spécialistes parlent d'une épidémie : voir Notre Poison quotidien, de Marie-Annick Robin, La Découverte, 2013) ; il y a la mortalité humaine due à la pollution : neuf millions de personnes en 2015, selon une étude qui vient de paraître dans The Lancet, la grande revue scientifique britannique. Il y a ... Il y a ... Il y a ... Tout ça, ça fait des combats disparates, des luttes manquant de cohérence, des résistances tirant à hue et à dia. Cela ne fait pas une force.
Le changement climatique reste quand même la menace la plus globale et la plus visible (voir les ouragans récents, dont le dernier, certes dégradé en "tempête tropicale", a frappé l'Irlande (une tempête tropicale sur l'Irlande !!! Et peut-être bientôt « un oranger sur le sol irlandais », salut Bourvil), après avoir suivi une trajectoire qui sidère les météorologistes !), mais la guerre des hommes contre la planète a bien d'autres visages. Et cette guerre a été déclarée il y a un peu plus de deux siècles, quand les progrès techniques et le machinisme naissant ont opéré le passage d'une économie de subsistance à une économie de production de masse. Il paraît clair que l'accroissement de la puissance économique a été fidèlement suivie comme son ombre par un accroissement identique et synchrone de la pollution et de la dégradation des environnements. En bout de course, plus les pays du monde ont été nombreux à s'industrialiser, plus se sont multipliés les agents destructeurs. Plus l'homme a créé des richesses, plus il a nui à la nature.
C’est maintenant indéniable : la gravité et l’intensité des pollutions découlent directement de la croissance industrielle. C’est l’industrie sous toutes ses formes qui nous a donné les agréments dont nous jouissons depuis toujours. C’est l’industrie qui, pour nous offrir tant de biens, a opéré, dans le même mouvement, la dévastation de la biosphère, dont nous voyons aujourd’hui la gravité. La pollution est directement le prix que nous faisons payer à la planète pour acheter notre confort. Plus nous vivons confortablement, plus nous sommes nuisibles : voilà l'équation.
Pour être sûr de la chose, il suffit de regarder les changements intervenus en Chine depuis quarante ans : plus le pays s'est enrichi et industrialisé, plus massives ont été les pollutions. La Chine a expérimenté en quatre décennies ce que les pays anciennement industrialisés ont fait en deux siècles. Les atteintes à l'environnement sont à la mesure de la démesure du pays (l'Inde suit à petite distance : à eux deux, une petite moitié de l'humanité). Peut-être pour ça que c’est en Asie que la prise de conscience est la plus rapide au niveau de la population, peut-être aussi des dirigeants. C'est d'autant plus urgent que, si la planète pouvait supporter le "développement" à l'époque où il concernait cinq cent millions de "privilégiés", elle menace de crever la gueule ouverte au moment où chacune des sept milliards de fourmis qui encombrent sa surface se mettent à rêver de "vivre à l'américaine".
Quid des populations occidentales ? Laquelle (moi compris) est prête à renoncer à quoi que ce soit de son confort et de ses facilités quotidiennes ? Quid des industriels, lancés dans la féroce compétition mondiale ? Lequel est disposé à se rogner les griffes pour faire plaisir aux écologistes ? Quid des financiers, traders et autres spéculateurs, dont l’unique obsession est de faire grimper toujours le taux de leurs profits ? Lequel de ces vautours est prêt à dire : « J’arrête » ? Tout cela fait système : chacun des éléments tient à tous les autres et n’existe que parce que les autres existent. En un mot, chacun des éléments est solidaire de tous les autres. Quand une machine est ainsi construite, allez donc la mettre en panne ou, simplement, la ralentir dans sa marche.
Qu’y a-t-il en face de ce monstre compact ? Des forces dispersées, plus ou moins vaguement organisées. Le GIEC ? On demande aux scientifiques de conduire des recherches et de produire des rapports. Pas de prendre les décisions que ces rapports appelleraient. Les ONG ? Elles peuvent avoir une influence éventuelle, c’est certain, mais ont-elles seulement le pouvoir d'infléchir la trajectoire ? Greenpeace tire un feu d’artifice dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom ? La belle affaire : c’est mauvais pour l’image d’EDF, mais quoi d'autre ? Tout le monde a déjà oublié.
Les associations de militants ? Mais chacun des GPI ("Grands Projets Inutiles", genre ND des Landes, Lyon-Turin, …) voit se former à chaque fois des associations à objet spécifique, déconnectées de toutes les autres : comment ces forces éparpillées pourraient-elles se fondre en un ensemble qui pourrait rivaliser en cohérence et en puissance, mettons avec un animal aussi stratégiquement structuré que le Forum de Davos (on pourrait encore mieux parler du groupe Bilderberg, ou même de la Trilatérale, qui en est l'émanation), où les membres de la fine fleur des élites mondiales se tiennent par la barbichette, se serrent les coudes et ricanent au spectacle des petits agités qui prétendent les empêcher de danser en rond ? Les vaguelettes de surface n'ont jamais mis en danger les gros navires. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à observer la vitesse à laquelle la limace européenne s'achemine vers l'interdiction du glyphosate. Sans parler de la brusque volte-face du clown américain en matière de réchauffement climatique.
Que peut-on faire en définitive pour s'opposer efficacement au processus global de cet ordre des choses ? D'excellents esprits disent, au motif qu'il faut toujours "finir sur une note d'espoir" : « Il ne faut pas se décourager. Il faut garder l'espoir. Tout est toujours possible. Nul ne connaît l'avenir. » (Hubert Reeves, Paul Jorion et plein d'autres volontaristes). Mais je ne suis pas volontariste. Je suis de l'avis de Günther Anders parlant d'Ernst Bloch, l'auteur de Le Principe Espérance : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer ». Je crois au contraire qu'il faut avoir le courage de cesser d'espérer : l'espoir est une telle machine à entretenir l'illusion qu'il rend aveugle sur ce qui est possible, ici et maintenant. Cette philosophie n'est pas confortable, j'en conviens, mais c'est la seule qui vaille : cessons de nous projeter dans l'avenir, et occupons-nous du présent, si c'est possible.
Et au présent, que peut-on faire ? Pas grand-chose, je le crains. Et si lentement ! La tâche est démesurée, et chacun se demande par quel bout commencer et quel fil il faudrait tirer pour faire obstacle au pire. Toutes ces montagnes à soulever ! Et pour obtenir quel résultat ! Et si encore la "croissance" se déroulait dans une atmosphère paisible et tranquille ! Mais pensez-vous ! Partout, c'est la concurrence, la compétition, le conflit, la guerre. Non, franchement, tout bien considéré, c'est mal parti. La destruction fait partie du programme.
D’accord, je ne suis pas un optimiste, mais j’ai le pessimisme un peu argumenté malgré tout. Non, ça ne me console pas. Bien obligé de faire avec. Ce qui me console, c'est ce rouge du domaine Gallety 2015 (un Saint-Montan) qui arrosait l'autre jour un sublime brie à la truffe de chez Galland, en même temps que les amygdales de quelques lurons pas tristes.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologistes, georges brassens, ballade des cimetières, grille de loto, tonton georges, claude bourguignon, inra, ogm, monsanto, marie-annick robin, notre poison quotidien, changement climatique, pollution, chine, giec, étude du climat, centrale nucléaire cattenom, greenpeace, grands projets inutiles, lyon-turin, forum de davos, groupe bilderberg, trilatérale, union européenne, donald trump, domaine gallety, saint montan, notre-dame-des-landes

