samedi, 15 juin 2019
ECOLOGIE = ANTICAPITALISME 2/2
2
Donc l’anticapitalisme dont je parle n'est en rien "communiste", mais exclusivement écologique, et l'écologie authentique dont je parle est exclusivement anticapitaliste, sachant qu'il ne s'agit ici en aucune manière d'un choix "politique" au sens pépère (= gauche/droite), tout au plus d'un choix politique, au sens où l'entendaient les Grecs, impliquant la décision de tout le corps social dans le choix de son organisation et de son mode de vie.
Car le seul, l'unique, l'exclusif coupable des crimes écologiques actuels (pillage des ressources, destructions innombrables, poubellisation généralisée, ...), c'est le capitalisme industriel et productiviste. Et ce brillant résultat a été vendu à l’humanité grâce à un argumentaire où scintillaient toutes les promesses miraculeuses : l’arracher à la malédiction biblique de la souffrance et du travail, et lui apporter tout à la fois bonheur, prospérité, confort et raton laveur.
L’économie capitaliste a atteint cet objectif, inutile de le nier, et chacun (moi compris) est heureux ou désireux de profiter de ses apports. Au passage, c'est fou ce qu'elle a pu inventer et fabriquer en matière de ratons laveurs superflus et inutiles, pour amuser, divertir, détendre, détourner l'attention, etc. Et s'enrichir. Je veux évidemment parler des "gadgets" et autres marchandises sans utilité, le raisonnement étant fondé sur : « Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver à leur vendre ? ».
Cette réussite a été rendue possible par l’invention de toutes sortes de moteurs, je veux dire de moyens de produire de la force (vapeur, pétrole, électricité, …) par des moyens artificiels (je fais abstraction du moulin à vent, de la voile ou de la roue à aube, qui ne faisaient qu’utiliser – intelligemment – l’énergie produite par la nature). Avec le moteur, l’homme a forcé la nature à lui donner infiniment plus que ce dont elle était capable spontanément.
Bien sûr, un moteur consomme le potentiel énergétique qu'on lui injecte, et la quête effrénée de sources d'énergie qui en découle est une partie cruciale du problème actuel. Toute la civilisation actuelle repose sur le moteur et son carburant. C'est sur le moteur que l'humanité a fait retomber l'essentiel de la quantité de travail. Enlevez le moteur, que reste-t-il ? Tout le monde à la réponse : de combien de moteurs nous servons-nous dans une journée ?
Le capitalisme a donc réussi, mais d'une part en réservant tous les fruits de la récolte à une infime minorité de privilégiés (pays "riches"), et d'autre part en prenant soin, tout au long de son développement, de glisser sous le tapis toutes les saloperies que la machine qu’il avait mise en route jetait à tous les vents, dans toutes les eaux, dans tous les sols et dans tous les êtres.
Il y a maintenant plus d’un demi-siècle que de grands illuminés (la liste est connue) ont été assez perspicaces pour voir que le "développement" étendu à tous les pays conduisait à une impasse, que le tapis n'était plus assez grand pour tout cacher, et que les saloperies commençaient à déborder par tous les pores de la nouvelle civilisation. Ils furent aussi assez inconscients pour proclamer cette vérité à la face du monde, en tenant pour négligeable de passer pour des rigolos ou des faux prophètes. C’est pourtant eux qui avaient raison, c’est aujourd’hui avéré. Et il est sans doute trop tard pour remédier à la folie qui a produit la catastrophe à laquelle nous assistons sans trop nous en formaliser encore (ça commence à remuer vaguement, mais concrètement ? et à quel rythme ?).
Le capitalisme productiviste et technico-industriel s'est imposé il y a deux siècles. A partir de là, il a répandu le Mal (la démesure). Nos ancêtres y ont goûté : ils ont trouvé le Mal délectable, ils en ont vu les bienfaits présents, les bénéfices futurs et, pour tout dire les « progrès » promis à l’humanité. Ils ont donc accueilli le Mal à bras ouverts, avec joie et fierté, persuadés d’œuvrer pour le Bien. Ils ont bu jusqu'à l'ivresse le philtre d'amour du progrès technico-industriel offert par Méphisto (voir le second Faust, je ne sais plus dans quelle scène), qui devait rendre l'humanité puissante et invulnérable. Tragique erreur.
Et nous-mêmes en sommes tellement gorgés qu’il est devenu indissociable de notre être. Qu'il est devenu notre chair, notre nature, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous respirons capitaliste, nous mangeons capitaliste, nous buvons capitaliste, nous forniquons capitaliste, nous déféquons capitaliste, nous dormons capitaliste, nous éduquons capitaliste, nous pensons capitaliste, etc. La moindre de nos cellules est capitaliste jusqu'au noyau. Comment logerait-on un écologiste dans ce milieu hostile ?
En un mot : chacun de nous est tout entier capitaliste, de la tête aux pieds, du sol au plafond, du cœur à la peau, du fond à la surface et de la naissance à la mort. Mieux : chacun de nous (y compris moi) est en soi un capitalisme en réduction, puisqu'il en est le produit, et militant avec ça, puisque le fait de consommer alimente le système (comment faire autrement ?). Chacun de nous se trouve dès sa naissance petit porteur de tout le capitalisme. Chacun de nous devient dès lors une parcelle vivante du système capitaliste.
Nous n'avons pas le choix : au mieux, complices taraudés par le doute ; au pire, partisans enthousiastes. Qu'ils soient velléitaires ou résolus, portés par la mauvaise conscience ou par la haine, tièdes ou bouillants, qu'ils aient la ferme intention de détruire le capitalisme ou qu'ils travaillent à le corriger ou à l'améliorer, les ennemis du système sont eux aussi pris dans le système, et du coup sont bourrés de contradictions.
Je veux dire que nous sommes tous si intimement imprégnés de ce que le capitalisme a fait du monde et des hommes qu’il est absolument inenvisageable de nous enlever la moindre parcelle du système sans nous arracher un morceau vital de chair. Nous hurlerions sous la torture. Il suffit pour s’en rendre compte de voir ce que nous coûtera l’abandon de misères telles que les touillettes, les cotons-tiges, et tous les objets en plastique à usage unique. Ne parlons pas du smartphone.
Alors dans ces conditions, tout ce que proposent sincèrement les gens conscients, actifs et responsables pour que le pire n’arrive jamais, tous les appels aux gouvernants, aux puissants, aux industriels et même aux individus, tout cela n’est que poudre de perlimpinpin, miroir aux alouettes, faux espoirs et charlatanerie. Tous les « Discours de Politique Générale » de tous les Edouard Philippe auront beau se « teinter de vert » (« Plus personne n’a aujourd’hui le monopole du vert ! », a-t-il textuellement scandé le 12 juin), on restera très loin du compte. Je dirai même : à côté de la plaque.
Et le succès de Yannick Jadot aux élections européennes reste, sur le planisphère des activités humaines, une voie de garage, même s'il indique la persistance d'un sentiment de culpabilité des populations à l'égard de la nature naturelle (enfin, ce qui en subsiste) : à quel taux de probabilité s'élèvent ses capacités d'action efficace ? Ses possibilités de transformer l'existant ? Combien sont-ils, les Verts, au Parlement européen ? Et qu'est-ce que le Parlement européen, dans le vaste chaudron de la mondialisation ?
***
Cette hypocrisie générale, ce mensonge n’est plus de mise. Thomas Piketty a bien raison d'intituler sa chronique du Monde du 9 juin 2019 "L'illusion de l'écologie centriste". Malheureusement, il se contente d'observer les jeux de vilains des politicards en présence, du coup la portée de son papier en souffre. Ce n’est pas de demi-mesures, d'accommodements courtois, de corrections à la marge, de remèdes de surface que l’humanité a besoin : ce serait d’un retour radical et volontaire à une conception raisonnable de tous nos rapports avec le monde. Carrément l'utopie, quoi !
C’est précisément cette conception que nous avons perdue et oubliée depuis deux siècles : nous avons quitté sans retour le monde ancien. Et malgré tous les hypocrites "c'était mieux avant" ou "c'était le bon temps", nous nous félicitons à chaque instant, par nos gestes mêmes, du fait que ce monde ancien nous soit devenu étranger (ringard, vieillot, suranné, etc.). Si par extraordinaire nous décidions de retrouver ce mode de vie (frugalité, sobriété, etc.), l’événement serait d’une violence insoutenable (y compris pour moi).
Vous imaginez la quantité astronomique de travail qui nous retomberait sur le dos ? Ce serait une conversion infiniment douloureuse. De façon plus réaliste, je crois que la perte est définitive et irréversible : on n'arrête pas une machine qui a les dimensions de la planète et qui régente l'existence de (presque) tout le monde..
Et si beaucoup de gens souhaitent "faire des gestes pour la planète" (nous culpabilisons), personne n'a vraiment compris. Je veux dire que personne n'est prêt (moi compris) à perdre tout ce qu'il faudrait pour retrouver l'équilibre perdu. Parce que ce serait individuellement trop coûteux. Sans même parler des efforts constants du système pour accroître sa puissance et son emprise, personne ne peut s'extraire de l'engrenage, même les écologistes convaincus, qui aiment se raconter de belles histoires (consommer "bio", circuits courts, agriculture raisonnée, permaculture, etc.). A quelle hauteur s'élève leur refus du système ? Leurs concessions au système ? Tout ça ressemble à : « Encore quelques minutes, monsieur le bourreau ! ».
Il nous faudrait réapprendre tout ce que nos ancêtres connaissaient par cœur. Dans quelle école apprendrions-nous aujourd’hui ce dont nous nous sommes dépouillés avec soulagement et enthousiasme il y a deux siècles et dont nous avons perdu la mémoire ? Comment trouverions-nous, sept milliards que nous sommes, un terrain d’entente avec la nature, avec la planète, avec le monde, bref : avec les nécessités irréductibles de la nature et des éléments ?
Quel coup de baguette magique nous inculquerait le sens et le respect des limites à ne pas dépasser, que l’humanité a respectées pendant pas mal de millénaires, et dont nous avons fait en deux cents ans des guenilles indignes d’être portées, que nous avons jetées aux orties ? L'humanité présente éprouve une haine viscérale des limites, comme le montrent à profusion les inventions des "créateurs culturels" dans leurs spectacles où fourmillent la transgression, l'attentat aux tabous, le franchissement des limites. Après toutes les Déclarations des droits humains, à quand la signature solennelle de la Déclaration Universelle des Limites Humaines ?
L’humanité présente est une Cendrillon qui n’a pas entendu les douze coups de minuit : il nous reste la citrouille, les rats et les trous dans la pantoufle de vair. Grâce à la machine du capitalisme industriel et productiviste, l’humanité retournera dans son taudis avec les pieds écorchés.
Malheureusement, il nous reste quand même, indéracinable, le rêve de la splendeur du palais princier, le rêve des vêtements chamarrés du bal de la cour. Il nous reste le rêve du bonheur définitif, le rêve de l’abondance des biens, le rêve des fontaines où coulent l’or de nos désirs et les diamants de la certitude de pouvoir les assouvir : la créativité humaine (l'innovation technique) reste pour nous infinie, et nous n'avons ni les moyens ni l'envie d'inverser le cours de l'histoire.
L’humanité présente rêve. Elle vit dans un conte de fées. Elle a fait de la planète un Disneyland géant en même temps qu'une poubelle, et n’envisage à aucun prix d’en sortir. L’humanité, qui a les pieds dans la merde, ne renonce pas à ses rêves sublimes, et ce ne sont pas les écologistes qui la réveilleront. La réalité l’attend au coin du bois.
« La mort lui fit au coin d'un bois le coup du père François ».
"Grand-père", Georges Brassens.
En résumé, si, pour être écologiste, il faut détruire le capitalisme, il faudrait en même temps dire comment on fait. Jusqu'ici, le capitalisme a régulièrement prouvé qu'il était increvable : il a tout digéré, y compris ses pires ennemis. Paul Jorion déclarait assez justement que les capitalistes ne feraient quelque chose pour sauver la planète que si ça leur rapportait. Autrement dit : aucune issue. Tant que l'écologie ne consiste qu'en pratiques fort sympathiques, mais infinitésimales, soigneusement montées en épingle par ses partisans, et qu'elle n'a, à part ça, que des mots à opposer au système capitaliste, celui-ci peut dormir tranquille : il ne sera pas dérangé.
Moralité : être écologiste aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça n'est pas près d'exister.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication, pillage des ressources, méphistophélès, goethe, second faust, emmanuel macron, édouard philippe, déclaration de politique générale, journal le monde, thomas piketty, disneyland, georges brassens, paul jorion
vendredi, 14 juin 2019
ÉCOLOGIE = ANTICAPITALISME 1/2
1
Toutes les grandes âmes, politiques ou autres, se rendent compte aujourd’hui que les populations électorales et consommatrices sont de plus en plus préoccupées par l’état de la planète, le changement climatique, l’empoisonnement chimique de l’environnement et autres réalités antipathiques. En un mot, les populations sont de plus en plus sensibles aux questions écologiques.
Pour leur donner l’impression qu’ils gardent un peu la maîtrise des choses, tous les "amis du peuple" qui briguent ses suffrages ont inscrit la protection de l’environnement à leur programme, sous forme de quelques virgules verdâtres, quelques phrases de sinople ou quelques paragraphes smaragdins, bref : des déclarations d'intention. Disons-le : ils veulent juste faire joli, et ça ne tire pas à conséquence. Le programme du parti écologiste lui-même, dont le chef provisoire ne vise rien de moins que la conquête du pouvoir (déclaration récente de Yannick Jadot), est – et c’est logique – entièrement consacré à ce thème.
Tous ces braves gens mentent effrontément. Ils mentent quand ils parlent de « développement durable ». Ils mentent quand ils parlent de « croissance verte ». Ils mentent quand ils enfourchent le cheval des « énergies renouvelables ». Ils mentent quand ils parlent de « consommateurs responsables » et de « tri sélectif ». Et la chaîne Biocoop se fout de nous, avec son slogan sur le "consommacteur". Pour résumer, dans la vie politique, l'écologie reste une potiche garnie d'une plante verte dans un coin de la scène où pérorent les responsables.
S’agissant d’écologie et de défense de l’environnement, il n’y a qu’une seule vérité : personne n’est écologiste s’il n’est pas résolument anticapitaliste. Aucun humain ne peut se prétendre écologiste s’il ne considère pas le capitalisme comme l’Ennemi à détruire. Toute autre position, qui accepte de transiger avec ce principe est une lâcheté, une tricherie, un mensonge, une imposture. Partant de cette prémisse, on aura beau chercher un écologiste avec une lanterne à la main, on n'en trouvera pas. Cela veut dire accessoirement que tout le monde ment, y compris les écologistes estampillés.
***
Le titre de ce billet est en soi un pléonasme. Pour être vraiment écologiste, il faut être un anticapitaliste résolu. J'avoue que, politiquement, le problème est difficile à résoudre. Dans les croyances les plus répandues, se déclarer anticapitaliste, c'est automatiquement être étiqueté bolchevique, marxiste, collectiviste, communiste, et toutes ces vieilles représentations armées d'un couteau entre les dents, où la planification autoritaire voisine avec la police politique, le Goulag, le KGB et les charmants souvenirs qu’a laissés le camarade Staline, petit père des peuples par antiphrase.
Cet anticapitalisme-là est une sinistre farce qui a été soigneusement entretenue par l'armée des agents de l'URSS à l'étranger connus sous le nom de "partis communistes". Car contrairement à la légende, l’URSS n’était pas anticapitaliste (Lénine a réprimé les premiers vrais soviets) : après 1945, elle fut seulement antiaméricaine. Et ça change tout. Ce qu'on nous a présenté pendant presque un siècle comme la patrie de l'anticapitalisme n'était ni plus ni moins qu'un autre système capitaliste, mais un capitalisme d'Etat, c'est-à-dire opposé au capitalisme à l'américaine, fondé, lui, sur la libre entreprise et l'initiative individuelle.
Dans l'un, tout était fait pour favoriser la libération des énergies des hommes entreprenants et courageux, dans l'autre, tout était administré par le couvercle d'une bureaucratie tatillonne et policière. – Soit dit par parenthèse, le rejeton bâtard de l'URSS nommé Nouveau Parti Anticapitaliste (Olivier Besancenot) ne fait que brouiller la donne. Heureusement : qui y croit ? Je ferme la parenthèse.
En dehors de cette différence – cruciale pour ce qui est des droits de l'homme – on aurait pu calquer à peu près le système soviétique sur le système américain : les deux s'entendaient à merveille pour faire de l’industrialisme et du productivisme à outrance l'alpha et l'oméga de la perfection des inventions humaines (voir par exemple la course à la bombe, la course à la Lune, les Jeux olympiques, ...). Le seul moteur qui alimentait l'antagonisme sauvage (quoique mimétique) que tout le monde prenait pour une incompatibilité de nature, une antinomie essentielle, c'était la performance dans tous les domaines possibles.
On se souvient du mythe de Stakhanov, ce "héros" du prolétariat mondial capable de remonter du fond de la mine cinq fois plus de charbon que le communiste ordinaire ; on se souvient de la souveraineté du "Plan" dont, systématiquement, le Soviet suprême concluait a posteriori que "le bilan était globalement positif". L'Amérique et l'URSS se sont simplement tiré la bourre pendant un demi-siècle pour savoir lequel des deux serait capable d'étouffer l'autre sous la masse supérieure de ses performances économiques, scientifiques et militaires chiffrées.
L'URSS a trahi tous les gogos qui ont cru aux "lendemains qui chantent". Une trop longue illusion qui a plongé toutes les gauches et les travailleurs de la planète entière dans la stupeur et le découragement quand l'imposture, au début des années 1990, s'est brutalement révélée pour ce qu'elle était, et que le "communisme" s'est désintégré sous nos yeux, dans une déflagration soudaine, comme par un effet de prestidigitation, où les apparatchiks purs et durs ont su se glisser du jour au lendemain dans le costume rutilant (et mafieux) des "oligarques" gourmands et forcenés. L'URSS abattue a laissé le champ libre aux Etats-Unis, qui ont pu croire que l'ennemi était définitivement à terre, et qu'il ne se relèverait jamais.

Vignette quasi-conclusive de Les Secrets de la Mer noire, de Bergèse et De Douhet, n°45 de la série "Buck Danny". Le volume est paru en 1994 !!!
Pour ce qui est du productivisme, de l’industrialisme et de la destruction de la nature, USA et URSS s’entendaient comme larrons en foire, avec cependant une prime aux soviétiques qui se souciaient de la vie humaine et de la sauvegarde de l'environnement encore moins que les Américains (c'est tout dire), comme l’ont montré les premières interventions après l’accident de Tchernobyl (voir La Supplication, de Svetlana Alexievitch, Lattès, 1998). Et il paraît qu’il vaut mieux ne pas tremper un orteil dans les eaux de Mourmansk ou de la Mer blanche, à cause des déchets innommables qui y ont été immergés.
Le capitalisme, incarné par son champion américain, est un anti-écologiste endurci, c'est sa nature, on le sait. Mais son ennemi déclaré, la soi-disant anticapitaliste et "communiste" URSS, était encore plus anti-écologiste que lui. L'écologie est le seul anti-capitalisme authentique.
A suivre.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication
jeudi, 01 novembre 2018
CLIMAT : CESSER D’ESPÉRER
Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°67).
« Ce n'est donc pas parce qu'elle est une découverte de la physique — même si elle l'est aussi — que l'énergie nucléaire est le symbole de la troisième révolution industrielle, mais parce que son effet possible ou réel est de nature métaphysique, ce qu'on ne peut dire d'aucun autre effet antérieur ayant une cause humaine. Je qualifie de "métaphysique" et non d'"épochal" l'effet de l'énergie nucléaire parce que l'adjectif "épochal" suppose encore comme une évidence la continuation de l'histoire et l'avènement de nouvelles époques, une supposition qui ne nous est justement plus permise à nous, hommes d'aujourd'hui. L'époque des changements d'époque est passée depuis 1945. Nous ne vivons plus à présent une époque de transition précédant d'autres époques, mais un "délai" tout au long duquel notre être ne sera plus qu'un "être-juste-encore". L'obsolescence d'Ernst Bloch, qui s'est opposé au simple fait de prendre en compte l'événement Hiroshima, a consisté dans sa croyance — aboutissant presque à une forme d'indolence — selon laquelle nous continuons à vivre dans un "pas-encore", c'est-à-dire dans une "pré-histoire" précédant l'authenticité. Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer [c'est moi qui souligne], ne serait-ce qu'un moment. Peu importe qu'elle se termine maintenant ou qu'elle dure encore, notre époque est et restera la dernière, parce que la dangereuse situation dans laquelle nous nous somme mis avec notre spectaculaire produit, qui est devenu le signe de Caïn de notre existence, ne peut plus prendre fin — si ce n'est pas l'avènement de la fin elle-même.
Cette troisième révolution est donc la dernière. »

Günther Anders, L'Obsolescence de l'homme, II, Editions Fario, 2011, p. 20-21.
Introduction : les trois révolutions industrielles, 1979.
Note : Ernst Bloch est un philosophe allemand, défenseur de la notion d'utopie, dont l'oeuvre principale est la somme intitulée Le Principe espérance. Mais Ernst Bloch n'avait pas la même grille de lecture que Günther Anders : le concept de "honte prométhéenne" (l'homme invente un objet prodigieux qui produit l'humiliation "métaphysique" de son inventeur) est totalement étranger à ce qui anime Ernst Bloch, indéfectible optimiste. Moralité : la négation du Mal conduit inexorablement à la catastrophe.
***
Le texte cité ci-dessus a donc été publié en 1979 (il y aura quarante ans dans pas longtemps). D'accord, la citation peut indisposer à cause de son ton vaguement prophétique. D'accord, Günther Anders fait de l'atome une quasi-transcendance qui peut aujourd'hui sembler excessive. D'accord, insouciants et heureux dans notre confort, nous laissons ronronner les centrales nucléaires comme un bon gros chat, nous chevauchons l'énergie atomique (« Nous faisons cuire des œufs au plat sur le soleil », s'exclame un témoin de Tchernobyl dans La Supplication (p.186) de Svetlana Alexievitch) et nous vivons tranquillement à proximité de ses usines de production, alors que se sont produits les "accidents" de Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island, Windscale, en attendant mieux.
Mais ajoutez à l'énergie nucléaire les déforestations massives. Ajoutez le changement climatique bientôt irréversible. Ajoutez la tyrannie technique que l'économie toute-puissante fait régner sur la marche du monde. Ajoutez la pollution de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et des aliments que nous ingurgitons par des milliers de substances chimiques de synthèse incontrôlées. Alors peut-être admettrez-vous, avec Günther Anders, que notre époque est vraiment la dernière. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y eut un tel cumul de facteurs de destruction.
C'est la situation produite par cette conjonction de facteurs qui FORCERA l'humanité à changer de mode de vie. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et probablement du sang.
Note : un commentateur récent (anonyme) me reproche de dire du mal des gens qui s'efforcent de "rendre le monde un peu plus vivable" (ce sont ses mots). D'abord, je ne dis pas du mal des personnes, mais je ne supporte plus les discours lénifiants et consolateurs qui ne font qu'anesthésier la vigilance. Ensuite, je n'ai rien contre les bonnes intentions et les bonnes volontés, je m'insurge seulement contre l'aveuglement de ceux qui refusent de voir que le monde se rend de jour en jour plus invivable, et que ce n'est pas le "bon cœur" des populations qui le sauvera (vous savez, le vieux refrain : « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain »).
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bombe atomique, hiroshima, nagasaki, fin du monde, éditions fario, fukushima, tchernobyl, svetlana alexievitch, la supplication alexievitch, philosophie
mercredi, 18 mai 2016
TCHERNOBYL ET APRÈS
LA SUPPLICATION,
de SVETLANA ALEXIEVITCH
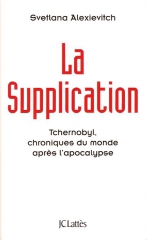 3/3
3/3
Petit florilège pour finir.
Sans commentaires et sans photos. En essayant de donner une idée des diverses facettes du livre, de la diversité des gens interrogés par l'auteur, mais aussi des points de vue et des problèmes rencontrés.
« "Qu’imaginais-tu ? Il a reçu mille six cents röntgens alors que la dose mortelle est de quatre cents. Tu côtoies un réacteur". Tout à moi … Tout aimé … » (p.25).
Une blague : « On demande à radio Erevan [la référence annonce toujours une histoire drôle] : "Est-ce qu’on peut manger des pommes de Tchernobyl ?" Réponse : "Bien sûr que l’on peut, mais il faut enterrer profondément le trognon" » (p.54).
« Nous n’aurons jamais d’asphalte correct ou des gazons soignés. Mais nous aurons toujours des héros ! » (p.88).
Un soldat « liquidateur », sa femme est partie avec leur gamin : « Nous sommes seuls. Nous sommes des étrangers. On ne nous enterre pas comme tout le monde, mais séparément, comme des visiteurs de l’espace » (p.93).
« Cela m’a pris quatre ans pour obtenir un certificat qui confirmait le lien entre des petites doses de radiations ionisantes et sa terrible maladie. Pendant ces quatre années, on me le refusait : "Les malformations de votre fille sont congénitales. Elle est invalide de naissance" » (p.97).
Une habitante de Pripiat : « A midi, il n’y avait plus de pêcheurs à la ligne au bord de la rivière. Ils sont rentrés chez eux tout noirs. Impossible de bronzer ainsi, même après un mois à Sotchi. Le bronzage nucléaire » (p.116).
« Je ne sais pas si je serai d’accord pour vous revoir. Il me semble que vous me percevez de la même manière que lui. Que vous m’observez, tout simplement. Que vous essayez de garder mon image, comme pour une expérience … » (p.120).
« Nous, les chevaliers » (p.124).
« Mais vous devriez voir ces images … Les visages des premiers pompiers, noirs comme du charbon. Et leurs yeux … Les yeux des gens qui savent qu’ils nous quittent. Sur un fragment, on voit les jambes d’une femme qui, le matin après la catastrophe, est allée travailler dans son potager. Elle a marché dans l’herbe couverte de rosée … Ses jambes ressemblent à un tamis. Elles sont couvertes de petits trous, jusqu’aux genoux … Il faut le voir, si vous écrivez un tel livre » (p.148).
Sur un des huit cents « sépulcres » autour de Tchernobyl, où sont stockés les déchets irradiés : « Des milliers de voitures, de tracteurs, d’hélicoptères … Des véhicules de pompiers, des ambulances … C’était le plus important sépulcre, près du réacteur. Il voulait le photographier dix ans après la catastrophe. (…) [Il n’arrive pas à obtenir l’autorisation] Et puis, j’ai fini par comprendre que le sépulcre n’existait plus que dans les rapports. En réalité, tout a été pillé, vendu dans les marchés, utilisé comme pièces détachées par des kolkhozes et des particuliers » (p.151).
« J’ai peur de vivre sur cette terre. On m’a donné un dosimètre, mais à quoi bon ? Je lave le linge, chez moi. Il est si blanc, mais le dosimètre sonne. Je prépare un gâteau, il sonne. Je fais le lit, il sonne. A quoi bon l’avoir ? Je donne à manger aux enfants et je pleure. "Maman, pourquoi pleures-tu ?" » (p.159).
Marat Philippovitch Kokhanov, ingénieur en chef dans le nucléaire : « Nous nous sommes longtemps servis du lait en poudre et des boîtes de lait concentré de l’usine de Rogatchev comme exemples de produits irradiés. Mais pendant ce temps, ces produits étaient en vente dans les magasins » (p.176-177).
Zoïa Danilovna Brouk, inspecteur de la préservation de la nature : « Et l’on jetait les déchets contaminés directement dans la nappe phréatique » (p.182). La même : « J’ai compris plus tard, quelques années plus tard, que nous avions participé … A un crime … A un complot » (p.184).
Lettre à l’auteur, écrite par une institutrice évacuée : « Le sort de millions de personnes se trouvait entre les mains de quelques individus. De la même manière que quelques personnes se sont révélées capables de nous assassiner. Ce n’étaient ni des maniaques, ni des criminels. De simples opérateurs de service dans une centrale nucléaire. Lorsque je l’ai compris, j’ai été bouleversée » (p.196).
Irina Kisseleva, journaliste : « Nous sommes arrivés dans le village non évacué de Tchoudiany : cent quarante-neuf curies … A Malinkovna : cinquante-neuf curies … La population avait reçu des doses de plusieurs dizaines de milliers de fois supérieures à celles des soldats qui gardent les zones d’essais nucléaires ! Des dizaines de milliers de fois ! Le dosimètre craquait. Il se bloquait au maximum » (p.223).
Vassili Borissovitch Nesterenko, directeur de l’Institut de l’énergie nucléaire de l’Académie des sciences de Biélorussie : « Des milliers de tonnes de césium, d’iode, de plomb, de zirconium, de cadmium, de béryllium, de bore et une quantité inconnue de plutonium (dans les réacteurs de type RBMK à uranium-graphite du type de Tchernobyl on enrichissait du plutonium militaire qui servait à la production des bombes atomiques) étaient déjà retombées sur notre terre. Au total, quatre cent cinquante types de radionucléides différents. Leur quantité était égale à trois cent cinquante bombes d’Hiroshima. Il fallait parler de physique, des lois de la physique. Et eux, ils parlaient d’ennemis. Ils cherchaient des ennemis ! » (p.229-230).
Natalia Arsenievna Roslova, présidente du comité des femmes de Moguilev "Enfants de Tchernobyl" : « Ma mère travaillait à l’état-major de la défense civile de la ville. Elle a été l’une des premières à apprendre ce qui s’était passé. Tous les appareils ont convenablement fonctionné. Selon les instructions accrochées dans chaque bureau, il fallait immédiatement informer la population et distribuer des masques et tout le reste. Ils ont ouvert les entrepôts secrets, mais tout ce qui s’y trouvait était dans un triste état, hors d’usage. Dans les écoles, les masques à gaz dataient d’avant la guerre et les tailles ne convenaient pas aux enfants. Les aiguilles des appareils enregistreurs restaient bloquées au maximum, mais personne ne comprenait rien. La situation était dantesque. Alors, ils ont simplement débranché les compteurs » (p.236). La même : « Lorsque l’empire a disparu, nous sommes restés seuls. J’ai peur de le reconnaître, mais nous aimons Tchernobyl. Cela a redonné un sens à notre vie. Comme la guerre » (p.240).
Un enfant : « Maman est venue. Hier, elle a accroché une icône dans ma chambre d’hôpital. Elle chuchote dans le coin, devant l’icône, se met à genoux. Tout le monde se tait : le professeur, les médecins, les infirmières. Ils pensent que je ne devine pas … Que je ne sais pas que je vais bientôt mourir … Ils ne savent pas que, la nuit, j’apprends à voler » (p.252).
J’arrête là : mon dosimètre personnel s’affole et crépite comme une mitrailleuse. Je me demande combien ont compris à l'époque ce que le continent européen a vécu le 26 avril 1986.
Le titre du livre, maintenant. La Supplication, franchement, j'avoue que j'ai mis du temps à trouver du sens. Pour une raison directe et simple : aucun des interlocuteurs de Svetlana Alexievitch ne supplie qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Tous parlent des difficultés, des souffrances : nul ne se plaint. Nul ne demande. Nul ne revendique, aussi bizarre que ça puisse paraître.
L'original s'intitule Tchernobylskaïa molitva. Il paraît que ça veut dire "prière de (ou pour ?) Tchernobyl". S'il en est bien ainsi, "supplication" semble emphatique. Dans quel état Svetlana Alexievitch est-elle sortie de tous ces entretiens ? Comment était-elle, après avoir enregistré toutes ces atrocités épouvantables ? Je ne peux imaginer qu'on puisse sortir intact de ce genre d'expérience. De ces confrontations parfois insoutenables avec des gens qui ont vécu l'invivable.
J’ai ma dose, et au-delà. Et ce fut un moment assez rude à passer, je vous jure. Vivement les petites fleurs et les petits oiseaux. Merci à ceux qui ont eu le cœur assez bien accroché pour me suivre dans ce parcours, décidément éprouvant. Et difficilement oubliable.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : au fait, j'ai oublié de signaler que le nom de Tchernobyl signifie "l'étoile-absinthe", celle-là même qui apparaît dans l'Apocalypse de Jean. Vous avez dit "apocalypse" ?
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication, prix nobel de littérature, tchernobyl, tchernobylskaïa molitva
mardi, 17 mai 2016
TCHERNOBYL ET APRÈS
LA SUPPLICATION,
de SVETLANA ALEXIEVITCH
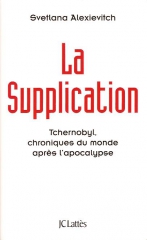 2/3
2/3
Beaucoup de passages du livre laissent le lecteur sans voix, mais parmi les plus éprouvants, figure celui ou une mère, Larissa Z., évoque le cas de sa fille, née sans anus, sans vagin et sans rein gauche. Peut-on vivre, dans cet état ? Apparemment oui : « A la naissance, ce n’était pas un bébé, mais un sac fermé de tous les côtés, sans aucune fente » (p.95). Et puis : « Mais elle n’est pas morte, parce que je l’aime » (ibid.). Et puis : « J’ai tout raconté au pope. Il dit qu’il faut prier pour expier ses fautes. Mais dans notre famille, personne n’a commis de crime … De quoi serais-je coupable ? » (p.96). Un des témoins affirme qu'il y eut deux cent mille avortements en Biélorussie en 1993.
Le plus grand malheur immédiat des populations habitant autour de Tchernobyl (en dehors du fait que plusieurs interlocuteurs de l’auteur disent des choses de ce genre : « La prédestination de notre peuple pour n’importe quel malheur », p. 214), ce fut dit à l’époque, c’est d’abord le mensonge dans lequel on les a fait vivre, et le cynisme muet des autorités, encore soviétiques à l’époque. Comme le dit un ingénieur : « Nous n’avions plus besoin de la vérité » (p.238) On en a fait évacuer une partie (combien ?). Des centaines de villages ont été, purement et simplement, enterrés.

Sergueï Vassilievitch Sobolev : « C’est là qu’on a enterré la "forêt rousse" abattue sur cent cinquante hectares autour du réacteur (dans les deux jours qui ont suivi la catastrophe, les sapins et les pins sont devenus rouges, puis roux » (p.151). Il fallait même « enterrer la terre » dans des fosses profondes, les « sépulcres ». Ivan Nicolaïevitch Jmykhov, ingénieur chimiste, déclare : « Nous soulevions la terre et l’enroulions comme un tapis. (…) Des centaines de kilomètres de terre arrachée, dénudée, stérile » (p.171). L’humus, la partie vivante du sol, avec les insectes et les vers, avait disparu : il ne restait plus que le sable.

Les « liquidateurs » ? Les autorités les ont envoyés laver le toit. Ils ne devaient pas y rester plus de quarante-cinq secondes, protégés par des plaques de plomb qui ne protégeaient pas de grand-chose. Il y en eut même un qui, quelques jours après l’explosion, reçut l’ordre d’aller y fixer un grand drapeau rouge. Qu'est-il resté du bonhomme ? Un mois après, le drapeau, complètement cuit, était tombé en poussière, et il fallut répéter l’opération. Combien de fois ?
Combien de « liquidateurs » ont laissé leur peau à Tchernobyl ? Mon ami F., qui croit dur comme fer au nucléaire, parle de cinq cents mille, mais en ajoutant que ça ne pouvait se passer qu’en Russie. Le même Sobolev donne un chiffre : « Et les soldats qui ont travaillé sur le toit du réacteur ? Au total, deux cent neuf unités militaires ont été envoyées pour liquider les conséquences de la catastrophe. Cela fait près de trois cent quarante mille hommes. Un véritable enfer pour ceux qui ont nettoyé le toit » (p.145). Mais il faut aussi compter les mineurs, envoyés pour creuser sous la centrale pour congeler le sol à coups d’azote liquide, pour empêcher le réacteur de « s’enfoncer dans les eaux souterraines » (p.149).

Qui est Sergueï Vassilievitch Sobolev ? Un spécialiste des fusées, du combustible pour fusées, qui travaillait sur la base de Baïkonour. Au moment de l’entretien avec l’auteur, il dirige un musée: « Mais mon œuvre véritable, c’est le musée. Le Musée de Tchernobyl. (Il se tait) Et parfois j’ai l’impression que ce n’est pas un musée, mais un bureau de pompes funèbres. Je travaille dans les pompes funèbres ! » (p.145). Il raconte encore : « Les robots téléguidés refusaient souvent d’exécuter les ordres, ou faisaient autre chose que ce qui leur étaient demandé : leurs circuits électroniques étaient détruits par les radiations. Les soldats étaient plus sûrs. On les a surnommés les "robots verts" à cause de la couleur de leur uniforme » (p.146).

Et que penser du sacrifice, parfois tout à fait conscient et volontaire, des pilotes d’hélicoptères qui ont multiplié les rotations pour jeter des centaines de tonnes de sable dans le réacteur en feu ? Etait-il un héros, le colonel Vodolajski, comme l'image à laquelle l’homme russe est très souvent invité à s'identifier ? Toujours est-il que, après avoir reçu la dose maximale, il n’a pas voulu être évacué : « Il est resté pour apprendre la technique à trente-trois équipages supplémentaires. Il a fait lui-même cent vingt vols et balancé sur la centrale entre deux cents et trois cents tonnes de sable. Quatre à cinq vols par jour. A trois cents mètres au-dessus du réacteur, la température dans la carlingue atteignait soixante degrés. Vous pouvez vous imaginer ce qu’il en était en bas, pensant la durée de l’opération. La radioactivité atteignait 1800 röntgens par heure. Les pilotes avaient des malaises en plein vol » (p.149).
Je vous laisse deviner ce qu’il en est aujourd’hui du colonel Vodolajski.
Voilà ce que je dis, moi.
lundi, 16 mai 2016
TCHERNOBYL ET APRÈS
LA SUPPLICATION,
de SVETLANA ALEXIEVITCH
PRIX NOBEL DE LITTERATURE
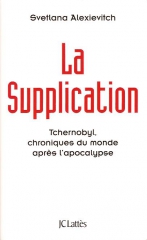 1/3
1/3
Si, avec La Fin de l’homme rouge (Lattès, 1998, voir ici 6 et 7 mai), Svetlana Alexievitch avait fait une sorte de terrible bilan du passé communiste de la Russie (bien que beaucoup de témoignages soient bien ancrés dans le paysage tout à fait présent de la « nouvelle » Russie, celle de Poutine, si peu reluisante et charitable au petit peuple), avec La Supplication, elle dessine le tableau de l’horreur absolue qui s’est installée pour des centaines d’années, depuis le 26 avril 1986, dans la région de Tchernobyl.
La Biélorussie a été frappée plus durement que l’Ukraine par l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl : deux millions des citoyens (sur dix que compte le pays) vivaient dans le rayon d’action du nuage qui s’en est échappé. Le lecteur du livre, je vous assure, ne sort pas indemne d’une telle épreuve. Merci aux âmes bien trempées de la partager. Et que les âmes plus sensibles veuillent bien me pardonner. D'ailleurs, l’auteur nous prévient : la catastrophe n’est pas derrière nous, mais devant : « Plus d’une fois, j’ai eu l’impression de noter le futur » (p.35). Froid dans le dos, si on regarde la vérité bien en face.
[Les quelques photos qui parsèment ces billets sont entre autres du photographe Paul Fusco, dont j'ai montré ici quelques autres clichés le 28 avril dernier. Par ailleurs, je signale que je n'ai pas cherché ce qui pouvait bien différencier les rems des curies, les curies des röntgens, les röntgens des becquerels.]

Et je pense à ce qui attend peut-être un jour les habitants de la région lyonnaise, qui vivent à quarante kilomètres à vol d’oiseau de la centrale de Saint-Vulbas. Mais non, voyons, vous ne risquez rien, on vous dit ! On est en France, on est sérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai tendance à ne plus faire confiance aux discours rassurants des thuriféraires du nucléaire (on se rappelle l'inénarrable professeur Pellerin, avec l'énormité fabuleuse de son mensonge au sujet d'un nuage radioactif resté bloqué à la frontière française, sans doute grâce à nos valeureux douaniers et à leurs "petits bras musclés").
Or, en l’état actuel des choses, on est obligé de faire confiance aux concepteurs, aux ingénieurs, aux techniciens, aux constructeurs : ils tiennent nos vies entre leurs mains. On est obligé de croire sur parole une poignée de gens qui détient en son pouvoir le sort de combien de millions d'autres ? Pour devenir antinucléaire, lisez La Supplication de Svetlana Alexievitch. Remarquez, je l’étais déjà bien avant. L’énergie nucléaire est une démence lancée à fond les ballons parmi les hommes.

La méthode de l’auteur n’a pas varié : de longs entretiens avec toutes sortes de témoins du déroulement de la catastrophe et de ses conséquences à long terme. La différence avec son livre sur le système soviétique et celui qui lui a succédé crève les yeux. On peut dire que la société communiste (et après) était simplement inhumaine, et que la cause en était directement humaine. Alors que Tchernobyl a obligé les hommes à affronter une force incommensurable aux capacités de l’homme.
Car tout ce qui s’est passé après le 26 avril dépasse l’entendement, est totalement inimaginable. L’homme est tout simplement enterré vif : « Le train roule à toute vitesse, mais en guise de machinistes, il est conduit par des cochers de diligence » (p.187), dit Alexandre Revalski, historien, qui ajoute, soudain poète : « Les roues des charrettes s’enlisent dans la boue, mais nous tenons l’oiseau de feu dans nos mains. (…) Voilà de la superbe : nous allons cuire des œufs au plats sur le soleil » (p.186).

Quant à Valentin Alexeïevitch Borissevitch, physicien, voici ce qu’il dit : « L’homme se détache de la Terre … Il manipule d’autres catégories temporelles et pas seulement la Terre, mais d’autres mondes. L’Apocalypse … L’hiver nucléaire … » (p.194). Un photographe : « Or Tchernobyl est une ouverture sur l’infini » (p.206). Comment l’homme pourrait-il être à la hauteur d’une invention qui outrepasse si absolument ses capacités ? Une enseignante constate : « Mais nous avons toujours vécu dans l’horreur et nous savons vivre dans l’horreur. C’est notre milieu naturel » (p.155).
C’est de la même démesure, celle aussi qu’honnissaient les Grecs de l’antiquité, que parle Günther Anders, à propos de la bombe atomique, dans L’Obsolescence de l’homme. Chez les Grecs, l'ubris (ὕϐρις) était châtiée par les dieux, parce qu'ils avaient le sens du sacré. La science a réussi au vingtième siècle à ressusciter une forme de sacré : la terreur que la bombe H a répandue parmi les hommes en est un signe, peut-être une preuve.

Et les consignes draconiennes de sécurité qui règnent sur les centrales nucléaires n'ont-elles pas à voir avec le sacré ? Celles-ci ne sont-elles pas gardées comme des temples, ces enceintes où l'on n'était autorisé à pénétrer qu'en observant un strict rituel de gestes et de comportements, sous peine de sacrilège ? Et les châtiments dont l'atome a déjà puni l'humanité (Hiroshima, Nagasaki, Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima, ...) ne sont-ils pas infligés par une divinité ?
Il y a de la transcendance dans l'atome, cet infiniment petit au potentiel infiniment grand, au service duquel se sont mis de modestes humains en blouse blanche. L'atome est un dieu implacable, fabriqué de toutes pièces par ses adorateurs. De plus, il est interdit de le toucher, d'entrer en contact avec lui : il est incommensurable. De plus, il est indestructible, puisqu'il faudrait l'enfouir au cœur de la Terre pour que l'homme échappe à son action. Et encore, ce n'est pas sûr : la Terre, comme toute la Nature, recèle aussi bien la Vie que la Mort.
La Supplication s’ouvre et se referme sur les témoignages de deux femmes de « liquidateurs ». Le premier est proprement insoutenable. Le mari, qui est pompier, est appelé sur les lieux dans la nuit du 26 au 27. Il y va en chemise, sans chapeau : « Ferme les lucarnes et recouche-toi. Il y a un incendie à la centrale. Je serai vite de retour » (p.11). Il a mis deux semaines à mourir dans d’atroces souffrances (« En quatorze jours, l’homme meurt… »). La femme raconte : « Les selles vingt-cinq à trente fois pas jour ... Avec du sang et des mucosités ... La peau des bras et des jambes se fissurait ... Tout le corps se couvrait d'ampoules ... Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller » (p.22). Plus loin : « Il avait également fallu couper l'uniforme, car il était impossible de le lui enfiler, il n'avait plus de cors solide ... Il n'était plus qu'une énorme plaie » (p.26).
Et elle, elle ne voit même pas les hideuses transformations physiques de son mari, elle ne voit que l’homme qu’elle aime plus que tout au monde, elle ne le quitte que pour dormir un peu, bien qu’on lui dise et répète que : « Ce n’est plus un homme, mais un réacteur » (p.24). Peu après, elle accouche d’une fille saine, sauf qu’elle a une cirrhose (« Vingt-huit röntgens dans le foie »), une malformation cardiaque, et qu’elle mourra à l’âge de quatre heures.
La femme, qui veut rester anonyme, termine ainsi son témoignage : « Mais moi, je vous ai parlé d’amour … De comment j’aimais » (p.31). Le dernier chapitre n’ajoute rien à cet enfer vécu, à part le fait que, intervenu plus tard sur le site, le mari met un an à mourir. Le chapitre initial et le final sont tous deux intitulés « Une voix solitaire ».
Une autre femme, qui habite Khoïniki (non loin de la centrale), raconte : « Ma fille m’a dit récemment : "Maman, si j’accouche d’un bébé difforme,je l’aimerai quand même". Vous vous rendez compte ? Elle est en terminale et elle a déjà des idées pareilles. Ses copines aussi, elles pensent toutes à cela … Un garçon est né chez des amis à nous. Il était tellement attendu ! Vous pensez, le premier enfant d’un couple jeune et beau ! Mais le bébé a une énorme fente en guise de bouche et pas d’oreilles … » (p.208-209).
Certains disent que l’homme s’adapte à toutes les situations. Je n’y croyais pas, mais après tout, c’est peut-être vrai.
Non, ce n'est pas vrai.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, svetlana alexievitch, prix nobel de littérature, alexievitch, la fin de l'homme rouge, la supplication alexievitch, éditions jean-claude lattès, vladimir pourine, tchernobyl, biélorussie, ukraine, paul fusco chernobyl legacy, centrale bugey saint-vulbas, centrales nucléaires, énergie nucléaire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, pripiat
samedi, 07 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
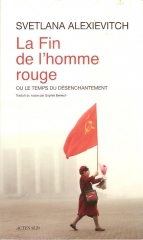 2
2
La Fin de l’homme rouge, livre de Svetlana Alexievitch, est bourré de la souffrance du peuple russe. L’étonnant, c’est que certains communistes intimement convaincus sont restés d’indéfectibles fidèles du Parti, même après avoir passé dix ans dans les camps de travail sibériens, pour avoir dévié si peu que ce soit de la « ligne » officielle, du moins dans l’acte d’accusation que la police rédigeait et, au besoin, fabriquait intégralement pour les besoins de la cause (ce gars qui, sous la torture, avoue qu’il est un espion, puis demande au juge d’instruction pour qui il est convenu d’espionner et qui, face à l’échantillon que l’autre lui présente, opte pour l’espionnage au profit des Polonais). Beaucoup ont toujours ignoré jusqu’au motif réel de cette accusation.
En tout cas, d’innombrables Russes (et autres) non communistes (ou pas assez), mais aussi des communistes pur jus, ont eu à connaître les camps. Tout le monde a entendu parler du Goulag, acronyme signifiant « administration centrale des camps ». L’URSS en a compté des milliers, répartis sur tout le territoire soviétique (ce que veut dire l' "Archipel" dont parle Soljenitsyne). Parmi eux, celui de Karaganda, où Anna Maïa, architecte de 59 ans, raconte que, petite fille, elle dut y suivre sa mère, qui avait été condamnée, et qu’elle y est, devenue adulte, retournée, dans une sorte de pèlerinage. Ensuite, elle se dit qu’elle n’aurait pas dû.
Voici ce qu’elle raconte. Elle est assise dans l’autobus, à côté d’un vieillard qui lui parle du camp, autrefois : « "Vous parlez des baraques ? On a détruit les dernières il y a deux ans. Avec les briques, les gens se sont construit des remises, des saunas. Les terrains ont été vendus pour y construire des datchas. On se sert des barbelés pour délimiter les potagers. Mon fils a un terrain ici. Eh bien, vous savez, ce n’est pas très agréable … Au printemps, avec la fonte des neiges et les pluies, des ossements remontent au milieu des pommes de terre. Ça ne dérange personne, on a l’habitude. Ici, les os, c’est comme les cailloux, il y en a partout … On les jette le long des terrains, on marche dessus … On les piétine. On est habitués ! Dès qu’on commence à creuser, ça grouille littéralement …" J’avais le souffle coupé, j’ai cru que j’allais m’évanouir. Le vieux s’est tourné vers la fenêtre : "Tenez, là-bas, derrière ce magasin, ils ont comblé un cimetière. Et là-bas aussi, derrière les bains." Je n’arrivais plus à respirer. A quoi m’étais-je attendue ? A voir des pyramides ? Des monuments funéraires ? » (p.308). A ne pas lire au moment de l’apéro.
Non plus que cet autre passage, où l’ancien colonel devenu homme d’affaires raconte le mariage qu’il a failli faire, et auquel il a renoncé après avoir rencontré son futur beau-père, dont il restitue les discours tenus un jour de boisson forte : « Je suis un soldat, moi ! On me donnait des ordres, et j’obéissais. J’exécutais des gens. Si on t’en donnait l’ordre, tu le ferais, toi aussi. Tu-le-fe-rais, nom de Dieu ! Je tuais des ennemis. Des saboteurs. Il y avait un papier officiel avec écrit dessus : "Condamné à la mesure suprême de défense sociale". Une sentence du gouvernement … Ah, c’était du boulot, je te dis pas ! Si le type n’est pas tué sur le coup, il s’écroule et il gueule comme un porc … Il crache du sang … Le plus désagréable, c’est de tirer sur quelqu’un qui rigole. Soit il est devenu fou, soit il te méprise. Les hurlements et les jurons, ça pleuvait des deux côtés. Faut jamais manger avant de faire ça. Moi je ne pouvais pas » (p.326-327).
Plus loin : « Tu sais, c’était rare, mais ça arrivait qu’on tombe sur un soldat à qui ça plaisait de tuer … On le retirait de l’équipe des exécutants et on le mutait ailleurs. On n’aimait pas les gens comme ça ». Pour finir là-dessus : « On oblige la personne à se mettre à genoux, et on tire avec son revolver presque à bout portant dans la tempe gauche … près de l’oreille. A la fin de la journée, on a la main qui pendouille comme un vieux chiffon. C’est surtout l’index qui déguste. Nous aussi, on avait un plan à remplir, comme partout. Comme à l’usine. Au début on n’y arrivait pas. On n’y arrivait pas physiquement. Alors ils ont fait venir des médecins, un conseil de médecins, et ils ont décidé de faire des massages aux soldats deux fois par semaine. Des massages de la main droite et de l’index droit » (p.327).
Svetlana Alexievitch, dans La Fin de l’homme rouge, a aussi recueilli une riche matière où apparaît, de façon éparse mais relativement nette, le portrait de ce qu’on appelle en général « l’âme russe ». Pour donner une idée approchante de la chose, disons que ce portrait est à même de provoquer chez les féministes exaltées le pire des urticaires virulents. Pensez : les femmes sont très généralement des mères dévouées, y compris pour leurs maris, et les hommes sont tous sommés de se conformer au rôle de héros virils, vodka comprise : « Nos hommes sont des martyrs, ils sont tous traumatisés, soit par la guerre, soit par la prison. Par les camps » (p.255). On voit que j’exagère à peine.
Ce qui frappe aussi, au moment de l’effondrement de tout le système soviétique en 1991, c’est la rapidité avec laquelle les voisins, russes et autres, sont devenus des ennemis. Du jour au lendemain, les Géorgiens, les Tadjiks, les Abkhazes, se sont jetés sur les Russes, brutalement considérés comme des étrangers ou des envahisseurs. Ils les ont chassés, parfois tirés comme des lapins. Alexievitch raconte l’histoire de cette femme qui a épousé un Russe, que son propre frère agonit d’injures pour ce seul motif. Je ne me rappelle plus s’il le tue.
On reconnaît le mécanisme qui a dressé les uns contre les autres, dans les années 1990, les Serbes contre les Croates ou les Bosniaques : ce fut brutal. Des voisins qui jusque-là vivaient en bonne entente, se mariaient et avaient des enfants ensemble, se retournent contre des voisins. Cela reste tout à fait incompréhensible : pourquoi la vie en bon voisinage devient-elle, du jour au lendemain, impossible, insupportable, inenvisageable ? Qu’est-ce qui fut mis sous le couvercle, pendant ces dizaines d’années ? Qui peut m’expliquer ? Cela dépasse l’entendement.
Dernier point à mentionner : le tableau que peint Svetlana Alexievitch de la vie quotidienne des gens simples, du petit peuple, que cela soit dans le régime soviétique ou après la chute de l’Empire, ne change guère. Certains considèrent même que leur situation nouvelle est pire qu’avant. Si la « perestroïka » a suscité l’enthousiasme, la façon dont toutes les entreprises publiques, après 1991 (Boris Eltsine), tout ce qui faisait le « bien commun » ont été dépecés, les remplit d’une profonde amertume, eux qui sont obligés de courir à droite et à gauche toute la journée, simplement pour trouver le moyen de survivre.
La fortune insolente et soudaine de ceux qu’on n’a pas tardé à appeler les « oligarques », les pouvoirs exorbitants que la richesse leur donne, sont proprement écœurants. Beaucoup ne les considèrent pas autrement que comme des gangsters. Est-il vrai que Vladimir Poutine, le « capo dei capi », en quelque sorte, possède quarante datchas ? Que sa fortune personnelle se monte à plusieurs milliards de dollars ? Le plus étonnant, dans certaines pages, c’est que beaucoup regrettent non pas le communisme, mais la perte de l’idéal exaltant auquel ils croyaient et qui les motivait.
Si La Fin de l’homme rouge ne ressemble pas à ce qu’on a coutume de nommer littérature, le travail de collecte auquel s’est livrée Svetlana Alexievitch pour composer ce livre aboutit à cet objet littéraire, certes non identifié, mais d’une puissance d’évocation que j’ai rarement rencontrée dans des romans plus traditionnels.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, littérature, prix nobel de llittérature, communisme, totalitarisme, staline, stalinisme, goulag, karaganda, urss, vladimir poutine
vendredi, 06 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
SVETLANA ALEXIEVITCH
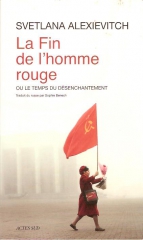 1
1
Quel livre terrible que La Fin de l’homme rouge, ce gros livre (542 pages grand format) de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. Pour situer le cadre, disons que l’auteur s’est faite journaliste pour recueillir des dizaines de témoignages, chez les gens les plus divers, en les interrogeant non sur l’URSS, Staline ou le Communisme, mais sur la façon dont leur vie quotidienne se déroulait concrètement. On n’est pas dans les généralités abstraites et les grands principes. On est dans la réalité tangible d’existences particulières.
Svetlana Alexievitch a fait de cette façon de procéder une véritable méthode de composition littéraire. Les fines bouches pourront bien dire qu’en laissant la parole à d’autres, l’auteur évite d’avoir à surmonter l’épineux problème de l’écriture et du style, et qu’à la limite, ce n’est donc pas de la littérature. Certes.
Je répondrai que l’empilement de témoignages qui sont autant de cas particuliers, formulés dans des registres de langue extrêmement divers (du populaire au très soigné), finit par produire un effet saisissant de généralité, dont se dégage un vrai point de vue sur un monde, à la fois vaste et profond, comme dans les romans de Balzac. Comme dans la grande littérature. Une plongée terrifiante au cœur de la vie dans le système totalitaire mis en place par Staline (mais déjà, Lénine avait montré ce dont il était capable).
Ce que les gens racontent dans le micro de l’auteur recouvre une période de temps très large, qui va, en gros, de la « grande guerre patriotique » (1941-1945), et même un peu avant, à nos jours, y compris le moment de bascule du communisme au capitalisme, que la phase de transition qui s’est appelée la perestroïka (Gorbatchev) a sinon provoqué, du moins facilité. Quelques interlocuteurs évoquent, au sujet du dernier maître du Kremlin communiste, la « faiblesse » de Mikhaïl Gorbatchev.
C’est vrai que, vu rétrospectivement, le système soviétique finissant ne tenait plus que par l’extrême rigidité de ses structures bureaucratiques, et Gorbatchev a peut-être commis l’erreur de juger qu’on pouvait instiller une dose de souplesse dans un édifice qui, sclérosé de la base au sommet, n’attendait qu’une chiquenaude pour s’écrouler brutalement : « Sans Terreur, tout va s’écrouler en un clin d’œil » (p.324), dit assez justement un ancien exécuteur politique, qui s’était fait prescrire des massages de la main droite pour soigner les crampes qu’il avait le soir, quand il avait dû appuyer trop souvent sur la queue de détente (c'est le vrai nom de la "gâchette") de son revolver dans la journée, dans les caves de la Loubianka.
Reste que le livre de Svetlana Alexievitch, en offrant au lecteur de plonger dans l’avant et dans l’après, permet de mesurer la profondeur et l’intensité du malheur auquel le peuple russe, dans son immense majorité, semble destiné. Toutes sortes de « profils » s’y côtoient, du plus humble ouvrier jusqu’à l’ancien colonel devenu un entrepreneur prospère (émigré au Canada).
Les récits où la cruauté du système soviétique apparaît en pleine lumière sont légion. Par exemple celui-ci, d’un homme dont la femme a été arrêtée par le NKVD, comme beaucoup de ses amis : « A la dernière réunion du Parti, quand on avait récité la litanie des félicitations au camarade Staline, toute la salle s’était levée. Il y avait eu une tempête d’ovations. "Gloire au camarade Staline, l’organisateur et l’inspirateur de nos victoires ! Gloire à Staline ! Gloire à notre Guide !" Cela a duré un quart d’heure, une demi-heure … Tous les gens se regardaient, mais personne ne voulait être le premier à se rasseoir. Ils restaient assis. Et, je ne sais pas pourquoi, je me suis assis. Machinalement. Deux hommes en civil se sont approchés de moi : "Pourquoi vous êtes-vous assis, camarade ?" Je me suis levé d’un bond » (p.211). Inutile de dire que les ennuis ne faisaient que commencer. Sur le bureau du juge d’instruction, il reconnaît l’écriture de son voisin dans la lettre qui le dénonçait, celui qui a ressorti à la police, mot à mot, les conversations que sa femme et lui avaient en sa présence.
Dans la cellule de cinquante personnes où il est enfermé, il raconte l’histoire drôle qui a envoyé son narrateur dans les griffes de la police politique : « Il y a un portrait de Staline au mur, un conférencier fait un exposé sur Staline, un chœur chante une chanson sur Staline, un artiste déclame un poème sur Staline … Qu’est-ce que c’est ? Une soirée consacrée au centenaire de la mort de Pouchkine ». Ce genre d’histoire abonde dans le livre, et donne une idée de la glaciation totalitaire qui a immobilisé le pays tout entier pendant soixante-dix ans.
Les seules échappatoires qui offraient aux gens une issue de secours, une soupape de sûreté, étaient l’alcool, les livres et la cuisine. Pas le mitonnage de petits plats, mais la pièce où on les prépare. Les « réunions » qui s’y déroulent n’ont rien d’officiel, et c’est le seul endroit où les propos sont à peu près libres, si l’on excepte les délateurs possibles, mais aussi les éventuels micros, vers lesquels on se retourne parfois, par défi, pour s’adresser au flic censé écouter.
Autre histoire de dénonciation, p.87 : deux femmes sont très amies, elles ont chacune une fille. L’une, un jour, quand elle est arrêtée, demande à l’autre de veiller sur sa fille. Dix-sept ans après, quand elle revient, elle baise les pieds de son amie, pour avoir veillé sur l'enfant. Et puis un jour où elle peut consulter le dossier qui l’a envoyée en camp, quand elle découvre que la lettre de dénonciation avait été écrite par cette « meilleure amie », elle se pend.
Autre histoire encore : « Mais oncle Vania est revenu … Sans dents, avec une main desséchée et un foie hypertrophié. Il a recommencé à travailler dans son usine, au même poste, il était dans la même pièce, le même bureau … (Il allume une autre cigarette.) Et celui qui l’avait dénoncé était assis en face de lui. Tout le monde le savait, et oncle Vania le savait aussi … Ils allaient aux réunions et aux manifestations, comme avant » (p.321).
Sans commentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, urss, staline, stalinisme, communisme, totalitarisme, grande guerre patriotique, kremlin, mikhaïl gorbatchev, perestroïka, loubianka, nkvd


