mercredi, 02 septembre 2015
KADARÉ : LE PALAIS DES RÊVES
 MES LECTURES DE PLAGE 2
MES LECTURES DE PLAGE 2
C’est l’histoire de Mark-Alem Kuprili qui, grâce à l’appui de son oncle le Vizir, devient un fonctionnaire de l’Etat dans cette vaste institution qui s’appelle le « Palais des Rêves ». Nous sommes dans l’empire ottoman. Il me semble que le palais est évoqué dans La Niche de la honte. Ce roman est formidable, y compris au sens étymologique du mot. A cause de son actualité : nous ne vivons pas dans un régime totalitaire, mais.
Les Kuprili sont une vieille et grande famille qui a donné à l’Etat cinq premiers ministres et une foule d’autres serviteurs à des rangs moins en vue : « … cette famille qui, aujourd’hui encore, malgré son relatif effacement, demeurait l’un des piliers de l’Empire, la première à avoir lancé l’idée de la reconstruction du grand Etat sous la forme des E.U.O. (Etats-Unis ottomans), la seule famille, avec la dynastie impériale, à figurer dans le Larousse, et cela à la lettre K, avec la notice suivante : "KÖPRÜLÜ : grande famille albanaise dont cinq membres furent, de 1666 à 1710, grands vizirs de l’empire ottoman", famille à la porte de laquelle, enfin, venaient frapper timidement les hauts fonctionnaires de l’Etat pour solliciter protection, avancement, intercession en vue d’une grâce … ». Mon Larousse 1903 confirme à peu près, sauf qu’il date le début de cette puissante famille de 1656. Et qu’il orthographie le nom « Kupruli ou Koproli ».
Mark-Alem pénètre donc un jour dans ce fameux et redouté Palais des Rêves comme un tout petit fonctionnaire. La première impression est qu’il entre dans un désert absolument immense, où il a d’abord le sentiment angoissant de se perdre, tant à cause des dimensions prodigieuses de l’édifice que de l’absence totale d’indications qui lui permettraient de s’orienter.
Il tombe presque par hasard sur un responsable, qui semble ne pas le voir puis qui, ayant pris la lettre de recommandation donnée par l’oncle, la brûle instantanément : « Au Tabir Sarrail, on n’accepte pas les recommandations, c’est foncièrement contraire à l’esprit de cette institution ». Inquiet, Mar-Alem écoute la suite : « Le fondement du Tabir Sarrail est non point l’ouverture, mais, au contraire, la fermeture aux influences extérieures, non point l’ouverture, mais l’isolement, et, partant, non pas la recommandation, mais précisément son opposé. Malgré tout, à compter d’aujourd’hui, tu es nommé à ce Palais ». Que peut bien être l’opposé de la recommandation ? Passons.
Mark-Alem est d’abord affecté au service de la Sélection (pas tout à fait en bas de l’échelle, puisqu’il est supérieur aux simples copistes). Il s’assied à la place qui lui est assignée, tout comme les innombrables employés du service déjà au travail. Il s’agit de faire le tri, dans l’épais dossier qui lui est confié, des récits de rêves qui sont parvenus au Palais des endroits les plus reculés de l’Empire. Car tous les sujets sont tenus, lorsqu’ils font un rêve qui leur semble particulièrement signifiant, de rejoindre l’office de collecte le plus proche de leur domicile et de le raconter au fonctionnaire préposé à cette tâche, qui le transcrit fidèlement, et cela quel que soit le temps ou la saison.
La date, le lieu, le nom du rêveur sont soigneusement précisés sur la feuille. Un service de voitures a pour tâche exclusive de réceptionner régulièrement les rêves produits et de les acheminer à la capitale, où un personnel ad hoc est là vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les rassembler en de volumineux dossiers. Certains rêves recèlent un contenu tellement épouvantable que le cheval refuse obstinément d'avancer : une procédure exceptionnelle permet de le retirer et de le détruire.
La tâche de Sélection des rêves consiste à jeter les insignifiants et à conserver les autres pour les envoyer au service de l’Interprétation, auquel Mark-Alem ne tardera d’ailleurs pas à être affecté. Cette promotion l’étonnera. Mais la responsabilité est aussi plus grande : il s’agit de ne commettre aucun impair et aucune erreur, car le cheminement du rêve est soigneusement enregistré, étape par étape et fonctionnaire par fonctionnaire. Les erreurs d'appréciation peuvent être durement sanctionnées.
Les rêveurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri de sanctions : Mark-Alem assiste à l’interrogatoire de l’un d’eux. Les policiers du rêve veulent en savoir plus. Après plusieurs dizaines de pages de procès-verbal et plusieurs jours d’interrogatoire, il voit sortir du bureau un cercueil porté par quatre hommes. On pense évidemment à la Loubianka et aux méthodes du KGB.
Les rêves se rangent ensuite dans quelques grandes catégories thématiques, qui vont du simple délire et du rêve fabriqué jusqu’au complot contre l’Etat. Régulièrement, parmi les dizaines ou centaines de milliers de rêves ainsi collectés, se voit élire le « Maître-Rêve », indispensable au Sultan dans la bonne administration de l’Empire, pour prévenir les problèmes ou pour déjouer les manœuvres qui pourraient viser à l’affaiblir ou à le renverser.
On l’a compris, Le Palais des Rêves raconte sur le mode fictionnel, comment se met en place une Police de la Pensée dans un régime totalitaire. Les décisions concernant les hommes tombent de tout en haut sans que quiconque puisse en comprendre le motif. L’arbitraire règne en maître. C’est ainsi que Mark-Alem, du rang de minuscule fonctionnaire qui était le sien au début, finira par être bombardé Directeur Général du Palais des Rêves, sans comprendre les raisons d’une telle faveur.
Mark-Alem a compris que sa puissance apparente est éminemment fragile. Il pense en effet à son oncle le Vizir qui, peut-être enivré de sa position dominante, s’est permis d’organiser dans son palais une fête grandiose au cours de laquelle il comptait faire chanter la grande ballade albanaise en l’honneur des Kuprili.
La sanction n’a pas tardé : alors que la fête bat son plein et que les musiciens s’apprêtent à se produire, une foule d’hommes en armes fait irruption. Les trois musiciens sont poignardés, le Vizir emmené. On apprendra plus tard qu’il a été proprement décapité. Comme quoi il n’y a pas qu’à Rome que « la roche tarpéïenne est proche du Capitole ».
Ismaïl Kadaré semble avoir pour obsession littéraire la description méticuleuse de la façon dont s’installe et perdure un système totalitaire, et des méthodes qui sont les siennes pour terroriser la population : les yeux se font inquiets quand on évoque le Palais des Rêves, qui semble enveloppé d’un mystérieux brouillard de crainte.
Beau livre, qui m’a fait penser (pour ce qui est du thème) à La Niche de la honte et à La Pyramide, du même auteur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, albanie, enver hodja, dictature, empire ottoman, totalitarisme, police de la pensée, la niche de la honte, le palais des rêves, urss, kgb, loubianka, kadaré la pyramide
lundi, 31 août 2015
KADARÉ : LE MONSTRE
 MES LECTURES DE PLAGE 1
MES LECTURES DE PLAGE 1
Je viens encore de lire un livre d’Ismaïl Kadaré, écrivain albanais qui a vécu sous la dictature communiste d’Enver Hoxha (Hodja), ce tyran qui a réussi à se brouiller avec ses copains Brejnev et Mao, sans doute pas assez méchants à ses yeux. Il est intitulé Le Monstre. Je n’ai rien compris à ce livre.
Présenté comme « le plus étrange et le plus original d’Ismaïl Kadaré », je l’ai personnellement perçu comme un livre compliqué. On nous dit, en quatrième de couverture, que « Le Monstre est un roman sur la terreur politique qui plonge un pays tout entier dans les affres ». Je veux bien, mais alors, il faut, de la part du lecteur, une grande prédisposition à la métaphore et à l’allégorie. Je suppose que je manque d'une prédisposition minimale.
L’action se situe de toute évidence à Tirana. Dans un vaste terrain vague, on voit un jour un vieux fourgon abandonné. Mais ce fourgon, n’est-ce pas plutôt un cheval ? Et plus précisément un énorme cheval de bois ? Dans le fourgon-cheval, en tout cas, logent une demi-douzaine de personnages : le Constructeur, Acamante (le seul apparemment qui ait le droit de sortir du cheval et d’aller dans le monde : il rapporte les journaux), Max, Milosh, Robert. Et puis, il y a Ulysse K. Au sol, dans le ventre du cheval, une vieille lance rouillée.
Et puis il y a l’histoire des amoureux, sur laquelle s’ouvre (presque, c’est le chapitre II) le livre : Gent Ruvina, promis à un brillant avenir, et à ce titre, qui est allé étudier à l’étranger, doit rentrer la queue basse en Albanie lorsque les relations avec Moscou se sont détériorées. De ce fait, il est auréolé d’un certain prestige. Il tombe amoureux de Léna, que tout le monde surnomme « Hélène de Troie », et avec qui il a échangé un vrai baiser lors d'une soirée. Mais si elle est plus belle que toutes les autres, elle n'est pas simple. Elle est promise à Max.
Quand elle se fiance officiellement à Max, Gent Ruvina décide de l’enlever (semble-t-il une coutume albanaise, mais on pense évidemment à Pâris, Hélène et Ménélas), le soir même, en l’emmenant dans un taxi, qui a stationné longuement sous les fenêtres, sans que personne ne se pose de questions. Max jure de se venger, et de planter la pointe de sa lance rouillée dans la poitrine de la promise et dans le dos du rival chanceux.
Gent Ruvina a commencé à travailler à une thèse sur les hypothèses qu’on doit pouvoir faire pour comprendre la signification du poème d’Homère, L’Iliade, en particulier la ruse du cheval en bois, que les Grecs ont manigancée pour affaiblir les défenses de la ville en endormant la méfiance des guerriers.
Ce livre entremêle le passé et le présent, le mythe et la réalité, l’ailleurs et l’ici, bref, il multiplie les doubles-fonds et les arrière-boutiques. Le lecteur que je suis a lu sans déplaisir ce curieux livre, tout en se demandant où l’auteur voulait en venir et ce qu’il avait derrière la tête.
Là-dessus, arrive un chapitre « rédigé » par Laocoon, ce Troyen qui ne croit pas à la sincérité des Achéens (« Timeo Danaos et dona ferentes », que reconnaîtront tous ceux qui ont sué sur L’Enéide), et qui finit par se mettre à dos le roi Priam en personne, précipitant la chute de la ville.
Laocoon, c’est ce personnage qui projette une lance qui va se ficher dans le ventre du cheval, faisant longuement résonner la structure, puis qui est puni de son audace, en mourant dans les anneaux du serpent envoyé par les dieux. Dans Le Monstre, on voit un petit Laocoon de la foule venue voir, se contenter de fracasser une bouteille de bière en la projetant sur la construction. On le retrouvera mort (ou peut-être pas).
Gent Ruvina épousera Léna. On les retrouve à la fin du livre, sur une route de campagne à l’écart de la ville, où l’on découvrira un couple qui a été assassiné : la femme, étendue sur le dos, porte dans la poitrine une horrible blessure provoquée par une arme étrange, sans doute de collection ou de musée. Une vieille lance rouillée ? Quant à l’homme, il porte sous l’omoplate une semblable blessure. Le meurtrier les a confondus avec nos « héros ». Au fait, j'oubliais de préciser que Léna est enceinte.
Bon, Tirana, c’est Troie, je veux bien. Max est Ménélas venu récupérer sa femme, je veux bien. Léna est Hélène de Troie, je veux bien. Mais pour le reste ? J'ai du mal à décalquer le mythe de Troie sur l'Albanie totalitaire. Je ne vois pas de cohérence dans la métaphore savante développée par l’auteur. Je me dis que les communistes d’Enver Hodja ont bien dû percevoir quelque chose d’une critique du régime, puisqu’ils ont interdit le livre à sa sortie en 1965. Mais bien des aspects du problème m’échappent. Je dois manquer de subtilité.
Il manque une notice explicative à ce livre décidément compliqué.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, le monstre, albanie, enver hodja
lundi, 06 juillet 2015
ISMAÏL KADARÉ : LA PYRAMIDE
FEUILLETON GREC
La question est (aussi, entre autres) de savoir si François Hollande cessera enfin d'être le « Grand Léchant Mou » auquel la dernière élection présidentielle a condamné la France, et s'il osera mettre le poing sur la table en opposant, face à Merkel et compagnie, un VETO décidé à la sortie de la Grèce de la zone euro. Sois un homme, François, au moins une fois dans ta vie. Montre que tu en as ! On attend que tu dises à Angela Merkel : « Avant de bouter la Grèce hors d'Europe, il faudra que tu me passes sur le corps ». Il n'est d'ailleurs pas dit que Brünnhilde hésiterait à le faire. Ce serait même une occasion pour les caméras de télévision de fixer pour l'éternité une scène hautement historique. Et ... délectable. Et sans doute pornographique.
Vas-y, Grand Léchant Mou ! Te dégonfle pas !
******************************************
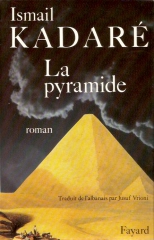 Ismaïl Kadaré vient de publier un petit ouvrage autobiographique où il est question de sa mère. Il paraît que c’est habituel : parvenu sur ses vieux jours, on a tendance à se retourner sur les premiers. Il a été traduit par Tedi Papavrami (né en 1971), le virtuose du violon. Je n’ai pas, au moins a priori, très envie de le lire (voir mes billets 28-29 mai et 17 juin). Kadaré est né dans la même ville d'Albanie du sud qu'Enver Hodja, le dictateur qui a terrorisé le pays : Gjirokastër.
Ismaïl Kadaré vient de publier un petit ouvrage autobiographique où il est question de sa mère. Il paraît que c’est habituel : parvenu sur ses vieux jours, on a tendance à se retourner sur les premiers. Il a été traduit par Tedi Papavrami (né en 1971), le virtuose du violon. Je n’ai pas, au moins a priori, très envie de le lire (voir mes billets 28-29 mai et 17 juin). Kadaré est né dans la même ville d'Albanie du sud qu'Enver Hodja, le dictateur qui a terrorisé le pays : Gjirokastër.
Heureusement, il a écrit beaucoup de beaux romans. Je viens de lire La Pyramide, aperçu dernièrement dans la vitrine du Livre à Lili, et acheté deux euros, en me disant que les livres ne valent plus grand-chose de nos jours : le prix des occasions en est un signe, qui invite à la mélancolie ceux qui ont toujours vécu entourés de bouquins.
La Pyramide raconte l’édification de la plus grande que l’Egypte ait jamais construite : celle de Chéops. Mais qu’on ne s’y trompe pas : malgré la solide documentation que Kadaré s’est procurée en égyptologie ancienne, ce n’est pas un livre sur l’histoire du pays : c'est bel et bien un roman, mais sur la façon dont procède, de la façon la plus générale, tout pouvoir totalitaire pour assujettir durablement la population. Après La Niche de la honte (l’empire ottoman, voir billet du 17 juin), nous voilà replongés dans le totalitaire, quoique d’une tout autre manière.
Tout l’argument du livre est contenu dans les quinze premières pages. Quand le pharaon déclare qu’il refuse de se faire construire un tombeau, les grands-prêtres du royaume sont catastrophés. Après s’être fiévreusement penchés sur les plus vieilles archives du royaume (les « vieux papyrus »), ils reviennent auprès de Chéops, dans le but de l’éclairer sur les véritables raisons qui ont poussé ses prédécesseurs et ses ancêtres à édifier chacun sa pyramide.
Et ce qu’ils ont trouvé dans les archives ne peut qu’intéresser le pharaon. Si les rois d’Egypte, depuis Djoser, ont tous tenu à avoir leur pyramide, « l’idée de cette construction n’avait à l’origine aucun rapport avec un tombeau ni avec le trépas ». Les prêtres ont conclu de leurs recherches que « l’idée de la pyramide, Majesté, a vu le jour en temps de crise ». Mais attention, pas n’importe quelle sorte de crise : une crise du pouvoir. Et ça, ça commence à l'intéresser, Chéops.
En effet, dans le passé, on s’est aperçu que, lorsque le pouvoir était affaibli, ce n’était pas à cause des mauvaises récoltes ou de la peste, mais au contraire, à cause de l’abondance et du bien-être ! On doit en déduire que le bien-être du peuple est nuisible au pouvoir : « … le bien-être, en rendant les gens indépendants, plus libres d’esprit, les faisait aussi plus rétifs à l’autorité en général et notamment au pouvoir pharaonien … ». Le message de l’astrologue envoyé au Sahara, pour méditer sur les solutions possibles, fut tout à fait clair : « … il fallait éliminer le bien-être ».
Oui, mais comment obtenir ce résultat de la manière la plus efficace ? Il fallait sans doute lancer le pays dans des travaux grandioses, dont les canaux mésopotamiens offraient alors un exemple. Sans compter tout le profit économique que le pays aux deux fleuves en a tirés.
Mais l’Egypte se devait de faire mieux : « Entreprendre une œuvre qui passât l’imagination, dont les effets seraient d’autant plus débilitants et anémiants pour ses habitants qu’elle serait plus colossale. Bref, quelque chose d’épuisant, de destructeur pour le corps et l’esprit, et d’absolument inutile. Ou, plus exactement, une œuvre aussi inutile pour les sujets qu’elle serait indispensable à l’Etat ». Quasiment une définition du totalitarisme.
Ce n’est qu’après cette intense réflexion qu’a germé l’idée de construire un tombeau monumental. Je passe sur les détails qui ont précédé le choix (un rempart autour de l’Egypte ? un trou sans fond ? …). Inutile d’ajouter que Chéops a vite fait de se convertir à l’idée de la pyramide, cette forme pointant vers le ciel avec lequel elle semble s’unir, et préparant la future célestisation du pharaon. Hemiounou le grand-prêtre ajoute, pour définir la fonction de la pyramide : « Au premier chef, elle est pouvoir, Majesté ». Bien vu.
Ce premier chapitre est un chef d'œuvre de mise en place romanesque. Il condense magistralement l’exposé des motifs de tout système totalitaire. Tout le reste du bouquin déroule avec méthode les implications logiques de la chose. Chaque chapitre vient préciser un aspect du système, si bien qu’au bout du compte, rien n’a été oublié.
Très vite, le peuple égyptien mesure le poids de la poigne de fer impitoyable qui vient de s’abattre sur lui : les moindres compartiments de l’existence de tous les individus ont été catalogués, et nul ne peut échapper à la case qu’on a prévue pour lui. Et la vie des individus ne pèse pas bien lourd, que ce soit entre les mains des policiers pharaoniques ou sur la trajectoire d'une pierre hors de contrôle (Kadaré semble avoir trouvé quelque par le nombre exact de ce qu'il a fallu pour édifier la pyramide).
Je n’ai pas envie d’inventorier toutes les richesses de ce livre. Ismaïl Kadaré a pensé à tout. Juste une mention pour le chapitre X (sur XVII), intitulé « L’hiver du soupçon général », qui rappelle qu’un totalitarisme fait de tout citoyen l’espion ou le flic de tous les autres, et de la délation un moyen peu coûteux de faire régner l’ordre (et la terreur). Une façon d’écraser jusqu’à la vie quotidienne de chacun.
Ah, encore un détail : la pente de la pyramide de Chéops n’est pas de 45°, mais de 52°. Je n’ai pas vérifié l’exactitude de l’information.
Ismaïl Kadaré a écrit ce livre entre Tirana et Paris, de 1988 à 1992. Hodja, le dictateur albanais, est mort en 1985, le Mur en 1989, l’URSS en 1991. Autrement dit, l’écriture a comme accompagné la fin d’un monde. Il va de soi que l’Egypte est une métaphore du totalitarisme en général.
L’auteur peint ici un tableau absolument magistral de ce système inhumain.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : juste pour dire à quoi m'a fait penser la momie du pharaon (il y a dans le livre des scènes qui sentent un peu fort, avec les pillards). Il y a dans Wunderkind, de Nikolai Grozni (dont j'ai parlé ici l'an dernier), une scène scolaire, après la visite au mausolée où dort la momie du "Père de la nation bulgare" : « Tu trouves ça drôle, Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. − Qu'on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l'empêcher de puer ». Bon appétit.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, françois hollande, angela merkel, zone euro, europe, littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, tedi papavrami, enver hodja, gjirokastër, albanie, kadaré la pyramide, égypte, pyramide de khéops, le livre à lili, kadaré la niche de la honte, empire ottoman, pharaon chéops, totalitarisme, union soviétique
mercredi, 17 juin 2015
KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE
 Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,
Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.
Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.
C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.
Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.
Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.
Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.
L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).
Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.
Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.
Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.
Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.
Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.
C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.
L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.
D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».
Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.
Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.
Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.
Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe

