jeudi, 15 septembre 2022
CEUX QUI ONT LA SOLUTION
Je sais pas vous, mais il y a quelque chose, dans le paysage de notre monde mal barré, qui me fait toujours autant rire, braire et m'apitoyer, dans la façon dont "certains" (en français : des intellos) évoquent les problèmes, les situations et même les événements. A les écouter, ces braves gens, il suffirait de prendre au sérieux leurs propos et appliquer les recettes qu'ils mettent sur la table, pour que les problèmes se résolvent et que les situations s'éclaircissent. A cet effet, ils disposent d'un « Sésame, ouvre-toi ! » dans l'immémoriale expression IL FAUT.
Je me souviens que le journal Le Monde a publié dans ses pages, dans les années 1970, toute une série de dessins d'un nommé Konk, une série intitulée "Faukon, Yaka et Pitucé" (pas besoin de traduire), où il se moquait de ces gouvernants de comptoirs qui détiennent, après quelques apéros, les clés de la bonne gouvernance du pays. La collaboration n'a pas duré trop longtemps, car assez vite on a vu Konk aller mouvoir ses nageoires dans les eaux sales voisines du Front National de Jean-Marie Le Pen, voire dans diverses cellules et officines un peu plus "musclées". Au Monde, on a dit : "Pas de ça, Lisette". On le comprend.
Reste que je demeure abasourdi quand, dans les pages du même Monde, il m'arrive encore de tomber sur des titres contenant la formule sacramentelle autant que passe-partout : il faut. Ces titres, on les trouve en général dans les pages "Débats" du journal. Alors bien sûr ce sont des collectifs, des trios, des tandems ou des individus qui profèrent l'expression fatidique et qui n'engagent nullement la responsabilité du quotidien.
Tous les titres qui figurent dans la petite rafale ci-dessous sont tirés de numéros récents, témoignant de l'étonnante santé d'une formule dont je subodore qu'elle ne doit sa survie qu'à l'indéracinable dose d'espoir qui, chez les humains, signifie l'impossibilité absolue (ou presque) de renoncer à envisager le futur en fermant la porte au nez des lendemains qui chantent. « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher », dit quelque part Jorge Luis Borgès. C'est exactement là que l'homme commence à rêver. C'est là qu'on franchit la frontière de l'imagination. La formule "il faut", c'est empêcher la porte des possibles de se refermer.
A cet égard, j'aime particulièrement les articles de fond produits par des journalistes sérieux et si possible chevronnés, et construits comme des dissertations normales ou comme des notes de synthèse, vous savez : 1 - constat ; 2 - causes ; 3 - perspectives. La troisième partie doit faire la preuve que la situation n'est pas désespérée. Ensuite, le rédacteur est invité à faire preuve d'ingéniosité pour éviter le grossier "il faut". Car la langue française abonde en ressources diverses et en moyens astucieux de tourner autour du "il faut".
En général, j'admire de tels articles aussi longtemps qu'ils décrivent le problème dans tous ses aspects et qu'ils entreprennent d'expliquer l'origine de ce problème : la virtuosité du journaliste peut se donner libre cours. Et puis vient la troisième partie, et patatras ! le cousu de fil blanc apparaît en pleine lumière. L'auteur de l'article y va de ses solutions, de ses propositions, de ses hypothèses, des mesures et des décisions à prendre. Mais il aura beau mettre en œuvre tout son talent pour costumer et grimer le "il faut" sous toutes sortes de fards et de fonds de teint, il butera immanquablement sur le mur du "comment on fait ?". Autrement dit : comment on passe du virtuel au concret ?
La petite suite que je présente ci-dessous n'est qu'un modeste échantillon (été 2022) des manifestations du pouvoir du "il faut" dans les cerveaux de ceux dont le métier est de penser.
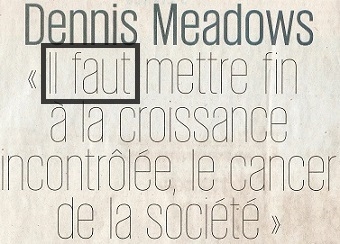
Ouais, t'as bien raison, mais tu peux nous dire comment on fait, monsieur le savant ?
***

Le Système ? Ouais, l'idée est bonne. Reste plus qu'à nous dire
COMMENT ON FAIT,
crâne de piaf !!!
***

Ouais, tout le monde va se mettre autour de la table, comme un gros tas de chouettes copains ! On va dire ça à l'Egypte, au Soudan et à l'Ethiopie pour le partage des eaux du Nil. On dira ça à la Turquie, à la Syrie et à l'Irak pour le partage des eaux du Tigre et de l'Euphrate. On dira ça ...
***

Ah, l'implication des citoyens, un beau cheval de retour ! Allez, on vous fera de splendides "Conventions Citoyennes" ! Monsieur Macron aura plein la bouche de beaux discours ! On appellera ça "concertation", et au bout du compte, personne ne sera satisfait.
***

Celui-ci, je le trouve particulièrement réjouissant : il me fait penser à une "évaluation à l'entrée en seconde" dont j'ai eu à connaître jadis. Parmi les 32 items des "objectifs" (on ne jurait alors que par la "pédagogie par objectifs"), le premier stipulait cette commination impérieuse et porteuse de tout le programme élaboré par la cohorte des crânes d'œuf qui préside depuis cinquante ans aux destinées de l'Education Nationale, pour le plus grand malheur de celle-ci et de la France : « MAÎTRISER L'ORTHOGRAPHE ». Il aurait fallu demander sa recette au crâne d'œuf. Dans le cas présent, je m'interroge : l'auteur peut-il me citer une période où l'humanité fut gardienne de la planète ("redevenir") ?
***
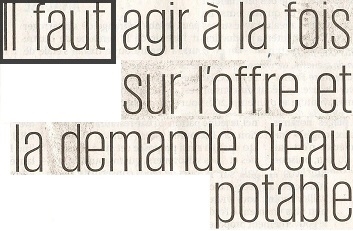
Traduction : attendez-vous à des restrictions !
***
Günther Anders est un philosophe. Il est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage qui m'a profondément marqué : L'Obsolescence de l'homme, dans lequel il propose le concept de "honte prométhéenne" qui, à mon avis, résume et condense tout le problème des relations entre l'homme et la technique. "Prométhée", c'est l'audace, l'énergie, la créativité, l'inventivité phénoménales dont est capable l'humanité. "Honte", parce que l'homme se rend compte qu'il a donné naissance à des forces sur lesquelles il n'a plus aucune prise (exemple de la bombe atomique). Des forces incommensurables à sa petitesse : les Lilliputiens ont fabriqué Gulliver. Ils ont créé un "Golem".
Dans son bouquin, il évoque la figure d'Ernst Bloch, autre figure de la philosophie germanique, auteur, entre autres, de Le Principe espérance., mais c'est pour lui faire un reproche : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer, ne serait-ce qu'un moment ». Si Günther Anders avait été haut fonctionnaire obligé de rédiger une note de synthèse pour un ministre, nul doute qu'il aurait soigné les parties 1 - constat et 2 - analyse des causes, et qu'il aurait arrêté là son texte.
Pour lui, toutes les solutions partielles sont des illusions, voire des impostures. Pour lui, tous les "il faut" qui tentent d'aménager tel ou tel aspect du problème, et non de s'attaquer à la racine de celui-ci, sont autant de mensonges. Pour lui, c'est tout l'édifice de notre civilisation fondée sur la confiance aveugle en les bienfaits de la technique qui est une erreur à la base. Günther Anders reste un des seuls (le seul ?) à ne pas nous beurrer la tartine et à refuser de toujours "finir sur une note d'espoir".
CESSER D'ESPÉRER. Autrement dit : arrêter de rêver tout éveillé. Autrement dit : du tragique en philosophie. C'est ça que ça veut dire, "regarder la réalité en face".
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, journalistes, konk, front national, jean-marie le pen, emmanuel macron, président de la république, convention citoyenne, dennis meadows, joëlle zask, günther anders, l'obsolescence de l'homme, ernst bloch, le principe espérance, honte prométhéenne
vendredi, 24 décembre 2021
AMIN MAALOUF : LE NAUFRAGE DES CIVILISATIONS

Je viens de lire Le Naufrage des civilisations, livre écrit par Amin Maalouf (Grasset, 2019). Le seul titre en dit déjà long sur la filiation dans laquelle s'inscrit l'auteur. Je citerai pêle-mêle Comment tout peut s'effondrer (Seuil, 2015) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens ; L'Humanité en péril (Flammarion, 2019) de Fred Vargas ; L'Âge de la régression (Premier parallèle, 2017), ouvrage collectif ; Au Temps des catastrophes (La Découverte, 2009) d'Isabelle Stengers ; Le Basculement du monde (La Découverte, 1997) de Michel Beaud. Il y en a pas mal d'autres, évidemment, et de plus marquants. Au premier rang, je citerai Günther Anders, le plus radical, avec L'Obsolescence de l'homme (L'Encyclopédie des nuisances et Ivréa, 2002). C'est dans cet ouvrage que l'on trouve une idée qui bouscule très fort.
La plupart des gens dits sérieux ne cessent de penser et de dire que la technique et la science ne sont pas mauvaises en soi, mais seulement à cause des usages qui en sont faits. Il est ainsi de bon ton, entre gens de bonne compagnie, de distinguer entre les applications médicales des radiations nucléaires et la mise au point de la bombe atomique. Anders pense et dit, au contraire, que l'homme, en ne cessant de découvrir les lois les plus secrètes de la Nature (structure de l'atome, fonctionnement du cerveau ou de la cellule humaine, etc.) et d'inventer les machines que cette connaissance rend possibles, fabrique des objets et des processus incommensurables aux limites humaines.
Des objets et des processus tellement plus grands et plus puissants que lui qu'ils échappent à son contrôle, qu'il n'a plus aucune prise sur eux, et qu'il se retrouve en état de servitude par rapport à ses propres inventions. C'est à ce propos qu'il invente la belle expression de « honte prométhéenne », que tous les prosélytes exaltés de l'innovation à tout prix devraient méditer. Anders affirme que l'homme ne s'interdira jamais de mettre en œuvre une innovation, même si elle comporte des risques catastrophiques.
J'avoue ma surprise quand j'ai lu, à la page 300 du Naufrage des civilisations d'Amin Maalouf une phrase qui va dans le même sens : « C'est presque une loi de la nature humaine : tout ce que la science nous donne la capacité de faire, nous le ferons, un jour ou l'autre, sous quelque prétexte ». Malheureusement, l'auteur poursuit : « Du moins tant que les avantages nous sembleront supérieurs aux inconvénients ». Et c'est là que le bât blesse : il a clairement l'intuition que l'humanité court à la catastrophe, mais il redoute plus que tout les affirmations tranchées, voire péremptoires. C'en est au point qu'il n'hésite pas, dès qu'il le peut, à arrondir les angles trop marqués, à atténuer les formules propres à heurter, comme s'il n'osait pas. Ici, tout est dans le "presque" et le "du moins".
Cette obsession de la nuance qui court tout au long du livre en affadit selon moi le propos et en diminue la portée. J'en viens à me demander pourquoi il a accepté de garder un titre aussi violent ("Naufrage") pour couronner son travail d'écriture, que vient contredire son constant effort pour estomper les contrastes. Je comprends bien qu'Amin Maalouf ne tient pas à encourir le reproche souvent fait à l'époque présente de préférer l'anathème au débat démocratique et l'injure à l'argumentation rationnelle. Mais à mettre aussi fortement la demi-teinte à l'honneur, je me dis que c'est toute l'intention de l'ouvrage qui en pâtit. C'est l'impression qui a été la mienne quand je l'ai refermé.
Cela dit, il ne faut quand même pas s'y tromper : l'horizon du Naufrage des civilisations, c'est bien le fait que l'humanité est très mal embarquée. Ses chances de survie deviennent de plus en plus minces. La chose étonnante, et qui me laisse un peu sceptique, est qu'il voit l'origine première de cette course à l'abîme dans l'échec des nations arabes et musulmanes à s'ouvrir avec confiance au Progrès. A commencer par son pays d'origine, le Liban, mais aussi l'Egypte, qui sont passés pas loin de la chance que l'Histoire leur offrait de devenir des petits paradis.
L'évolution de ces deux pays (deux "paradis perdus" aux yeux de l'auteur) inspire à Amin Maalouf une immense tristesse : « A vrai dire, et je l'écris au soir de ma vie avec une infinie tristesse, au lieu de garder l'enfant et de jeter l'eau sale, on a fait l'inverse. On a jeté l'enfant pour ne garder que l'eau sale. Tout ce qui était prometteur s'est rabougri. Tout ce qui était inquiétant et malsain, et qu'on espérait provisoire, s'est installé plus solidement que jamais » (p.82).
L'auteur cite un certain nombre d'événements qui sont à l'origine de cet "état d'âme" destructeur, à commencer par la défaite arabe de 1967, soudaine, imparable, et qui n'a jamais été compensée ultérieurement par des succès : « Le drame que les Arabes d'aujourd'hui nomment simplement "Soixante-sept" fut donc une tournant décisif sur le chemin de la détresse et de la perdition » (p.167). A quelle sorte de « revanche » – militaire ou autre – jamais advenue pense-t-il (p.116) ? Il cite l'année 1973 et la "crise pétrolière" qui, en faisant pleuvoir dans les caisses des pays de la péninsule arabe et de quelques autres un Niagara de dollars faciles, a donné à des puissances rétrogrades tous les moyens de conforter leur pouvoir et le système politico-religieux sur lequel celui-ci est fondé, tout en ouvrant un boulevard aux "révolutions conservatrices" à venir.
L'auteur évoque aussi le cas de l'Iran que les Américains, en chassant le docteur Mossadegh du pouvoir à la demande, affirme-t-il, de Churchill, n'ont pas laissé le pays prendre le virage de la modernité heureuse. Ce faisant, ils ont sans le savoir préparé le chemin à l'ayatollah Khomeiny et à la plus spectaculaire entreprise de régression historique qui soit. Comme si la "nation arabe" souffrait de "haine de soi" : « Bien que risible, et irritante, cette absence de confiance en soi paraît néanmoins bénigne quand on la compare à ce qui émane du monde arabe depuis quelques années, à savoir cette profonde détestation de soi-même et des autres, accompagnée d'une glorification de la mort et des comportements suicidaires » (p.90).
Peut-on réellement voir dans l'incapacité de l'islam à consentir à l'évolution, à la critique, à la modernité l'origine de la décomposition du monde (titre de la dernière partie : "Un monde en décomposition") ? « C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde » (p.328). Tout bien pesé, l'hypothèse me paraît exagérée, bien que l'auteur y consacre la moitié du livre (ainsi qu'une part de la troisième partie) : d'accord pour voir les civilisations humaines confrontées comme jamais auparavant à des forces particulièrement dissolvantes, mais pas d’accord pour voir l'origine de cette dissolution généralisée dans l'évolution du seul monde arabe, ça me semble bien réducteur. Comme dit l'auteur lui-même à plusieurs reprises : « Les choses ne sont pas aussi simples ». Plus intéressante et convaincante m'apparaît l'idée de fixer à 1979 l’année où le monde a vraiment basculé. Même si ça déborde un peu sur les années précédente et suivante, ça fait un joli tir groupé, le fil des événements. Jugez plutôt.
En 1979, l'ayatollah Khomeiny chasse le shah Mohamed Réza Palavi et prend le pouvoir à Téhéran, porté par un peuple en folie : le journaliste Amin Maalouf, qui est alors sur place, n'a jamais vu une foule aussi dense dans les rues, une telle exaltation fanatique des masses populaires. En 1979, Margaret Thatcher l'intransigeante devient Premier Ministre de Grande Bretagne, bientôt suivie par Ronald Reagan, élu à la présidence des Etats-Unis. Le point commun ? L'auteur appelle ça la "Révolution Conservatrice". Pour faire bonne mesure, il ajoute l'arrivée au pouvoir à Pékin (pardon : Beijing) d'un certain Deng Xiao Ping, puis l'arrivée de Karol Wojtila sur le trône de Rome, avec son fameux "Non abbiate paura". Et puis il ajoute la fin annoncée de l'U.R.S.S. et les suites ultimes de la crise pétrolière. Ça commence à faire beaucoup. Oui, là, on se rend compte que quelque chose de fondamental s'est produit.
Amin Maalouf consent à examiner pour finir d'autres aspects de la décomposition du monde. Cela commence par la "tribalisation" généralisée : rétraction des groupes humains sur les frontières de leurs communautés respectives, revendication parfois fanatique de toutes sortes d’identités particulières en opposition avec les autres, la promotion médiatique insolente des fortunes échevelées en même temps que le creusement des inégalités, le surgissement du pouvoir de nuisance des « minorités » sur le sentiment de l’appartenance et de l’intérêt général, la difficulté apparemment de plus en plus grande de communautés à cohabiter ou même coexister avec d’autres.
Parmi les facteurs qui ont favorisé l’émergence du sentiment d’hostilité tous azimuts qui s’est répandu sur le monde, Amin Maalouf souligne avec une parfaite justesse l’erreur historique commise par les Etats-Unis lors de l’effondrement de l’U.R.S.S. Il regrette que ceux-ci n’aient pas pris exemple sur Nelson Mandela qui, quand il eut été mis fin au système d’apartheid, rendit visite à l’un des principaux acteurs de celui-ci pour lui affirmer qu’il n’y aurait pas de « vengeance » de la part des noirs.
Au contraire de Mandela, lorsque l’empire communiste éclata en 1991, avec les tentatives de réformes entamées par Gorbatchev (« glasnost » et « perestroïka »), et que des forces s’agitèrent en tout sens, faisant peser des menaces combien plus graves de désagrégation de l’autre puissance nucléaire, avec tout ce que l’on peut imaginer rétrospectivement, l’Amérique, à ce moment-là, a gâché les chances d’établir des relations enfin durablement pacifiées avec le géant russe.
Et même, au contraire, elle a profité de l’apparent K.O. de l’adversaire pour placer des pions dans sa proximité immédiate (Géorgie, pays baltes, Pologne, etc.). Et ce, malgré les avertissements de George F. Kennan, qui avait assez combattu le système communiste pour être pris au sérieux quand celui-ci s’est retrouvé à terre : « Il eut beau répéter qu’en humiliant les Russes, on allait favoriser la montée des courants nationalistes et militaristes, et retarder la marche du pays vers la démocratie, on n’a pas voulu l’écouter » (p.277).
Soit dit entre parenthèses, au lieu de s’alarmer de l’agressivité de Vladimir Poutine, qui est en train de masser des troupes à la frontière de l’Ukraine, on pourrait commencer par demander aux Américains de cesser d’approvisionner l’Ukraine en armes et en « conseillers » militaires, en passant par-dessus la tête des Européens, réduits à n’être que les spectateurs d’une confrontation, s’ils n’en sont pas un jour les victimes. Les U.S.A. n'en sont pas à une erreur historique près.
Pour conclure cette lecture de Le Naufrage des civilisations, d’Amin Maalouf, je dirai que j’en retiens avant tout le ton général : une « infinie tristesse ». Ce qui prime en effet, c’est le sentiment que le monde arabe a raté le « train de l’Histoire », et que non seulement la perte est irrémédiable, mais que tout est là pour que cette situation ne cesse de s’aggraver, sous les coups des groupes djihadistes, du conflit entre sunnites et chiites, des dissensions entre communautés et quelques autres raisons. Certes, quand l’auteur parle des « Arabes » en général, on serait en droit de lui demander ce qui lui permet de les mettre tous dans le même sac, mais il faut lui laisser ce sentiment d’appartenance à cette généralité.
J’ai cependant du mal à le suivre dans son analyse et à voir un lien de cause à effet entre ce qui se passe dans le monde arabe et ce qui se produit depuis quarante ans dans le monde globalisé. Et j’ai assez parlé de l’usage quasi-maniaque d’atténuatifs de toutes sortes, des affirmations les plus prudentes et modérées pour ne pas insister.
Il me restera de ce livre un témoignage fort : celui d’un homme en éveil resté toute sa vie très à l’écoute de tout ce qui l’entoure ; celui d’un humaniste qui nourrissait les plus grands espoirs d’épanouissement et d’émancipation pour l’espèce humaine ; mais pour finir celui d’un septuagénaire désenchanté, effaré et effrayé d’assister impuissant à la montée implacable des « ténèbres » qui menacent de nous engloutir.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, amin maalouf, arabes, liban, égypte, syrie, amin maalouf le naufrage des civilisations, pablo servigne, collapsologie, servigne comment tout peut s'effondreer, fred vargas l'humanité en péril, l'âge de la régression, isabelle stengers au temps des catastrophes, michel beaud le basculement du monde, günther anders l'obsolescence de l'homme, encyclopédie des nuisances, honte prométhéenne, ayatollah khomeiny

