mercredi, 21 mai 2014
HENRI GODARD ET CELINE
CELINE LE PESTIFÉRÉ
Henri Godard n’a pas eu de chance dans la vie. Etudiant en Lettres, il aurait pu tomber sur les sonnets de Louise Labé, la poésie de Jean-Baptiste Rousseau ou les œuvres de Jean-Baptiste Gresset. Autrement dit, des sujets pépères, tranquilles, sans risque. Mais non, à vingt ans, la marmite de potion magique dans laquelle il se précipite n’est autre que celle des écrits de Louis-Ferdinand Céline.
Et pas n’importe quel titre. Tout de suite c’est D’un Château l’autre. Toute de suite l'essentiel. Vous savez, le bouquin où le pestiféré raconte Sigmaringen (qu'il orthographie « Siegmaringen » par dérision), Pétain fini. Accessoirement, le bébé Philippe Druillet (il raconte ça dans son récent Délirium) y a été soigné par le docteur Destouches (= Céline), parce que son nazi de père s'y était aussi réfugié.
On est alors en 1957. Godard a vingt ans. Résultat, quand, en 2011, Henri Godard propose le nom de Céline et qu’une main administrative, ne voyant aucun obstacle à la chose, inscrit ce nom parmi les célébrations culturelles nationales prévues (c'est alors le cinquantenaire de sa mort), monsieur Serge Klarsfeld, brandissant l'étendard de la « lutte contre l'antisémitisme », obtient en deux jours de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, qu’il le raie d’un trait de plume. Rien que le nom de Céline est honni des juifs. Henri Godard n’a pas de chance. Qu'on se le dise : monsieur Serge Klarsfeld est au nombre de ceux qui font la police de la pensée.
Remarquez, ça finira par devenir une habitude chez les amateurs de pestiférés : tout récemment, une vente aux enchères d’objets nazis n’a-t-elle pas été interdite par le conseil des ventes, sur recommandation d’Aurélie Filipetti, ministre de la culture, elle-même interpellée par le vice-président du « Conseil Représentatif des Institutions Juives de France » (Crif), monsieur Jonathan Arfi qui, la vente étant tout à fait légale, se référait à des « valeurs morales ».
Rebelote et censure identique il y a quelques jours, mais cette fois à la demande du responsable d’un « Comité de vigilance contre l’antisémitisme » ! Aux chiottes la légalité ! Vive les « valeurs morales » ! Celles qui sont du bon côté, évidemment ! Ah mais ! Quand on met ces choses bout à bout, ça finit par faire beaucoup. En période d'Inquisition, tout le monde ouvre le parapluie (« barabli », comme on dit en alsacien).
Il ne me viendrait pas à l’idée de me porter acquéreur d’un objet au motif qu’il porte une croix gammée. Il faut être un brin azimuté pour aimer ça. Mais l’idée d'interdire aux amateurs confits dans le culte nostalgique du troisième Reich de satisfaire leur goût bizarre ne peut, à mon avis, germer que dans des cerveaux aussi malades que ceux-ci. Il faut déjà être vigoureusement cintré de la voûte pour avoir l'idée de créer quelque « comité de vigilance » pour protéger les juifs en France aujourd'hui ! Vive la paranoïa au pouvoir ! Pour être une bonne victime, il faut le crier le plus fort possible.
C’est fou quand on pense au nombre de cinglés/victimes qui ont comme principale raison de vivre (dont ils ont fait une raison sociale : « les associations ») de passer leur temps à scruter les mouvements de leurs ennemis (les réacs, les fachos), de pousser les hauts cris dès qu’ils voient le plumet d’un cimier s’agiter au vent et d’appeler les autorités, au nom du Code Pénal et de la Morale, à faire peser la griffe de la Loi (ou plutôt des gens au pouvoir) sur les téméraires qui osent les défier.
Dieudonné est une autre victime récente de cette folie punitive. Je ne cultive aucunement le Dieudonné, ni en pot ni en plein champ, mais ces fulminations haineuses me laissent ahuri et pantois (au fait, quelqu'un a-t-il des nouvelles de la "quenelle" ?). C'est à se demander de quel côté est le Bien, de quel côté le Mal.
Qu’on se le dise, les flics des brigades « ANTI- » (anti-islamophobes, anti-homophobes, anti-antisémites, anti-sexistes, anti-fascistes, etc.) n’ont pas les yeux qui se croisent les bras, ils veillent de toutes leurs antennes et montent au créneau comme un seul homme à la moindre alerte. Et les autorités n’ont rien de plus pressé que de céder à leurs demandes, faites en l’occurrence au nom de la mémoire de l’Holocauste.
Henri Godard était bien gentil, finalement, en ne dénonçant, en 2011, qu’ « une forme de censure ». Je doute quant à moi que cette vigilance chatouilleuse et que cette intolérance exacerbée soient d’une quelconque efficacité contre une montée éventuelle du racisme et de l’antisémitisme. Je ferme la parenthèse.

S’intéresser à un pestiféré comme Céline comme l’a fait Henri Godard, c’est aimer vivre dangereusement. Roland Thévenet (un homme exaspérant et carrément indispensable) en a fait l’expérience, mais lui, c’était à propos de Henri Béraud, autre pestiféré de la Libération, injustement accusé de « collaboration », condamné à mort, gracié in extremis, que je ne place pas – littérairement, s’entend – au niveau de l’auteur de Voyage au bout de la nuit. Alors que le génie de Céline brille dans la collection Pléiade, le talent indéniable de Béraud croupit dans les oubliettes de l’histoire.
 Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.
Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.

Et puis je viens de lire A Travers Céline, la littérature (Gallimard, 2014). Le propos est évidemment tout autre. Henri Godard y raconte comment Céline est devenu inséparable de son parcours personnel. C’est là qu’il raconte la stupéfaction qui fut la sienne à la lecture de D’un Château l’autre (en 1957). Une stupéfaction du Tonnerre de Dieu. Je sais, pour l’avoir vécu, que certaines lectures, faites à un moment décisif, peuvent faire bifurquer une trajectoire individuelle. Ici, Godard peut dire que D'un Château l'autre a décidé de l’orientation de son existence.
Godard n’hésite pas à intituler son premier chapitre « Coup de foudre ». Il n’y a aucune raison de douter que c’en fut un véritable. Quand ça vous arrive à vingt ans, ça ne pardonne pas. Mais il raconte aussi comment, dix ans plus tard, il reçut un choc aussi violent en découvrant par le menu la substance de Bagatelles pour un massacre, long pamphlet de 1937 débordant d’une stupéfiante rage antisémite. Il compte le nombre d’occurrences du mot « juif » : « A eux tous, ils ne surgissaient pas moins de trente-sept fois en à peine quatre pages » (p. 75).
J’ai mis le nez dans les Bagatelles … Eh bien honnêtement, je trouve surtout que c’est de la bien mauvaise littérature. Et puis c’est quoi, ces arguments de « ballets-mimes » dont le bouquin est parsemé ? Je sais bien que Lucette Almanzor-Destouches, son épouse, était danseuse, et qu’elle donnait des cours dans la maison de Meudon, mais je ne vois pas bien l’intérêt, sauf le fait que la traduction en mots des ambiances et des mouvements des danseurs prend un aspect ridicule. Je n'y peux rien. Disons-le, Bagatelles ... m'est tombé des mains.

Alors je comprends bien que Henri Godard se soit senti tiraillé : d’un côté neuf chefs d’œuvre de la littérature française ; de l’autre la traînée d’immondices que le grand écrivain a incontestablement laissée derrière lui. Est-ce que celle-ci est une raison d’occulter ceux-là ? Je dis que non. Il faut savoir ce que l’on regarde. Et ce qu'on garde. Et regarder ce qui en vaut la peine. Appelons cela un clivage si vous voulez.
Je pense à Jean Richepin et à ses « Oiseaux de passage », que Georges Brassens a mis en musique : « Ce qui vient d’eux à vous, c’est leur fiente ». Voilà : les pamphlets sont à considérer comme autant de déjections excrétées de l’anus de Céline. Sans aller jusqu’à appeler « fouille-merde » les horrifiés et les scandalisés qui répugnent à Céline dans son ensemble au seul motif de ses pamphlets antisémites, j’ai envie de percevoir dans l'affichage de ce dégoût un prétexte à justifier une médiocrité de béotien. Le béotien est une figure de la bêtise. Et une bonne conscience à bon compte. Et le conformisme qui tient compagnie à la lâcheté.
Si j'écrivais, des lecteurs aussi fatigués, aussi paresseux, je n'en voudrais à aucun prix ! Et ne parlons pas de la mauvaise foi et de l'hypocrisie.
De toute façon, je garde cette idée formidable de Henri Godard, qui dit quelque part que Céline écrit pour mettre celui qui ouvre son bouquin au défi de le lire et, quand il l'a ouvert, d'aller au bout de sa lecture. Pas de meilleure définition de l'œuvre : Céline écrit à rebrousse-poil de son lecteur.
Le tigre de la provocation est tapi dans le moteur profond des ténèbres de l'écriture de Louis-Ferdinand Céline.
Voilà ce que je dis, moi.
Je mentionne pour mémoire La Mort de L.-F. Céline, l'excellent petit livre, beaucoup plus militant, que Dominique de Roux avait consacré à Céline, après avoir été le maître d'œuvre, me semble-t-il, de deux Cahiers de l'Herne qu'il avait élevés à son grand homme.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, louis-ferdinand céline, henri godard, antisémitisme, juif, klarsfeld, d'un château l'autre, philippe druillet, délirium, frédéric mitterrand, crif, nazisme, dieudonné, henri béraud, roland thévenet, solko, voyage au bout de la nuit, à travers céline la littérature, bagatelles pour un massacre, lucette almanzor, dominique de roux, la mort de l.-f. céline, les cahiers de l'herne
vendredi, 16 mai 2014
3/4 MAIGRET ECRIVAIN
Je commence à en avoir un peu assez de Maigret. C’est sûr que c’est intéressant d’en lire pas mal à la file, parce que ça permet de cerner la façon dont l’auteur s’y prend pour capturer le lecteur. Il est vrai que Simenon sait y faire. Mais à force le lecteur finit par ne plus voir que les trucs.
J’avais parlé des problèmes d’identité sur lesquels reposaient Pietr-le-Letton et M. Gallet, décédé, les deux premiers de la longue série consacrée au commissaire. Dans l’un, le jumeau dominé par l’envergure criminelle du frère qu’il assassine pour prendre sa place à la tête du réseau. Dans l’autre, le noble complètement décavé qui vend son nom prestigieux à un roturier, juste parce qu’il a besoin d’argent.
Et voilà que, pas loin du dernier épisode, Simenon nous refait le coup de deux romans qui se suivent et qui traitent du même thème : le meurtrier qui cherche à se faire prendre, qui irait presque jusqu’à supplier le commissaire de le coffrer. On trouve ça dans Maigret et le tueur et Maigret et le marchand de vin.
Avec des variantes, il ne faut pas exagérer. Dans le premier, le tueur est un obsessionnel qui a commencé à quatorze ans, avec un couteau suédois volé à son oncle, et qui croit « se libérer » en lardant sa victime, qui est un charmant jeune homme timide, juste poussé par la passion des voix humaines, qu'il collectionne sur bande magnétique dans les cafés parisiens. D'où de fructueuses fausses pistes, en particulier la bande des malfrats qui se fait coffrer en flagrant délit de cambriolage.
Alors que dans le second, c’est un minable qui a été horriblement humilié par la victime et qui n’aspirait qu’à en tirer vengeance. Il faut dire que le marchand de vin, type même du self-made-man qui s'est hissé jusqu'au sommet à la seule force de son poignet, est l'imbuvable absolu qui ne sait que prendre. J'ai un jour croisé la route d'un tel homme : il vaut mieux ne pas avoir besoin de ses services.
J’ajoute qu’après le portrait de parfait salaud que Simenon trace de la victime, le lecteur est appelé à éprouver quelque indulgence envers le coupable. Alors que dans le premier, le mec est un nul parfait, essentiel et congénital : on le plaint d'avoir tant de difficulté pour se donner l'impression d'exister. Un « meurtre gratuit » contre un « meurtre à mobile ». Il faut bien avouer toutefois que le manège des deux pour se faire prendre repose sur un argumentaire des plus mince (sic, ainsi orthographié après vérification dans mon Grevisse, 9ème édition).
Il y a autre chose qui finit par fatiguer, à la lecture des Maigret en série : la marche à suivre. Je n’ai rien contre le savoir-faire. Par exemple, dans mon restaurant préféré, j’en veux beaucoup au maître-queux d’avoir modifié sans me prévenir sa préparation du gras-double rissolé à la lyonnaise, raison pour laquelle cela fait des années que je ne mets plus les pieds « Chez Mounier », 1, rue des Marronniers, pour le punir de cette inqualifiable agression.
Un roman policier n’est toutefois pas un restaurant. Encore moins un « bouchon lyonnais ». De toute façon, la mère Mounier a quitté le service depuis lurette, alors … Je n’en ai pas moins gros sur la patate : le souvenir d’une jouissance, s’il n’est pas un appel à recommencer au présent, se dégrade en pure remembrance de vieillard idiot (formule d’Arthur Rimbaud, cf. Les Remembrances du vieillard idiot, de Michel Arrivé, Flammarion, 1977).
Croiser le souvenir d’anciens bons moments communs dans les yeux d’une accorte et joyeuse bougresse n’oblige-t-il pas à vérifier l’emploi du temps du soir, dans l’agenda ? Et à préparer le prétexte officiel ? Dites-moi que ce n’est pas vrai, tiens ! Revenons à nos boutons.
La marche à suivre, dans les Maigret ? Facile, Mimile ! Les romans consacrés à Maigret se découpent assez régulièrement en quatre étapes. Première étape : les faits, les lieux, un ou deux témoins. Si possible un meurtre banal, pour ne pas dire sordide (dans La Folle de Maigret, la mort par suffocation d’une charmante dame de quatre-vingt-six ans).
Dans la deuxième, les gens, le milieu et son ambiance. C'est là que Maigret renifle, tâtonne, s'imprègne, s'imbibe des données spécifiques de l'affaire, à la recherche d'un fil à tirer. Dans un troisième temps, Maigret, quoique pataugeant commence à démêler l’écheveau des relations que les circonstances ont établies entre les personnages, les adultères, les haines, les désirs. C’est le moment où le commissaire lève une partie du voile sur les passions spécifiques mises en jeu par l’histoire. La quatrième étape est classiquement consacrée à la synthèse de l’ensemble quelle qu’en soit la forme, confession du coupable ou explication du commissaire.
C’est par exemple le cas d’Un Crime en Hollande (1931), où Simenon se paie même le luxe d’une reconstitution du crime : c’est la vieille bigote protestante, la plus racornie, la plus prude et la plus insoupçonnable, qui a tué, trop jalouse de la jeune fille appétissante. Que voulez-vous, elle ne pouvait pas rivaliser : « Deux beaux seins, que la soie rendait plus aguichants, des seins de dix-neuf ans qui tremblaient à peine sous la blouse, juste de quoi les rendre plus vivants ». Simenon ne pourra pas nier qu’il a aimé les femmes, c’est sûr. Et particulièrement la chair fraîche.
Georges Simenon était un homme normal.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 15 mai 2014
2/4 MAIGRET JOURNALISTE
Le personnage de Maigret, disais-je dans un billet précédent (hier, si je ne me trompe), est un prétexte. Certes, le métier de Georges Simenon est d’écrire des romans. Mais il est aussi journaliste. La preuve cette série de 12 articles intitulée Escales nordiques, publiée par Le Petit journal du 1er au 12 mars 1931. Les titres en sont très rigolos, je tiens à le souligner. Voir plus bas pour confirmation du fait.
Je n’irai pas jusqu’à prétendre que les Maigret sont de mauvais romans policiers, ce serait idiot, ridicule et insoutenable. Mais il faut bien dire que l’intrigue de plusieurs de ceux que j’ai lus est bâtie sur une chute qui a tout l’air d’être parachutée. Je pense par exemple à l'extravagant nid d’espions qu’on trouve dans une boîte de nuit de Liège, dans La Danseuse du Gai Moulin. Une histoire pépère, planplan et apparemment minuscule.
Le fait que le crime crapuleux s’ajoute à l’affaire d’espionnage montre que Simenon est un maître du tricotage narratif. Il n’en reste pas moins que cette histoire de plans « d’un nouveau fusil-mitrailleur fabriqué à la FN de Herstal » et de mise à l’épreuve d’un apprenti espion par ailleurs richissime qui a le tort et la faiblesse de s’ennuyer dans la vie, garde des airs assez peu crédibles.
Je dirai que l’intrigue proprement policière (toujours bien tricotée) permet à l’auteur d’appâter son lecteur. C’est d’ailleurs ce qui émerge de temps à autre dans le récit à propos de la « méthode » que Maigret applique dans ses enquêtes. Cette méthode est précisément de ne pas en avoir. Enfin, pas vraiment. On ne peut pas dire en effet que les « deux phases » décrites dans La Guinguette à Deux Sous puissent en tenir lieu. Mettons plutôt une façon d’être qu’une façon de faire.
La première phase consiste pour Maigret à pénétrer dans l’ambiance spécifique dans laquelle baigne le milieu social ou géographique où va se dérouler l’affaire : « D’abord la prise de contact du policier avec une atmosphère nouvelle, avec des gens dont il n’avait jamais entendu parler la veille, avec un petit monde qu’un drame vient d’agiter ». Au cours de cette période, « la plus passionnante » pour le commissaire, « on renifle. On tâtonne ». Et quand le juge Poiret lui demande ce qu’il pense de l’affaire : « Je ne pense pas encore. Je tâtonne ». Ça, c’est dans Maigret et le tueur. Mais c’est quand même au chapitre deux, c'est-à-dire dans la partie initiale, où le commissaire patauge encore.
Revenons à La Guinguette … La deuxième phase peut ensuite débuter : « Brusquement on saisit un bout de fil et voilà la seconde période qui commence. L’enquête est en train. L’engrenage est en mouvement. Chaque pas, chaque démarche apporte une révélation nouvelle, et presque toujours le rythme s’accélère pour finir par une révélation brutale ». J’avais noté pour ma part cette impression de « tempo accelerando » (voir ici même au 29 avril) produite par la manière dont le commissaire conduit (semble conduire, car c'est évidemment le romancier qui tient les manettes) son enquête.
Georges Simenon semble construire ses Maigret comme fait un journaliste d’investigation quand il est en reportage. Et l’auteur fut un tel journaliste. Patrick Kéchichian le confirme en 2008 dans Le Monde (1er août) à propos du Simenon de 1935 débarquant à Tahiti : « Il allait y séjourner deux mois. Largement de quoi s’imprégner, dira-t-on, de cette autre réalité … ». Kéchichian commente ici une édition des textes journalistiques (Georges Simenon. Les Obsessions d’un voyageur, textes choisis et commentés par Benoît Denis). Je relève avant tout le verbe « s’imprégner ». Simenon le journaliste et Maigret le policier appliquent la même « méthode ».
Et dans le fond, les enquêtes de Maigret ne sont-elles pas, outre des intrigues policières bien ficelées (quoique plus ou moins convaincantes), des reportages dans les milieux les plus divers ? Celui des marins – d’eau douce ou au long cours – semble être une des prédilections de l’auteur : j’ai l’impression d’avoir fait un tir groupé, avec Au Rendez-vous-des-Terre-Neuvas, Le Chien jaune, Le Charretier de « La Providence », Le Port des brumes. Successivement Fécamp, Concarneau, les canaux, Ouistreham. C’est vrai que beaucoup de titres sont datés d’un « A bord de l’Ostrogoth » significatif : Simenon a navigué et la mer et les marins, il connaît.
Toujours est-il que l’imprégnation est à la base de la méthode de l’écrivain comme de celle du policier qu'il a imaginé.
Simenon reste journaliste en écrivant ses romans policiers. Et il fait un journaliste du commissaire devenu une grande figure de la littérature policière française. Les enquêtes de Maigret ressemblent un peu à des reportages.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : georges simenon, commissaire maigret, journalisme, presse, journaux, littérature, roman policier, quai des orfèvres, la danseuse du gai moulin, la guinguette à deux sous, maigret et le tueur, journal le monde, patrick kéchichian, au rendez-vous des terre-neuvas, le chien jaune, le charretier de la providence, le port des brumes
mercredi, 14 mai 2014
1/4 MAIGRET ETHNOLOGUE
Bon, voilà (dans l’ordre où je les ai faites) la liste de mes dernières lectures :
1 – Maigret et la Jeune Morte (1954)
2 – Pietr-le-Letton (1929)
3 – M. Gallet, décédé (1930)
4 – Le pendu de Saint-Pholien (1930)
5 – Le Charretier de la « Providence » (1930)
6 – Maigret à l’Ecole (1953)
7 – Maigret chez le Ministre (1954)
8 – Maigret et l’Homme tout seul (1971)
9 – Maigret et l’Indicateur (1971)
10 – Maigret et Monsieur Charles (1972)
11 – La Tête d’un homme (1930)
12 – Le Chien jaune (1931)
13 – La Nuit du Carrefour (1931)
14 – Au Rendez-vous-des-Terre-Neuvas (1931)
15 – La Danseuse du Gai-Moulin (1931)
16 – La Guinguette à Deux Sous (1931)
Tout par un coup (comme les Lyonnais ne disent plus), voilà donc que je me rends compte que j’en suis à mon seizième Maigret d’affilée. C’est en train de virer à la manie. Il va falloir que je prenne des mesures. Tout le monde se fiche d'une tel palmarès, et je dis que tout le monde a raison.
Car je ne dis pas ça pour me vanter, juste pour dire que je commence un petit peu à savoir ce que c’est, Maigret. Et je vais vous dire, au point où j’en suis, je crois que le sujet de ces bouquins n’est en aucun cas le commissaire affublé de ce nom. Le personnage est juste un prétexte. Un moyen, si vous voulez.
La liste ci-dessus fait apparaître (dans le désordre) les dix premiers « Maigret » et les trois derniers avec, entre les deux, trois de la période intermédiaire (années 1950). Simenon est du genre maniaque : il fait figurer à la fin de ses romans le lieu, le mois et l'année de leur composition. Par exemple, Pietr-le-Letton, premier de la longue série, porte la mention « Delfzijl (Hollande), à bord de l’Ostrogoth, septembre 1929 ». La manie d’un maniaque raffole de la précision minutieuse.
On se rend compte, en rapportant les dates aux titres, que le nom du commissaire est absent de tous les premiers épisodes. Il apparaît, si je ne me trompe, au 20ème, sobrement intitulé Maigret, que je n’ai pas lu. Sans doute quand le personnage massif du policier eut acquis assez de notoriété pour fonctionner comme une « marque » dans l’esprit des lecteurs familiarisés.
Le Pendu de Saint-Pholien ne m'a pas convaincu outre mesure. Pour la raison que l'intrigue, bien menée comme d'habitude, repose sur un vieux secret liant les comparses, mais un secret vaseux, comme un beau monument qui serait érigé sur du sable. Le lecteur déçu referme le livre en se disant : « Ah bon, ce n'était que ça ». C'est un peu le reproche que j'ai fait aux livres de Jean-Christophe Grangé (Les Rivières pourpres, Le Vol des cigognes, Le concile de pierre).
Et pas plus Le Charretier de la « Providence », qui se passe dans le milieu des mariniers d’eau douce, sur les canaux de Picardie et d’ailleurs, à cause d’une fin tirée par les cheveux : le médecin condamné aux travaux forcés et qui finit conducteur de chevaux de halage, ça fait un peu parachuté, même si la peinture de son agonie et de sa mort ne manque pas de pittoresque. Sans aller jusqu'à juger la fin invraisemblable, parce qu'on se dit que Simenon a parié sur la force des « profondeurs insoupçonnées ».
Maigret à l’Ecole est nettement plus attrayant, peut-être plus réussi, plus homogène, moins vasouillard dans la conduite du récit. Peut-être que l’intrigue est mieux conçue à la base : l’instit d’un petit village de Charente, l’instituteur Gastin est soupçonné par tout le monde, sur fausse dénonciation d’un gosse de l’école, d’avoir tué d’un coup de 22 long Léonie Birard, une vieille chouette, ancienne postière qui collectionnait les lettres adressées aux habitants du village et qui leur recrachait leurs turpitudes en public. L’ensemble a du nerf, de la chair et de l’os.
J’ai bien aimé Maigret chez le Ministre qui, comme le titre l’indique, fait entrer le commissaire dans le milieu nauséabond et corrompu du personnel politique français, que Simenon ne semble pas porter dans son cœur. La turpitude présente est liée à l’effondrement meurtrier d’un sanatorium pour enfants, dont un mystérieux « rapport Calame » dénonçait la future construction, que des « influences » avaient fait aboutir, malgré les avertissements, au mépris de la sécurité.
A l’autre bout de la chaîne, les trois derniers épisodes écrits par Simenon autour du personnage de Maigret sont de fort belle venue. Maigret et l’homme tout seul raconte comment et pourquoi un miséreux a été tué de trois balles dans la poitrine, une nuit, dans un immeuble promis à la démolition.
Un moment – quasiment ethnographique – de l’épisode se déroule dans une école de coiffure, dont le directeur utilise à des fins pédagogiques la tête et les cheveux des clochards du quartier (anciennes Halles de Paris, rue de la Grande-Truanderie, 1er arrondissement). Les élèves apprennent gestes et techniques du métier, et les clochards sont (un peu) rémunérés : le type même du contrat « gagnant-gagnant » (comme on dit maintenant). Bon, c’est vrai que si vous voulez bien manger pas cher ou faire réparer la voiture, il y a les « restaurants d’application » et les classes de mécanique auto des lycées professionnels. Mais pour les futurs coiffeurs, j’avoue que j’ignorais.
Le moindre intérêt des romans de Simenon n’est pas, en tout cas, de nous faire pénétrer dans des milieux bien caractérisés. Mieux : ils permettent au lecteur d'éprouver « de l’intérieur » l’ambiance de chacun de ces milieux sociaux, comme s’il y était immergé. Moi qui suis un adepte de ce qu’on appelle la « grande littérature » (Proust, Kafka, Musil et toute la clique), je me suis étonné d’abord de prendre plaisir à ce genre de lecture. Mais après tout, c’est peut-être tout simplement ce côté « ethnologie familière », cet aspect à la fois exotique et proche qu’on trouve dans les œuvres du bonhomme qui me plaît. Bon, on dira que quand on cherche des raisons, celles qu’on trouve nous apparaissent forcément bonnes …
Mais après réflexion, je trouve que cette raison n’est pas si mauvaise.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, romans policiers, polar, quai des orfèvres, brigade criminelle, la crime, maigret et monsieur charles, la tête d'un homme, le chien jaune, jean-christophe grangé, les rivières pourpres, le vol des cigognes, le concile de pierre, maigret à l'école, maigret chez le ministre
dimanche, 27 avril 2014
BONJOUR MONSIEUR MAIGRET
MAIGRET ET LA JEUNE MORTE
Je viens de lire Maigret et la Jeune Morte. Pas de quoi se relever la nuit pour l’apprendre par cœur. Le positif de la chose, c’est que c’est vite lu. Je veux imaginer que Simenon avait la modestie de ne pas se prendre pour un grand écrivain, et qu’il ne prétendait à rien d’autre qu’à gagner beaucoup d’argent en publiant ses histoires. Je crois qu’il le disait lui-même : l’écriture d’un roman lui prenait environ trois semaines. Quand ce n'était pas trois jours.
J’avais lu je ne sais plus où qu’il avait adopté, pour écrire, un rituel immuable. Il s’installait le matin à son bureau, devant sa pile de feuilles blanches avec, à portée de sa main droite la pile des dizaines de crayons qu’il avait taillés la veille, avant d’aller déjeuner, dans le taille-crayons mécanique fixé au bord, sur un côté, parce qu’il ne supportait pas de s’interrompre pour le faire en cours d’écriture. Et qu'il ne supportait pas d'écrire quand la pointe du crayon était trop émoussée.
Maigret, dans cette histoire terne, ressemble à Maigret : vieux. A-t-il un jour été jeune ? C’est douteux. Le personnage est forcément un vieux de la vieille, un renard expérimenté à qui on ne la fait pas. Faut pas le prendre pour un canard sauvage ou un perdreau de l’année. La preuve qu’il est célèbre, c’est que son nom est connu des autres personnages du roman.
Il suffit qu’il leur dise son nom pour qu’ils déballent ce qu’ils savent. Ils se mettent alors en quatre. A se demander si les acheteurs des « Maigret » n’ont pas fait leur succès en s'imaginant témoins interrogés par le célèbre commissaire. Il a suffi pour cela, en somme, que l’auteur atteste la renommée incontestable de son policier pour qu’elle devienne effective dans la société réelle. Le nom du personnage sur le même piédestal que celui de son inventeur ! Bel exemple d’une campagne d’autopromotion réussie.
L’histoire ? On s’en fiche. Une fille est retrouvée morte, une nuit, sur une place déserte, le crâne défoncé. Simenon ici fait de Maigret un psychologue : c’est en s’efforçant de cerner la personnalité de la fille et de se pénétrer de l’essence de son caractère qu’il découvrira le meurtrier, un malfrat bien connu de lui.
En attendant, il nous balade dans Paris, à la rencontre d’une ribambelle de personnages minables, de meublés crades en chambres sordides, avec les détours obligés par le « Quai » (des Orfèvres) et le Boulevard Richard-Lenoir (où le commissaire habite et où l’attend l’éternelle Germaine armée de son éternel ragoût). Il agrémente ici le tableau en doublant la silhouette compacte de Maigret de celle, fantomatique, de l’inspecteur Lognon, dit « le Malgracieux », sorte de « loser » indécrottable, tenace et malchanceux.
La première chose que le lecteur cherche quand il ouvre un « Maigret », ce sont des pantoufles. Façon de parler, bien sûr. Ce que je veux dire, c’est que les livres de Simenon, y compris la foule innombrable des romans privés du commissaire, forment une littérature confortable, une littérature de coin du feu et de fauteuil profond. Une littérature d’intérieur douillet et de décor familier.
Je sais que j’exagère, parce que, ayant refermé Maigret et la Jeune Morte, j’ai enchaîné sur Pietr-le-Letton, qui est le premier (publié en 1929) épisode qui met en scène le « commissaire Maigret » en tant que protagoniste. Et Simenon sait dès ce moment qu’il sera un personnage hautement récurrent. Or, dans Pietr-le-Letton, il lui en arrive, des choses, au commissaire : il prend une balle de revolver dans les côtes, il marche dans la boue jusqu’aux genoux, bref, il paie de sa personne, je veux dire physiquement.
Il faut donc nuancer. Disons que Maigret, au fur et à mesure que son inventeur avance en âge, a tendance, comme lui, à s’embourgeoiser. C’est un peu ce que Simenon sous-entend dans La Naissance de Maigret : « J’ai maintenant soixante-trois ans, Maigret environ cinquante-deux. Lorsque je l’ai créé, à vingt-cinq ans, il en avait quarante-cinq. Ainsi a-t-il eu la chance de vieillir beaucoup moins rapidement que moi et sans doute lui garderai-je encore longtemps son âge actuel ».
En clair, en trente-huit ans, Maigret en a juste pris sept. Après tout, en presque un demi-siècle (des Soviets aux Picaros, je ne compte pas le posthume Alph-art), Tintin aussi a gardé l’éternel même âge indéterminé. Même sa houppe n’a pas pris une seule ride. Simplement, dans les « Maigret », au fil du temps, le ragoût de Germaine et les pantoufles prennent davantage d’importance.
Inversement, j’imagine que Simenon a de moins en moins éprouvé le besoin de décrire son commissaire. Dans Pietr-le-Letton, il en précise la silhouette : « Lui restait là, énorme, avec ses épaules impressionnantes qui dessinaient une grande ombre. On le bousculait et il n’oscillait pas plus qu’un mur ». Voilà qui est dit.
Ce qui ne change pas en revanche, de ce premier Maigret à Maigret et la Jeune Morte (1954), c’est la façon dont l’intrigue avance, la façon dont l’auteur opère le dévoilement progressif de ce qui fait le nœud et le nerf de l’intrigue : posément, méthodiquement, implacablement. On pardonnera à Simenon d’avoir tué dans Pietr-le-Letton son inspecteur Torrence, qui reviendra dans un des rôles d’indispensables bras droits du commissaire. Après tout, même chez Balzac, il y a parfois des problèmes de « raccords ».
Je laisserai de côté les considérations sur l’art de Simenon de peindre des « ambiances », des « climats », des « atmosphères ». Je garderai seulement la nette impression qu’aux yeux du romancier, les individus ont plus souvent l’air crapoteux que l'apparence de belles âmes. L'image la plus constante qui se forme à la lecture des « Maigret » (mais aussi des autres romans), est celle d'une population faite de petitesse, de crasse et de médiocrité. Maigret se meut dans un univers gris et bas. Parfois gluant.
L’impression aussi qu’il observe l’humanité souffrante et grouillante comme s’il était assis en spectateur de l’autre côté de la vitre de l’aquarium où elle évolue, le plus souvent péniblement et laborieusement, mais aussi, à l'occasion, avec la cruauté de qui n'a aucune gratitude envers les parents qui l'ont fait naître. Ses congénères de marigot n'ont aucun geste secourable à attendre de lui. L'empathie n'est pas son fort.
L'œil de Georges Simenon est un organe froid. En même temps qu'une curiosité (toujours clinique, parfois étonnée) d'entomologiste chevronné, sa littérature respire l'indifférence.
Mais comment dire, une indifférence fascinée.
Une indifférence passionnée. Qui rappellerait presque, de loin, le Louis-Ferdinand Céline de Mort à crédit. Ou alors La Vie des insectes de l'entomologiste Jean-Henri Fabre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : polar, littérature, littérature policière, georges simenon, maigret, commissaire maigret, quai des orfèvres, loui-ferdinand céline, mort à crédit, pietr-le-letton, maigret et la jeune morte, tintin
vendredi, 18 avril 2014
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Tout le monde doit mourir un jour. Pas d'éloge funèbre. Mais à l'occasion de la mort de l'écrivain colombien, des souvenirs de ma lecture d'un livre unique, d'un livre sans équivalent :
Cent ans de solitude.

Le village de Macondo, pauvre localité tropicale devenue le centre d'un univers aux dimensions du cosmos.
Le seul livre qui m'ait jamais donné cette impression d'un microcosme humain gros comme un confetti, mais dilaté et comme multiplié jusqu'à prendre des airs de planète entière, c'est Mémed le mince, de Yachar Kemal.
Le saisissement du gamin de Macondo quand il pose la main sur le bloc de glace que lui présente son grand-père (on est au niveau de l'équateur).
La beauté ensorcelante de Remedios-la-belle.
La vieille éternelle, Ursula Buendia, pour laquelle « le temps ne passe pas ».
L'innombrable tribu de la famille Buendia, dont j'avais été obligé, pour me retrouver un peu dans le fourmillement des noms (parfois identiques) et des personnes, de dessiner l'arbre généalogique, pour démêler Aureliano d'Aureliano le Second et d'Aureliano José, celui-ci de José Arcadio et ce dernier d'Arcadio tout court, bref, un écheveau savamment entortillé.
Inoubliable et vivant.
Mais je garde aussi une place pour L'Automne du patriarche, vaste coulée de lave folle qui se moque des limites de la phrase pour mieux laisser bourgeonner l'impression de folie qui habite (mais sait-on ?) le cerveau du dictateur vieillissant.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gabriel garcia marquez, cent ans de solitude, l'automne du patriarche
mercredi, 19 mars 2014
32 BALZAC : JÉSUS-CHRIST EN FLANDRE (1831)
Commenter La Comédie humaine, je ne m'y risquerai pas. D'abord parce que les commentaires, gloses, études, exégèses, annotations, explications et autres bavardages érudits doivent se répandre sur je ne sais combien de dizaines de mètres de rayon dans toutes les bibliothèques savantes. Ce qui doit finir par faire des kilomètres.
Ensuite, parce que je crois profondément que toutes les couches de savoir dans lesquelles les savants croient englober l'acte créateur du génie laisseront toujours échapper ce qui en fait l'essentiel : la jouissance au présent. C'est pourquoi je me contente de donner une idée (parcellaire et subjective) des récits dont cette cathédrale est édifiée, non pas en les résumant, mais en en livrant des sortes de comptes rendus de lecture, sans doute tant soit peu scolaires. On fait ce qu'on peut.
Je me rappelle la visite faite il y a des temps au château de Saché, le plus éminent temple balzacien qui existe au monde. Un pèlerinage, en quelque sorte. On vous montre par exemple la chambre qu'il occupait tout en haut, reconstituée (?) avec soin, y compris la table devant la fenêtre dominant une allée bordée d'arbres nobles.

Y compris la cafetière chargée de fournir du carburant au moteur de son génie. Souvenir puissant, imprégné des contrastes que la lumière d'un soleil éclatant faisait peser sur les lieux. J'y reviendrai. Pour l'instant, parlons d'une drôle de nouvelle : Jésus-Christ en Flandre.
Disons que cette très courte nouvelle d’à peine vingt pages est une féerie, et n’en parlons plus. Une parabole si vous voulez, mais alors taillée à la hache. Une légende populaire ancienne aussi. Jugez plutôt. Un marinier qui fait la traversée d’un bras de mer entre Ostende et une île qui lui fait face embarque ses derniers passagers, quand un mystérieux personnage s’ajoute.
A l’arrière se sont installés un jeune cavalier fringant et arrogant faisant sonner ses éperons dorés ; une demoiselle portant faucon sur le poing et ne causant qu’à sa mère ou à l’archevêque qui leur tenait compagnie ; un gros bourgeois de Bruges accompagné d’un valet armé jusqu’aux dents à cause des gros sacs pleins d’argent ; enfin un homme de science à la haute renommée.
A l’avant, on trouve un vieux soldat, assez charitable pour laisser sa place assise à l’inconnu ; une ouvrière d’Ostende chargée d’un enfant ; un paysan et son fils ; une pauvresse bien pieuse. Le schéma est clair et édifiant : les riches à l’arrière, séparés des pauvres assis à la proue par les bancs des rameurs.
Attention, ça va secouer, l’orage menace et les passagers sont diversement inquiets, les uns s’en remettant à Dieu, les autres inquiets pour leur personne. L’orage devient tempête, et malgré la vigueur des rameurs, le sort de l’esquif devient de plus en plus précaire. Parmi les débats entre ceux qui croient au Ciel et ceux qui n’y croient pas, seul l’inconnu reste calme, disant à la jeune mère : « Ayez la foi, et vous serez sauvée ».
Puis, quand la barque a chaviré : « Ceux qui ont la foi seront sauvés ; qu’ils me suivent ». Se mettant debout, il se met à marcher sur la mer, suivi aussitôt par le soldat, puis par la petite vieille qui, à leur tour, marchent sur la mer. Les deux paysans les imitent, de même que Thomas, le marinier qui a accueilli la vieille sans réclamer le prix du passage. La foi de Thomas est chancelante, et il tombe plusieurs fois, mais réussit à suivre les autres.
Et les riches, allez-vous me demander ? Devinez, voyons, c’est la question à 15 euros : leur sort est éminemment moral. On retrouve ensuite le narrateur dans la cathédrale d’Ostende. Il est fatigué de vivre. On est en 1830, après la révolution de juillet et la chute des Bourbons. Il est assis et décrit ce qu’il voit. Mais la description se transforme en tableau fantastique, « comme sur la limite des illusions et de la réalité ».
Une femme, une petite vieille froide, de sa main glacée le prend par la main et le conduit dans une demeure obscure. Il comprend qu’elle est la Mort, veut fuir, ne peut pas : « Je veux te rendre heureux à jamais, dit-elle. Tu es mon fils ! ». Il l’apostrophe durement, lui reprochant de s’être prostituée, entre autres culpabilités. Alors la vieille se transforme en belle jeune fille lumineuse, et lui lance : « Vois et crois ! ».
Il aperçoit alors dans le lointain des milliers de cathédrales, magnifiquement ornées, il entend « de ravissants concerts », il voit des foules humaines empressées « de sauver des livres et de copier des manuscrits » ou de servir les pauvres. Puis la jeune fille redevient vieille, et souffle : « On ne croit plus ! ». Soudain une voix rauque le réveille, c’est le donneur d’eau bénite qui le prévient de la fermeture des portes.
La conclusion ? « Croire, me dis-je, c’est vivre ! Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre l’Eglise ». La monarchie en question est la dynastie des Bourbons, qui s’écroule après cinq ou six siècles de règne. On comprend que ça fasse un choc à Balzac devenu (ou qui deviendra) légitimiste.
Chateaubriand en parle longuement dans Les Mémoires d’Outre-tombe, regrettant la raideur doctrinale du clan groupé autour de Charles X, allant même jusqu’à reprocher au roi, qui refuse de « rapporter les ordonnances de juillet », de n’avoir pas compris que la seule solution pour la survie de la royauté eût été, non pas d’épouser son époque, mais au moins d’en accepter quelques innovations.
Au fond, il s’agissait de montrer que le roi était capable d’accompagner le mouvement des idées, seul moyen pour Chateaubriand de rester à sa tête. Au lieu de quoi, c’est le clan le plus réactionnaire qui emporta la décision, et précipita la chute des Bourbons. Chateaubriand se serait pourtant bien vu en précepteur du futur Henri V, se proposant d’inculquer au fils de Charles X la souplesse d’esprit nécessaire à qui veut ne pas être écrasé par la modernité.
Balzac ne va pas aussi loin dans l’analyse. Il se contente ici de déplorer la disparition d’un des piliers de la nation française (le Trône) et veut tout faire pour sauver l’autre (l’Autel). J’adore quant à moi la phrase : « Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre l’Eglise ». Qu’il ait emprunté pour cela au genre fantastique, ma foi, c’est une faute tout à fait vénielle, n’est-il pas ?
Jésus-Christ en Flandre se laisse lire sans déplaisir.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, jésus-christ, jésus-christ en flandre, la comédie humaine, château de saché, touraine, paul métadier, monarchie de juillet, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, charles x, bourbons
lundi, 03 mars 2014
29 BALZAC : LA FEMME DE TRENTE ANS
Drôle de livre que La Femme de trente ans. Pour une raison qui paraîtra évidente, mais qui peut désarçonner à la lecture quand on n’est pas au courant : ce n’est qu’en 1842 que Balzac décide de fusionner six nouvelles écrites séparément. D’où un ensemble tant soit peu hétérogène, voire décousu, par la longueur des récits, mais aussi par les thèmes abordés.
De plus, le titre est très réducteur, car la trame, que Balzac a vu se dessiner après coup pour lier les six récits, repose sur six périodes de la vie d’une femme, de la jeunesse nubile jusqu’au lit de mort. Certes le troisième chapitre s’intitule « A trente ans », mais il n’occupe qu’un dixième du volume. Il ne faudra pas non plus s’attarder sur la faiblesse de certaines soudures : l’auteur a colmaté tant bien que mal les brèches existant entre des récits d’abord indépendants.
Pour Balzac et pour son époque, une femme est fraîche à dix-huit ans, vieille à quarante. A trente ans, elle n'est plus l'une et pas encore l'autre. Être une femme de trente ans, cela veut dire, aux yeux de Balzac, qu'elle peut encore séduire, mais avec une supériorité sur la jeune fille : elle « connaît la vie ». Elle n'a plus sa fraîcheur innocente de jeune vierge, et elle peut encore prétendre capturer des amants par sa façon de se rendre désirable et par les ruses et moyens qu'elle déploie pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, foin de ces considérations désuètes, pensez, même les maisons de retraite son devenues des théâtres amoureux.
Les deux épisodes les plus développés sont le premier, où Balzac s’amuse à dépeindre la fatale étourderie d’une jeune vierge, véritable oie blanche qui s’amourache d’un homme nul, et le cinquième, où il raconte les dégâts accomplis dans une famille par le poids du secret qui fait de la mère et de la fille des complices (la fille connaît l'adultère maternel et a provoqué la mort du fils adultérin).
Au début, Julie, au désespoir de son père, est complètement entichée du colonel Victor d’Aiglemont, qu’elle voit parader en compagnie de l’Empereur, un beau jour de 1813, scène sur laquelle Balzac s’attarde un peu longuement : il a beau être légitimiste, il ne se fait pas faute d’admirer le grand homme.
L’année suivante, dans la France envahie par les troupes étrangères, Julie, devenue madame d’Aiglemont, se mord déjà amèrement les doigts de sa toquade exaltée de jeune ignorante. Victor, ce piètre époux, conduit sa femme chez une tante, comtesse ou marquise suivant les pages : Mme de Listomère-Landon.
Celle-ci prend Julie sous son aile et lui promet de la former en lui apprenant comment manœuvrer un mari stupide. Malheureusement, elle meurt « de joie et d’une goutte remontée au cœur » (sic !) en revoyant à Tours le duc d’Angoulême. « Julie sentit toute l’étendue de cette perte ». Son inexpérience des choses de la vie lui donne un temps l’espérance de mourir jeune.
Il n’y aurait rien à raconter ensuite, si un jeune Anglais, lord Arthur Grenville, n’était tombé raide dingue amoureux de Julie d’Aiglemont. Il se consume d’amour, le pauvre garçon, et en pure perte, parce que Julie a décidé de rester vertueuse. Le malheur veut que, au moment où elle accepte de le recevoir chez elle au motif que son mari est à la chasse pour plusieurs jours, il fasse un retour inopiné après l’annulation. Brusquement obligée de le cacher, elle ne sait pas qu’elle lui a broyé les doigts en claquant la porte, et qu’il préfère se laisser mourir de froid plutôt que de compromettre celle qu’il aime.
Le deuxième épisode nous montre Julie venue se cloîtrer dans le château de son domaine de Saint-Lange. On voit là une marquise en proie aux remords causés par la mort de son amant (qui n’a pas eu le temps de le devenir). Elle ne veut voir personne et dépérit. Seul le vieux prêtre de l’endroit parvient à forcer sa porte. Effaré, il découvre une femme sans religion, qui lui avoue tout uniment son indifférence pour son mari et son amour contrarié pour lord Arthur Grenville. Il échouera à la ramener dans le sein de notre très sainte mère l’Eglise. Oui, bof, passons.
Le troisième chapitre voit apparaître Charles de Vandenesse, sans doute un parent du Félix du Lys dans la vallée, qui ambitionne de faire carrière dans la diplomatie. Madame Firmiani (dont le nom fait ailleurs l’objet de tout un récit) le présente à Julie, un jour où elle reçoit dans son salon. Avant de l’aborder, il la contemple, puis engage avec elle une conversation qui leur fait constater la déjà parfaite unisson dans laquelle chantent leurs deux âmes.
L’intérêt romanesque de l’épisode, en dehors de laisser pressentir le futur adultère, est une tirade typiquement balzacienne sur … sur … sur LA FEMME. Eh oui, et même farcie de formules propres au grand écrivain : « Il existe des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître » ; « Emanciper les femmes, c’est les corrompre » ; « La jeune fille n’a qu’une coquetterie, et croit avoir tout dit quand elle a quitté son vêtement ».
Mais il y a aussi des formules bien senties sur les contemporains de l’écrivain, qui n’y va pas de main morte. Parlant de « certains hommes toujours en travail d’une œuvre inconnue » : « statisticiens tenus pour profonds sur la base de calculs qu’ils se gardent bien de publier ; politiques qui vivent sur un article de journal ; auteurs ou artistes l’œuvre reste toujours en portefeuille ; gens savants avec ceux qui ne connaissent rien à la science (…) », j’arrête là les vacheries. Oui vraiment, ce sera tout pour aujourd’hui.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, balzac, la femme de trente ans, la comédie humaine, femme, adultère, le lys dans la vallée, féminisme, féministes
jeudi, 27 février 2014
CHANTONS SUR LES CHARNIERS
BIGUINE A BANGUI, BIGUINE A BANGKOK
Aujourd’hui on se détend un peu. C’est l’actualité des événements qui se produisent dans le monde qui m’a fait penser à Charles Trenet et à sa chanson « Biguine à Bango ! » (cliquer pour visionner). Oh, la chanson est peu connue, certes, mais elle me fait irrésistiblement penser à ce qui se passe dans les capitales de deux pays : la Thaïlande et la Centrafrique.
En Thaïlande, une partie de la population en a assez d’être gouvernée par des gens appartenant à une élite corrompue jusqu’au trognon, et pour le faire savoir, elle est descendue dans la rue, au risque de se faire tirer dessus par les militaires de Yingluck Shinawatra, la sœur du nommé Thaksin, réfugié à l’étranger pour ne pas être coffré comme un vulgaire malfaiteur, pour corruption éhontée.

Tiens, au fait, est-ce que ce n’est pas le motif qui a poussé une bonne partie de la population ukrainienne à occuper depuis trois mois la place Maïdan ? Remarquez que, pas très loin de là, j’ai lu quelque part que certains Russes reprochent (en parlant assez bas pour ne pas être entendus de l’intéressé) à Vladimir Poutine d’avoir amassé depuis qu’il est au pouvoir une fortune aux dimensions inimaginables. Il posséderait ainsi plus de quarante résidences luxueuses. Il m'arrive de me demander ce que je ferais de quarante résidences, si j'étais dictateur. Passons.
Remarquez que les Tunisiens n’ont pas foutu dehors Ben Ali pour une raison différente, et que la première visite qu’ils ont faite dans le palais du dictateur leur a autant coupé le souffle qu’aux Ukrainiens celle que ceux-ci ont organisée dans l’invraisemblable propriété qu’occupait Ianoukovitch jusqu’à son départ. Et j’imagine que si les Egyptiens avaient pu visiter la propriété de Moubarak, ç’aurait été pareil : du marbre et de l'or. Il paraît même que chez Ben Ali, il y avait dans certaines pièces des murs de liasses de billets (je le tiens d'une bonne source, mais allez savoir).
Et peut-être un jour prochain ne sera-t-il plus permis aux Africains, les potentats Obiang, Sassou-Nguesso et autres Bongo de réinvestir dans la pierre et le foncier français (l'affaire des « biens mal acquis ») les sommes colossales qu’ils ont piquées dans les caisses de leurs Etats, sans parler des subventions accordées par la « communauté internationale » au titre de « l’aide au développement » (laissez-moi pouffer) qu’ils ont détournées à leur profit et planquées en Suisse, à Singapour ou aux Îles Vierges britanniques.
Vous en voulez encore ? Eh bien voyons du côté d'Ankara et d'Istamboul, et des islamistes de l'AKP dirigés par l'islamiste « conservateur modéré » (!) Redjep Tayip Erdowan (en phonétique). Un bon musulman, c'est certain, qui se garde de l'esprit de lucre comme de la peste. Tout faux ! Pris les doigts dans le cambouis de l'argent sale, le bon musulman !
Mais peut-être – espérons-le – qu’il n’est pas obligatoire dans tous les pays du monde que ce soient les bandits, gangsters et autres mafias qui arrivent au pouvoir.
Cela reste une question malgré tout, par exemple après lecture du copieux dossier paru dans Le Monde récemment au sujet des fortunes faramineuses accumulées par ce que le journal appelle les « princes rouges » et leurs héritiers. Je parle de la Chine, évidemment. N’est-ce pas le fils de l’un d’eux dont on a retrouvé les restes dans les débris fumants d’une Ferrari dernier cri ?
Il ne faut donc pas généraliser. On ne peut imaginer – je parle au hasard – que de tels abus puissent arriver dans notre beau pays de France. Jamais de la vie, voyons. Nous avons les capitaines de pédalo les plus intègres de la planète, tout le monde le sait et personne n’oserait contester cette vérité. Et dire que j’annonçais un moment de détente en commençant. Moralité, si l’on va où l’on a décidé d’aller, ce n’est pas toujours sans sinuosités et méandres. Bon, revenons à nos roustons.

Après la Thaïlande, si nous portons nos regards sur la Centrafrique, que voyons-nous, devant nos yeux ébaubis ? Après le pillage et le meurtre généralisés commis par les milices de la coalition nommée « Séléka », juste retour des choses, c’est maintenant aux milices nommées « anti-balaka » de se dire qu’il est temps de faire couler le sang. Ce n’est qu’une habitude à prendre, comme on peut lire dans l’impressionnante trilogie écrite par Jean Hatzfeld sur la tragédie rwandaise (commencer par l’absolument indispensable Une Saison de machettes).
C’est au détour d’amusements aussi simples que ceux fournis par ces informations que la loupiote d’une chanson de Charles Trénet se met à clignoter dans ma tête. Cette chanson, peu connue, je l’ai dit, s’intitule « Biguine à Bango ». Elle dit : « Connaissez-vous la Martinique ? Connais-tu là-bas le Bango ?… ». Voilà, c’est tout. Quoi, ça ne vous suffit pas ? He bien si. Remplacez « Bango » par « Bangui ».
Vous pouvez aussi remplacer « Bango » par « Bangkok ». Et vous comprenez pourquoi j’ai parlé de l’actualité en Thaïlande et en Centrafrique. Comment, je ne suis pas très sérieux ? Mais certainement, et non seulement je le reconnais, mais je le revendique haut et fort : il ne faut pas être sérieux sur les choses sérieuses, pas plus qu’il ne faut prendre à la légère les choses légères.
Que voulez-vous faire d’autre que du mauvais esprit, au spectacle des horreurs qui se commettent un peu partout dans le monde, et qui constituent le fonds de commerce de tous les médias d’information.
En me mettant à fredonner : « Woho ! Woho ! Biguine à Bangui ! » ou « Woho ! Woho ! Biguine à Bangkok ! », j’exorcise en quelque sorte un démon, celui qui, autrement, me laisserait tétanisé d’horreur. On me parlera de dérision, de manque de compassion, et ce ne sera pas complètement faux.
Mais je demande qu’on laisse ma compassion un peu tranquille de temps en temps. Ma compassion, si c’était une personne, elle serait classée parmi les grands brûlés, traitée en grand blessé, hospitalisée vite fait dans un service d’urgence, et le monde cesserait de la harceler pour lui laisser le temps de se remettre de tous ses traumatismes et de toutes ses blessures.
Ma compassion pour les misères du monde, elle n’en peut plus. Epuisée d’avoir été sollicitée sur tous les fronts des petites et des grandes tragédies qui ensanglantent les contrées émergées de la planète.
La compassion, ça suffit ! C'est juste pour ça que je fais semblant de rire ! Parce que, finalement, ça soulage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, corruption, france, politique, charles trénet, chanson française, biguine à bango, bangui, bangkok, centrafrique, thaïlande, thaksin shinawatra, yingluck shinawatra, place maïdan, russie, ukraine, vladimir poutine, tunisie, ben ali, égypte, moubarak, afrique, obiang, sassou-nguesso, omar bongo, argent sale, turquie, erdogan, islam, islamisme, musulman, coran, journal le monde, princes rouges, chine populaire, séléka, anti-balaka, jean hatzfeld, une saison de machettes, rwanda
mercredi, 26 février 2014
28 BALZAC : LE CHEF D’ŒUVRE INCONNU (1831)
J’avais vu en 1991, quand il était sorti en salle, le film que Jacques Rivette avait tiré, soi-disant, de la nouvelle de Balzac. Il l’avait intitulé La Belle noiseuse. Un film de quatre heures que j’avais cependant vu sans déplaisir, malgré la présence de Jeanne Birquain, pardon, Jane Birkin. Je ne sais pourquoi cette personne m’insupporte.
Ou plutôt je le sais, mais ça n’a aucune importance : quand elle a vu l’âge venir, elle s’est fait greffer un sourire en plâtre qui ne la quitte pas quand elle est en public. Passons. Le film est gratifié de quatre étoiles (le maximum) dans le dictionnaire de Jean Tulard, dans une notice signée Claude Bouniq-Mercier. Moi je veux bien.
Si je me souviens bien, c’est tout à fait exagéré : c’est un bon film, mais de là au chef d’œuvre, il y a un pas trop grand pour la longueur de mes jambes. C'est sûr que là, on entre dans l’irréfutable arbitraire des subjectivités et des goûts.
Emmanuelle Béart, le plus souvent complètement à poil, se laisse tordre bras et jambes par un artiste poursuivant un but mystérieux que le cinéaste voudrait bien nous faire pressentir. Les poses changent, la torture esthétique reste. Mais je simplifie sûrement. Je me souviens d’un très long panoramique à 360° sur la campagne qui entoure une superbe bâtisse provençale, sûrement très ancienne.
Quel rapport, du film au livre ? Le titre, et encore. Dans le livre, « La Belle Noiseuse » désigne l’ultime tableau peint par maître Frenhofer, celui qui doit couronner toute son œuvre, celui qui doit immortaliser son nom dans l’histoire des arts. Il y travaille depuis dix ans.
Dans le film, Michel Piccoli, artiste-peintre de son état, qui s’appelle Frenhofer, sûrement pour la filiation balzacienne, poursuit donc sa quête torturée de la perfection picturale en torturant le corps dénudé de l’alors encore belle Emmanuelle Béart, je dis « encore belle » parce qu’elle n’avait pas encore les deux pneus qui lui ont servi de lèvres par la suite, après le passage de la siliconeuse.
Mais pour dire le vrai, franchement, Rivette, Le Chef d’œuvre inconnu, l’œuvre écrite par Balzac, il s’en contrefiche allègrement, il s'en tape le fondement, il s'en brosse le nombril, au point qu’il n’en reste qu’un très lointain souvenir, si du moins le spectateur est de bonne volonté. Car il en faut, en même temps qu’un bel effort intellectuel pour faire le lien entre la nouvelle et le film.
Car le bouquin, qu’est-ce qu’il raconte ? Un grand maître de la peinture, supérieur à tous les peintres de son époque et reconnu comme tel par ses pairs, épuise son génie à faire en sorte qu’il se dépasse pour atteindre à une beauté qu’il espère surhumaine.
Soit dit en passant, Nicolas de Staël a sans doute succombé à l’échec d’une semblable ambition, quand il a choisi de se défenestrer, en 1955. Ceci pour dire qu’il y a du fanatisme religieux autocentré dans ce genre de tentative d’atteindre l’absolu. Je ne juge certes pas. Et il n'est pas le seul à avoir ainsi fini de croire qu'il pouvait.
Je me contente de plaindre (et d'admirer) l’artiste qui se trouve aux prises avec un démon venu du dedans, parce que je sais déjà, en même temps que je découvre son désespoir d’atteindre son idéal, qu’il ne l’atteindra jamais. Ce fut le drame de Giacometti, désespéré devant la tête de Michel Leiris, qu’il n’arrive pas, dit-il, à rendre comme il la voit dans sa tête à lui.
Mais saura-t-on jamais pour quelle exacte raison Nicolas de Staël s’est suicidé ? Peut-être même ne s’est-il pas suicidé, après tout ? Peut-être était-il simplement pris de boisson. Mais le Frenhofer de Balzac, il sait qu’il est un maître, car il lui suffit d’ajouter quelques coups de pinceau au magnifique tableau de son élève Porbus pour en faire un chef d’œuvre digne des collections de la reine de France auxquelles il est destiné.
Porbus existe, de même que son jeune ami le peintre Nicolas Poussin. L’histoire se passe en 1612. Le vieux maître Frenhofer, qui travaille donc depuis dix ans à parachever le chef d’œuvre de ses chefs d’œuvre cherche une jeune femme pour lui servir de modèle. Il se trouve que l’épouse de Poussin est remarquablement belle, mais le peintre, déjà un peu reconnu par ses pairs, rechigne à la laisser poser nue sous les regards de Frenhofer, car il en est encore très amoureux et très jaloux.
Mais l’histoire n’ira pas à son terme, car Frenhofer, fanatisé par l’espoir d’absolu placé dans son travail ultime de « La Belle Noiseuse », interdit à quiconque de s’approcher de sa toile. Et le jour où, après d’âpres négociations qui ont mis des aspérités pointues dans la parfaite entente (jusque là) entre Poussin et sa tendre épouse, Porbus et ce dernier sont autorisés à entrer enfin dans l’atelier, ils ne voient sur la toile sacrée qu’un amas de couleurs informes.
A l’exception de, « dans un coin de la toile, le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d’admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction ».
Car Porbus et Poussin constatent que la monomanie exaltée de ce génie de la peinture, comme est présenté Frenhofer, l’a conduit à barbouiller une infamie picturale sur la toile qui devait consacrer son éternel génie. On apprend que, dans la nuit suivante, la maison de Frenhofer a brûlé, avec Frenhofer et avec tous les tableaux : mis en face de ce chaos sorti de sa palette, l’artiste n’a pas supporté de voir cette réalité en face, d’avoir fait du n’importe quoi. Le débat vital où se débat l'artiste (doit-il privilégier le dessin ou la couleur ? le trait ou la surface ?) s'abolit à l'instant même, pour que le récit verse dans le tragique.
Dans le film de Rivette, disons-le, il ne reste rien de cette quête d’un absolu. Quand Piccoli enferme dans un mur la toile obtenue après les longues tortures qu’il a fait subir à la dénudée Béart Emmanuelle, il retourne s’asseoir dans son fauteuil à côté de celui de Jeanne Birquain, pardon Jane Birkin.
Un film de bourgeois futile plein de son angoisse existentielle, retrouvant à la fin le confort de sa continuité nantie et la chaleur de son coin du feu habituel, là où Balzac traçait le portrait tragique d’un grand artiste soudain mis en présence de son propre néant, et qui, dès lors, préfère s’anéantir.
Autrement dit la différence qu’il y a entre la comédie de boulevard et une tragédie de Racine.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cinéma, littérature française, balzac, le chef d'oeuvre inconnu, la belle noiseuse, jacques rivette, emmanuelle béart, michel piccoli, jane birkin, nicolas de staël, alberto giacometti, peinture, nicolas poussin
vendredi, 31 janvier 2014
21 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Le roman est, selon l’histoire, celui qui a procuré la renommée au jeune écrivain, qui avait préalablement « fait ses classes » avec ce que la tradition appelle « romans de jeunesse ». Je suis pour ma part persuadé que La Peau de chagrin est un roman fondateur, un roman pourtant mal bâti. Je n’y peux rien, c’est mon avis : à la lecture, je vois un grave défaut, mais en refermant le livre, je suis saisi par la force de l’ensemble. Allez comprendre.
Le défaut, il est vite vu. Quand Raphaël sort du magasin, ayant glissé dans sa poche la peau fatale. Miracle ! Il tombe en effet (c’est vraiment le mot) sur son ami Emile, entouré de quelques copains, qui l’entraîne chez le banquier Taillefer, pour se lancer dans une bombance et une orgie acharnées. Emile lui annonce tout de go qu’il vient d’être bombardé directeur d’une revue financée par le banquier : il n’a pas intérêt à faire défaut.
La description de l’orgie est parfaite. Le problème, à mon avis, vient après le dialogue entre les deux amis et deux prostituées, Euphrasie et Aquilina. Sans entrer dans le détail, elles y exposent leur « philosophie » de l’existence, elles qui se savent promises à finir à « l’hôpital ». On verra qu’Euphrasie aura un autre, mais étonnant destin. C’est elle qui déclare aux deux amis : « J’aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Je n’ai ni la manie de la perpétuité ni grand respect pour l’espèce humaine à voir ce que Dieu en fait ! Donnez-moi des millions, je les mangerai … ».
Ce n’est qu’ensuite que Raphaël commence à raconter sa vie à Emile. Et je vous jure, ça n’en finit pas. C’est qu’il faut faire tout un chapitre (le fameux « La femme sans cœur »), que diable. On a droit à tout. La vie de Raphaël défile donc, depuis la solitude auprès d’un père très autoritaire, intraitable et riche. Le destin (encore lui) veut qu’il soit ruiné, et il aura beau lancer son fils, devenu juriste par force, dans des procès à n’en plus finir, il ne lui restera rien ou presque (une petite île au milieu de la Loire, où est la tombe de sa femme).
Raphaël, devenu maître de sa vie, envisagera d’abord de se lancer dans la littérature et la science, entreprenant un énorme « Traité de la volonté » à la lueur d’une chandelle, dans la mansarde d’un petit hôtel tenu par une femme, qui vit seule avec sa fille Pauline, âgée de quatorze ans. Toutes deux vivent pauvrement et, voyant la grande austérité du régime que s’impose le jeune homme, se mettent à veiller sur lui sans qu’il s’en doute, sur son linge, sur ses repas, bref deux anges gardiennes. La dame attend le retour de son mari, prisonnier des Cosaques depuis si longtemps qu’il faut vraiment avoir la foi pour y croire. Mais sa certitude est entière.
Le malheur de Raphaël lui vient par Rastignac, soi-disant son ami, qui vient lui instiller la « philosophie » d’un certain Honoré de Balzac : avoir des dettes, c’est risquer de se ruiner, mais c’est avoir une chance d’attirer la chance. Rastignac est le premier tentateur : après lui avoir permis de gagner quelque argent facile par l’écriture de quelques traités grassement payés, il lui prend ses dernières pièces d’or pour aller les jouer. Le malheur c’est qu’il gagne gros.
Cela tombe très bien et très mal, car il a présenté Raphaël à Foedora. La femme sans cœur, c’est elle. Il en tombe éperdument amoureux, raide dingue et c’est peu dire. Il s’agit d’une femme, certes, mais ce n’est pas n’importe qui. Et le curieux de l’affaire, c’est que le bouquin est écrit en 1831, et que Balzac ne rencontre Madame Hanska qu’en 1833. Or il écrit en toutes lettres, à propos de Foedora : « Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié Russe, une Russe à moitié Parisienne ». Intuition ? Prédestination ? Fantasme ? Hasard pur ? Allez savoir.
Ce qui me reste de ça, c’est la course désespérée du pauvre Raphaël derrière la trop belle et trop cruelle Foedora, qui désespère tous les hommes par sa façon d’attirer tous leurs hommages. Et pour parler franchement, cet étalage des tourments d’un Raphaël écartelé entre l’idéal austère de l’œuvre à élaborer et l’espoir de jouissances beaucoup plus terrestres autant qu’immédiates, a quelque chose de fatigant.
Finissons. Le coup de théâtre est tellement théâtral que j’ai du mal à y croire. C’est au pénible réveil de tous les convives du banquier Taillefer que se présente l’homme de loi qui déclare à la face du monde ici rassemblé que Raphaël est le légataire tant recherché, qui hérite de l’immense fortune de son aïeul maternel. Le côté spectaculaire et m’as-tu-vu de toute la scène, en particulier la solennité tapageuse du notaire Cardot, a quelque chose de peu vraisemblable.
Car ce qui est sûr, c’est que Raphaël voit ici se réaliser son désir et que ce désir le fait penser à la mort. Il est saisi d’horreur. Ayant aussitôt mesuré le rétrécissement de la « peau de chagrin », il sait que le moindre de ses désirs précipite sa fin. Il s’enferme donc dans son luxe, servi par Jonathas, le vieux domestique dévoué, revenu se mettre à son service.
Jusqu’à ce qu’un jour il retrouve la jeune Pauline, mais transformée. En effet, le papa est revenu et, tenez-vous bien, nanti d’une fortune colossale amassée au cours de ses voyages dans les lointains. Et elle est amoureuse de son Raphaël, Pauline. Les deux amants sont bientôt mariés et vivent dans une fusion totale.
Tout ça finira mal, comme on sait, après quelques péripéties liées aux angoisses de mort de Raphaël, que Pauline ne comprendra qu’à la dernière extrémité, lançant à Jonathas accouru : « Que demandez-vous ? dit elle. Il est à moi, je l’ai tué, ne l’avais-je pas prédit ? ». Un drôle d’épilogue, rêveur et poétique, laisse entendre que Pauline est devenue vapeur et brume, « fantôme de la Dame des Cousines », du côté de quelque château de la Belle au Bois Dormant.
Je garde du livre cette impression partagée entre l’admiration pour la conception du roman et le regret dû à une composition que je me permets de trouver faible. Je sais, on me dira que « La femme sans cœur » permet à Balzac d’établir un contraste tranché entre le vain amour pour Fœdora dans lequel Raphaël manque de se perdre et l’amour réciproque et comblé pour Pauline, qui le tue.
Je crois que le défaut se situe dans la volonté de symétrie : l’auteur veut à tout prix découper son récit en trois parties équilibrées, ce qui l’oblige à étirer démesurément l'exposé que fait Raphaël à son ami, n’épargnant au lecteur aucun détail des tourments et déboires éprouvés, qu’ils soient pécuniaires ou amoureux. Pour le coup, on peut appeler ça du « tirage à la ligne ». Enfin, c’est mon avis, et je le partage, comme dit Dupont ou Dupond, je ne sais plus.
Cela dit, le fait que j’aie pu m’attarder (trop, et encore, j’aurais pu …) longtemps sur cette œuvre montre qu’elle recèle de riches profondeurs, ce qui n’étonnera guère les habitués de l’écrivain. Maintenant, ce qu’ont pu écrire des gens très savants sur les sources de La Peau de chagrin, je leur laisse les considérations oiseuses. Balzac s’est-il inspiré du mesmérisme ? A-t-il emprunté à L’Homme au sable (ETA Hoffmann) ?
Autant de questions que je n’ai même pas l’idée de me poser. J'aurais plutôt celle de ne pas trouver géniaux les deux coups de baguette magique que sont la spectaculaire annonce du fabuleux héritage et les spectaculaires retrouvailles avec Pauline, devenue elle aussi richissime grâce à l'incroyable retour de son père. On me dira qu'un miracle ne vient jamais seul.
On ne va pas chipoter.
Voilà ce que je dis, moi.
08:59 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, la peau de chagrin
mercredi, 29 janvier 2014
19 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Je ne fais pas exprès de passer du temps sur La Peau de chagrin : c'est le livre lui-même qui m'y conduit. Qui m'y oblige peut-être. Et pour dire les choses franchement, je trouve du plaisir à en parler. C'est peut-être un signe, après tout.
Alors en fait, qu’est-ce que c’est, concrètement, une peau de chagrin ? C'est le problème du jour. La deuxième partie, intitulée « La femme sans cœur », est totalement muette sur ce point, puisqu’elle raconte en long, en large et en détail ce qu’a été la vie de Raphaël avant la rencontre avec le vieux marchand d’antiquités.
Dans la première, la présentation et la description de la peau sont expédiées en cinq pages. Il est vrai que ces pages sont d'une densité rare. Tout le monde connaît le thème, ressassé dans les manuels scolaires et les dictionnaires et histoires de la littérature. Tout le reste est dans la dernière, quand la peau de chagrin, en entrant en possession, entre en action. Et c'est bien elle qui possède celui qui la possède. Une variante du pacte faustien, en quelque sorte.
Je commencerai donc logiquement par la dernière partie, lorsque Raphaël a déjà commencé à subir les effets de la peau magique. Et encore plus logiquement, je débuterai par cet épisode tout à fait étonnant, dans lequel Balzac raconte les démarches accomplies par le héros pour percer le secret de ce talisman incroyable, dont il a scrupuleusement tracé le contour d’origine sur une grande surface blanche, et dont il a constaté le rétrécissement, déjà conséquent au moment où j'en parle.
Balzac décide, à ce moment du récit où la vie de Raphaël se résume à une petite pièce de cuir qui rapetisse dès qu’il exprime un désir, de confronter la Science à un phénomène qui la dépasse. Le premier spécialiste qu’il consulte est le zoologiste Lavrille, qui lui révèle (ou lui affirme) que la peau est celle d’un âne de Perse, plus précisément un onagre.
Cela ne lui apprend strictement rien, puisqu'au moment où il découvrait l'existence de la peau (au début du livre), il déclarait : « J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre ». Mais il n'est pas impossible que ce détail soit une étourderie de Balzac : ce ne serait pas la seule.

UN ONAGRE
Comme Raphaël aimerait bien faire retrouver à la peau sa surface d’origine, Lavrille l’aiguille sur le professeur Planchette, célèbre spécialiste de mécanique, en plein siècle de la mécanique toute-puissante (et de son exaltation). Planchette, comme Lavrille et la plupart du temps les scientifiques, est un illuminé perdu dans ses raisonnements et ses découvertes, et insoucieux de la gloire et de l’argent.
Rendus chez le métallurgiste Spieghalter, Planchette introduit la peau entre les deux platines d’une presse hydraulique. Que croyez-vous qu’il arrive ? La presse se brise, incapable de venir à bout de cette peau animale : « Non, non, je connais ma fonte. Monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans ». L’Allemand en colère aura beau flanquer un énorme coup de masse sur la peau posée sur une enclume, la faire brûler dans une forge, celle-ci ressort absolument intacte de tous les mauvais traitements : « Un cri d’horreur s’éleva, les ouvriers s’enfuirent ».
Planchette emmène alors Raphaël chez Japhet pour voir si la Chimie viendra à bout du problème, mais là encore : « La Science ? Impuissante ! les acides ? Eau claire ! La potasse rouge ? Déshonorée ! La pile voltaïque et la foudre ? Deux bilboquets ! ». La conclusion des deux savants, après avoir baptisé « diaboline » la substance de la peau est la suivante : « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l’Académie, nos collègues s’y moqueraient de nous ». Echec sur toute la ligne.
Ce n’est pas pour rien que le mot « cuir » a produit le mot « coriace ». C’est sûr, au sujet de la « Science », on ne saurait confondre Balzac et Zola. Ce qui les différencie ? Pour schématiser, je dirais volontiers que Balzac ressemble à un moteur à explosion, émotif par nature, quand Zola descend par filiation des animaux à sang froid, scientifiques par profession, par nature et par vocation. Le passionnel opposé au rationnel. L’observation du vivant, par contraste avec la dissection des cadavres sur le marbre d’un amphithéâtre de faculté de médecine. La palpitation des émotions contre l'esprit de système. Les battements du cœur contre la Raison toute-puissante et desséchée.
Pour résumer, je vote Balzac, et je jette (pas tout) Zola à la corbeille.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, émile zola
mardi, 28 janvier 2014
18 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Préambule : voilà-t-il pas que je tombe, dans l'avis « Au lecteur » qui ouvre L'Elixir de longue vie, sur cette jolie phrase d'Honoré de Balzac : « La lecture nous donne des amis inconnus, et quel ami qu'un lecteur ! nous avons des amis connus qui ne lisent rien de nous ! l'auteur espère avoir payé sa dette en dédiant cette œuvre Diis ignotis ». Je dédie cette déclaration aux curieux qui me font l'honneur de venir jeter un œil dans ce blog et d'y passer un moment.
Post-préambule : dernières nouvelles d'Egypte, où le général Sissi a été nommé maréchal : "Après Sissi Impératrice, Sissi Maréchal". Et ça commence à se savoir, que l'époque est au changement de sexe et au « trouble dans le genre ».
*******
LA PEAU DE CHAGRIN (1831)
La visite du magasin d’antiquités au début de La Peau de chagrin permet à Balzac de faire un inventaire de tout ce qu’on peut trouver d’original, de rare, voire d’unique dans toutes les contrées de la terre. Il faut savoir qu’il n’aimait rien tant que le beau et le cher, et quand il décrit l’intérieur somptueusement aménagé d’un hôtel particulier parisien, impossible de ne pas ressentir son goût pour les belles choses et le luxe.
Il s’ingéniait par exemple à se faire faire des cannes toutes plus curieuses et intéressantes les unes que les autres. Il va sans dire que son goût pour les meubles, les tentures, les rideaux, les objets, la vaisselle, tout était à l’avenant. On comprend sans mal que Madame Hanska, à la mort de l’écrivain, fut mise en face d’un monceau de dettes et en présence des figures patibulaires de la foule des créanciers du défunt.
Son principe était simple : s’endetter, c’est se mettre dans l’obligation de faire rentrer l’argent. Et puis rien de tel qu'un intérieur princier pour en mettre plein la vue à l'imprimeur, à l'entrepreneur, voire au créancier impatient, avant de traiter avec eux : faire croire qu'on est en mesure de dépenser sans compter, Balzac le considérait comme une mise de fonds, dont il attendait et espérait de généreux « retours sur investissement ». Ce n'est pas en paraissant misérable qu'on peut escompter entrer dans les affaires et faire fortune.
Et lui qui connaissait son Rabelais sur le bout des doigts, on peut se dire qu’il avait fait sienne la conviction exposée par Panurge dans les chapitres III et IV du Tiers livre, où il fait un long discours à la louange des « debteurs et emprunteurs », qui vaut son pesant de ʺPrix Nobel d’Economieʺ qui, comme chacun sait, n’existe pas, Alfred Nobel ayant toute sa vie professé une solide haine des mathématiques et de l’économie. Tant pis si j'exagère. Il est vrai que Rabelais corrige le chenapan au chapitre V, où Pantagruel expose sa réprobation et sa détestation de ces « acteurs du marché ».
Et les biographes se sont plu à commenter en parallèle les fortunes impressionnantes que Balzac a fait entrer dans ses caisses grâce à son acharné travail d’écrivain, et les richesses fabuleuses qu’il a prodiguées et englouties sans compter pour se créer un décor intime luxueux et prestigieux, digne de la haute idée qu’il se faisait de lui-même. Cette tendance de fond, est perceptible dans la visite qu’il nous fait faire du magasin de curiosités, où sont accumulés tous les objets capables de satisfaire son appétit insatiable ou son inextinguible curiosité.
Pour alimenter cet appétit et faire fonctionner la machine à faire rentrer l’argent, il ne lésina pas. La Comédie humaine tout entière fut écrite en dix-sept ans seulement ! Ce monument, unique dans l’histoire littéraire avec ses cent trente-trois œuvres (!!!!), fut conçu en 1833, l’année où il déboula chez sa sœur Laure, devenue Madame Surville, pour déclarer : « Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie ». Proclamation stupéfiante. Mais il avait diantrement raison. Revenons à nos moutons.
Quand Raphaël de Valentin, pour attendre l’heure nocturne de plonger dans la Seine, entre dans la boutique de curiosités, il n’est pas tout à fait dans son état normal : « … laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d’un ivrogne. N’était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort ? ». Sa vision des choses est troublée par son état, il s’en rend compte : « Il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s’ils ne renfermeraient pas quelques singularités à sa convenance ». Un « gros garçon joufflu » va le guider.
Je n’essaierai pas de résumer la visite, autant vaudrait réécrire le livre. En attendant ce moment improbable, il faut le lire. Qu’on imagine simplement un invraisemblable capharnaüm, où voisinent les objets les plus hétéroclites, les armes avec la vaisselle, les tableaux avec les marbres, les animaux empaillés avec les bibelots exotiques, que Balzac synthétise dans la jolie expression « fumier philosophique ». Raphaël, dans « ces trois salles gorgées de civilisations, de cultes, de divinités … », sous l’action de la mystérieuse émanation de ce fumier, quitte le monde réel.
Il est conseillé de prendre le mot « magasin » dans son premier sens d’ « entrepôt ». C’est une accumulation, un amoncellement, un bric-à-brac, une rubrique-à-braque, tout ce qu’on veut. Je soupçonne Balzac d’avoir soigneusement placé, au fur et à mesure de l’avancée de Raphaël dans la cataracte des objets énumérés dans cette scène ahurissante tout ce qui avait guidé les rêves de grandeur du jeune homme, quand il feuilletait le « Catalogue de la Manufacture des Armes et Cycles de Saint-Etienne ». Je plaisante à moitié : tous ces trucs, ces machins, ces bidules insolites, dont beaucoup coûtent la peau du cul, Balzac ne les a pas sortis de son chapeau. Je veux dire que, dans son imaginaire, ça vient de loin.
Ils font partie intégrante de son rêve de grandeur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, l'élixir de longue vie
lundi, 27 janvier 2014
17 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Il paraît que La Peau de chagrin est un des chefs d’œuvre de Balzac. C’est sûrement vrai, puisque des autorités éminentes en la matière l’ont affirmé. C’est en tout cas, encore aujourd’hui, un des romans les plus lus de l’auteur. Pour mon compte, je reste partagé. Pour une raison simple, tenant à la composition, qui donne l’impression d’une vaste digression placée au cœur même du livre et qui nous éloigne du sujet annoncé dans l’introduction.
Il est en effet divisé en trois parties, dont la première, introductive en quelque sorte, forme un petit tiers, la suite constituant les deux autres (gros) tiers : 1) Le Talisman ; 2) La femme sans cœur ; 3) L’agonie. La deuxième partie semble au premier abord, et surtout pendant la lecture, n'avoir aucun lien avec les deux autres. Le livre s’ouvre sur le pressentiment d’une tragédie : un jeune homme à la mine de déterré vient perdre son dernier écu dans une salle de jeu, puis se dirige vers la Seine, avec l’intention d’y finir sa triste existence.
Comme il fait grand jour et que Raphaël de Valentin (le lecteur ne découvre son identité que plus tard) ne veut pas rater sa mort et risquer d’être sauvé par la barque du « Secours aux asphyxiés », il doit attendre la nuit. Pour cela, rien de mieux que de passer le temps, par exemple en pénétrant dans cette boutique d’un « marchand de curiosités » : « … un magasin d’antiquités dans l’intention de donner une pâture à ses sens, ou d’y attendre la nuit pour y marchander des objets d’art ». Il ne sait pas encore que franchir le seuil va décider de son destin, en même temps que retarder sa fin.
Et là il faut dire quelque chose de la description de l’antre du maître des lieux. Bien souvent, les amateurs de littérature, quand ils sont tièdes, sont rebutés par ces longues pages où Balzac plante un décor avec le soin méticuleux d’un artiste peignant un paysage ou un bouquet de fleurs. Je pense aux pages introductives du Père Goriot, dans lesquelles l’auteur nous amène jusqu’à la salle à manger de la mère Vauquer (« Cette pièce est dans tout son lustre … »), que le lecteur moyen (disons le lycéen qui doit rendre son devoir lundi prochain) saute avec lassitude et empressement, déjà fatigué.
Le lecteur paresseux a toujours tort de délaisser ces passages qu’il juge fastidieux, car, surtout chez Balzac (ou Dostoïevski), si l’auteur se donne la peine de décrire longuement (voir la peinture de la Nature dans Les Chouans, déjà), c’est qu’il a une intention : en général, c’est de faire ressentir une ambiance, un climat, parfois même d’annoncer de façon métaphorique ce qui va se passer. Se passer des descriptions quand on lit Balzac, c'est s'exposer à ne rien comprendre aux profondeurs morales et psychologiques sur le flot desquelles il fait aller l'embarcation de son récit.
Dans La Peau de chagrin, dans cette boutique emplie de vieilles choses, que nous montre Balzac ? C’est simple : l’univers. L’impression qui domine en effet, est quasiment que : « Rien de ce qui est humain n’est absent ». Une concentration de trésors accumulés, sur lesquels veille un gros garçon joufflu : « Vous avez des millions ici, s’écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d’appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. – Dites des milliards, répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n’est rien encore, montez au troisième étage et vous verrez ! ».
On a l’impression que l’espace de la boutique s’est distendu aux dimensions de l’imaginaire de l’auteur, c’est-à-dire aux dimensions de l’infini. J’ai l’impression de retrouver la maison marseillaise des frères Sourbidouze dans L’Antiquaire (Henri Bosco) avec ses invraisemblables sous-sols démesurés, ses interminables boyaux tortueux à peine éclairés, ses portes épaisses et ses immenses cavernes secrètes.
Il ne faut à aucun prix bâcler la lecture du cheminement de Raphaël dans le magasin d'antiquités.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, l'antiquaire, henri bosco
dimanche, 26 janvier 2014
16 BALZAC : PETITES MISERES DE LA VIE CONJUGALE
Petites misères de la vie conjugale est donc un livre brillant, plein de ce qu’on appelait à l’époque de Balzac « l’esprit parisien ». Il s’agit de causer. Je veux dire qu’on est dans un salon élégant et impitoyable, où la survie dépend de l’originalité et de la vivacité d’une repartie, et où la cruauté d’une épigramme bien tournée est capable de ruiner pour toujours la réputation d’un homme, même quand il est « en vue ». Et au style dont le livre est rédigé, on sent que Balzac, non seulement a fréquenté ce genre de société assidûment, mais aussi qu'il ne devait pas être maladroit dans le lancer de piques et autres formules incisives.
L'ouvrage adopte en effet le ton qu'on imagine bien qu'aurait une conversation entre quelques jeunes gens célibataires fumant et devisant joyeusement, accoudés à la cheminée, et observant les manèges et les allées et venues des couples invités dans les salons d'un riche bourgeois. Comme s'ils se donnaient les uns aux autres toutes les raisons de la terre de ne pas se marier, et se renforcer ainsi dans leur décision.
On les entend presque se livrer gaillardement à la dissection du spectacle qu'ils ont sous les yeux, et à l'énumération par le menu des mille détails qui pourrissent la vie d’un mari, quand il se rend compte que son épouse ne ressemble que très approximativement à la mignonne petite fée dont il était tombé amoureux trois ans auparavant et dont il a étourdiment demandé la main à des parents nantis comme des huîtres grasses.
Car toute la première partie du livre s’apitoie sur les calamités qui s’abattent sur l’homme qui, inconsidérément, s’est aventuré dans les sentiers tortueux et hérissés d’épines du statut de « mari ». Notre époque, superbement « libérée » des normes et des conventions, est à des années-lumière de pouvoir comprendre des temps où, au moins dans une certaine classe sociale (supérieure), les dites normes et conventions apparaissaient encore comme intangibles.
Et s’il m’est permis de formuler un avis personnel, la façon dont Balzac dépeint l’intelligence féminine dans les relations du couple conjugal est d’une subtilité et d’une justesse incomparables.
Sans vouloir généraliser à outrance (vous savez, tous ceux qui disent : « La Femme …», mais aussi toutes celles qui disent : « Oh vous, les Hommes … »), et sans vouloir paraître misogyne à l’excès, Balzac indique aux malheureux qui ont, sous le coup de l’illusion que donne le désir (pris pour de l'amour) pour une jeune, gracieuse et jolie personne, décidé de sauter le pas et de comparaître en sa compagnie devant monsieur le Curé puis monsieur le Maire, les deux caractéristiques essentielles, les deux grandes spécificités de l’intelligence féminine sont : 1) la manipulation par torsion ou réversion du sens des mots, 2) une mauvaise foi à toute épreuve, essentiellement manifestée dans la dénégation des évidences. Ce n'est pas mal vu.
Certains titres de chapitres attirent et aiguisent l’attention : « La logique des femmes » commence ainsi : « Vous croyez avoir épousé une créature douée de raison, vous vous êtres lourdement trompé, mon ami ». C’est un épisode à enfant, ce surnuméraire familial dont la mère se sert comme d’une arme contre le père (toujours putatif, rappelons-le).
Celui-ci veut envoyer son fils au Collège dans le but qu’il reçoive une éducation et une instruction, mais aussi au motif qu’il mène au logis une sarabande dévastatrice : « La mère lui dit ʺPrends !ʺ à tout ce qui est à vous ; mais elle dit : ʺPrends garde !ʺ à tout ce qui est à elle ». Le père, qu’il soit bien entendu, se soucie de faire former son fils, la mère de le protéger du monde réel. Et quand la bonne déclare que le petit n’a jamais eu d’engelures, « Vous sortez suffoqué de colère ». On n’est pas plus retors. Que le mari le sache : la femme est passée maitresse dans l’art du retournement d’argument.
Quelques titres de chapitres : « Jésuitisme des femmes », où leur dextérité extrême de la casuistique déploie des ailes de grand rapace ; « Le taon conjugal » expose toutes les piqûres d’amour-propre que la femme plante dans l’épiderme de son mari en comparant ce qu’il fait pour elle à ce que fait monsieur Deschars pour son épouse ; « Nosographie de la villa » déroule tout le caprice d’une femme qui se met à aimer la campagne par vanité, et qui, sitôt satisfaite, regrette son appartement parisien. Bref, chapitre après chapitre, l’enfer du mari. On n’en finirait pas.
Il est juste de préciser qu’il ne s’agit que de la première partie du livre. La seconde est présentée comme celle où l’auteur rend justice à la femme, en lui faisant à son tour jouer le rôle de la victime, la précédente s’étant achevée sur le chapitre « Le solo de corbillard ». Essayons d’être objectif, et admettons pour le coup que, dans le livre, les tracasseries que le mari fait à sa femme n’ont aucune commune mesure avec celles qu'il en a subies. Balzac a bien du mal à revêtir la sensibilité féminine.
Cela n’empêche pas l’auteur de farcir son texte de considérations intéressantes, parfois passionnantes, qui ressemblent à des professions de foi. Parlant de petits hommes qui n’écrivent que des petites choses (voir la tirade de Figaro au dernier acte du Mariage de Figaro : "Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits") : « Ceci est l’histoire des médiocrités en tout genre, auxquelles il a manqué ce que les titulaires appellent le bonheur. Ce bonheur, c’est la volonté, le travail continu, le mépris de la renommée obtenue facilement, une immense instruction et la patience qui, selon Buffon, serait tout le génie, mais qui certes en est la moitié ».
Je ne peux m’empêcher de lire dans cette déclaration comme un autoportrait d’Honoré de Balzac en personne. Une sorte de charte déontologique traçant le contour de la silhouette de l'homme qui a l'ambition de devenir un "grand écrivain". C'était en effet un travailleur acharné, impitoyable avec lui-même et avec son secrétaire, et qui voulait que celui-ci le réveillât à minuit pour se consacrer à ses travaux d'écriture. Parmi quelques autres, Jules Sandeau, premier mari de George Sand, à ce régime, se retrouva assez vite sur les rotules et hors d'état.
En tout cas, un autoportrait très juste. Et magnifique. Et en une phrase, s'il vous plaît !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, france, balzac, petites misères de la vie conjugale
samedi, 25 janvier 2014
15 BALZAC : PETITES MISERES DE LA VIE CONJUGALE
Physiologie du mariage disséquait tous les risques encourus par l’homme qui décidait de se marier, à commencer par celui de se faire « minotauriser » par un « célibataire » au bout d’un temps plus ou moins long, qu’il appelait la « lune de miel », évaluée par Balzac à la durée approximative de trois ans. L’ouvrage se voulait en quelque sorte un traité scientifique, un manuel théorique.
Et de même que la science fondamentale est complétée par la science appliquée (où la technique joue le rôle déterminant), Balzac jugea utile d’adjoindre à ses hautes considérations un « manuel pratique » consignant un ensemble de faits observés dans la réalité et scrupuleusement rapportés.
Il le déclare dans le bien nommé chapitre « Ultima ratio » : « Cette œuvre qui, selon l’auteur, est à la Physiologie du mariage ce que l’Histoire est à la Philosophie, ce qu’est le Fait à la Théorie, a eu sa logique, comme la vie prise en grand a la sienne ». Cela donne Petites misères de la vie conjugale, livre brillant, qui braque cette fois la longue vue – et avec quelles délices de gourmet ! – sur le champ de bataille où ces deux armées que sont le mari et la femme s’affrontent sans que mort s'ensuive (en général).
Certains voient ici un roman. Quelle drôle d’idée ! Franchement, s’il y a du romanesque dans ce livre, c’est sous une forme fragmentaire et esquissée. Je m’explique. Certes, le couple est formé d’une Caroline et d’un Adolphe, mais ce sont une Caroline et un Adolphe purement virtuels, que Balzac se plaît, au fil des courts et nombreux chapitres, à plonger successivement dans toutes sortes d’éprouvettes et de corps chimiques pour en décrire la couleur, l'odeur et la teneur du précipité ainsi obtenu.
Je veux dire que l’auteur mêle allègrement les situations, les époques, les contextes et que, dans ces conditions, on ne saurait parler d’un roman à proprement parler, avec sa scène d’exposition, ses péripéties, sa construction et son dénouement. Comme le dit encore l’auteur, c’est un « livre plein de plaisanteries sérieuses ».
Concédons cependant que l'auteur suit une sorte de trame chronologique, qui irait du premier appétit pour la jolie personne et la jolie dot qui l'accompagne jusqu'au moment où le mari se résout et se résigne à la plus vaste indifférence pour tout ce qui concerne la personne de son épouse.
Ce qui est sûr, c'est que Balzac s’amuse énormément aux dépens des malheurs conjugaux de tous les Adolphes de la terre : « Il a lu des romans dont les auteurs conseillent aux maris gênants tantôt de s’embarquer pour l’autre monde, tantôt de bien vivre avec les pères de leurs enfants … ». On sent l’habitué des salons mondains qui, en compagnie de quelques amis, se divertit en taillant en pièces la réputation de quelques figures qui se pavanent sous ses yeux.
Qu’est-ce que vous pensez de « maris gênants » ? Et de « bien vivre avec les pères de leurs enfants » ? C’est pas beau, ça ? Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à Georges Brassens, et plus précisément à la chanson « A l’ombre des maris » : « Si madame Dupont, d’aventure, m’attire, Il faut que, par surcroît, Dupont me plaise aussi ! ». Brassens a le « célibataire » difficile.
Mais la strophe que je préfère, et celle qui commente avantageusement l’ouvrage de Balzac, c’est l’avant-dernière : « Et je reste et, tous deux, ensemble on se flagorne. Moi je lui dis ʺC’est vous mon cocu préféréʺ. Il me réplique alors : ʺEntre toutes mes cornes, Celles que je vous dois, mon cher, me sont sacréesʺ ». Cet éloge, ce dithyrambe en l’honneur de la femme adultère (« Ne jetez pas la pierre ...») ressemble fort à une adhésion sans réserve à la théorie de Balzac développée à la fin de Petites misères … Cocu et content de l'être, en somme ?
Après tout, Balzac et Brassens, ça commence par la même lettre. Et ce sont deux célibataires. Rien de mieux pour partager une "philosophie" identique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, balzac, physiologie du mariage, petites misères de la vie conjugale, georges brassens, à l'ombre des maris, mariage, cocu, adultère
samedi, 18 janvier 2014
13 BALZAC : LA MAISON NUCINGEN
La Maison Nucingen (1838) consiste en un dialogue débridé de quatre amis, tenu dans un des « cabinets particuliers » d’un célèbre cabaret (non nommé) de Paris, et fidèlement reconstitué par le narrateur qui, dans le cabinet mitoyen séparé par une mince cloison, a entendu et mémorisé l’intégralité de la conversation.
Aux voix, il a reconnu les personnages, qui se nomment Blondet, Finot, Couture et Bixiou : « C’était quatre des plus hardis cormorans éclos dans l’écume qui couronne les flots incessamment renouvelés de la génération présente ». Il est utile de préciser que les langues vont bon train, du fait qu’on a fait venir un nombre respectable de bouteilles de champagne, au point qu’à la fin les compères sont un peu gris.
Bixiou raconte à ses amis comment Eugène de Rastignac, qui vivait si pauvrement à la pension Vauquer, vit aujourd’hui confortablement, à la tête d’une fortune de quarante mille livres de rentes, tout en ayant pu richement "doter" ses sœurs, restées au fond de leur province.
Accessoirement, il va dénouer l’écheveau qui rend incompréhensibles au bon peuple les calculs et manœuvres hautement raffinés qu’on voit à l’œuvre dans les milieux de la haute finance, incarnés ici par le richissime banquier alsacien Nucingen. Ah ! les interventions de Nucingen, plus alsaciennes que le vrai : « Hé pien ! ma ponne ami, dit Nucingen à du Tillet en tournant le boulevard, location est pelle bire ébiser Malfina : fous serez le brodecdir teu zette baufre vamile han plires, visse aurez eine vamile, ine indérière ; fous drouferez eine mison doute mondée, et Malfina cerdes esd eine frai dressor ».
Traduction : eh bien mon bon ami, l’occasion est belle pour épouser Malvina : vous serez le protecteur de cette pauvre famille en pleurs, vous aurez une famille, un intérieur ; vous trouverez une maison toute montée, et Malvina certes est un vrai trésor. On trouve dans le Nouveau dictionnaire des œuvres le commentaire suivant : « De plus, Balzac, par un souci exagéré de réalisme, s'obstine à reproduire le singulier jargon parlé par le baron, ce qui rend pénible la lecture des dialogues ».
Pas faux, mais ma parole, si le commentateur met un jour les pieds dans l'Alsace profonde pour dialoguer avec un vieux de la vieille, il verra ce que c'est. Je pense aussi à Victoire, la servante du colonel dans Le Sapeur Camember, et à son accent superlativement alsacien, qui provoque quelques malentendus. Ainsi : « Le colonel est-il visuel, mam'selle Victoire ? - Foui ! mossieu Gamempre, ché fiens te le foir ... tant son gabinet ... il ... é...grivé », dont le dernier mot fait croire au sapeur que le colonel est "crevé". Toute la caserne se précipite chez lui. Comme il est bien vivant, on convoque Victoire : « Oh ! mossieu Gamempre (...) c'est pas chentil te faire arrifer tes misères à une bôvre cheune fille innocente ... Ch'ai pas tit : "Le golonel il est grévé" ... Ch'ai tit : "Le golonel il égrivé ... avec une blume, quoi ! ».
Ailleurs, elle va faire les courses, et fait deviner à Camember ce qu'elle va acheter : « ... ça gommence par un C ». Le sapeur ne trouve pas : « Eh ! pien ! mossieu Gamempre, puisque fous ne tefinez pas : c'est tes cuernouilles et un chigot ! ». Dans les Contes drolatiques, Balzac se laissera carrément aller à une débauche toute rabelaisienne dans ce genre, en imitant cette fois la langue du XVI° siècle. Revenons à nos moutons.
Je laisse de côté la complexité des tripatouillages boursiers décrits par Bixiou-Balzac, pour en venir à ce que Blondet dit des canuts de Lyon, qui se révoltèrent en 1831 et en 1834 contre le sort qui leur était fait, et dont l’étendard portait en ces journées la fière devise : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ».
Voici ce que déclare Blondet : « Voici, reprit Blondet. On a beaucoup parlé des affaires de Lyon, de la République canonnée dans les rues, personne n’a dit la vérité. La République s’était emparée de l’émeute comme un insurgé s’empare d’un fusil. La vérité, je vous la donne pour drôle et profonde. Le commerce de Lyon est un commerce sans âme, qui ne fait pas fabriquer une aune de soie sans qu’elle soit commandée et que le paiement soit sûr. Quand la commande s’arrête, l’ouvrier meurt de faim, il gagne à peine de quoi vivre en travaillant, les forçats sont plus heureux que lui. Après la Révolution de Juillet, la misère est arrivée à ce point que les CANUTS [sic] ont arboré le drapeau : Du pain ou la mort ! une de ces proclamations que le gouvernement aurait dû étudier, elle était produite par la cherté de la vie à Lyon. Lyon veut bâtir des théâtres et devenir une capitale, de là des Octrois insensés. Les républicains ont flairé cette révolte à propos du pain, et ils ont organisé les Canuts qui se sont battus en partie double. Lyon a eu ses trois jours, mais tout est rentré dans l’ordre, et le Canut dans son taudis. Le Canut, probe jusque-là, rendant en étoffe la soie qu’on lui pesait en bottes, a mis la probité à la porte en songeant que les négociants le victimaient, et a mis de l’huile à ses doigts : il a rendu poids pour poids, mais il a vendu la soie représentée par l’huile, et le commerce des soieries françaises a été infesté d’étoffes graissées, ce qui aurait pu entraîner la perte de Lyon et celle d’une branche de commerce français. Les fabricants et le gouvernement, au lieu de supprimer la cause du mal, ont fait, comme certains médecins, rentrer le mal par un violent topique. Il fallait envoyer à Lyon un homme habile, un de ces gens qu’on appelle immoraux, un abbé Terray, mais l’on a vu le côté militaire ! Les troubles ont donc produit les gros de Naples à quarante sous l’aune. Ces gros de Naples sont aujourd’hui vendus, on peut le dire, et les fabricants ont sans doute inventé quelque moyen de contrôle. Ce système de fabrication sans prévoyance devait arriver dans un pays où Richard Lenoir, un des plus grands citoyens que la France ai eus, s’est ruiné pour avoir fait travailler six mille ouvriers sans commande, les avoir nourris, et avoir rencontré des ministres assez stupides pour le laisser succomber à la Révolution que 1814 a faite dans les prix des tissus. Voilà le seul cas où le négociant mérite une statue. Eh ! bien, cet homme est aujourd’hui l’objet d’une souscription sans souscripteurs, tandis que l’on a donné un million aux enfants du général Foy. Lyon est conséquent : il connaît la France, elle est sans aucun sentiment religieux. L’histoire de Richard Lenoir est une de ces fautes que Fouché trouvait pire qu’un crime ».
Bon d’accord, Blondet finit par laisser tomber les canuts et son propos dérive, mais tout le dialogue est pareillement décousu, mené « à sauts et à gambades » (Montaigne, III, 9). Balzac nous a d’ailleurs prévenus dès le début : « Ce pamphlet contre l’homme que Diderot n’osa pas publier, le Neveu de Rameau ; ce livre débraillé tout exprès pour montrer des plaies, est seul comparable à ce pamphlet dit sans aucune arrière-pensée, où le mot ne respecta même point ce que le penseur discute encore, où l’on ne construisit qu’avec des ruines, où l’on nia tout, où l’on n’admira que ce que le scepticisme adopte : l’omnipotence, l’omniscience, l’omniconvenance de l’argent ». Je confirme : La Maison Nucingen est bien un livre « débraillé ». Les quatre amis se lancent donc dans une longue "improvisation" (le mot est de B.), qui fait penser à la manière dont Béroalde de Verville conduit (ou fait semblant, ou ne conduit pas) son Moyen de parvenir. Et Balzac ajoute à propos de cette improvisation : « … et, quoique souvent interrompue, prise et reprise, elle fut sténographiée par ma mémoire ».
J’ai raconté ici même (31 janvier) l’événement que fut pour la ville de Lyon, ses habitants et ses autorités la venue de Franz Liszt. C’est bien connu : tout ce qui est important se passe à Paris. Ce n’est pas dans La Maison Nucingen que Balzac va nous dire le contraire, même s’il prouvera maintes fois par ailleurs que la vie de province n'a aucun secret pour lui (il faut voir avec quelle jubilation maligne Balzac assaisonne Alençon dans La Vieille fille, avec quelle poétique mélancolie il décrit les rives de l’Indre dans Le Lys dans la vallée, etc., etc.). S’il fait ici référence à Lyon, c’est presque par hasard, au détour d’une conversation entre amis, lancés dans une agréable beuverie.
Ce que dit des canuts le passage cité est trois fois rien. Ce n’est pas une raison pour le bouder.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lyon, balzac, la maison nucingen, le père goriot, rastignac, pension vauquer, le sapeur camember, christophe georges colomb, nouveau dictionnaire des œuvres, littérature française
mardi, 14 janvier 2014
10 BALZAC : UN EPISODE SOUS LA TERREUR
Cette nouvelle d’une petite vingtaine de pages raconte une toute petite histoire, mais tendue comme une corde de piano. La Terreur dont il est ici question la situe évidemment en 1793. Le 22 janvier exactement. Le récit commence en un hiver couvert de neige épaisse.
Le suspense est immédiat : une frêle silhouette féminine avance fiévreusement, suivie par une ombre menaçante. Arrivée chez le boulanger, elle se fait remettre un mystérieux colis par le boulanger qui, craignant d’être espionné ou dénoncé, la chasse en essayant vainement de lui reprendre la « boîte ».
Tout aussi fiévreusement, la femme, dont Balzac ne décrit qu’une tête aux manières d’ancien régime, se hâte sur le chemin du retour, toujours suivie par l’ombre noire. Elle rejoint son logis, où l’attendent une autre femme et un vieillard. Elle demande instamment à celui-ci de se cacher « dans une espèce d’armoire », ce qu’il consent à faire, après avoir tenté de rassurer les deux femmes : « Sœur Marthe, dit-il en s’adressant à la religieuse qui était allée chercher les hosties, cet envoyé devra répondre Fiat voluntas, au mot Hosanna ». Il s’agit du mot de passe convenu avec un réseau royaliste.
Le vieux prêtre réfractaire et les deux nonnes ont en effet échappé au massacre qui a fait disparaître tous les occupants du couvent des Carmes. Et on ne peut célébrer une messe sans hosties, d’où l’expédition nocturne qui sert d’introduction. On entend des pas lourds résonner dans l’escalier. Un homme entre. Drôle de personnage, à vrai dire. Informé de la présence des trois religieux dans le taudis, il ne les a pourtant pas dénoncés.
Ayant rassuré les trois proscrits, il prie le vieux prêtre de célébrer une messe pour l’âme d’un mort, « une personne sacrée, et dont le corps ne reposera jamais dans la terre sainte ». Le prêtre a compris de qui il s’agit. « Revenez à minuit », répond-il. A l’heure dite, ce petit monde se prépare à la cérémonie dans une ambiance marquée de ferveur et de gravité. Arrivé au Pater Noster, l’abbé ajoute cette phrase : « Et remitte scelus regicidis Ludovicus eis remisit semetipse ». On comprend qu'il y a eu crime sur un certain Louis. Deux grosses larmes roulent alors sur les joues de l’inconnu. Sa douleur n’est pas feinte.
L’inconnu s’en va ensuite, après avoir refusé de se confesser comme le prêtre l’en priait, mais après lui avoir légué une « sainte relique ». Il garantit aux trois réfugiés la sécurité de leur asile, et se chargera de les faire approvisionner. Balzac appelle curieusement le propriétaire de la maison Mucius Scaevola, grand héros romain de la guerre contre les Etrusques (brûlant volontairement sa main droite pour montrer à Porsenna qu'il ne craint rien). L’inconnu leur donne rendez-vous au 21 janvier suivant. La relique s’avère être un mouchoir de baptiste marqué de la couronne royale et taché de sang. L’horreur saisit les trois personnes.
L’année se passe sans encombre, sous la mystérieuse aile protectrice du maître des lieux et de l’inconnu. Celui-ci ne manque pas le rendez-vous, puis, la messe dite, s’éclipse sans en dire davantage sur lui-même. Arrive le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), qui délivre le monde de Robespierre et de ses « complices ». L’abbé de Marolles et les deux religieuses peuvent à nouveau circuler librement.
Du temps passe. Quatre jours après la messe pour le 2ème anniversaire de l’exécution de Louis XVI, le prêtre se trouve sur le seuil de la boutique de Ragon, un ancien parfumeur de la Cour resté fidèle au roi. Il aperçoit un convoi qui passe par là, emmenant les derniers robespierristes à l’échafaud. Stupéfait, il reconnaît, debout, l’homme qui, fidèlement, chaque 21 janvier, lui demande de célébrer la messe.
Il demande au parfumeur qui est cet homme : « C’est le bourreau, répondit monsieur Ragon en nommant l’exécuteur des hautes œuvres par son nom monarchique ». Le prêtre s’effondre sur le sol : « Il m’a sans doute donné, dit-il, le mouchoir avec lequel le roi s’est essuyé le front, en allant au martyre … Pauvre homme !... Le couteau d’acier a eu du cœur quand toute la France en manquait !...
Les parfumeurs crurent que le pauvre prêtre avait le délire ».
Balzac ne sait pas écrire, comme le prétendent étourdiment et un peu vite quelques méchantes langues. Mais bon dieu de saprelotte de vertuchou, ce qu'il sait raconter une histoire !
Voilà ce que je dis, moi.
PS : pour ce qui est des messes commémorant à Lyon la décollation de Louis le seizième, je signale celle de l'église Immaculée-Conception, avec la présence de SAR (Son Altesse Royale) le prince Rémy de Bourbon-Parme. Elle sera accompagnée de la sonnerie des trompes de chasse de la Diane lyonnaise. On regrettera qu'elle ait lieu le samedi 18 janvier à 10 h 30. Une hérésie, quoi.
La seule, la vraie, l'authentique sera bel et bien célébrée le 21 janvier en l'église Saint-Denis de la Croix-Rousse, quoique sans roulement de tambours et sans sonnerie de trompes. Pour l'heure, prudent se renseigner (comme disent presque les restaurants qui souhaitent tirer argument d'un succès d'affluence purement hypothétique).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, balzac, la comédie humaine, un épisode sous la terreur, révolution française, robespierre, louis 16, 21 janvier 1793, messe royaliste
mardi, 07 janvier 2014
7 BALZAC : LA PAIX DU MÉNAGE
Le troisième volume de l’édition complète de La Comédie humaine parue au Cercle du Bibliophile recueille une douzaine de nouvelles de dimensions variées. J’avais déjà évoqué la première, dont le titre espagnol – El Verdugo (« Le Bourreau ») – indique assez, sinon une volonté d’exotisme, du moins un souci de « couleur locale ».
Pour en rappeler brièvement la teneur, je dirai juste que cela se passe pendant la guerre de Napoléon en Espagne, dans le château du marquis de Léganès, « hidalgo » distingué en même temps que « grand d’Espagne ». Un détachement français est proprement massacré par les partisans, sauf un jeune officier qui parvient à s’enfuir (prévenu par la fille de la maison qui l'a trouvé mignon).
La vengeance du général « G…t…r » est terrible : la famille entière est condamnée à mort. Mais dans un sursaut de bonté sadique, il accorde au noble vieillard la survie de son nom à travers son fils, à condition que celui-ci se fasse le bourreau de tous les siens et leur coupe la tête. Court récit sec, net et violent, dramatique et spectaculaire. Un coup droit dans l'estomac.
Bien loin de cette ambiance intense de sang, de larmes et de frissons, La Paix du ménage nous introduit dans un grand salon parisien, au cours d’un bal prestigieux donné par un grand personnage de l’Empire (on est en 1809), le « citoyen Malin » devenu comte de Gondreville, sénateur et ami de Napoléon. C’était l’époque où, écrit Balzac, « l’engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie, et concorda trop bien aux vues de l’empereur pour qu’il y mît un frein ». La phrase sent son épigramme rétrospective. Peut-être aussi un regret pour un temps qu'il n'a pas connu.
Dans la foule formée par cette somptueuse et splendide société, et après avoir établi tout le cadre historique et social, Balzac braque le lorgnon du lecteur sur quelques individus choisis, entre lesquels l’intrigue est savamment circonscrite, et qui, s’observant mutuellement avec une attention qui a quelque chose de sauvage, sauront interpréter le moindre des regards des autres protagonistes pour en tirer des conclusions sur les intentions des uns et des autres et sur l’état de leurs relations. L'évocation de ces regards dans le récit est en soi un petite merveille de mise en scène romanesque.
Deux amis, le baron Martial de la Roche-Hugon et le général Montcornet font le pari d’être chacun le premier à mettre dans son lit une femme mystérieuse, très belle quoique très mélancolique, restée à l’écart près d’un candélabre, avec toutes les apparences de la tristesse, voire de la souffrance. Personne ne semble la connaître.
Le baron est l’amant en titre de Mme de Vaudremont, l’une des plus belles femmes de Paris, jeune et belle veuve d'un militaire mort bravement, dont le plus grand souci est de n’apparaître, pour faire contraste, qu’au moment du bal où les autres femmes ainsi que leurs toilettes apparaissent déjà un peu fatiguées.
Elle semble s’intéresser à un autre militaire, le général comte de Soulanges, soit par jalousie (elle surprend son amant Martial empressé auprès de la belle inconnue), soit par inclination (le monsieur a de la prestance). Mais sur le conseil avisé de la duchesse de Lansac, vieille renarde rusée (« volpa astuta », comme dit Leos Janacek) des salons parisiens, qui fut, dit-on, maîtresse de Louis XV, elle se laisse détourner de l’amant en titre, informations désobligeantes à l’appui (« Il a des dettes »), pour s’intéresser, si elle veut du « solide », à Montcornet.
Puis la vieille duchesse se débrouille pour se faire raccompagner chez elle par Soulanges, qui se révèle n’être autre que le mari de la belle inconnue, qui s’apprêtait à brûler spectaculairement la cervelle de La Roche-Hugon, qui, à son goût, serre son épouse d’un peu trop près pour être honnête. Mais il n’en aura pas le temps, et qui plus est, sa crainte est infondée, puisque sa femme n’est venue (incognito) à cette soirée que pour reconquérir son époux volage en suscitant sa jalousie.
Et quand elle rentre chez elle, après avoir repoussé les avances du piètre La Roche-Hugon, au moment où elle pénètre dans sa chambre, elle est très surprise et bien heureuse d’y trouver son mari installé qui, sans doute sermonné par la vieille Lansac, juge plus sage de se réconcilier avec sa femme. « Tout est bien qui finit bien », comme il est dit à la fin du Trésor de Rackham le Rouge (c'était juste pour ça, l'illustration du début).
Une magnifique nouvelle, toute en subtilité, du jeune Balzac. Un bel exercice d’observation du monde, et une intrigue assez ramassée pour que la construction, sans une once de gras, en paraisse aussi savante qu’économe en moyens. Suprême habileté du futur grand romancier. Délectable d'intelligence.
Moralité : il faut lire Balzac.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la comédie humaine, la paix du ménage
lundi, 23 décembre 2013
5 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
Physiologie du mariage se présente sous la forme de trente « Méditations de philosophie éclectique », réparties en trois blocs à peu près égaux : « Considérations générales », « Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieur » et, pour couronner le tout, « De la guerre civile » (!). L’ensemble fait trois bonnes centaines de pages, dont la lecture est rendue réjouissante, du fait de la variété de la composition, où ruptures de ton, de registre ou de mode de narration alternent savamment les images et les leçons.
L’ensemble est parsemé d’ « aphorismes », souvent loufoques, parfois étranges, tel le cinquième : « Une femme qui fait la cuisine dans son ménage n’est pas une femme honnête ». Certains sont frappés au coin du bon sens : « Physiquement, un homme est plus longtemps homme que la femme n’est femme », même si ça ne plaira pas à toutes les ménopausées qui s’efforcent de rester fraîches, minces et lisses à coups de cosmétiques, de lifting, de jogging, de magazines féminins, de club de remise en forme (step, rameur, vélo d'appartement ...) et de surveillance du contenu de l’assiette. Remarquez, soit dit à leur décharge (si j’ose dire), les journaux font régulièrement des « sujets » sur ce qui se passe en matière de sexe dans les maisons de retraite, alors ...
Il faut préciser que Balzac différencie la femme « honnête » de la « vertueuse », et là j’avoue que, pour moi du moins, l’auteur se complaît à entretenir, sinon le paradoxe, du moins un certain flou. Il consacre pourtant un chapitre à chacune, et fait semblant de poser la question de savoir « si une femme honnête peut rester vertueuse ».
Son livre ne s’adresse pas à n’importe qui. Il faut se retenir de rire ou de se mettre le doigt sur la tempe à la lecture des « statistiques » que Balzac bricole en prétendant « cerner » son sujet. « Plaisanterie », ai-je d’abord envie de dire. Il aurait pu en effet s’épargner la peine de fabriquer des chiffres hypothétiques, et déclarer simplement que son propos était circonscrit à ce qui se passe dans la haute société, c’est-à-dire celle qui s’offre à ses yeux d’observateur redoutable. Les femmes du peuple, ce n'est pas sa tasse de thé. S'agissant de thé, il ne trempe ses lèvres que dans les porcelaines de l'élite. C'est une image.
Pour entrer dans son « échantillon représentatif », il faut en effet, sinon posséder un hôtel particulier, du moins avoir assez de moyens pour vivre dans le luxe, avec domesticité nombreuse, ameublement raffiné, équipage splendide et relations au ministère et à la Chambre. C’est en effet dans ce milieu que le regard des autres, impitoyable, est capable de percer en un clin d’œil les moindres secrets d’alcôve, et la germination éventuelle de ces excroissances cervidoïdes, à quoi se reconnaît l’inconduite des épouses.
Pour obéir en quelque sorte à la scientificité (réelle ou fictive) affichée par le titre (l’ouvrage se présente comme un traité de médecine : « Physiologie »), les titres des chapitres s’affublent souvent de déguisements scientifiques : « Statistiques conjugales », « Théorie du lit », où le caractère facétieux de l’auteur s’expose ouvertement.
Soit dit en passant, ce n’est pas pour me vanter, mais on trouve dans la Méditation XXII le mot qui donne son titre à ce blog : « Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque [c’est moi qui souligne, évidemment] dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes ». Je rappelle que ce terme, formé de racines grecques, est le synonyme exact d’ « antidote », « contrepoison », « alexi- » voulant dire « qui protège » (dans Alexandre, par exemple), et « pharmaque » signifiant « poison » (comme dans « pharmacie »).
Parmi tous les hommes qui risquent de faire franchir aux épouses la barrière de leur vertu, l’ennemi public du mari, celui qui selon Balzac, a des chances de brandir l'épouse comme un trophée, c’est, en tout et pour tout, le « Célibataire ». Mais pas n’importe quel célibataire : en termes de statut social et d’aisance matérielle, rien ne le différencie de l’époux (comme on le voit dans l’illustration ci-dessus). La seule différence, c’est qu’il n’est pas marié, lui.
L’amusant dans l’affaire, c’est que Balzac ne s’est jamais marié, sauf à la fin de sa trop courte vie, après avoir pendant des années fait le siège de l’élue de son cœur, Madame Hanska. Même si son aspect n’avait rien à voir avec le portrait de la gravure, ça en dit long sur la façon dont il considérait les femmes des autres. Sa première conquête d’importance (au grand dam de sa propre mère) fut d’ailleurs une femme mariée, même si le mari avait eu la bonne idée de mourir avant, ce qui caractérise en général la situation des veuves.
En se permettant de devenir le « conseiller conjugal » des maris inquiets, et tout en montrant qu’il connaissait son sujet, Balzac se payait donc le luxe de se moquer d’eux en se donnant l’air de venir à leur secours. Ce n’est pas sans raison que le livre, à parution, suscita quelque émotion.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, balzac, physiologie du mariage, adultère
dimanche, 22 décembre 2013
4 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
Disons-le d’entrée de jeu : Physiologie du mariage n’est pas un roman. Le sous-titre éclaire déjà davantage la question : « Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal ». J'admire la triple ironie contenue dans "méditations", dans "éclectique" et dans "philosophie". Ce n’est donc pas un roman, mais ça n’empêche pas le livre d’être un merveilleux bijou de vachardise (voire de férocité à l’occasion).
L’auteur, célibataire endurci de tout juste trente ans quand paraît son « Traité », propose aux maris tous les moyens imaginables de se prémunir contre le risque inhérent, voire consubstantiel à l’institution maritale et à la vie dans l’état conjugal : le cocuage. Il fait semblant de leur donner tous les conseils pour ne pas avoir un jour « du cerf sur la tête » (Brassens, Le Cocu). Ce n’est pas pour rien que Balzac ne s’est marié qu’à la toute fin de son existence, et l’on peut admirer ici un formidable catalogue d’observations, par lequel il prétend faire le tour de la question en même temps qu’épuiser le sujet.
Il est certain que l’ouvrage a acquis un intérêt plus historique que pertinent dans le contexte actuel : le mariage, le régime matrimonial, la famille étant devenus ce qu’ils sont, une grande partie des remarques de l’auteur tombe à plat, si on les regarde avec l’œil des générations actuelles, habituées à obéir à leur moindre désir avant même d’en savoir davantage sur son origine, sa destination, ses conséquences et diverses considérations auxquelles seuls les plus anciens sont désormais accessibles.
Je veux dire que l’institution du mariage est devenue un supermarché où chacun trouve un produit à sa convenance, un produit dont une enquête marketing fine a permis de dessiner le « profil » adapté à sa « cible »; on pourrait dire aussi qu’elle est devenue un restaurant dont la carte proposerait tous les menus et tous les plats qu’il est possible de manger sur notre planète. Je veux dire évidemment que la notion même d’institution a pris du plomb dans l’aile, et que ce qui reste de son corps décharné agonise dans la liesse générale.
Pendant ce temps, une ribambelle de doctes intitulés « penseurs » et de cuistres autoproclamés « intellectuels », s’interrogeant sur le délitement du lien social et les moyens de le retisser, pondent des thèses sur le Progrès indéniable que constitue l’évolution dans les mœurs, tout en accompagnant, si ce n’est en précédant ou provoquant, par le contenu de leur « pensée », le dit délitement.
Michel Foucault et Pierre Bourdieu, entre beaucoup d’autres, ont fondé leur renommée sur leur talent à structurer et théoriser leur haine de l’ordre social, et en le « déconstruisant » patiemment et méthodiquement, pour en dégager et extirper l’insupportable odeur d’arbitraire. Jusqu’à faire découvrir au bon peuple ébahi, comme si c’était une nouveauté révolutionnaire, que la « culture » se différencie radicalement de la « nature », vieux cours de philo pour classes terminales d’après-guerre.
A cet égard, Physiologie du mariage apparaîtra, aux yeux des thuriféraires de cette « société en mouvement » (on se demande autant ce qu’est une société en mouvement : une société statique, ça n’existe pas, du moins aussi longtemps que les membres en sont en vie), comme un livre abominablement suranné, tout juste capable de motiver et d’intéresser je ne sais quel boutonneux soucieux d’accéder pas trop tard à une chaire en Sorbonne. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j’ai refermé le livre, c’était comme si je m’étais abreuvé à la source Hippocrène. C’est sur le mont Hélicon, près de Thespies. Ah, le sabot de Pégase ! Je veux dire que je m’y suis « ressourcé ».
D’abord parce qu’on y retrouve une société où un partisan des institutions n’était pas encore considéré comme un ennemi public à anéantir. Ensuite parce qu’on sait, après ça, ce que c’est que la littérature. Et dire qu’il y a des gens d’un goût apparemment très sûr prêts à soutenir que « Balzac ne sait pas écrire » (citation d’un propos récemment entendu dans la bouche de quelqu’un d’éminemment sensé). N’en veuillons pas trop à la personne : de même que quelqu’un a dit : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc, XXIII, 34, traduction du chanoine A. Crampon), certains ne savent pas ce qu’ils disent, et il ne serait pas charitable de leur en tenir rigueur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, physiologie du mariage, comédie humaine
vendredi, 20 décembre 2013
UN FOU REMARQUABLE

Il n’y a pas que Balzac, dans la vie. Voici pour le prouver de quoi alimenter l’insatiable curiosité des curieux (curiosité dont le métier est généralement de faire de l’auto-allumage : comme chacun sait, la curiosité, cette invention, mère de la créativité et moteur de l’action, ne se décrète pas : elle se sécrète). C'est parti.
« LE PÉCHÉ ORIGINEL
« Pécer ou pesser = pisser. Pé ce t’ai, pesse t’ai, pester. La petite beste pestait. En pesse t’ai, empestait. Ai ce, p’ai ce ; ai ce pesse, l’esse pesse, l’espèce. Toute esse pesse de toute espèce ; le pécé ou le péché empestait, c’est l’origine du pessimisme : pesse i m’ai, isse-me. Pécer ou pesser se retrouve dans la bouche des enfants pour pécher.
« Péch’ai, péche ai, pécher, péché. Péche ai heure, pêcheur ; péche ai raie-ce, pécheresse. Le péché offrait son eau au bec pissant ou péchant contre les règles de l’art. On pisse ou pèche contre. Il a péché queue on treu moi ; celui qui avait fait cela était violemment repoussé et chassé. Tu eau fais en ce dieu ou lieu, tu offenses Dieu.
« Les premiers êtres se promenaient avec leur aspergès et lançaient leur eau de tous côtés ; cela alla encore chez les prêtres ; mais les dieux, nés d’une mère, s’en indignèrent, et le péché à la figure des gens fut honni. Celui qui pisse en face de nous, nous offense, car le péché offense Dieu et d’yeu, ton œil. Le nom de péché fut donné plus tard à tout ce qui était répréhensible, mais le premier et le vrai péché vient du bénitier, lançant son eau que c’était une bénédiction. (…)
« Eau r’ai, aure ai, aurer, orer. Eau d’aure ai, odorer. L’eau d’aure odorait. A l’aure ai ore, à l’aurore, les anges offraient leur eau du matin, en présentant leur auréole, ore ai eau le, aure ai haut le. L’auréole était formée par la peau du prépuce découvrant le gland. L’homme étant un ancien membre, le diable met une auréole sur le sommet de la tête de ses saints pour désobéir au grand Dieu tout-puissant qui défend les idoles ».
Ce ne sont que quelques-unes des délicieuses "fariboles sidérales" (l'expression est le titre d'une excellente et méconnue BD de Lacroix, alias Alias) et sidérantes qu’on trouve dans un livre en général connu des seuls spécialistes, et je me permets de trouver ça regrettable : Les Origines humaines. L’auteur, dont le nom ne devrait lui aussi être connu que de rares initiés, est néanmoins plus répandu, car André Breton a jugé bon de le faire figurer dans un livre célèbre quant à lui : L’Anthologie de l’humour noir, et cela, bien qu’il s’agisse d’André Breton le pontifiant pontificateur, n’est pas injuste.
Brisset est encore l’auteur de La Grammaire logique, plus fastidieux à la lecture : il faut imaginer par le texte ci-dessus les mauvais traitements qu’il fait subir à l’objet qu’il se propose d’y traiter. Il occupe une place éminente dans une confrérie, une tribu injustement obscure : les bien nommés « Fous Littéraires », confrérie à laquelle le très savant André Blavier a consacré un très savant et très copieux (in-quarto de 1147 pages) ouvrage, très pertinemment intitulé Les Fous littéraires (Editions des cendres, 2001).
Pour se faire une idée du genre de folie dont il s'agit, le lecteur peut se replonger dans le trente-huitième chapitre du Tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel, « composé par M. Fran. Rabelais, Docteur en médicine », qui expose « Comment par Pantagruel et Panurge est Triboullet blasonné ».
A ce propos, je ne résisterai jamais au plaisir de rappeler l'histoire narrée au chapitre précédent, où Rabelais expose l'histoire jubilatoire de Seigny Joan, fou appelé pour arbitrer le différend entre le rôtisseur et le faquin qui mangeait son pain en le parfumant « à la fumée du roust », et qui déclare, en véritable nouveau Salomon, après avoir fait sonner deux pièces d'argent : « La Court vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roust civilement a payé le roustisseur au son de son argent ».
Parmi ce déluge de façons pour l'esprit humain de battre la campagne (plus de 200 sortes de fous), qui place le lecteur dans le plus grand embarras quant au choix, ma préférence, très variable selon les jours et les circonstances, ira pour cette fois au « Fol bien mentulé » et au « Fol de haulte fustaie », avec une mention spéciale pour le dernier de la liste : « Fol a espreuve de hacquebutte ».
L’éditeur de Blavier prend soin de préciser que le motif de couverture est inspiré de « bois gravés d’après les dessins de Dürer illustrant ʺLa Nef des folz du mondeʺ de Sébastien Brandt (1497) ». Dans l’édition que je détiens de la dite Nef des fous, la gravure d’Albrecht Dürer, complète cette fois, et 29ème d’une richissime série, figure à la page 73 (Editions de la nuée-bleue, 1977, traduction de Madeleine Horst).
On a appelé « fous littéraires » toutes sortes d’écrivains. André Blavier s’efforce de classer les membres de cette famille inclassable selon leur mode et leur domaine d’inspiration. Le Sommaire indique quelques-unes des catégories retenues : « prophètes, visionnaires et messies », « astronomes et météorologistes », « philanthropes, sociologues et casse-pieds », « persécutés, persécuteurs et faiseurs d’histoires(s) », etc. L’auteur en dénombre ainsi une treizaine au total.
Pour donner un exemple, voici ce que déclare un certain André Dodet, dont l’auteur place une citation en épigraphe de son chapitre hautement moral « Médecins et Hygiénistes » : « La crasse forme un revêtement protecteur ». Le nommé Cornay n’a rien à lui envier, qui déclare : « La formation des rides repose sur les impulsions cérébrales. (…) Les rides demi-circulaires indiquent la franchise … les rides horizontales indiquent l’ambition, etc. », non plus qu’Augustine de Baralle : « La nature a mis dans chaque femme un utérus plus ou moins perfectionné ». Le réservoir est à peu près inépuisable.
Mais dans ce parterre de fleurs où chaque individu forme en soi une espèce unique, Jean-Pierre Brisset détient sans conteste la palme qui revient au vainqueur : « Jeu m’ai ou yeu, je mets ouille, je mouille. B’ai ou yeu, b’ai ouille, bouille. Bouille ai on, Boue y ai on, bouillon. Bouille ai, one ai ente ; bouillonnante. L’eau des mares bourbeuses fut le premier bouillon. Les ancêtres bouillants, bout y ai en, s’y tenaient dans les eaux bouillonnantes. Queue où yeu, coup yeu, couille = coule. Couille ai on, le couillon ne pouvait entrer et restait à la porte. C’est là qu’ai un nœud ouille ; c’est la queune ou yeu, c’est la quenouille. Chéant t’ai, peux ou yeu ; chanter pouille. On ce d’ai, pouille ai ; on se dépouillait. D’ai pouille au pime, dépouilles opimes. C’étaient les parties sexuelles des vaincus. C’est avec de telles dépouilles que David obtint Mical, fille de Saül (1 Sam. 18, 27). On ce, à jeune ai où yeu ; on s’agenouille ».
Ce n’est pas pour rien qu’un certain nombre de gens sérieux et gais, par exemple à La Ferté Macé, dans l’Orne, où il a fini ses jours, continuent à rendre hommage à celui qui fut surnommé « Prince des penseurs ». Par exemple en posant une plaque en l'honneur du « Pas sage Jean-Pierre Brisset ».
De quoi se réjouir en toute innocence en ces temps de disette morale et politique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les fous littéraires, andré blavier, jean-pierre brisset, la ferté macé, les origines humaines, la grammaire logique, littérature, péché originel, andré breton, anthologie de l'humour noir, pape du surréalisme, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, la nef des fous, sébastien brant, albrecht dürer
lundi, 16 décembre 2013
2 BALZAC : LES CHOUANS
Balzac n’aime pas la Bretagne : « La place que la Bretagne occupe au centre [sic] de l’Europe la rend beaucoup plus curieuse à observer que ne l’est le Canada. Entouré de lumières dont la bienfaisante chaleur ne l’atteint pas, ce pays ressemble à un charbon glacé qui resterait obscur et noir au sein d’un brillant foyer. Les efforts tentés par quelques grand esprits pour conquérir à la vie sociale et à la prospérité cette belle partie de la France, si riche de trésors ignorés, tout, même les tentatives du gouvernement, meurt au sein de l’immobilité d’une population vouée aux pratiques d’une immémoriale routine ». On trouve ça dans Les Chouans. On n’est pas plus amène, n’est-ce pas. A méditer à la lueur de l’actualité (bonnets rouges, etc.).
Pourtant, son mépris ne peut s'empêcher de se teinter d'admiration : « Une incroyable férocité, un entêtement brutal, mais aussi la foi du serment ; l’absence complète de nos lois, de nos mœurs, de notre habillement, de nos monnaies nouvelles, de notre langage, mais aussi la simplicité patriarcale et d’héroïques vertus s’accordent à rendre les habitants de ces campagnes plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l’Amérique septentrionale, mais aussi grands, aussi rusés, aussi durs qu’eux ». On peut comprendre l’ancienne double consigne qui figurait autrefois à l’entrée des écoles bretonnes : « Défense de parler breton et de cracher par terre ».
Ce qui peut surprendre, dans Les Chouans, c’est le mépris que l’auteur manifeste pour ces paysans, de vraies brutes au plafond bas, mal dégrossies. Car dans l’Avant-Propos à la Comédie Humaine, voici ce qu’il déclare : « J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays ». Il est vrai que c’est écrit en 1842, alors que le livre date de 1829.
Le plus étonnant, c’est que le roman, déjà à ce moment-là, ne ridiculise pas la religion, bien au contraire : il suffit que l’abbé Gudin paraisse pour que les Chouans se taisent et s’agenouillent, même si Balzac assaisonne le curé de remarques peu aimables à l’égard des curés fanatiques qui se mêlent de politique. A l’opposé, il tresse des louanges à l’humble abbé qui, à la fin, est introduit dans la maison de Marie de Verneuil pour la marier au marquis de Montauran. Lui au moins, sans ostentation, se contente de servir humblement et obscurément Dieu et la religion.
Toujours dans l’Avant-Propos, il ajoute cet argument qui devrait nous pousser à réfléchir, nous qui, aujourd’hui, nous contentons d’exister politiquement les jours d’ouverture des bureaux de vote, et d'être contraints au silence le reste du temps : « Sans être l’ennemi de l’Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l’Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu’elle l’est aujourd’hui, car elle ne représente pas d’imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique ». Je suis bien d’accord avec lui : la peste soit de la dictature majoritaire, qui laisse les mains libres au parti vainqueur d’imposer leurs caprices à des masses qui auront tout oublié des avanies ainsi subies quand on leur demandera de voter à nouveau.
Marche-à-Terre est un très beau personnage, décrit comme aussi redoutable qu’insaisissable. Au début, dans le premier affrontement, il ne lui faut qu’un instant pour se soustraire à la vue des soldats, dont il vient de fracasser le crâne des deux qui le surveillent, avec le manche de son fouet. C’est le personnage qui sert de fil rouge à la partie chouanne du récit, toujours aux aguets, toujours aux premières loges pour casser du républicain. C’est même sur lui que se referme le roman : « … et personne ne lui disait rien quoiqu’il eût tué plus de cent personnes ».
Chez les Bleus, la figure qui domine est celle de Hulot, chef de demi-brigade, vieux militaire respecté par ses hommes, féru de discipline et de manœuvres savantes comme on le verra à la fin. Un homme fier aussi, qui brise son épée quand Marie de Verneuil sort de son corset le papier donnant l’ordre de Fouché à tous les républicains de se mettre aux ordres de sa personne : « Je ne sais pas servir où les belles filles commandent ».
Le féminisme n’était pas encore passé par là.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans
dimanche, 15 décembre 2013
1 BALZAC : LES CHOUANS
Il y a des chances que Balzac n’ait éprouvé pour la Bretagne et les Bretons que du mépris. Mais un mépris curieusement teinté d’admiration. Dans Les Chouans, le mépris s’exprime dans la description des mœurs, des habitations et de la pauvreté misérable de la région et de ses habitants, qu’il juge à peine civilisés. Il faut lire la description de la cabane de la Barbette, la femme de Galope-Chopine.
Il écrit ceci : « … et les Chouans sont restés comme un mémorable exemple du danger de remuer les masses peu civilisées d’un pays », et je ne cite pas le pire. Il se moque de leur manie de placer leur fumier au haut bout de leur cour, ce qui a selon lui de fâcheuses conséquences. L’admiration transparaît dans ce que l’auteur dit de l’attitude des chouans dans la bataille.
Mais là encore, il ne peut s’empêcher de voir en ceux-ci des sortes de brigands, dont les motivations sont bassement matérielles, tant ils sont avides de s’emparer de l’or qui passe à portée de leurs mains. Tout ça manque singulièrement de grandeur, et Balzac montre à plaisir, en même temps que leur indéniable courage, la cupidité (et la stupidité de bûche) de ces va-nu-pieds féroces.
En 1829, Balzac n’a pas encore eu l’idée de la future Comédie humaine. C’est après coup qu’il inclut Les Chouans dans son énorme cycle. Pour dire le vrai, ce roman porte un titre tant soit peu trompeur. Je ne l’avais jamais lu. Et pourtant le livre se lit tout seul : pour le coup, c’est un roman d’action, seulement ponctué par quelques instants de contemplation de la nature, et par un fort long, subtil et passionnant duel verbal entre les deux héros.
Le titre est trompeur : il aurait pu tout aussi bien s’intituler Les Blancs et les Bleus, ou encore Une tragédie amoureuse. Les Chouans sont une des composantes principales du roman, mais à peu près à égalité avec les soldats républicains (uniforme bleu) envoyés pour les combattre. L’autre composante essentielle est constituée des deux personnages principaux : Mademoiselle de Verneuil et le marquis de Montauran, surnommé par tout le monde « Le Gars ».
La première est envoyée par Fouché pour faire tomber le second en le prenant dans ses filets au moyen de son talent insurpassable de séduction amoureuse. Le second est envoyé par le roi pour soulever la Bretagne, pendant qu’un autre gentilhomme soulève la Vendée. Les deux sont donc en mission politique, quasiment nationale, sauf que ce n’est pas pour le même pouvoir. Tous deux tendent leurs filets, sauf qu’ils ne sont pas du même genre. Et que tous deux vont être pris dans le filet de l’ennemi, à leur corps défendant, et en perdre la vie.
Car Les Chouans raconte d’abord une histoire d’amour dans une région en guerre civile. C'est l’histoire tragique de deux ennemis amoureux l’un de l’autre, l’histoire de deux dons de la vie de soi à la vie de l’autre, l’histoire de deux sacrifices voulus, désirés, consentis d’un jeune homme et d’une jeune fille prêts à tout donner dès lors qu’ils ont la certitude absolue d’avoir trouvé l’élu de leur cœur, l’unique objet qu’ils attendaient pour se dire qu’à défaut, leur vie ne valait pas la peine, et qu’à ce moment-là, autant la gaspiller.
Les Chouans, c’est une sorte de « remake » étendu à la nation française d’alors de l’immortelle discorde véronaise entre Capulet et Montagu, à la différence que, dans ce combat politique impitoyable, Marie et Le Gars, s’ils ont le coup de foudre chacun de son côté, sont retenus par la méfiance : la Bretagne d’alors est un terrain dangereux, où tout le monde ignore d’où le coup de fusil mortel peut partir.
A cet égard, les moments où Balzac nous fait ressentir les heures d’affres du doute et de la défiance éprouvés par les amoureux sont des chefs d’œuvre où s’expose et se surmonte peu à peu leur résistance à leur désir spontané, immédiat et total de confiance de l’un à l’autre.
Chez les Chouans, les figures les plus travaillées sont au premier chef celle de Marche-à-Terre, et juste derrière lui, celles de Pille-Miche et de Galope-Chopine. Ce dernier se verra la tête coupée par les deux autres au motif que sa femme Barbette a renseigné Mademoiselle de Verneuil, ce qu’ils considèrent comme une trahison. Du coup, d’ailleurs, la Barbette se vengera en trahissant carrément la cause auprès des Bleus.
C’est bien fait pour les Chouans.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans, bretagne, bretons
mardi, 03 décembre 2013
LEONARD ET VICTOR
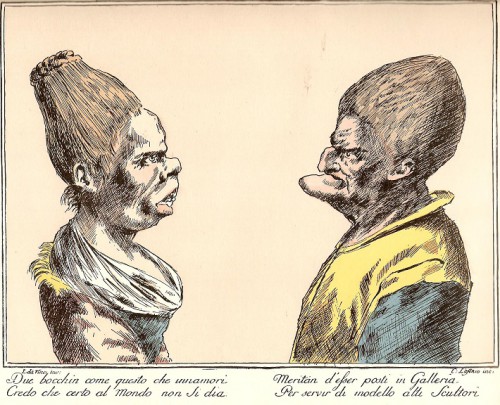



BON, D'ACCORD, LES DESSINS DE LEONARD DE VINCI, QUI N'ETAIENT QUE DE SIMPLES GRIFFONNAGES, ONT ETE RETRAVAILLÉS PAR DES GRAVEURS QUI N'ONT RIEN FAIT POUR NE PAS LES EMBELLIR. LES AUTRES GRIFFONNAGES SONT DE VICTOR HUGO.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonard de vinci, victor hugo, littérature, art, artiste

