vendredi, 19 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 2
2/2
 De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.
On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.
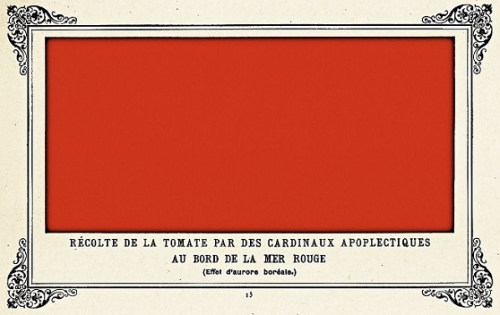
Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?
Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).
Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.
Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.
Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.
Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).
Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.
Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.
Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil
jeudi, 18 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 1
1/2
 Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.
Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.
C'est un souvenir cuisant. Vaguement humiliant, même. C'est peut-être un handicap. Si c'est le cas, je dis : pitié pour les handicapés ! Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Je me suis fait ma religion : il y a deux sortes de savants. Oui, je sais, on va me ressortir l’histoire de De Gaulle disant à Malraux : « Il y a deux sortes de gens … », et puis, voyant s’allumer l’œil de son ministre, il complète et conclut : « … ceux qui pensent qu’il y a deux sortes de gens, et les autres ».
Désolé, je le répète, il y a deux sortes de savants : ceux qui parlent pour tout le monde, et ceux qui parlent entre eux. Par exemple, en psychanalyse, il y a Jacques Lacan, et puis il y a Didier Anzieu. Avec l’un, on reste entre spécialistes pointus. Avec l’autre, on est entre égaux (pas vraiment, mais quand il me parle, je comprends d’abord qu’il s’adresse à moi).
Je trouve pitoyable, voire méprisable, tout humain qui use du langage pour faire croire qu'il connaît des choses que tout un chacun serait infoutu de comprendre. Ce genre de pouvoir n'impressionne que ceux qui y croient. A cet égard, je suis un mécréant de l'espèce la plus incorrigible : je m'efforce de parler comme tout le monde, en offensant le moins possible la langue française. Je considère comme bien à plaindre celui qui éprouve le besoin d'intellectualiser et de créer des concepts abstrus (si possible innovants) pour avoir l'impression d'exister enfin. Et se donner l'apparence de comprendre le monde.
Chez les musiciens contemporains, c’est la même chose : il y a les très savants, qui considèrent mes oreilles comme des poubelles assez bonnes pour digérer ou recycler les déchets de leurs savants concepts (Nono, Berio, Boulez, Pauset, Stockhausen, Cage, …), et puis il y a ceux qui admettent que mes oreilles méritent quelques égards et un minimum de courtoisie, en plus du savoir-faire (Messiaen, Britten, Hersant, Grisey, Bryars, Kancheli, Pärt, …). C’est une philosophie de l’existence. C'est même un humanisme.
Tenez, l’autre jour, j’entendais Cédric Villani (qui arbore une cravate aussi impressionnante que sa médaille Fields), en tournée de promo pour l’album de bande dessinée qu’il vient de publier avec le formidable dessinateur Baudoin, Les Rêveurs lunaires (Gallimard / Grasset), sous-titré « Quatre génies qui ont changé l’histoire ». Villani est de ceux qui veulent, non pas faire de la « vulgarisation », mais réconcilier la science avec le grand public en faisant entrevoir à celui-ci les raisons de l’importance historique de certains chercheurs.
Paul Valadier, l’auteur de L’Anarchie des valeurs (Albin Michel, 1997), est de ceux qui s’adressent à tout le monde. C’est vrai qu’il a été formé pour ça : jésuite, il fut longtemps directeur de la revue de l’ordre, qui porte un titre aussi modeste que terriblement ambitieux, Etudes. Je connaissais un peu Jean Mambrino, poète, qui tenait pour la revue la rubrique de l’actualité poétique et théâtrale.
Dans L’Anarchie des valeurs, la langue n’a rien à voir avec quelque jargon technique. Valadier applique ce principe oratoire formulé jadis par le génial Chaïm Perelman (ne pas oublier Lucie Olbrechts-Tyteca) dans son Traité de l’argumentation (éditions de l'université de Bruxelles, 1988, pour la nouvelle édition) : s’adresser à un « auditoire universel » (I, § 7), pour virtuel qu’il soit. L' « auditoire universel » ! Quelle prétention ! Mais quel espoir ! Car il s’agit en définitive de faire de la connaissance acquise un objet socialisé. Un « Bien Commun », en quelque sorte, que tout un chacun soit en mesure de s’approprier pour peu qu’il en fasse l’effort.
Pourtant, le sujet de Valadier n’est pas évident : comment établir des valeurs ? Sur la base de quoi a-t-on le droit de fonder des jugements (de valeur) ? Ces « valeurs » que les responsables politiques, mais aussi les grandes entreprises, brandissent comme des étendards (je me souviens du panneau d’affichage dans le hall du siège de Mérial, à Gerland, qui trompetait fièrement « Nos Valeurs », et qui les énumérait). Hollande s’est particulièrement illustré dans ce domaine après le 7 janvier.
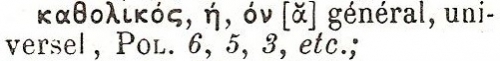
Si tout un chacun peut revendiquer ses valeurs, c’est la confusion. C’est l’anarchie, comme le dit le titre du livre. Le temps est fini où une religion pouvait, sans être contredite, s’intituler « catholique », c’est-à-dire « universelle », et imposer les valeurs constituant la Vérité révélée qu’elle voulait répandre (« propager » serait plus juste : on parle bien de « propagation de la foi »).
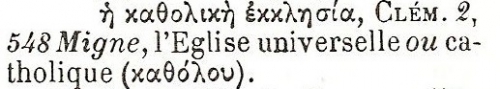
A cet égard, reconnaissons qu’elle a mis de l’eau dans son vin de messe, par la force des choses. Il faudra bien que l’Islam descende aussi de son piédestal de « Seul authentique détenteur de la Vérité révélée », même si ça n’en prend pas le chemin.
Maintenant qu’est réalisé l’inventaire exhaustif des sociétés humaines, des cultures, des croyances, des systèmes sociaux, la question se pose de savoir sur quelle base unique de valeurs pourrait s’amorcer un accord général de l’humanité entière. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas simple, nul n’ayant l’autorité requise pour imposer à qui que ce soit sa manière de voir les choses et d’interpréter le monde.
Je n’ai pas envie de m’attarder sur les analyses et les références que livre Paul Valadier. C’est très savant et très documenté, il a beaucoup lu, beaucoup compris, c’est très subtil et très nuancé : le monsieur montre qu’il n’est pas sorti de nulle part, vu qu’il donne des gages incontestables de la connaissance qu’il a des enjeux de la discussion.
Moi qui suis le rustaud du service de com’, je vais vous dire, toutes ces références me font l’effet de « validation du permis de conduire » : Paul Valadier, bien qu’il sache qu’on connaît sa science de la chose, tient à montrer qu’il n’est pas philosophe pour du beurre et qu’il s’y connaît (il est jésuite). Et ça défile : Lefort, Boudon, Nietzsche, Hobbes, Marx, Dognin, Freud, Mauss, Proust, Lévi-Strauss, Saint-Exupéry, par ordre d’entrée en scène. Pardon, j’oubliais Kant (et quelques autres). Et l’on n’a fait que les quarante premières pages ! C’est le vice universitaire, sur lequel est fondé le rapport de la civilisation avec la connaissance : prouver qu’on sait de quoi on cause.
C'est aussi l'un des aspects rebutants de ce que l'on a appelé la scolastique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature, paul valadier, compagnie de jésus, jésuites, l'anarchie des valeurs, bernard groethuysen, anthropologie philosophique, relativisme, de gaulle, malraux, jacques lacan, didier anzieu, musique contemporaine, boulez, stockhausen, berio, messiaen, brittent, philippe hersant, gérard grisey, gavin bryars, cédric villani, edmond baudoin, les rêveurs lunaires, éditions gallimard, éditions grasset, revue études, éditions albin michel, chaïm perelman, traité de l'argumentation, mérial, gerland, catholique, église catholique, islam, claude lefort, raymond boudon, nietzsche, hobbes, karl marx, lévi-strauss, freud, marcel proust, christianisme
mercredi, 17 juin 2015
KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE
 Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,
Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.
Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.
C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.
Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.
Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.
Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.
L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).
Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.
Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.
Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.
Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.
Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.
C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.
L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.
D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».
Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.
Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.
Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.
Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe
vendredi, 29 mai 2015
POUR TEDI PAPAVRAMI 2
2/2
 Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.
Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.
Ce qui domine, c'est que le gamin stupéfie son monde, jusqu’à l'immense Pierre Amoyal, qui accepte de le prendre comme élève. Il se voit offrir une bourse d’études. Une faveur spéciale du « Guide Suprême » délivre un bon de sortie (une rarissime exception) du territoire, et voilà le père et le fils partis pour Saint Jean de Luz (où habite le violoniste), via Paris et l’ambassade d’Albanie, étroitement contrôlés et suivis par les fonctionnaires : attention, ne pas dévier du programme.
Bon, je passe sur les détails. La prestation du petit Tedi (on est en 1983, il a douze ans) convainc d’emblée Amoyal, qui le prépare activement pour le concours d’entrée au CNSM de Paris, afin de le prendre dans sa classe (une autre étant tenue par Gérard Poulet). Simple formalité : il y sera reçu premier sur trois cents : c'est sûr, il stupéfie son monde.
Mais l’Albanie d’Enver Hoxha reste impitoyable : la mère ayant rejoint son fils, les choses se gâtent quand le père débarque à Paris avec l’intention de ne plus retourner à Tirana. Ils seront obligés de demander l’asile politique, ce qui déclenchera des représailles contre la famille restée au pays. Le sentiment de culpabilité des exilés n’en sera que plus vif. Le réseau des nouveaux amis, mais aussi la gendarmerie française leur permettront d’échapper aux recherches des services secrets du dictateur. Ils apprendront que leur maison a été rasée.
 Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.
Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.
Mais il sera aussi saisi par l’impeccable maîtrise de Nathan Milstein, qu’il vient écouter à Bordeaux. Il cite encore le nom du grand Christian Ferras, dont il évoque le caractère dépressif, l’alcoolisme, puis la défenestration volontaire, à même pas cinquante ans. Il a une pensée pour Zino Francescatti, un autre grand.
Ajoutons pour finir qu’une fois en France, Tedi Papavrami a fini par se soumettre, volontairement et de lui-même, à une discipline de fer dans le travail du violon, s’astreignant à d’interminables exercices, parmi lesquels des gammes exécutées avec la plus grande lenteur, dans le but d’arriver à la plus extrême justesse (est-ce Saint-Saëns, Fauré ou Poulenc qui déclarait,: « Tous les violonistes jouent faux, mais il y en a qui exagèrent » ?). Il s'est aussi mis à la traduction : prenant la succession de l'excellent Yusuf Vrioni (mort en 2003), c'est lui qui a traduit tous les derniers livres d'Ismaïl Kadaré.
Au total, un livre excellent. Bien sûr, l’auteur nous parle de son enfance, de ses chiens, de ses chats (qu’il martyrisait), de l’amour de sa vie (Silva), qui n’a jamais dépassé le stade du platonisme contemplatif, de ses sentiments, de ses impressions, et tout et tout, mais on lui pardonne, car il parle aussi et surtout, sobrement et sans pathos, de ce qu’il a fait, des événements, des situations que lui et sa famille ont traversés. Il dresse aussi quelques portraits et paysages albanais.
Par exemple, il découvre un jour, stupéfait, un aspect de Tirana qu’il ignorait totalement. On lui dit un jour de se rendre dans la maison de Shpati, muni de son violon. Elle est située dans un quartier gardé par des militaires armés, interdit à tous ceux qui n’ont pas une autorisation expresse. Il faut dire que Shpati est le petit-fils d’Enver Hoxha en personne, le dictateur bien aimé, le petit père du peuple. Tedi constate au cours de son incursion dans ce monde tabou qu’il y a deux villes, dans la capitale albanaise.
L’une pour la masse : elle est grise, délabrée, ses rues ne sont pas toujours bitumées, la télévision y est en noir et blanc, les voitures y sont rares, bref, c’est la ville pour tout le monde. Et voilà qu’au beau milieu de cette ville moche, existe une autre ville, réservée à quelques-uns, où se concentrent toutes les « saloperies » capitalistes, les « immondices » impérialistes et autres modernités « dégénérées » (télé couleur en particulier), que tout ça a l'éclat du neuf, et que tout ça est strictement réservé au petit cercle d’élus qui détient le pouvoir. En Russie soviétique, ça s’appelait la Nomenklatura.
Le 20ème siècle a décidément légué bien des laideurs au 21ème.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique classique, tedi papavrami, pierre amoyal, cnsm paris, gérard poulet, albanie, enver hoxha, jascha heifetz, vladimir horowitz, nathan milstein, christian ferras, zino francescatti, saint-saëns, gabriel fauré, francis poulenc, ismaïl kadaré, yusuf vrioni, tirana, communisme
jeudi, 28 mai 2015
POUR TEDI PAPAVRAMI 1
1/2
 Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.
Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.
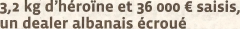
Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).
Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).
Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.
Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.
Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.
J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.
Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.
L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.
Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.
Des privilégiés, somme toute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella
mercredi, 27 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
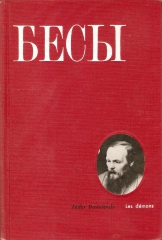 Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
2/2
La deuxième moitié du livre nous fait prendre pied sur le terrain politique. Verkhovensky fils (Piotr Stépanovitch) est le chef d’une section clandestine de révolutionnaires. Il fait croire à ces exaltés tant soit peu nihilistes que celle-ci n’est qu’une cellule dans un vaste réseau dirigé depuis l’étranger par une sorte de Comité Central.
La réunion (intitulée « Chez les nôtres ») a quelque chose de proprement stupéfiant de prescience du régime qu’instaureront beaucoup plus tard Lénine, puis Staline. Sorties du cerveau de Chigaliov (le théoricien qui forme avec l'activiste Verkhovensky la transposition dans le roman du nihiliste frapadingue et historique Netchaïev) et expliquées par « le professeur boiteux », on lit des choses comme : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité ».
Plus fort encore : « Pour résoudre définitivement la question sociale, il propose de partager l’humanité en deux parts inégales. Un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau ; maintenus dans une soumission sans bornes, ils atteindront, en passant par une série de transformations, à l’état d’innocence primitive, quelque chose comme l’Eden primitif, tout en étant astreints au travail ».
Et Verkhovensky explique plus tard à Stavroguine : « Son projet est remarquable (…). [Chigaliov] établit l’espionnage. Chez lui, tous les membres de la société s’épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu’ils apprennent. Chacun appartient à tous, et tous appartiennent à chacun. Tous les hommes sont esclaves et égaux dans l’esclavage ». Ah bon ? Ça vous rappelle quelque chose ?
Et puis encore : « La soif d’instruction est déjà une soif aristocratique. A peine laisse-t-on s’installer la famille ou l’amour, que naît aussitôt le désir de propriété. Nous tuerons ce désir : nous développerons l’ivrognerie, la calomnie, la délation ; nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe, nous détruirons dans l’œuf tout génie ».
Allez, une dernière pour la route : « Seul le nécessaire est nécessaire, telle doit être dorénavant la devise de l’humanité. Mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions ; et nous, les chefs, nous y pourvoirons. Les esclaves doivent avoir des maîtres. Obéissance complète, dépersonnalisation absolue ; mais tous les trente ans, Chigaliov autorise les convulsions ; et alors tous se jetteront les une sur les autres et s’entre-dévoreront ; mais jusqu’à une certaine limite seulement, uniquement pour vaincre l’ennui. L’ennui est un sentiment aristocratique. La société de Chigaliov ne connaîtra plus les désirs ». Précisons que Stavroguine, qui écoute ce galimatias, se demande si l'autre n'est pas carrément cintré ou complètement ivre.
Que Chigaliov (à moins que ce ne soit Verkhovensky) et son programme transposent (en caricaturant ?) le hélas trop authentique et historique Netchaïev et son Catéchisme du révolutionnaire ne fait guère de doute. Intéressant de savoir aussi que Lénine s’inspira de celui-ci pour concevoir dès 1902, puis organiser le parti bolchévik qui allait prendre le pouvoir quinze ans plus tard, avec les suites bien connues, mises en musique par Staline et consort.
Pour confirmation, on se reportera à la remarquable bande dessinée La Mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, pour se faire une idée de l’ambiance terrifiante qui régnait au sommet de l’Etat soviétique, y compris et surtout parmi les plus proches du pouvoir suprême, qui savaient comment ils étaient arrivés là, et qui avaient donc toutes les raisons de redouter le pire à tout instant de la part de leurs meilleurs « amis ».

Molotov, Krouchtchev : ils se les caillent sur le balcon, parce que Béria a fait poser des micros partout à l'intérieur. Ça ne les empêche pas de préparer l'avenir d'un certain nombre de leurs « amis » : « De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ». Il n'y a pas que dehors qu'il fait très froid. Brrr ...
Le projet de ce petit noyau de révolutionnaires, à qui l’on a fait croire que la même chose se passerait partout dans les campagnes russes, est de gâcher la « fête » voulue par Julie Mikhaïlovna, épouse du gouverneur Von Lembke, une sorte de fantoche et de mari falot, et de semer le trouble dans la ville par tous les moyens, dans l’espoir de provoquer l’insurrection qui balaierait l’ordre établi.
On ne résume pas Les Possédés. Il faudrait encore citer le personnage de Lébiadkine, vaguement officier en retraite et diplômé d’ivrognerie, qui bat sa sœur, laide, boiteuse et plus qu’à moitié folle. On apprendra que celle-ci (Maria Timopheïevna) a été épousée autrefois, par bravade et par Nicolaï Vsévolodovitch (c'est un zeugma), fils de Varvara Petrovna Stavroguine.
Ce personnage, qui occupe dans le roman une place centrale, on découvre dans un chapitre censuré (« La Confession de Stavroguine », ou « Chez Tikhone »), qu’il a longtemps été complètement barré, désespéré, capable de prendre au pied de la lettre, dans une réunion mondaine, le nommé Gaganov affirmant : « On ne me mène pas par le bout du nez », le saisissant aussitôt par l’appendice nasal et lui faisant traverser le salon.
La vie ne lui est de rien, semble-t-il, aussi incapable de s’aimer que d’aimer Lisaveta Nicolaïevna. On comprend, dans sa « confession », qu’il a sans doute violé une fillette, qu’il n’empêche pas ensuite de se pendre après qu'elle lui a déclaré : « J’ai tué Dieu ». Et pourtant, le comploteur Piotr Stépanovitch l’admire tel un demi-dieu, qu’il rêve de voir sur le trône de Russie en tant que « tsarévitch Ivan ». Allez comprendre. Je garde après lecture le sentiment que Stavroguine est un personnage romanesque incohérent (un peu à l'image du livre pris dans son entier).
Lébiadkine et sa sœur seront assassinés, soi-disant par l’ancien forçat évadé Fédka qui croyait trouver une forte somme. Les assassins présumés ont tenté de dissimuler leur forfait en mettant le feu à la maison au cours de l’incendie qui a détruit tout un quartier de la ville, mais la maison, isolée au milieu d’un terrain vague, a refusé de brûler. Fédka sera lui-même retrouvé mort, sur un chemin.
Il semblerait aussi que Dostoïevski a voulu régler quelques comptes avec l'écrivain Tourgueniev, qui s'est paraît-il offusqué du portrait dressé par l'auteur de l'écrivain Karmazinov, qui le présente sous un jour très peu sympathique. Entre « amis », n'est-ce pas.
Alors maintenant, quel est le vrai titre du livre ? J’avais depuis longtemps dans mes rayons Les Démons, dans une édition « club ». Et puis j’ai découvert que ce livre et le « poche » que je viens d’acheter (traduction de Boris de Schloezer) à 1,60 € ne font qu’un. Enfer et damnation. Il paraît qu’il faut dire « Les Démons ». Même si la perspective en est modifiée, ça ne change rien à la folie des personnages.
Ce qui domine de très haut, une fois qu’on l’a refermé, c’est à coup sûr la dénonciation violente de cette folie destructrice contenue dans l’utopie véhiculée par le petit groupe de conspirateurs dirigé par Verkhovensky, et mû par les théories de Chigaliov. Toute la seconde moitié des Possédés est un pamphlet dirigé contre la folie criminelle de Netchaïev et de tous ses semblables. Faut-il les appeler « communistes », « socialistes », « nihilistes » ? Ou plus simplement : « association de malfaiteurs » ?
Je pencherais volontiers vers la dernière hypothèse (il est vrai que l'enrichissement personnel n'est le but d'aucun "révolutionnaire"). En me disant que Dostoïevski nous parle d'un temps, après tout, pas aussi lointain qu'on pourrait le penser.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, bolchéviks, nihilisme, révolutionnaires, lénine, staline, netchaïev, chigaliov, communisme, socialisme, catéchisme du révolutionnaire, la mort de staline, bande dessinée, nury robin, état soviétique, confession de stavroguine, boris de schloezer, association de malfaiteurs
mardi, 26 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
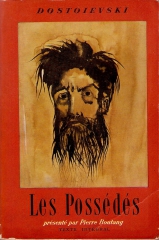 1/2
1/2
J’ai toujours entretenu une relation ambivalente avec Fédor Dostoïevski, échaudé vers l'âge de quatorze ans par des tentatives infructueuses dans L'Eternel mari et Le Joueur. Il a fallu du temps : rien de tel que l'étude de Cinna en classe de cinquième pour vous dégoûter durablement de Corneille. Et puis un jour, j’ai eu la chance de découvrir Les Frères Karamazov, qui m’avait transporté très loin et très haut. Si j’avais commencé par L’Idiot ou Crime et châtiment, je n’aurais probablement pas donné suite à l’invitation.
J’ai en effet laissé tomber L’Idiot à la page 454 (sur 751, édition Pléiade), pour dire que j'ai insisté. J’ai abandonné le prince Mnichkine en pleines parlotes. Crime et châtiment, c’était à la page 378 (sur 761, éditions Garnier), pour l’exacte même raison : des causettes interminables en cercles plus ou moins larges, dans des lieux plus ou moins confinés, voire inconfortables.
Après avoir achevé Les Possédés, œuvre qui recèle quelque chose de prodigieux, même si j’ai du mal à situer ce prodigieux-là, je me dis que la « parlote » n’est pas forcément un vice rédhibitoire dans un roman. Mais je devrais plutôt parler de « conversations ». Il m'appert même l'éventualité que la conversation ait été érigée par Dostoïevski en système romanesque à part entière.
Dostoïevski, je vais vous dire : c’est très spécial. Le lecteur est obligé de découvrir les faits, les situations, les relations à travers les yeux, la bouche et les oreilles de chacun des personnages. S’il veut saisir de quoi il est question, le lecteur doit endosser complètement un nouveau rôle à chaque changement d’interlocuteur, à travers les propos que les uns et les autres tiennent, au gré des circonstances. Une sacrée gymnastique : une nouvelle personnalité, sans même savoir de quoi celle-ci est faite, comme si vous changiez en permanence d'yeux, de cerveau, d'identité. Le récit à la troisième personne est réduit à la portion congrue.
L’auteur se garde bien d’expliquer quoi que ce soit, il embarque le lecteur dans une incroyable succession de points de vue spécifiques et de subjectivités embrouillées, souvent exaltées, ambiguës et contradictoires, toujours possédées par une passion inintelligible à la première approche. Comme une pièce de théâtre écrite dans une langue qu'ignore le spectateur, à qui l'auteur dirait : débrouille-toi. Sans sur- ou sous-titrage.
Disons-le, sur les 350 premières pages (la moitié), le sujet du livre reste dans un brouillard savamment entretenu. Ce n’est pas pour rien qu’on lit dans une notice consacrée au bouquin : « Aucune œuvre de Dostoïevski n’est plus difficile à lire que celle-ci, par la confusion et l’obscurité qui enserrent tous les personnages ».
Dostoïevski adopte une convention narrative complexe : c’est à force de s’emmêler dans les confrontations et interactions orales entre les personnages que le lecteur chemine vers la compréhension des caractères, des relations, des projets et intentions des uns et des autres. Le narrateur, qui s’affiche comme simple « chroniqueur » (sous le nom de « G…v »), se contente de témoigner de ce qu’il a vu, entendu, compris, même s’il lui arrive, comme n'importe quel ethnologue dans son enquête chez les Rakotofiringa ou les Pitjantjatjara, de pratiquer l’ « observation participante ».
Attention, ça ne l’empêche pas d’être bizarrement très au fait de tout un tas de détails concernant des événements auxquels il n’a carrément pas pu assister, et que nul n'a pu lui rapporter. Ainsi, comment s’y prend-il pour raconter dans le moindre détail l’assassinat de Chatov, qui n’a eu aucun autre témoin que la demi-douzaine de participants ? Ce n’est à coup sûr à aucun d’eux (Liamchine, Lipoutine, Piotr Stepanovitch, Virguinski, Chigaliov …) que serait venue l’idée de tout lui révéler. Disons que c’est tellement bien fait que le lecteur n’y voit que du feu, et gobe tout sans se poser de questions.
Il y a deux livres dans Les Possédés : la première moitié offre la peinture de la vie ordinaire et quotidienne d’une ville de la campagne russe, une ville dont on ne sait pas grand-chose de la taille ni de la distance qui la sépare de Pétersbourg, et où s’agitent un certain nombre de personnages plus ou moins oisifs qu’on verra en action dans la deuxième moitié. Leur occupation principale semble être de se rendre les uns chez les autres pour parler.
Chacun de ces personnages, à commencer par Stépane Trophimovitch Verkhovensky, intellectuel paresseux et parasite qui vit aux dépens de Varvara Pétrovna, riche veuve Stavroguine, est un peu fêlé, bizarre à sa façon, animé d’un déséquilibre qui lui appartient en propre, comme un trait d’identité. Tous se ressemblent sur un point : la médiocrité, qui confine en plus d’une occasion à la niaiserie et au ridicule.
Cette partie est pour l’essentiel énigmatique : on se demande où ça va. La deuxième moitié fonctionne donc à la manière d’un dévoilement, bien que le lien de nécessité entre les deux soit pour le moins évanescent. Sous les tensions, les désirs, les haines et les hypocrisies, on comprend que le masque des conventions et des rapports sociaux cachait une partie humainement âpre, qui trouve ses origines dans le passé et à l’étranger. Plusieurs des personnages ont séjourné, jadis ou naguère, aux Etats-Unis, en Suisse, à Berlin. Ce qu’ils y ont fait n’est évoqué que pour créer autour d’eux un climat de suspicion ou d’incertitude.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, les frères karamazov, crime et châtiment, l'idiot, prince mnichkine, stavroguine, verkhovensky, le joueur, l'éternel mari, corneille cinna
lundi, 11 mai 2015
LE DERNIER FRED VARGAS
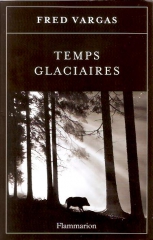 Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.
Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.
**************
Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.
être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.
L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.
Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.
De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.
J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.
Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.
Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.
Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.
Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.
L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.
A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.
Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.
Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.
Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.
Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?
Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.
Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».
Voilà ce que je dis, moi.
 Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!
Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers
samedi, 09 mai 2015
L'HOMME EST APPROXIMATIF
Est-ce ainsi que Pierre Reverdy envisageait ses "Flaques de verre" ?
A moins que ce ne soit qu'un grain de café presque transparent.
(Murakami Ryu a écrit l'allumé halluciné Bleu presque transparent.)
**********************************************************************************
Je n’ai jamais pu me dépêtrer de L’Homme approximatif. Cette œuvre de Tristan Tzara (qui a bien connu Pierre Reverdy), qui n'a pas arrêté de me courir après depuis des millénaires, m’a convaincu que, quand on est poète, on ne saurait se résumer au croupion d'un quelconque Mouvement Dada, ou au squelette d'une vulgaire Révolution Surréaliste. Et qu'il y a de la chair, et de la bonne, sur les os de cette volaille : c'est du corpulent.
Que l’homme ne sait jamais ce dont il est porteur quand il fait. Qu’il n’est jamais ce qu’il croit être. Qu'il est une flèche lancée par l'arc d'il ne saura jamais qui. Que la trajectoire humaine n'est jamais une ligne droite. Que ce qu’il est dépasse (je n’ose pas dire "transcende") de loin l’image qu'il s'est faite de ce qu'il doit être. Quand le poète est en état de produire cet effet, il dégage un puissant souffle de vérité. Ici, il me dépasse.

L’Homme approximatif me colle à la peau. Tenez ce petit fragment :
« frileux avenir – lent à venir
un écumant sursaut m’a mis sur ta trace de regard là-haut où tout n’est que pierre et nappe de temps voisin des crêtes argileuses où les jamais s’enflent sous robe d’allusion
je chante l’incalculable aumône d’amertume
qu’un ciel de pierre nous jette – nourriture de honte et de râle –
en nous rit l’abîme
que nulle mesure n’entame
que nulle voix ne s’aventure à éclairer
insaisissable se tend son réseau de risque et d’orgueil
là où l’on n’en peut plus
où se perd le règne du silence plat pulsation de la nuit ainsi se rangent les jours au nombre des désinvoltures et les sommeils qui vivent aux crochets du jour sous leur joug
jour après jour se rongent la queue et dansent autour et là-haut là-haut tout n’est que pierre et danse autour »
Rien que le titre du livre est un chef d’œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
**********************************************************************************
Babioles :
Elections législatives en Grande-Bretagne.
Une fois de plus, prosternons-nous devant l'infaillibilité Royale et Scientifique de leurs Majestés et de leurs Excellences les Sondages d'Opinion.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, littérature, tristan tzara, dada, surréalisme, dadaïsme, pierre reverdy, flaques de verre, la révolution surréaliste, andré breton, grande bretagne, david cameron, tory, labour, ed milliband, nick clegg, sondages d'opinion, élections législatives
lundi, 20 avril 2015
QUAND HOUELLEBECQ INTERVIENT
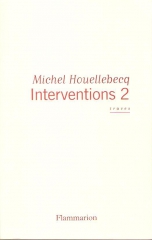 Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.
Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.
Je ne rejette pas a priori l’hypothèse de la pathologie, mais que voulez-vous, quand vous mettez le pied dans un patelin où, à votre grand étonnement, vous avez soudain l’impression de rentrer à la maison tellement c’est comme ça que vous vous racontiez l’histoire et que vous vous peigniez le paysage, vous avez envie de vous arrêter là, et d’en savoir un peu plus long, ne serait-ce que pour vérifier que vous ne rêvez pas.
Il se trouve simplement que j’ai découvert en 2011, avec La Carte et le territoire, un écrivain qui surpasse de très loin le niveau du vulgum pecus littéraire français. Et que j’ai eu envie de creuser la question. Je dois dire qu’en creusant, je n’ai pas été déçu des matières que ma rivelaine amenait au jour, à mesure que j’avançais dans le filon.
Interventions 2 est ce qu’on appelle un « recueil ». Forcément, il y a « à boire et à manger » : des textes de longueurs, de natures, de genres et de thématiques différents, qui ont été demandés à l’auteur entre 1992 et 2008. Sans compter l’avant-propos, il s’ouvre et se ferme sur des règlements de comptes. Le premier (« Jacques Prévert est un con ») n’a pas besoin d’explication. Le titre annonce la couleur et se suffit à lui-même.
En revanche, le titre « Coupes de sol », qui clôt l'ouvrage, reste énigmatique tant qu’on ne sait pas que Houellebecq est sorti de la même « Agro » que Robbe-Grillet, et que la « coupe de sol » est une des bases, paraît-il, de l’enseignement agronomique. Cela n’empêche pas le condisciple à retardement d’infliger une bonne avoinée littéraire à son prédécesseur : non, Houellebecq n'aime pas le pape du "Nouveau Roman". Je le comprends.
C’est que Houellebecq a fait des choix (il ne le dirait peut-être pas comme ça : des choix qui se sont imposés ou qu’il n’a pu refuser de faire, il a une conception pessimiste de la liberté humaine), il a pris position, ce qui l’autorise à porter des jugements.
Si certains trouveront ceux-ci péremptoires et injustes, c’est qu’ils ont l’esprit « errant et sans patrie » de ceux qui, prenant tout ce qui vient au motif qu’il ne faut rejeter ou exclure rien ni personne, s’interdisent de porter quelque jugement que ce soit sur qui ou quoi que ce soit, mais attention : en interdisant absolument à quiconque de ne pas être d’accord avec eux, sous peine de correctionnelle. Pour eux, affirmer des choix et porter des jugements, c'est forcément être facho. Si tout au moins choix et jugements osent s'écarter de leur ligne.
Je veux parler de tous les obsédés du consensus moral, tous les flics tolérantistes qui peuplent la gauche raplapla, dépourvus de ce moyen de jugement qui permet de distinguer le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le beau et le laid, – ce moyen qu’on appelait un CRITÈRE, à l’époque où les « valeurs » étaient encore des échelles, qui permettaient de placer êtres, choses, langages, systèmes, œuvres d’art à des altitudes différentes. Cette époque ténébreuse et heureusement révolue, où l’on avait encore l’infernal culot d’appeler un chat un chat.
Je laisse Robbe-Grillet aux amateurs, s’il y en a encore. Je m’arrête sur Prévert, le poète préféré des enseignants masochistes qui aiment se faire flageller en faisant apprendre « Le Cancre » à leurs élèves multiculturels : « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime, il dit non au professeur, et gnagnagna et gnagnagna ». Prévert illustre à merveille la niaiserie irréversible qui a saisi la société française au moment où elle a commencé à sacraliser « le monde merveilleux de l’enfance ».
Houellebecq met le monsieur dans le même sac que Vian, Brassens et Boby Lapointe (qu’il écrit « Bobby », l’ignorant), dont il trouve les jeux de mots stupides. Tant pis, c’est son droit. Question de génération sans doute. Vian, je le lui laisse assez volontiers, mais Brassens et Lapointe, je ne suis pas d’accord : ils ont poussé leur rhizome trop loin dans mon oreille pour que je puisse seulement songer à en arracher la moindre radicelle. S’agissant de Brassens et Lapointe, je perds tout esprit critique.
Jacques Prévert souffre, aux yeux de Houellebecq d’un certain nombre de tares. Certes et hélas, « il a quelque chose à dire », « Malheureusement, ce qu’il a à dire est d’une stupidité sans borne ». Il enfonce le clou : « Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, fondamentalement, un imbécile ». Il n’a pas tort. Pour terminer : « Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse ». J’avoue que ces quatre pages m'ont fait un bien fou. Un fier encouragement à poursuivre la lecture.
Le propre d’un recueil, c’est d’être d’un intérêt inégal. C’est dans sa nature. Certains textes (critique cinéma, critique art, critique poésie, …) ne me disent guère. C’est le cas, en particulier d’ « Opera Bianca », suite de courts textes destinés à accompagner l’ « installation mobile et sonore conçue par le sculpteur Gilles Touyard ».
Je ne connais pas les œuvres de Gilles Touyard, mais en apprenant que « la musique est due à Brice Pauset », c’est plus fort que moi, je ferme toutes les écoutilles. Peut-être à cause du traumatisme que constitue la production sonore (je n'ai pas dit la « musique ») de ce monsieur, tout fier de reproduire, par exemple, les sons enregistrés d'un aspirateur en fonctionnement.
D’autres retiennent sans effort mon attention. C’est le cas d’un article daté de 1992 (« Approches du désarroi »), un vrai petit chef d’œuvre synthétique et analytique sur l'époque que nous vivons, dont je conseille vivement la lecture. C’est aussi le cas de « Philippe Muray en 2002 ». C’est encore le cas d’un entretien avec des gars de Paris-Match. Quelques autres.
La loi du genre, quoi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, critique littéraire, michel houellebecq, interventions 2, éditions flammarion, la carte et le territoier, jacques prévert, jacques prévert est un con, alain robbe-grillet, nouveau roman, prévert le cancre, boris vian, georges brassens, tonton georges, boby lapointe, paris match, musique contemporaine, brice pauset
vendredi, 17 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 4 (MH et BH)
4/4
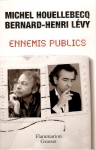 Je n’ai guère envie de m’appesantir sur les propos que les deux compères tiennent sur la foule de leurs détracteurs (de leurs « ennemis », « l'agent de sécurité Assouline », Jérôme Garcin, la « meute »), si ce n’est pour mentionner l’espèce de scolaire et pompeuse dissertation en trois points par laquelle BH se fait fort de tailler en pièce le spectre de « la meute ». Ce dont MH, si je ne me trompe, s’abstient en général : quand il parle de lui, il ne s’attarde pas trop sur l’analyse de son image publique, comme sur ce qu'il faut faire quand on est face à ses ennemis. Il se sent démuni, allant jusqu'à dire des choses énormes : « ... il serait plus juste de parler de "guerre d'extermination totale dirigée contre moi" » (p. 201). L'emphase hyperbolique laisse sceptique. Si lui aussi s'y met ... A moins qu'il ne s'amuse à titiller la parano de BHL ? Pas sûr, mais je l'en crois capable.
Je n’ai guère envie de m’appesantir sur les propos que les deux compères tiennent sur la foule de leurs détracteurs (de leurs « ennemis », « l'agent de sécurité Assouline », Jérôme Garcin, la « meute »), si ce n’est pour mentionner l’espèce de scolaire et pompeuse dissertation en trois points par laquelle BH se fait fort de tailler en pièce le spectre de « la meute ». Ce dont MH, si je ne me trompe, s’abstient en général : quand il parle de lui, il ne s’attarde pas trop sur l’analyse de son image publique, comme sur ce qu'il faut faire quand on est face à ses ennemis. Il se sent démuni, allant jusqu'à dire des choses énormes : « ... il serait plus juste de parler de "guerre d'extermination totale dirigée contre moi" » (p. 201). L'emphase hyperbolique laisse sceptique. Si lui aussi s'y met ... A moins qu'il ne s'amuse à titiller la parano de BHL ? Pas sûr, mais je l'en crois capable.
Ce que je trouve en revanche tout à fait intéressant, pour ne pas dire essentiel, dans les propos de MH, c’est tout ce qu’il dit de la poésie et de la littérature. Il livre au passage quelques secrets de fabrication, ce que, soit dit en passant, ne fait jamais BHL, comme si, à ses yeux, le "littéraire" comptait pour rien. Ou comme s'il n'avait pas d'autre secret de fabrication que son moi qui déborde. Comme s'il ne savait pas que le moi est une impasse, un cul-de-sac. Un dédale, un labyrinthe, un trou sans fond. Que nous importe le moi, tout bien considéré ?
Houellebecq, ses premiers livres publiés appartiennent au genre poétique. J’ai inscrit cette lecture à mon programme : je n’ai pour l’instant lu que quelques poèmes épars. J’ai lu avec beaucoup de plaisir le « chapitre » qu’il consacre (entre autres) à deux ouvrages savants de Jean Cohen sur le sujet.
Il est vrai que son pessimisme chromosomique, lui fait déplorer la disparition de la poésie : « Nous vivons peut-être dans un monde (c’était la conclusion de Ghérasim Luca juste avant son suicide) où la poésie n’a simplement plus de place » (p. 263). Ghérasim Luca, pour moi, c’est Héros-Limite, Paralipomènes, La Voici, la voix silanxieuse … Un tout grand, un peu maniéré peut-être avec ses jeux de langage, mais dont l'œuvre, prise dans son entier, est bâtie sur un socle infrangible d'authenticité poétique.
Je crois qu'il est dans Héros-Limite (Paralipomènes ?), ce poème inépuisable et merveilleux qui me terrasse de maîtrise à chaque lecture, « Son corps léger » (en cliquant, le texte, et la voix de son auteur lisant), où l’âme (désolé, je n’ai pas d’autre mot) du poète fait réellement corps (éphémère et changeant) avec la langue française, lui qui, comme Paul Celan, autre suicidé de l’exigence, venait de Czernovitz, « capitale secrète de la littérature allemande » (formule de François Mathieu, dans son introduction à Poèmes de Czernovitz, éditions Laurence Teper, 2008). La référence à Ghérasim Luca m'a surpris et touché.
Pour la production romanesque, Houellebecq s’avoue horripilé à l’idée de « raconter des histoires » (p. 266), ce dont je lui sais vivement gré (il y aurait à dire sur le besoin effréné des gens de s'entendre raconter des histoires), mais en revanche, dit-il : « J’étais doué pour une chose, et pour une seule en relation au roman, c’était la création de personnages » (266). Au sujet de son univers romanesque, il dit je ne sais plus où (en substance) que pour bien expliquer le monde, il faut commencer par le décrire. Il dit ailleurs : « Je tends un miroir au monde, où il ne se trouve pas très beau » (p. 295). C’est le moins qu’on puisse dire. Ce que certains ne lui pardonneront jamais.
Et puis surtout, je retiens ce qui m’avait sauté aux yeux, impressionnant de vérité, à la lecture de Soumission. On peut d’ailleurs affirmer que l’espèce de théorie romanesque qui suit s’applique avec brio à son dernier livre : « J’ai l’impression d’écrire un roman lorsque j’ai mis en place certaines forces qui devraient normalement conduire le texte à l’autodestruction, à l’explosion des esprits et des chairs, au chaos total (mais il faut que ce soit des forces naturelles, qui donnent l’impression d’être inéluctables, qui paraissent aussi stupides que la pesanteur ou le destin) » (p. 231, c’est moi qui souligne). On n’est pas plus exact. Soumission constitue une merveille de rouage romanesque bien huilé fabriqué selon ce principe. Techniquement, c'est parfait de naturel, d'évidence irréfutable comme la loi de la gravitation. En plus, idéologiquement percutant, comme on l'a vu avec les cris d'orfraie suscités.
La citation est de 2008, Soumission de 2015. C’est sûr, la trajectoire (ni la théorie) romanesque de Houellebecq n’a pas dévié. Là, on est sûr, même si l’auteur ne s’affiche pas philosophe (malgré la défense qu’il entreprend du si bizarre Auguste Comte), même s'il ne se prétend pas penseur, qu’il y a pour le coup une vraie pensée. BHL a écrit beaucoup de livres, Houellebecq laissera derrière lui une œuvre.
Bon, je crois que j’en ai assez dit. On me reprochera de m’être davantage répandu sur les tares de l’un que sur les vertus de l’autre. Peut-être le contraire. Deux raisons à cela : c’est la première (et je l’espère la dernière) fois que je commente des choses écrites par Bernard-Henri Lévy ; ce n’est pas la première (et pas la dernière sans doute) que j’écris à propos de Michel Houellebecq.
 Argumenter n’a jamais modifié les convictions de qui que ce soit : on n'argumente pas pour modifier l'opinion de l'autre, mais pour renforcer sa conviction et/ou éviter de la remettre en question. Malgré le génial Chaïm Perelman et son génial ouvrage, j'ai cessé de croire dans les pouvoirs de l'argumentation : ce sont la propagande, la publicité, la télévision qui l'ont pris, le pouvoir.
Argumenter n’a jamais modifié les convictions de qui que ce soit : on n'argumente pas pour modifier l'opinion de l'autre, mais pour renforcer sa conviction et/ou éviter de la remettre en question. Malgré le génial Chaïm Perelman et son génial ouvrage, j'ai cessé de croire dans les pouvoirs de l'argumentation : ce sont la propagande, la publicité, la télévision qui l'ont pris, le pouvoir.
L'argumentation rationnelle a perdu la partie. Le livre le confirme : malgré ce qu'écrivent les deux compères, il n’y a pas de véritable interaction dans l'échange MH/BH, qui doit beaucoup à la perspective de départ (une correspondance entretenue à seule fin de sa publication).
Chacun reste soi-même, et c’est très bien comme ça.  Il suffit de regarder les photos des auteurs en couverture : d’un côté (MH), la distance, le scepticisme, voire l’hébétude (« … une manière d’être à demi présent, une capacité à l’hébétude … », p. 299) ;
Il suffit de regarder les photos des auteurs en couverture : d’un côté (MH), la distance, le scepticisme, voire l’hébétude (« … une manière d’être à demi présent, une capacité à l’hébétude … », p. 299) ;  de l’autre, l’attitude, la pose, l'affectation, le "fabriqué", le personnage étudié : « Comment dois-je placer mon index, pour que tout le monde me croie en train de chercher la phrase ? » (pcc. FC). Comme s'opposent l'authentique et le frelaté. Je n'idéalise pas le personnage de Houellebecq, Dieu m'en préserve, mais tout, dans celui de Lévy, sonne faux. Au sortir du livre, on a l'impression que les trois marques de parfums que préfère BHL sont « Epate » de Guerlain, « Esbroufe » de Chanel et « Frime » de Dior.
de l’autre, l’attitude, la pose, l'affectation, le "fabriqué", le personnage étudié : « Comment dois-je placer mon index, pour que tout le monde me croie en train de chercher la phrase ? » (pcc. FC). Comme s'opposent l'authentique et le frelaté. Je n'idéalise pas le personnage de Houellebecq, Dieu m'en préserve, mais tout, dans celui de Lévy, sonne faux. Au sortir du livre, on a l'impression que les trois marques de parfums que préfère BHL sont « Epate » de Guerlain, « Esbroufe » de Chanel et « Frime » de Dior.
D'un côté un Houellebecq finalement fatal, pour qui l'écriture se concentre depuis le départ dans la production de romans et de poèmes (avec en prime les « Interventions », textes de commande, me semble-t-il, plus disparates en tout cas, réunis en deux volumes sous ce titre). De l'autre un Lévy pris de tournis perpétuel, de tourisme événementiel exacerbé, frénétiquement polygraphe (inventeur de l'inénarrable forme du « romenquête », qui avait surtout blessé la veuve de Daniel Pearl, l'égorgé d'Al Qaida), peut-être talentueux et brillant, mais trop dispersé pour produire de vraies œuvres, que ce soit en philosophie, en littérature, en journalisme, en cinéma, en « action humanitaire », en prestations médiatiques, ... Rien d'étonnant à ce qu'il se soit bien entendu avec Nicolas Sarkozy. Un vrai gâchis, je vous dis.
Houellebecq est centripète, Lévy est centrifuge.
D'un côté un Houellebecq qui se contente de rester lui-même ; de l'autre un Lévy qui ne cesse de jouer tous ses personnages (avec la certitude qu'ils sont tous nécessaires). D’un côté un Houellebecq pas très sympathique, mais le plus souvent exact, « honnête » et précis ; de l’autre un Lévy brouillon, vibrionnant, insupportable de grandiloquence égocentrée, mais finalement éparpillée. Je vais vous dire : un Osiris par choix.
Vers quelle Isis tend-il désespérément, "le pauvre homme" ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, bhl, bernard-henri lévy, pierre assouline, jérôme garcin, houellebecq bhl ennemis publics, jean cohen, poésie, ghérasim luca, héros limite, paralipomènes, la voici la voix silanxieuse, paul celan, poèmes de czernovitz, éditions laurence teper, houellebecq soumission, chïm perelman traité de l'argumentation, nicolas sarkozy, isis osiris
jeudi, 16 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 3 (MH et BH)
3/4
 Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?
Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?
Beaucoup de vantardises fiérotes, ça c’est sûr. Que ce soit dans le café voisin (le Twickenham) de l’éditeur Grasset (où il a son bureau de directeur littéraire, j’imagine) ou à propos du village d’Esbly, il faut que nul n’en ignore : BHL aura été un homme "couvert de femmes". Cette fois ce n’est plus Sartre ou Malraux (quoique …), c’est carrément Chateaubriand : il lui suffit d’apparaître pour qu’elles lui tombent dessous (je suis assez content de la formule, servez-vous).
C’est MH qui cite le nom de la commune où les parents de BH avaient une maison, revendue à cause de la « cancérisation » par Disneyland. Réaction de BH : « Mon Dieu, Esbly ! ». Aussi sec, je vous jure que c'est vrai, il nous fait le coup de la madeleine (sur l'air de "J'avais totalement oublié", "Mon dieu quelle émotion !") !
Et c'est parti pour nous tartiner l’histoire de l’épouse-caissière du boucher surnommé « le cocu », cette femme qui payait de sa personne dans l’initiation sexuelle des jeunes mâles du coin. « Mon prince, on a les dames du temps jadis qu'on peut » (Georges Brassens). Pourquoi pas, après tout, la bouchère d'Esbly ? D'autant que Houellebecq réplique finement, dans la lettre qui suit, que c'est BHL lui-même qui a parlé de la commune dans un de ses livres. Simplement, il avait "oublié".
Houellebecq est peut-être moins intelligent que BHL, mais il n’est pas le moins subtil des deux. Il raisonne peut-être de façon plus "stratégique" que le philosophe. Il y a un côté « américain » chez BHL, je veux dire « banque de données », je-collecte-tout-on-triera-après (le syndrome NSA, "grandes oreilles", etc.), qui est à peu près absent de l’univers houellebecquien. Houellebecq voit venir de loin. Bernard-Henri Lévy a du mal à voir le monde tel qu’il est, je veux dire à le comprendre : son personnage, qui remplit son paysage, fait écran.
Si l'épisode du "Journal intime" qu'il tient et de sa peur qu'il finisse sur les rayons de l'IMEC (archives de l'édition contemporaine) vire au comique, je suppose que c'est involontairement. Ça commence p. 310, « au bar de l'hôtel Excelsior, à Venise, avec Olivier Corpet, le patron de l'IMEC ». Ça ne pouvait évidemment pas se situer à l'hôtel de la Gare de Gleux-les-Lure, la bourgade qui vit naître le sapeur Camember, un inoubliable 29 février. Ah, Venise !...
Quand Corpet lui soutient que, quelque précaution qu'il prenne, testamentaire ou autre, son Journal atterrira tôt ou tard dans ses collections, il va passer un temps fou « à fabriquer une usine à gaz, à mon avis unique en son genre » pour s'assurer "ante mortem" qu'il n'en sera rien. Et pourquoi tout ce cirque ? Parce que ce Journal « mirifique », « de vingt et quelques mille pages », pas moins, est « plein de secrets plus explosifs les uns que les autres » !! Farpaitement ! On s'en doutait un peu, BH, que ton importance intrinsèque t'a introduit dans le secret des dieux, et que tu te retiens de tout dire, parce que sans ça !
Pour ce qui est du style, je ne sais pas si c’est à Chateaubriand qu’il faut penser, j’ai du mal à faire le lien. Monsieur Lévy écrit par exemple : « … quand on a été ces jeunes gens orageux, frères en apocalypse et en pyromanie … » (p. 279). Désolé, cette enflure verbale me fait penser à Eloge des voleurs de feu, d’un certain Dominique de Villepin. Le lyrisme est souvent ridicule. Sinon, il est volontiers grotesque.
Désolé, ça n’a tout de même pas la gueule de « Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René sur les rivages d’une autre vie … ». Je m'étonne presque que BHL n'ait pas senti « le vent sifflant dans [sa] chevelure », qu'il a pourtant abondante (peut-être à dessein ?). N'est pas Chateaubriand qui veut. J’ai constamment l’impression qu’ « il se la joue ». BHL mauvais imitateur. Peut-être parce qu'il rêve d'imiter tous les grands noms de la littérature et de la philosophie (sans compter les autres) ?
Sa plume sème aussi, ici ou là, des citations cachées, réservées sans doute à l'élite des initiés. Ainsi, p. 243 : « … le jour où on verra clair dans leur communauté inavouable, … » (un titre du très classieux, très chic et très « fashion » Maurice Blanchot) et, juste en dessous : « … des mouchards, des charognards plaqués sur du vivant … » (réminiscence assez niaise d'Henri Bergson, dans Le Rire).
Pour avoir besoin, à tout moment, de s’en référer à des autorités, on se demande finalement si BHL, le "philosophe" autoproclamé, arrive seulement à la cheville de ceux qui inventent des concepts ou des catégories de la pensée, ceux qu'on appelle, pour le coup, des philosophes. Tout compte fait, il ne semble pas. Il s’est beaucoup démené, il a beaucoup fait, mais qu'a-t-il fait bien ? Il fut peut-être un élève brillantissime, tant mieux pour lui, mais il faut un jour cesser d'être "scolaire". Un jour, il faut choisir, mais choisir, c'est éliminer.
Il frise parfois l’odieux. On trouve par exemple, p. 223 : « Je pense à tous les anonymes qui m’écrivent quand mes livres paraissent, ou que je passe à la radio et à la télé … ». Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un mot qui ne passe pas. Le même mot écœurant que les journalistes emploient dans les événements dramatiques, les grands enterrements : c’est le mot « anonymes ». Mais si, ça vous dit sûrement quelque chose, « la foule des anonymes ». Ho BH, tu sais ce qu’il te dit, l’ « anonyme » ? Anonyme mon c..., dirait Zazie ! Moi, je serais plus grossier.
Alors au tour de Houellebecq, à présent. Je crois bien que c’est lui qui déclare : « Nous avons les mêmes ennemis ». Oui, c’est bien possible. Mais, cher monsieur Houellebecq, avec une différence de taille, me semble-t-il : pas pour les mêmes raisons. Je dirais même : pour des raisons opposées. Si BHL a joué les phalènes pour se placer dans la lumière des projecteurs, s’il a fait exprès pourrait-on dire, Houellebecq n’a pas cherché les feux de la rampe : ce sont ses livres, à commencer par le premier, Extension …, qui ont produit l’effet qu’on connaît (sans parler des Particules élémentaires). Ça lui est tombé dessus. C'est du moins ce que je suis enclin à croire.
On me dira qu’il s’est vite habitué. Sans doute, il n'a pas refusé. Je note cependant que son succès et le scandale qui est allé avec n’ont pas dévié d’un centimètre la trajectoire qu’il a imprimée dès le départ à sa production romanesque. Je reste persuadé qu’avant publication de son premier roman, il n’avait pas prévu qu’il déclencherait le schproum qui accompagne désormais chaque parution, et qu'il a alors pris en pleine figure. Ça ne lui a sans doute pas fait de bien, comme s'en inquiète Sollers, cité dans le livre de Dominique Noguez (cf. 3-4 avril).
Cela n’empêche pas Houellebecq de tomber dans la complaisance : « Tout ça pour vous dire, cher Bernard-Henri, que je n’ai aucun mal à vous croire quand vous me dites n’avoir nullement prémédité votre célébrité. J’y ai d’autant moins de mal que je n’ai pour ma part à peu près rien prémédité de ma vie (ou, plus exactement, que tout ce que j’ai prémédité a échoué) » (p. 269). J’espère pour lui qu’il fait semblant. Autant je crois à peu près à la sincérité de MH, autant je doute de celle de BH, que je crois constamment et résolument insincère. On me dira sûrement que je suis de parti pris. Ce n’est pas tout à fait impossible, mais.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, ennemis publics, bhl, bernard-henri lévy, éditions grasset, esbly village, sartre, malraux, chateaubriand, disneyland, georges brassens, imec, gleux-les-lure, sapeur camember, dominique de villepin, éloge des voleurs de feu, maurice blanchot, la communauté inavouable, henri bergson le rire, zazie dans le métro, extension du domaine de la lutte, dominique noguez, houellebecq en fait, philippe sollers, les particules élémentaires
mercredi, 15 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)
2/4
 Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).
La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.
Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.
De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.
Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.
Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).
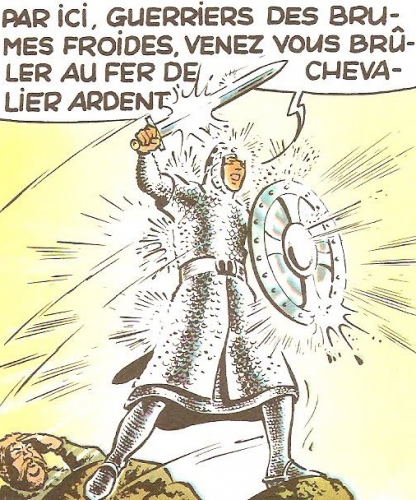
BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.
Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).
Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.
Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?
Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.
Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.
Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton
mardi, 14 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 1 (MH et BH)
Oui, je vais de nouveau parler de Michel Houellebecq. Mais pas que. Vous êtes prévenus.
1/4
 Je m’étais pourtant juré que jamais je n’ouvrirais un livre sur la couverture duquel figure le nom honni d’un histrion qui se fait passer, successivement ou en même temps, pour philosophe, cinéaste, homme d’action, journaliste et autres métiers menant autant que possible jusqu’aux plateaux de télévision. J’allais oublier qu’il s’est couvert de gloire en Libye, dont on peut croire qu’il est un peu à l’origine du chaos qui y règne aujourd’hui. Je veux parler de monsieur Bernard-Henri Lévy.
Je m’étais pourtant juré que jamais je n’ouvrirais un livre sur la couverture duquel figure le nom honni d’un histrion qui se fait passer, successivement ou en même temps, pour philosophe, cinéaste, homme d’action, journaliste et autres métiers menant autant que possible jusqu’aux plateaux de télévision. J’allais oublier qu’il s’est couvert de gloire en Libye, dont on peut croire qu’il est un peu à l’origine du chaos qui y règne aujourd’hui. Je veux parler de monsieur Bernard-Henri Lévy.
Ce monsieur, j’applaudissais à chaque fois qu’on le voyait couvert de la crème de la tarte (cliquer pour 1'22") dont l’orna à plusieurs reprises Noël Godin, alias « l’entarteur », alias « Le Gloupier » (l’onomatopée « gloup », je suppose, érigée en identité), dont une mémorable en 1985 (ou 1986 ou 1988, ça dépend des sources), scène où le masque du philosophe tombe pour montrer la violence du personnage quand on ose porter atteinte à sa majesté, immortalisée dans une séquence que Desproges se fait ensuite un plaisir de commenter pour Michel Denisot. Ci-contre dans un "Salon du livre", sauf erreur.
Noël Godin, alias « l’entarteur », alias « Le Gloupier » (l’onomatopée « gloup », je suppose, érigée en identité), dont une mémorable en 1985 (ou 1986 ou 1988, ça dépend des sources), scène où le masque du philosophe tombe pour montrer la violence du personnage quand on ose porter atteinte à sa majesté, immortalisée dans une séquence que Desproges se fait ensuite un plaisir de commenter pour Michel Denisot. Ci-contre dans un "Salon du livre", sauf erreur.
J’ai également savouré à sa juste valeur virtuelle la présence virtuelle d’un BHL virtuel sur le plateau virtuel de l’émission virtuelle d’Henri Chapier « Les Grands Cerveaux de l’Histoire » : cette séquence croquignolette, qui finit très mal pour l’histrion aux chemises blanches amidonnées, figure dans une remarquable bande dessinée de Chanoinat, Georges Lautner et Castaza. Le père des Tontons flingueurs s’est mis de la partie pour apposer sur le logo de l’entreprise son label de loufoquerie foutraque et de cruauté joyeuse.
Au cours de l’émission, Henri Vidal-(Chapier), énamouré, interroge béatement son grand homme, Bernard Jacques-(Lévy), qui lui répond toujours avec la certitude de celui que le moindre doute au sujet de sa valeur n’effleure strictement jamais. Malheureusement, quand l’émission prend fin, le grand homme prend sur le crâne un élément du décor du plateau : un énorme cerveau en plâtre. Il est écrabouillé. Quelqu’un conclut avec bon sens : « Les mauvaises langues diront qu’il est mort par là où il a péché ». Le titre de cette BD ? On achève bien les cons (2004, comme quoi la BD est impuissante sur le réel, sinon) ! BD réjouissante, comme on voit. Malgré tout.

S’il n’y avait eu sur la couverture du livre que le nom de Bernard-Henri Lévy, j’aurais fait comme pour toutes ses autres publications : je l’aurais laissé, bien fermé, reposer en paix sur l’étal du libraire, éternellement. Mais voilà, au-dessus de ce nom figurait celui de Michel Houellebecq. Le livre date de 2008. Son titre : Ennemis publics (Flammarion / Grasset).
Je ne me suis quand même pas précipité : j’ai attendu, pour l’ouvrir, qu’un ami me le prête. Mais, surprise, j’ai été assez intéressé pour faire la dépense : j’aime bien dans ces cas-là griffonner ce qui me vient à la lecture et souligner ceci ou cela, ce que je me serais interdit dans un livre non mien.
Ennemis publics résulte d’un pari étrange : le projet de publication d’un livre contenant la correspondance que les auteurs ne se mettent à échanger que parce qu’ils savent qu’elle sera publiée. Ce livre, s'il n'est pas artificiel (y a-t-il des livres naturels ?), est donc le produit d'un artefact (d'où ma réticence, d'ailleurs). Le statut des interlocuteurs s’en trouve évidemment modifié : chacun des deux écrit des lettres à l’autre, certes, mais forcément avec, à l’horizon, le futur public des lecteurs. C’est sûr : les compères ne perdent jamais de vue cette perspective. Le contenu de ce qu’ils écrivent s’en ressent.
Je vous dis tout de suite ce qu’il en est : Michel Houellebecq ressort de la confrontation moins sympathique que je n’aurais souhaité, alors que Bernard-Henry Lévy en ressort moins antipathique que je n’aurais voulu. Un tout petit peu moins : n’exagérons pas. C’est que, entre la décision prise d’entreprendre ce travail commun (dans un restaurant, si j’ai bien compris) et la publication du livre, six mois se seront écoulés, vingt-huit lettres auront été échangées au total : le temps d’aller un peu au-delà de la question « Bonjour, ça va ? » qu’on pose sans attendre de réponse, surtout mauvaise.
On ne s’engage pas dans un tel travail sans que les idées qu’on avait au départ se complexifient tant soit peu en cours de route. En se complexifiant, elles prennent des nuances qu’on n’envisageait pas au préalable. Le contraste violent du noir et du blanc sur la photo s’atténue et se charge de dégradés de gris qu’on n’apercevait pas en restant à distance.
J’imagine que c’est une sorte de règle du jeu : deux personnages publics pratiquent ici une mise en scène de soi. Mais on verra que la tonalité de l’un n’a rien à voir avec la tonalité de l’autre, même s’ils affirment essayer d’établir des passerelles : l’impression dominante, au sortir du livre, reste celui d’une distorsion. Une distorsion peut-être existentielle. Peut-être aussi due au caractère artificiel de toute la démarche.
Ce qui les sépare n'est jamais dit, c'est un signe. Il y a du mondain (du parisien ?) là-dessous. Du consentement. Peut-être de la connivence.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, bernard-henri lévy, ennemis publics flammarion grasset, tarte à la crème, noël godin, le gloupier, entarteur, pierre desproges, michel denisot, salon du livre, bhl, henri chapier, chanoinat georges lautner castaza, on achève bien les cons, les tontons flingueurs, parodie, satire, humour
mercredi, 08 avril 2015
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE 3
3/3
 Nous parlons de Daniel1, de sa formidable réussite professionnelle, de ses déconvenues sexuelles et sentimentales tout aussi remarquables.
Nous parlons de Daniel1, de sa formidable réussite professionnelle, de ses déconvenues sexuelles et sentimentales tout aussi remarquables.
Il est vrai que les quarante-sept ans qu’il affiche au compteur commencent à peser. Mais incapable de se faire à l’idée de la déréliction sexuelle qui accompagne la venue de l’âge, il repique, comme Isabelle l'avait prédit, avec une jeunette « libérée » de vingt ans, Esther, splendide femelle un peu droguée et partouzarde, un peu actrice, qui lui donne un plaisir fou, très douée au lit, mais avec laquelle Daniel1 fait l’expérience terrible et douloureuse de l’amour absolu quand il n’est pas payé de retour.
Les réflexions sur l’âge se situent non loin du centre de gravité du roman. Il est entendu que la grande affaire du sexe masculin est le bonheur par le plus grand épanouissement sexuel possible. Que les personnes les plus aptes à le procurer sont les jeunes et jolies filles, si possible pleines d'appétit de plaisir et armées de l'irremplaçable minijupe (jeunes filles qui se réduisent quand les hommes prennent de l'âge à des seins et à des touffes offerts à la vue sur la plage – mais assortis de l’impérieux "Pas touche !". T’es plus dans le coup, pépé. Je précise que tout ça est dans le livre).
C’est vrai que la sève masculine s’assèche et raréfie avec le temps, mais surtout, et surtout plus vite que chez les hommes, la peau féminine ne tarde pas à ressembler à une étoffe tout juste bonne pour la friperie, à la pelure d'une pomme qui a passé l'hiver au frais sur sa claie, et la chair féminine, avant même les quarante, a tendance à gondoler, à se boursoufler et ramollir, à obéir de plus en plus fatalement à la loi de la gravitation.
Comme le dit ailleurs l’auteur (je vais tâcher de retrouver où, je ne garantis rien), le culte de la beauté, qui entraîne le culte de la jeunesse, a quelque chose de totalitaire, voire d'un peu nazi. La force de Houellebecq romancier est dans l'impavidité avec laquelle, à partir d'une donnée, il déroule jusqu'à son point ultime la chaîne inéluctable des causes et des conséquences. Houellebecq s'étonne de la pusillanimité de ceux qui, élaborant un raisonnement, sont pris de panique devant la conclusion à laquelle la simple logique les conduit. Cela peut-être qui froisse les susceptibilités en haut lieu.
La civilisation occidentale, en faisant de la beauté corporelle un idéal inatteignable dans la durée, a condamné l’humanité à la compétition impitoyable, à la tristesse et à la dépression. Avouons qu’il y a perspectives plus gaies.
Comme le disent les personnages de Houellebecq : il ne fait pas bon vieillir dans ce monde. Plus l'être humain avance en âge, plus il est en butte au Mal et à la souffrance. A lire les journaux, on ne saurait lui donner tout à fait tort (ci-dessous). Voilà, pourrait-on presque dire, à quoi se résume le traité d'anthropologie (mâtinée de philosophie) dont Michel Houellebecq a fait un roman.

Vous êtes sûrs d'avoir envie de finir « entourés » de cette façon ? Ça vous donne vraiment envie d'arriver à cent ans ?
Non, il ne fait vraiment pas bon vieillir.
Houellebecq, je vais vous dire, j'ai comme l'impression que ses bouquins opèrent sans fausse pudeur et sans hypocrisie ce que les psychanalystes appellent un violent et puissant « Retour du Refoulé ». Et les bien-pensants, ça, ils n'aiment vraiment pas. Finalement, il détestent qu'on leur dise la vérité.
Ils ont le Balzac qu'ils méritent.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j'ai oublié de mentionner la belle place que donne Houellebecq à la poésie dans son livre. Révélatrice en ce qu'elle est (sauf erreur de ma part, j'ai la flemme de vérifier) l'apanage exclusif des créatures néo-humaines sur lesquelles le bouquin se referme (mais c'est faux : il reste le très étonnant chapitre intitulé « La possibilité d'une île »), expliquant le choix du titre, et montrant (peut-être) que l'idée de la joie et la quête de l'amour sont inscrites, comme un ultime espoir, au cœur du cœur inexpugnable des hommes. Indéracinable :
« Ma vie, ma vie, ma très ancienne
Mon premier vœu mal refermé
Mon premier amour infirmé,
Il a fallu que tu reviennes.
Il a fallu que je connaisse
Ce que la vie a de meilleur,
Quand deux corps jouent de leur bonheur
Et sans fin s’unissent et renaissent.
Entré en dépendance entière,
Je sais le tremblement de l’être
L’hésitation à disparaître,
Le soleil qui frappe en lisière
Et l’amour, où tout est facile,
Où tout est donné dans l’instant ;
Il existe au milieu du temps
La possibilité d’une île » (p. 433).
Est-ce que ce n'est pas beau ? Est-ce que Houellebecq ne serait pas, tous les comptes remis à zéro, un idéaliste ? Amer et déçu, c'est possible, mais un idéaliste ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, la possibilité d'une île, éditions fayard, poésie
mardi, 07 avril 2015
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE 2
2/2

La « philosophie » de Daniel1, le comique de profession, est simple : « Ma carrière n’avait pas été un échec, commercialement du moins : si l’on agresse le monde avec une violence suffisante, il finit par le cracher, son sale fric : mais jamais, jamais il ne vous redonne la joie » (p. 164). Et de l’argent, il en a gagné plus que sa dose (quarante-deux millions d’euros, Houellebecq pense-t-il à quelqu’un de réel ? Y aurait-il, fût-ce fortuitement, une ressemblance avec une personne existante ?).
Quoi qu’il en soit, Daniel1, par honnêteté, et de moins en moins motivé par la création de ses spectacles, jusqu'à n'en plus rien avoir à foutre, se pose la question existentielle : tout ça vaut-il la peine de se donner encore la peine ? S’il a du mal à s’y résoudre, il finit par répondre, après avoir descendu la pente, un « non » aussi franc que décisif et désespéré.
Heureusement, si l’on peut dire, il a fait entre-temps la connaissance de Patrick, le grand-prêtre (le « Prophète ») de la secte baptisée Eglise Elohimite, grossier décalque de la secte raëlienne de Claude Vorilhon, le fada qui a rencontré, dit-il, les extra-terrestres sur un volcan d'Auvergne (je précise que je parle par ouï-dire : je ne voudrais pas que).
On a déjà rencontré les raëliens dans Lanzarote (2002). Dominique Noguez l’évoque dans son bouquin sur Houellebecq : l’auteur s’est un peu frité avec Raphaël Sorin, directeur de je ne sais quoi chez Flammarion, qui, ne voulant prendre aucun risque juridique, voire judiciaire, réclamait un nom fictif. Il paraît que Houellebecq avait envisagé de la rebaptiser en secte des "Raphaëliens", pour se venger.
Les Elohim ? Mais si, vous savez bien, ce sont ces entités qui ont créé l'humanité : ils ont décidé de reprendre contact avec elle parce qu'elle est arrivée à un stade satisfaisant de développement technique. Le sort tomba sur Claude Vorilhon, par eux renommé Raël. Je n'ai pas vérifié dans les fichiers de l'INPI si la marque était libre de droit, mais j'imagine que Raphaël Sorin craignait un grabuge.
Raël et ses fidèles ne prétendent à rien de moins que d’acquérir l’immortalité : vous adhérez à l’Eglise, on prélève et on stocke votre ADN, et l’on attend que les biotechnologies aient rendu possible le clonage de votre personne à partir de votre double hélice composée d’AGCT (Adénosine, Guanine, Cytosine, Thymine). Alors, c'est promis, vous ressusciterez.
Qui plus est, vous ressusciterez à un âge où l'on est en théorie débarrassé de toutes les tribulations pénibles (parents, éducation, scolarité, puberté, apprentissage sexuel, tout ça) qui encombraient l'être humain entre zéro et vingt ans. Et ainsi indéfiniment, jusqu'à l'achèvement des temps (l'expression « consommation des siècles » (Mt. XXVIII, 19-20) n'étant plus disponible, préemptée et déposée de plus longue date par l'un des principaux concurrents de Raël). Quoi qu'il en soit, une variante non chrétienne de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle les adeptes élohimites n'ont aucune répugnance à se suicider le moment venu. On n'est pas pour autant dans la mécanique mécaniste et anthropophage de Soleil vert.
C’est ce que fera Daniel1 pour finir. Mais en attendant, sa célébrité en fait un VIP, que le « Prophète » se fait un plaisir et un honneur (en plus d’un argument de propagande) d’inviter, d’abord en Herzégovine, puis à Lanzarote, une île des Canaries au climat favorisé. L’occasion rêvée pour observer de l’intérieur le fonctionnement d’une secte, avec ses adeptes fascinés et béats devant le charisme du « Prophète », avec les lieutenants de celui-ci, que le visiteur rebaptise « Flic » et « Savant », l’un chargé de tout ce qui est organisation, l’autre de tout ce qui touche à la recherche en génétique, et dont le laboratoire, dans ce domaine, n’a pas de rival dans le monde.
Inutile de dire que le « Prophète » use de son charisme pour grouper autour de lui un certain nombre de « fiancées » plus accortes et avenantes les unes que les autres et toujours disposées à lui prêter l’orifice qu’il souhaite honorer.
Il en profite à l'occasion, quand il trouve une adepte particulièrement à son goût, pour aller librement à la pêche dans le cheptel féminin qui se met spontanément à sa disposition, pour désigner l'heureuse élue de son désir qui recevra la faveur de l'accompagner au dodo.
En général, le compagnon attitré de l’élue ressent le choix du maître comme un immense honneur, mais il suffit parfois d’un Italien particulièrement amoureux, jaloux et irascible pour accélérer brutalement le cours des choses.
Je répugne à résumer l’action du livre. Qu’on sache simplement que Daniel1, s’il a amassé grâce à ses talents de provocateur une fortune confortable, finit par n’éprouver dans sa vie privée que des déconvenues. D’abord pleinement heureux ("heureux" voulant dire pour Daniel1 "sexuellement épanoui") avec Isabelle, qui « bosse dans des magazines féminins » (p. 33) et qu’il a épousée, la répétition émoussant le sensation, il se lasse. Ils se quittent courtoisement : elle se contente de sept millions d’euros.
On n’est pas plus raisonnable.
Voilà ce que je dis, moi.
Désolé, ce n'est pas encore tout. Suitetfin demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, la possibilité s'une île, prophète, élohim, raël, raëliens, claude vorilhon, lanzarote houellebecq, raphaël sorin, éditions flammarion, dominique noguez, houellebecq en fait, adn, agct, évangile selon saint mathieu, soleil vert
lundi, 06 avril 2015
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE 1
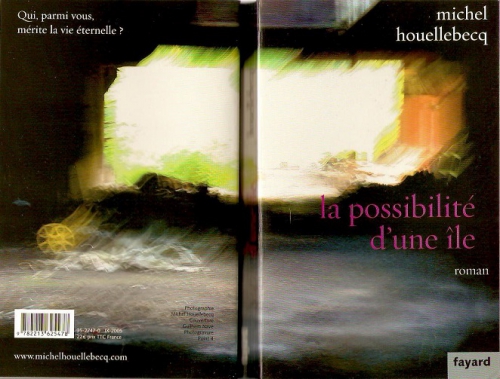
La photo de couverture est de Michel Houellebecq.
1/2
Houellebecq, je m’y suis mis tout récemment. J’étais rebuté par, pour le dire vite, le « battage médiatique » qui entourait la parution de chaque roman : deux camps s’affrontaient, parfois en paroles « musclées ». Tout ce bruit et cette fureur me paraissaient de mauvais augure. Je voyais dans ces affrontements je ne sais quel goût de l’auteur pour le monde « spectaculaire-marchand » et le feu des projecteurs. Je croyais que le fonds de commerce de l'écrivain « controversé » consistait à épater la galerie. J’avais tort.
Si les projecteurs se sont braqués sur Michel Houellebecq, la personne de l’auteur n’y est pour rien, mais bien ses livres. Que la personne, ensuite, se soit prise au jeu, c’est possible. Je le dis nettement : de cela, je me fous désormais éperdument.
C’est en voulant en avoir le cœur net que j’ai lu La Carte et le territoire (2010). C’était à l’été 2011 : mieux vaut tard que jamais. Ce fut immédiat, jubilatoire et lumineux : un très grand livre, d’un grand écrivain français. Enfin un roman qui parle du monde comme je le perçois, tellement malade. L’écrivain majeur de notre temps, loin devant tous les autres. Du coup, j’ai aligné dans la foulée Les Particules élémentaires (1998) et Plateforme (2001). Extension du domaine de la lutte (1994) a suivi à quelque temps de là. Inutile d’ajouter que le 6 janvier dernier, voyant Soumission sur un étal de librairie, je n’ai fait ni une ni deux (voir mon billet du 16 janvier).
Un sixième roman manquait à mon tableau de chasse : La Possibilité d’une île (2005). Dix ans après parution, je viens de corriger cet oubli impardonnable. C’est un gros livre (près de 500 pages). Je n’ai pas été déçu. D’une certaine façon, il est annoncé dès Les Particules …, et certains de ses passages annoncent étonnamment Soumission. On se rappelle que les travaux du savant Michel Djerzinski, à la fin des Particules …, rendent possible le clonage reproductif des humains.
Le « dispositif narratif » dépayse tout d’abord le lecteur : qui est Daniel24 ? Sur quoi fait-il un « commentaire » ? Et puis qui est ce Daniel1, qui semble contredire le titre de la 1ère partie ? Cela surprend, mais on s’y fait vite. Le livre est ambitieux, peut-être plus difficile d’accès, à cause tant du dit dispositif faisant alterner le « récit de vie » de Daniel1 et le « commentaire » de Daniel24 (puis Daniel25), que du thème ici exploré, qui tourne autour de la déception amère que procure l’existence humaine et de la quête d’immortalité qu’elle suscite.
On ne tarde pas à comprendre que Daniel24, plus tard Daniel25, est l’exacte réplique, à deux millénaires de distance, de Daniel1 : le clonage imaginé par Djerzinski dans les Particules … a permis la création d’une nouvelle espèce : les « néo-humains », qui n’a rien à voir avec l’ancienne humanité, dont les survivants de la grande extermination sont très vite retournés à l’état sauvage, primitif, rudimentaire.
Daniel1 a fait fortune en faisant le clown : les sketches comiques et scénarios, dont il faisait le clou de ses spectacles et de ses films avec un succès retentissant, portaient des titres comme « Broute-moi la bande de Gaza », « Deux mouches plus tard », « Le combat des minuscules », « On préfère les partouzeuses palestiniennes », et d’autres tout aussi suggestifs. Plus il provoquait, plus le succès grandissait.
Le choix du métier d'humoriste pour son personnage n'est certainement pas, de la part de Houellebecq, dû au hasard. On pensera aujourd’hui, bien sûr, à Dieudonné, mais il n’avait pas autant fait parler de lui en 2005. Rien de mieux qu'un « humoriste professionnel » pour mettre en scène la dérive subie dans notre monde par la fonction accordée au rire. Je pense au rôle purement instrumental que les médias de masse assignent aujourd’hui à l'hilarité. Rien de plus lugubre à mon avis que ces fantoches pas drôles, payés pour déclencher les rires, toujours mécaniques, même quand ils ne sont pas enregistrés.
Car avec les titres ci-dessus, Houellebecq met sur la scène romanesque une provocation à l’état pur, qui ricoche curieusement sur l’état actuel du comique médiatique entretenu à heure fixe par tout un tas de sinistres individus qui sévissent sur les plateaux pour « animer » des émissions et faire rire un public d’avance acquis à « la cause du rire ».
La grève à Radio-France m’a incidemment amené, consterné, à écouter, catastrophé, RTL : rien par exemple de plus ridicule que ces gens, réunis autour de la table d’un petit studio, qui font semblant de se tenir les côtes en écoutant les calamiteuses prestations routinières de Laurent Gerra. Atterré, j'ai tourné le bouton (vu les appareils actuels, c'est une image).
Le plus inquiétant est que les gens plébiscitent et redemandent de cette soupe. Sans doute pour ça qu’il y a des écoles pour la formation des désespérants « Nouveaux Comiques ». Je suis à côté de la plaque. Pas de ce monde-là. J’espère ne pas être le seul à crier grâce. Rien de plus lassant que ce métier de faire rire pour faire rire (décompresser, déstresser, soupape de sûreté, …). Coluche (pas toujours) et Desproges, eux, avaient un regard sur le monde et les gens.
Le rire est désormais un produit de consommation de masse, comme les autres compartiments de l’existence humaine, qui semblaient jusqu’il y a peu protégés par une cloison qui leur donnait l’aspect d’un vague mystère philosophique, quelque part entre le politique, le social et le médical. Etant entendu, chez les bien-pensants, je veux dire les fidèles qui se massent autour des prêtres, dans l’Eglise de l’Empire du Bien (comment pourrait-on se passer de Philippe Muray ?), qu’on peut rire de tout, sauf (suit la liste des gaz hilarants interdits à la vente).
Daniel1 est finalement un cynique exacerbé : « Finalement, le plus grand bénéfice du métier d'humoriste, et plus généralement de l'attitude humoristique dans la vie, c'est de pouvoir se comporter comme un salaud en toute impunité, et même de grassement rentabiliser son abjection, en succès sexuels comme en numéraire, le tout avec l'approbation générale » (p. 23). J'approuve vivement le mot "abjection".
Daniel1, dans le genre, se présente comme un désespéré fataliste, même si tout le monde lui reconnaît un talent indéniable. A se demander si La Possibilité d'une île n'a pas donné quelques idées à Dieudonné. Le livre ne s'est toutefois pas assez vendu pour cela. Combien d'exemplaires aurait-il fallu qu'il s'en écoule pour qu'on en finisse radicalement avec le métier d'humoriste ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, la possibilité d'une île, la carte et le territoire, les particules élémentaires, plateforme, extension du domaine de la lutte, houellebecq soumission, grève radio france, mathieu gallet, fleur pellerin, rtl, laurent gerra, coluche, pierre desproges, philippe muray, l'emppire du bien, bien-pensants, dieudonné, humoristes
samedi, 04 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
2/2
 Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Disons-le, l’étude du style m’est tombée des mains : un relevé énumératif consciencieux des tournures, formules, termes favoris de l’écrivain. Même si tout est juste et bien observé, c’est tout à fait indigeste, comme un découpage de cadavre à la morgue. Que celui qui est allé à l'école lise ! Comme l'écrit Alfred Jarry dans le "Linteau" des Minutes ... (qui, j'imagine, n'a pas de secret pour Noguez) : « ... car il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ».
L’étude sur le « réactionnaire » supposé est en revanche intéressante, montrant que le concept est brumeux et marécageux à souhait, et qu'il fonctionne comme certains bars, où l'on signale au client : « Ici on peut apporter son manger ». Noguez donne trois ou quatre listes de gens peu recommandables, qualifiés successivement de « réactionnaires » par Daniel Lindenberg (Le Rappel à l'ordre) et quelques autres après lui : certains voisinages sont pour le moins étranges ou inattendus. Si "réactionnaire" est un concept, ce qui n'est pas sûr, il est singulièrement élastique, plastique et déformable dans toutes les sauces idéologiques. Pour autant, l’analyse est-elle efficace ? Peut-elle servir à quelque chose ? Pas sûr.
Les « éléments » du langage mouliné en permanence par les médias privatisés (qui ont contaminé les chaînes publiques, que plus grand-chose n'en distingue) se moque allègrement de ce qu’on appelait autrefois la « justesse des termes » (cela s’appelle aussi la « rigueur intellectuelle »). Le média spectaculaire régnant (la télévision) se contente de la vitesse et de l'éclat de l’expression, au mépris de son poids, de son exactitude et de sa profondeur. La catastrophe « Philippe Sollers » a triomphé. Briller est un impératif.
Je crois, monsieur Noguez, qu’il ne sert à rien de définir le mot « réactionnaire » : tout le monde s’en fout. Son rôle est de servir de flash (de piquouse), d’étiquette, d’identifiant immédiat, de blason, d'étendard, voire de mot de passe. Bientôt peut-être de lieu de détention.
C’est la tâche de purification lexicale assignée par les tenants de la nouvelle « bien-pensance » (p. 252) à quelques projectiles fabriqués spécialement à l'intention des survivants de l’esprit critique et de la liberté de penser (qu’il suffit, pour les disqualifier, de désigner « facho », « macho », « réac », « sexiste », « homophobe », et j’en passe). S’attarder sur le contour du mot « réactionnaire », je vais vous dire, c’est du temps perdu. Dans un duel arme au poing, l’explication rationnelle et argumentée est programmée pour échouer.
Dominique Noguez est écrivain. Je n’en doute pas. Pas plus qu’il ne doute des qualités de son livre Les Derniers jours du monde. Je dirai ce que j’en pense quand je l’aurai lu. Mais, comme Daniel1, le personnage de La Possibilité d’une île, il est foncièrement honnête (bien que j'ignore l'extension sémantique exacte du mot "foncièrement" dans ce contexte) où on lit : « ... j'étais, par rapport aux normes en usage dans l'humanité, d'une honnêteté presque incroyable » (p. 400), phrase qui sonne a posteriori comme une déclaration de théorie littéraire.
Car Houellebecq lui-même est honnête, en ce que ses livres ne se racontent pas d'histoire. Etonnant comme ses fictions romanesques semblent porteuses d'une vérité très nue, presque écorchée (peut-être ce qui le rend insupportable aux yeux de beaucoup). Houellebecq déclare ainsi à Frédéric Martel : « Je connais les réponses simples, celles qui vous font aimer de tous (…) ; si je ne les emploie pas ce n’est pas par provocation, mais par honnêteté » (cité p. 252). Noguez est donc honnête : il reconnaît que Houellebecq est un plus grand écrivain que lui. Il n’est pas jaloux. Il a au moins ce mérite, et cela m’incite à aller y voir de plus près.
Il écrit d’un roman de M. H. (Extension du domaine de la lutte) : « Après trois lectures, je tiens que ce roman est un des plus grands d’aujourd’hui. Je dis bien "d’aujourd’hui". Je n’en vois pas en effet qui disent mieux un certain nouvel air du temps – du temps social et économique – que celui-là » (pp. 29-30). Il écrit ça en 1994, c’est-à-dire avant Les Particules élémentaires, avant La Carte et le territoire. Je regrette quant à moi de l’avoir lu après ces deux livres, beaucoup plus forts et accomplis, auprès desquels Extension … fait un peu pâle figure, tout en tenant fort bien son rang : l’univers maintenant bien connu de l’auteur est déjà pleinement présent.
Noguez, tenant son journal, montre donc qu'il est intervenu en faveur de Michel Houellebecq, dans la presse comme critique, au tribunal comme témoin de la défense. Il lui écrit aussi des lettres, où il note ses impressions de lecture, par exemple sur Les Particules ….
Le procès intenté contre l’auteur de ce roman à parution ajoute au ridicule du motif le contradictoire de la chose : un directeur réclamant l’anonymat pour le camping qu’il dirige reproche à M. H. de donner des informations qui permettent de le reconnaître et situer. Evidemment, l’action en justice donne une publicité énorme à ce qui serait resté inaperçu et cru fictif s'il avait fait le mort. Conclusion de Noguez : « Cela ressemble fort à une opération publicitaire faite sur le dos de la littérature » (p. 62). Auguste en personne aurait dit « tout juste ».
Le procès intenté par Dalil Boubakeur, de la grande mosquée de Paris, suite à la publication de Plateforme, est plus crucial et plus révélateur. Houellebecq islamophobe ? Et alors, quand bien même ? Ne pas aimer l'islam est un droit, que je ne me prive pas d'exercer pour mon propre compte, moi qui suis, de façon générale, religio-incompatible. Noguez écrit : « Avoir un avis sur les religions, préférer l’une à l’autre ou les rejeter toutes relève de la liberté d’expression la plus élémentaire dans une démocratie comme la nôtre » (p. 211). Je ne peux qu’approuver. J'irais même volontiers plus loin, jusqu'à paraphraser Lino Ventura dans Les Tontons, à propos de Claude Rich, le petit ami de sa protégée : « ... il commence à me les briser menu ».
Et Noguez de rappeler que M. H. n’est pas le premier à traiter l’islam de « religion la plus stupide », avec des citations de Montaigne, Pierre Charron, Pascal, Spinoza, Tocqueville, etc. (p. 210). Voltaire n’a-t-il pas écrit une pièce de théâtre intitulée Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète ? Jusqu’au respectable Claude Lévi-Strauss qui y voit « une religion de corps de garde » (p. 211, ce que l’actualité nous confirme tous les jours).
Là où j'ai le grand plaisir de me retrouver en bonne compagnie, dans ce livre, c’est chaque fois que Dominique Noguez aborde la question de la « bien-pensance » et de l’ambiance policière qu’elle tend à instaurer dans le monde de la pensée, de la création et de l’expression, amalgamant sans sourciller des actes répréhensibles ou délinquants et des personnages éventuellement déviants, mais pures créatures fictives. Noguez se paie en passant Claire Brisset, la « Défenseure » (!) des enfants, « une folle avérée » (p. 176, mais il ne la nomme que trois pages plus loin – par prudence ? –, je précise que c’est moi qui interprète) : certaines formules font du bien, c’est sûr. Du coup, on se sent moins seul.
Là aussi où j’ai l’impression de trouver une « tribu » où je puisse me sentir un peu moins mal dans mon époque, c’est en apprenant que Dominique Noguez a donné une conférence intitulée « Le livre sans nom » (BNF, 15 décembre 1999), qu’il évoque dans la note 48 (p. 165) : « J’y donnais, comme explication de la multiplication actuelle des procès en matière de littérature, "l’immense privatisation de tout à laquelle on assiste depuis une douzaine d’années" dans les sociétés occidentales capitalistes ou, plus exactement, dans la manière dont elles se donnent à voir. "Tandis que la fiction romanesque semble saisie d’un appétit de plus en plus grand de réalité, ajoutais-je, la réalité qu’elle veut ingurgiter se privatise et se dérobe. Il n’y a plus de nature, il y a des propriétés privées ; plus de pays, mais des multinationales ; plus de ville, mais des chaînes de magasins et des marques ; plus de foule, mais des individus qui peuvent interdire ou monnayer leur image." (Publié dans La Nouvelle Revue Française n° 555, octobre 2000) ». Je salue l'expression "l'immense privatisation de tout". Les curieux peuvent se reporter à mon billet du 17 mars, où j'évoque « La Grande Privatisation de Tout » (GPT pour les intimes). Depuis la publication de Houellebecq, en fait, il y a douze ans, Noguez à dû pouvoir constater la nette aggravation du processus. Mais quand même, ça fait plaisir de se retrouver en pays de connaissance. Je me dis : chouette, encore un que Laurent Joffrin ne doit pas porter dans son cœur !
Tiens, à propos de Laurent Joffrin, voici ce qu’on lit p. 229, à propos d’un article sur « les nouveaux réactionnaires » : « Pour sa phrase sur l’islam, "l’excellent Laurent Joffrin", explique-t-il [il s'agit de Houellebecq], l’a traité dans Le Nouvel Observateur de "beauf lambda" ». J’imagine que la phrase en question est celle où il qualifie l’islam de « religion la plus stupide » (voir plus haut). Je renvoie à mes deux billets consacrés à ce monsieur. Houellebecq et Noguez doivent se dire, à la façon de Courteline : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Si j’étais à leur place, c’est en tout cas ce qui me viendrait à l’esprit. Avec délectation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, houellebecq en fait, réactionnaire, lindenberg les nouveaux réactionnaires, alfred jarry, minutes de sable mémorial, philippe sollers, les derniers jours du monde, la possibilité d'une île, frédéric martel, extension du doomaine de la lutte, les particules élémentaires, la carte et le territoire, dalil boubakeur, grande mosquée de paris, plateforme, voltaire, le fanatisme ou mahomet le prophète, islam, claude lévi-strauss, claire brisset, laurent joffrin, le nouvel observateur
vendredi, 03 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
1/2
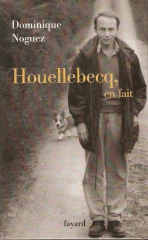 Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.
Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.
Le point commun entre Bernard Maris et Dominique Noguez, c’est qu’ils ont publié des choses sur Houellebecq, mais il m’étonnerait fort que leurs liens aient été très étroits. Je ne sais rien de la vie privée de Bernard Maris, mais je ne le vois pas fréquenter les mêmes cercles que Noguez. J’ai évoqué ici Houellebecq économiste (11-12, puis 29-30 mars), écrit par le premier. Je viens de lire Houellebecq, en fait, du second. Je n’aurais peut-être pas dû.
Je l’avoue, je ne connaissais rien de l’œuvre littéraire de ce monsieur. J’ai découvert que, comme il a travaillé sur Alfred Jarry, il ne saurait être entièrement mauvais. En effet, si j’en crois la rubrique « Du même auteur », il a publié L’Arc-en-ciel des humours. Jarry, Dada, Vian, etc..
Jarry, c’est bien, c’est la ‘Pataphysique, c'est l'invention du Curateur Inamovible du Collège, un Docteur riche de vingt-sept chefs d'œuvre de la littérature en butte aux tracasseries d'un huissier au nom inoubliable ; un Docteur qui pisse dans des bateaux qui flottent tout en étant percés ; un Docteur qui va "de Paris à Paris par mer" tout en restant sur la terre ferme, tout en persécutant un singe papion intitulé Bosse-de-Nage et qui ne sait dire que "Ha ha", bref : quelqu'un de bien.
Vian, ce n’est pas mal, bien que ce soit, en 'Pataphysique, une pièce rapportée. Son Mémoire concernant le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses est finalement bien laborieux, comparé au chapitre "De la surface de Dieu", dans le Faustroll de son glorieux prédécesseur.
Je ne peux m'empêcher de voir dans Boris Vian ou Raymond Queneau des écrivains surévalués (une certaine idée de la modernité, tout ça ..., pardon aux mânes de Noël Arnaud), mais bon, admettons ; en revanche, pour Dada, je me demande un peu ce qui lui prend, à Noguez : pas de vide humoristique plus abyssal que chez Dada (ainsi que chez André Breton). Mais j’irai sans doute mettre le nez dans son bouquin : je ne demande qu’à m’instruire.
En attendant, l’ouvrage qu’il consacrait à son ami Houellebecq en 2003 m’a somme toute intéressé, même si j’ai des reproches à lui faire. D’abord, je regrette d’avoir découvert quelques aspects de la personne privée de Michel Houellebecq. La peste soit de la "société du spectacle" et de tous les Gustave Lanson ou Bernard Pivot, l’un parce qu’il a fait de la loi dichotomique de « L’homme-et-l’œuvre » un parcours obligé, l’autre à cause de sa manie d’interroger les écrivains qu’il invitait sur son plateau sur la part d’eux-mêmes qu’ils avaient mise dans leurs livres de fiction, vous savez, ces bouquins qui portent sur la couverture la mention "roman".
 Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».
Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».
Quand la vie et la personne d'un artiste deviennent un spectacle, son œuvre a du mouron à se faire pour son avenir : qu'y a-t-il de plus futile et combustible que la vie d'un individu, fût-il artiste ? Depuis l'aube de la curiosité humaine pour le monde, ce qui reste d'un individu, c'est son œuvre. Et encore : la plupart sont purement et simplement effacés de la surface et des mémoires. Le "devoir de mémoire" est une fumisterie.
Je me contrefiche d’apprendre quoi que ce soit d’autobiographique sur le bonhomme qui a tenu la plume : je sais pertinemment qu’un auteur se sert forcément, pour écrire un roman, du matériau qu’il connaît le mieux (quoique …) et qu’il a le plus directement à disposition sous la main : lui-même.
Les plus grandes œuvres de l'art et de la littérature sont composées à 100 % du bonhomme, auxquels s'ajoutent les 100 % de l’art qu’il y a déployé. Aux petits comptables, aux Lagarde-et-Michard, aux chefs de bureau et aux médecins légistes de faire ensuite le départ et de disséquer. La littérature commence après la question : qu’en a-t-il fait, de ce matériau ? Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée ? Quel édifice a-t-il construit ? De quelle œuvre est-il l’auteur ?
Étonnant comme les animateurs, journalistes, "critiques", dans les "talk shows" (pardon) qui jalonnent la « tournée de promo » obligatoire, sont capables d’interroger les écrivains sur ce qu’ils sont (personnalité, penchants, musiques et yaourts préférés et autres fadaises genre questionnaires Proust) éprouvent, aiment, détestent, pensent, mais rarement sur ce qu'ils font, je veux dire sur les caractéristiques proprement littéraires du livre qu’ils viennent d’écrire.
La littérature n'intéresse guère les critiques littéraires. Ils veulent du vivant, de la tripe, du saignant. Au fond, le spectacle télévisuel qu'a fini par imposer "Apostrophes", a définitivement donné la priorité à « l'homme » sur « l'œuvre ». Et parmi les invités de Pivot, priorité au meilleur camelot vendeur de salade (à preuve les ventes en librairies dès le lendemain).
Voilà le rideau que je regrette d’avoir soulevé sur la personne privée qu’est Michel Houellebecq, d’autant qu’en plusieurs occasions, l’écrivain est loin d’être présenté à son avantage (l’état dans lequel il s’est mis quand il entre au "Queen", sur les Champs-Elysées !). Parfois, c’est même pire. A cet égard, je me permets de trouver ce livre bien indiscret. De la part d’un qui se dit son ami, c’est plutôt malvenu, je trouve.
Le deuxième reproche que je fais à Noguez, c’est de montrer les coulisses du petit bocal où évoluent les cyprins de la littérature parisienne : repas en ville, réceptions, soirées, copinage en bande, éditeurs, organes de presse, impression que tout le monde se connaît. J’imagine que l’auteur, par son ancienneté dans le métier ou par ses fonctions dans la profession, a tissé des relations multiples. La description des mœurs de ce petit monde parisien, avec énumération des gens présents ou rencontrés, rend celui-ci tout au plus antipathique. On n'est parfois pas loin de la rubrique mondaine et des pages "pipeul".
Je me moque éperdument de croiser au détour des pages des gens comme Arnaud Viviant, le péremptoire rayonnant du Masque et la Plume. Par curiosité, on peut se reporter au traitement de faveur que le grand Philippe Muray fait subir à ce « roquet des Inrocks » dans Après l’Histoire II (Essais, Belles Lettres, p. 451-452). Sa majesté Philippe Sollers a lui aussi une place de choix dans le bouquin : rien que le nom de ce type me rendrait presque la lecture pénible. Bon, c’est vrai que ces messieurs font partie des défenseurs de Houellebecq. Je me demande bien pour quelle raison.
Pour moi, Houellebecq et Sollers n'ont pas grand-chose à faire sur le même plateau. Mais peut-être qu'après tout, le second reconnaît en le premier un maître. Allez savoir.
Je ne parle pas de Viviant. Evidemment.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, particules élémentaires, bernard maris, houellebecq économiste, houellebecq en fait, l'arc en ciel des humours, docteur faustroll, bosse-de-nage, pataphysique, collège de pataphysique, boris vian, raymond queneau, noël arnaud, dada, dadaïsme, gustave lanson, bernard pivot, lagarde et michard, jean nouvel ycone, lyon la confluence, devoir de mémoire, questionnaire proust, émission apostrophes, philippe sollers, philippe muray, arnaud viviant, les inrockuptibles
jeudi, 26 mars 2015
BERTRAND REDONNET, AUTEUR
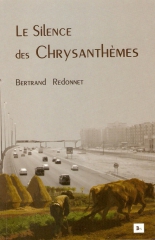 2/2
2/2
La place qu’occupe Bertrand dans la fratrie est une place à part. Au milieu de ces « manards » que sont ses frères, futurs artisans, ouvriers ou paysans, il fait figure d’ « intello », il passe du temps à lire et à écrire. L’auteur consacre des pages parfois ferventes aux relations étroites qu’il entretient et cultive avec ces deux activités, et rend hommage à l’instituteur qui lui a montré « le chemin à suivre » et qui lui permet, en se retournant sur son parcours d’affirmer : « … J’ai toujours eu l’impression de n’obéir qu’à moi-même » (p. 89). Autrement dit : c'est à l'école qu'on apprend la liberté individuelle : bel éloge de l'école d'avant l'effondrement.
Bertrand Redonnet retrace quelques scènes de cette vie campagnarde d’avant la mécanisation de l’agriculture et des hommes qui la font (le cochon, le repas familial, les relations avec les voisins, l’entraide au moment des travaux). Il évoque surtout cette vie de liberté en contact direct avec les éléments et la nature, avec ses côtés aventureux à l’occasion, avec ses bambées dans les chemins, ses grimpées aux arbres, bref, l’enfance insouciante et banale de tous ceux qui ont eu la chance de connaître ce monde et qui ont du mal à considérer la modernisation autrement que comme un saccage.
Pas de nostalgie pour autant : constater que les conditions d’existence se sont appauvries, enlaidies et compliquées, ça ne se réduit pas à regretter « le bon vieux temps ». Déplorer l’état de la réalité qui nous est faite n’a rien à voir avec le refrain : « C’était mieux avant ». Tout dépend de l’attitude. Celle de l’auteur fait une bonne place à la réflexion sur le monde comme il va mal. La colère face à ce que les hommes du présent font du monde et de l'humanité ne se réduit pas à la nostalgie pour le paradis perdu, l'enfance, le temps passé.
Certains épisodes retiennent l’attention, drôles ou plus dramatiques. Les frères qui se fabriquent un radeau "insubmersible" pour naviguer sur la rivière voisine ; l’auteur qui se fait prendre par les gendarmes avec la boîte d’allumettes dans la poche, après qu’une meule de foin a brûlé, acte qui plonge la mère dans la honte et fait passer le gamin pour dangereux auprès de tout le monde ; le séjour au pensionnat, avec la première autorisation de sortie accordée le jour de la Toussaint, qui donne son titre au livre (p. 71).
Là où l’auteur établit une sorte de cousinage avec le lecteur que je suis, c’est dans la référence à Georges Brassens, constante, souvent signalée comme telle, mais souvent aussi plus indirecte et souterraine, au travers de citations plus ou moins explicites, mais pas toujours. La première, par exemple : « Il est à la fois aurore et crépuscule et son hymen avec les ténèbres lui est promis dès le premier souffle » (p. 16). Ceux qui ne connaissent pas « Oncle Archibald » n’y verront que du feu (« Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême »).
On trouve encore « Erreur on ne peut plus funeste » (L’orage, p. 24) ; « un arbre " nullement de métier" » (Le grand chêne, p. 43) ; « j’abandonnai la partie, mais "sur le chemin du Ciel ne feignis plus jamais de faire un pas" » (Le mécréant, p. 69) ; « Le cœur serré, j’espère que le croque mort qui t’a emporté a eu l’infinie bonté de te conduire à travers Ciel, au Père éternel ou ailleurs » (L’auvergnat, p. 78, bel hommage au frère mort, qui m’a touché pour une raison personnelle voisine) ; « ... et je n'en souffre pas avec trop de rigueur » (La tondue, p. 178) ; « champ de navets » (Le vieux Léon, p. 140).
J’arrête là : je n’en finirais pas. J'ajoute quand même que Redonnet a écrit un Georges Brassens, poète érudit, ce qui explique la présence du chanteur dans le récit, en filigrane, mais aussi en personne, un peu partout. Disons-le : sans avoir étudié la question au même degré, je me suis trouvé en pays de connaissance. Comme l'auteur, je suis du genre à suer du Brassens par tous les pores de la mémoire.
Chacun des quinze chapitres qui composent le livre de Bertrand Redonnet est construit selon le principe musical du contrepoint (ou contre-chant, et pourquoi pas contrechamp), et se clôt sur un personnage récurrent : un lundi, jour de marché, un « colosse moustachu » fait irruption dans l'écurie où le gamin attend on ne sait trop quoi, et lui demande s’il a des cordes parce que, dit-il, il va acheter des volailles au marché. Je ne dirai rien de la façon dont s’achève cette série de quinze « flashes », juste du choc, efficace et brutal, qu’elle produit.
La prose de Bertrand Redonnet est d’une belle simplicité, travaillée sans affectation, souvent poétique, et donne de la saveur à cette visite dans la campagne poitevine. L’auteur ne déteste pas les régionalismes qui lui reviennent : métives, détervirer, … même si je n’approuve pas des expressions comme « litornes aux abois » (p. 71) ou « des mouches et des taons vampirisés » (p. 50). Ce qui domine, c'est la prose ample. Je recommande les premiers chapitres, particulièrement inspirés.
A lire Le Silence des chrysanthèmes, je n’ai vraiment pas perdu mon temps. Merci, monsieur Redonnet.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, bertrand redonnet, autobiographie, nostalgie, éditions du bug, georges brassens, oncle archibald, chanson, le grand chêne, le mécréant, l'auvergnat, georges brassens poète érudit, le silence des chrysanthèmes
mercredi, 25 mars 2015
BERTRAND REDONNET, AUTEUR
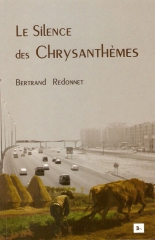
1/2
En même temps qu’elles faisaient paraître La Queue, de Roland Thévenet (voir ici même les 19 et 20 mars), les éditions du Bug publiaient, de Bertrand Redonnet, Le Silence des chrysanthèmes (site et blogs à visiter).
Le curieux de ces sorties simultanées, c’est qu’elles ne sont pas sans parenté thématique, même si le premier opte pour la fiction romanesque alors que le second offre un récit de vie.
Dans l’un comme dans l’autre, ce qui porte l’inspiration a quelque chose à voir avec la filiation paternelle et les origines. Thème : quand le père commence à merder (ou disparaître). Dans le livre de Thévenet, le premier (et l’unique, finalement) père de Félix Sy est Guillaume, le prêtre qui a accepté d’en assumer la garde.
Le magnifique logo des éditions du Bug.
Je conseille en passant aux éditions du Bug, pour leurs futures parutions, de lui donner une visibilité digne de sa qualité esthétique (voir plus haut, et rendu méconnaissable dans l'agrandissement ci-dessous).

Chez Redonnet, le père est le grand absent : « Nous sommes de la diaspora des orphelins et, loin de nous en dépiter, nous nous en nourrissons. – J’ai ainsi eu des centaines de pères » (p. 88). Je m’incline en passant devant la superbe formule « la diaspora des orphelins » : Bertrand Redonnet montre à mainte reprise qu’il possède à l’état aigu le sens du poétique, mieux : du véridique.
De même il dit ailleurs : « J’ai pourtant grandi sans épaules paternelles où déposer mes peurs ». Ça, c'est pour les peurs. Pour les pleurs, il faut l’épaule de la mère, à condition que celle-ci veuille bien les recevoir, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Et pour en finir avec ce thème : « Œdipe facétieux, j’avais éliminé une absence en tuant un père en jupe ».
Cela dit, on n’est pas forcé d’apprécier la référence à l’auteur de la théorie œdipienne, mais bon, qu’il soit entendu qu’on ne tue que rarement le père réel, même si beaucoup en ont rêvé. Il faut croire qu’on a besoin de lui, puisque ceux qui ne l’ont pas connu s'en inventent un capable de remplacer valablement la pièce manquante. Mais tout le monde sait que c'est peine perdue. Il reste que, dans Le Silence des chrysanthèmes, l’absence du père est omniprésente. On peut même dire : l’absence du père prend toute la place qu’il a laissée vacante en disparaissant. Et finit par vous éclater au visage.
Même si le lecteur comprend que le narrateur-auteur est exilé (il tient un blog d'ailleurs intitulé "L'exil des mots") en Pologne, non loin de la frontière orientale, l’essentiel se passe dans le Poitou profond, avant la « Grande Modernisation ». On est dans une ferme à l’ancienne. La mère, sans être présentée comme une « fille à tout le monde » (Brassens, La mauvaise herbe), a fait ses nombreux enfants (seulement des garçons, au nombre de sept) avec différents hommes.
Mais les enfants sont une matière éminemment plastique : ils sont les seuls à prendre la vie « comme elle vient ». C'est ensuite qu'il leur prend l'idée de la corriger, voire de la refaire. Pour eux, le monde ressemble à ce que leur font vivre leurs parents. Les problèmes commencent quand celui des enfants en diffère par trop.
Entre parenthèses, je me demande si l'avenir n'est pas en train de fabriquer des enfants qui seront, non plus "autres" que leurs parents, ce qui est, somme toute, la réalité historique depuis longtemps, mais qui leur seront de plus en plus "étrangers". Il n'y a pas de raison pour que le processus s'interrompe. A celui de l'origine et de la filiation, s'ajoute désormais le problème de la transmission. C'est logique.
Le monde des parents est en train de devenir, aux yeux des enfants, un paysage exotique, vaguement écœurant, dont ils sont en passe de préférer ignorer qu'il a pu exister. Osons le mot : qui est en train de perdre toute existence et toute validité à leurs yeux.
Et qu'on ne me dise pas « Il en a toujours été ainsi ». Ce faux argument n'est que le moyen pathétique (« Tout est dans tout et réciproquement. ») de tous ceux qui refusent de regarder en face ce que toutes les époques présentes ont toujours eu de fondamentalement spécifique, caractéristique, unique, original.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, éditions du bug, roland thévenet, la queue roman, le silence des chrysanthèmes, bertrand redonnet, georges brassens
dimanche, 22 mars 2015
ENCORE MODIANO
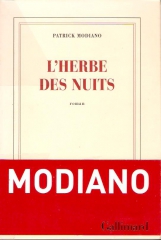 J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).
Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».
De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.
Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !
Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?
Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».
Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.
La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).
J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.
Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.
Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.
Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.
Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.
Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.
L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).
Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.
Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.
L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie
vendredi, 20 mars 2015
ROLAND THÉVENET, AUTEUR
2/2
Les deux parties suivantes font un grand bond en arrière, pour reprendre à son point de départ le parcours extraordinaire du désormais vieillard. On est à Decize, au bord de la Loire, dans la débâcle de juin 1940, juste avant que les ponts soient dynamités pour arrêter la ruée allemande. Félix Sy est né personne ne sait où.
Son père est un Italien, jeune, dont l’identité restera à jamais ignorée. Sa mère est la compagne de l’inconnu. Elle finira par être identifiée. Tous deux ont été trouvés, assassinés, dans une « traction avant », au bord de la Loire. Le nouveau-né vagissait sur la banquette arrière, à côté de « la bakélite d’un accordéon Soprani » (p. 68). Règlement de compte, sans aucun doute : les plaques d’immatriculation ont été arrachées.
Une autre histoire commence alors : celle de ce garçon, dont rien n’annonce, au départ, l'avenir brillant. Pensez, remis entre les mains du curé de la paroisse de Decize, Guillaume Foing, et materné à la demande de celui-ci par « Julienne, sa fidèle sacristaine qui logeait à deux pas » (p. 75), il trouve un drôle de couple de parents improvisés, par un « caprice de la fortune, qui avait fait d’eux, en pleine Occupation, deux parents clandestins » (p. 103). Félix, "fils" d'un prêtre, avouez que. Enfin, il paraît que Baudelaire, déjà ...
C’est là que Félix va grandir dans un milieu aimant, recevoir une éducation attentive, exigeante et profondément catholique, découvrir et cultiver un don exceptionnel, quasi-miraculeux, pour le dessin. Jusqu’à la rupture, le jour où il apprend que Guillaume – un prêtre ! – lui a menti, enfin, n’a jamais eu le courage de lui dire la vérité sur ses origines.
On suit dès lors, par étapes, les aventures mouvementées de Félix, ramené par les gendarmes chez sa grand-mère maternelle, que les recherches officielles ont permis de retrouver (hameau de La Chivas, près de La Clayette - prononcer "la clette"), avec laquelle il entretient des relations robustes et simples.
Puis au château de La Chaize, chez la marquise de Montaigu, à Odenas en Beaujolais, où il se fait embaucher comme jardinier, mais où il se rend bientôt compte que, comme le personnel est à peu près payé à ne rien faire, il peut s'adonner entièrement à sa passion pour le dessin.
 Puis à Paris et bientôt en Amérique, dans le sillage de Jack Kerouac, en qui le hasard des rencontres (le Beat Hotel de Mme Rachou, rue Gît-le-Cœur, ci-contre, ainsi nommé parce qu'il était le rendez-vous des acteurs de la « beat generation ») lui a fait trouver le grand frère qu’il n’a pas eu. Et qui donne à l’auteur l’occasion de livrer un aperçu sur la vie, libre jusqu’au décousu, vagabonde, improvisée, flamboyante et imprévisible, menée par des vagabonds américains de passage à Paris, dont certains devenus célèbres, à travers quelques scènes hautes en couleur.
Puis à Paris et bientôt en Amérique, dans le sillage de Jack Kerouac, en qui le hasard des rencontres (le Beat Hotel de Mme Rachou, rue Gît-le-Cœur, ci-contre, ainsi nommé parce qu'il était le rendez-vous des acteurs de la « beat generation ») lui a fait trouver le grand frère qu’il n’a pas eu. Et qui donne à l’auteur l’occasion de livrer un aperçu sur la vie, libre jusqu’au décousu, vagabonde, improvisée, flamboyante et imprévisible, menée par des vagabonds américains de passage à Paris, dont certains devenus célèbres, à travers quelques scènes hautes en couleur.
Il y a encore Lisa, cette fille qui a perdu ses parents, dont son père, proprement décapité par la Mercedes folle de Pierre Levegh, dans le terrifiant accident survenu aux 24 Heures du Mans, le 11 juin 1955, qui fit plus de 80 morts dans le public : les circonstances historiques sont radicalement différentes, le statut d'orpheline tragique la rapproche de Félix.
Ils s'épousent et feront quelques enfants, jusqu'à ce que Lisa, journaliste chez le populaire et triomphant France-Soir de Pierre Lazareff (« Pierrot-les-Bretelles », cet ennemi supposé du « triste Beuve-Méry » (p. 208), fondateur de l'analytique et donc ennuyeux Monde), prenne une balle perdue à Londonderry dans la colonne vertébrale, lors d'un reportage.
On revient pour finir au vieillard richissime que Félix est devenu, à son étrange disparition et à l’affolement qui a aussitôt gagné tous les étages et toutes les ramifications de l’empire. Un livre, donc, à la construction savante, où chaque partie avance à un rythme qui lui est propre (frénétique au début, lent et posé ensuite, mouvementé pour la partie « américaine », qui m'a personnellement emporté) : une vraie composition musicale en quatre mouvements bien différenciés, du plain-chant quasi-monacal aux stridences ouvrant sur la grande dissonance contemporaine, en passant par Decize, aux sonorités et modulations harmonieuses.
Le lecteur ne doit pas se laisser déstabiliser par la pratique de l'ellipse brutale (au cinéma, parmi les techniques de montage, on appelle ça le "cut up"), qui évite les transitions à rallonge, celles qu'on met pour soigner la continuité et la cohérence du récit, pour maintenir en éveil les lecteurs paresseux. Ce livre aime les lecteurs agiles et toniques.
Un livre, aussi, écrit par un vrai connaisseur de la langue française, qui a fait le pari d’adapter le style de son écriture au contenu du récit – variable donc suivant les moments, comme les couleurs des jours et des saisons, à l'époque où la ville tentaculaire n'avait pas encore imposé l'uniformité de son déroulement imperturbable, aux dépens des inépuisables variations rythmiques d'une vie quotidienne soumise aux aléas météorologiques.
Un livre avec les mêmes pleins et les mêmes déliés élégants et raffinés que ceux de la police « Optima », dessinée à la fin des années 1950 par Hermann Zapf, et dignement réhabilitée par Michel Chandeigne, aux éditions du même nom. Enfin, il semblerait, contrairement à ce que dit Marcel Cohen, le journaliste de Libération (l'Optima « tombée en désuétude »), est toujours resté un caractère bien vivant et apprécié. Comme c'est une autorité en la matière qui me l'a dit, c'est sans doute Marcel Cohen qui est mal informé.

Un auteur qui sait ce qu'écrire veut dire. Et qui sait regarder le monde en face.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, roland thévenet, la queue, éditions du bug, decize église saint aré, religion catholique, catholicisme, la clayette, château de la chaize, odenas en beaujolais, jack kerouac, beat hotel madame rachou, rue gît-le-coeur, beat generation, gregory corso, pierre levegh le mans 1955, france soir pierre lazareff, journal le monde, hubert beuve-méry, londonderry, optima hermann zapf, éditions chandeigne, journal libération, marcel cohen
jeudi, 19 mars 2015
ROLAND THÉVENET, AUTEUR
1/2
 Je viens de lire un roman fort intéressant. Son auteur s’appelle Roland Thévenet. Un livre qui claque, dès son titre : La Queue (éditions du Bug). Je ne dis pas ça parce que l’auteur est un ami ou parce qu’il m’a été donné d’assister, dans une petite mesure, à la conception, à l’élaboration et à la mise en place des éléments, mais parce que je le pense.
Je viens de lire un roman fort intéressant. Son auteur s’appelle Roland Thévenet. Un livre qui claque, dès son titre : La Queue (éditions du Bug). Je ne dis pas ça parce que l’auteur est un ami ou parce qu’il m’a été donné d’assister, dans une petite mesure, à la conception, à l’élaboration et à la mise en place des éléments, mais parce que je le pense.
Disons-le tout de suite, ce livre est profondément actuel en même temps que totalement inactuel. Actuel, parce qu'il nous parle du monde d'aujourd'hui, tel que, sous nos yeux impuissants, il tourne mal. Inactuel, en ce qu'il célèbre (a contrario) des éléments vitaux d'une façon de vivre (pour faire vite : la campagne autrefois, mais pas seulement) et de références (catholiques, entre autres) que la modernité a rejetées dans les bas-fonds de la ringardise passéiste.
Le projet de Roland Thévenet est ambitieux : au travers d'une fiction développée comme une grande métaphore, à l'aide de personnages et de situations adéquats, peindre le cloaque spirituel, moral, esthétique et marchand dans lequel baignent aujourd’hui le monde en général, l’Europe et la France en particulier, et la déréliction dans laquelle les dirigeants de tous horizons ont laissé glisser la civilisation d’un occident encore matériellement arrogant mais agonisant dans tout le reste, à commencer par l'utilité de soi dans le corps social et par, osons les grands mots, le « sens de la vie ».
Le vieillard sur lequel s’ouvre la narration s’appelle Félix Sy. Il a bâti la fortune et la puissance de son empire sur la veulerie et le snobisme d’une humanité assez futile et inconséquente pour s’enticher de gadgets ridicules qu’une propagande bien orchestrée suffit à présenter sous les dehors du supplément d’âme nécessaire, définitif et insurpassable, à même de combler le désir éternellement frustré et renouvelé du consommateur-à-perpétuité.
Le supplément d’âme, en l’occurrence, n’est autre que l’appendice caudal que la station debout a fait perdre à l’être humain au cours de l’évolution vers la bipédie, et dont Félix Sy a eu l’idée géniale de restituer l’ornement à son postérieur sous la forme d’un marqueur social de classe. Il y a là un régressisme réjouissant, dans lequel la planète entière a plongé avec délectation.
La queue dont il s’agit, elle existe sous de multiples formes, aspects, consistances, matériaux : les bureaux d’études du milliardaire en ont imaginé et dessiné une infinité de modèles, du plus prolétaire au plus surchargé de diamants. Les hommes comme les femmes s'accrochent ainsi, si j'ose dire, à la queue, au point d'en faire parfois collection, pour être en mesure de répondre à la diversité des sollicitations possibles, de la plus humble et intime à la plus officielle et sophistiquée.
Tranchons le mot : arborer sa queue en toute occasion et en tout lieu est devenu la norme universelle. La queue, grâce au génie de Félix Sy, s’est imposée comme le symbole suprême de la mondialisation marchande en régime capitaliste : inconcevable de sortir dans la rue (pour monsieur tout le monde) ou de se rendre en grande tenue à la réception mondaine la plus huppée sans exhiber sa queue.
La première partie du livre raconte en quelques tableaux, de Bruxelles à New York en passant par Athènes, le vide existentiel, frénétiquement affairé, dans lequel évoluent les humains vibrionnaires et perdus du temps présent. Les enfants de Félix Sy ont pris le relais du patriarche à la tête de l’empire : Romain disjoncte et erre quelque part dans une Grèce déconfite et ruinée, Richard s’ennuie à New York, en compagnie de son amant Caïto. Quelque chose, dans la transmission des « valeurs », n’a pas fonctionné.
Seule la bru de Félix Sy tient, envers et contre tout, la barre du navire familial. Anne-Laure a été assez avisée et habile pour se rendre indispensable. Elle est Commissaire Européen. C’est dire si sa vie est futile. Je vois quant à moi dans ce personnage de « maîtresse-femme » le centre névralgique de la problématique telle qu’elle se présente au début. L’araignée au centre de sa toile méticuleuse, à l’affût, veillant au grain, réactive, concrète, cerveau d’ « executive woman » (comme on ne dit plus).
Le grain de sable, c’est la disparition de Félix Sy, le vieillard fondateur, à la veille d’une rétrospective promise au retentissement le plus international et universel qu’on ait jamais vu. « Grand branle-bas dans Landerneau » (tonton Georges B.). L’empire Sy tremblera-t-il sur ses bases ?
Voilà pour la toile de fond.
Voilà ce que je dis, moi.
NOTE : dans la blogosphère, Roland Thévenet est connu sous le nom de Solko (voir dans les "blogs à visiter").
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, roland thévenet, la queue, éditions du bug, france, europe, occident, solko, georges brassens
dimanche, 15 mars 2015
YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?
2/2
 Même chose pour les quelques références musicales qui affleurent de loin en loin : de simples noms. Non, pas la musique que les personnes ont faite, faut pas exagérer : des bulles de noms propres lâchées à la surface de l’étang par quelque carpe en manoeuvre d'intimidation : « Antony [sic !] Braxton, Albert Ayler, Godspeed You ! Black Emperor [un groupe musical] ou des musiques traditionnelles du Mali » (p. 89, quelques lignes sous Lacan, chapeau l’artiste).
Même chose pour les quelques références musicales qui affleurent de loin en loin : de simples noms. Non, pas la musique que les personnes ont faite, faut pas exagérer : des bulles de noms propres lâchées à la surface de l’étang par quelque carpe en manoeuvre d'intimidation : « Antony [sic !] Braxton, Albert Ayler, Godspeed You ! Black Emperor [un groupe musical] ou des musiques traditionnelles du Mali » (p. 89, quelques lignes sous Lacan, chapeau l’artiste).
Des slogans publicitaires. Des oriflammes faites pour claquer au vent sous le nez des naïves foules extasiées, communiant devant le poste. Plus éclectique et branché, tu meurs ! J’ai réentendu mes vinyles d’Albert Ayler : ce n’est vraiment plus possible. Tiens, essayez d’avaler dans la continuité les quatre CD des œuvres pour piano (1968-1988) du susnommé jazzman Anthony Braxton, autrefois célébré par Delfeil de Ton, dans le grand Charlie Hebdo, le seul, celui où ne sévissait pas Philippe Val : même jouée par Hildegard Kleeb, il faut être un stoïcien émérite et aguerri pour supporter cette musique. Je l’ai fait. C’était il y a longtemps. Moralité : ce que j’ai fait, aucune bête au monde ne l’aurait fait : pour qu'une vache produise plus de lait, il faut du Mozart, pas du Braxton. Depuis, je me suis converti à l’humanité.


Pour dire que je sais de quoi je parle.
Pour Braxton, Anthony, c'est avec un h, monsieur Haenel.
Et puis il faut qu’on sache que monsieur Haenel a des goûts exquis en matière d’art. Tout commence devant la porte de Ghiberti, au Baptistère de Florence. Les peintres, sculpteurs, architectes de la renaissance italienne n’ont aucun secret pour lui, et chacun a sa place dans la longue procession des bannières et des Noms : « Bien sûr, je vis avec Donatello, Masaccio, Brunelleschi, Fra Angelico, j’ai cette chance » (p. 56, sous-entendu : tout le monde ne l’a pas, cette chance).
Mais il prend le temps de méditer devant le Déluge peint par Uccello pour le cloître de Santa Maria Novella (p. 31), pour en tirer des considérations très pénétrées, sans pour autant négliger, du même, la Bataille de San Romano.
Mais il ne précise même pas, le malheureux, que ne figure dans les collections du musée des Offices que la partie du triptyque consacrée à la mise hors de combat du Siennois Bernardino della Ciarda, les deux autres étant à la National Gallery (« Nicolo da Tolentino à la tête de ses troupes ») et au Louvre (« Contre-attaque décisive de Micheletto da Cotignola »), faisant subir au lecteur une frustration dommageable. Zut et mince alors ! Quelle négligence !
De même, il aurait pu se lancer dans des envolées sur les « mazzocchi » (à peine s’il mentionne en passant un « mazzocchio » en regardant Le Déluge, p. 42), ces drôles de coiffes toscanes que portent certains des guerriers, qui servaient à Uccello d’études sur la perspective. Vous manquez de belles occasions d’éblouir le badaud, monsieur Haenel !
Je conseille encore la contemplation nocturne, un 25 mars, jusqu'au lever du jour (j'espère qu'en sortant de là, le 26, il n'a pas oublié de téléphoner à Pierre Boulez pour lui souhaiter un bon anniversaire), de l'Annonciation de Fra Angelico à San Marco : « La lumière, c'est du silence qui respire - un silence qui trouve sa justesse. Et peut-être ce silence est-il l'élément de la pensée qui se recueille en elle-même. / Une telle pensivité est l'autre nom de la lumière ». C'est-y pas envoyé ! Pour un peu, ça ressemblerait presque à de la pensée !
Et puis, il faut encore qu’on sache que Yannick Haenel a de hautes préoccupations spirituelles et qu’il est porteur de tout l’héritage biblique (développements sur Achab et Moïse) et chrétien, même si la religion fait ici office de simple vêtement de parade. L’histoire et le message de François d’Assise n’ont aucun secret pour lui.
Il décrit le Casentino dans le moindre détail, comme s’il y était né. Il connaît par cœur ou presque les Fioretti collectées après la mort du saint : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour le nom de Lacan (sous-entendu : je l’ai lu, mieux, je l’ai compris). Il reste que tout le chapitre sur François est purement ornemental, flatteur pour l'écrivain peut-être, et qu'il n'est à aucun moment porté par une foi qui aurait quelque chose de vrai. Pur exercice esthétique de style à la rigueur, pour touriste averti.
Car il faut encore qu’on sache que Yannick Haenel, eh bien il sait écrire. La formule brillante, c’est son truc, même si le lecteur reste perplexe à mainte reprise : « Rester allongé à l’écart, c’est rendre son corps disponible au passage entre les hommes et les dieux. La transparence de la voix qui vient alors, et que personne n’entend, fait le pont entre le ciel et les montagnes ; elle occupe l’intervalle (ce même intervalle qui palpite entre les autres et moi) » (p. 148). Branché sur l'univers, pas moins !
Mais ce n'est pas le passage le plus illustratif de l'idée, j'ai la flemme d'en chercher davantage. Car il y a pire dans l’alambiqué et le fabriqué, semé un peu partout. J'arrête là. Je passe sous silence le chapitre japonais, avec le jardin zen obligatoire, auquel se joint un Bouddha qui fait marrer des Coréens.
Je renonce à aller chercher d’autres exemples : aux amateurs d’y aller voir. Pour moi, Yannick Haenel n’est rien d’autre qu’un poseur, un phraseur mondain qui, la coupe à la main, fait le beau, élégamment accoudé au marbre de la cheminée du salon devant les dames en décolleté qui boivent ses paroles. Il y a du Vendenesse ou du Rastignac dans cette pose. Quand il écrit, il ne cesse de se regarder écrire, citant même à l’occasion des phrases écrites dans son carnet, et se les répétant à plaisir. Si c'est ça, la "prose poétique", la poésie inspirée, alors je retourne à ma charrue, à ma glèbe et à mes bœufs.
Quelques citations quand même, pour se faire une idée de l'esprit qui est ici à l'oeuvre : « Même si j'étais bâillonné de contraintes, il y aurait encore dans ma gorge, dans mon cœur et ma main, une mémoire de la faveur » (p. 65).
« Je la relis à voix haute, lentement, avec une joie étrange : "Les dieux seuls parviennent à l'oubli : les anciens pour s'éloigner, les autres pour revenir". Le sourire de mystère qui glisse dans une telle phrase relève de la faveur » (p. 77, sur une phrase de Maurice Blanchot, l'un des préférés du bocal intello parisien).
« A chaque fois qu'on est lancé dans l'écriture d'un livre, on est porté par une faveur ; on est dans un lieu qui lui-même porte un lieu qui s'ouvre » (p. 119).
« Allongé dans le noir, je cherche une parole qui chasse les démons. Un tel éclat, s'il existe, ne se donne ni au travail ni au temps : il s'agit de convertir un danger en faveur. J'attends alors qu’Éros cesse de brouiller mon existence - qu'il devienne une chance » (p. 152).
« Faire l'expérience de la simplicité du temps est une faveur : cette simplicité n'est-elle pas l'autre nom du temps ? » (p. 166). Mon Dieu, que de faveurs le sort fait à Yannick Haenel, ma parole ! Vraiment, Yannick Haenel est un "favori des dieux" ? Faveur ? Faveur ? Est-ce que j'ai une gueule de faveur ?
Yannick Haenel fait une littérature de snob. Son truc, c'est l'affectation brillante. Cela donne une prose fabriquée, à la préciosité souvent outrée. Je Cherche l’Italie n’est pas un livre de savant, mais d’un cuistre étalant non un savoir, mais les signes d’un savoir dont à aucun moment il ne donne les preuves consistantes. Le journal de bord d'un touriste qui prépare la future soirée diapos devant les amis impressionnés.
Je Cherche l’Italie ressemble à un cortège de mariage qui klaxonne à percer les oreilles en passant dans les rues pour faire savoir au bon peuple que, le soir même, les étreintes amoureuses du nouveau couple ne se dérouleront plus dans le péché, mais seront couvertes du sceau de la légitimité républicaine, voire divine. San Antonio les appelle quelque part les « grimpettes légitimes ».
Avec sa litanie obsessionnelle de noms propres lancés comme des slogans publicitaires, Je Cherche l’Italie a quelque chose du concert de klaxons.
C’est d’autant plus regrettable que le constat que Yannick Haenel pourrait dresser du monde qui est le nôtre voisinerait sans trop d'incompatibilité avec l'impitoyable diagnostic posé en son temps par le grand Philippe Muray, ainsi qu'avec l'analyse approfondie qu'en fait depuis lors, roman après roman, l'immense Michel Houellebecq.
Malheureusement, ce monde, tel qu'il est, ne lui paraît pas encore aussi invivable que le disent ces grands prédécesseurs. Comme décor de fond de scène pour accompagner la grâce de ses évolutions, ce monde, malgré les taches qui voudraient le défigurer, conserve assez de beaux restes aux yeux de Yannick Haenel.
Il s'y trouve, finalement, pas si mal. Il y trouve trop de satisfactions de l'esprit pour le conspuer totalement. Il n'a pas l'estomac assez sensible à l'indigeste. Il reçoit de ce monde assez de gratifications, il en tire assez de bénéfices, sa situation personnelle est assez satisfaisante pour n'en pas demander davantage. Il s'apitoie, des hauteurs de sa terrasse, sur le sort des affligés qui se débattent au loin : Sénégalais, Lampedusa, Hiroshima, Fukushima, chambres à gaz, personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir pensé aux malheureux.
Yannick Haenel se contente. Il se paie de mots. Il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il se couche. Il n'a pas le courage de s'opposer. Comme aurait dit Aristide Bruant (« Nini peau d'chien ») : il a le « foie blanc ». Houellebecq, lui, pour s'opposer, est capable de s'oublier totalement dans ce qu'il écrit, y compris et surtout quand il invente un personnage nommé Michel Houellebecq. S'oublier : voilà bien ce dont Yannick Haenel se montre totalement incapable dans Je Cherche l'Italie.
Sous son dehors clinquant de livre de premier de la classe, Je Cherche l'Italie est un livre prétentieux. Balzac aurait dit : le livre d'un paltoquet. Il paraît que monsieur Haenel écrit aussi des romans. On est content pour lui. Grand bien lui fasse.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : yannick haenel, michel houellebecq, je cherche l'italie, littérature française, jacques lacan, anthony braxton, musique contemporaine, albert ayler, charlie hebdo, delfeil de ton, porte de ghiberti florence, paolo uccello, santa maria novella, bataille de san romano, françois d'assise, philippe muray


