dimanche, 14 mai 2017
LES BELLES HISTOIRES ...
... DE TONTON BÉROALDE.

Allégorie du temps. Marque de l'imprimeur Peter Jordan.
**************************
Histoire de mademoiselle d'Amélie, qui avait un mari impuissant.
A ce propos, je vous dirai de mademoiselle d'Amélie, qui a beaucoup acquis de réputation, ayant hanté la cour toute sa vie, pour ce qu'elle était mariée à un impuissant et elle l'a enduré sans aller à Notre Dame des Aides ou - pour mieux dire - à la cour des aides. Elle n'a tout ce temps-là point mis dedans et si, on ne s'apercevait point de son désastre, pour ce qu'elle le feignait de bonne grâce. Ce premier mari lui a duré dix ans, il faut que vous sachiez cette vérité. Etant mariée à ce bon personnage, la première nuit de ses noces, il la caressa de baisers et de petites mignotises superficielles, et mit la main à une petite paire d'époussettes de soie qui étaient pendues au chevet du lit et lui épousseta son cas, ce qu'il fit deux ou trois fois. Et ainsi, les passant et repassant par son velu d'entre les deux gros orteils, la contentait sans qu'elle y pensât autre finesse. Le lendemain, ses amies lui demandèrent comment elle se portait et ce qu'elle disait de ce bonhomme : « Vraiment, dit-elle, il m'a épousseté trois fois mon cas. - Ho ! ho ! dirent-elles, vous êtes bien, ma mie ». Ainsi font les dames de Paris, et disent à la nouvelle mariée : « Eh bien ! la jeune femme, comment vous portez-vous ? ». Si d'aventure elle est bien graissée à la charnière, elle dira : « Fort bien, madame, Dieu merci ! J'ai un bon mari. Il me donne tout ce que je demande : si je voulais manger de l'or, il m'en donnerait ». Mais si elle est mal servie : « Ardez ! dit-elle, mon mari est un grincheux. Il est chiche et ne fait que penser à son avarice. - Hélas ! voyez, voilà grand-pitié !». Celle-ci n'était pas si fine. Elle ne savait ce que c'était et s'ébahissaient comment les femmes faisaient si grand cas de si peu de chose, qu'elle estimait moins que rien, encore que, au dire des dames, ce fût beaucoup d'excellence.
Mais, après dix ans d' "époussetage de son velu", voilà que le mari tombe malade et finit par mourir. Elle commence par se dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme au logis. Mais un beau jeune homme commence à lui tourner autour. Et ce qui la décide à se remarier, c'est qu'il a "un beau chausse-pied de mariage", ce qui veut dire, très concrètement, qu'il est loin d'être pauvre.
Ils furent donc mariés aux us et coutumes du pays, ainsi que le prêtre leur dit (j'y étais) et leur acheva ainsi la benoîte cérémonie : « Vous, Claude, vous promettez bien aimer Marie. Au cas semblable, gouvernerez votre mari, Claude, autant sain que malade, etc. ». Cela promis, la belle emmena son jeune mari en sa maison, où elle lui fit bonne chère, puis ils couchèrent ensemble au lit même où le bonhomme lui avait épousseté son cas. Le jeune homme n'eut pas la patience d'attendre, mais se juche sur elle, qui se trouve toue scandalisée de cette façon : « Quoi ! dit-elle, me voulez-vous outrager ? « Êtes-vous fou ou enragé ? - Je veux vous faire comme votre défunt mari faisait. - Il ne faisait pas ainsi : il prenait ces époussettes et m'en époussetait mon engin. Il ne me foulait pas comme vous faites, il passait et repassait ces époussettes sur le pré de ce petit fossé que j'ai en contrebas. - Vraiment, c'est cela ? Laissez-moi faire : je l'entends mieux que lui. Il n'était pas clerc ! ». Elle s'y accorda et, comme elle sentit l'embrochement entre les hypocondres - chose qui lui était toute nouvelle : « Hélas ! crie-t-elle, mon ami (pensant aux époussettes) je crois que vous avez mis le manche dedans ». Voilà comme il l'accommoda et s'en vanta, et toutefois il n'était pas si bon compagnon qu'il se disait. Je le sus de la femme de chambre qui ouït le discours et les effets. Je lui demandai s'il était vrai qu'il eût frétillenaturé sa femme neuf fois, comme il se vantait. Elle, se moquant, secoua la tête, me disant : « Je voudrais avoir ce qu'il s'en faut ! ». Depuis cette fortune, la demoiselle s'est reconnue et n'a plus été si niaise. De fait, on m'a assuré que, comme les autres, elle aimerait mieux un vit au poing qu'un bourdon sur l'épaule.
Allons, tout est bien qui finit bien.
Note : le "bourdon" est le bâton des pèlerins.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, béroalde de verville, littérature grivoise
samedi, 13 mai 2017
LES BELLES HISTOIRES ...
 ... DE TONTON BÉROALDE.
... DE TONTON BÉROALDE.
Aujourd'hui, une histoire peut-être inspirée des fabliaux du moyen âge.
L’AUTRE : J’en prends à témoin mon compère Livet, procureur au Châtelet de Paris, qui ne laissait jamais son écritoire. Il advint, par malencontre de bas avis, que madame sa femme, voyant un gai, gaillard et jeune Maure, eut envie d’en être couverte. Elle le fit entrer et, pour remédier à un mal d’estomac qu’elle avait, elle le fit coucher sur elle – ce qu’elle en faisait était qu’elle considérait que sa peau, vu sa nation, serait plus chaude que celle d’un Français. Le jeune homme, ayant été là assez longtemps, fut remercié et salarié de son bon office, où il n’y avait point de mal vu que cela tendait à la santé. Mais que c’est des impressions ! Il lui advint que, son mari venant à la copuler, elle, qui se souvint du Maure, en engendra un : ce qui parut quand elle accoucha. Sa commère, voyant à son enfantement cette aventure si noire, l’avisa et la pauvrette lui dit sa friande imagination, à quoi la bonne commère et amie pourvut et s’en alla au Châtelet faire appeler Livet qui, venu, lui dit : « Eh bien ! ma mie, quoi ? Qu’avons-nous ? – Un beau fils, lui dit-elle. Mais, je vous prie, dites-moi en conscience, mon compère, vous n’avez jamais accolé ma commère que vous n’eussiez votre écritoire à votre côté ? – Oh ! que si ai-je ! Plus de trente fois ! – Vraiment, vous avez bien besogné ! Je m’en doutais bien. Voilà ! il est chu de l’encre dedans, si que vous avez fait un enfant noir comme un Maure !
Et pour les vrais amateurs, la fin du chapitre (dans l'édition Lemerre, 1896) :
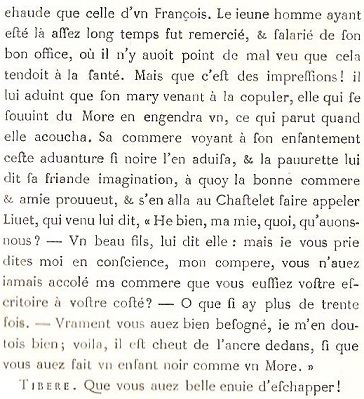
J'aurais volontiers rapporté l'histoire de ce "saint personnage" qui se disait sabotier, mais elle est un peu longue. C'est très dommage, car elle est aussi haute en couleur, en odeur et en saveur. Pour résumer, le soir venu, le monsieur demande l'hospitalité chez le Page. La femme, qui est « avaricieuse comme un financier qui a fait ses affaires et n'a point d'enfant », lui ferme la porte au nez, au prétexte de son mari, présenté comme « chiche et grondeur ». Il toque chez la chambrière de Chiquetière, qui lui fait le meilleur accueil. Au matin, en remerciement, il lui déclare : « Je prie le bon Dieu qu'il lui plaise vous bénir, et que la première besogne que vous ferez aujourd'hui lui soit tant agréable que vous ne puissiez tout le jour faire autre chose ». Sa première besogne est de plier du linge, et plus elle en plie, plus il y en a, car il « multipliait au touchement de ses mains ».
La le Page, apprenant cela, se mord les doigts, et essaie de rattraper le coup. Le lendemain, le "saint personnage" lui fait exactement le même compliment. Lui parti, elle fait préparer tout son linge, mais auparavant, elle s'avise « d'aller pisser » pour ne pas être dérangée dans sa tâche. Et que croyez-vous qu'il arriva ? « Mais ce fut ici une efficace terrible, d'autant qu'elle commença pisserie qui continua tout le jour ». Et le soir : « Ses amies, la venant voir et la trouvant ainsi distillant le dissolvant philosophique, lui demandaient : "Hé quoi, ma commère ? - Hélas ! disait-elle, hélas !" ». Le résultat ? « Elle coula force eau, et fit ce ruisseau qui passe au pied des Loges et va jusques aux Indes ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 12 mai 2017
LES BELLES HISTOIRES ...
... DE TONTON BÉROALDE.
Il ne faut pas se formaliser, en lisant Le Moyen de parvenir de Béroalde de Verville (1556-1626), de ce que les noms des personnages qui interviennent dans les joyeux et savants dialogues portent une infinité de noms divers, parmi lesquels on trouve Pétrarque, Paracelse, Erasme, Amyot, Rabelais, Albert le Grand, et tant d’autres plus exotiques ou antiques. A croire que toute l’humanité savante s’est rassemblée ici, pour festoyer et deviser gaiement.
On ne s’étonnera donc pas que l’anecdote qui suit (qu’on pourrait intituler « la dispute de la bouche et du con », comme il y eut, dans des temps plus obscurs, à ce qu'on raconte, des "disputationes" du con et et du cul, travesties en chansons paillardes par la modernité) soit racontée par un certain :
« TITE-LIVE : Par le plus saint faux serment que je fais à la race féminine (qui me nomme "le bonhomme Trompecon") ! j’oubliais mon conte, pensant à la folie que vous faites sur la comparaison du temps passé. Je ne croyais pas que ce qu’il y a mille ans qui est passé et anéanti soit plus vieux que ce qui passe tous les jours et qui va dans le sac de vieillesse, dans l’écrin de l’oubli, et ce qu’on propose de plus ou moins vieux est d’aussi bonne grâce que la question de Martin Chabert, qui aimait trois filles, auxquelles il dit pour arrêt un jour : "Mes fillettes mignonnes, je ne puis vous épouser toutes trois, bien que je vous aime de toute ma loyale fressure [de toutes mes tripes] et plus chacune l’une que l’autre. Je ne sais comme faire, sinon qu’il faut que j’aie à choisir et, pour nous ôter de cette peine, je vous dirai, si vous voulez, un moyen : c’est que j’épouserai celle qui me dira la plus naïve vérité de ce que je lui demanderai". Elles s’y accordèrent. "Or çà ! dit-il, lequel est le plus vieux de votre chose ou de votre bouche ?" J’ai quasi bronché des mâchoires, mais pourquoi dit-on "confiture" ? Que ne dit-on "ficontures" ou "fiturescon" ? Et tant d’autres mots qui commencent ainsi : comme congrégation, conscience …
ELPIS : C’est bien entendu par un philosophe ! Ne savez-vous pas bien qu’il est devant et jamais derrière ? Et pourtant il faut le colloquer en la tête.
– … le charpentier qui demanda au curé : "Pourquoi dites-vous "dominus vobiscum" ? Que ne dites-vous "dominus vobiscul" ? Le curé lui dite : "Pourquoi dites-vous "un compas" ? Que ne dites-vous "un culpas" ?
– Sainte Marande ! vous avez raison, mais faites parler ces filles.
– L’aînée répondit "C’est mon cela qui est le plus vieux, d’autant qu’il a de la barbe et ma bouche n’en a point". La seconde : "C’est ma bouche qui est la plus vieille, parce qu’elle a des dents et mon petit n’en a point". La petite dit : "Je dis comme ma sœur. – Dites donc, mignonne, une belle raison comme nous". Elle pétillait et frétillait comme une marmotte déchaînée : "C’est, dit-elle, ma bouche qui est la plus vieille, pour autant qu’elle est sevrée et mon con tète tous les jours".
– Ha ! ha ! hé !
– Or, devinez, vous autres, et jugez laquelle a le mieux dit, afin que Martin soit le marié comme les autres.
– Jean ! par la certe Dieu ! dit Copeau – aussi était-il tout réformé –, alors, j’aimerais autant ma chambrière qui, nous oyant ainsi discourir, me reprocha que, si ce n’était leur cas, que je ne saurions que dire ! Et là-dessus ma dit : "Vous qui en savez tant, si vous aviez trouvé un con tout seul, que lui diriez-vous ?" ».
Note : Elpis est un mot grec signifiant "espoir". Tous ceux qui ont un jour appris le grec ont croisé cette très vieille blague (qui date forcément d'après l'invention du chemin de fer) :
"ουκ έλαβον πόλιν αλλα γαρ ελπις εφη κακα"
Phrase qui peut se traduire phonétiquement : "Où qu'est la bonne Pauline ? A la gare, elle pisse et fait caca", et sémantiquement : "Je n'ai pas pris la ville, mais l'espoir a dit des choses fausses".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, béroalde de verville, humour, où qu'est la bonne pauline, blague cochonne, licencieux, obscène
mardi, 09 mai 2017
VIALATTE ET L’IDÉE DE L’ALGÉRIE
 Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :
Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :
« Les Français s’avisèrent, en 1830, qu’il valait mieux gouverner l’Algérie que d’y être vendus sur les marchés d’esclaves. C’était un point de vue. Ils l’adoptèrent. L’Amérique, à l’époque, les en félicita, le monde civilisé les remercia, Abd el-Kader, vaincu, leur apporta son aide, M. Ferhat Abbas apprit la pharmacie. Cent trente ans plus tard, ils trouvèrent qu’une Algérie antifrançaise irait mieux dans "le sens de l’Histoire", et que les Chinois feraient mieux qu’eux. La chose paraissait plus "à gauche". Ce mot de "gauche" emporta tout. Car on accepte à la rigueur d’être accusé d’avoir tué son père, on ne peut pas s’exposer au reproche d’être moins "à gauche" que son voisin. Même s’il faut pour cela soutenir l’assassinat : l’assassinat n’est pas la guerre ; on peut assassiner en restant pacifiste ; l’assassinat ne devient blâmable que pratiqué par des méchants. Et le méchant, c’est l’armée française. Sans armée, en effet, il n’y aurait jamais de guerre. Et puis d’ailleurs, qu’est-ce que ça peut nous faire, puisque ça se passe de l’autre côté de l’eau ? Bref l’idée plut.
Au bout de sept ans d’efforts, de combats, de campagnes de presse, de guillemets déplacés, de citations dirigées, la France a enfin réussi à perdre l’Algérie française. A la suite des victoires d’Oran et de Bab El Oued. Elles furent sanglantes. Aussi la joie régna-t-elle dans le camp des vainqueurs. Les enfants se partageaient le képi du général. Il était lauré de feuilles de chêne. Ils en firent des indigestions. Des harkis furent pelés comme on pèle une carotte, salés comme du jambon et cuits dans une marmite. Ce ne furent plus qu’égorgements, disparitions, espiègleries, accords d’Evian.
Les riches colons rentrèrent en France avec les restes de leur famille. Ils trouvèrent pour les accueillir de vastes terrains vagues où ils plantèrent leurs tentes, de soie et d’or, mal vus par la population qui leur reprochait leurs milliards, l’exploitation des indigènes, plusieurs vols de porte-monnaie, et le cynisme qu’ils avaient eu de naître à Mascara ou Orléansville.
Il ne s’agissait plus que de décoloniser. On sait en quoi la chose consiste : on déboulonne Lesseps, on garde le canal ; on supprime les propriétaires, et on coupe la tête à Jeanne d’Arc.
Il y a neuf millions d’Algériens qui ne doivent la vie qu’à la médecine française. Va-t-on les supprimer aussi ?
Mais à quoi bon donner la vie à tant d’enfants, sans leur offrir avec une situation brillante ? Et c’est pourquoi, devenus grands et nombreux, les enfants battirent leur nourrice. Heureusement, la nourrice entendait merveilleusement la plaisanterie. Elle l’entendit jusqu’à violer la Constitution de son pays pour l’Algérie antifrançaise. Ce qui n’épargna nul massacre. La majorité des députés ne dit mot. Puis renversa le gouvernement, parce qu’elle trouvait qu’il violait la loi sur un autre point. Ce fut en chantant La Marseillaise.
On en est là. Si bien qu’à travers l’événement, la France, aux yeux des députés, apparaît gouvernée, tantôt par un gouvernement légal et par une Constitution factieuse, et tantôt par un chef factieux et par une Constitution légale. Tel est le tableau. J’y mets à peine de mauvaise foi ; et encore, uniquement pour le plaisir de la chose ; pour le principe ; ou pour ne pas être trop sévère : user de la vérité serait un abus de pouvoir.
Ceux qui firent les frais de l’aventure furent les garçons qu’on envoya vaincre et mourir sur les djebels, au nom d’une Algérie qu’on leur enlève ensuite au mépris des serments qu’ils avaient dû donner. Ce fut d’eux qu’on ne parla jamais. Ce furent eux qui n’eurent jamais droit aux sollicitudes de la presse. Masques maigres de sentinelles, figures de proue de l’armée française, sacrifiés de leur génération, ce furent eux qui ne défilèrent pas, afin que la nation ne pût pas les remercier. Ils revoyaient dans leurs cauchemars le chef de douar ou les harkis qu’on avait torturés quand ils étaient partis, en dépit des promesses qu’ils avaient dû leur faire. Ils s’accusaient de complicité d’assassinat. Tel fut le drame. Comment fut-il compris ? La grande presse annonça un jour que le général Massu, qui avait eu pour eux un mot de pitié dans un discours, était privé de homard par le général de Gaulle. Oui, la chose alla jusque-là. De Gaulle étant venu aux manœuvres, Massu ne fut pas invité à sa table où "l’ordinaire avait été amélioré". Il n’eut pas droit au homard mayonnaise. Et la presse en fit quatre colonnes. Et c’est elle qui fait l’opinion.
Ce furent les morts les plus trahis. On leur retira leur raison d’être devenus des cadavres. Offerts à la nuit des djebels et sacrifiés sur la montagne, tués à la balle, mutilés au couteau, ils n’apprirent que du fond de la tombe que ce n’était pas pour la France, mais d’abord que c’était pour rien, ensuite que c’était pour l’ennemi. C’étaient nos fils, c’étaient nos frères. Voilà, disent les discours de la télévision, "ce que nous avons réalisé à travers tant de sang, avec tant de réussite"… ».
Alexandre Vialatte le dit lui-même : il n’écrit pas cela sans une certaine dose de mauvaise foi. Je me garderai de porter un jugement sur le fond. Je me contenterai d’estimer que ce n’est pas ce qu’il a écrit de meilleur, y compris – en dehors de quelques réussites (dont l'énumération - deux octosyllabes approximatifs - qui aboutit aux "accords d'Evian") – dans le style lui-même. Dans un numéro de la même revue, en janvier 1963, il sera encore plus net, voire violent (« La patrie était une famille ; le général de Gaulle était un paladin. Et tout à coup il nous apprend que la patrie est une épicerie dont on lâche le rayon qui ne rapporte rien. Qui se ferait tuer pour une épicerie ? »). Moins violent, certes, que les réalités de cet épisode de l'histoire de France.
Vialatte poursuit sa chronique en commentant à sa façon Au Lieutenant des Taglaïts, de Philippe Héduy qui livre là, selon lui, « témoignage lyrique d’un militaire, documentaire passionné d’une époque, et pièce à conviction fécondement accablante », puis Désert perdu, de son amie Ferny Besson, « fille d’un médecin des oasis », qui « ne vient en France qu’à seize ans », et qui a perdu un fils dans la guerre d’Algérie.
La chronique s’achève sur la longue citation d’un article de Jean Cau paru dans L’Express, dans lequel son auteur jette une déploration sur les dégâts irrémédiables qu’est en train de faire subir à la terre algérienne le départ massif des Européens. Quand on voit, cinquante-cinq ans après la fin de la guerre, l’état d’esprit d’une majorité de la population face aux élections législatives qui viennent d’avoir lieu en Algérie – jouées d’avance, selon plusieurs journalistes et observateurs algériens – peut-on dire qu’il a complètement tort ? Pouvoir et ressources confisqués par une petite secte de seigneurs militaires, population où grouille une jeunesse (le pays a 27,3 ans d'âge moyen en 2014) désillusionnée, désorientée, autant qu'inemployée. Oui, qu'elle doit paraître belle, aux yeux des Algériens d'aujourd'hui, l'indépendance ....... d'avant l'indépendance !
Ils avaient encore au moins la chance de pouvoir combattre un ennemi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, revue le spectacle du monde, vialatte résumons-nous, guerre d'algérie, algérie française, oas, robert bourgine, jean cau, ferhat abbas, abd el kader, bab el oued, france, politique, société, la marseillaise, général de gaulle, général massu, harkis, philippe héduy, lieutenant des taglaïts, ferny besson désert perdu, rapatriés d'algérie, littérature française
dimanche, 19 mars 2017
MÈRE ET FILLE, DIALOGUE
On n'était pas toujours, à l'époque où la scène qui vient se passe (XVI°), allusif dans le langage.
« NANNA – Quelle colère, quelle fureur, quelle rage, quelle folie, quels battements de cœur, quelles pâmoisons, quelle moutarde est la tienne ? Fastidieuse enfant que tu es !
PIPPA – La mouche me grimpe, de ce que vous ne voulez pas me faire courtisane, comme vous l’a conseillé Monna Antonia, ma marraine.
NANNA – Il faut plus que d’entendre sonner neuf heures, pour dîner.
PIPPA – Vous êtes une marâtre ! Hou hou !
NANNA – Tu pleures, ma petite chérie ?
PIPPA – Je veux pleurer, bien sûr.
NANNA – Renonce d’abord à ta fierté, renonces-y, te dis-je, parce que si tu ne changes pas de façons, Pippa, si tu n’en changes point, tu n’auras jamais de braies au derrière. Aujourd’hui le nombre des putains est si grand, que celle qui ne fait pas de miracles en l’art de se conduire, n’arrive pas à joindre le dîner au goûter. Il ne suffit pas d’être un friand morceau, d’avoir de beaux yeux, de blondes tresses : l’adresse ou la chance seules vous tirent d’affaire ; le reste n’est rien.
PIPPA – Oui, à ce que vous dites.
NANNA – Et cela est, Pippa. Mais si tu entres dans mes vues, si tu ouvres les oreilles à mes préceptes, bonheur à toi, bonheur à toi, bonheur à toi.
PIPPA – Si vous vous dépêchez de faire de moi une dame, je les ouvrirai bel et bien.
NANNA – Pourvu que tu veuilles m’écouter, que tu cesses de bayer au moindre poil qui vole et d’avoir l’idée aux grillons, comme à ton ordinaire, quand je te parle dans ton intérêt, je te jure et je te rejure, par ces patenôtres que je mâchonne toute la journée, qu’avant quinze jour je te mets en perce. »
On peut compter sur la mère pour enseigner à sa fille tout ce que doit savoir une femme qui exerce le métier (Brassens dirait : « les p'tites ficelles »), à commencer par les moyens de « ne pas faire banqueroute le jour même où l'on ouvre boutique ». Pour cela, il faut se servir de sa cervelle. Moyennant quoi, Pippa sera en droit d'espérer pouvoir « monter plus haut que favorite de pape ».

Ce court dialogue constitue le tout début de L’Education de la Pippa (éditions Allia, 1997), qui fait partie des Ragionamenti de Pietro Aretino, connu en France sous le nom de L’Arétin (1492-1556). Les excellentes éditions Allia précisent que le titre original est formulé ainsi : Dialogo di messer Pietro Aretino nel quale la Nanna il primo giorno insegna a la Pippa sua figliuola a esser putana. J’aime assez « La mouche me grimpe », mais j'avoue que je comprends mal « avoir l’idée aux grillons ». Peut-être la mère veut-elle signifier à sa fille que, si l’on veut arriver à quelque chose dans la vie, il faut raisonner avec sérieux et avec un esprit pragmatique. Pas besoin, je pense, d'expliquer « avant quinze jours, je te mets en perce ». On a ci-dessus une illustration, parmi d'innombrables exemples, des joyeusetés et fantaisies que les Raggionamenti de l'Arétin ont inspirées à une pléiade de dessinateurs et graveurs talentueux. Mais ses poèmes luxurieux n'ont pas laissé toute sèche l'imagination des artistes, comme on le voit ci-dessous.
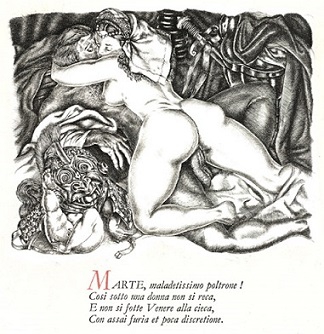
"Conversation" entre Mars et Vénus. Je crois bien que "poltrone" signifie quelque chose comme "paresseux". Selon toute apparence, si le monsieur se contente, de sa raquette, d'assurer "les balles de fond de court", la dame se montre assez vaillante pour "monter au filet" (pardon pour la métaphore pénistique).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature érotique, petro aretino, l'arétin, pierre arétin, l'éducation de la pippa, georges brassens, arétin ragionamenti
samedi, 18 mars 2017
UNE FABLE DE LA FONTAINE
AUTRE LEÇON DE SUBTILITÉ
Je prie le visiteur de m’excuser : la fable qui vient est à la vérité un peu longue. Je dirai pour me défendre que la faute en revient à l’auteur lui-même, qui prend le temps de tout expliquer à M. de Barillon, qui se trouve être ambassadeur, en même temps que le dédicataire de la fable. On trouve celle-ci dans le livre VIII, où elle rate le podium de peu, puisqu'elle porte le numéro IV. Elle est une illustration de ce qu'on appelle, en termes de savantasse, une « mise en abyme » : c'est la fable qui parle d'elle-même et, en l'occurrence, en termes plutôt désobligeants, comme on va le voir.
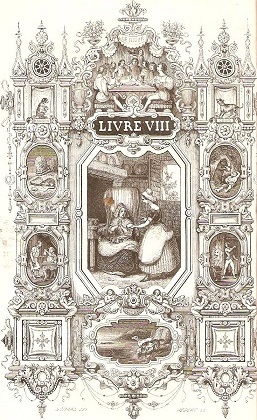
Le drôle de la chose, c’est que La Fontaine semble ici tourner en dérision le principe même de la fable, pour cause d’enfantillage : il reproche ici aux hommes de s’occuper de choses futiles en temps ordinaires et de délaisser les affaires les plus sérieuses, celles qui regardent la société dans son ensemble, en l’occurrence rien de moins que la question de sa sécurité. Comme les enfants, même (et surtout) quand la situation est grave, les hommes ne prêtent attention qu’à ce qui les divertit : ils aiment qu’on leur raconte des histoires. On reconnaîtra sans doute, au moment de tirer la morale de l’histoire, deux vers fort connus (texte intégral).
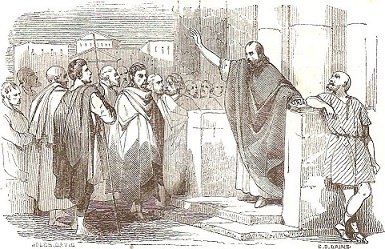
LE POUVOIR DES FABLES (à M. de Barillon).
« La qualité d’ambassadeur
Peut-elle s’abaisser à des contes vulgaires ?
Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères ?
S’ils osent quelquefois prendre un air de grandeur,
Seront-ils point par vous traités de téméraires ?
Vous avez bien d’autres affaires
A démêler que les débats du lapin et de la belette.
Lisez-les, ne les lisez pas ;
Mais empêchez qu’on ne nous mette
Toute l’Europe sur les bras.
Que de mille endroits de la terre
Il nous vienne des ennemis,
J’y consens ; mais que l’Angleterre
Veuille que nos deux rois se lassent d’être amis,
J’ai peine à digérer la chose.
N’est-il point encor temps que Louis se repose ?
Quel autre Hercule enfin ne se trouverait las
De combattre cette hydre ? Et faut-il qu’elle oppose
Une nouvelle tête aux efforts de son bras ?
Si votre esprit plein de souplesse,
Par éloquence et par adresse,
Peut adoucir les cœurs et détourner ce coup,
Je vous sacrifierai cent moutons : c’est beaucoup
Pour un habitant du Parnasse.
Cependant faites-moi la grâce
De prendre en don ce peu d’encens.
Prenez en gré mes vœux ardents,
Et le récit en vers qu’ici je vous dédie.
Son sujet vous convient ; je n’en dirai pas plus :
Sur les éloges que l’envie
Doit avouer qui vous sont dus,
Vous ne voulez pas qu’on appuie.
Dans Athène [sic] autrefois, peuple vain et léger,
Un orateur, voyant sa patrie en danger,
Courut à la tribune ; et, d’un art tyrannique,
Voulant forcer les cœurs dans une république,
Il parla fortement sur le commun salut.
On ne l’écoutait pas. L’orateur recourut
A ces figures violentes
Qui savent exciter les âmes les plus lentes :
Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu’il put ;
Le vent emporta tout ; personne ne s’émut.
L’animal aux têtes frivoles,
Etant fait à ces traits, ne daignait l’écouter ;
Tous regardaient ailleurs : il en vit s’arrêter
A des combats d’entas, et point à ses paroles.
Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour :
Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour
Avec l’anguille et l’hirondelle ;
Un fleuve les arrête, et l’anguille en nageant,
Comme l’hirondelle en volant,
Le traversa bientôt. L’assemblée à l’instant
Cria tout d’une voix : Et Cérès, que fit-elle ?
Ce qu’elle fit ! un prompt courroux
L’anima d’abord contre vous.
Quoi ! de contes d’enfants son peuple s’embarrasse,
Et du péril qui le menace
Lui seul entre les Grecs il néglige l’effet !
Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ?
A ce reproche l’assemblée,
Par l’apologue réveillée,
Se donne entière à l’orateur :
Un trait de fable en eut l’honneur.
Nous sommes tous d’Athène en ce point ; et moi-même,
Au moment que je fais cette moralité,
Si Peau-d’Âne m’était conté,
J’y prendrais un plaisir extrême.
Le monde est vieux, dit-on : je le crois ; cependant
Il le faut amuser encor comme un enfant. »
De quoi, peut-être, émettre, de concert avec M. de Talleyrand, le regret de tous ceux qui, et nous sommes un certain nombre, à ne pas savoir ce que c'est que la douceur de vivre, pour n'avoir pas vécu au temps d'avant la Révolution (citation très approximative).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, la fontaine, fables la fontaine, le pouvoir des fables
vendredi, 17 mars 2017
LA FONTAINE, LE LICENCIEUX ÉLÉGANT
UNE LEÇON DE SUBTILITÉ
Dégoûté par la grande pitié que m’inspire le spectacle du monde tel qu’il va mal et de la France politique en particulier, je m’immerge depuis quelque temps dans l’œuvre de quelques écrivains qui ont marqué le Grand Siècle. Présentement, je poursuis en parallèle la lecture des Mémoires de Saint-Simon et du cardinal de Retz, et je ne me lasse pas d’admirer la haute idée que ces deux figures marquantes de la haute aristocratie française et de la littérature se faisaient de la France, de la dignité de leur propre personne et de la langue alors en usage. Saint-Simon davantage homme de cour, généalogiste méticuleux et grand seigneur jaloux de voir conserver les prérogatives de son rang, Retz tout entier voué à la gloire et aux grandes actions héroïques que lui a insufflées dans sa jeunesse la lecture des Vies des hommes illustres de Plutarque.
Je me garderai de comparer l'altitude où se situent ces figures d'exception, tant avec la bassesse de vue de nos modernes politiques qu’avec l’aridité squelettique de la langue qu’ils pratiquent, et qui ne fait que traduire la pauvreté de leur pensée, toutes choses qui feraient presque regretter l’Ancien Régime, voire déplorer la décollation de Louis seizième, un certain 21 janvier. Venons-en au fait.
Il existe des livres dont tout le monde cite le titre, souvent sans les avoir lus. Tout le monde connaît, par exemple, quelques-unes des Fables de La Fontaine, mais qui connaît Les Souris et le Chat-huant ? Les Femmes et le Secret ? La Tortue et les deux Canards ? La jeune Veuve ? Et bien d'autres sont encore plus méconnues. Il est vrai que la plupart de celles qu'on apprenait autrefois à l'école (les apprend-on encore ?) figurent dans le premier tome, le second paraissant dix ans plus tard. Quant aux Contes et nouvelles en vers, n’en parlons pas. C’est bien dommage, car c’est se priver de plaisirs délectables et d’enseignements précieux.
C’est ainsi que dans le tome second des Contes et nouvelles, La Fontaine expose sans fard sa théorie du beau langage et de ses subtilités, sur laquelle il fonde tout l’intérêt de ses narrations. On trouve cet exposé dans le préambule, fort développé pour une fois, du récit intitulé Le Tableau. Cette belle et grande leçon de subtilité touche bien entendu au domaine éminemment sensible (sans qu’il soit besoin de préciser) dans lequel un courtisan qui ferait montre de crudité se verrait interdire l’accès des salons pour cause d'incivilité.
C’est à qui, au contraire, fera la preuve du plus extrême raffinement dans l’expression par les mots des choses qui occupent les deux sexes depuis la nuit des temps, mais une expression édulcorée, passée par le tamis de l'art de la formulation. Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas :  Agostino Carrache (1557-1602, qui est loin d'être le seul ; ci-contre Hercule et Déjanire en plein débat conjugal) a commis dès cette époque des gravures splendidement explicites pour illustrer diverses galipettes de personnages de la mythologie, et quand il s'agissait d' « aller au déduit », les plus grands seigneurs étaient bien obligés de mettre bas le masque de la mondanité et de condescendre au très concret. Il reste qu'on se devait, devant le monde, de sauvegarder les apparences, ce qui explique les détours parfois tortueux mais toujours élégants et habiles offerts par le procédé de l'allusion suggestive.
Agostino Carrache (1557-1602, qui est loin d'être le seul ; ci-contre Hercule et Déjanire en plein débat conjugal) a commis dès cette époque des gravures splendidement explicites pour illustrer diverses galipettes de personnages de la mythologie, et quand il s'agissait d' « aller au déduit », les plus grands seigneurs étaient bien obligés de mettre bas le masque de la mondanité et de condescendre au très concret. Il reste qu'on se devait, devant le monde, de sauvegarder les apparences, ce qui explique les détours parfois tortueux mais toujours élégants et habiles offerts par le procédé de l'allusion suggestive.
Dans le récit du Tableau, sœur Claude et sœur Thérèse ont pris coutume de se partager dans leur cellule les « qualités » d’un bachelier, qu’il a particulièrement avantageuses semble-t-il, et dont il ne demande qu’à faire bénéficier les belles qui le lui demandent. Un jour, comme il est en retard, passe un « Mazet », qui se trompe de cellule. Qu’à cela ne tienne, Claude et Thérèse, faute de la grive attendue, se rabattent sur le merle. Elles ne perdront pas au change.

« Ah, pour être dévote, on n'en est pas moins femme. »
Sur le « tableau » qui donne son titre au conte, trois personnages : deux nonnes se disputent les faveurs d’un rustre. Mais la chaise ne résiste pas (« Ou soit par le défaut / De la chaise un peu faible, ou soit que du pitaut / Le corps ne fut pas fait de plume, / Ou soit que sœur Thérèse eût chargé d'action / Son discours véhément et plein d'émotion, ... »). Claude a profité du bris de la chaise pour s’emparer du « timon » du garçon, au grand dam de Thérèse qui, dans la chute, a perdu la « tramontane » et qui voudrait bien reprendre sa place. La position de sœur Claude, soigneusement voilée par l’ampleur de l’étoffe (quoiqu'on distingue opportunément la robe bien haut levée ainsi que les braies tombées de l'homme) ne laisse heureusement rien ignorer de la raison, assurément consistante, qui a attisé la fureur de ces religieuses.
Voici comment La Fontaine introduit (si j’ose dire) son récit scabreux :
« On m’engage à conter d’une manière honnête
Le sujet d’un de ces tableaux
Sur lesquels on met des rideaux :
Il me faut tirer de ma tête
Nombre de traits nouveaux, piquant et délicats,
Qui disent et ne disent pas,
Et qui soient entendus sans notes
Des Agnès même les plus sottes :
Ce n’est pas coucher gros ; ces extrêmes Agnès
Sont oiseaux qu’on ne vit jamais.
Toute matrone sage, à ce que dit Catulle,
Regarde volontiers le gigantesque don
Fait au fruit de Vénus, par la main de Junon.
A ce plaisant objet si quelqu’une recule,
Cette quelqu’une dissimule.
Ce principe posé, pourquoi plus de scrupule,
Pourquoi moins de licence aux oreilles qu’aux yeux ?
Puisqu’on le veut ainsi, je ferai de mon mieux :
Nuls traits à découvert n’auront ici de place ;
Tout y sera voilé ; mais de gaze, et si bien,
Que je crois qu’on ne perdra rien.
Qui pense finement et s’exprime avec grâce,
Fait tout passer, car tout passe :
Je l’ai cent fois éprouvé :
Quand le mot est bien trouvé,
Le sexe en sa faveur à la chose pardonne :
Ce n’est plus elle alors, c’est elle encor pourtant.
Vous ne faites rougir personne,
Et tout le monde vous entend.
J’ai besoin aujourd’hui de cet art important.
Pourquoi, me dira-t-on, puisque sur ces merveilles,
Le sexe porte à l’œil sans toutes ces façons ?
Je réponds à cela : chastes sont les oreilles,
Encore que les yeux soient fripons ».
Michel Foucault s'est bien éreinté à à décrire de large en long les pouvoirs respectifs des mots et des choses (Les Mots et les choses, 1966), La Fontaine se contente, quant à lui, d'évoquer la "chose" en évitant de prononcer le "mot". Si ce n'est pas ça, la littérature, j'aimerais qu'on me dise ce qui en est.
On a compris : il s'agit d'exprimer les choses les plus lestes tout en sauvegardant toutes les apparences de la décence et de la bienséance. Tout un monde superbement ignoré et relégué dans nos temps soi-disant si "progressistes". Pour bien marquer la différence, en même temps que l'état de vulgarité dans lequel le vingtième siècle a plongé l'humanité (état qui ne cesse de s'aggraver), qui préfère aller droit au but plutôt que de s'embarrasser de circonlocutions (après tout, qu'est-ce que la civilisation, sinon le détour par les mots ? Cf. Boby Lapointe, L'Ami Zantrop, qui construit sa dérision créolisante sur la Célimène et l'Alceste du Misanthrope),
on trouvera ci-dessous l'interprétation graphique de la même scène trouvée dans une édition moderne des Contes et nouvelles. L'artiste s'adresse visiblement à des "non-comprenants" : l'allusion et le "poids des mots" ne suffisent plus, il faut l'explicite et le "choc des photos", du direct, du brutal. Et l'on s'étonne encore de la vogue du porno (priez porno, pauvres pécheurs, en latin : ora pornobis).

Les nonnes sont superbes, mais il faudrait que l'artiste m'explique les positions respectives de la chaise, qui paraît entière, et du "corps" (le "timon") du délit : où est passée l'assise du siège ? De deux choses l'une, soit la chaise est brisée, comme le spécifie La Fontaine, soit le "Mazet" est coupé en deux. Auquel dernier cas la "performance" exhibée par ce dernier paraît hautement improbable. Mais je chipote, je chipote : oui, je sais bien, l'essentiel n'est pas là, il est montré. Passez muscade.
Note : je n'ai rien contre les "Agnès même les plus sottes", pourvu que.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, la fontaine, mémoires de saint-simon, mémoires du cardinal de retz, grand siècle, siècle de louuis xivutarque vies des hommes illustres, ancien régime, louis xvi, la fontaine fables, la fontaine contes et nouvelles, érotisme, agostino carracci, littérature érotique, boby lapointe, l'ami zantrop, alceste et célimène, molière le misanthrope
jeudi, 16 mars 2017
RETZ PAR SUARÈS (1868-1948)
Fin de la galerie de portraits : un regard moderne sur un homme qui fut d’une trempe exceptionnelle, et qui reste un auteur mémorable.
« Un petit homme noir, des yeux et un esprit étincelants ; une volonté ardente, tendue vers un seul objet, mais qui semble en changer, tant les mœurs de l’homme sont faciles, et tant le goût du plaisir le porte à varier sur les moyens d’y atteindre ; il a l’air de prendre toute sorte de sentiers, et c’est toujours le long de la même route, qui doit le mener au Louvre, pour y être le chef de l’Etat, pendant la Régence ; un grand nom et peu de morgue ; ni fat ni modeste, pas ombre de mélancolie ni de vanité ; peu d’orgueil, mais le sentiment de son intelligence qui est, sans comparaison, fort supérieure à tous les politiques de son temps, Cromwell excepté ; d’ailleurs beaucoup plus riche, plus brillant, plus humain, plus étendu en tous sens, et moins puissant, moins profond que le puritain d’Angleterre ; d’Eglise malgré lui, et sans aucune des vertus qui font le prélat ni le prêtre ; plus d’ambition que d’amour-propre, plus de hauteur que d’ambition, et la soif de dominer plus que tout : on ne voit en lui que l’intrigue et les oscillations d’un brouillon, il est au contraire plein d’idées et de suite, beaucoup plus sage qu’on ne croit ; d’une mesure étonnante jusque dans l’excès et l’apparence du désordre ; maître de lui à confondre tous ceux qui en doutent, qui le jugent sans le bien connaître et qui en attendent des caprices et des incartades hors de saison ; d’une modération admirable quand il semble sortir le plus de la règle ; passionné de nature et la tête la plus froide ; tout calcul quand il faut, et n’en laissant rien paraître ; prompt et pétillant au plaisir, et le moins vif en lui n’est pas de railler ses adversaires ou la fortune, comme sa volupté propre est de braver les puissances ; supérieur au point qu’il s’amuse de ce qu’il méprise et se moque de ses plus dangereux ennemis : lui-même, il est sans rancune et sans haine ; ni cruel ni méchant ; on le craint, on le proscrit, on l’estime toujours redoutable, et il est clément à tout le monde, même à ses partisans ; en vain, est-il de son temps l’homme le plus populaire de Paris : en tout, sa supériorité d’esprit l’isole. Voilà François-Paul de Gondi, cardinal de Retz. »
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, cardinal de retz, mémoires du cardinal de retz, andré suarès, paul de gondi
mercredi, 15 mars 2017
PORTRAIT D'UN CARDINAL
Chacun son tour, ce n’est que justice : après avoir été croqueur, voici croqué le cardinal de Retz. Et pas par n’importe, qui : le duc de La Rochefoucauld en personne.
« Paul de Gondi, cardinal de Retz, a beaucoup d’élévation, d’étendue d’esprit, et plus d’ostentation que de vraie grandeur et de courage. Il a une mémoire extraordinaire, plus de force que de politesse dans ses paroles ; l’humeur facile, de la docilité et de la faiblesse à souffrir les plaintes et les reproches de ses amis ; peu de piété, quelques apparences de religion. Il paraît ambitieux sans l’être ; la vanité, et ceux qui l’ont conduit lui ont fait entreprendre de grandes choses, presque toutes opposées à profession ; il a suscité les plus grands désordres de l’Etat sans avoir un dessein formé de s’en, prévaloir, et bien loin de se déclarer ennemi du cardinal Mazarin pour occuper sa place, il n’a pensé qu’à lui paraître redoutable et à se flatter de la fausse vanité de lui être opposé. Il a su néanmoins profiter avec habileté des malheurs publics pour se faire cardinal ; il a souffert sa prison avec fermeté, et n’a dû sa liberté qu’à sa hardiesse. La paresse l’a soutenu avec gloire, durant plusieurs années, dans l’obscurité d’une vie errante et cachée. Il a conservé l’archevêché de Paris, contre la puissance du cardinal Mazarin ; mais après la mort de ce ministre, il s’en est démis, sans connaître ce qu’il faisait, et sans prendre cette conjoncture pour ménager les intérêts de ses amis et les siens propres. Il est entré dans divers conclaves, et sa conduite a toujours augmenté sa réputation. Sa pente naturelle est l’oisiveté ; il travaille néanmoins avec activité dans les affaires qui le pressent, et il se repose avec nonchalance quand elles sont finies. Il a une grande présence d’esprit, et il sait tellement tourner à son avantage les occasions que la fortune lui offre, qu’il semble qu’il les ait prévues et désirées. Il aime à raconter ; il veut éblouir indifféremment tous ceux qui l’écoutent par des aventures extraordinaires, et souvent son imagination lui fournit plus que sa mémoire. Il est faux dans la plupart de ses qualités, et ce qui a le plus contribué à sa réputation est de savoir donner un beau jour à ses défauts. Il est insensible à la haine et à ‘amitié, quelque soin qu’il ait pris de paraître occupé de l’une ou de l’autre ; il est incapable d’envie ou d’avarice, soit par vertu, soit par inapplication. Il a plus emprunté de ses amis qu’un particulier ne pouvait espérer de pouvoir leur rendre ; il a senti de la vanité à trouver tant de crédit, et à entreprendre de l’acquitter. Il n’a point de goût ni de délicatesse ; il s’amuse à tout et ne s’amuse à rien ; il évite avec adresse de laisser pénétrer qu’il n’a qu’une légère connaissance de toutes choses. La retraite qu’il vient de faire est la plus éclatante et la plus fausse action de sa vie ; c’est un sacrifice qu’il fait à son orgueil, sous prétexte de dévotion : il quitte la cour où il ne peut s’attacher, et il s’éloigne du monde, qui s’éloigne de lui. »
Du grand art, où s'entremêlent avec virtuosité les marques de respect dues au rang éminent et les banderilles d’un à qui le cardinal a donné on ne sait quel ombrage. J’adore quant à moi "son imagination lui fournit plus que sa mémoire".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 14 mars 2017
PORTRAIT DE RICHELIEU
Après avoir voituré une belle « mazarinade » du cardinal de Retz, remontons un peu le cours du temps, jusqu’à son prédécesseur.
« Le cardinal de Richelieu avait de la naissance. Sa jeunesse jeta des étincelles de son mérite : il se distingua en Sorbonne ; on remarqua de fort bonne heure qu’il avait de la force et de la vivacité dans l’esprit. Il prenait d’ordinaire très bien son parti. Il était homme de parole, où un grand intérêt ne l’obligeait pas au contraire ; et en ce cas, il n’oubliait rien pour sauver les apparences de la bonne foi. Il n’était pas libéral ; mais il donnait plus qu’il ne promettait, et il assaisonnait admirablement les bienfaits. Il aimait la gloire beaucoup plus que la morale ne le permet ; mais il faut avouer qu’il n’abusait qu’à proportion de son mérite de la dispense qu’il avait prise sur ce point de l’excès de son ambition. Il n’avait ni l’esprit ni le cœur au-dessus des périls ; il n’avait ni l’un ni l’autre au-dessous ; et l’on peut dire qu’il en prévint davantage par sa sagacité que par sa fermeté. Il était bon ami ; il eût même souhaité d’être aimé du public ; mais quoiqu’il eût la civilité, l’extérieur et beaucoup d’autres parties propres à cet effet, il n’en eut jamais le je ne sais quoi, qui est encore, en cette matière, plus requis qu’en toute autre. Il anéantissait par son pouvoir et par son faste royal la majesté personnelle du Roi ; mais il remplissait avec tant de dignité les fonctions de la royauté, qu’il fallait n’être pas du vulgaire pour ne pas confondre le bien et le mal en ce fait. Il distinguait plus judicieusement qu’omme du monde entre le mal et le pis, entre le bien et le mieux, ce qui est une grande qualité pour un ministre. Il s’impatientait trop facilement dans les petites choses qui étaient préalables des grandes ; mais ce défaut, qui vient de la sublimité de l’esprit, est toujours joint à des lumières qui le suppléent. Il avait assez de religion pour ce monde. Il allait au bien, ou par inclination ou par bon sens, toutefois que son intérêt ne le portait point au mal, qu’il connaissait parfaitement quand il le faisait. Il ne considérait l’Etat que pour sa vie ; mais jamais ministre n’a eu plus d’application à faire croire qu’il en ménageait l’avenir. Enfin il faut confesser que tous ses vices ont été de ceux que la grande fortune rend aisément illustres, parce qu’ils ont été de ceux qui ne peuvent avoir pour instruments que de grande vertus.
Vous jugez facilement qu’un homme qui a autant de grandes qualités et autant d’apparences que celles même qu’il n’avait pas, se conserve assez aisément dans le monde cette sorte de respect qui démêle le mépris d’avec la haine, et qui, dans un Etat où il n’y a plus de lois, supplée au moins pour quelque temps à leur défaut. »
Dans les Mémoires, ce portrait précède immédiatement celui de Mazarin (voir hier). Il est évidemment fait pour produire avec ce dernier un splendide effet de contraste. Autant Retz respecte Richelieu, autant il n’a que mépris pour son successeur, en qui, s’il reconnaît l’habileté (mais il lui attribue la responsabilité du déclenchement de la Fronde), il ne perçoit que la bassesse de l’homme.
C’est certain, Paul de Gondi, homme d’épée dans l’âme, mais cardinal par force, était bel et bien imprégné jusqu’à la moelle des Vies des hommes illustres de Plutarque, grands hommes auxquels il rêva obstinément de s’égaler, jusqu’à ce que les obstacles que lui opposa la réalité se fissent à ce point insurmontables qu’il fut obligé de reporter toute son énergie sur la rédaction de son chef d’œuvre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, cardinal de retz, richelieu, mazarin, louis xiv, sorbonne, paul de gondi, plutarque, vies des hommes illustres
lundi, 13 mars 2017
PORTRAIT BIEN MAZARINÉ
Le cardinal de Retz vient d’achever le portrait de Richelieu. Ci-dessous, il attaque – c’est peu dire ! – celui de Mazarin.
« Le cardinal Mazarin était d’un caractère tout contraire. Sa naissance était basse et son enfance honteuse. Au sortir du Colisée, il apprit à piper, ce qui lui attira des coups de bâtons d’un orfèvre de Rome appelé Moreto. Il fut capitaine d’infanterie en Valteline ; et Bagni, qui était son général, m’a dit qu’il ne passa dans sa guerre, qui ne fut que de trois mois, que pour un escroc. Il eut la nonciature extraordinaire en France, par la faveur du cardinal Antoine, qui ne s’acquérait pas, en ce temps-là, par de bons moyens. Il plut à Chavigni par ses contes libertins d’Italie, et par Chavigni à Richelieu, qui le fit cardinal, par le même esprit, à ce que l’on a cru, qui obligea Auguste à laisser à Tibère la succession de l’Empire. La pourpre ne l’empêcha pas de rester valet sous Richelieu. La reine l’ayant choisi faute d’autre, ce qui est vrai quoi qu’on en dise, il parut d’abord l’original de "Trivelino Principe" [l'acteur Trivelin jouait les valets et les aventuriers]. La fortune l’ayant ébloui et tous les autres, il s’érigea et l’on l’érigea en Richelieu ; mais il n’en eut que l’impudence de l’imitation. Il se fit de la honte de tout ce que l’autre s’était fait de l’honneur. Il se moqua de la religion. Il promit tout parce qu’il ne voulut rien tenir. Il ne fut ni doux ni cruel, parce qu’il ne se ressouvenait ni des bienfaits ni des injures. Il s’aimait trop, ce qui est le naturel des âmes lâches ; il se craignait trop peu, ce qui est le caractère de ceux qui n’ont pas de soin de leur réputation. Il prévoyait assez bien le mal, parce qu’il avait souvent peur ; mais il n’y remédiait pas à proportion, parce qu’il n’avait pas tant de prudence que de peur. Il avait de l’esprit, de l’insinuation, de l’enjouement, des manières ; mais le vilain cœur paraissait toujours au travers, et au point que ces qualités eurent, dans l’adversité, tout l’air du ridicule, et ne perdirent pas, dans la plus grande prospérité, celui de fourberie. Il porta le filoutage dans le ministère, ce qui n’est jamais arrivé qu’à lui ; et ce filoutage faisait que le ministère, même heureux et absolu, ne lui seyait pas bien, et que le mépris s’y glissa, qui est la maladie la plus dangereuse d’un Etat, et dont la contagion se répand le plus aisément et le plus promptement du chef dans les membres. »
Littérature, conscience historique, connaissance de l'homme, rien ne manque.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, cardinal de retz, mémoires de retz, richelieu, mazarin
dimanche, 12 mars 2017
MAZARIN
On est à la cour de Louis XIII, à la veille de la mort du roi. Le cardinal de Richelieu est mort. Le futur Louis XIV est au berceau.
« Le Roi, son père, qui n’aimait ni n’estimait la Reine, sa femme, lui donna, en mourant, un conseil nécessaire pour limiter l’autorité de sa Régence ; et il y nomma M. le cardinal Mazarin, Monsieur le Chancelier, M. Boutiller et M. de Chavigny. Comme tous ces sujets étaient extrêmement odieux au public, parce qu’ils étaient tous créatures de M. le cardinal de Richelieu, ils furent sifflés par tous les laquais, dans les cours de Saint-Germain, aussitôt que le Roi fut expiré ; et si M. de Beaufort eût eu le sens commun, ou si M. de Beauvais n’eût pas été une bête mitrée, ou s’il eût plus à mon père d’entrer dans les affaires, ces collatéraux de la Régence auraient été infailliblement chassés avec honte, et la mémoire du cardinal de Richelieu aurait été sûrement condamnée par le Parlement avec une joie publique. »
Suivent les premiers pas du nommé Mazarin, occasion d’un premier portrait.
« L’on voyait sur les degrés du trône, d’où l’âpre et redoutable Richelieu avait foudroyé plutôt que gouverné les humains, un successeur doux, bénin, qui ne voulait rien, qui était au désespoir que sa dignité de cardinal ne lui permettait pas de s’humilier autant qu’il l’eût souhaité devant tout le monde, qui marchait dans les rues avec deux petits laquais derrière son carrosse. »
Mais les apparences sont trompeuses. L’arrestation de M. de Beaufort est le premier geste fort par lequel Mazarin commence à impressionner la Cour.
« L’on se croyait bien obligé au Ministre de ce que, toutes les semaines, il ne faisait pas mettre quelqu’un en prison, et l’on attribuait à la douceur de son naturel les occasions qu’il n’avait pas de mal faire. Il faut avouer qu’il seconda fort habilement son bonheur. Il donna toutes les apparences nécessaires pour faire croire que l’on l’avait forcé à cette résolution ; que les conseils de Monsieur et de Monsieur le Prince l’avaient emporté dans l’esprit de la Reine sur son avis. Il parut encore plus modéré, plus civil et plus ouvert le lendemain de l’action. L’accès était tout à fait libre, les audiences étaient aisées, l’on dînait avec lui comme avec un particulier ; il relâcha même beaucoup de la morgue des cardinaux les plus ordinaires. Enfin il fit si bien qu’il se trouva sur la tête de tout le monde, dans le temps que tout le monde croyait l’avoir encore à ses côtés. Ce qui me surprend, est que les princes et les grands du royaume, qui pour leurs propres intérêts devaient être plus clairvoyants que le vulgaire, furent les plus aveuglés. Monsieur se crut au-dessus de l’exemple ; Monsieur le Prince, attaché à la cour par son avarice, voulut s’y croire ; Monsieur le Duc était d’un âge à s’endormir aisément à l’ombre des lauriers ; M. de Longueville ouvrit les yeux, mais ce ne fut que pour les refermer ; M. de Vendôme était trop heureux de n’avoir été que chassé ; M. de Nemours n’était qu’un enfant ; M. de Guise, revenu tout nouvellement de Bruxelles, était gouverné par Mlle de Pons, et croyait gouverner la cour ; M. de Bouillon croyait de jour en jour que l’on lui rendrait Sedan ; M. de Turenne était plus que satisfait de commander les armées d’Allemagne ; M. d’Espernon était ravi d’être rentré dans son gouvernement et dans sa charge ; M. de Schomberg avait toute sa vie été inséparable de tout ce qui était bien à la cour ; M. de Gramont en était esclave ; et MM. De Retz, de Vitry et de Bassompierre se croyaient, au pied de la lettre, en faveur, parce qu’ils n’étaient plus ni prisonniers ni exilés. Le Parlement, délivré du cardinal de Richelieu, qui l’avait tenu fort bas, s’imaginait que le siècle d’or serait celui d’un ministre qui leur disait tous les jours que la Reine ne se voulait conduire que par leurs conseils. Le clergé, qui donne toujours l’exemple de la servitude, la prêchait aux autres sous le titre d’obéissance. Voilà comme tout le monde se trouva en un instant Mazarin. »
Ainsi écrivait-on, quand on s’appelait François-Paul de Gondi, plus connu pour les Mémoires qu'il a laissés et par son titre de "cardinal de Retz". Une leçon.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, tittérature française, paul de gondi, cardinal de retz, mémoires de retz, louis xiii, louis xiv, mazarin, prince de condé
dimanche, 05 mars 2017
DÉLICE DE VIALATTE
 Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,
Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,
 collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.
collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.
J’ai commencé par me plonger dans le recueil des articles parus dans Le Spectacle du monde entre 1962 et 1971 (mes parents furent un de ces temps abonnés à la revue, mais je confesse que j'étais alors passé complètement à côté de ces articles : je devais être un peu trop vert pour saisir la méthode et la subtilité de la langue de Vialatte, même si je n'ai pas trop tardé à m'y mettre).
Dire combien je me régale depuis quelques dizaines d’années avec la prose de Vialatte relèverait du pléonasme, voire de la simple balourdise. Hommage à un grand homme de la langue française. Ce plaisir n’a pas pris une ride. Mieux : il se bonifie et s’intensifie avec le temps. Je recommande les références savantes à Phorcypeute l'Enumérateur, Hermogène le Guttural, Phyte l'Environnaire, et même le vicomte Amable de Vieuval. Elles valent les trouvailles des "proverbes bantous" et de l'uzvarèche.
« La femme remonte à la plus haute antiquité. Phorcypeute l’Enumérateur la cite déjà dans ses ouvrages. Le vicomte Amable de Vieuval fait mention d’elle avec vivacité dans son Tableau des chemins de fer suisses, suivi d’un Eloge du printemps et Casanova la raconte avec la plus grande affection. Elle a su provoquer le lyrisme d’Hermogène le Guttural et de Phyte l’Environnaire. Horace la vante et Pétrarque l’exalte, le Dr Gaucher l’étudie. C’est l’effet de sa grande importance, car elle joue un rôle capital dans la suite des générations et le déroulement même de l’histoire.
Faut-il rappeler Marguerite de Bourgogne, Hélène de Troie, Emilienne d’Alençon ? Citer Mme Steinheil ou la belle Otéro ? Leurs noms sont dans toutes les mémoires. On montre encore dans les sous-sols du musée Grévin la petite baignoire-sabot en zinc, munie d’un couvercle à charnières, dans laquelle Charlotte Corday immola le cruel Marat. Mme Roland faisait les discours de son mari. La femme de Poetus montrait à son époux comment il faut s’ouvrir les veines. Mme Tolstoï exhortait le sien à écrire d’excellents romans plutôt que de faire de mauvaises bottes [historique].
Sans la femme, l’enfant serait sans mère, le père sans fille, le beau-frère sans belle-sœur, l’oncle sans nièce, l’époux sans veuve. Supprimez-la, l’opéra perd son charme, l’écran ses bustes les plus beaux. Sans elle, au Grand Café il n’y aurait plus de caissière, même à l’heure de l’apéritif, entre deux pots de sansevieria de valeur moyenne. L’homme vivrait comme un orphelin. Recueilli par charité dans d’immenses internats par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ou les Frères des écoles chrétiennes, il mènerait dans de grandes casernes une existence d’enfant trouvé, sans autre distraction que la promenade du jeudi, sous l’œil indifférent d’un gardien en casquette, dont les réprimandes salariées ne sauraient remplacer les discussions de famille. De longs troupeaux de quinquagénaires rasés sans soin et brossés sans vigueur se traîneraient sur les routes nationales, rêvant vainement de retrouver aux grandes vacances, pour jouer au croquet et boire du chocolat, des cousines en jupe à plis plats, dans de vieux jardins ornés d’ocubas et de tilleuls. Le soir ramènerait l’homme à son orphelinat. Il y jouerait aux cartes, il fumerait du tabac, il parierait aux courses, il boirait du vin rouge, il sombrerait dans des plaisirs grossiers. Les droits de la femme ne seraient plus défendus. Les travaux de George Sand perdraient toute importance. Des chauves barbus devraient remplacer au pied levé le jury du prix Femina, et manger des petits-fours en buvant du thé tiède. Avec la femme, au contraire, tout s’anime, tout se passionne, la vie reprend ses droits. Elle se marie, elle divorce, elle enfante, elle trompe le boulanger avec le pharmacien ; elle renverse les ministères, elle jette ses enfants par la fenêtre, elle tricote des layettes bleu-pâle sur la ligne Italie-Nation. Enveloppée d’un manteau de vison, elle porte en tête des cortèges politiques une pancarte d’un mètre-carré, qui proclame : « Nous voulons du pain ». Elle tape le courrier de l’homme, elle le porte à signer, il signe, elle l’embrasse, elle l’épouse ; de temps en temps elle le vitriole. L’homme assiste impuissant, l’œil vide, à toutes ces manifestations. Elle lui dispute le bureau et l’usine, elle lui a chipé son pantalon. De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler quatre-vingt-dix heures par semaine.
C’est un progrès considérable et apprécié.
D’où vient la femme ? Du même jardin que l’homme. Louis XIV avait chargé l’évêque de Beauvais, si j’ai bonne mémoire, d’en retrouver l’emplacement exact. L’évêque le situa à peu près au confluent du Tigre et de l’Euphrate. C’est de là que la femme s’est répandue partout. Sous toutes ses formes. Elles sont nombreuses. Jean Dubuffet, qui aime les contours tremblés, lui donne souvent la figure du Danemark, dont la silhouette l’avait frappé dans son enfance sur les cartes géographiques. Mais l’époque en impose bien d’autres, telles que la ligne haricot vert, la ligne diabolo, la ligne corde à nœuds (la ligne saucisson est innée). Autant en emporte la mode. Bref, la femme est épisodique.
Le Dr Garnier, dans son ttraité du mariage légal, la définit par son opposition à l’homme. « L’homme, lit-il [sic], est altier, pileux, dominateur ; sa texture fibreuse et compacte ; ses cheveux raides, sa barbe noire et bien fournie ; sa poitrine fortement velue exhale le feu qui l’embrase. » La femme a « la figure plus courte et le caractère plus timide, les genoux plus gros, la graisse plus blanche, et le foie plus volumineux ». On voit par là que le Dr Garnier a pris l’homme pour Garibaldi. Sa description de la femme en perd en vraisemblance, ou au moins en portée générale.
Il paraîtra plus équitable de constater que la femme, au moins au XX° siècle, se compose d’une âme immortelle et d’un manteau de renard en chèvre façon loup. Le "drapé en vrille" et "l’ourlet explosif" lui donnent une silhouette étonnante ; sa bouche enduite de Top Secret "va du beige rosé au rouge vibrant". Des substituts de beauté la frottent, la "désincrustent", la hachent, la raclent, la flagellent, la pincent, la rabotent, la triturent, la battent en neige, la roulent dans la farine, et la déroulent sans un faux-pli. Puis la font sécher sur une corde.
(…) ».
Sans commentaire.
Merci, monsieur Vialatte.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : les publicitaires n'ont honte de rien. Un ramassis de tâcherons de je sais plus quelle basse extraction avaient piqué sans vergogne à Vialatte le "truc" des deux dernières phrases, comme on le voit ci-dessous :

Je me souviens que le réjouissant dans l'affaire avait été les hauts cris poussés par les féministes qui, n'ayant honte de rien non plus, prétendent parler "au nom de toutes les femmes", et qui étaient à cette occasion montées à l'assaut de cette publicité, au motif qu'elle "portait atteinte à la dignité des femmes", alors qu'on sait que toute publicité est, par essence et par nature, une atteinte à la dignité humaine en général. Mais on sait malheureusement qu'un militant, quelle que soit la cause qu'il brandit, a pour métier de tirer toute la couverture à lui. Une revue « bête et méchante » aujourd'hui disparue avait même fait du thème un slogan : « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, résumons-nous, chroniques de la montagne vialatte, proverbe bantou, uzvarèche, phorcypeute l'énumérateur, ferny besson, éditions julliard, bouquins laffont, bananes de königsberg, almanach des quatre saisons vialatte
mercredi, 01 mars 2017
MIETTES DE SAINT-SIMON

En frontispice du tome I (volume I), « Louis, duc de Saint-Simon Vermandois ».
Relevé dans le tome IV (1698) des Mémoires de Saint-Simon (Louis, duc de) :
« Son ami le duc de Gesvres, qui quelquefois faisait le lecteur et retenait quelques mots qu'il plaçait comme il pouvait, causant un jour dans les cabinets du roi, et admirant en connaisseur les excellents tableaux qui y étaient, entre autres plusieurs crucifiements de Notre-Seigneur, de plusieurs grands maîtres, trouva que le même en avait fait beaucoup, et tous ceux qui étaient là. On se moqua de lui, et on lui nomma les peintres différents qui se reconnaissaient à leur manière. "Point du tout, s'écria le marquis, ce peintre s'appelait INRI ; voyez-vous pas son nom sur tous ces tableaux ?" On peut imaginer ce qui suivit une si lourde bêtise, et ce que put devenir un si profond ignorant. ».

Le peintre dont il est parlé ci-dessus était sans doute le bien connu "Jésus de Nazareth Roi des Juifs". Pauvre duc de Gesvres : il fut un temps où le ridicule tuait.
Le tome III des Mémoires rapporte quelques anecdotes d'un tonneau qui devait être voisin de cave. Imaginez le tsar en Hollande, pour s'initier incognito aux secrets des métiers de la charpenterie de marine (il a de grandes ambitions pour la Russie). Il est "czar" chez Saint-Simon, mais "zar" dans l'opéra de Lortzing, Zar und Zimmermann (Tsar et charpentier).

L'incognito est, semble-t-il, bien léger, puisqu'il doit un jour recevoir les ambassadeurs d'Angleterre, dont il est vexé du peu d'intérêt qu'ils lui portent. Il se venge de la façon que voici :
« Enfin, l'ambassade arriva : il différa de lui donner audience, puis donna le jour et l'heure, mais à bord d'un gros vaisseau hollandais qu'il devait aller examiner. Il y avait deux ambassadeurs qui trouvaient le lieu sauvage, mais il fallut bien y passer. Ce fut bien pis quand ils furent arrivés à bord. Le czar leur fit dire qu'il était à la hune, et que c'était là où il les verrait. Les ambassadeurs, qui n'avaient pas le pied assez marin pour hasarder les échelles de corde, s'excusèrent d'y monter ; le czar insista, et les ambassadeurs, fort troublés d'une proposition si étrange et si opiniâtre ; à la fin, à quelques réponses brusques aux derniers messages, ils sentirent bien qu'il fallait sauter ce fâcheux bâton, et ils montèrent. Dans ce terrain si serré et si fort au milieu des airs, le czar les reçut avec la même majesté que s'il eût été sur son trône ; il écouta la harangue, répondit obligeamment pour le roi et la nation, puis se moqua de la peur qui était peinte sur le visage des ambassadeurs, et leur fit sentir en riant que c'était la punition d'être arrivés auprès de lui trop tard ».
Pour le dire simplement : je me régale.
Allez, juste pour le plaisir, un portrait bien gratiné au four, tiré de la fin du tome II :
« Madame de Castries était un quart de femme, une espèce de biscuit manqué, extrêmement petite, mais bien prise, et aurait passé dans un médiocre anneau ; ni derrière, ni gorge, ni menton, fort laide, l'air toujours en peine et étonné, avec cela une physionomie qui éclatait d'esprit et qui tenait encore plus parole. Elle savait tout : histoire, philosophie, mathématiques, langues savantes, et jamais elle ne paraissait qu'elle sût mieux que parler français ; mais son parler avait une justesse, une énergie, une éloquence, une grâce jusque dans les choses les plus communes, avec ce tour unique qui n'est propre qu'aux Mortemart. Aimable, amusante, gaie, sérieuse, toute à tous, charmante quand elle voulait plaire, plaisante naturellement avec la dernière finesse sans le vouloir être, et assénant aussi les ridicules à ne les jamais oublier, glorieuse, choquée de mille choses avec un ton plaintif qui emportait la pièce, cruellement méchante quand il lui plaisait, et fort bonne amie, polie, gracieuse, obligeante en général, sans aucune galanterie, mais délicate sur l'esprit et amoureuse de l'esprit où elle le trouvait à son gré ; avec cela un talent de raconter qui charmait, et, quand elle voulait faire un roman sur-le-champ, une source de production, de variété et d'agrément qui étonnait ».
Je ne m'en lasse pas.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis duc de saint-simon vermandois, mémoires de saint-simon, littérature, littérature française, lortzing zar und zimmermann
jeudi, 01 décembre 2016
LA VIE DANS LA VITRE APRÈS LA FERMETURE
Le Chesterfield.
Photographie Frédéric Chambe.
« Ce ne sera pas vraiment la fortune. Ils [Jérôme et Sylvie] ne seront jamais présidents-directeurs-généraux. Ils ne brasseront jamais que les millions des autres. On leur en laissera quelques miettes, pour le standing, pour les chemises de soie, pour les gants de pécari fumé. Ils présenteront bien. Ils seront bien logés, bien nourris, bien vêtus. Ils n'auront rien à regretter.
Ils auront leur divan Chesterfield, leurs fauteuils de cuir naturel souples et racés comme des sièges d'automobile italienne, leurs tables rustiques, leurs lutrins, leurs moquettes, leurs tapis de soie, leurs bibliothèques de chêne clair.
Ils auront des pièces immenses et vides, lumineuses, les dégagements spacieux, les murs de verre, les vues imprenables. Ils auront les faïences, les couverts d'argent, les nappes de dentelle, les riches reliures de cuir rouge.
Ils n'auront pas trente ans. Ils auront la vie devant eux ».
On trouve ça dans les dernières pages de Les Choses, de Georges Perec, le mémorable "prix Renaudot" 1965.
A comparer avec les derniers mots du Soumission de Michel Houellebecq : « Un peu comme cela s'était produit, quelques années auparavant, pour mon père, une nouvelle chance s'offrirait à moi ; et ce serait la chance d'une deuxième vie, sans grand rapport avec la précédente.
Je n'aurais rien à regretter ».
Autre différence : sorti début janvier 2015 (je l'ai acheté le 6, la veille de), c'était trop tard pour le Renaudot (ou trop tôt, c'est selon).
*********************
*********************
Rions un peu.
Entendu le soir de la victoire de Fillon à la primaire, un juppéiste de la plus belle eau (qui ?) déclarant : « Il va de soi que tous les amis d'Alain Juppé se rassemblent dès maintenant pour se ranger devant ... euh ... derrière François Fillon ».
Comme le chantait Claude Nougaro : « Les p'tits bruns et les grands blonds, Quand ils sont entre garçons, Les p'tits bruns et les grands blonds Rient comme des fous, sont comme des frères ».
*******************
Pour compléter la photo ci-dessus.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, perec les choses, georges perec, prix renaudot, michel houellebecq, houellebecq soumission, littérature, divan chesterfield, jérôme et sylvie, claude nougaro, les petits bruns et les grands blonds, françois fillon, alain juppé
jeudi, 17 novembre 2016
THRILLER, POLAR ET NOIR
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
LES RIVIÈRES POURPRES
 J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.
J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.
Lire en série des Maigret, des San Antonio, voire des Manuel Vasquez Montalban (Roldan ni mort ni vif, La Rose d'Alexandrie, Le Quintette de Buenos Aires, ...) ou des Michael Connally (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, Les Egouts de Los Angeles) produit le même effet : ça rentre par un neurone, et ça sort par l’autre. Cette littérature n’est pas faite pour s'éterniser dans son lecteur et, pourquoi pas, le modifier, comme le font certains certains chefs d'œuvre.
Tout ça pour dire que, bien je ne me nourrisse pas que de lectures « sérieuses » ou de « grande littérature », et que moi aussi, j’aime juste passer de temps en temps « un bon moment », je n’en confonds pas pour autant ces différents registres, qui s'adressent à des niveaux, à des hauteurs très différents du lecteur : il y a une hiérarchie des valeurs littéraires, n'en déplaise aux "abatteurs de frontières". Moins ambitieux par principe, les « polars », « thrillers », « noirs » ne sont pas faits, au moins a priori, pour prendre racine durablement dans l’esprit de celui qui les prend en main. Ce sont des livres « à consommer ». Or on sait comment finit ce que nous consommons : au trou. Passons vite.
Car je viens de relire Les Rivières pourpres. C’est vrai que c’est le genre de livre qui « fait passer le temps », mais c’est du temps perdu. Inutile de partir à sa recherche. A cause de la structure particulière de tous les romans qui finissent sur le dévoilement du mystère ou de l’énigme, que l’auteur nous y livre l’identité du coupable, reconstitue l'enchaînement des faits et le rôle de chacun des personnages, ou qu’il expose la nature du complot qui a été mis en échec.
Ces livres (tout comme les films), dont l'intégralité du travail de construction de l'intrigue est orientée en direction d'une fin conçue comme la solution d'un problème, ces livres dont il ne faut surtout pas raconter la fin sous peine de passer pour un gougnafier qui vous savonne la planche de salut, ces livres qui perdent tout intérêt aux yeux de ceux qui ne l'ont pas lu dès qu'on vient de leur dire qui a tué, ces livres où le détective (le commissaire fait aussi ça très bien) est à l'arrivée tel qu'il était au départ, pli du pantalon et brushing compris (ragoût de mouton mitonné par Germaine toléré), ces livres ont moins de valeur que Lucien Leuwen ou Illusions perdues, où les personnages subissent jusque dans leur être l'action du temps, des autres et des événements. Il y a une trajectoire indéterminée dans la grande littérature. Dans le polar etc., il y a une boucle : le point d'arrivée était le point de départ. L'écrivain sait où il va, ce qu'il fait. Je simplifie. Je schématise. Je caricature. Je sais qu'il y a des exceptions. N'empêche que.

Je n'ai pas vu le film.
Dans Les Rivières pourpres, il s’agit d’un complot. Il y a des coupables. Beaucoup de coupables. Et très peu d'innocents, à commencer par le commissaire Niémans, qui s'occupe de l'affaire, capable de tuer un supporter de football trop violent. Même le lieutenant (on ne dit plus "inspecteur") Karim Abdouf, qui partage l'enquête avec lui, porte quelques menues peccadilles sur la conscience, et n'hésite pas au besoin sur les moyens à utiliser pour arriver à ses fins.
Prenez un beau complot, façonnez-le méticuleusement pour lui donner une forme définitive et présentable. C’est en général dans les dernières pages du roman que la grande explication vous sera donnée par un des principaux personnages, qui vous mettra sur la table la carte géographique de toute la machination et en reconstituera sous vos yeux éberlués la logique implacable.
Grangé vous place ici dans une université renommée située dans un patelin improbable (Guernon ne figure pas dans le répertoire des communes de France), non loin de Grenoble. Au sein de l’université est installée une caste archi-héréditaire de chercheurs brillants, qui vit depuis très longtemps en autarcie. Les mariages de plus en plus consanguins ont produit de véritables phénomènes intellectuels, mais en faisant de ces phénomènes des petites natures au plan physique. Mais aussi des malades mentaux.
Pour donner un coup de fouet régénérateur à cette fin de race, deux illuminés de la génération qui précède la présente ont élaboré un magnifique plan : un aide-soignant de la maternité et le chef de la bibliothèque universitaire. Le premier, à chaque fois qu'une des universitaires concernées va mettre bas, substitue au bébé celui d’une femme venant d’un village de montagne (Taverlay, lui aussi inconnu au bataillon), parce que c’est bien connu : les enfants d’universitaires ont des corps chétifs, alors que les petits montagnards sont des forces de la nature. Tout le monde sait ça. Ainsi va-t-on fabriquer des enfants qui auront à la fois un grand cerveau et un corps à toute épreuve : des savants et des alpinistes hors-pair. Je ne sais plus quel autre illuminé voulait collecter le sperme de tous les prix Nobel pour en féconder des femelles de compétition. C'est sur un tel fantasme que le bouquin est bâti.
Après l'école, les gamins intègrent l'université. C'est là que le bibliothécaire intervient. De son côté, il falsifie les états-civils pour dissimuler l’opération et s’arrange pour toujours placer (c'est lui qui assigne à chacun sa place) le même garçon en face de la même fille. Et devinez ce qui arrive : dans 70% des cas, ça finit par un mariage qui assurera la régénération de la race : si, si, c'est comme ça que ça marche ! Du moins à ce qu'on dit. Que l’aide-soignant et le bibliothécaire du bouquin soient de complets tarés mentaux, schizophrène ou paranoïaque, en tout cas des psychopathes accomplis, n’a finalement rien d’étonnant.
Si le bouquin souffre d’une faiblesse, c’est bien 1 - à cause de ce projet foireux, qui aboutit contre toute vraisemblance à la formation d'individus qui sont des forces de la nature (intellectuellement et physiquement), et 2 - à cause de cette invraisemblable façon de procéder, poursuivie inlassablement sur au moins deux générations. Conclusion : thèse, hypothèse, foutaise. C’est dommage, parce que, du coup, ça dégonfle tant soit peu la baudruche.
C’est d’autant plus dommage que tout le reste est absolument remarquable. Le commissaire déséquilibré qui a des crises de violence pure, le lieutenant Karim Abdouf en dreadlocks qui pique une voiture, la scène dans le caveau du cimetière de Sarzac (Lot ?), ça c'est de la peinture. Le découpage et la succession des séquences comme un montage cinématographique fiévreux, l’agencement des situations, les caractères des personnages comme leurs relations, la construction logique de l’édifice, tout cela s’emboîte à la perfection.
Techniquement, ce thriller-polar-noir est donc irréprochable, parce qu'il laisse espérer la découverte de quelque chose d'inouï, de grandiose, d'extraordinaire. A l'arrivée, on reste sur sa faim, un peu déçu de tomber sur une petite magouille improbable. Cela veut dire que l’ « idée » qui est au départ du roman, qui est admirablement servie par un « métier » incontestable, un métier de malade, genre M.O.F. (col tricolore) ou Compagnon du Tour de France, ne se situe malheureusement pas à la même hauteur que la mécanique savantissime artistement élaborée pour la mettre en valeur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, jean-christophe grangé, les rivières pourpres, le vol des cigognes, le concile de pierre, l'empire des loups, commissaire maigret, san antonio, michael connally, le poète connally, la blonde en béton, le cadavre dans la rolls, les égouts de los angeles, polar, roman noir, roman policier, thriller
vendredi, 28 octobre 2016
NADEEM ASLAM : LA VAINE ATTENTE
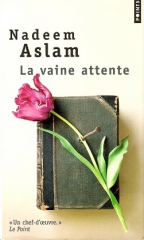 NADEEM ASLAM : LA VAINE ATTENTE
NADEEM ASLAM : LA VAINE ATTENTE
Je viens de lire La Vaine attente, livre de Nadeem Aslam, écrivain d’origine pakistanaise vivant en Angleterre depuis ses quatorze ans. Ce bouquin paru en 2009 délivre un message unique et puissant : la religion musulmane est, sur le plan humain, une pure et simple aberration. Ceux qui considèrent l'islam comme une religion "comme les autres" se fourrent le doigt dans l’œil. Remarquez que l'Occident ne sort pas trop grandi de l'histoire. Pas pour la religion, mais question cruauté, ce serait plutôt un partout, avec avantage tout de même aux fanatiques islamiques.
L'islam est une aberration qui fournit à une foule de malades mentaux les éléments nécessaires pour répandre la terreur autour d’eux si la fantaisie ou l'appétit de pouvoir les prend. Première aberration qui me revienne de la lecture : quand Mahomet scellait un marché avec une femme, il avait trouvé un détour pour ne pas se "souiller" en lui serrant la main, en plongeant la sienne dans une jarre pleine d’eau, dans laquelle elle n’avait plus qu’à faire de même pour que cette sorte de signature vaille validation. Il ne serrait pas la main des femmes, mais pour assurer sa descendance, il n'a pas hésité à les toucher de près, et en profondeur. Une religion de malades, quoi.
A l'époque de l'Afghanistan ouvert, accueillant et tolérant, le vieux Marcus, dont la maison de six pièces est située non loin de la ville d’Usha, s’est converti à l’islam pour pouvoir épouser Qatrina. Tous les murs, à l’intérieur de la maison, sont peints de scènes, de paysages et de personnages, que Marcus a soigneusement couverts d’une couche de boue quand les talibans ont pris le pouvoir : il sait qu’ils interdisent toute musique et toute représentation de la figure humaine. Il a bien fait : les rares endroits laissés visibles sont mitraillés au kalachnikov.
Qatrina aime peindre. Elle a réalisé quatre-vingt-dix-neuf peintures pour honorer chacun des noms par lesquels le Coran glorifie Allah (le très miséricordieux, etc.), et les a entreposées dans une malle. Cette malle, Marcus la retrouve je ne sais plus où, et la soustrait à son voleur. Arrêté pour cela en tant que voleur présumé (il est incapable de prouver qu’elle est à lui), il est condamné à se voir trancher la main. Et c’est à Qatrina que les talibans donne le scalpel pour que la peine soit exécutée.
Elle en deviendra folle et, dans sa folie, pendant toute la durée de l’hospitalisation de Marcus, cloue au plafond tous les livres de sa bibliothèque (voir l'image de couverture), qui comporte une foule d’exemplaires précieux et anciens. Ensuite accusée d’avoir vécu des dizaines d’années dans le péché avec cet homme (un mariage prononcé par une femme n’est pas valable aux yeux d'Allah), on la condamne à la lapidation. Elle mettra huit jours à mourir, mise à croupir dans une cellule, avec les asticots qui lui tombent du nez dans la bouche.
On n’en finirait pas d’énumérer les atrocités commises par tous les « bons musulmans » qui peuplent le livre (dont le terrible « buzkashi » par lequel les « dukhi » afghans à cheval se disputent un butin nommé Benedikt, le déserteur russe frère de Lara, qui finit comme on peut le deviner : en charpie). Par le personnage de Casa (Giocante Casabianca, l’homme sans nom ainsi baptisé quand il était petit), l’auteur nous fait entrer dans l’esprit, les raisonnements et la vision du monde qui peuvent ou doivent être ceux d’un musulman pur et dur, qui a voué sa vie à la destruction des ennemis de l’islam et de l’Afghanistan. L’effet est saisissant.
Il serait injuste de ne pas mentionner la présence des Américains, en la personne de David Town, un ancien de la CIA qui, dégoûté, a quitté le service, et de James Palantine, fils de Christopher (un ami de David, qui s'est suicidé pour des raisons x), et membre actif et très opérationnel des « Forces spéciales », sans pitié pour ceux qu’il considère comme les ennemis de la sacro-sainte Amérique, celle précisément dont David Town s’est débarrassé des mythes pour ne plus voir devant lui que des personnes humaines (David tend la main à Casa en le faisant travailler à la fabrication à la façon indienne d'un canoë destiné à se promener sur le lac ; Casa le remerciera en se faisant sauter avec lui sur une mine oubliée dans le jardin de Marcus).
Pour obtenir des informations du nommé Casa, James, en effet, n’hésite pas à lui faire "travailler" un œil au chalumeau jusqu'à ce qu'il coule. « Merci pour ce moment », a-t-on envie d’ajouter.
Nadeem Aslam n’oublie pas de faire mention des rivalités tribales qui opposent les Afghans entre eux de toute éternité. J’ai évoqué Benedikt, le déserteur russe, devenu le butin convoité par deux clans rivaux, avec l’abomination qui en découle. Mais la rivalité quasi-tribale qui oppose Nabi Khan et Gul Rasool n’est pas mal non plus.
Ce dernier utilise les Américains en leur faisant croire qu’il est de leur côté, pendant que l’autre passe aux yeux de ces benêts soi-disant civilisés pour des crapules fanatisées. Rasool se garde de dire à ses protecteurs qu’il détourne à son profit une large part de l’aide alimentaire fournie par la « communauté internationale » au peuple afghan qui souffre. Nabi Khan lui enverra une dizaine d'hommes-explosifs.
Je ne parle pas des personnages absents (morts) dont les vivants sont à la recherche (Zameen, Bizhad, on ne sait plus bien de qui ils sont fils, frères ou épouses).
Tout le livre est à la recherche d’un monde définitivement perdu ; d’un temps où l’Afghanistan était le pays de la paix, de l'hospitalité et de l’accueil de l’étranger ; d’un temps où Marcus pouvait épouser (moyennant conversion) une musulmane, fonder une fabrique de parfum, exhumer sans scandale une tête monumentale de Bouddha couché, tête qui laissera couler de l’or des blessures infligées par les kalachnikovs des talibans. Depuis ces temps pacifiques auxquels les vieux pensent avec nostalgie, la religion musulmane a rallumé l'incendie de l'intolérance et de la "guerre aux infidèles".
La thèse principale de l’auteur reste en effet que l’islam, en se répandant comme une traînée de poudre au septième siècle et en conquérant presque sans coup férir des territoires gigantesques, a fait subir à des civilisations et à des sociétés avancées et prospères une régression enragée, dans un violent retour au moyen âge. Les musulmans y sont décrits comme cette perdrix mise en cage, et qui ne cesse de balancer la tête d’avant en arrière, comme ces petits musulmans que des fascistes obligent à lire le Coran pour les imprégner jusqu'à la moelle de la Vérité révélée.
Ce livre salutaire devrait, pour nous occidentaux, sonner le tocsin. Il ne faut pas confondre tolérance et aveuglement.
Un roman qui est un manifeste, un cri d'alarme poussé par quelqu'un qui vient de par là-bas, et qui doit savoir de quoi il cause.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nadeem aslam, la vaine attente aslam, islam, musulmans, islamistes, talibans, afghanistant, religion, mahomet, allah, oussama ben laden, mollah omar, le coran, sourate, cia, central intelligence agency, amérique, états-unis
dimanche, 02 octobre 2016
40 BALZAC : L'ENFANT MAUDIT

Balzac par Nadar (Félix Tournachon).
Dessin préparatoire au "Panthéon de Nadar" (défilé de 249 caricatures des gens (+ ou -) à notoriété, paru en 1854).
Le schéma sur lequel est construit ce récit paraît caricatural. L’action de situe en pleine guerre de religion. Jeanne de Saint-Savin, douce et frêle jeune fille, aimait le jeune Georges de Chaverny qui avait le tort d’être un vilain parpaillot. Elle est obligée par sa famille et par la situation d’épouser le comte d’Hérouville, seigneur normand, homme déjà âgé, mais aussi brutal et fanatique, tant comme catholique que comme royaliste et comme chef d’une maison de grande noblesse, qui la terrorise. Jusqu’alors sans enfant, il attend de sa jeune épouse un héritier mâle capable de perpétuer dignement la lignée.
Comme il a eu vent des sentiments de Jeanne pour un autre, il la menace du pire si elle accouche avant les neuf mois réglementaires. Catastrophe, le bébé va naître à sept mois. Le vieux d’Hérouville est persuadé qu’il n’est pas de lui.
Pour que l’événement se passe au mieux, on assiste alors à une étonnante mascarade : le seigneur et son serviteur de confiance se déguisent et vont proprement enlever en pleine nuit le très savant et mystérieux Beauvouloir, « un rebouteur » à la « réputation équivoque attachée à un médecin chargé d’œuvres ténébreuses », sommé, une fois à pied d’œuvre, de présider à l’accouchement. Le comte laisse vivre l’enfant, car l’accoucheur lui a déclaré qu’il ne vivrait pas, tant il était chétif.
C’est ainsi que naît Etienne d’Hérouville. Inutile de dire que son père légal le hait et ordonne qu’il grandisse dans une masure attenant au château, sans jamais en franchir les murs, sous peine de mort. Etienne restera, tant qu’il vivra, d’une touchante et terrible fragilité. Comme dit le bon Beauvouloir, une telle nature est toute âme. Maximilien, son cadet, sera l’exact opposé, viril, vigoureux et obtus. Malheureusement, il est tué par les protestants, en même temps que le maréchal d’Ancre, au pont du Louvre.
Cette mort force le désormais duc d’Hérouville à rappeler Etienne, qui est maintenant le seul espoir de perpétuer la lignée. Hélas, Etienne a grandi sous le magistère bienveillant du vieux Beauvouloir, qui a demandé à sa fille Gabrielle de venir lui tenir compagnie. Les deux jeunes gens, comme on peut s’y attendre, sont tombés amoureux. Quand il apprend ça, le duc rentre au château avec l’intention de marier Etienne et la fille de Mme de Grandlieu en faisant croire à son fils que Gabrielle est morte. A cet instant, Gabrielle chante dans la pièce où elle est retenue, ce qui décide Etienne à s’opposer frontalement à son père qui sue la haine : « Eh ! bien, crevez tous ! Toi, sale avorton, la preuve de ma honte. Toi, dit-il à Gabrielle, misérable gourgandine à langue de vipère qui as empoisonné ma maison ! ». La violence de la scène est telle que lorsque le vieux lève l’épée sur Gabrielle, Etienne tombe mort, aussitôt suivi par sa bien-aimée, qui essayait de le retenir. M. d'Hérouville les a tous deux proprement fait mourir de terreur. Le père alors se tourne vers Mlle de Grandlieu : « Je vous épouserai, moi ! – Et vous êtes assez vert-galaant pour avoir une belle lignée, dit la comtesse [la mère de la jeune fille !] à l’oreille de ce vieillard qui avait servi sous sept rois de France. ». Ce sont les derniers mots de la nouvelle.
Le caractère jusqu’au-boutiste, intraitable et fanatique du vieux d’Hérouville fait penser au Bartolomeo di Piombo de La Vendetta, qui manque de tuer sa fille quand il apprend qu’elle aime et veut épouser le dernier survivant des Porta, la famille de ses ennemis jurés. Dans les deux récits, on est évidemment dans la démesure. Balzac pousse le contraste à ses confins.
Cette recherche forcenée de l’effet affaiblit à mon avis le récit en ôtant de la vraisemblance aux faits et aux personnages. Je sais bien que la réalité est capable de dépasser la fiction, mais. Ici, la stature du duc est tellement terrible comparée aux pauvres créatures qui ont affaire à lui qu’on n’y croit qu’en se forçant, comme en présence d’une caricature. Pour racheter la tiédeur de ce jugement péremptoire, j’ajoute cependant que les portraits des personnages sont d’une grande force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, l'enfant maudit, la vendetta
vendredi, 30 septembre 2016
39 BALZAC : LE LYS DANS LA VALLÉE

Avec Le Lys dans la vallée, Balzac a fait un des plus classiquissimes romans de La Comédie humaine. Un incontournable, comme on dit : jusqu’à quelles extrémités peut aller le sentiment éprouvé par un tout jeune homme qui s’enflamme durablement pour la beauté d’une femme qu’il a rencontrée par hasard un soir de bal ?
La scène de la rencontre vaut son pesant de littérature, et vaut en soi le voyage. Jugez-en par le portrait de Mme de Mortsauf que Félix de Vendenesse (cf. Une Fille d'Eve) dessine pour sa maîtresse d'alors, Natalie de Manerville, une fois l'aventure terminée (par la mort de l'héroïne). Le choix de "Mortsauf", ce nom quasiment oxymorique, me fait penser (à tort ou à raison) à l'insurpassable air de la Passion selon Saint-Jean "Mein teurer Heiland" : l'homme pose à Jésus crucifié la question : « Bin ich vom Sterben freigemacht ? » (suis-je libéré de la mort ?). Et le commentaire suit, sublime et tendre : « da neigest du das Haupt und sprischst "Ja" » (là, tu inclines le chef et dis "oui"), avec l'accompagnement de la basse par le chœur. Pour dire tout ce que Balzac a voulu mettre de sacrifice de soi dans le nom même de cette femme.
« Trompée par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s’endormir en attendant le bon plaisir de sa mère, et se posa près de moi par un mouvement d’oiseau qui s’abat sur son nid. Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l’avais été par la fête ; elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j’aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d’une gaze, mais dont les globes azurés et d’une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle ».
Est-ce assez érotique ? Balzac se souvient-il de Laure de Berny, dont les enfants ont à peu près son âge, mais que ça n’empêche pas de céder un soir (1821 ?) à ses avances, sur un banc du jardin de sa maison de Villeparisis ? Passons. Félix passe à l'action en se jetant de la bouche entre les deux omoplates de la belle, à quoi celle-ci répond par un « Monsieur ? » outré et une fuite précipitée.
Quand ils en sont à s’échanger des confidences, Félix et Henriette se rendent compte que leurs vies à leur début se ressemblent par la tristesse et la rudesse du sort que l’enfance et l’adolescence leur ont fait. Charles de Vendenesse capte toute l’attention et l’ambition de ses parents, au détriment du frère cadet qui, mal aimé, méprisé par sa mère, peine à accéder à une vie équilibrée (tout le début du roman).
Blanche-Henriette de Lenoncourt, quant à elle, a eu à subir bien des avanies, au point que, pour y échapper, elle s’est dépêchée d’accepter le déjà âgé M. de Mortsauf pour époux, qui s’est dépêché de la lester de deux enfants, Jacques et Madeleine. La vie avec lui est tout sauf facile et heureuse : c’est un homme aigri, acariâtre, tant soit peu déséquilibré, en proie à des crises de rage (ou de folie) qui sèment la panique au logis. Bref, une femme qui a le sens du sacrifice de soi et qui, par dévouement pour ses enfants et grâce à un sens exagéré du devoir conjugal, persiste à subir stoïquement un sort injuste.
Tout juste se laissera-t-elle aimer de Félix, à la condition expresse qu’il ne franchisse jamais les bornes d’une honnête décence, tout juste lui laissera-t-elle de loin en loin sa main à baiser. Le jeune homme, porté par l’infini de son amour, accepte tout. Dans la foulée, il laissera l’intensité de ses sentiments s’exprimer au moyen du langage des fleurs. Il s’ingénie, au cours de longues promenades dans la campagne, à composer des bouquets qui soient autant de figure de son amour sublimé.
Et là, Balzac met toute la gomme, comme il sait faire quand il lâche la bride à son démon. Attention les yeux, on a quasiment droit au manuel de botanique : flouve odorante, dont le parfum enivre, sédum des vignes, liserons à cloches blanches, bugrane rose, fougères, jeunes pousses de chêne, amourette purpurine, paturin des champs et des eaux, bromes, agrostis, roses du Bengale, daucus, linaigrette, reine des prés, cerfeuil sauvage, clématite en fruits, croisette, millefeuille, fumeterre, etc … (tout ça sur une seule page).
J’arrête là : « Quelle femme enivrée par la senteur d’Aphrodise cachée dans la flouve, ne comprendra ce luxe d’ides soumises, cette blanche tendresse troublée par des mouvements indomptés, et ce rouge désir de l’amour qui demande un bonheur refusé dans les luttes cent fois recommencées de la passion contenue, infatigable, éternelle ? ». Rien de mieux que les symboles pour compenser une frustration sexuelle (dans La Nouvelle Héloïse, Saint-Preux avouera à Julie, tout honteux, sa façon de compenser : qu'en est-il de Félix ? Balzac n'en dit rien).
Pour faire pendant au platonisme forcé de cette relation bizarre, Balzac mettra Félix en présence de la torride lady Dudley, qui l’entraîne dans des sarabandes autrement érotiques et concrètes. Ce caprice n’aura qu’un temps. Je passe sur quelques épisodes, à commencer par la maladie qui mène Mortsauf à la dernière extrémité, mais victorieusement combattue par l’irréprochable dévouement de son épouse. Je passe aussi sur la mort pathétique de Mme de Mortsauf et sur l'aversion que manifestera Madeleine à l'égard de Félix, alors que sa mère avait envisagé de la lui donner pour épouse (on sait par Une Fille d'Ève qu'il saura se consoler, et au-delà).
J’en viens à l’impression que m’a laissée la relecture de ce livre célèbre. Pour parler franchement, je m’y suis pas mal ennuyé. Littérairement impeccable, évidemment, c’est par son contenu que le bouquin m’a pompé l’air. Cette femme toute en abnégation de soi, guidée par un sens du devoir poussé jusqu'à l'absurde, qui considère son amoureux comme un troisième enfant, ce garçon qui, par idéalisme radical, accepte sa servitude comme une forme de castration, ce vieux comte auquel Balzac a fait un caractère impossible pour mieux faire ressortir la sublimité de la conduite de la comtesse, tout cela a quelque chose d’horripilant.
C’est sûrement une infirmité : c'est sans doute moi qui ne suis pas à la hauteur de ce chef d’œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 22 septembre 2016
38 BALZAC : UNE FILLE D’ÈVE

Le dessin d'Eugène Giraud après le décès.
Résumé : la faute (non consommée) d’une oie blanche tout juste sortie des jupes de sa mère, aussitôt épousée par un jeune homme au trop grand cœur, et qui, manipulée par quelques grandes dames qui veulent s’amuser à ses dépens, a l’impression de vivre une belle histoire d’amour en jetant son dévolu sur un homme nul, mais qui brille dans les salons aux yeux des ignorants, et qui risquera de l’entraîner dans le tourbillon d’un scandale, ce que le mari, de justesse, empêchera généreusement, lui montrant sa noblesse et sa grandeur d’âme.
****************
Le comte de Granville a deux filles, Marie-Angélique et Marie-Eugénie. Elles ont été élevées, pire qu’au couvent, par une mère plus dévote qu’une grenouille de bénitier. L’aînée a épousé Félix de Vendenesse, guéri de ses aventures, chastes avec Mme de Mortsauf, torrides avec Lady Dudley, décevantes avec Laure de Manerville. La cadette s’appelle Mme du Tillet depuis qu’elle a épousé un des deux grands banquiers de La Comédie humaine. Elle s’en repent d’ailleurs amèrement, car son mari, peu sympathique, intraitable dans son ménage comme dans ses affaires, la laisse sans le sou.
Félix, après des frasques qui lui ont fait la réputation d’un Don Juan, il a décidé de « faire une fin », usé par son usage des femmes, au point que Balzac le qualifie de « jeune vieillard », mais doté d’une solide connaissance des humains et de la société. Il apparaît ici en mari impeccable, plus prévenant avec sa femme qu’une poule avec ses poussins, faisant d’elle une femme du monde accomplie, et allant au-devant de ses moindres désirs avant même qu’ils aient été formulés, en sorte que quand commence le roman, elle est « cuite à point par le mariage pour être dégustée par l’amour » (on peut prédire un bel avenir à un auteur qui a un tel sens de la formule).
La totale confiance que Félix a dans sa femme fait que, lorsque, appâtée et guettée par un trio de dames jalouses de sa perfection, elle laisse apparaître la véritable toquade qui la jette vers Raoul Nathan, le mari n’y verra que du feu, de même que Marie-Angélique est aveugle sur les mérites de l’homme qu’elle croit aimer : Balzac en dresse d’ailleurs un portrait peu reluisant, qui tire à hue et à dia. Virtuellement grand écrivain, il voudrait aussi fort arriver en politique (tiens, Balzac aussi aurait bien voulu). En fait, il ne sait pas bien ce qu’il veut et s’active d’une façon désordonnée. En gros, c’est un journaliste « à prétentions ».
De plus, il est l’amant en titre de l’actrice Florine, chez laquelle il vit, dans un appartement richement meublé (car elle a fait une belle carrière), et décoré d’une foule d’objets et d’œuvres offerts par ses admirateurs. Nathan se garde bien de parler d’elle à la comtesse. Pour fonder un journal qui lui ouvrirait des perspectives politiques, il se laisse entortiller par le banquier du Tillet et un compère. Les réserves fondent rapidement à l’usage, les dettes s’accumulent, et Nathan est un jour sommé de les rembourser, sous peine d’aller en prison.
Il manque son suicide, sauvé in extremis par la comtesse, qui le cache et décide d’emprunter la somme nécessaire au paiement de la dette. La baronne de Nucingen accepte de la lui prêter. Elle sera sauvée du déshonneur par sa sœur, qui raconte tout à Vendenesse, qui rembourse aussitôt la créancière.
Il décide d’ouvrir les yeux de sa femme sur les vraies qualités de Raoul Nathan, l’amant indigne et brouillon, mais surtout sa relation pérenne avec l’actrice Florine. Marie-Véronique prend conscience de la réalité, aperçoit l’abime dans lequel elle a failli tomber et se rend compte de la noblesse de cœur de son mari, pour lequel elle éprouve désormais de l’admiration. Tout est bien qui finit bien. Le couple voyagera. A son retour d’Italie, la comtesse apercevra un jour Nathan (« dans un triste équipage ») et Florine dans la rue : « Un homme indifférent est déjà passablement laid aux yeux d’une femme ; mais quand elle ne l’aime plus, il paraît horrible, surtout lorsqu’il ressemble à Nathan ».
Ce court roman de Balzac n’est pas son meilleur, mais il reste intéressant. L’auteur l’ouvre « in medias res », lorsqu’Angélique aux abois se précipite chez sa sœur pour lui avouer toute son aventure et lui demander secours. En vain, puisque celle-ci ne dispose d’aucun argent en propre. L’irruption de du Tillet au cours de l’entretien plonge son épouse dans la terreur, car cet homme cruel et impitoyable leur révèle qu’il sait tout et qu’en abattant Nathan (qu’il a surnommé « Charnathan »), il l’évince de la place qu’il a bien l’intention d’obtenir pour lui-même (avec succès). La suite est grosso modo un long flash-back, avant que le récit renoue avec la scène inaugurale.
La tiédeur de l’impression que laisse le livre est peut-être due à la distance à laquelle les personnages sont maintenus par l’auteur, comme s’il les observait sur une scène depuis la salle. L’affaire se dénoue d’ailleurs par une comédie de masques, à la fin de laquelle Florine, ayant appris la duplicité de son amant, rend à la comtesse toutes les lettres qu’elle lui a envoyées.
Bon roman, quoiqu’un peu lisse, qui finit de façon au fond très morale, après avoir exploré les méandres de la méchanceté humaine dissimulée derrière le masque des conventions sociales.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, une fille d'ève, félix de vendenesse, la comédie humaine
mardi, 20 septembre 2016
37 BALZAC : LE CURÉ DE VILLAGE (1837-1845)
Résumé : il y avait un "Mais ...".
2
Mais ce que tout le monde ignore, à l’exception du bon curé Bonnet et du si perspicace Dutheil, vicaire général devenu évêque et plus tard archevêque, c’est le mensonge affreux sur le piédestal duquel s’élève la statue de la « sainte » : la femme de la bonne société qui est à l’origine du double meurtre commis par Tascheron n’est autre que Véronique Graslin en personne. Francis Graslin est-il même le fils de son père légal ? Le doute est au moins permis.
 Et alors là, Balzac met la surmultipliée (pour ceux à qui le mot deudeuche veut encore dire quelque chose : c'était, sur le levier des vitesses, celle qui permettait de monter à 80km/h, en descente et par vent arrière). S’il y avait eu le cinéma, Balzac n’aurait pas hésité devant le technicolor, l'écran géant, la 3D et la démesure des effets spéciaux.
Et alors là, Balzac met la surmultipliée (pour ceux à qui le mot deudeuche veut encore dire quelque chose : c'était, sur le levier des vitesses, celle qui permettait de monter à 80km/h, en descente et par vent arrière). S’il y avait eu le cinéma, Balzac n’aurait pas hésité devant le technicolor, l'écran géant, la 3D et la démesure des effets spéciaux.
Car au fur et à mesure que la région embellit et s’enrichit, Mme Graslin dépérit, au point qu'elle se trouve bientôt aux portes de la mort. On apprendra que, depuis douze ou quinze ans, pour faire pénitence, elle porte un cilice de crin qui met sa peau à vif (« Son corps n'est qu'une plaie », dira quelqu'un qui a coupé le cilice au ciseau sur l'ordre d'Horace Bianchon, qui s'exclame, en apprenant ça : « Comment ! au dix-neuvième siècle, s'écria le grand médecin, il se pratique encore de semblables horreurs ! »), et qu’elle ne mange, trois fois par jour et toujours seule, qu’ « un morceau de pain sec sur une grande terrine de cendre et des légumes cuits à l’eau, sans sel, dans un plat de terre rouge, semblable à ceux qui servent à donner la pâtée aux chiens ! ». Que tous ceux qui sont en surpoids en prennent de la graine ! Certains appelleraient peut-être ça l’anorexie (le triomphe de la volonté sur son propre corps, jusqu’à la mort).
Arrivée au bord de la tombe (comme on dit), elle a résolu de faire une confession publique, spectaculaire et solennelle de ses fautes, au cours d'une cérémonie grandiose, en présence de ses proches, du curé Bonnet, de l’archevêque en grande tenue, de M. de Grandville l’avocat général (en qui elle voyait le meurtrier de son amant), de Denise Tascheron la sœur du criminel revenue de son exil américain, toute la population étant réunie au château, au comble de l’émotion. Elle sera enterrée dans le petit cimetière de Montégnac, et reposera à côté de son ancien amant décapité. Trop, c'est trop : Balzac, avec emphase et solennité, avec le gros aiguillon dont il titille les émotions du lecteur, abuse des effets de grandeur.
J’avoue que cette séquence tire-larmes, par sa boursouflure et son outrance démonstrative, m’a bien fait rire, avec ses effets aussi gros qu'en son temps la scène finale du film Love story (1970) d'Arthur Hiller sur les âmes sensibles venues au cinéma avec une provision de mouchoirs (je dois être sans-cœur). Mais aussi que cette profession de foi catholique, proclamée à la face de tous et provoquant chez tous des émotions intenses et visibles reste un morceau de bravoure qui, d'un point de vue purement littéraire, garde quelque chose d’admirable.
Au total, un véritable tour de force romanesque, homogène bien que composite, doublé de l’insupportable manifeste d’un catholique fanatique et militant. Mais même si la leçon de catholicisme proprement dite passe quand même assez mal, on n’a pas envie de lâcher, quoiqu’en exceptant les longues dissertations sur l’état moral, économique et politique de la France et les moyens d’y remédier, qui semblent n'avoir rien à faire là, mais sont tout à fait appropriées au grand projet de transformation économique mis en œuvre par Mme Graslin à Montégnac.
Je renvoie ici aux propos tenus à l’évêché ou à l’hôtel Graslin, puis par l'auteur au début du troisième chapitre, puis la très longue lettre (de motivation) de l’ingénieur à M. Grossetête, protecteur de Véronique Graslin, puis les propos de table tenus au château par l’élite de Montégnac. Ici éclatent aussi les convictions anti-parlementaires, anti-égalitaires de l’auteur, qui déplore amèrement la montée de l’individualisme et de l'égalitarisme, du fait de l’affaiblissement de l’autorité royale, de l’autorité paternelle et des liens familiaux, sous les coups des idées révolutionnaires.
Balzac, à la dernière page, assume d’ailleurs crânement ce qu’il a mis de moralement édifiant dans son roman : « Cette discrétion fut un hommage rendu à tant de vertus par cette population catholique et travailleuse qui recommence dans ce coin de France les miracles des Lettres édifiantes » (lettres que devaient écrire du monde entier les missionnaires jésuites à leur général Ignace de Loyola pour rendre compte).
Tout en restant baba devant le génie de cette langue et de cette technique, on est autorisé à ne pas goûter le fond du propos, historiquement marqué au fer.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j'ai relevé une phrase qui devrait faire plaisir à mon ami Roland : « La philanthropie moderne est le malheur des sociétés, les principes de la religion catholique peuvent seuls guérir les maladies qui travaillent le corps social ». Et puis une formule de Denise Tascheron l'exilée : « ... aux Etats-Unis, où il n'y a ni espérance, ni foi, ni charité ... ». Et enfin cette phrase qui sonne curieusement actuelle : « Les peuples unis par une foi quelconque auront toujours bon marché des peuples sans croyance ». Les Français d'aujourd'hui ont-ils encore un reste de "foi quelconque" ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, le curé de village, littérature édifiante, 2cv citroën, horace bianchon, love story film arthur hiller
lundi, 19 septembre 2016
36 BALZAC : LE CURÉ DE VILLAGE (1837-1845)
UN ROMAN ÉDIFIANT.
1
Résumé : roman hybride, qui commence dans une misère assise sur un tas d’or, se poursuit en plaidoyer pour la peine de mort (« la peine de mort, ce grand soutien des sociétés », écrit Balzac au deuxième chapitre), continue par de hautes considérations sur l’état moral et matériel de la France, et se termine dans l’outrance religieuse, sur un dithyrambe catholique.
Le vieux Sauviat, Auvergnat habitant à Limoges dans une maison à la limite de l’insalubre, exerce la profession de marchand forain. Il a épousé une demoiselle Champagnac (devenue ainsi « la Sauviat »), qui lui a plu parce qu’elle parlait le même patois que lui. Leur fille Véronique avait la beauté qu’on prête aux anges, mais la petite vérole l’a défigurée.
Le train de vie du ménage est d’une modestie telle qu’on pourrait le croire dans la misère, mais il n’en est rien : Sauviat, à force d’acheter et vendre de vieilles ferrailles, a pu, disons-le, amasser une petite fortune, qui permet de doter richement sa fille et de lui faire épouser M. Graslin, banquier limougeaud quarantenaire, ravi de faire une bonne affaire. Il n’est pas bien beau, souffrant d’éruptions cutanées liées à sa suractivité financière, heureusement épisodiques. Véronique va donc s’installer dans le superbe hôtel Graslin et devenir le centre d’attraction de la ville.
Au deuxième chapitre, changement radical de décor. Le bien nommé Pingret, vieil Harpagon, a été assassiné, en même temps que sa servante, dans le jardin où, de nuit, il alimentait son trésor, consistant en pièces d’or contenues dans quatre jarres, qu’on retrouve évidemment brisées. Il y en a pour quatre-vingt mille francs, somme énorme. L’enquête conduit à un jeune ouvrier porcelainier, Jean-François Tascheron. On le soupçonne d’avoir commis son crime à cause d’une femme de la bonne société.
Tout le temps de l’enquête, et jusqu’à la fin du procès d’Assises, Tascheron reste muet sur le mobile de son acte et sur l’identité de la femme, mais suivez mon regard : Mme Graslin, à plusieurs reprises, et fort subtilement, émet des avis tendant à dédouaner le jeune homme, qui n'avouera qu'au curé Bonnet, en confession, ce qu'il a dissimulé à tous, à commencer par la cachette où repose l'or. Vaste débat en Limousin : certains vont jusqu’à juger Pingret responsable de son propre assassinat ! Personne cependant n’est effleuré par le moindre soupçon sur la conduite de la belle Mme Graslin.
Pourtant on aurait quelque raison de s’interroger. Pourquoi, après la condamnation de Tascheron à mort, et après le rejet de son recours en grâce, cette dernière dirige-t-elle sa haine massive contre M. de Granville qui, avocat général aux Assises, a obtenu la tête du criminel ? Pourquoi, après la mort de son banquier de mari, quitte-t-elle Limoges pour aller s’enterrer dans le château de Montégnac, que celui-ci a fait construire sur une hauteur de ce petit village pauvre, inhospitalier, et même déshérité, du fait d’une nature ingrate ?
C’est d’abord à cause de M. Bonnet, curé de Montégnac. Ce prêtre, d’une humilité exemplaire, a par son ministère fait d’une population de vauriens prêts à rançonner le voyageur qui se hasardait, voire pire, une population de catholiques fervents et de bons travailleurs, assidus à la messe (d'où le titre du roman, bien que le personnage principal soit Mme Graslin). Mais c’est aussi à cause du fait que Jean-François Tascheron est né là, et qu’il y sera bientôt enterré, à la demande de Mme Graslin, sitôt exaucée que formulée, tant sa réputation est immaculée.
Le roman tombe alors dans le schéma du Médecin de campagne, ce roman où éclate la volonté d'un homme énergique d'amener le bonheur et la prospérité dans une région démunie de Savoie, où le docteur Bénassis, grâce à son génie de l’organisation, et avec l’aide de quelques appuis, au premier rang desquels le colonel Genestas, a complètement transformé tout un coin de montagne. Au  passage, notons que Bénassis, dans sa générosité, a quand même fait déporter tous les crétins des Alpes (ci-contre un authentique) qui, en se reproduisant, perpétuaient l’arriération dans laquelle vivait la vallée, et interdisaient son essor économique, un essor fondé sur le labeur, l’intelligence et la volonté. Il faut savoir ce qu’on veut, que diable ! Comme dit l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin !
passage, notons que Bénassis, dans sa générosité, a quand même fait déporter tous les crétins des Alpes (ci-contre un authentique) qui, en se reproduisant, perpétuaient l’arriération dans laquelle vivait la vallée, et interdisaient son essor économique, un essor fondé sur le labeur, l’intelligence et la volonté. Il faut savoir ce qu’on veut, que diable ! Comme dit l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin !
A l’image de Bénassis, Véronique Graslin se fait la grande dispensatrice des bienfaits qui ne tarderont pas à faire de Montégnac une commune riche et prospère. Elle embauche Grégoire Gérard, jeune ingénieur ambitieux, frais émoulu de Polytechnique, qui se morfond dans la routine stérile de l’emploi que l’Etat lui a donné.
Appuyé sur l’investissement des sommes énormes que la châtelaine a empruntées grâce à son crédit, tout le monde se met à l’ouvrage et transforme le paysage, en traçant des chemins, plantant des arbres par centaines, construisant des barrages pour recueillir les eaux pour irriguer les sols et en prévision des futures sécheresses, faisant de landes stériles des terres à fourrage, sur lesquelles vaches et chevaux ne tardent pas à se multiplier. Le résultat, après quelques années, est spectaculaire, la région métamorphosée. Le paysage, enfin façonné de la main de l’homme, est devenu productif et utile à tous. Inutile de décrire la dévotion qui entoure de toutes parts la personne de Mme Graslin, considérée comme une véritable sainte. Mais …
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, le curé de village, limoges, peine de mort, catholiques, catholicisme, chrétien, église, balzac le médecin de campagne, docteur bénassis balzac, arthur hiller love story, france, société, ignace de loyola
dimanche, 18 septembre 2016
35 BALZAC : URSULE MIROUËT (1841)
Résumé : Une charge sabre au clair contre la bourgeoisie provinciale, agrémentée de quelques singuliers miracles.
C’est un roman tout à fait étrange qu’Ursule Mirouët : très prenant, voire poignant par certains aspects, complètement improbable, à la limite du grotesque, par certains autres. L’action se passe à Nemours, ville de province où coule le Loing. La population se répartit en divers groupes. L’un rassemble trois familles bourgeoises qui ont fini par peupler tout l’arrondissement, les Massin, les Minoret et les Levrault qui, à force de se croiser et recroiser (Massin-Levrault, Minoret-Levrault, etc.) ont dessiné un arbre généalogique inextricable, que Balzac renonce raisonnablement à décrire dans le détail.
Minoret-Levrault domine, au début, le tableau familial. Cet hercule doté d’une Zélie qui porte impérieusement la culotte, et d’un Désiré dont il finance les études à Paris en lui voyant une brillante carrière dans la magistrature, est quant à lui d’une stupidité et d’une cupidité sans borne. Il exerce la profession de « maître de poste », qui le met au centre de bien des activités de la ville et au-delà, et dont il a tiré de substantiels bénéfices au fil des années.
Face aux bourgeois, vit tant bien que mal une vieille femme, veuve de M. de Portenduère, née Kergarouët, dont la noblesse, qui remonte à neuf cents ans, est restée intraitable s’agissant d’alliances et de mésalliances. L’intransigeance aristocratique de la vieille Portenduère va bientôt nuire à son fils Savinien. Elle soupçonne la jeune Ursule de calculs d'arriviste, mais touchée par l'héroïsme pur de sa conduite, elle l'acceptera pour sa fille.
L’histoire commence lorsque le docteur Minoret, autour de qui se forme le troisième groupe, après sa longue carrière, et après avoir été le médecin de l’Empereur, revient au bercail pour y finir ses jours, éveillant l’intérêt de ses neveux, qui, lui supposant (non à tort) une fortune personnelle, se considèrent par avance comme les héritiers naturels du médecin. Comme pour les contrarier, celui-ci a malheureusement reporté toute son affection sur la petite Ursule, orpheline, fille d’un aventurier musicien, lui-même fils d’un facteur de clavecins, Valentin Mirouët.
La seule idée du docteur est de donner à Ursule l’éducation la plus soignée, mais en la protégeant jalousement du « monde » et de ses maléfices, si bien que le cœur de la petite n’abandonnera jamais l’état de pureté qui a servi de cadre à sa croissance : elle n’aura aucune idée, même aux pires moments, de la méchanceté du monde, et sera bonne même pour ceux qui lui veulent le plus grand mal. Pour elle, pour son bonheur, il est capable de tous les sacrifices. Le pire est que le vieux tuteur est un athée convaincu, ami des encyclopédistes et rationaliste en diable.
Heureusement – c'est le premier miracle – il se convertit et devient un catholique fervent et convaincu. Par quel prodige ? C’est en effet un coup de baguette magique : retrouvant le docteur Bouvard, un vieux confrère avec lequel il était brouillé parce que celui-ci était un adepte du mesmérisme, cette doctrine sur le magnétisme (le baquet de Mesmer, …) qui apparaissait comme un charlatanisme au docteur Minoret, à l'esprit épris de stricte rationalité.
Mais dans la pièce où Bouvard introduit ce dernier, point de baquet : « Rien que le pouvoir de Dieu, répondit le swedenborgiste » (Swedenborg est, entre autres, un illuministe suédois qui avait eu des visions mystiques, cf. Louis Lambert). Le docteur est accueilli par un homme mystérieux (on dirait aujourd'hui un médium). Il a plongé une femme (de « classe inférieure », autrement dit, pour Balzac, d'une ignorance crasse) dans un sommeil hypnotique, qui, quand il lui a pris la main, se met à lui décrire sa maison de Nemours dans les moindres détails, avec sa bibliothèque ainsi que les faits et gestes d’Ursule, jusqu’au point rouge dont elle a marqué la Saint Savinien dans son agenda, parce qu’elle est amoureuse du jeune Portenduère, et jusqu’aux gros volumes des Pandectes de Justinien dans l'un desquels le docteur garde les billets des dépenses du trimestre, et dont le tome III est rangé avant le tome II.
Boum ! Patatras ! La révélation tombe sur le docteur : « Cette dernière partie de l’interrogatoire foudroya le docteur Minoret ». Et voilà mon athée, ami des encyclopédistes, changé en catholique pur jus en un instant. Shazam ! Moralité : la science ne sait pas tout, car Dieu est là. Minoret retourne à Nemours tout pénétré de religion. C'est proprement miraculeux, et j'avoue que j'ai eu du mal à gober. Le problème, c’est que quand les Massin et Minoret-Levrault voient le docteur accompagner sa filleule à l'église avec son paroissien sous le bras, ils entrent en ébullition. Ils n'ont alors qu'une seule pensée : dépouiller Ursule de tous ses droits à la succession, voire la chasser de la ville. Tout ça parce qu’à la mort du vieux médecin, ils comptent sur son héritage, qui ne peut manquer d’être imposant, vu que, côté finances, il n'y a pas plus avisé et prudent.
C’est là que le roman devient un véritable thriller palpitant : entrent en scène le notaire Dionis, et surtout son clerc Goupil, une créature infernale, prêt à tout pour s’élever dans la société, capable d'ignobles crapuleries pour arriver à ses fins. Il se forme autour des héritiers présomptifs un groupe compact de gens soucieux de leurs seuls intérêts, qui veulent au plus haut point empêcher Minoret de les dépouiller de leurs "espérances". Le docteur bénéficie heureusement de sa longue expérience des hommes et d'une profonde connaissance de leurs turpitudes, mais aussi des bons conseils des amis qui se réunissent tous les soirs chez lui : Jordy, l’abbé Chaperon (le bien nommé) et Bongrand, le juge de paix.
L’affaire se complique de l’amour qui lie Ursule et Savinien de Portenduère. Ce dernier, que le docteur a fait libérer de sa prison pour dettes en avançant la somme à sa mère, se révèle un homme droit, qui ne demande qu’à réparer tous ses torts. Pour aller vite, disons que tout finira pour le mieux, même pour Goupil qui, ayant obtenu un bon poste, ne cherche plus à nuire à quiconque (deuxième miracle).
Heureusement, troisième miracle : le tuteur mort vient visiter Ursule pendant son sommeil et lui révèle comment elle a été privée de son argent au moment de sa mort, annonçant même la mort future de Désiré, le fils du maître de poste, en qui ce dernier a placé tous ses espoirs. Minoret-Levrault est tiraillé par le remords, suite à l'infamie qu'il a commise après avoir surpris la dernière confidence faite par Minoret à Ursule à ses derniers instants : il a fait disparaître une somme considérable, en numéraire et « trois inscriptions ». Quatrième et dernier miracle, il deviendra lui aussi un catholique fervent et restituera tout à la belle Ursule Mirouët, qui pourra épouser son Savinien et recouvrer sa fortune et son château si ignoblement détournés.
C’est dommage, cette fascination de Balzac pour l’invraisemblable, car le happy end apparaît très forcé. En bonne logique, c’est la coterie des bourgeois de Nemours qui emporte le morceau. Mais non, il faut que le Bien triomphe et que le Mal soit puni : Désiré meurt misérablement, Zélie sa mère devient folle. Mais le roman reste très intéressant, à cause de l'incroyable férocité avec laquelle l'auteur décrit la bourgeoisie d’une petite ville de province : les dialogues qu’il met dans la bouche des conjurés et les actions qu’ils commettent ne permettent pas de s’attendre à ce dénouement heureux. On connaît pourtant un Balzac moins amateur de coups de théâtre et plus soucieux de vraisemblance, jusqu’à la cruauté à l’encontre des vertueux (voir le père impitoyable de La Vendetta ou le cynisme avide et répugnant de Mme d'Espard dans L'Interdiction).
Voilà ce que je dis, moi.
A noter le coup de chapeau à maître Rabelais, que Balzac - qui l'a beaucoup pastiché (voir les Contes drolatiques) - déplace avec ironie de la bouche de Frère Jean des Entommeures (au début de la guerre picrocholine dans le vignoble de l'abbaye de Seuillé) dans celle de Zélie (femme du maître de poste) : « Adieu paniers, vendanges sont faites ! », pour dire le désastre au cas où l'héritage échapperait. A noter aussi, pour amener « la science des fluides impondérables » du magnétisme mesmérien et Swedenborg, la révérence à Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, ursule mirouët, louis lambert, balzac l'interdiction, balzac la vendetta
lundi, 12 septembre 2016
MOITESSIER, HÉROS MODERNE
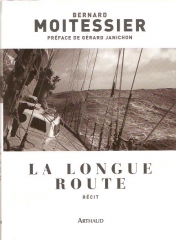 Je connaissais bien sûr le nom et la réputation de Bernard Moitessier l'incorruptible, à cause de l’anecdote qui l’a rendu célèbre, lorsque, terminant son tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, il avait renoncé à arriver en vainqueur et poursuivi sa route, au motif qu’il ne voulait pas « perdre son âme ». La puissance de cette histoire ne m’avait pas incité à lire les livres qu’il a écrits : je ne suis pas marin, ni du pied, ni – pire – du cœur (je me rappelle une partie de pêche au tacaud qui avait mal fini, m'ayant vu nourrir les poissons au lieu de l'inverse). Mon goût m'a toujours porté vers les cailloux et les altitudes. Même si la mer et la montagne offrent à l'homme des défis comparables. Parmi les derniers livres lus traitant de la chose maritime, il y a, évidemment, Moby Dick, Redburn, il y a quelques années. Il y a aussi La Mer cruelle de Nicholas Monsarrat. Bref, à voile ou à vapeur, pas grand-chose à voir avec la navigation en solitaire.
Je connaissais bien sûr le nom et la réputation de Bernard Moitessier l'incorruptible, à cause de l’anecdote qui l’a rendu célèbre, lorsque, terminant son tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, il avait renoncé à arriver en vainqueur et poursuivi sa route, au motif qu’il ne voulait pas « perdre son âme ». La puissance de cette histoire ne m’avait pas incité à lire les livres qu’il a écrits : je ne suis pas marin, ni du pied, ni – pire – du cœur (je me rappelle une partie de pêche au tacaud qui avait mal fini, m'ayant vu nourrir les poissons au lieu de l'inverse). Mon goût m'a toujours porté vers les cailloux et les altitudes. Même si la mer et la montagne offrent à l'homme des défis comparables. Parmi les derniers livres lus traitant de la chose maritime, il y a, évidemment, Moby Dick, Redburn, il y a quelques années. Il y a aussi La Mer cruelle de Nicholas Monsarrat. Bref, à voile ou à vapeur, pas grand-chose à voir avec la navigation en solitaire.
Je viens de lire, aimablement prêté par un ami (merci Freddy), La Longue route, de Moitessier, qui raconte précisément comment l’auteur a relevé le défi lancé par le Sunday Times, et je m’en félicite. Oh, pas à cause de ce qui touche à la conduite de son bateau, le « Joshua ». Je suis toujours aussi hermétique au vocabulaire technique des marins, qui abonde dans le livre. Si on me demandait ce qui distingue une bonnette d’une trinquette, je donnerais ma langue au chat. Pareil pour la bôme et le tourmentin. De même, la comptabilité qu’il tient des distances parcourues par vingt-quatre heures et les manœuvres auxquelles il se livre sont restées dehors : mes yeux se contentaient de survoler.
Non, ce qui m’a retenu et touché, c’est ce qu’il raconte de ses expériences passées, par exemple quand il faisait le commerce du riz dans le golfe de Siam ou lors de sa navigation sur le Marie-Thérèse II qui avait vu son baptême du cap Horn. Et puis ce sont les quinze lettres qu’il avait écrites à des cap-horniers reconnus pour les interroger sur ce qu’ils pouvaient lui dire de ce fameux cap, de ses difficultés, de ses courants, mais aussi les quinze réponses précises et fraternelles qu’il en avait reçues, laissées sans un mot de remerciements, faute de temps.
Ce qui m'a touché, c'est aussi la fraternité qui éclaire la page 252 : coincé avec son bateau avarié à Singapour et sans aucun moyen de remédier, Moitessier voit un jour arriver quelqu’un : « Un type est venu. Je ne le connaissais pas. Il a ramené une équipe de calfateurs professionnels. Il a tout payé. C’était cher et il n’était pas riche. Ensuite il a dit : "Tu rendras à un inconnu comme je l’ai fait pour toi. Parce que je le tenais moi aussi d’un inconnu qui m’a aidé un jour, et m’a dit de rendre de la même manière à un autre. Tu ne me dois rien, mais n’oublie pas de rendre." Maintenant, je crois bien que c’est tout ce bouquin qui est dans la balance. S’il en était autrement, la route que nous avons faite ensemble ne serait que des mots ». Rien à dire : c’est juste beau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lègue au pape tous les droits de son bouquin, en espérant ainsi contribuer à colmater quelques-unes des brèches faites dans la beauté du monde par la modernité (voir plus bas). Voilà une belle façon : Moitessier n'a pas oublié de "rendre".
Ce sont encore ces messages qu’il envoie à destination de l’Angleterre et de sa famille, en catapultant sur le pont d’un cargo de rencontre des tubes contenant films et photos de son journal de bord. Il confectionne un jour deux maquettes de voiliers qu’il met à l’eau quand vents et courants sont favorables, et qui justifient cette merveilleuse note de l’éditeur : « Ces deux maquettes porteuses de message ont été recueillies plus d’un an après leur mise à l’eau, l’une sur une plage de Tasmanie, l’autre en Nouvelle-Zélande. Le courrier que portaient ces bateaux est parvenu aux destinataires, parfaitement lisible » (p.124). Certains petits détails vous en convainquent : il faut croire en l'humanité.
Ce qui m’a touché, c’est la relation qui s’établit à l’occasion entre le navigateur et les créatures volantes et nageantes qui croisent sa route et parfois l’accompagnent plus ou moins longtemps. Et c’est tout ce qu’il dit du soleil, de la mer, des nuages, de la nuit, tantôt avec ses étoiles et sa lune, tantôt avec sa noirceur d’encre, tantôt encore avec ses aurores australes (il n'y a pas que les boréales dans la vie, n'est-ce pas, Sylvain ?). Au fond, j'ai été moins impressionné par la parfaite maîtrise du métier de marin qu'un tel voyage suppose et démontre à chaque page, que par tout ce qui touche à la personne même du bonhomme.
Mais ce qui a emporté mon adhésion, et qui met en pleine lumière les fondements de la motivation de l’auteur, et qui fait que je range ce livre, même si ça peut sembler bizarre, dans la lignée des grands dénonciateurs de l’absurde marche du monde actuel vers sa destruction (Jacques Ellul, Günther Anders et quelques autres), c’est la formule ahurissante dont la grenade m'a éclaté en pleine gueule à la page 226 : « Et je porte plainte contre le Monde Moderne, c’est lui le Monstre. Il détruit notre terre, il piétine l’âme des hommes ». V'rendez compte ? "Je porte plainte contre le Monde Moderne" ! Il faut oser écrire ça ! Il a raison : quand l’humanité portera-t-elle plainte contre ce monde, niaisement matériel et dérisoire ? Moi, je n'arrête pas. Mais je n'ai pas le courage de Moitessier.
Je ne peux pas passer sous silence l’éclat de joie et de rire qui s’est emparé de moi à la tourne des pages 232-233, quand je suis tombé sans du tout m’y être attendu sur cette phrase devenue quasi-sacramentelle, qu’il adresse au responsable de la course au Sunday Times au moment où, le plus dur étant fait, on s’attend à le voir remonter l’Atlantique pour aller toucher la récompense sonnante et trébuchante de son exploit : « Cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme ». On peut dire ce qu’on veut, le monsieur en a où je pense. Je veux dire que ce livre confronte le lecteur à quelque chose qui a à voir avec l’héroïsme, quand l'homme s'élève plus haut que lui-même. Si ça n'avait tenu qu'à lui, Moitessier serait devenu un nouveau Hollandais Volant : il aurait erré sans fin sur la mer. Mais il y a quand même le monde.
Au total, de Plymouth à Tahiti, dix mois se seront écoulés. A Papeete, il retrouve des copains, mais il retrouve aussi toutes les mesquineries et laideurs de ce monde. Le livre se clôt ainsi dans les basses réalités, après avoir plané sur les cimes du ciel, c’est-à-dire la vague, la houle et l’écume de la mer.
La Longue route, mieux qu’un livre à lire : une expérience à partager.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bernard moitessier, la longue route, tour du monde en solitaire, cap horn
jeudi, 25 août 2016
BAUDELAIRE À LYON
Les amateurs des Fleurs du Mal, les spécialistes de la question, les professeurs de Lettres le savent : Baudelaire est passé par Lyon. Il y a même demeuré de 1833 à 1836 : le lieutenant-colonel Aupick, qui a épousé sa mère restée veuve, est en poste dans la ville. En 1834-1835, Charles est élève en classe de troisième, interne au Collège Royal de Lyon (aujourd’hui lycée Ampère). S’il ne brille pas parmi les « premiers-de-la-classe », il n’est pas mauvais élève. La preuve, c'est qu'à la fin de l’année scolaire, il obtient quelques récompenses (qui ne l'empêcheront pas de redoubler sa troisième l'année suivante à Paris, au collège Louis-le-Grand).
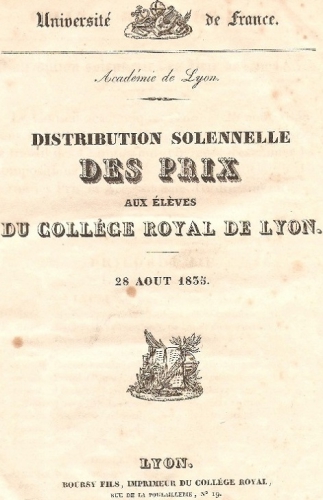
A cette époque d' "obscurantisme moyenâgeux", le romantisme dévoyé d'un Prévert n'avait pas encore élevé le cancre à la dignité de héros moderne et de modèle à suivre. A cette époque d' "arrogance élitiste", un égalitarisme intégriste et fanatisé n’avait pas encore causé les ravages auxquels on assiste depuis quatre décennies, et qui ont ruiné le système éducatif républicain. A cette époque "bourrée de stéréotypes archaïques", on craignait si peu de reconnaître les mérites scolaires des meilleurs élèves que ceux-ci étaient célébrés en fin d’année au cours de la cérémonie dite « Distribution des Prix », cette vieillerie que mai 68 a jetée à la poubelle, en même temps que les insupportables « chaires » et autres estrades, qui soulignaient par trop l'imméritée supériorité du maître sur l'élève. Le Collège Royal de Lyon avait même si peu honte qu'il faisait imprimer la liste de ceux qui méritaient le plus d’être distingués. C’était l’imprimeur Boursy, rue de la Poulaillerie (où se situe aujourd’hui le musée de l’imprimerie), qui était chargé de la fabrication de ce "tableau d'honneur".
C’est ainsi que le nom de Charles Baudelaire, en ce jour solennel du 28 août 1835, fut prononcé à six reprises, dans autant de disciplines :
« Thème »,
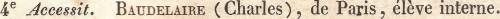
« Version latine »,
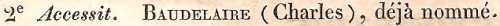
« Vers latins »,
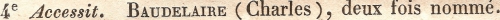
« Version grecque »,
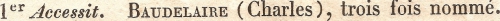
« Arithmétique »
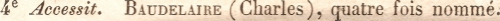
et « Dessin » (spécialité « Figures », les deux autres étant « D'après nature » et « Académies »).

Certaines paraîtront aller de soi, d’autres sembleront plus surprenantes. Quant au dessin, il sera une évidence aux familiers de cette partie de son œuvre où le poète se livre à la critique artistique.
Ce n’est qu’un document, à peine une anecdote ; c'est, si l'on veut, de l'histoire littéraire abordée par son tout petit côté. Pourtant cela me fait quelque chose de voir imprimé noir sur blanc le nom de Charles Baudelaire adolescent (il a 14 ans), dans ce mince volume que je tiens dans la main,
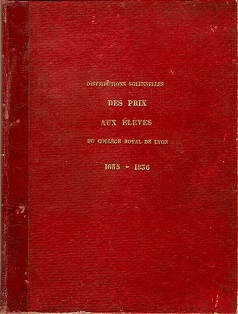
où ont été reliés (demi-basane rouge) les tableaux d'honneur de 1835 et 1836 d'un grand lycée de province. Il ne me semble pas indifférent de pouvoir toucher du doigt un témoignage, si modeste soit-il, du passage d’un tel génie dans notre ville (il n'engloba pas celle-ci dans la même aversion que celle dont le nom d'Aupick était pour lui l'objet. On raconte qu'il criait, sur les barricades de 1848 : « Fusillez le général Aupick ! »). J'ai l'impression de parvenir à lui par une voie facile et proche (si j'ai obtenu un premier prix de version latine [au royaume des aveugles ...], j'ai toujours été infoutu de composer des vers latins), mais inconnue du plus grand nombre.
C'est un privilège.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j'aurais pu faire figurer dans ce billet les noms des trois élèves de cette classe de troisième (« Professeur, M. Carrol ») qui jouent les Usain Bolt pour truster les médailles. Je les mentionne pour mémoire : Benjamin Marcouire, de Montpellier, élève interne, vainqueur toutes catégories, qui revient à sept reprises, dont cinq sur la plus haute marche du podium (« Excellence »,« Thème », « Version », «Vers latins » et « Histoire ») ; Nestor de Songeon, de Bourgoin, élève interne, huit fois cité, mais plus souvent en position de Poulidor ; Jean-Jacques Hardouin, de Lyon, élève interne, excellent "troisième couteau", dont le nom apparaît cinq fois. On trouve encore les noms d'Auguste Blanc, Marius Ginoyer, Eugène Turin, Jean-Baptiste Gérentet, Victor Boisset, Décius Giamarchi (de Vescovato, Corse).
Figure aussi un certain Dominique Barnola (« de Lyon, pension Champavert ») qui me rappelle les monstrueux chahuts que, élèves de 2de dans les antiques bâtiments de ce même lycée Ampère, nous avions fait subir au nouveau professeur de physique-chimie, qui portait ce patronyme, pour étrenner sa première année d'enseignement (dévissage intégral des plateaux - en bois - et des pieds - en fonte - des tables, entre autres, avec les conséquences qu'on peut imaginer). Nous retrouvant à la rentrée suivante, il s'était cruellement vengé, en crucifiant dans les trois premières minutes du premier cours notre camarade Pons, beaucoup moins méchant que nous autres, mais pas assez "discret" (ce qu'on appelle "faire un exemple"). Cette année-là, il fut tranquille. Comme quoi ...
09:05 Publié dans LITTERATURE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, lyon, poésie, lycée ampère, général aupick, baudelaire à lyon, collège royal de lyon, éducation nationale, najat valaud-belkacem, jacques prévert, distribution des prix, littérature, les fleurs du mal, littérature française


