lundi, 29 octobre 2018
UN PEU DE BERNANOS
Message à tous les caritatifs, à tous les humanitaires, à tous les altruistes, à toutes les grandes âmes qui font profession de se porter au secours des misérables du monde entier et des victimes de toutes les calamités, qu'elles soient naturelles ou causées par les activités humaines.
« Les misérables n'ont jamais été aimés pour eux-mêmes. Les meilleurs ne les souffrent ou ne les tolèrent que par pitié. Par la pitié, ils les excluent de l'amour. Car la réciprocité est la loi de l'amour. Il n'est pas de réciprocité possible à la pitié. »
Merci, à l'occasion, à celui qui me dira de quel ouvrage sont tirées ces quelques lignes.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, georges bernanos
samedi, 06 octobre 2018
LES 31 DÉCEMBRE DE FRÉDÉRIC BEUTTER
LA FRANCE D'AUTREFOIS (2)
1881 : Demain Samedi dans mon ancien magasin après petite soirée chez Mme Herzberg, les enfants reçoivent de jolis cadeaux de tous côtés.
L’année qui vient de finir en somme n’a pas été mauvaise pour nous, tous les nôtres ayant été conservés en bonne santé et les enfants ayant été bien sages. Au magasin, les affaires n’ont pas été brillantes, le nouveau rayon d’Orient me donne beaucoup de souci, mais enfin espérons que la nouvelle année nous soit aussi propice que l’ancienne. J’ai fait une petite spéculation à la bourse qui m’a rapporté 12 à 15.000 Frs par le Crédit Provincial.
1882 : Les Vincent viennent passer la soirée chez nous mais une forte migraine me force de me coucher de bonne heure, je souffre aussi beaucoup d’un eczéma à la main droite et je finis tristement l’année, d’autant plus que les affaires vont très mal et que nous craignons une bien mauvaise année pour 1883 Dieu merci tous les nôtres vont bien et les enfants sont sages, espérons que le Bon Dieu nous les conserve ainsi pour 1883 – Mort de Gambetta.
1883 : Point d’arbre de Noël ni fête de jour de l’An que nous passons très tranquillement, faisant les visites de famille qui ne m’amusent pas beaucoup.
En somme 1883 n’a pas été mauvaise pour nous tous les nôtres étant en bonne santé et les garçons très sages à l’école, les affaires ont été très difficiles mais toujours été occupé, puisse l’année 1884 nous être aussi favorable.
1884 : Nous finissons bien tranquillement cette année qui a été mauvaise pour les affaires nous forçant à réduire les frais le plus possible, nous renvoyons Mr Sallebach et Mr Fournier qui nous quitte également, j’ai eu des correspondances très pénibles avec Weigert à ce sujet, mais en dehors des soucis d’affaires, l’année a été bonne pour les santés. Fred est dans les 7 premiers de sa classe et reçoit demain sa 1ère redingote, Pierre est 5ème et reçoit demain son premier pantalon long et uniforme, Charley sait presque lire nous avons donc lieu de remercier Dieu de nous avoir conservés en bonne santé espérons que la nouvelle année nous soit aussi favorable.
1885 : Nous passons la soirée bien gentiment avec Auguste et nous avons à remercier Dieu d’avoir conservé tous les nôtres en bonne santé pendant cette année.
1886 : Nous passons la soirée très tranquillement, les Gonon, à la suite d’un potin nous ayant un peu négligés. Fred s’est décidé à se préparer à Polytechnique, Dieu veuille qu’il réussisse. L’année 1886 n’a pas été mauvaise pour nous, tout le monde s’est bien porté et au magasin j’ai été bien occupé Dieu veuille qu’il en soit de même avec la nouvelle année.
1887 : Nous finissons l’année bien tranquillement avec les Vincent.
1888 : Charles ayant pris la rougeole, Sophie ne peut le quitter et nous faisons les visites de jour de l’An avec Fred et Pierre.
Nous avons à remercier Dieu de toutes les grâces de cette année, beaucoup de travail, la santé et surtout le mariage si heureux de Hortense [sa fille et mon arrière-grand-mère].
1889 : Fred va mieux, ce soir nous avons le Dr Blanc à souper puis les Bodoy avec lesquels nous passons la soirée jusqu’à minuit.
L’année 1889 a été bonne pour nous, ce dont je remercie le Bon Dieu, et j’espère que 1890 sera aussi heureux.
1890 : Nous passons la soirée avec le Dr Blanc et Lieutenant Parrin, ami de Frédéric et nous disons adieu à l’ancienne année avec reconnaissance envers Dieu pour nous avoir tous conservés en bonne santé et donné le petit-fils Léon [mon grand-oncle, alias Bibolet, alias Topé] que Pierre et Charles sont allés voir hier.
1891 : Mme Alex va mieux, ce matin jour de mes comptes de fin de mois et c[illisible] de Weigert qui me demande d’aller le voir à cause d’une réclamation injuste sur les comptes de Liebmann, ce voyage à Lyon me contrarie beaucoup, quoique j’y trouve Pierre et Charles chez Hortense tous en bonne santé, je ramène Pierre et Charles avec moi, ils avaient passé 3 jours à Lyon pendants lesquels Pierre m’a téléphoné tous les jours au bureau.
L’année 1891 a été bonne pour nous comme santé mais très mauvaise comme affaires qui pour la 1ère fois ne me donne rien à mettre de côté, et l’engagement avec la maison a été prolongé jusqu’à fin 1892, et Dieu veuille que d’ici là les affaires deviennent meilleures et qu’au mois de Mars Hortense nous donne une gentille petite fille [ce sera mon grand-père Frédéric, le médecin].
1892 : Ce soir je reçois un excellent bulletin du Directeur de l’Ecole de Commerce qui nous fait bien plaisir pour Pierre qui est venu passer les fêtes avec nous. Nous passons la soirée bien tranquillement en nous souhaitant une bonne nouvelle année qui s’annonce sous des auspices bien tristes à cause des troubles politiques et le scandale de Panama et pour moi la réduction de mon appointement à [de ?] 6.000 Frs. Mais tous les miens se portent bien et les enfants sont sages, donc, à la grâce de Dieu.
1893 : Je me couche de bonne heure et dis adieu à la vieille année qui, pour moi, a été mauvaise, mais bonne comme santé.
1894 : Nous finissons l’année bien tranquillement. Nous sommes tourmentés par Pierre dont la paupière gauche se ferme ce qui m’inquiète. Les autres santés allant bien, nous n’avons pas à nous plaindre quoique je n’aie pas réussi à trouver une position et Mr Savoye se retirant des affaires je suis obligé de quitter en Mars mon joli bureau et de me caser ailleurs.
1895 : Ce soir nous soupons chez les Harmet et finissons gaiement l’année à laquelle nous devons ce brillant mariage de Fred [avec Marie Harmet] et le succès de Charles au Bachot si je pouvais trouver du travail, tout serait parfait, car tous les nôtres sont en bonne santé.
1896 : Nous passons la soirée tranquillement chez nous après avoir souhaiter la bonne année à Fred et Marie et aux Harmet.
Que l’année nouvelle nous permette de caser Pierre et nous apporte un bébé bien portant chez Fred, c’est là mon plus grand désir.
1897 : A cause de ma mauvaise position je finis l’année tristement tout en remerciant Dieu de nous avoir conservés en bonne santé.
1898 : A la suite d’une nouvelle scène avec Pierre, l’année finit tristement pour moi. Heureusement il me demande pardon ; ce qui rétablit nos rapports.
1899 : Depuis 15 jours nous avons les 2 grèves des passementiers et des mineurs qui arrêtent complètement les affaires. L’année finit donc tristement mais tous les nôtres sont Dieu merci en bonne santé.
1900 : Maman et Charles vont à la messe de minuit.
1903 : Pierre part à 1 heure 40 pour Château Renard [où réside sa fiancée] nous finissons donc l’année seuls. Dieu veuille bénir cette nouvelle union.
1904 : Depuis 8 jours nous attendons un 5ème bébé chez Fred, le soir après avoir fait quelques visites avec Charles nous soupons chez les Vincent le 1er Janvier avec les Harmet Pierre et Paulin.
Dieu veuille que Hortense au lit depuis 4 mois se rétablisse en 1905.
1905 : Comme Pierre faute de capitaux est forcé de liquider son commerce et de chercher une autre situation l’année finit tristement pour nous, espérons que 1906 qui s’ouvre sous des auspices très inquiétants nous garde tous en bonne santé, et nous préserve de tout malheur.
1906 : Hortense toujours malade et Pierre sans place, nous finissons l’année tristement.
1907 : Nous finissons tristement la fin d’année dans laquelle nous avons perdu notre chère Hortense mon indisposition durant toujours espérons que 1908 soit meilleure.
1908 : Nous finissons tranquillement l’année qui nous a bien éprouvés par la maladie de moi Maman et Fred et m’a forcé de me retirer des affaires [il a 81 ans, et il regrette d'être obligé de cesser de travailler].
[Frédéric Beutter meurt le 12 août 1909 : pour lui il n'y aura pas de 31 décembre cette année-là].
Il va de soi, j'espère, que je n'ai pas modifié une virgule du texte que j'ai transcrit avec émotion.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 05 octobre 2018
LES 31 DÉCEMBRE DE FRÉDÉRIC BEUTTER
LA FRANCE D'AUTREFOIS*
Voilà, ça y est : j'ai achevé hier la transcription du tapuscrit (198 pages 21x27, 2° ou 3° carbone sur une vieille machine à écrire, 144 pages au format A4) du Journal du Grand-Père maternel de mon Grand-Père maternel, FRÉDÉRIC BEUTTER. Au fil de ses jours et de ses années, je me suis pris d'attachement pour cette personne particulière et celles qui l'ont entourée. Curieusement, ce citoyen allemand naturalisé français (qui arbore en 1870 une citoyenneté suisse !), que je vois d'un genre plutôt rigide, a relevé tous les jours dans un carnet qui ne le quittait jamais, à partir de sa vingtième année, ce qu'il jugeait bon à retenir. Il va de soi que j'aimerais bien mettre un jour le nez dans le manuscrit original.
Frédéric Beutter, je ne l'idéalise certes pas : il ne devait pas être drôle tous les jours. Mais enfin, ce fut un père énergique et actif, attentif et aimant et, à l'occasion d'agapes amicales ou familiales, un très bon compagnon, qui se montrait parfaitement en mesure de manger et surtout de boire autant que les autres et, en de certaines circonstances particulières, de se prendre un « plumet colossal » (selon ses mots), quoique toujours capable de rentrer chez lui par ses propres moyens.
Frédéric Beutter naît le 9 juin 1827 à Constance (Allemagne). J'ai rassemblé ici toutes les annotations qui figurent au long de son Journal, mais seulement à la date du 31 décembre. Il met du temps, on le verra, à considérer le dernier jour de l'année comme digne d'être célébré puisque, à une exception près (au tout début), il commence à évoquer la date de façon spécifique après son mariage avec Sophie Paliard (il a 32 ans en 1860).
* Référence au livre de Jean-Pierre Le Goff : La France d'hier, Stock, 2018 (qui lui-même se référait à Stefan Zweig : Le Monde d'hier).
************************
LES 31 DÉCEMBRE DE FRÉDÉRIC BEUTTER
1849 : Je passe la soirée au café Lauser avec Zahn, Fisher, ce dernier à ma grande joie me propose de nous tutoyer.
1863 : Ma femme se fâche sérieusement contre moi de ce que j’ai fait part à Mme Friedmann de sa grossesse, cette dernière journée de l’année finit très tristement pour moi et, contre mon habitude, je me couche sans attendre comme autrefois Minuit. J’ai arrêté mes comptes aujourd’hui et je vois à ma grande déception que mes dépenses de cette année ont encore dépassé Fr 6.000, malgré la plus stricte économie, comme ma position dans la maison A & S sans contrat est très précaire, je suis très inquiet de ce que la nouvelle année me réserve… Puissé-je me tromper.
1865 : Nous passons la soirée très gaiement avec Henri et sa famille après avoir fait comme d’habitude un très joli arbre de Noël.
1866 : Aujourd’hui après souper, nous avons Henri et sa femme, Mr et Mme Mees pour finir dignement l’année, nous passons assez bien la soirée ensemble et à minuit nous buvons du champagne à la santé du père, à Constance et de tous ceux que nous aimons.
Ainsi finit pour nous cette année 1866, très importante pour nous à cause de mon changement de position, même assez bonne si le Bon Dieu ne nous avait pas enlevé notre chère petite Fanny [morte âgée d'un an].
1867 : Ce matin, à mon plus grand bonheur, je reçois une bonne lettre du père de Constance, qui Dieu merci continue à aller un peu mieux. Nous passons la soirée tranquillement avec les Mees et disons adieu à l’année 1867 qui après tout ne nous a pas été défavorable puisque nous et tous les nôtres nous ont été conservés en bonne santé ; que le Bon Dieu nous accorde la même faveur pour la nouvelle année 1868.
1868 : Nous passons la soirée chez les Mees, avec les Fiedmann et souhaitons la bonne venue à la nouvelle année. Quant à l’ancienne nous la quittons sans regrets, car par la mort de notre pauvre père, de Jules, par la perte de ma position, elle a été la plus malheureuse de ma vie entière.
1869 : Nous avons les Mees, nous faisons de la musique jusqu’à minuit où nous disons adieu à l’année ; nous nous embrassons en nous souhaitant une bonne nouvelle année, que le Bon Dieu nous protège et nous donne un enfant bien portant.
1870 : A cause des temps tristes dans lesquels nous vivons, nous n’avons pas fait d’arbre de Noël, ni de souper ce soir ; et c’est tout seul que nous attendons le coup de minuit ; espérons que la nouvelle année soit meilleure que l’ancienne et que le Bon Dieu nous préserve tous de tout malheur.
1871 : Joseph vient souper avec nous mais s’en va avant minuit, nous restons donc tous les deux à attendre ce moment et saluons la nouvelle année ; puisse-t-elle être aussi bonne pour nous que celle que nous quittons et pendant laquelle le Bon Dieu nous a tous conservés en bonne santé.
1872 : Comme nous n’avons malheureusement plus d’amis pour passer cette soirée nous restons tout seuls, Hortense étant invitée chez Mme de Mirandol ; malgré moi cela me rend triste, d’autant plus que depuis quelques jours nous n’avons absolument rien à faire au magasin et il y a des moments où je regrette d’avoir quitté ma position chez F. Vogel et Cie, malgré tous les désagréments avec Appold. Enfin, espérons que cela change et que surtout la nouvelle année nous donne un enfant bien portant, et que ma chère Sophie passe très bien ce terrible moment ; pour le moment toutes les santés vont bien, j’ai donc encore à remercier le Bon Dieu de nous avoir protégés pendant l’année qui vient de s’écouler.
1873 : Avant-hier je reçois la visite de Mr Peterson avec qui j’allais à Grenoble hier, en route je lui fais part de mes ennuis causés par l’inaction et le séjour prolongé de Glackmeyer. Ce soir nous allons dîner chez Boell où nous passons la soirée assez agréablement jusqu’à minuit lorsque tout le monde se souhaite la bonne nouvelle année.
L’ancienne année n’a pas été bonne pour nous ayant perdu notre cher petit Léon [mort en bas âge] et les affaires étant toujours très mauvaises et moi presque toujours inoccupé ce qui me rend malheureux.
Mais Sophie, Hortense et Frédéric vont très bien et les enfants grandissent et nous font tous les jours plus de plaisir. Donc nous n’avons pas trop à nous plaindre et seulement à espérer que la nouvelle année ne soit pas moins bonne pour nous que l’ancienne.
Depuis environ un mois Sophie croit être de nouveau enceinte, que Dieu la protège et nous accorde la joie de recevoir un enfant bien portant et que tout se passe bien.
1874 : Depuis plusieurs jours nous avons un froid excessif mais Dieu merci tous les nôtres vont bien et nous finissons donc l’année tranquillement mais bien heureux et contents. Dieu veuille nous protéger en 1875 comme en 1874.
1875 : Je reçois ce matin une très jolie lettre de Caton [sœur de F.B.] et de ses enfants qui me fait plus de plaisir que depuis ma brouille avec Charles, je suis sans nouvelles de ma famille. Le soir nous restons seuls et je me couche de bonne heure en disant adieu à l’année 1875 qui sous le rapport des affaires de l’agrément n’a pas été bien bonne pour nous, mais Dieu merci tous les miens vont bien ce qui est l’essentiel, espérons qu’en 1876 cela reste de même et que nos enfants continuent à être sages comme jusqu’à présent.
1876 : Aujourd’hui Dimanche nous recevons des lettres de partout, St-Etienne, Sens, Constance, Feldkirch, après midi nous faisons des visites et comme Joseph et sa femme sont venus nous voir quelques fois ces temps-ci, je leur fais une visite de jour de l’An, pour la 1ère fois depuis 2 ans, ce qui paraît faire beaucoup de plaisir à Joseph.
Le soir nous trinquons avec les amis Valayer et puis nous nous couchons tranquillement, en faisant adieu à l’année 1876 qui, comme santés, chose essentielle, nous a été favorable, seulement comme affaires elle a été désastreuse pour moi puisse la nouvelle année être meilleure.
1877 : Hier Dimanche, Fred était très fatigué, pendant que j’étais allé à St-Genis avec Hortense, heureusement la nuit a été meilleure et ce matin il va mieux et Pierre se lève, le temps est très mauvais et l’année finit bien tristement pour moi ; Dieu veuille que 1878 nous soit plus propice et que je trouve une position convenable car je crains bien qu’il ne soit pas possible de relever l’affaire C.W. Cie.
Chamberlin part ce soir pour Nice, il ne peut rien faire avec nous, je l’accompagne à la gare et reviens à Minuit souhaiter la bonne année à ma chère femme et à nos chers enfants que Dieu nous les conserve aussi sages qu’ils ont été jusqu’à présent.
1878 : Nous avons Klipfel et Sallenbach à souper et finissons la soirée ensemble jusqu’à minuit.
Nous voilà donc à la fin de cette année, pendant laquelle j’ai perdu toute ma fortune chez Wichelmann et forcé de tâcher de la refaire, j’ai dû quitter cette belle ville de Lyon pour revenir à St-Etienne, le berceau de ma carrière commerciale. Quoique ma nouvelle position m’assure le pain, j’ai toujours le regret d’avoir quitté Lyon. Enfin que ce soit pour le bonheur des miens et que le Bon Dieu me les conserve en bonne santé et aussi sages qu’ils le sont en ce moment.
1879 : Ce soir, nous avons Sallenbach, Klipfel et Maurer à souper et passons la soirée très gaiement.
Après tout nous avons à remercier le Bon Dieu de l’année 1879 pendant laquelle nous avons eu beaucoup de joies avec nos enfants et le bonheur de recevoir Charles qui va très bien, puisse l’année 1880 nous être aussi favorable. Et me donner un peu plus de satisfaction dans mes affaires commerciales.
1880 : Heureusement après une explication avec Victor et une bonne visite au père Félix et Juju nos rapports avec la famille se rétablissent, nous passons la soirée chez nous bien tranquillement et avons lieu de ne pas trop nous plaindre de l’année 1880, à l’exception de la mort de Fanny [autre sœur de Frédéric] et du mauvais état des affaires, espérons que dans l’année 1881 cela aille mieux et que nos enfants continuent à nous faire autant de joie que par le passé.
A suivre demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 octobre 2018
FRÉDÉRIC BEUTTER JUNIOR SE MARIE ...
1895
[UN "BRILLANT" MARIAGE]
6 mars : Aujourd’hui Melle Verneret vient proposer à Maman un mariage pour Fred avec Melle Mirk et une dot de 10.000 Frs comme elle a été légitimée à 9 ans nous n’y donnons pas suite, mais activons nos démarches auprès des Harmet.
25 mars : Mr de Castelnau fait venir Fred chez lui et lui propose un superbe mariage. Fred dit qu’il ne se prononcera pas avant d’être fixé sur ses vues sur Melle Harmet, M. de C. l’approuve et lui promet son concours.
27 avril : Aujourd’hui Mr Harmet m’ayant donné rendez-vous sur la place St-Charles je l’emmène au bureau où il me demande, en cas, que l’idée de marier nos enfants se réalisait, combien je lui donnerais pour cadeaux et mise en ménage je lui réponds que dans ma position actuelle, je ne pourrais pas lui donner plus de 10.000 Frs plus 3.000 Frs de rente viagère et qu’il désirerait garder comme inaliénables les propriétés qu’il a achetées et qui ne devront pas figurer sur le contrat, je lui ai répondu que nous nous en rapportions à lui pour cela et que Fred ne tiendrait pas à toucher le capital mais il n’est pas de cet avis, enfin il demande à ce que rien ne soit changé à nos rapports actuels avant fin Mai lorsqu’il donnera sa réponse définitive.
20 avril : Mr. De Castelnau ayant informé Fred de ce que Mr Harmet lui avait dit qu’il pourrait maintenant agir comme il l’entendrait Maman et moi allons prier M. de C. de faire la demande ce qu’il promet de faire en quelques jours.
21 mai : Mr Harmet m’ayant donné rendez-vous sur la place Marengo me dit de venir avec Maman demain faire la demande officielle.
22 mai : A 2 heures Maman et moi allons chez Mr Harmet et sommes reçus à bras ouverts Melle charmante dit gentiment oui à notre demande après quoi nous nous embrassons tous bien heureux de ce bonheur inespéré. Fred est invité à déjeuner pour demain et envoie le soir même son 1er bouquet, j’annonce la nouvelle à Mme Alexandre et David félicité chaudement.
23 mai : J’écris à Joseph Henri Léon Valayer à midi Fred bien ému va chez les Harmet et porte une belle bague de fiançailles il est reçu très chaudement et part pour Lyon inviter Félix et Hortense au dîner chez M.H. pour demain soir où nous serons présents tous à leur famille, il revient à 1 heure du matin bien content.
24 mai : J’écris à mes frères et sœurs et reçois des félicitations partout.
25 mai : Ce soir grand dîner de fiançailles chez Mme Harmet et présentation à la famille, Félix et Hortense arrivent à 6 heures assistent au dîner avec tante Maria et partent à 10 heures. Accueil charmant et cordial nous sommes tous enchantés de notre gentille future belle-fille.
29 mai : Ce soir Mr Mme Melle Harmet viennent pour la 1ère fois souper à la maison.
2 juin : Fred va passer 2 jours de fête chez les Harmet à Flévieux et Vienne.
6 juin : Aujourd’hui Fred reçoit un beau bronze (Vulcain forgeant une flèche) offert avec une lettre par une 100aine de ses ouvriers. Le soir Mr Harmet vient souper à la maison.
10 juin : Ce soir Mr Mme Melle Harmet viennent souper à la maison.
13 juin : Ce soir Fred présente sa corbeille de mariage se montant à près de 10.000 Frs et payée par la dot que je lui ai constituée.
22 juin : Ce soir Fred donne son dîner de garçon chez Faure pour les garçons d’honneur et tous les chefs de service de l’usine qui lui offrent un beau bronze.
30 juin : Ce soir à 5 heures lecture et signature du contrat chez Mr Harmet devant le notaire Mr Balaÿ, Félix Hortense, nous tous et le Cel Rivoire y assistent, tout se passe bien quoique Mme Harmet soit bien triste. Après dîner soirée très gaie malgré la forte chaleur.
1 juillet : Ce soir 5 heures mariage civil avec Mr de Castelnau et Dr Blanc pour témoins de Fred et Cel Rivoire et Marducci ceux de Melle Harmet, le soir Mr Mme Melle Harmet viennent souper chez nous.
2 juillet : Temps superbe à 10 heures ½ nous nous rendons chez les Harmet avec Fred très ému en quittant son foyer paternel, la mariée est ravissante et suivie d’un brillant cortège à l’Eglise St-Charles remplie de l’élite de la Société de St-Etienne à notre entrée la musique de l’usine joue, puis l’abbé Gisclon, après un beau sermon nous touchant aux larmes, bénit le jeune couple, ensuite chant de Mme Bouton et Mme Tardif et solo de Violon par Beau devin, cérémonie magnifique et ensuite défilé à la sacristie à 1 heure dîner de 100 couverts chez Duprés avec les beaux toasts du Cel Lucien Rivoire Léon et Mme de Castelnau, je bois à la santé des chanteurs garçons et demoiselles d’honneur gaieté générale, à 9 heures ½ ouverture du bal par le quadrille d’honneur des grands-parents et les nouveaux mariés qui sont tout radieux et restent jusqu’à 2 heures puis rentrent chez Mr Harmet pour partir en voyage de noces demain matin, fête magnifique, assistance nombreuse toilettes superbes.
Joseph et sa fille Louise sa sœur et son frère sont de la fête dans la journée nous recevons plusieurs dépêches entre autres de Feldkirch, Maman était très belle dans la robe de satin noir tissée par Pierre [son fils] et rentre avec Pierre et Charles à 5 heures du matin moi j’étais rentré à 3 heures.
3 juillet : Fred et Marie partent par le 1er train pour Genève d’où dans la journée Mme Harmet reçoit une bonne dépêche.
31 décembre : Ce soir nous soupons chez les Harmet et finissons gaiement l’année à laquelle nous devons ce brillant mariage de Fred et le succès de Charles au Bachot si je pouvais trouver du travail, tout serait parfait, car tous les nôtres sont en bonne santé.
***********************
Note : J'ai ici éliminé des notes du Journal de Frédéric Beutter tout ce qui ne concerne pas directement la vie et la trajectoire professionnelle de son fils Frédéric ainsi que les rapports entre père et fils. Il faut signaler que je respecte scrupuleusement l'orthographe et la ponctuation (quand il y en a) telles qu'elles figurent dans le tapuscrit en ma possession. Je n'ai corrigé que les coquilles évidentes. Les données factuelles et nominales (malgré les errements de l'orthographe du tapuscrit en particulier sur les noms propres) sont exactement confirmées par celles qui figurent dans les remarquables travaux généalogiques de Mr Alain Teyssier, d'Annonay.
Je n'ai pas l'honneur de connaître ce monsieur, ce que je sais c'est qu'il n'a cessé d'enrichir l'arbre familial "Paliard", à partir du tronc (Pierre François Paliard, mort avant 1742, qui avait épousé Jeanne Claudine Chagrot, et il y a un Claude Antoine Paliard né en 1722, quelque part du côté du lac de Saint-Point, Doubs, côté Malbuisson), au moyen de branches, branchettes, rameaux, ramilles et ramillons, dont l'ensemble touffu, mais à la méthode impeccablement rigoureuse, impressionne, au point de sembler, au premier abord, impénétrable comme le pire des ronciers (abondance de Félix Léon Maurice Henri et quelques autres à chaque génération et dans chaque branche — au nombre respectable de 48 au fil de plus de deux siècles !! On imagine avec peine la distance de papier qu'il faudrait pour faire figurer la totalité de l'extension horizontale de cette famille dans la génération actuelle) : je commence à peine à me faire une idée de la structure principale.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : généalogie, littérature familiale, frédéric beutter, assassinat sadi carnot lyon, caserio, école des mines, aciéries de saint-étienne, famille paliard, alain teyssier annonay
mardi, 02 octobre 2018
FRÉDÉRIC BEUTTER JUNIOR SE MARIE ...
... ET FAIT CARRIÈRE.

Frédéric junior, le futur.
1870-1922

Marie Clotilde Harmet, la promise.
1873-1958

Frédéric senior.
1827-1909

Henri Guillaume Harmet, le père de la demoiselle.
1844-1926
***********
EXTRAITS DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER.
1893
17 juillet : Ce matin Fred est agréé par Mr Cholat comme Ingénieur aux Aciéries de St-Etienne pour y rentrer le 1er Août, cette bonne nouvelle nous comble de joie, car nous y voyons l’avenir de notre cher fils assuré avec le bonheur de le garder près de nous.

L'usine où Frédéric (Fred) a son bureau.
29 juillet : Aujourd’hui Fred met pour la 1ère fois son joli uniforme des Mines et assiste le soir au banquet d’adieu.

Un nommé Auguste Courriol, promotion 1896-1899, en uniforme.
31 juillet : Aujourd’hui Fred entre comme Ingénieur aux Aciéries de St-Etienne Dieu veuille qu’il réussisse à y faire son chemin comme il le mérite. Au classement définitif [de l'Ecole des Mines] il sort 4ème sur 23 élèves.
25 août : Aujourd’hui Fred reçoit de Mr Harmet l’assurance qu’il serait payé à partir du 1er courant à raison de 1.500 Frs l’an plus une prime de 3 Frs par plaque reçue ce qui vaut environ 2.500/2.700 Frs l’an superbe.
31 août : Aujourd’hui Fred touche ses 1ers appointements 125 Frs par mois (plus une prime sur les plaques reçues).
8 octobre : Aujourd’hui Fred rentre à son poste à l’usine et Pierre à l’Ecole de Commerce de Lyon.
1894
15 mars : Fred se trouvant fatigué va voir le Dr Blanc qui lui dit qu’il a une sistite [sic] – inflammation de la vessie. Espérons que cela ne soit pas trop sérieux. Depuis 15 jours pas une seule lettre quel ennui.
18 mars : Aujourd’hui Dimanche scène pénible avec Fred qui me reproche de fumer en passant par sa chambre et me dit que plus tard il me défendrait de fumer chez lui. Inouï.
28 mars : Après une bonne journée d’hier étant sorti et probablement resté dehors trop longtemps, il reprend le soir ses douleurs à la vessie très fort et passe une bien mauvaise nuit. Ce matin le Dr Blanc lui prescrit un repos absolu au lit et me dit que cela pourrait bien durer assez longtemps ce qui nous effraye, j’en préviens Mr Harmet qui me dit de le soigner avant tout et de ne pas le laisser se préoccuper de sa position.
29 mars : Après une bien mauvaise nuit souffrant d’atroces douleurs au ventre Fred se calme à midi et passe
30 mars : une bonne nuit espérons que cela continue.
9 avril : Aujourd’hui Fred reprend son service à l’usine.
18 avril : Ce matin Fred va mieux et retourne à l’usine.
25 juin : Ce matin à 1 heure Fred ayant passé la journée à Lyon pour voir l’Exposition nous apporte la toute nouvelle de l’assassinat de Carnot par un Italien tout le monde est bouleversé et inquiet sur l’avenir.
7 septembre : Ce soir Fred me fait encore une scène au souper il me reproche de les empêcher de s’amuser [Fred a 24 ans] à la maison où ils s’embêtent comme des rats morts et cela dans un moment où je fais tout mon possible pour qu’ils ne souffrent pas de ma perte de position.
8 octobre : Aujourd’hui Fred est nommé chef de service aux Forges en remplacement de Mr Verdreau, renvoyé.
23 octobre : Aujourd’hui Pierre va à Lyon recevoir son diplôme.
Ce soir Mr Harmet informe Fred qu’à partir du 1er Novembre ses appointements seraient élevés à 300 Frs par mois, augmentés dans le courant de l’année ce qui nous comble de joie.
1 novembre : Après la visite au cimetière Fred va à Lyon annoncer cette bonne nouvelle.
20 décembre : Aujourd’hui Mr Harmet prévient Fred qu’à partir du 1er Janvier ses appointements seraient élevés à 400 Frs par mois, donc position superbe.
************
Prochain épisode : un brillant mariage.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : généalogie, littérature familiale, frédéric beutter, assassinat sadi carnot lyon, caserio, école des mines, aciéries de saint-étienne, famille paliard
lundi, 01 octobre 2018
ÇA Y EST, MON GRAND-PÈRE EST NÉ
EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER.
ANNÉE 1892
03 17 : Ce matin ayant reçu une dépêche de Félix annonçant l’accouchement imminent de Hortense, maman part pour Lyon à midi et le soir à 4 heures je reçois une seconde dépêche de Félix me disant que Hortense était heureusement accouchée d’un gros garçon (avant l’arrivée de Maman) et que tout allait bien ce dont nous sommes très contents quoique Hortense eût désiré une petite fille.
03 18 : Ce soir Maman revient de Lyon, bien contente. Hortense a beaucoup souffert et était seule avec son mari et sa belle-mère, mais à 10 heures du matin tout était fini, et maintenant Hortense va aussi bien que possible et le garçon est superbe.
03 20 : Aujourd’hui dimanche, par un temps splendide, nous partons tous pour Lyon, après la messe, déjeuner excellent chez Léon [père de Félix, grand-père du nouveau-né], puis nous allons chez Hortense qui va aussi bien que possible et nous témoigne beaucoup de gratitude pour nos beaux cadeaux, médaille et chaîne et un porte feuille de Fred pour le nouveau-né qui est superbe de santé, un chronomètre pour Félix et des jouets pour Bibolet qui va très bien.
A 4 heures, baptême à l’église de la paroisse, je suis parrain avec Marianne pour marraine et le petit est baptisé, Frédéric Pierre Joseph, après la cérémonie, nous prenons congé de Hortense et allons dîner chez les Valayer où nous passons une excellente soirée heureux de voir nos enfants réunis [142] de nouveau pour la 1ère fois depuis notre départ de Lyon, les enfants s’amusent beaucoup et nous regrettons seulement l’absence de M. Valayer parti hier pour Crest à 10 heures du soir nous partons à pied et revenons par le dernier train et arrivons à 1 h ½ du matin bien contents de cette belle journée.

Entre le premier moment de sa vie et la dernière photo – éminemment chargée pour moi – de Frédéric Paliard vivant (été 1969, il est mort en septembre), il s'est écoulé 77 ans.
Note : Marianne Paliard (née Milliet) est l'épouse de Jacques Léon Paliard : ce sont les grands parents qui sont parrain et marraine. "Bibolet" est le surnom (inexplicable) de Léon Paliard, futur chanoine et futur fondateur du Grand Séminaire de Hanoï (Vietnam). Je l'ai plutôt connu avec son surnom "Topé" (tout aussi inexplicable). Celui de Frédéric était "Frisco", et celui de Pierre, le dernier fils d'Hortense et Félix (mon parrain que nous appelions "Oncle Pierre de Marseille"), "Pazo".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 30 septembre 2018
FRÉDÉRIC BEUTTER MARIE SA FILLE
EXTRAIT DU JOURNAL DE FREDERIC BEUTTER.
1888
12 16 : Aujourd’hui la tante Maria nous demande notre chère Hortense en mariage avec Félix Paliard qui a fini ses études de médecin, notre bonheur de cette demande n’est troublé que par la crainte que Hortense nous quitte pour aller habiter Lyon, car sans cela, nous n’aurions pas pu espérer mieux pour ce cher enfant.
12 25 : Aujourd’hui Marianne et Félix viennent remettre la bague de fiançailles à Hortense et nous passons une bonne journée ensemble, nous recevons des félicitations de tous côtés.
12 31 : Charles ayant pris la rougeole, Sophie ne peut le quitter et nous faisons les visites de jour de l’An avec Fred et Pierre.
Nous avons à remercier Dieu de toutes les grâces de cette année, beaucoup de travail, la santé et surtout le mariage si heureux de Hortense.
1889
01 01 : Après nos visites nous soupons chez Vincent ; tout le monde me félicite du mariage de Hortense.
01 21 : Hortense Fred et la tante Maria partent avec moi pour Lyon pour voir les Léon qui nous reçoivent avec beaucoup d’enthousiasme, nous passons une bonne soirée avec eux et revenons par le dernier train bien contents, Sophie ne pouvait pas quitter Charles qui est en convalescence de la rougeole.
04 08 : Depuis 3 mois Félix vient voir Hortense toues les semaines ; ils reçoivent beaucoup de cadeaux de la famille, Antonin, Peyre, Daeniker, Delporte, Berthollet. Aujourd’hui paraît au Mémorial l’annonce de leur mariage.
04 17 : Aujourd’hui pour récompenser Fred de sa bonne place je l’amène à Lyon entendre « Sigurd » [d’Ernest Reyer] nous y trouvons son professeur Billies.
04 20 : Henri par une simple carte refuse notre invitation à la noce.
04 23 : Ce matin nous assistons tous à la messe par l’abbé Jeune et servie par Fred, Félix arrivé hier et Hortense communient ensemble ce qui nous donne une émotion bien douce.
04 24 : Ce soir mariage civil de notre chère fille Hortense avec Félix Paliard assistés de leurs parents oncles et tante Maurice Général Sapy [?] Léon Paliard Mr Berthollet témoins, l’adjoint (Mr Roux) fait un joli petit discours faisant mes éloges et ceux des deux familles. Ensuite nous signons le contrat (Me Germain). Je donne 20.000 Frs de dot comptant plus le trousseau. Après le mariage nous dînons tous ensemble à l’hôtel de France (sauf Léon Berthollet).
04 25 : Par un temps incertain, mais se levant un peu, je vais chercher les Valayer et Joseph (vêtu comme un pauvre) à la gare, puis à 11 h 15 nous rendons à l’église St-Charles superbement décorée de fleurs et remplie d’une assistance très nombreuse ; Maurice (violon) Fred (Harmonium) jouent les morceaux religieux composés par Léon d’une manière superbe, l’abbé Morel, cousin de Félix qui lit la messe fait une très jolie allocution. [123] Après cette magnifique cérémonie où Hortense est ravissante dans sa toilette de mariée, tout le monde se presse dans la sacristie, après nous nous rendons directement à l’Hôtel de France où la table est dressée pour 65 couverts parmi lesquels Dr Lépine Gayet Alexandre Guillaume J.Gerin, Berthollet, Burty, le dîner est excellent et très gai pendant lequel nous recevons des dépêches de Feldkirch, Ario, Meran, Constance, Freiburg et Daeniker, on fait beaucoup de toasts et après le dîner on monte au 1er où on commence à danser tandis que les jeunes mariés partent pour Lyon à 8 heures. Je leur dis adieu à la gare où j’avais accompagné les Valayer et rentre chez moi tout de suite après.
04 26 : Aujourd’hui le Mémorial parle de notre cérémonie d’hier et à midi arrive James Gill avec qui je reste à mon grand regret occupé pendant plusieurs jours.
04 28 : Je pars avec Gill pour St-Bonnet le Château, hier en rentrant à la maison je trouve Sophie toute seule à table, ce qui nous attriste beaucoup pauvre femme ; nous recevons de bonnes nouvelles des mariés qui partent pour Marseille, Nice.
05 01 : Nous souhaitons la fête à Fred à qui revient en grande partie le succès de cette superbe cérémonie.
05 23 : Ce soir à 6 heures juste un mois après leur départ Félix et Hortense reviennent en excellente santé et enchantés de leur voyage de noces.
Note : Depuis le début de cette série "Journal de Frédéric Beutter" (le grand-père maternel de mon grand-père maternel), je respecte scrupuleusement l'orthographe et la ponctuation telles qu'elles apparaissent dans le tapuscrit complet du Journal. Le "Fred" qui joue de l'harmonium est le fils de Frédéric. Le "Léon" dont parle cet extrait (le grand-père paternel de mon grand-père maternel) s'appelle Jacques Léon Paliard.

Pour la pose, Marianne fait semblant de tricoter.

Jacques Léon Paliard et Marianne, son épouse, née Milliet.
Toute une époque dans ces photos (non datées, lui est mort en 1907, elle en 1908).
Il est le père du marié. On le présente de la façon suivante à sa place dans l'arbre généalogique familial : « Auteur compositeur, musicien, poète, élu membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, négociant, caissier à Lyon, receveur des hospices civils de Lyon ». N'en jetez plus.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 29 septembre 2018
FRÉDÉRIC BEUTTER SE MARIE EN 1861
EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER.
1861
04 07 : Aujourd’hui jour de la cavalcade, où toute la famille Paliard est venue à mon magasin je forme la résolution de demander en mariage Mlle Sophie Paliard, et j’en informe le soir même Madame Friedmann et la prie de faire les démarches nécessaires pour cela.
04 10 : Ce soir je parle de ce projet à mon ami Félix au magasin qui me témoigne beaucoup de satisfaction et me promet son concours de frère. [8]
08 23 : Je reçois par Madame Friedmann la réponse de Mr et Mme Paliard, que ma demande est acceptée et le Dimanche 1er septembre a lieu la présentation. Je suis en compagnie de Mr et Mme Friedmann. Le mariage est fixé au 24 Septembre mais est renvoyé de 8 jours à cause de mes papiers qui se font attendre.
09 03 : Voyage à Lyon accompagné de Mme Paliard, Mle Sophie, Félix, Mme Friedmann pour acheter les cadeaux de noce et une partie du mobilier.
09 10 : Je loue un gentil petit appartement 5 place Mi-Carême chez Mr Crépet au 3ème à 1.000 Fr l’an sans compter les réparations.
09 26 : Enfin arrivent mes papiers de Constance [lieu de naissance de Frédéric].
09 28 : Aujourd’hui nous signons le contrat de mariage devant Mr Merley le notaire.
09 30 : A cinq heures du soir nous allons à la mairie pour le mariage civil. Mes témoins sont Mr et Mme Friedmann, mon frère Henri, Alexandre Lan et Gonon. J’épouse donc pour mon grand bonheur Mademoiselle Sophie Paliard née le 18 février 1839 de Mr Jules Paliard fabricant d’armes et Mme Hortense du Colombier sa femme.
10 01 : A dix heures du matin nous allons à l’église Saint-Louis pour la Bénédiction Nuptiale Mr Fraisse, Merley m’avait offert sa voiture de Gala ; je donne le bras à Mme Friedmann et Sophie donne le bras à son père. Toute l’église est remplie de monde et à notre grande surprise, nous y trouvons tout l’orchestre du théâtre sous la direction de Mr Sivarts. Ils jouent pendant toute la cérémonie, nous sommes bénis par Mr Langlois curé de Saint-Louis. Mr Wishermann est venu représenter la maison de Lyon. Après la cérémonie, je déjeune chez Mr Friedmann ; à 5 heures du soir, il y a un grand dîner chez le beau-père dans un grand atelier magnifiquement arrangé pour la fête, nous sommes soixante à table, et le dîner est fort gai ; Henri fait un toast bien gracieux au dessert, après le dîner nous passons au salon où nous dansons jusqu’à 1 heure du matin puis nous rentrons chez nous.
10 02 : Mr Friedmann vient nous voir à midi et nous emmène dîner chez lui. Malheureusement au dessert Félix vient nous dire tout effaré que la mère s’est fâchée de ce que nous ne soyons pas d’abord allés chez elle ; nous avons une scène des plus désagréables aux Gauds, dans laquelle ma chère Sophie se montre sublime de dévouement pour moi, ce soir il y a souper aux Gauds mais nous sommes tristes tous les deux et rentrons de bonne heure chez nous.
10 03 : A sept heures du matin nous partons de chez nous pour notre voyage de noces.
Note : Jules Paliard (la branche Paliard de Saint-Etienne) s'était associé à M. Vialletton pour fonder une entreprise où l'on fabriquait essentiellement des fusils de chasse.

Fusil marqué "Paliard-Vialletton Frères A St Etienne".
L'orthographe des noms propres n'a pas changé (façon de parler) : hormis quelques certitudes, elle est toujours aussi aléatoire (Wishermann devient à l'occasion Wichelmann, voire Wickelmann). Les Gauds sont la maison de famille du fabricant d'armes. Le voyage de noces fait l'objet d'un récit à part, beaucoup plus copieux que ce qui figure dans le Journal complet, mais je n'en suis pas encore là.
La "cavalcade" dont il est question au tout début est une fête de bienfaisance qui fut organisée à Saint-Etienne le 7 avril 1861, et fut baptisée "la grande cavalcade historique". J'ai vainement cherché des images de la chose.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric beutter, saint-étienne
vendredi, 28 septembre 2018
LA MORT DE JULES BEUTTER EN 1868
EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER
ANNEE 1868.
03 15 : Notre petit Jules souffrait beaucoup de sa dentition depuis le 6 courant où il a eu sa 1ère dent, il a beaucoup d’humeur autour des oreilles mais nous ne nous en étions pas inquiétés, nous faisons un petit tour sur la promenade, et là il prend peut-être un peu froid, malgré tous les soins de la [sic] garantir.
03 17 : Nous faisons appeler Mr Chappet qui dit que ce ne sera rien, nous recommençons pourtant à être effrayés d’une grosseur très rouge qui se forme autour de son oreille et pour nous tranquilliser, je vais appeler [03 20] Mr Emery qui nous dit que le pauvre petit est atteint d’un hérésipèle [sic] très caractéristique à la tête, nous sommes donc de nouveau dans des angoisses terribles, à cause du danger d’un transport au cerveau ; Dieu veuille nous préserver de ce malheur terrible. [41]
03 22 : Jules est toujours très assoupi, et ne fait presque pas de mouvements pourtant cette nuit il a un peu dormi et tété avec assez d’appétit.
03 24 : Dieu merci il y a un léger mieux aujourd’hui, nous recevons la visite de Mr Chappet qui espère que nous ne sous soyons pas trompés en nous adressant à Mr Emery, tandis que nous sommes persuadés qu’en suivant ses ordonnances à lui, le pauvre petit ne serait plus là.
03 28 : Aujourd’hui Mr Schulthess m’annonce positivement qu’il n’avait pas l’intention de continuer et m’engage à chercher activement une autre position. Je m’adresse à Mr Mombrun qui me dit être toujours dans les mêmes dispositions à mon égard mais qu’il doit d’abord s’entendre avec son commanditaire.
03 30 : Ce matin je reçois une lettre de Mr Appold (à qui j’ai écrit hier) dans laquelle il me dit sous le sceau du secret le plus grand qu’il ne voulait plus de Schulthess, mais qu’il comptait toujours sur moi ; cette nouvelle me fait d’autant plus de plaisir que Mombrun ne donne pas signe de vie. Le petit Jules est guéri de l’érésypèle, mais prend un affreux abcès derrière l’oreille, qui le fait bien souffrir et qui nous inquiète beaucoup malgré les bons soins de Mr Emery qui au bout de 8 jours perce l’abcès avec beaucoup de difficultés car il était excessivement profond.
04 03 : Notre pauvre petit Jules s’affaiblit toujours davantage et a beaucoup de peine pour respirer, car pour notre grand désespoir il se forme un autre abcès sous le menton, qu’il est impossible de percer aujourd’hui.
4 07 : Après une nuit et une matinée assez tranquilles, notre pauvre petit Jules, cet enfant délicieux qui nous avait tant rendus fiers et heureux par sa bonne constitution et son bon caractère, nous est également ravi, il meurt dans les bras de sa pauvre maman, à 1 heure de l’après-midi, étouffé par le nouvel abcès. Que Dieu nous donne le courage nécessaire pour supporter ce nouveau malheur ; mais franchement c’en est trop ; nous recevons des preuves de sympathie de partout, mais cela ne peut nous consoler de l’irréparable perte que nous venons de subir.
04 08 : Ce soir à 4 heures a lieu l’enterrement de notre pauvre petit ange.
Note : Frédéric et Sophie Beutter auront donc vu trois de leurs enfants mourir en bas âge. Et je ne parle pas d'une fausse-couche qui a eu lieu en je ne sais plus quelle année. Au total, Sophie aura donc vécu huit grossesses et en aura vu quatre aboutir favorablement. De quoi sont morts les trois bébés ? Je ne suis pas médecin, mais il est probable qu'un bon antibiotique aurait été efficace. Promis, demain on passe à quelque chose de plus gai.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 27 septembre 2018
LA MORT DE FANNY BEUTTER EN 1866
EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER,
ANNEE 1866.
(Je rappelle que l'orthographe des noms propres n'est pas du tout garantie.)
05 15 : Au bout de 40 jours pendant lesquels la petite Fanny avait également la rougeole, de sorte que Sophie ne pouvait sortir un instant, les deux petites guérissent, la petite Fanny commence à mettre sa 1ère dent, ce qui la fatigue beaucoup. Depuis quelques jours, je souffre d’une forte diarrhée ce qui m’ennuie d’autant plus que c’est justement le moment où arrivent nos acheteurs, je fais une connaissance très [34] agréable avec Aschmann et je passe un dimanche avec lui à la campagne de Mr Schulthess, je monte souvent à Saint-Etienne où j’ai enfin la chance de sous-louer mon appartement moyennant une perte de 200 Frs par an à Mr Faberd.
J’ai fait ces jours-ci mon premier voyage à Grenoble, le chemin de fer qui y mène par Bourboing [sic, pour Bourgoin] est très pittoresque, la ville de Grenoble même tout à fait au pied de hautes montagnes, nous allons en fabrique où je suis partout bien reçu grâce à la présentation de Mr Raffin, notre homme de Grenoble.
06 18 : Je monte à Saint-Etienne et finis complètement notre déménagement du magasin.
Pendant ce mois nous avons dîné et soupé au parc, fait des promenades en barque sur le lac et nous nous trouvons tout à fait bien ici.
06 24 : Aujourd’hui par un temps magnifique mais excessivement chaud, nous faisons une ravissante promenade à Chasselay, nous y dînons très bien, passons tout l’après-midi au bois et revenons le soir tard, bien contents de cette belle journée.
06 26 : Aujourd’hui Pierre arrive à Lyon et s’installe dans ses nouvelles fonctions au magasin.
La petite Fanny a un peu la diarrhée et nous faisons appeler le médecin qui malheureusement ne peut venir que le surlendemain quand la pauvre petite a déjà la dysenterie au suprême degré ; elle fait beaucoup de sang et le médecin nous laisse peu d’espoir de pouvoir sauver cette pauvre petite qui depuis sa naissance a toujours été excessivement faible ; nous passons une semaine affreuse, tantôt espérant la sauver, tantôt craignant le contraire ; vendredi soir grâce aux remèdes violents, la dysenterie cesse mais la diarrhée continue, la faiblesse devient générale. Samedi soir, nous avons une lueur d’espoir le médecin la trouvant un peu mieux.
07 01 : Toute la journée mauvaise, à 3 heures ½ du soir nous essayons de lui donner un peu de soupe mais elle ne peut pas la garder, à 9 heures la pauvre Sophie n’en pouvant plus se couche, à 11 heures la pauvre petite commence à avoir les premiers signes d’un transport au cerveau, les yeux fixes et de temps en temps, elle pousse des cris affreux, aigus ; comme nous sommes tout seuls, je vais d’abord appeler l’épicière en bas puis le Docteur (à 1 heure lui n’y étant pas j’emmène son frère qui nous ordonne quelques calmants) : au bout d’un moment les cris cessent et l’agonie commence.
07 02 : Lundi à 8 heures et ½ du matin cette pauvre petite fillette que nous aimions tant s’envole vers le ciel ; que le bon Dieu nous préserve à jamais d’un pareil malheur et nous donne la force de le supporter avec courage. Je fais toutes les démarches avec Henri, le soir arrivent le père, Félix et Victor. Je suis vivement touché par cette grande attention et tends une bonne main de réconciliation à Félix, j’ai écrit ce matin au père, à Constance et à Fanny la marraine de notre chère ange. [35]
07 03 : Ce matin de bonne heure, la bonne Madame Friedmann arrive et aide Sophie à faire la petite dernière toilette de la chère Fanny, la pose ensuite avec Sophie dans son petit cercueil où elle est comme endormie et pas du tout changée, elle est entourée de fleurs et cela nous déchire l’âme lorsque nous l’embrassons pour la dernière fois. L’enterrement a lieu à 10 heures et est suivi de beaucoup de monde ; elle repose au cimetière de la Guillotière, malheureusement très loin de chez nous.
Note : Fanny était née le 9 mai 1865. Son père exerçait la profession d'une sorte de directeur commercial dans l'industrie textile (soies, rubans, etc.). Les chiffres en rose sont ceux des pages du tapuscrit (support fragile pas toujours lisible) que je me suis donné pour tâche de transcrire au propre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 26 septembre 2018
LA MORT DE LÉON BEUTTER EN 1873
EXTRAIT DU JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER,
le grand-père de mon grand-père.
Année 1873
***********************************
05 10 : Cette nuit, à 1 heure, nous sommes réveillés par la nourrice, le petit Léon ayant fait un accès de fièvre, je cours chez le Docteur Bondel qui le trouve sérieusement malade, nous passons une nuit atroce ; aujourd’hui Dimanche le petit Léon est encore bien bas et nous craignons à tous les moments que ce ne soit fini avec lui ; heureusement les Veyrin et Valayer (aussi le Dt Maag) nous entourent et nous donnent du courage le Docteur Bondet revient le soir et trouve un léger mieux ; ce brave docteur nous tranquillise, sans toutefois nous donner encore beaucoup d’espoir ; la nuit pourtant est assez calme, les mouvements nerveux diminuent et nous espérons ce matin qu’avec l’aide de Dieu …
05 12 : …nous conservions ce cher petit être.
05 13 : Léon continue à aller mieux, la fièvre cérébrale est tombée, seulement il est excessivement assoupi, ce qui nous inquiète beaucoup.
05 15 : Aujourd’hui Léon prend des crises de nerfs affreuses.
05 16 : Ce matin nous croyons tout fini, car après une nouvelle crise il refuse le sein, à midi en désespoir de cause on lui donne d’abord un peu de vin sucré ensuite sur l’avis du docteur un peu de Chartreuse et de l’eau, sur quoi il se remet à téter. Mme Figuier passe toute la journée et la nuit auprès de lui.
05 17 : La journée se passe assez calme, mais la nuit à partir de minuit est de nouveau très agitée.
05 18 : Les crises commencent le matin et dureront presque toute la journée et nous attendons d’un moment à l’autre son dernier soupir, d’autant plus que ce matin il refuse le sein, à 11 heures Mme Figuier arrive pour le veiller, et à partir de minuit les crises cessent et à 2 heures du matin il …
05 19 : …se remet à téter, malheureusement la nourrice après ces terribles secousses a un peu perdu son lait.
05 20 : Ce soir Léon est calme et passe une assez bonne nuit.
05 21 : Ce matin le docteur constate un mieux sensible et nous commençons à espérer, Dieu veuille que cela continue.
05 31 : Malheureusement cela ne devait pas durer car après des alternatives ter [69] ribles du mieux au pire le pauvre petit meurt aujourd’hui à midi après une agonie de 24 heures. La pauvre nourrice, une très brave femme est au désespoir et nous quitte ce soir pour retourner chez elle.
06 01 : Pentecôte – Aujourd’hui à 4 heures nous enterrons notre Léon et le soir le père vient nous voir, on nous témoigne beaucoup de sympathie.
******************************
Note : Je rappelle (voir un autre extrait au 9 septembre) que j'ai habillé de rose les numéros de pages du tapuscrit que j'ai en ma possession. J'ai déjà dit que l'orthographe des noms propres est pour le moins aléatoire. Frédéric Beutter et Sophie (née Paliard) verront trois de leurs enfants mourir en bas âge. Léon, mort à l'âge de deux mois, est le troisième, après une petite Fanny (née le 9 mai 1865, morte le 2 juillet 1866), et un petit Jules (6 mai 1867-7 avril 1868). Hortense, Frédéric, Pierre, Charles resteront, quant à eux, bien vivants. Hortense (1862-1907) est mon arrière-grand-mère.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédeéric beutter, journal intime
dimanche, 09 septembre 2018
JOURNAL DE FRÉDÉRIC BEUTTER
UN VOYAGE EN RUSSIE EN 1863.
Le texte transcrit ci-dessous est un extrait du Journal de Frédéric Beutter (1827-1909), le grand père de mon grand père Paliard. Frédéric Beutter, né à Constance, épousa en 1861 Sophie Paliard, fille de Jules Paliard, fabricant d'armes à Saint-Etienne, et de Hortense du Colombier. F. et S. eurent pour premier enfant une fille qu'ils appelèrent Hortense qui, plus tard, épousa Pierre Félix Elisé [sic] Paliard, son cousin et mon arrière-grand-père.

Fusil de chasse à canons juxtaposés
sorti des ateliers Paliard et Vialetton.
Ce texte relate le voyage commercial que Frédéric Beutter fit en 1863 en Russie, pour le compte de la maison Appold et Schulthess, de Lyon.
Ne disposant pas du manuscrit original, je donne ici le texte tel que le livre une version dactylographiée sur une vieille machine à écrire, en je ne sais pas quelle année et dans des circonstances que j'ignore, par une personne qui n'avait apparemment pas d'affinités avec l'orthographe des noms propres, surtout allemands (fluctuante et le plus souvent invérifiable). J'imagine que l'écriture manuscrite de l'auteur (d'origine germanique) y est pour quelque chose.
Cette version étant parfois à la limite de la lisibilité (deuxième ou troisième carbone, pour ceux qui savent encore ce que ce fut), je me suis résolu à en retranscrire intégralement les 198 pages, augmentées des 7 pages du « Carnet Spécial » consacré par Frédéric Beutter à la relation plus détaillée de son voyage de noces. Voici quelques-unes de ces pages. Je tâche d'éclaircir quelques points par des références entre crochets. Les indications en rose indiquent les numéros des pages du tapuscrit. Je corrige les fautes d'orthographe manifestes. La ponctuation est laissée telle quelle.
A tort ou à raison, je considère un tel document comme exceptionnel et sa détention comme un privilège. Malgré le fait que Frédéric Beutter ne soit pas un écrivain (on s'en aperçoit vite), j'ai jugé bon d'inscrire ce billet dans la catégorie "Littérature".

Frédéric Jacques Félicien Beutter (1827-1909).

Henriette Sophie Beutter, née Paliard (1839-1922).
On est en 1863.
VOYAGE EN RUSSIE
01 25 : Aujourd’hui Dimanche, après avoir depuis quinze jours travaillé énormément pour préparer mes affaires, nous mangeons pour la dernière fois aux Gauds [lieu où habite sa belle-famille] ; après dîner j’arrange mes bagages, le soir nos amis Fiedmann [Friedmann ?] soupent avec nous et je vais à 10 heures un moment chez Fraisse & Merley faire un trio avec Mlle Marie et Truarts [Frédéric Beutter joue assez bien de l'alto].
01 26 : A 8 heures du matin, je prends congé de ma chère femme et de mon enfant et accompagné par l’ami Fiedmann jusqu’à la gare, je pars à 8 heures par un temps magnifique. Arrivé à Lyon, je suis très bien reçu pas ces Messieurs [Appold et Schulthess, toujours ainsi nommés] qui me remettent des colis de Lyon et Fr 1.000 espèces. Je pars de Lyon à 8 heures du soir et fais le trajet à Paris très agréablement avec Mr Ferdinand Balaÿ.
01 27 : Je descends au Grand-Hôtel, et je fais une visite à Holop, Gonon et Julien ; au café on me parle de la révolution en POLOGNE, ce qui m’inquiète un peu. Je déjeune avec Holop, dîne avec Julien, et lance une dépêche à ma chère fille Hortense, le soir je vais au Gymnase entendre Les Ganaches [pièce de Victorien Sardou].
01 28 : Je pars de PARIS par LIEGE et COLOGNE pour LIEPZIG [sic] où j’arrive le lendemain à 10 heures du matin.
01 29 : Je vais voir Kettenbeit, et ne réussis pas à arranger à l’amiable son différend avec la maison ; je dîne chez lui et le soir, j’assiste à un très beau concert au Gewonndhaus [sic, pour Gewandhaus].
01 30 : A 7 heures du matin je pars pour Berlin où j’arrive à 11 heures, je me fais promener en ville et au Thiergarden [sic], je suis enchanté de tous ces beaux monuments, rues, palais. Le soir j’assiste à un superbe ballet : « Elestra » [Electra oder die Sterne, musique de Peter Ludwig Hertel] où je vois danser Mr Faglioni [Taglioni] et je suis ravi de ces beaux décors et de ce superbe théâtre. Après le théâtre, je soupe à mon hôtel (de Rome) et je pars ensuite en prenant un billet jusqu’à EYDTKUHNEN [aujourd'hui Tchernychevskoïe, du côté de Kaliningrad]. [13]
01 31 : Je fais le trajet par la Prusse, très agréablement et admire en passant le beau pont de DIRSOHAU [Dirschau] où il faut quatre minutes de chemin de fer pour passer, nous arrivons très gaiement jusqu’à HALLOPUNEN quand le chef de Station prie tous les voyageurs pour la RUSSIE de descendre car la route de POLOGNE était coupée par les insurgés et qu’il était impossible d’aller plus loin vu que EYDTKUHENE était rempli de réfugiés, je lance une dépêche à Lyon et retourne à KONISBERG où je descends à l’hôtel Janssouri [Sanssouci].
02 01 : Comme je suis déjà allé plus de dix fois à la gare, pour savoir des nouvelles, et que personne ne peut ou ne veut … rien me dire j’écris une lettre désolée à la maison et à ma chère femme et suis au désespoir de ne pouvoir atteindre le but de mon voyage. Je jette les deux lettres à la boîte et j’apprends que demain on va de nouveau essayer de passer. Je reprends donc à ma grande joie mes deux lettres, grâce à l’obligeance de l’employé de poste, et je pars à nouveau à 3 heures pour EYDTKUNEN où j’arrive à 7 heures du soir, en route je fais connaissance avec notre expéditeur Mr Rosa, qui me présente à tous ses amis et nous passons la soirée très gaiement en chantant et buvant du champagne jusqu’à minuit.
02 02 : Nous partons d’EYDTKUHNEN à 10 heures du matin et passons la frontière RUSSE, drôle d’impression en voyant pour la première fois un « Cosaque ». Mr Rosa m’accompagne à WISBALLEN, me fait changer mon argent, fait visiter mes bagages et m’installe dans un beau wagon de 1ère classe, nous passons par la POLOGNE très inquiets, sommes souvent arrêtés pour laisser passer des convois de troupes, et arrivons sans obstacle sérieux à Saint-PETERSBOURG, rencontre d’un vieux bonhomme qui nous demande des nouvelles de la route et en échange nous conduit à l’hôtel Klée où je demande de suite s’il n’y a pas quelqu’un de Lyon, car je suis presque au fond de ma bourse. J’y trouve Mr Deger de PARIS qui m’accueille très bien et me dit qu’il part avec moi le lendemain pour MOSCOU.
02 04 : Nous partons à midi et faisons le trajet très agréablement en causant du passé et en nous racontant nos biographies ; le temps n’est pas très froid et ce n’est que depuis WILNA que j’ai trouvé de la neige ; nous arrivons le lendemain matin à 10 heures à Moscou où à ma grande joie je trouve l’ami Revel à la gare, qui m’emmène dans son traîneau. Après avoir été très gracieusement accueilli par Mme Revel, je lance une dépêche à ma chère femme pour lui annoncer mon heureuse arrivée.
02 06 : Le lendemain Mr Revel nous propose de nous tutoyauter [sic] ce que j’accepte de grand cœur. Il m’accompagne et me présente chez tous nos clients : Mrs Klein, Hadt, Schmahlmann, Schlesinger Frère, et grâce à lui, je suis reçu partout comme un vieil ami ; le soir après la besogne finie, il m’emmène au théâtre où je vois des ballets magnifiques (Mlle Debideff) dans un théâtre superbe, immense, d’où j’entends des Opéras très beaux et très bien exécutés ; après le théâtre nous allons d’habitude chez Mme Miller où nous faisons une promenade magnifique en Droike [sic] à KRILNER, en passant devant l’ancienne résidence de Napoléon 1er en 1812. [14]
02 08 : Aujourd’hui Dimanche à 10 heures Revel m’emmène au Kremlin, nous rentrons par la porte sacrée où tout le monde se découvre en passant, je suis très vivement affecté par l’aspect de ce vénérable Kremlin, avec ses murs crénelés, ses églises dorées ou bariolées, ses palais grandioses, son cachet oriental, et nous avons une vue magnifique sur toute l’immense ville de MOSCOU par un temps magnifique malgré le – 28° de froid. Aujourd’hui arrivent chez Revel ses deux belles-sœurs de NISOOHNI [probablement Nijni Novgorod] Mmes Mariokin et Poeteren avec lesquelles je deviens bientôt très intime, elles me brodent un bonnet et me remettent leurs photographies avant de partir. Je fais d’assez bonnes affaires malgré l’état calme de la vente, je m’amuse beaucoup et passe mon temps agréablement ; j’ai beaucoup de succès par mes chansonnettes et suis bien vu partout ; l’ami Revel me montre chaque jour quelque chose de nouveau, me mène prendre des bains Russes et me traite absolument comme si j’étais son fils ; pendant mon séjour je visite le Kremlin et les églises, où je suis étonné par les immenses richesses enfouies sur [sic] les vêtements sacerdotaux : perles, diamants, rubis, etc. J’assiste aussi une fois à un office religieux et je suis ravi par le parfait chant (quatre voix d’homme) qui résonne comme un orgue. Revel ne me laisse pas dépenser un centime, je loge chez lui comme si j’étais de la famille et il me fournit même des cigares excellents (50) ; après avoir passé trois semaines bien agréables et fait des affaires très satisfaisantes, je commence mes préparatifs de départ et reçois le 28 février de l’ami Paul Revel pour cadeau de noces un superbe manchon et collier en marthre [sic] pour Sophie ; ce magnifique cadeau après tant de bienfaits de sa part m’a ému jusqu’aux larmes et jamais je ne pourrai remercier assez ce brave ami de tout ce qu’il a fait pour moi.
3 01 : Après avoir laissé mes photographies à mes divers amis, clients et après avoir fait mes adieux partout, je pars de MOSCOU à midi par un temps magnifique accompagné à la gare par Mr et Mme Revel et Messieurs Blimberg et Edmhoff ; quoique je sois excessivement content de recommencer mon voyage pour rejoindre ma chère femme et Hortense et mes amis, mais la séparation de ces bons amis de MOSCOU m’attriste beaucoup et je dois leur promettre de revenir sans faute l’année prochaine ; j’arrive à Saint-PETERSBOURG le lendemain matin, et à mon grand plaisir j’entraîne une affaire pour Lyon, avec une très bonne maison, qui m’avait été indiquée par Revel ; dans l’après dîner je fais une magnifique promenade sur la rue magnifique de Newoky, aux îles Petrowsky, Elgina, etc. en passant la Newa en traîneau attelé de quatre rennes. Je passe devant le superbe palais impérial avec l’arc de triomphe en face, je visite la citadelle où je vois le tombeau de Nicolas, la maison de Pierre le Grand, et les statues de Pierre le Grand et Nicolas, je visite les superbes églises de Isaac Casansky, avec leurs magnifiques sculptures, riches autels, superbe colonnes en marbre vert Casankry et construits d’après le modèle de Saint-Pierre de Rome, j’y suis douloureusement affecté en y voyant des drapeaux Français pris en 1810-12 étalés sur les murs.
03 03 : Après avoir fait mes affaires et recommencé ma promenade dans la ville, que je trouve excessivement intéressante, j’assiste le soir à un très beau concert dirigé par Richard Wagner ; 130 excellents musiciens exécutent la Symphonie Héroïque de Ludwig van Beethoven et quelques très [15] beaux fragments de Tamhausur [sic, tout le monde devine] à la perfection, je suis enthousiasmé autant par le concert que la belle assemblée et la superbe salle ; j’y rencontre un capitaine qui connaît Saint-Etienne.
03 04 : Aujourd’hui veille du jour de ma fête par un temps splendide je pars de PETERSBOURG à Midi, nous passons WILNA, KOWNO, et toute la POLOGNE sans aucun obstacle grâce au déploiement formidable de troupes Russes, nous arrivons le lendemain soir en bonne santé à Wirballen et après à EYDTKUHNEN où je retrouve mes amis qui sont tous contents de me revoir. : le soir même j’arrive encore à KONISBERG au même hôtel Sanssouci seulement cette fois très content et très heureux de mon beau voyage en RUSSIE.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : année 1863, voyage en russie, frédéric beutter, sophie paliard, jules paliard fabricant d'armes saint-étienne, hortense du colombier, hortense paliard, pierre félix élisé paliard, maison appold et schulthess, saint petersbourg, lyon, soiries, vrp, richard wagner, danseur taglioni, victorien sardou, tannhäuser, pologne, symphonie héroïque, ludwig van beethoven, histoire familiale
lundi, 30 juillet 2018
UN GÉOGRAPHE HORS-NORME
YVES LACOSTE
AVENTURES D’UN GÉOGRAPHE
Equateurs, 2018
Yves Lacoste est un géographe à la renommée solidement établie. Chaque fois que je l’ai entendu à la radio, j’ai été saisi par l’originalité de son propos. Je veux dire que je n’aurais jamais pensé à mettre en relation des faits appartenant à des domaines différents. Je me souviens par exemple qu’il avait opposé, en comparant l'Asie du sud-est et l'Afrique, deux sortes de tracés de frontières, suivant qu’ils étaient conçus par des officiers de marine ou par des officiers d’infanterie (on parle de l’époque coloniale), avec une prime à l’intelligence et à la pertinence accordée à la marine, alors que les « biffins » avaient tendance à tirer des lignes droites. Je n’ai pas cherché à savoir si l’idée était toujours opérationnelle : je m’étais contenté d’apprécier l’inattendu de la conception.
Je viens de lire Aventures d’un géographe, paru très récemment. Le livre se présente curieusement comme des « Mémoires ». Curieux, en soi, à cause du nombre de pages (330), mais aussi à cause du contenu, d’aspect beaucoup trop schématique (mais ça va avec) à mon goût. J’aurais aimé en particulier que l’auteur entre beaucoup plus dans les détails, s’agissant des problématiques envisagées.
Il concentre son récit autour de deux points qui constituent, pense-t-il avec raison, son principal apport à la discipline. D’abord, avoir arraché la « géopolitique » à l’acception qu’elle avait sous le régime nazi : « Je lui [Julien Gracq] répondis que les géographes allemands avaient proclamé de prétendues lois instituant la propriété des peuples germaniques sur certains territoires » (p.254). Ce que les nazis appelaient, je crois, le "Lebensraum" (espace vital). Ensuite, d’avoir fondé la revue Hérodote, devenue un outil indispensable dans l’exercice de la profession de géographe.
Je n’ai jamais fréquenté la revue, mais j’aurais lu avec beaucoup d’intérêt la narration circonstanciée de l’installation du mot « géopolitique » dans le langage des géographes, avec les aléas, les oppositions rencontrées, bref : les heurs et malheurs d’un concept qui, de mal famé qu’il était, est devenu d’un usage tellement courant que les journalistes l'invoquent souvent à tout bout de champ. Un volume de 600 pages ou davantage ne m’aurait pas fait peur. C’est dire que je reste (un peu, n'exagérons pas) sur ma faim.
Même remarque à propos de l'ouvrage – à léger parfum de scandale – par lequel il s’est fait un nom : La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Maspero, puis La Découverte) : « Et le petit livre bleu hérissa en effet la confrérie » (p.7). J'ai du mal à comprendre les raisons de cette réaction : ne parlait-on pas depuis longtemps de "cartes d'état-major" ? Or, si la carte est forcément géographique, qu'est-ce qu'un état-major, sinon le haut commandement militaire dirigeant des opérations, c'est-à-dire un acteur de l'histoire ? J’aurais aimé en savoir plus sur les raisons de l’hostilité déclarée des confrères géographes. Yves Lacoste préfère s’étendre sur le peu de considération dont jouissait la géographie dans la hiérarchie intellectuelle et son souci de participer à sa revalorisation : il voulait qu’on puisse le prendre au sérieux, et pour des motifs solides. Il avait bien raison, même si j’aurais été intéressé, par exemple, par un chapitre évoquant plus précisément la réception de l’ouvrage "scandaleux".
Si j’ai bien compris, la géopolitique, c’est précisément la mise en rapport des données de la géographie d’un territoire précis (question d'échelle : cela peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres) avec les événements qui se produisent sur ce territoire, conditionnés par ces données. La géopolitique traite des rapports de forces qui s'exercent sur un territoire. Dans le fond, la géopolitique, c’est vouloir expliquer la géographie par l’histoire, et envisager d’expliquer un certain nombre de faits de l’histoire par les données de la géographie. Il me semble qu’un certain Bismarck (1815-1898) avait déjà eu de telles idées, mais je ne suis pas spécialiste (est-il l'auteur de cette formule dont je crois me souvenir : « La seule chose qui ne change pas dans l'histoire, c'est la géographie » ?).
Et le duc de Saint-Simon, quand il commente certaines batailles perdues ou occasions manquées par l’un des bâtards de Louis XIV (le duc de Vendôme, je crois bien), ne manque pas de souligner, en plus de la paresse native de ce dernier, le peu d’à-propos avec lequel il choisissait et organisait le terrain de ses « exploits ». Et quand il relate les entreprises militaires (du début du printemps à la fin de l’automne, chaque année ou à peu près), il ne manque jamais de commenter l’intelligence ou la bêtise du général en chef dans la disposition des troupes en fonction du terrain, qu'il s'agisse de franchissement de fleuve, d'occupation d’une position dominante, de passage d’un défilé ou de défense d'une cité fortifiée, à l'exemple de celle, splendide, que le marquis de Boufflers conduit lors du siège de Lille, mené par le prince Eugène). Oui, la géographie est bien une constante des événements historiques.
Ce qui intéresse le spécialiste de géopolitique, ce sont les interactions entre la conformation d’un site et la façon dont se produisent les rapports entre les forces en présence ou l’affrontement des volontés et des intérêts. Cette préoccupation constante de l’auteur l’amène à conduire ses étudiants sur le terrain, dans la vallée de Chevreuse ou sur la Montagne de Reims : « En effet, il est interdit de planter de la vigne sur la totalité des versants de la Montagne de Reims. Il s’agit d’une décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui engendre d’énormes écarts de prix entre deux parcelles voisines, l’une plantée de vigne, l’autre où c’est interdit » (p.224). Voilà un exemple de passage où, n’étant pas géographe, j’ai du mal à comprendre les tenants et aboutissants du problème. Cette histoire de pente, de sable, de lignite et de prix du champagne me semble nébuleuse, faute de précision.
Dans un autre chapitre, en revanche, Yves Lacoste raconte comment il a été amené à intervenir au Vietnam, pendant la guerre et les bombardements américains : chapitre absolument passionnant. Je passe sur les aspects anecdotiques (croustillants : comment voyager en avion sans visa avec un billet offert en douce). Les Américains avaient imaginé de bombarder les digues qui contenaient les eaux du fleuve Rouge : « … j’écrivis un petit article très pédagogique expliquant que le fleuve coule au-dessus de la plaine du delta surpeuplée, et je l’avais envoyé au journal "Le Monde" » (p.180). Le journal publie l’article.
La suite est étonnante : les Nord-Vietnamiens ont immédiatement compris le parti qu’ils pouvaient tirer des compétences et du regard particulier du géographe, et le lui font savoir. Sautant allègrement par-dessus les formalités avec l'aide obligeante des soviétiques, il atterrit à Hanoï, il réclame et finit par obtenir les cartes, malgré le secret militaire, où figurent « les points qui ont été atteints » (p.182). On apprend que « la rupture d’une digue est plus probable si elle a été attaquée dans la partie concave du méandre, parce que c’est là que s’exerce surtout la pression du courant » (p.183). « Le réseau des digues du fleuve Rouge est l’un des plus complexe au monde et il faisait l’admiration de Pierre Gourou. Ces digues ont été construites en terre compactée par la mobilisation du peuple vietnamien au cours des siècles, de l’amont vers l’aval » (p.185). Pierre Gourou est l’auteur d’une thèse sur le fleuve Rouge.
Le plus fort de l’affaire montre que la géopolitique peut à l’occasion devenir un acteur dans un conflit, car la conclusion fut la suivante : « De retour à Paris, je me suis rendu au siège du "Monde" qui publia l’après-midi même la carte du delta du fleuve Rouge représentant les digues et les points bombardés, ainsi que mon commentaire. Des journaux du monde entier l’ont repris, même au Japon et aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, les bombardements américains sur les digues cessèrent » (p.186). On imagine sans peine la catastrophe humaine que le géographe a permis d’éviter. Yves Lacoste peut être fier : il a arrêté l’aviation américaine ! D'un autre côté, on pourrait souligner qu'il a mis clairement la géopolitique au service de l'un des belligérants, faisant fi de la sacro-sainte neutralité scientifique, mais bon.
Un autre chapitre tout à fait intéressant raconte la rencontre de l’auteur avec Julien Gracq, lui-même professeur d’histoire et géographie. L’idée lui en est venue à la lecture du Rivage des Syrtes, ce roman somptueux qui a obtenu le prix Goncourt (refusé par Gracq), et dont la trame illustre bien la phrase de Voltaire : « L’homme est fait pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude ou dans la léthargie de l’ennui ». Un jeune aristocrate, rouage du destin, provoque la fin catastrophique de son pays, la principauté vieillissante d’Orsenna, parce qu’il finit par ne plus supporter la vie étale, immobile et sans relief qu’il mène dans le poste où il a été affecté à sa demande.
Yves Lacoste écrit à Gracq pour lui dire qu’il lui semble qu’il a écrit un « roman géopolitique ». La rencontre a lieu chez le romancier. Il lui explique que le terme sert à « désigner toute rivalité de pouvoirs sur un territoire et confronter les arguments des uns et des autres » (p.254). « Dans ce roman, lui dis-je, vous vous attachez aux signes avant-coureurs du nouvel affrontement à venir entre le Farghestan mystérieux, voire mystique, et les grandes familles vieillissantes d’Orsenna » (ibid.).
Il va jusqu’à faire dessiner par un spécialiste la carte « en perspective cavalière » de la façon dont il se représente la disposition des lieux tels que Julien Gracq les a imaginés. « Désorienté » par une précision demandée par Lacoste, le romancier lui répond, « presque en s’excusant » : « Vous savez, j’ai seulement voulu faire un "tremblé géographique" » (p.255). Pour un lecteur assidu de Julien Gracq, voilà un chapitre qui ne manque pas d’intérêt, en ce qu’il lui procure une grille de lecture inédite.
Il faudrait encore faire un sort aux multiples centres d’intérêt sur lesquels Yves Lacoste a été amené à travailler : Ibn Khaldoun, la Haute-Volta, Cuba, voire mentionner les recherches de son épouse sur les Kabyles. Ce dernier point donne à l’auteur quelques occasions délectables de s’en prendre aux thèses de Pierre Bourdieu : mon dieu, une tache sur la statue ! Au total, un livre foisonnant d’aperçus d’une grande variété. Si j’avais une réserve à faire, ce serait donc à propos du nombre de pages, à mon avis insuffisant pour combler la curiosité du lecteur, frustré par l’évocation trop rapide de certains aspects du travail de ce géographe hors-norme.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves lacoste, géographe, géographie, aventures d'un géographe, éditions des équateurs, géopolitique, revue hérodote, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, éditions maspéro, éditions la découverte, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, guerre du vietnam, fleuve rouge, pierre gourou, julien gracq, littérature, prix goncourt, le rivage des syrtes, ibn khaldoun, kabyles, pierre bourdieu
vendredi, 20 juillet 2018
RETOUR A LEMBERG 2/2
 PHILIPPE SANDS : RETOUR A LEMBERG;
PHILIPPE SANDS : RETOUR A LEMBERG;
(Editions Albin Michel, 2017)
Deuxième épisode : la trajectoire des individus.
Résumé : Philippe Sands, dans Retour à Lemberg, dresse l'historique de l'inscription dans le droit international de deux concepts désormais familiers : le "crime contre l'humanité" et le "génocide", qui servirent de base à l'accusation lors du procès de Nuremberg. Ce procès en quelque sorte fondateur, inaugure un nouveau modèle d'instance judiciaire internationale. C'est à Nuremberg que fut admis le principe qu'un Etat ne peut pas traiter n'importe comment ses citoyens : l'Etat reste souverain, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. On voit tous les jours ce qu'il en est de la réalité de tels grands principes en suivant jour après jour ce qui se passe dans la Syrie de Bachar el Assad.
L'auteur montre d'ailleurs que ce problème s'est posé dès 1919 : on assiste en effet en Pologne à des massacres de juifs. Les vainqueurs tentèrent d'imposer au nouvel Etat polonais un traité l'obligeant à un minimum d'humanité dans le sort qu'il réservait à ses minorités, juives en particulier mais pas que. L'efficacité de ce traité fut éphémère, la Pologne considérant cette ingérence extérieure dans ses affaires comme une inadmissible mise sous tutelle, et affirmant sa pleine souveraineté sur toute l'étendue de son territoire et sur les gens qui l'habitaient.
Face à ces considérations à caractère juridique qui occupent plutôt la deuxième moitié du livre, Philippe Sands se livre pour commencer à une enquête quasi-policière pour comprendre quelles furent les trajectoires d'un certain nombre d'individus, ce qui l'amène à parcourir un certain nombre de pays. Il tient à voir les lieux de ses yeux, à rencontrer les acteurs encore vivants (voir par exemple le chapitre "La fille qui avait choisi de ne pas se souvenir"), à s'imprégner dans la mesure du possible des conditions qui leur furent faites en leur temps. Il s'efforce aussi de recueillir les témoignages de leurs enfants (Eli Lauterpacht, Niklas Frank, Horst von Wächter).
Il est lancé sur la piste de plusieurs personnes : outre les deux juristes que sont Lauterpacht et Lemkin (à chacun desquels ils consacre un chapitre copieux, voir hier), il s'attache à retracer d'abord la trajectoire exacte suivie par son grand-père, Leon Buchholz, depuis sa Galicie natale jusqu'à Paris, en passant par Vienne, au moment même de la montée du nazisme et de l'annexion de l'Autriche (Anschluss).
Une question, en particulier, préoccupe Philippe Sands : comment se fait-il que ce grand-père, quand il a quitté Vienne (l'Autriche étant sous régime nazi) pour Paris en janvier 1939, n'ait pas emmené avec lui sa femme Rita et sa fille Ruth (la propre mère de l'auteur) ? Plus tard, en juillet de la même année, la petite fille le rejoint, accompagnée par celle qui sera présentée comme étant "Miss Tilney de Norwich". Pourquoi la mère n'est-elle pas montée dans le train ? Elle est juive, et elle sait ce qu'elle risque en tant que telle dans un pays largement "nazifié". Pourtant, ce n'est qu'en 1942 qu'elle rejoint sa petite famille à Paris.
Est-elle restée pour veiller sur sa mère ? Peut-être. L'hypothèse de l'auteur est liée à "l'homme au nœud papillon", auquel il consacre un chapitre. Une photo (p.256) montre celui-ci en "lederhosen" (la typique culotte de cuir tyrolienne) et grandes chaussettes blanches, signe, selon Sands, d'une adhésion au nazisme. Cette hypothèse oblige à faire de cet homme (que de patientes recherches permettront d'identifier comme étant Emil Lindenfeld) l'amant de Rita, grâce auquel celle-ci, se sentant protégée, peut résider sans crainte à Vienne, jusqu'à son départ pour Paris, trois ans après. Après tout, elle est mère. Les disputes entre Leon et Rita sont-elles dues aux infidélités de cette dernière ? Voilà pour l'histoire familiale (très simplifiée).
Quant à "Miss Tilney de Norwich", le détective Philippe Sands parviendra après de longs efforts à reconstituer le parcours de cette femme, morte en 1974, reconnue plus tard « juste parmi les nations ». Ce n’est pas simple, parce que la dame a beaucoup voyagé, de l’Angleterre à l’Afrique du sud et de la France à l’Autriche, avant de prendre sa retraite quelque part en Floride. C’est logique, puisqu’elle se considère comme une « missionnaire », dont l’unique but dans l’existence est de « sauver les juifs » pour accomplir le message du Christ. Elle est chrétienne jusqu’au fond de l’âme. Son rôle dans l'histoire de la famille est central, tout en restant farouchement anonyme. Il y a là de l'héroïsme.
Une autre question mobilise l’attention de l’auteur : pourquoi les parents de Lauterpacht n’ont-ils pas rejoints leur fils à Londres ? Quoi qu’il en soit, le sort de ceux qui sont restés en Galicie ne fera aucun doute : ils ont disparu quelque part entre Belzec, Majdanek et Treblinka, à moins qu’ils n’aient été massacrés dans la ville même qu’ils habitaient ("die grosse Aktion"). Quant à Leon, Philippe Sands le verra toujours taciturne et muet : il ne dira jamais un mot des soixante-dix parents plus ou moins directs qui ont disparu dans le génocide.
Le cas de Hans Frank comporte son lot d’étrangetés : tout au long de son gouvernorat de la Pologne, il a rédigé très méthodiquement, jour après jour, un « Journal » où il note les événements, les décisions et les actions de l’armée allemande qu’il a sous ses ordres. Et ce qui est incroyable, c’est que, quand il a vu la défaite arriver, il s’est simplement replié chez lui en Allemagne, en emportant les milliers de pages de ce « Journal », et que le lieutenant Walter Stein de la VII° armée américaine venu l’arrêter n’a eu qu’à placer les volumes sur le siège avant de la Jeep. Frank livrait ainsi aux procureurs du futur tribunal tous les motifs possibles de le condamner à être pendu. Autre curiosité : Hans Frank, en prison, s’est converti au catholicisme et a, malgré des biais et des rétractations, admis une part de responsabilité dans la « destruction des juifs d’Europe », s’attirant le mépris de Göring.
Le hasard de l'histoire fait que le petit-fils de Leon Buchholz, au cours de ses études de droit, aura pour professeur Eli Lauterpacht (né en 1939), le propre fils de Hersch, l'inventeur du "crime contre l'humanité". Eli a de vagues souvenirs de ses grands-parents, venus rendre visite à Londres en 1935, « lorsque son père "les supplia de rester"». En vain. On ne les reverra jamais. En 1937, Hersch Lauterpacht est « élu à la prestigieuse chaire de droit international de Cambridge » (p.128). L'auteur se demande brièvement quel était l'état des relations entre le fils et ses parents. Peut-être distantes. En tout cas Eli ne l'a jamais entendu s'exprimer au sujet de sa famille restée au pays. On préfère ne pas imaginer qu'il a préféré privilégier sa carrière, au détriment de sa famille, mais le soupçon n'est pas tu.
Philippe Sands tient aussi à rencontrer le fils de Hans Frank (né en 1939 lui aussi), le bourreau de la Pologne, pendu à Nuremberg. On peut dire que Niklas Frank ne pardonne rien à son père. Il est journaliste au Stern. Il a publié Der Vater [le père], où il règle ses comptes et dont une très insatisfaisante traduction abrégée a été publiée sous le titre In the Shadow of the Reich. Sands en fait un portrait sympathique : « c'était un homme généreux, doté d'un solide sens de l'humour, et qui n'avait pas sa langue dans sa poche » (p.279). En réalité, il était sans doute le fils de Karl Lasch, ami de son père, gouverneur de Galicie et amant de sa mère, qui sera tué ou se donnera la mort. De toute façon, la personnalité de Hans Frank ne sort pas grandie du livre de l'auteur : peut-être était-il un homosexuel refoulé. Il avait en tout cas une crainte souveraine de Brigitte, son épouse, et apparaît comme un homme plein de contradictions et de faiblesses.
Horst von Wächter, le fils d'Otto, le gouverneur du district de Galicie après Karl Lasch et le subordonné de Frank, n'a toujours pas honte de son père quand Philippe Sands le rencontre dans son « imposant château du XVII° siècle situé à une heure environ au nord de Vienne » (p.297). Il est même très fier de lui montrer la bibliothèque qu'il a héritée de lui, et qui n'est rien d'autre que « le "département national-socialiste" de l'histoire familiale » (ibid.). L'auteur ouvre au hasard un ouvrage dédicacé au père par Himmler en personne. L'étonnant est que le fils du nazi ne rougit pas de honte, bien au contraire, en montrant ses "trésors", et qu'il ne cache pas son plaisir lorsque Sands déniche un exemplaire de Mein Kampf : « Je ne savais pas qu'il était ici » (ibid.). Horst voudrait "réhabiliter" son père : « Mon père était un homme bon, un libéral qui a fait de son mieux » (p.300). De quoi tomber de sa chaise.
Voilà pour le volet "histoires individuelles" de Retour à Lemberg, ce livre remarquable.
En conclusion, qu'il s'agisse du versant juridique ou du versant narratif, l'ensemble fait de Retour à Lemberg un impressionnant livre d’histoire, qui fourmille de détails qu'il est impossible de rapporter, et où rien, au long des 450 pages, n’est inutile : Philippe Sands ne bavarde pas, il est lui aussi un juriste international, et en tant que tel, il sait que l’essentiel se suffit à lui-même. Ce qui m’impressionne en particulier, c’est l’art avec lequel il tient constamment – sans pathos, il faut le souligner – deux fils narratifs : celui des trajectoires individuelles des fourmis humaines aux prises avec les circonstances et celui du chaudron du diable qu'est la grande et terrible Histoire du XX° siècle.
Voilà ce que je dis, moi.
Ajouté le 24 juillet : je ne voulais pas entrer dans certains détails figurant dans le livre de Philippe Sands, et puis je me dis qu'il n'y a pas de raison de ne pas montrer bien concrètement les raisons bien concrètes pour lesquelles on a pourchassé les nazis après la guerre. Car si l'auteur ne cite pas tous les témoins intervenus au tribunal de Nuremberg, il rapporte au moins le témoignage de Samuel Rajzman, qui vaut pour tous les autres. En voici une partie : « Rajzman poursuivit d'une voix monocorde. Une femme âgée avait été amenée au "Lazarett", avec sa fille enceinte dont le travail avait commencé ; on avait couché la fille sur l'herbe. Les gardes l'avaient regardée pendant qu'elle accouchait. Mentz avait demandé à la grand-mère qui elle préférait que l'on tue d'abord. La vieille femme avait supplié d'être la première.
"Ils ont bien sûr fait le contraire", dit Rajzman à la salle, parlant très doucement. "Le nouveau-né fut tué en premier, puis la mère de l'enfant, enfin la grand-mère" ».
Pas de commentaire.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe sands, retour à lemberg, éditions albin michel, tribunal de nuremberg, crime contre l'humanité, génocide, juifs, extermination des juifs, destruction de juifs d'europe hilberg, shoah, auschwitz, camps d'extermmination, majdanek, sobibor, belzec, treblinka, hans frank, elihu lauterpacht, niklas frank, horst von wächter, anschluss, leon buchholz, deuxième guerre mondiale, adolf hitler, heinrich himmler
jeudi, 19 juillet 2018
RETOUR A LEMBERG 1/2
 PHILIPPE SANDS : RETOUR A LEMBERG;
PHILIPPE SANDS : RETOUR A LEMBERG;
1 (Editions Albin Michel, 2017)
Voilà un livre remarquable en tout point. Si j’ai lu un nombre certain d’ouvrages traitant de la deuxième guerre mondiale et du programme d’extermination des juifs, des tziganes, des Polonais et des Slovènes (et autres) élaboré par Hitler et ses sbires, je n’avais jamais lu ce qu’un juif d’aujourd’hui, juriste de son état, pouvait avoir à dire d’un grand-père qui avait échappé à la mort et de la laborieuse mise en place du tribunal de Nuremberg : le rapport n'est pas évident. L’incroyable de ce livre, c’est qu’il marie parfaitement la reconstitution patiente du destin de plusieurs individus nettement identifiés, et l'implacable « Solution finale » : l’extermination des juifs d’Europe en tant que groupe (mais avec les tziganes, ils n’étaient pas les seuls au programme d’Hitler : la défaite ne lui a pas laissé le temps).
Philippe Sands conçoit son livre en ouvrier tisseur impeccable : il ne lâche jamais le fil des destins individuels, tout en ourdissant la trame méticuleuse d’un destin collectif. La question centrale qu’il pose est de savoir s’il faut (s'il fallait), à Nuremberg, juger les crimes nazis au nom des droits inaliénables des individus ou de la défense de groupes nationaux (Slovènes, Polonais, …), ethniques ou religieux (juifs, tziganes, …).
Autrement dit, ce qui prime, est-ce le droit des individus ou le droit des groupes ? Question qui n'a l'air de rien a priori, mais une question ardue. Pour y répondre, il s’appuie, en juriste consommé, sur le conflit entre deux concepts juridiques entièrement nouveaux proposés par deux brillants juristes juifs dont les familles ont à peu près entièrement disparu – Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin –, même s’ils ignorent encore tout de la terrible réalité au moment de leur travail.
Lauterpacht proposait l’inscription du « crime contre l’humanité » dans le droit international, alors que pour Lemkin, le terme de « génocide » devrait s’imposer en priorité. Le premier considère que la fin ultime du droit est l'individu, alors que le second se donne pour objectif la défense des groupes, c'est-à-dire des individus en tant qu'ils appartiennent à une entité collective (ethnique, religieuse, ...). Les deux hommes sont originaires d’un territoire, la Galicie, tour à tour polonais ou ukrainien et placé sous l’autorité successive de la Pologne, de l’Allemagne et de l’Union Soviétique, avec des allers-retours. Le livre oscille avec obstination entre Žołkiew et Lemberg (alias Lwów, alias Lviv, suivant les annexions successives).

Philippe Sands relate en détail la longue et laborieuse trajectoire des deux concepts, depuis les deux cerveaux qui en ont eu l’idée jusqu’à leur gravure dans le marbre du nouveau droit international : vu les horreurs absolument inouïes que l’on découvre à la Libération – dans les usines à tuer imaginées par les nazis, mais pas seulement – il est nécessaire d’enrichir la panoplie des armes juridiques à même de les prévenir ou de les châtier.
A cet égard, Hersch Lauterpacht a plus de chance que Raphael Lemkin : le concept de « crime contre l’humanité » fait quasiment l’unanimité au sein de la communauté des juristes impliqués dans le futur procès. Il faut dire que son auteur a l'opportunité, avant même la fin de la guerre, de capter l'attention d’un haut responsable américain du futur tribunal, alors que Lemkin, de son côté, indispose ses interlocuteurs par son caractère passionné, jugé incompatible avec l’impassibilité supposée du juriste. D’autant que le concept de génocide gêne un certain nombre de gens, à commencer par les Américains, qui craignent un jour d’en être la cible, à cause du sort qu'ils ont réservés à toutes les ethnies amérindiennes lors de la "conquête de l'ouest", les survivants étant condamnés à vivre parqués dans des réserves.
Mais si Lauterpacht a fait entrer comme dans du beurre le « crime contre l’humanité » dans le droit international, Lemkin a dû batailler jusqu’à la fin pour qu’il en soit de même pour le « génocide ». Beaucoup, au sein du consortium de juristes internationaux, jugeaient le concept indésirable, et l'homme déséquilibré, caractériel.
Le mot a cependant fini par s’imposer (de justesse), mais par malheur avec un effet pervers que Philippe Sands souligne : « … élevant la protection des groupes au-dessus de celle des individus. La puissance du terme forgé par Lemkin l’explique peut-être, mais, comme l’avait craint Lauterpacht, sa réception a entraîné une bataille entre victimes, une concurrence, où le crime contre l’humanité a été perçu comme le moindre des deux maux » (p.445).
On n’a pas fini de mesurer les effets indésirables entraînés par cette concurrence victimaire, qui interdit en principe d’établir une hiérarchie des malheurs collectifs, donc qui ouvre la porte, sans distinction de gravité, à toutes sortes de victimisations extensives, voire abusives. Je suis effaré, par exemple, du nombre des gens qui se sont portés parties civiles au procès d'Abdelkader Merah (plus de 200, selon son défenseur Me Dupond-Moretti). Que dire des parties civiles du futur procès de Salah Abdeslam (environ 2000 pour l'instant) ? Je ne savais pas que les attentats de novembre 2015 avaient fait tant de victimes collatérales. Après tout, moi aussi, comme la France entière, j'ai reçu en plein cœur la tragédie du Bataclan. On pourrait se demander si la motivation de certains n'est pas, tout simplement, l'espoir d'un dédommagement bien concret. J'ai peut-être tort, mais je n'aime vraiment pas cette prolifération vertigineuse des victimes, avec en perspective le fonds d'indemnisation.
L'effet pervers souligné par Philippe Sands agit comme une bombe à retardement : « C'est un défi sérieux pour notre système de droit international confronté à une tension tangible : d'une part, les gens se font tuer parce qu'ils appartiennent à un groupe ; d'autre part, en insistant sur le sentiment d'identité collective, la reconnaissance de cette appartenance par le droit rend le conflit entre groupes plus probable. Leopold Kohr ["un individu remarquable", p. 235] avait peut-être raison de noter, dans la lettre personnelle et puissante qu'il avait adressée à son ami Lemkin, que le génocide finirait par susciter les situations mêmes qu'il cherchait à corriger » (p.446).
Je ne suis pas juriste : je n'ai pas compris la raison pour laquelle le tribunal de Nuremberg s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les atrocités commises par les nazis avant l'ouverture officielle des hostilités (juste à cause d'une virgule dans le texte, d'après l'auteur). De toute façon, je n'ai jamais éprouvé d'attirance pour le droit : je crois que la réalité de la vie déborde constamment le droit. On peut s'en féliciter (qui peut avoir pour but de vivre en restreignant son existence à l'observance scrupuleuse de tous les articles d'un code ?). On peut aussi le regretter (combien de crimes – personnels ou internationaux – restent impunis ?). Il reste que le droit est, selon moi, une construction plus ou moins abstraite dont la validité et la légitimité dépendent du bon vouloir des vivants. Et on ne peut pas dire que les vivants d'aujourd'hui (je parle surtout des hauts dirigeants) en aient beaucoup, de bon vouloir.
Philippe Sands dresse d'ailleurs une liste de procès intentés à de grands criminels par la CPI depuis sa formation en 1998 (Rwanda, Pinochet, Milosevic, Omar al Bashir, Charles Taylor, et sans doute quelques autres : l'auteur ne cite pas Pol Pot, c'était avant). Il le dit : « Les procès se succèdent, comme les crimes eux-mêmes. Aujourd'hui, je travaille sur des cas impliquant le génocide ou les crimes contre l'humanité en Serbie, en Croatie, en Libye, aux Etats-Unis, au Rwanda, en Argentine, au Chili, en Israël et en Palestine, en Grande-Bretagne, en Arabie Saoudite et au Yémen, en Iran, en Irak et en Syrie » (p.444). Il en oublie probablement (rien sur la Chine de Xi Jin Ping ? Rien sur les Philippines du président Duterte ?).
Le seul fait qu'une telle liste puisse être dressée est décourageant, car elle éclaire l'impuissance du droit à prévenir et empêcher les grands crimes. Si le droit se réduit à courir après les coupables pour les châtier une fois les crimes commis, je me dis, à tort ou à raison, que le Mal n'a pas grand-chose à craindre du Code Pénal des démocraties, et que c'est vain et désespérant : il a fallu quelques mois pour que disparaissent des centaines de milliers de Rwandais (surtout Tutsis, mais aussi Hutus). Et combien d'années pour traîner quelques responsables devant le tribunal ?
Faire justice après coup est indispensable, évidemment, mais je crois que l'humanité serait plus efficace et mieux inspirée dans la lutte contre le Mal en agissant effectivement (et en amont) contre les inégalités et les injustices : faire en sorte que chaque être humain puisse se trouver justement rétribué pour ses efforts, je veux dire tarir la source des tensions (économiques, sociales, ethniques, etc.), est la meilleure façon de prévenir les aigreurs et les haines. Mais là, tout le monde va dire que je suis un doux rêveur. Parti comme c'est, le dernier génocide et le dernier crime contre l'humanité ne sont pas pour demain, et l'on n'en a pas fini avec ce genre de procès. Mais bon, ça donne un gagne-pain de longue durée – et une raison de vivre – aux juristes spécialisés. Il faut voir le bon côté des choses, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe sands, retour à lemberg, éditions albin michel, deuxième guerre mondiale, extermination des juifs, destruction des juifs d'europe, adolf hitler, tribunal de nuremberg, solution finale, hersch lauterpacht, raphael lemkin, crime contre l'humanité, génocide, abdelkader merah, mohamed merah, me dupond-moretti, salah abdeslam, bataclan, attentats paris 2015, code pénal, rwanda, augusto pinochet, milosevic, omar al bashir, charles taylor, pol pot, antisémitisme
jeudi, 05 juillet 2018
LE LAMBEAU, DE PHILIPPE LANÇON
Chose promise (voir ici même au 13 juin dernier), chose due : j’ai lu Le Lambeau, de Philippe Lançon, rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo. Le Lambeau est un livre redoutable. Peut-être pas pour tout le monde, mais à coup sûr pour tous ceux qui ont ressenti jusqu’au centre d’eux-mêmes la dévastation de la salle de rédaction de Charlie Hebdo, un certain 7 janvier, par un tandem de frères décidés à mourir. "Ressenti" : j’imagine quelque chose de pas très éloigné de ce que fut le "9 / 11" (nine / eleven) pour un Américain.
Pour moi, vieux lecteur du mensuel Hara Kiri, de son petit frère hebdomadaire, de son cousin Charlie (le mensuel de BD tenu par Wolinski) et de son neveu Charlie (l’hebdo, après le coup de ciseau de la censure pour crime de lèse-majesté), l’atmosphère assez « anar » et totalement libre que véhiculaient ces revues était la seule respirable : la dizaine de déchaînés qui faisait souffler ce vent semblait capable de pousser les murs à volonté et d’agrandir l’espace des possibles. J’ai mangé et ruminé mon foin à ce râtelier pendant de nombreuses années. Même si, à la longue, j’ai éprouvé la lassitude pour tout ce qui commence à tourner en rond pour se mordre la queue, les boyaux de mon crâne avaient assimilé tellement de cette matière que l’attentat m’a enlevé une partie de moi-même.
Lire Le Lambeau, dans ces conditions, n’a pas été une partie de plaisir, parce que, du moment où j’ai ouvert le livre jusqu’à la dernière page, j’ai revécu – et je revis en écrivant ces lignes – le 7 janvier dans toute sa dimension incompréhensible, absurde, avec le sentiment constant de l’irréparable. J’y suis finalement arrivé, par toutes petites étapes, en lecteur déjà fourbu au bout de vingt pages. Philippe Lançon est un examinateur impitoyable : il sait comme personne appuyer là où ça fait le plus mal. La balle de 7,62 tirée par Kouachi lui a emporté le maxillaire inférieur, faisant de lui une « gueule cassée » en tout point semblable aux innombrables défigurés de 14-18.

Une "gueule cassée" dans la réalité. Quelle épouse reconnaîtrait son époux ?
Le Lambeau raconte en détail les étapes de la reconstruction (réinvention) de son visage détruit. En 500 pages, j’ai le sentiment d’avoir laborieusement accompagné la tâche de titan à laquelle les assassins de ses amis ont contraint le journaliste pour revenir parmi les vivants ordinaires. Car l’attentat a fait de Philippe Lançon un « non-mort », faisant tomber un rideau d’acier entre lui et les gens normaux. Pour ses amis (Cabu, Wolinski, Bernard Maris, …), la chose est sans bavure et définitive (le jour fatidique, Reiser, Gébé, Cavanna, Choron étaient excusés, eux, pour cause de décès préalable). Pour lui, que les assassins ont après tout raté, le retour dans la vie quotidienne sera horriblement compliqué, jalonné d'un nombre impressionnant d'opérations chirurgicales. Le bloc opératoire de La Salpêtrière (« le monde d’en bas ») devient un lieu presque familier, où Chloé, sa chirurgienne (« la fée imparfaite »), parfois remplacée par Hossein ou une assistante, tente de lui refaire une mâchoire, morceau par morceau, de peau, de chair et d’os.

Monument aux morts de 14-18, à Trévières (Calvados), promu "gueule cassée" en 1944.
Lançon explique à la page 249 le titre de son livre. C’est au moment où les chirurgiens décident de lui prendre un péroné pour remplacer l’os pulvérisé par la balle : « La greffe du péroné était depuis plusieurs années pratiquée, d’abord sur les cancéreux de la mâchoire et de la bouche, principaux patients du service. On lui donnait aussi un autre nom et un autre soir, j’ai entendu sortir de la bouche de Chloé le mot qui allait désormais, en grande partie, me caractériser : le lambeau. On allait me faire un lambeau ». Une vie en lambeaux. Un morceau de jambe pour mâcher de nouveau ! Et je ne parle pas des mésaventures de la peau et de la chair dans la reconstitution laborieuse. Par exemple, quand on lui greffe un morceau de cuisse ou de mollet (je ne sais plus) pour faire la lèvre inférieure, des poils vont lui pousser dans la bouche ! Et puis les fuites persistantes, qui font qu’il en met partout quand on l’autorise enfin à manger un yaourt par l’orifice buccal !
Non, Philippe Lançon ne sera plus jamais l’homme qu’il a été, que ce soit pour lui-même ou pour ceux qui l’entouraient avant l’attentat. Il est devenu, en un instant, un bébé exigeant et un vieillard intraitable. Les frères Kouachi ont fait de lui un oxymore, et c'est ce qui passe mal auprès de certains. Par exemple, nous le suivons dans les hauts et les bas que subit sa relation avec Gabriela, la femme aimée – dont la vie suit par ailleurs une trajectoire instable et compliquée : l’homme qu’elle aime n’est plus celui dont elle était tombée amoureuse. Elle supporte mal la brutalité du changement. Accourue de New York aussitôt qu’elle apprend la nouvelle, puis faisant des allers-retours, elle ira jusqu’à reprocher à son amant de ne penser qu’à lui.
Et l’auteur assiste impuissant à cet éloignement, qu’il n’a ni voulu ni causé, mais dont il est, malgré tout, responsable, pense-t-il : « L’attentat s’infiltre dans les cœurs qu’il a mordus, mais on ne l’apprivoise pas. Il irradie autour des victimes par cercles concentriques et, dans des atmosphères souvent pathétiques, il les multiplie. Il contamine ce qu’il n’a pas détruit en soulignant d’un stylo net et sanglant les faiblesses secrètes qui nous unissent et qu’on ne voyait pas. Assez vite, les choses ont mal tourné avec Gabriela.
J’étais heureux de la revoir, mais j’avais pris des habitudes en son absence, et plus que des habitudes : des règles de vie et de survie. J’avais tissé mon cocon de petit prince patient, suintant, nourri pas sonde et vaseliné autour d’un frère, de parents, de quelques amis et de soignants » (p.343). "Mon cocon" !? "Petit prince" !? Qu'est-ce qu'il lui faut ? Mais qui envierait un tel cocooning de "petit prince" ?
A dire vrai, j’ai trouvé dans un premier temps déplacées ces confidences sur la vie intime de l’auteur, l’accusant de tomber dans l’auto-fiction, par nature indécente. Et puis, je me suis dit que ça aussi, ça appartient de plein droit au récit, et que, après tout, cette façon d’objectiver ce moment de la vie privée permet au lecteur bouleversé de prendre un peu de distance avec le tragique de la situation. Je pense à l’épouse d’une « gueule cassée » de 14-18, et je me dis qu’il lui a fallu bien de l’héroïsme pour rester attachée à son homme, quand elle l'a revu, "après". Qu'est devenu le couple de la "gueule cassée", après 1918 ?
Car juste avant le passage cité, on trouve ceci, qui se passera de mes commentaires : « Mes parents sont arrivés peu après et se sont installés, l’un à droite, l’autre à gauche, chacun me tenant une main et la caressant. J’ai pris la tablette et j’ai écrit : "Miroir ?" Ils l’avaient apporté. J’allais savoir à quoi je ressemblais. J’ai pris le miroir et j’ai découvert, à la place du menton et du trou, cernée par d’épaisses sutures noires ou bleu sombre, une grosse escalope sanguinolente et vaselinée de couleur claire, entre jaune et blanc, d’une surface lisse, glabre et unie comme celle d’un jouet en plastique. C’était ça, mon menton ? C’était pour ça qu’on m’avait opéré pendant dix heures, retiré un os de la jambe et mis dans cet état ? J’étais accablé » (p.334).
Heureusement, Philippe Lançon se fait accompagner par quelques amis infiniment plus dociles et réconfortants : les pages de La Recherche où Proust raconte la mort de sa grand-mère, de La Montagne magique de Thomas Mann, de Kafka, mais aussi et (selon moi) surtout, Jean-Sébastien Bach et Beethoven : « J’ai senti les piqûres et me suis concentré sur la musique de cet homme, Bach, dont j’avais chaque jour un peu plus l’impression qu’il m’avait sauvé la vie. Comme chez Kafka, la puissance rejoignait la modestie, mais ce n’était pas la culpabilité qui l’animait : c’était la confiance en un dieu qui donnait à ce caractère coléreux le génie et la paix » (p.390). Ainsi, Bach a "sauvé la vie" de l’auteur ! Quelle beauté dans la formule ! Oui, la musique de Jean-Sébastien Bach est bien ce qui sauve en dernier recours.
J’ai un seul reproche à faire au livre de Philippe Lançon : l’éloge qu’il fait de Laurent Joffrin. Il est vrai que celui-ci est son patron, et qu’il lui doit sans doute beaucoup dans l’exercice de son métier de journaliste. Mais je n’oublie pas quant à moi l’insupportable gougnafier, capable d’assassiner un dialogue en empêchant son interlocuteur de développer sa pensée, quand celle-ci commet l’impardonnable erreur de s’opposer à la sienne. Invité chez Guillaume Erner ou Alain Finkielkraut, sur France Culture, il se débrouille, avec son importunité fanatique, pour se rendre haïssable, et transformer en bouillie le propos de l’adversaire, qu’il s’appelle Obertone ou Maler. Laurent Joffrin incarne à merveille l’idée que je me fais de l’intolérance bornée (on peut lire ici ce que je disais du monsieur le 17 février 2017).
Il va de soi que cette réserve ne fait pas oublier la violence exercée à travers ce livre sur un lecteur (moi) que les équipes d’Hara Kiri, Charlie et compagnie ont entouré comme des ombres tutélaires pendant quelques dizaines d’années. Et là, non, y a pas à tortiller du croupion :
« Quand l'un d'entre eux manquait à bord,
C'est qu'il était mort.
Oui mais jamais au grand jamais
Son trou dans l'eau ne se refermait ».
(Tonton Georges).
Merci, monsieur Philippe Lançon, pour ce livre tellement dur à avaler. Oui, je vous remercie pour tout ce qu'il m'a coûté. Parce qu'il m'a restitué l'essentiel. On peut appeler ça la Vérité.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe lançon, philippe lançon le lambeau, charlie hebdo, charlie mensuel, hara kiri hebdo, anarchisme, frères kouachi, attentats paris 2015, kalachnikov, cabu, wolinski, hara kiri, bernard maris, reiser, gébé, cavanna, professeur choron, hôpital la salpêtrière, proust la recherche du temps perdu, thomas mann la montagne magique, jean-sébastien bach, ludwig van beethoven, laurent joffrin, france culture, guillaume erner, georges brassens, tonton georges, les copains d'abord, alain finkielkraut répliques, gueules cassées, musique
dimanche, 17 juin 2018
CE QUE C'EST QUE DEUX FRÈRES
4 CE QUE C'EST QUE DEUX FRÈRES
Le Lambeau est un très dur et très beau livre. J'ai même parfois un peu de mal à comprendre comment, après un déchaînement de violence meurtrière où tant d'amis sont morts et où son propre corps est soumis à une torture de tous les instants, il est encore possible d'écrire de cette façon pacifiée, presque sereine. Et distanciée. Mais, comme le dit Philippe Lançon, il y a deux Philippe Lançon : celui d'avant et celui d'après. Celui d'après regarde de l'extérieur celui d'avant. Il le dit très simplement, d'ailleurs. Et sa prose dépassionnée place le lecteur que je suis (mentalement ficelé dans l'aventure de Charlie Hebdo depuis son tout début) au cœur de ce qu'il ressent encore de la tragédie, mais (miraculeusement) sans appuyer sur le moi et sur ce qu'il endure (en en parlant sans arrêt). Sortir de soi pour dire ce qui fut : chapeau, monsieur Lançon ! Du fond du cœur. Le Lambeau est un livre d'une grande dignité.

« J'ai relevé les yeux et, à ma gauche, au-dessus de moi, est apparu le visage de mon frère Arnaud. J'ai alors senti pour la première fois qu'il m'était arrivé quelque chose de grave, que si le café et le reste étaient un rêve, l'attentat, lui, ne l'était pas, et j'ai regardé mon frère, moi l'aîné, comme je ne l'avais jamais regardé. Comme il était mince ! Et étrangement blafard ... Il avait maigri et pâli en si peu de temps ? Que faisait-il là ? Tout seul ? Depuis quand ne l'avais-je pas vu ? Quelques jours à peine ... Maintenant les lumières de cet endroit inconnu avaient déteint sur lui. On avait repeint mon frère aux couleurs de ma nouvelle vie et on l'avait rajeuni du même coup, du cœur même de la fatigue et de l'angoisse, rajeuni et affermi dans la mission qu'il acceptait et entamait. Cette mission allait faire de lui mon jumeau et mon directeur de cabinet pratique, administratif, social, intime, pendant plusieurs mois. L'ordre en a été ancé, malgré lui et malgré moi, dans ce premier échange de regards. J'ai déplacé ma main vers la sienne avec une double exigence de consolation : je devais le consoler et il devait me consoler, l'un n'allait pas sans l'autre, il n'y aurait pas de consolation à sens unique.

Monument aux morts de 14-18 à Trévières (Calvados). Un obus de la bataille de Normandie en 1944 en a fait une "gueule cassée". Les municipalités successives ont eu la bonne idée de le laisser en l'état.
J'ai pensé que chacun de nous n'avait qu'un frère, l'autre, et cherché ce que pourrait être sa vie sans la mienne, et, le regardant fixement, ma vie sans la sienne. Les enfants font parfois cette expérience, par jeu, pour se faire peur et pour tester les limites de leur endurance à l'effroi – pour mieux se rassurer finalement. L'exercice a besoin de complaisance – comme lorsqu'on appuie sur la dent qui fait mal pour vérifier la douleur qu'on augmente et avoir le délicat plaisir de s'en plaindre en la renouvelant. Ce qui m'arrivait était peut-être de même nature, mais d'intensité différente : je ne jouais pas, j'étais joué, et la vision me tomba dessus sans que j'y sois préparé.
Quand on imagine le moins imaginable avec une force imprévue et comme détachée de soi-même, une force telle que la scène imaginée devient la seule possible, quelque chose crève dans le tissu fragile et résistant qui sert de conscience : la perspective de nos morts jumelles a ouvert un champ dont j'ai aussitôt pressenti, malgré l'abrutissement, que l'arpenter me rendrait tout aussi fou que de trop voir la cervelle de Bernard. Je voyais mon frère mort et j'ai vu défiler la suite, son enterrement, nos parents défaits, moi les prenant en charge, etc. Je me voyais mort et j'ai vu défiler la suite, mon frère à mon enterrement, nos parents défaits, lui les prenant en charge, etc. Dans les deux cas, l'enterrement avait lieu dans notre village et la tombe de chacun était celle de nos grand-parents, à quelques mètres de celle de Romain Rolland [Vézelay]. Les scènes se détachaient de moi-même et tournaient, comme des chevaux de bois sur un manège, se mélangeaient pour m'envelopper et m'enferment dans leur fixité et leur répétition. Le manège allait revenir régulièrement dans les mois suivants. Il accueillait des scènes différentes, mais récurrentes, mais récurrentes, et qui tournaient, tournaient. Les unes me faisaient vivre ce que je craignais le plus ; les autres, les plus redoutables, ce que j'avais vécu et ne pourrais plus jamais vivre : j'assistais en boucle à l'enterrement de mes vies passées ; mais qui portait le deuil exactement ? Je n'en savais rien. C'était le champ du pire aussitôt là, une suite d'images qui m'acculaient pour étrangler les restes de ma propre existence et les remplir d'incertitude, de vide. Je devenais ce que je voyais et ce que je voyais me faisait disparaître. Comme un vol de corbeaux dans un champ de blé était devenu un jour, tandis qu'il le peignait, la seule réalité, celle de l'artiste à l'oreille coupée et du nuage dans lequel il s'est perdu.

Le champ Van Gogh est apparu pour la première fois à cet instant, dans la nuit du réveil. J'ai fermé les yeux pour lui échapper, espérant retrouver l'illusion du café et de l'haleine de Gabriela, les retrouver par la réalité. Mais l'attentat ne permet pas ce genre de fiction : il dissout toute tentative de retour en arrière. Il est l'avenir qu'il détruit, le seul avenir, sa seule destruction, et tant qu'il règne il n'est que ça. J'ai rouvert les yeux. Mon frère était toujours là et il était vivant. Moi aussi. Le champ Van Gogh a disparu. L'infirmière est arrivée pour vérifier mon état et celui des perfusions. Elle nous a donné une tablette Velleda et un feutre bleu pour qu'on puisse communiquer.
Quels rapports ont les frères, les sœurs ? Comment se mêlent les souvenirs d'une intimité quotidienne – celle de l'enfance – à l'éloignement progressif qui généralement lui succède ? Arnaud et moi nous entendions bien, sans tensions ni conflits, mais sans nous voir beaucoup, sinon aux repas familiaux. Nous avions des vies et des amis aussi différents que possible – deux chiens d'une même portée mais de race différente, et qui ne retrouvent leurs réflexes communs que dans la niche qui les renvoie au temps perdu et partagé. Acquise ou innée, cette distance a sauté dans la salle de réveil – ou bien notre intimité, latente, a profité d'une occasion dont nous nous serions passés pour ressurgir. Nos parents n'étaient pas encore là, je ne savais pas si c'était l'aube, la journée ou la nuit ; c'était Arnaud qui prenait en charge ma vie et mon emploi du temps. Il l'a fait avec la fiabilité, la diplomatie et le sens moral qui le caractérisaient. notre enfance commune, nos vacances, nos blagues à deux balles, nos déjeuners rapides et réguliers dans un restaurant chinois situé sur l'avenue de la République où nous mangions toujours exactement la même chose, les mille et un liens qui nous tenaient sans que nous y pensions, tout ne semblait avoir eu lieu que pour aboutir là, dans cette salle de réveil, premier cadre de l'épreuve qui nous attendait. L'attentat a pesé sur nous avec une telle puissance qu'il n'y a jamais eu besoin, dans les mois suivants, de commentaires ni d'explications : sa violence et la violence de ses conséquences simplifiaient tout.
Arnaud était arrivé en se demandant ce qu'il faudrait affronter. Il ignorait à quel point j'étais touché, conscient ou diminué. Sa hantise était de tomber sur un légume ou un homme entièrement défiguré. Il a découvert un visage aux deux tiers intact. Le troisième tiers, inférieur, était couvert de pansements. On ne pouvait qu'imaginer l'absence de lèvres, de dents, et le trou. L'opération avait duré entre six et huit heures. Les orthopédistes ont attendu que les stomatologues aient fini leur boulot pour rafistoler les mains et l'avant-bras droit. Ma chirurgienne, Chloé, déjeunait avec une amie quand on l'a appelée. "Et vous savez de quoi on parlait ? m'a-t-elle dit deux ans plus tard. De Houellebecq ! Mon amie était venue avec Soumission, qu'elle m'a offert ..." Leur repas s'est arrêté là. Plus tard, elle a lu le livre et l'a aimé. Qu'en aurait-elle pensé si mon arrivée au bloc n'avait pas abrégé son déjeuner ? Quand elle m'en a parlé, nous étions dans son cabinet de consultation, je n'étais plus en position horizontale et nous avons simplement ri de la coïncidence, mais, après tout, en était-ce une ? Houellebecq me semblait bien loin, désormais. Il appartenait à mes souvenirs, comme il appartient à mon livre. Je me demande qui a récupéré l'exemplaire annoté de Soumission, que j'ai perdu.
J'ignorais quelle heure il était, si une heure, un jour ou un mois avait passé. Plus tard, j'ai su qu'il était minuit. Arnaud m'a dit d'une voix douce : "Nous avons eu beaucoup de chance, mon frère. Tu es vivant..." Je n'ai compris qu'en écoutant ces mots que j'aurais pu être mort et, regardant de nouveau mes mains et mes bras bandés, me rappelant que la mâchoire était détruite, me suis demandé pourquoi je ne l'étais pas. Il n'y avait ni colère ni panique ni plainte dans cette question muette, adressée à je ne sais qui. Il n'y avait qu'une recherche du nord. J'étais désorienté. J'ai de nouveau regardé mon frère, senti que j'avais du mal à respirer. Mon ancien corps s'en allait pour laisser place à un encombrement de sensations précises, désagréables et inédites, mais assez bien élevées pour n'entrer que sur la pointe des pieds.
Arnaud me regardait, je le trouvais décidément maigre et blafard comme la lumière dont il semblait sortir. Il avait l'air si jeune, si seul ! Pour un peu, je l'aurais plaint et l'aurais pris dans mes bras ; mais mes bras ne voulaient pas bouger. Et, cette fois ensemble, nous nous somme regardés comme deux frères qui avaient failli ne plus jamais se voir et que la perspective de la mort venait de souder. Je n'ai même pas essayé de parler. Je n'avais pas encore conscience des pansements qui fermaient le visage et de la trachéotomie, la trach' comme on allait vite m'apprendre à dire, ni de la sonde nasale qui allait bientôt m'irriter insupportablement la gorge et le nez, mais quelque chose m'avertissait que parler était impossible. Le patient pressent ce qu'il ignore. Son corps violé est un aboyeur. Il annonce des invités, inconnus et presque tous indésirables, à la conscience qui se croyait maîtresse de maison. J'ai fait un signe lent à Arnaud, un tout petit geste de souverain moribond, et il a commencé à me parler. De quoi ? Peu importe. Il me parlait. »
Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, pp. 114-119.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe lançon, attentat charlie hebdo, le lambeau philippe lançon, frères kouachi, monument aux morts trévières, islam
vendredi, 15 juin 2018
CABU JUSTE AVANT DE MOURIR

3 CABU JUSTE AVANT DE MOURIR
LE GÉNIE GRAPHIQUE DE CABU
« Les enquêteurs notent ensuite la présence, entre les corps de mes compagnons, d'un couteau de marque Laguiole "au manche de couleur grise et dont la longueur totale est de 28 centimètres pour une lame d'une dizaine de centimètres", et "un emballage d'aluminium d'un gâteau et des morceaux de cake imbibés de sang". Mais où étaient donc passés les biscuits de Cabu ?
Il en mangeait volontiers pendant ou après la réunion, quand ce n'était pas du vieux pain ou quelque chose comme ça, rangé dans du papier d'aluminium. C'étaient peut-être les seuls instants où il ne dessinait pas – et encore, ce n'est même pas sûr, car il pouvait dessiner d'une main en grignotant de l'autre. Je le regardais souvent faire avec sympathie et inquiétude, comme on regarde agir un enfant jusqu'au moment où l'on s'aperçoit qu'il a quatre-vingts ans, phénomène qui signifie que soi-même on n'en a plus tout à fait vingt. Cabu et sa frange n'avaient pas d'âge, dans la mesure où il était sans cesse rajeuni et comme enluminé par les dessins qui la prolongeaient et, en quelque sorte, la justifiaient. Il était comme ses biscuits, son vieux pain : son intelligence était peut-être limitée, mais son génie donnait du goût à n'importe quoi. Il resterait toujours un écolier insolent, teigneux, timide et surdoué qui caricaturait les fabricants d'autorité sur une vieille table de bois couverte de graffitis et qui, vers la fin du cours, sortait son paquet de biscuits pour en manger un ou deux, comme un rongeur en hiver, avant de continuer à refaire d'un geste sûr le pire et le meilleur des mondes, le nôtre, le seul, sur un support ou sur un autre, y compris dans sa poche ou, pourquoi pas, au creux d'une main ou sur une semelle de chaussure. Tout faisait paroi dans sa grotte, sur quoi laisser des inscriptions et l'ombre d'un rire.
J'étais arrivé à jeun à la conférence de rédaction. Ce jour-là Cabu avait du cake mais, vers la fin, il a fait circuler un paquet de biscuits. Était-ce vraiment le sien ? Je n'en sais rien. Mais c'est lui qui me l'a tendu et ils ont été mon dernier repas avant extinction. Quelques instants avant l'entrée des tueurs, j'en ai mangé un non sans scrupules, car je ne me sentais guère en droit d'accepter le moindre don de la part de ceux avec qui je partageais si peu et auprès de qui, malgré les années, je me sentais toujours aussi marginal et peu légitime, aussi peu apte à mener le moindre combat ou à me rappeler la moindre épopée : je n'avais pas été adulte dans les années soixante et soixante-dix, je n'avais pas eu à expérimenter des libertés dont j'avais bénéficié. J'étais un homme sans abus parmi des hommes qui en avaient commis ou qui, en tout cas, les avaient contés, commentés et dessinés. Ce défaut d'abus m'empêchait souvent d'accepter la brioche de Tignous ou les biscuits de Cabu. »
Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, pp. 97-99.
*****************************
IN MEMORIAM
Frédéric Boisseau, Agent d’entretien.
Franck Brinsolaro, Policier du Service De La Protection (SDLP).
Jean Cabut, Dessinateur.
Elsa Cayat, Psychanalyste et Chroniqueuse.
Stéphane Charbonnier, dit Charb, Dessinateur et Directeur de CH.
Philippe Honoré, Dessinateur.
Bernard Maris, Economiste et Journaliste.
Ahmed Merabet, Policier.
Mustapha Ourrad, Correcteur.
Michel Renaud, Organisateur à Clermont-Ferrand d’une exposition de dessins de Cabu, à qui il rapportait ses œuvres.
Bernard Verlhac, alias Tignous, Dessinateur.
Georges Wolinski, Dessinateur.
*******************

Hommage de Dutreix à l'équipe de Charlie : « Je vois que vous allez être assassinés par des terroristes ... En votre mémoire, le glas de Notre-Dame sonnera, il y aura un grand défilé avec Hollande, Valls, Sarkozy, Copé, Merkel, Cameron et même Netanyahou ... Il y aura des drapeaux tricolores et on chantera la "Marseillaise" ... On proposera de vous panthéoniser, le Nasdacq et l'Académie française diront "Je suis Charlie" et le pape priera pour vous ». Les quatre copains sont écroulés de rire. On reconnaît à peu près Wolinski et Cabu. Pour les deux autres, je ne sais pas (Charb ? Tignous ? Honoré ?).
Tout ça qui remonte à cause du livre de Philippe Lançon : le trou est resté béant.
Il y a des choses qui ne passent pas.
Il y a des choses qu'il est impossible de pardonner.
09:03 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, philippe lançon, le lambeau philippe lançon, charlie hebdo, attentat charlie hebdo, frères kouachi
jeudi, 14 juin 2018
CABU CHEZ PHILIPPE LANÇON
2 CABU CHEZ PHILIPPE LANÇON
« En 2004, après avoir appris sa mort, j'écris sur lui [le batteur de jazz Elvin Jones] une chronique dans Charlie. Cabu se souvient, de son côté, des circonstances où il a vu le batteur, en plein air, au festival de Châteauvallon. Il me le raconte et j'insère son souvenir dans ma chronique : « Soudain l'orage éclate. Il est violent. Les musiciens et le gros du public, tout le monde disparaît comme dans La Symphonie des Adieux ; tout le monde, sauf Jones. Déchaîné, démesuré, battant la mesure d'outre-tombe, le géant aux mains d'acier anime les peaux et les cuivres parmi les éclairs, seul comme un dieu oublié, un dieu oriental aux mille bras. L'orage semble créé pour lui, par lui. Il se fond dedans. Il a cinquante ans, le tonnerre demeure. » C'était en 1977. Vingt-sept ans plus tard, Cabu en fait un dessin qui, posé à côté de ma chronique, lui donne une valeur qu'elle n'a pas, qu'elle n'aurait pas en tout cas sans lui : être "illustré" par Cabu, en partculier sur le jazz, ou plutôt accompagner par écrit l'un de ses dessins, me fait alors rejoindre une adolescence heureuse, celle où je découvrais en même temps que Céline, Cavanna, Coltrane et Cabu. C'est à peu près comme si, écrivant en 1905 un roman se déroulant dans le monde des danseuses, les illustrations du livre étaient faites par Degas.
Si Elvin Jones n'était pas mort, je n'aurais pas écrit cette chronique. Si je n'avais pas écrit cette chronique, Cabu n'aurait pas fait ce dessin. Si Cabu n'avait pas fait ce dessin, je ne me serais pas arrêté pour lui montrer ce matin-là le livre de jazz qui me l'avait rappelé. Si je ne m'étais pas arrêté pour le lui montrer, je serais sorti deux minutes plus tôt et je serais tombé à l'entrée dans l'escalier, j'ai cent fois refait le calcul, sur les deux tueurs. Ils m'auraient sans doute tiré une ou plusieurs balles dans la tête et j'aurais rejoint les autres Palinure, mes compagnons, sur le rivage aux gens cruels et dans le seul enfer existant : celui où l'on ne vit plus.
J'ai posé le livre de jazz sur la table de conférence et j'ai dit à Cabu : "Tiens, je voulais te montrer quelque chose ..." Il m'a fallu un peu de temps pour trouver la photo que je cherchais. Comme j'étais pressé, j'ai pensé que j'aurais dû marquer la page ; mais comment aurais-je pu le faire, puisque je ne savais pas, trente minutes avant, que j'allais la lui montrer. Je ne savais pas s'il serait présent ce jour-là – même s'il ratait rarement la conférence du mercredi : Cabu avait dessiné une infinité de cancres, mais c'était un bon élève.
La photo d'Elvin Jones date de 1964 et s'étale sur les pages 152-153. C'est un gros plan. Il allume une cigarette de la main droite, énorme et fine à la fois, qui tient les deux baguettes en croix. Il porte une élégante chemise à carreaux fins, légèrement ouverte. Les manches ne sont pas relevées. Les yeux clos, il tire sur la cigarette. La moitié du visage, puissant et anguleux, est prise dans le triangle supérieur dessiné par les deux baguettes, comme dans les formes d'un tableau cubiste. La photo a été faite pendant une session d'enregistrement d'un disque de Wayne Shorter, "Night Dreamer". Cabu l'a trouvée aussi belle que moi. J'étais heureux de la lui montrer. Le jazz était au bout du compte ce qui me rapprochait le plus de lui. Quant au livre, il le connaissait déjà. »
Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, pp. 72-74.
Cabu en 2005 sur la chaîne KTO (une petite heure d'entretien simple et sympathique). Note à l'intention de l'intervieweuse : ce n'est pas Isabelle Cabut qui a fondé La Gueule ouverte, madame, c'est le grand Pierre Fournier. En revanche, elle a quelque chose à voir avec la fusion de La Gueule ouverte et Combat non-violent, intervenue au bout d'une vingtaine de numéros de la revue de Fournier, mort après deux ou trois numéros.
Note : Palinure est le pilote de la flotte d’Énée dans l’Énéide.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe lançon, le lambeau philippe lançon, cabu, charlie hebdo, éditions gallimard, jazz, elvin jones, attentat charlie, frères kouachi, cavanna, wayne shorter, pierre fournier, la gueule ouverte, isabelle cabut, combat non-violent
dimanche, 25 juin 2017
LE DERNIER FRED VARGAS
Il n'y a pas que Saint-Simon dans la vie : j’aime aussi passer un bon moment à suivre, de temps en temps, une bonne enquête policière. C’est ce que je viens de faire avec le dernier Fred Vargas (à ne pas confondre avec la chanteuse Chavela Vargas, la bouleversante interprète de Paloma Negra),
Quand Sort la recluse.
Je ne suis plus le grand amateur de polars (et toute cette sorte de choses) que j'ai été. On me dit que c'est un tort, parce que c'est dans le polar, paraît-il, que se sont réfugiées la description et l'analyse du monde et de la société tels qu'ils sont, description et analyse qu'on ne trouve plus au rayon « littérature générale », devenue, si l'on excepte les romans de Michel Houellebecq, nombriliste, dépourvue d'horizon, recroquevillée sur les tourments existentiels et narcissiques de pauvres individus qui s'attendrissent sur leurs "souffrances" vénielles. Je réponds que si cela est vrai, c'est bien regrettable et bien triste. Revenons à nos moutons, revenons à Quand Sort la recluse.
On retrouve évidemment le commissaire Adamsberg, plus que jamais "perdu dans ses brumes", avec sa démarche, tanguée ou flottée, et, pour cette fois, ses « bulles dans le cerveau ».
Je trouve, à tort ou à raison, qu’il y a du Maigret dans le personnage, qui ressemble à notre commissaire national sur un point précis : tout le monde constate sa quasi-infaillibilité quant aux résultats des enquêtes, mais personne, pas même le personnage lui-même, n’est en mesure de définir sa méthode. Leur méthode à tous les deux est de n’en pas avoir, et de se laisser aller à leurs impressions, à leur intuition : en trois coups de cuillère à pot, Adamsberg, rappelé d’urgence de sa villégiature islandaise, résout une affaire de meurtre. C’est juste une mise en bouche, avant le plat de résistance, devant lequel il va sérieusement "flotter".
Le commissaire de Vargas se différencie cependant de Maigret par la façon dont l’auteur creuse dans son personnage de façon à en faire percevoir les abîmes intérieurs. Ici, par exemple, c’est un souvenir d’enfance qu’il avait chassé de son esprit aussitôt que le traumatisme avait été vécu, que son propre frère va lui remettre en mémoire. On trouvait déjà dans Sous les Vents de Neptune une telle remontée dans le passé enfantin d'Adamsberg (le criminel, à la personnalité puissante, parvenait à s'échapper).
Mais on retrouve aussi tous les membres de l’équipe, chacun identifiable grâce à un trait de caractère ou un talent particulier : Voisenet et sa connaissance du monde animal, Danglard avec son érudition et sa mémoire des noms, Froissy l’experte en hacking tous azimuts, etc. Cette fois, la sauce est épicée de la curieuse implication de Danglard, un des seconds du commissaire, dans l’enquête, au point qu’il essaie de la torpiller, avant de découvrir que, heureusement pour sa sœur, c’était une fausse piste.
Tout part d’une curieuse araignée aperçue par Adamsberg sur l’écran de l’ordinateur de Voisenet, qui a relevé dans la presse deux faits divers apparemment sans problème : deux vieillards de la région de Nîmes ont été retrouvés morts après avoir été piqués par une « recluse », alias « Loxosceles rufescens ». Or cette araignée est, d’une part, d’une timidité maladive et, d’autre part, absolument sans danger pour l’homme dans des circonstances normales.
Pour qu'elle soit dangereuse, il faudrait, selon l' « imbuvable » professeur Pujol, arachnologue réputé, rassembler le venin de plusieurs dizaines d'individus, ce qui est hautement improbable ; selon l'encyclopédie en ligne, la morsure de cette "Sicariidae" peut provoquer des lésions de 10 cm. de circonférence, dont on doit particulièrement se méfier quand on est dans la région de Nîmes et Montpellier.

Exemplaire de "recluse", Loxosceles rufescens, dite aussi "araignée violon".
Il faut qu’une immonde petite fripouille en glisse une dans le pantalon d’un souffre-douleur de l’orphelinat « La Miséricorde » pour que la nécrose se mette aux testicules du garçon, garantissant son infirmité future, pour la plus grande joie des bourreaux. Le tortionnaire faisait partie de la « bande des recluses », qui faisait la loi parmi les orphelins de l’établissement, dans les années 1940 : de véritables petits bandits qui faisaient régner la terreur parmi les garçons et qui allaient montrer leur sexe aux filles, à travers le grillage qui les séparait, jusqu’à éjaculer sur elles.
C’est presque naturellement que la bande s’était convertie au viol collectif dans la suite : des salauds qui ont commis leurs méfaits pendant des dizaines d’années. Et qui voient s'abattre sur la dizaine de membres de la bande, longtemps après les faits, une vengeance longuement remâchée et méticuleusement méditée. La police se voit obligée de protéger la vie des derniers salauds qui sont encore au programme.
On appelait aussi « recluses » les femmes qui choisissaient de se faire enfermer dans un local exigu, ne recevant de quoi survivre, de la générosité des passants, que par une étroite lucarne, sans aucun soin, vivant dans leurs déjections et leurs immondices jusqu’à ce que mort s’ensuivît. On s’apercevra que cet autre sens du mot n’est pas sans lien avec le commissaire Adamsberg.
Le roman est techniquement réussi, alliant de façon convaincante – quoi que de façon parfois artificielle – la psychologie (si l’on peut dire) des personnages (policiers comme autres) et la conduite de l’intrigue. Pas de quoi entrer dans le panthéon des lettres, mais l’auteur n’en demande sans doute pas tant.
De quoi voir défiler sans trop d’ennui un après-midi de canicule.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature policière, polar, roman noir, fred vargas, sous les vents de neptune, vargas quand sort la recluse, commissaire adamsberg, commissaire maigret
jeudi, 22 juin 2017
UN PORTRAIT
Portrait d’un drôle de zigoto en 1710, sous la plume du duc.
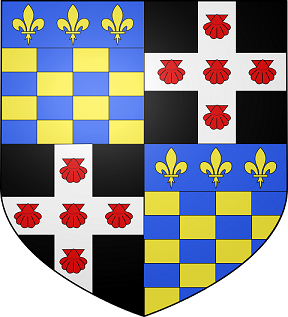
Ecartelé : au 1 et 4 échiqueté d'or et d'azur au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, au 2 et 3 de sable à la croix d'argent chargé de cinq coquilles de gueules.
J’ai déjà parlé ailleurs de Courcillon, original sans copie, avec beaucoup d’esprit, et d’ornement dans l’esprit, un fond de gaieté et de plaisanterie inépuisable, une débauche effrénée et une effronterie à ne rougir de rien. Il fit d’étranges farces lorsqu’on lui coupa la cuisse après la bataille de Malplaquet. Apparemment qu’on fit mal l’opération, puisqu’il fallut la lui recouper en ce temps-ci à Versailles. Ce fut si haut que le danger était grand. Dangeau, grand et politique courtisan, et sa femme, que madame de Maintenon aimait fort et qui était de tous les particuliers du roi, tournèrent leur fils pour l’amener à la confession. Cela l’importunait. Il connaissait bien son père. Pour se délivrer de cette importunité de confession, il feignit d’entrer dans l’insinuation, lui dit que, puisqu’il fallait en venir là, il voulait aller au mieux ; qu’il le priait donc de lui faire venir le père de la Tour, général de l’Oratoire, mais de ne lui en proposer aucun autre, parce qu’il était déterminé à aller à celui-là. Dangeau frémit de la tête aux pieds. Il venait de voir à quel point avait déplu l’assistance du même père à la mort de M. le prince de Conti et de M. le Prince ; il n’osa jamais courir le même risque ni pour soi-même, ni pour son fils, au cas qu’il vînt à réchapper. De ce moment il ne fut plus question de confession, et Courcillon, qui ne voulait que cela, n’en parla pas aussi davantage, dont il fit de bons contes après qu’il fut guéri. Dangeau avait un frère abbé, académicien, grammairien, pédant, le meilleur homme du monde, mais fort ridicule. Courcillon, voyant son père fort affligé au chevet de son lit, se prit à rire comme un fou, le pria d’aller pleurer plus loin, parce qu’il faisait en pleurant une si plaisante grimace qu’il le faisait mourir de rire. De là il passe à dire que, s’il meurt, sûrement l’abbé se mariera pour soutenir la maison ; et il en fait une telle description en plumet et en parure cavalière, que tout ce qui était là ne put se tenir d’en rire aux larmes. Cette gaieté le sauva. Il eut la bizarre permission d’aller chez le roi, et partout sans épée, sans chapeau, parce que l’un et l’autre l’embarrassaient avec presque toute une cuisse de bois, avec laquelle il ne cessa de faire des pantalonnades.
Mais cette gaieté ne le sauva pas, un peu plus tard, de la petite vérole.

Collier de l'ordre du Saint-Esprit, sur l'attribution duquel Saint-Simon était d'une jalousie sourcilleuse et d'un orgueil intraitable.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, armoiries, noblesse, aristocratie, blason, héraldique
mercredi, 21 juin 2017
LIRE LES MÉMOIRES DE S.-S.

Louise de Priel, maréchale de la Motte-Houdancourt.
De quoi sont faits les Mémoires de Saint-Simon ? Ayant tant soit peu avancé dans cette traversée au long cours, je commence à en avoir une idée assez nette : on voit se succéder les campagnes militaires, invariablement commencées en avril-mai et terminées en octobre-novembre ; des anecdotes plus ou moins croustillantes ou mémorables ; les portraits des gens auxquels l’auteur accorde un intérêt ou de l’importance ; les manèges, manœuvres, manigances et intrigues de la cour ; les démêlés de l’auteur en personne avec divers personnages (duc de Luxembourg au sujet des préséances). L'essentiel, à la cour, est de paraître constamment au courant de tout : c'est le règne de la "conversation". Et l'on peut compter sur le mémorialiste pour tout faire pour se tenir au courant.
On trouve aussi la généalogie méticuleuse (parfois interminable) des lignées de premier ou de second plan, avec à chaque fois mention du déluge des noms, des parentés et des unions, et jugement sur la basse extraction des uns ou la grandeur des autres, mais aussi sur la légitimité des prétentions. Il arrive à Saint-Simon de faire sa révérence à telle grande famille en remontant son fil jusqu'au XI° siècle, signe de haute noblesse. Et quand il ne peut remonter que jusqu'à 1350, on sent que sa plume fait sur le papier une moue de dédain. Il tient aussi une rubrique nécrologique soigneuse au fur et à mesure des décès de divers courtisans, agrémentée de l’intensité des regrets ou du soulagement que ceux-ci laissent en partant, ainsi que des éventuels problèmes ayant marqué leur succession.
Certains récits sont passionnants : la longue imposture du duc de Vendôme à la tête de l’armée, qui consiste à faire valoir ses moindres actions militaires dans des courriers dithyrambiques, à entraver en Italie le génie militaire du duc d’Orléans, finalement obligé d’abandonner l’Italie aux armées de l’empereur d’Autriche, puis, en Flandre, à essayer de faire retomber sur le duc de Bourgogne, petit-fils légitime du roi et « héritier nécessaire de la couronne », la responsabilité des revers essuyés par l’armée française, aidé en cela par une « cabale » redoutable, sorte de complot fomenté par un petit nombre de gens haut placés, au premier rang desquels on trouve le duc du Maine, fils naturel de Louis XIV, dont Saint-Simon dénonce à plusieurs reprises la manifeste préférence de Louis XIV pour ses enfants bâtards (enfants de l'amour) et l'obstination du roi à leur donner la préséance sur les "fils de France" et les "princes du sang". Il va jusqu'à parler quelque part de « cette souillure de la bâtardise qui me faisait horreur ».
On sent par ailleurs que Saint-Simon n’a que mépris pour madame de Maintenon : d’abord à cause de sa basse extraction (elle fut l’épouse obscure de Scarron, qu’il lui arrive de nommer « madame Scarron, devenue reine »). Ensuite et surtout à cause de son appétit de pouvoir et de l’habileté diabolique avec laquelle elle a étendu son emprise sur l’esprit de Louis XIV, qui ne prend aucune décision sans en référer à elle. L’auteur évoque remarquablement la volonté de la reine de tout régenter (indirectement) à la cour de Charles V d’Espagne (petit-fils du roi), en se servant de la princesse des Ursins, qui est à sa dévotion.
Je viens d’achever le passionnant récit où Saint-Simon raconte comment, secondé par Besons, il s’y est pris (on est alors en 1710) pour que le duc d’Orléans, neveu du roi, abandonne sa maîtresse madame d’Argenton, avec laquelle il entretient une liaison scandaleuse aux yeux de tous, pour revenir auprès de son épouse légitime. Il finit par le convaincre – et il faut voir avec quel déploiement d’éloquence ! – qu’au regard de sa proximité avec le roi et des éventuelles responsabilités qu’il aura à exercer dans l’Etat (dont il est un des premiers personnages, au point d'exercer la Régence à la mort du roi), il est nécessaire de faire le sacrifice de son puissant amour.
Il faut vraiment lire les moments, palpitants et pathétiques, où le duc, conscient de la nécessité et ayant fait part de sa décision au roi (à la grande satisfaction de celui-ci), mais torturé jusqu’au fond de l’âme, se laisse aller à l’immensité de sa souffrance : « Alors vaincu par sa douleur, sa voix s’étouffa, et il éclata en soupirs, en sanglots et en larmes. Je me retirai dans un coin ». Même les princes peuvent éprouver de vrais sentiments.
Ce qui ressort aussi de cette lecture, entre beaucoup d’autres choses, c’est l’omniprésente préoccupation du « rang » des membres les plus éminents de la cour, parmi lesquels il faut évidemment compter Saint-Simon lui-même. Les notations au sujet des « fauteuils », des « chaises à dos » ou des « tabourets des grâces », sur lesquels on a droit ou non de s’asseoir en présence du roi ou des plus hauts personnages sont constantes. En présence de qui le roi reste-t-il debout ? En chapeau ou découvert ? Qui a droit de « manger et d’entrer dans les carrosses » ? En présence de qui le roi reste-t-il assis, se lève-t-il, va-t-il accueillir à la porte, à l’escalier ?
Ce qu’on a aujourd’hui bien du mal à comprendre est cette méticulosité dans l’attention apportée au respect des rangs, des hiérarchies, des préséances, et la conclusion que j’en tire personnellement est qu’une telle obsession a quelque chose d’enfantin. C'était sans doute le but recherché par le roi : quand on prête une attention aussi grande à ces tout petits détails, on ne pense pas à fronder.
Le très long reportage que nous livre Saint-Simon jette une lumière crue sur un monde faisandé jusqu’au cœur, tenaillé par des jalousies de toutes sortes, muselé et tenu en laisse par un souverain absolu, mais vieillissant, lui-même savamment gouverné par une femme assoiffée d’influence et de pouvoir.
On s’explique mal qu’il ait fallu presque un siècle pour que ce monde soit balayé. En tout cas, Saint-Simon ne nous laisse rien ignorer des petitesses et des misérables cruautés auxquelles peuvent descendre des gens prétendant à ce point à la grandeur : « Pour tout le reste du monde, c'était une cour anéantie, accoutumée à toutes sortes de jougs et à se surpasser les uns les autres en flatteries et en bassesses ».
Une curiosité de cette lecture est de voir l’auteur déplorer à maintes reprises l’avilissement des dignités. Très imbu de sa propre dignité de « duc et pair » et de « chevalier de l’ordre », très à cheval sur la légitimité des prétentions, il n’oublie jamais de mentionner l’année de la promotion de tel ou tel, et ne peut s’empêcher de regretter la confusion des vrais mérites dans laquelle le roi laisse, à la fin de son règne, tomber l’attribution des titres. De même, il désapprouve le roi quand il accorde le bâton de « maréchal de France » à des gens qui ne le méritent pas, tel Villeroy après la défaite de Malplaquet, heureusement secondé par l’intègre et prestigieux Boufflers qui réussit à sauver le gros de l’armée en organisant une magnifique retraite, qui lui vaudra des louanges unanimes.
La cour de Louis XIV ? Un panier de crabes dans un bac à sable.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, louis xiv, madame de maintenon
lundi, 12 juin 2017
L'EUROPE MISE A LA QUESTION
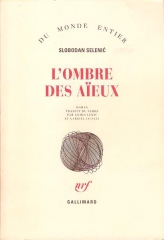 La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.
La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.
Au fur et à mesure que j'avance dans la lecture des Mémoires de Saint-Simon, je suis frappé par l’énergie déployée par les souverains (Angleterre, Autriche, France, Etats italiens, Savoie, Lorraine, Espagne, Hollande, …) à se disputer des territoires, des couronnes royales, et même des chapeaux de cardinaux, à rivaliser de puissance et animer des querelles de préséance, je me dis que l’Europe est irréductiblement composée de nations trop nettement individuées pour disparaître dans une instance plus vaste qui les subsumerait toutes et en laquelle chacune pourrait à bon droit se reconnaître.
Et ne parlons pas des affrontements qui ont ensanglanté le continent au cours des deux derniers siècles. Tout ce qui façonne ce qu'il faut bien appeler l'identité des peuples s'appelle l'histoire, et ce n'est pas le trait de plume que voudraient bien tirer sur celle-ci les signataires de tous les traités européens qui peut effacer cette réalité ni changer les peuples à volonté.
En même temps que les différences de langues et de coutumes, ces rivalités, querelles et autres guerres ont accentué tous ce qui forme les traits par lesquels les peuples européens se distinguent les uns des autres (on ne devient soi-même qu’en s’opposant, aux parents, au chef, au prof, aux autres, etc. : penser, c’est dire non, disait le philosophe Alain), produisant autant d’identités nettement marquées, voire irréductibles, donc difficilement fusibles les unes dans les autres.
Et ce n’est pas la lecture de L’Ombre des aïeux, du Serbe Slobodan Selenić (Gallimard, 1999, en 1985 dans la langue originale), qui incitera à croire encore possible l’édification d’une Europe unie. Dans ce remarquable roman, à travers les relations complexes des deux protagonistes, Stevan le Serbe et Elizabeth l’Anglaise (qui se partagent inégalement la narration), l’auteur aborde, parmi une multitude de sujets, l’impossibilité pour les nations d’Europe de perdre une identité en perdant une souveraineté qui bien souvent leur a coûté si cher à conquérir : leur mariage donne naissance à un garçon – Mihajlo pour son père, Michael pour sa mère – qui, pris entre les deux cultures, ne parviendra jamais à trouver un socle assez solide pour fonder son existence et son identité. Il en mourra. L’action se déroule sur plusieurs décennies à partir des années 1920, si l’on excepte les éléments remontant à l’enfance de Stevan.
Le premier dépaysé, dans l’histoire, est Stevan, qui achève à Bristol ses études de droit. Elizabeth lui a littéralement tapé dans l’œil, avec sa grande allure et sa chevelure flamboyante de rousse. Lui est plutôt du genre timide, mais elle ne semble pas effarouchée par ses travaux d’approche. Mieux, sous son aspect tellement « british », fait de réserve et de distance dans la conversation, elle répond à ses avances, au point qu’il ose la demander en mariage, allant même jusqu’à l’amener dans la petite chambre qu’il occupe dans une pension de la ville, pour « faire vraiment connaissance ». Il découvre à cette occasion qu’Elizabeth, sous des dehors froids, cache un tempérament de feu, presque déraisonnable.
Stevan est, par tempérament, un être tant soit peu torturé : élevé seul entre son père Milutin, ancien commerçant cossu, et Nanka, la vieille servante analphabète venue de la Serbie profonde et imprégnée de la tradition populaire, il s’inquiète, à l’occasion de son séjour anglais, de constater qu’il pourrait trahir la culture authentiquement serbe qui lui a été fidèlement transmise, et il s'en sent vaguement coupable.
L'auteur, par son personnage de Stevan, étudie en profondeur ce qui se passe dans l'esprit et dans la personnalité d'un homme confronté à une telle division de son propre moi. Dans son cas particulier, d'ailleurs, ce qui se passe à la longue illustre le poids des atavismes : lancé dans des travaux universitaires qui doivent lui assurer un rayonnement intellectuel, il se laisse peu à peu gagner par la nature lymphatique, et même paresseuse du peuple serbe. Le message est clair : si le processus d'acculturation ne va pas à son terme, le long passé historique et traditionnel reprend le pouvoir.
Car il découvre en Angleterre un peuple imprégné d’une culture radicalement autre, fait de coutumes et de rituels extrêmement codifiés, pour ne pas dire rigides, à l’opposé de ceux, primitifs, voire archaïques, en usage dans le peuple serbe : « Tout à coup, je n’avais plus du tout honte de mon pays inculte, perdu dans l’isolement, encore marqué de traits orientaux ; tout à coup, je découvrais, dans la gravité avec laquelle mon peuple affamé considérait la vie, une noblesse humaine et morale plus élevée que la frivolité douillette de celui qui, autour de moi, prenait, depuis des centaines d’années, son thé "at five o’clock", avait depuis huit siècles ses universités et une famille royale qui, dès le seizième siècle, avait résolu ses conflits dynastiques, à l’opposé de ce qui se faisait chez nous ».
Un soir de réunion du groupe, en évoquant son pays, par provocation, il va jusqu’à raconter le cas du berger Milomilj qui, « par une froide journée de novembre », est pieds nus pour garder son troupeau dans la montagne. Et quand le père et le fils s’étonnent de cela, il répond : « Y’a qu’à attendre un peu, avait répondu Milomilj, jusqu’à ce que la première vache bouse. Alors, c’est le paradis : les pieds dans la bouse chaude, y’a rien de meilleur ; la chaleur te monte jusqu’aux oreilles ». Précisons que l’anecdote se situe aux alentours de 1925. On imagine la stupeur des Anglais, mais aussi le vague mépris qu’ils éprouvent pour un peuple aussi arriéré.
Mais Stevan, au moins, retourne dans son pays une fois terminées ses études, en emmenant Elizabeth, désormais son épouse. Et c’est au tour de celle-ci d’éprouver la cruauté qu’il y a dans une telle transplantation en terre étrangère, à plus forte raison sachant que c’est définitif, et que, entre les deux nations, il ne s’agit pas de petites différences : la Serbie est carrément un autre monde, où apparaissent alors encore les traces très visibles (et souvent misérables) de l’empire ottoman. Et pourtant, elle fait des efforts inouïs pour s’adapter, par exemple en essayant d’apprendre le serbe, sans jamais arriver à le maîtriser totalement. Et puis, avec sa chevelure rousse, comment pourrait-elle passer inaperçue et se fondre dans la masse ?
Le pire, peut-être, est que, avec les meilleures intentions du monde, elle se fait un point d’honneur d’élever son Michael-Mihajlo selon les préceptes qu’elle a elle-même reçus. Pendant les premières années, le jeune garçon laisse entrevoir des aptitudes exceptionnelles, maîtrisant très tôt les deux langues et passant sans heurts de l’une à l’autre, lisant très tôt Shakespeare, enfin bref, montrant tous les caractères de l’enfant docile et surdoué.
Et puis un jour tout change. Les parents, de jour en jour plus effarés, voient leur fils s’éloigner d’eux. Ils constatent que le compréhensible besoin de s’intégrer dans le « groupe des pairs » (comme disent les psychosociologues) amène Mihajlo à délaisser d’abord l’anglais pour le serbe, puis à imposer le respect à son groupe – qui le traite encore d’Anglais – en relevant un défi lancé par les autres (ramener une des pastèques qui flottent en nombre sur le Danube). Pour s’intégrer, il faut choisir, or choisir, c’est éliminer. Mihajlo choisit ses camarades, bien que n'ayant pas trop d'estime pour eux, plus rustauds et rustiques.
Au sortir de la guerre, alors que se livrent les derniers combats contre les Allemands, juste avant que ne s’installe le régime communiste de Tito, Mihajlo rejoint un groupe de partisans, dont il impose la présence à ses parents, au motif qu’ils possèdent une table assez vaste pour confectionner à l'aise les banderoles des manifestations, au grand dam des parquets et tapis, aimablement souillés par les chaussures crottées.
Les relations du jeune homme avec ses parents deviennent tous les jours plus exécrables. Il va jusqu’à se mettre en colère contre sa mère, qui lui a donné les mêmes cheveux rouges qui le distinguent de tous les autres Serbes. Il n’hésite même pas à l’agonir des injures les plus violentes. Que peuvent les pauvres parents face à de telles explosions ?
Un jour, cependant, Stevan, n’en pouvant plus, éclate contre son fils et lui lance : « I wish you were dead » (je voudrais que tu sois mort). Le point de non-retour est dépassé. Mihajlo, sans rien dire, s’engage dans les troupes envoyées sur le front, soit pour échapper à un milieu devenu pour lui haïssable, soit pour exécuter inconsciemment la malédiction de son père. Peut-être les deux. Ce qui devait arriver arrive. Est-ce le père qui a renié son fils ? L’inverse ? Quoi qu’il en soit, la rupture entre les générations est consommée. Le fil de la transmission est cassé.
Inutile de dire que la lecture de ce livre – qui n’est qu’un roman, mais la seule science exacte n’est-elle pas la littérature (c’était Jean Calloud qui l’affirmait) ? – a été une belle occasion pour moi de m’interroger sur l’état actuel des relations entre les pays européens et sur les conséquences de l’entreprise de marche forcée des peuples européens vers « une ténébreuse et profonde unité » (en réalité purement et simplement réduite à la marchandise et à l’argent), qui fait allègrement fi de tout ce qui sépare ou éloigne les unes des autres chacune de ses entités élémentaires.
De tels arrangements mercantiles et de tels dénis de démocratie ne peuvent produire que des Donald Trump.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature serbe, slobodan selenic, selenic l'ombre des aïeux, mémoires de saint-simon, europe, construction européenne, éditions gallimard, donald trump, populisme
lundi, 22 mai 2017
GEORGES PEREC DANS LA PLÉIADE
 A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.
A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.
Je ne dis pas "connaisseur" par hasard : non content d’avoir côtoyé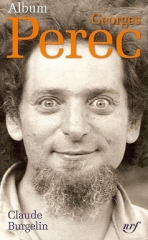 l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.
l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.
Les deux volumes (n°623 et 624) sont sobrement présentés sous l’appellation d’ « Œuvres », pour la raison que la diversité des tâches auxquelles s’est livré Perec au cours de sa brève existence (il est mort à quarante-six ans) mettrait la collection de prestige de l’éditeur en infraction à sa vocation presque (il y a quelques exceptions, comme Henri Michaux) exclusivement littéraire. Il a en effet donné des jeux à la revue Ça m’intéresse, des mots croisés, etc.
Et je ne parle pas du – qu’on me pardonne – fatras des publications posthumes : on dirait que, à l’instar des bouts de nappe en papier signées ou griffonnées par Picasso précieusement conservés dans le restaurant, il fallait absolument immortaliser le moindre brimborion qui porte la trace du grand homme. Je ne suis pas sûr qu’il faille absolument ennoblir par la publication ce que Perec lui-même appelait « l’infra-ordinaire », mais bon. Son œuvre proprement littéraire est déjà assez placée sous le signe du disparate qu’il n’y a peut-être pas à vouloir à tout prix inclure dans d’improbables « Œuvres complètes » jusqu’au plus petit souvenir laissé par l’homme, si grand qu’on puisse le considérer.
Personnellement, si je suis touché par W ou le souvenir d’enfance ou Je me Souviens, intéressé par Les Choses, amusé par les performances lexicales de La Disparition ou la désinvolture osée de Les Revenentes, immergé dans la matière océanique de La Vie mode d’emploi, je reste sceptique devant la virtuosité des « onzains hétérogrammatiques », et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien me laisse indifférent : inventorier les plus minuscules faits (y compris chaque passage de bus) observés depuis le Café de la Mairie ou le Tabac de la place Saint-Sulpice, pourquoi pas, mais sans moi. Même si je passe à côté d'un aspect (l' « infra-ordinaire ») pour lequel Perec lui-même manifestait un grand intérêt.
 Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.
Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.
Il y a, dans La Vie Mode d’emploi, les mille et une aventures d’une foule d’individus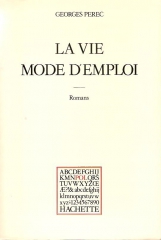 d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.
d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.
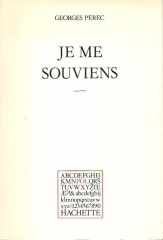 Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?
Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?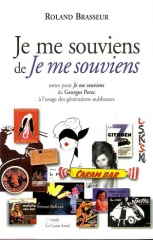
Quand j’ai la curiosité d’ouvrir l’album de famille qui rassemble des photos de gens qui m’ont précédé il y a un siècle et demi, j’ai beau savoir que mon existence a quelque chose à voir avec la leur, ma mémoire n'est ici qu'une page blanche. Si le livre de Perec s’était intitulé Traces pour archéologues à venir, Brasseur aurait été le premier de ces derniers. Et peut-être le dernier.
Quant à W ou le Souvenir d’enfance, il touche le lecteur de façon très indirecte, je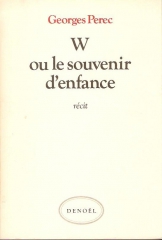 dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.
dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.
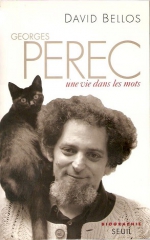 Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.
Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.
Je garderai mes réticences à l’égard de tout ce qu’il y a eu d’expérimental, voire d’excessivement « cérébral » dans les multiples activités du cerveau fertile de l’auteur, mais je ne peux oublier la substance vivante et vibrante dont est constitué l’ensemble de son œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, pléiade gallimard, collection de la pléiade, éditions gallimard, éditions du seuil, claude burgelin, perec les choses, w ou le souvenir d'enfance, perec l'infra-ordinaire, perec la disparition, perec les revenentes, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, la vie mode d'emploi, perec je me souviens, perec jérôme et sylvie, jean baudrillard, baudrillard la société de consommation, canapé chesterfield, roland brasseur je me souviens de je me souviens, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, bartleby, i would prefer not to
vendredi, 19 mai 2017
ARTICLE TINTIN
La collection des Dictionnaires amoureux (éditions Plon) est désormais, et depuis longtemps, confortablement installée dans le paysage de la librairie française. Il en a paru une centaine. Je m'en suis procuré deux, pour la simple raison que le "concept" me rase a priori. Peut-être à tort. Aucun sujet n'est apparemment proscrit. Alain Rey a même confectionné un savoureux Dictionnaire amoureux des dictionnaires. En 2016, Albert Algoud, un fou de BD, ou plutôt tintinophile enragé, ce qui est à la fois plus restrictif et plus ambitieux, a à son tour publié, après son Petit dictionnaire énervé de Tintin (éd. De l’Opportun, 2010) un formidable Dictionnaire amoureux de Tintin : une vraie mine à ciel ouvert.
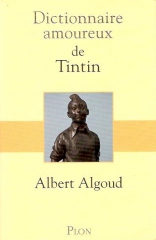
On y trouve en effet une foule de pépites. Par exemple, on apprend que le « Caramba » proféré à plusieurs reprises, entre autres, par Ramon Bada dans L’oreille cassée, en dehors de signifier « sapristi », « flûte » ou « zut », a pour étymologie un mot (« carajo ») qui « désigne le membre viril ». Il n’est pas sûr que Hergé se soit avisé de la chose avant d’en faire usage (ni d’ailleurs que dans l’affirmative il aurait choisi autre chose).
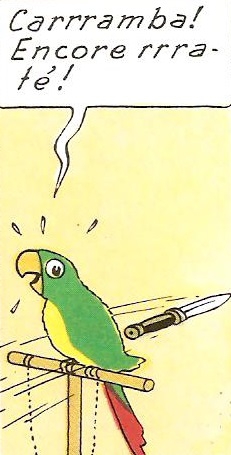
Le ton souvent personnel d’Albert Algoud convient parfaitement au sujet qu’il s’est proposé, et c’est presque naturellement qu’on voit apparaître des sujets dont la connexion à l’univers de Hergé ne saute pas aux yeux. Ainsi voit-il dans certaines vignettes spécialement surchargées de détails un discret hommage au style bien particulier du dessinateur Dubout. Il commence l’article à lui consacré par un souvenir. Ses grands-parents possédaient une gravure de Dubout, intitulée "Fête au village" : « Evidemment, j’avais remarqué tout particulièrement dans l’encadrement d’une fenêtre aux volets entrebâillés cette jeune femme à demi dénudée lutinée par un moustachu apoplectique ». Esprit de Rabelais, es-tu là ?
Albert Algoud ne dédaigne pas, pour s’amuser ou pour remplir le cahier des charges (un respectable volume de 800 pages), de glisser dans ses pages des articles qui font diversion. Par exemple, le nom de Wronzoff, un des méchants de l’Île noire (le seul à être en mesure de se faire obéir du gorille Ranko), sert de prétexte à un délire sur le nom de Voronoff, un chirurgien français célèbre dans les années 1920, qui pratiquait des opérations à partir de testicules de singe sur une clientèle masculine qui pensaient retrouver de la « vigueur », parmi laquelle il se plaît à placer le philosophe fictif Jean-Baptiste Botul (personnage inventé par Frédéric Pagès), célèbre pour avoir « enduit d’erreur » l’imbu et imbuvable Bernard-Henri Lévy en personne. On pardonnera cet excursus à l'auteur.
On dira que je cherche vraiment la petite bête, mais je ne peux m’empêcher de signaler à monsieur Algoud une erreur dans l’article Cartoffoli, l’Italien qui roule en « Lancia Aurelia B20 GT coupé de couleur bordeaux » dans L’Affaire Tournesol, et qui possède le nom le plus long de toute l'histoire de la BD (avec la kyrielle des prénoms qu'il débite au gendarme qui l'a arrêté. En effet, parmi ces noms , il cite le vieil Indien d’Oumpah-pah (Goscinny et Uderzo, avant Astérix) N’a-qu’une-dent-mais-elle-est-tombée-alors-maintenant-n’en-a-plus, mais il orthographie mal, comme je le montre ci-dessous, le nom du « chevalier prussien », l’Allemand qui fait face au Français De la Pâte Feuilletée.
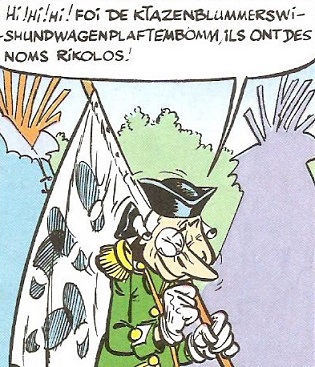
Et non pas Katzen...etc., monsieur Algoud, sauf votre respect. Le nom du "chevalier prussien" vaut celui dont le savant Cosinus baptise son invention cyclable, je parle évidemment de l'anémélectroreculpédalicoupeventombrosoparacloucycle (ci-dessous). J'avoue qu'il faut un certain entraînement pour le prononcer d'une seule coulée.
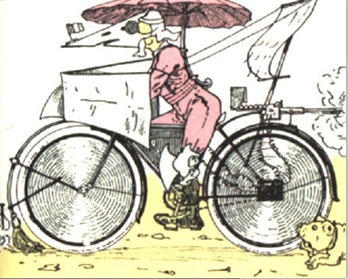
Cela n’enlève rien à l’inépuisable savoir d’Albert Algoud en matière de tintinologie, qui rassemble, dans ce Dictionnaire amoureux de Tintin, une masse d’informations indispensables. J’ajoute que c’est un ouvrage d’une hospitalité et d’une convivialité hautement recommandables : s’il égratigne tant soit peu les psychanalystes de Tintin (Tisseron, Apostolidès, …), c’est qu’il ne supporte pas la sotte cuistrerie et la fatuité pédante de tous ceux qui affirment détenir le savoir. Face à la sécheresse universitaire (et au Savoir en général), il est indispensable de rester sceptique, voire narquois.
En revanche, l’auteur rend un hommage appuyé à tous les conviviaux qui ont servi humblement et fidèlement la divinité sortie de la plume et du talent de Georges Rémi : Philippe Goddin, Benoît Peeters, … Dans je ne sais plus quel article, il pousse la confraternité jusqu’à citer le nom de Renaud Nattiez, auteur d’un Mystère Tintin (que je n’ai pas lu) et qui vient de faire paraître Le Dictionnaire Tintin aux trop peu connues du grand public éditions Honoré Champion. J’admire évidemment le travail du monsieur, qui reconnaît d'entrée de jeu sa dette envers plusieurs connaisseurs de Tintin, parmi lesquels on trouve les noms de Goddin, Peeters, Algoud et compagnie. L'œuvre de Hergé a beau être vaste, on se dit que le monde est petit.
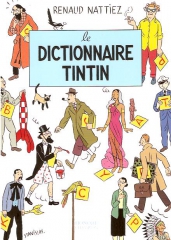
Aucun libraire lyonnais n'a été foutu de me procurer ce bouquin : nul ne connaissait en effet les éditions Champion qui, reconnaissons-le, ne sont pas spécialement connues pour être versées dans la Bande Dessinée.
Je me permets cependant de trouver superfétatoire sa manie de la définition dont il estime utile d’en affubler chacune des entrées (exemple : « Drapeaux : Pièces d’étoffe attachées à une hampe, portant l’emblème, les couleurs d’une nation, d’une unité militaire, d’un organisme, d’un groupe »). Il me semble qu’il aurait pu (et dû) s’en passer. Passons.
Tombe d'Honoré Champion au cimetière du Montparnasse à Paris (2014).
Quoi qu’il en soit, les visées des deux auteurs sont radicalement hétérogènes, et peut-être incompatibles : autant Albert Algoud s’efforce de nous apprendre le maximum de choses que nous ignorons, lecteurs moyens, quoiqu’assidus, autant Renaud Nattiez s’adresse aux néophytes, qui ne connaissent l’univers de Hergé qu’à travers ce que la rumeur publique en colporte. Nattiez se contente de rassembler, sous la double centaine d'entrées de son ouvrage, les données éparses dans les albums. Que peut-il apporter au petit peuple des élus, à la confrérie des initiés, je veux dire à ceux qui savent ?
Pour finir, une remarque tout de même sur la façon dont les deux dictionnaires sont illustrés : la dictature que fait régner Nick Rodwell, administrateur délégué de Moulinsart SA sur l’héritage de Georges Rémi, allant jusqu’à interdire à quiconque d’utiliser quelque vignette que ce soit de l’œuvre du maître a poussé nos deux auteurs à ruser. Nattiez (éditions Champion) en est réduit à confier à un certain Stanislas la couverture de son ouvrage, tandis que celui d’Albert Algoud est parsemé de vignettes signées Alain Bouldouyre.
D’ici que Tintin tombe dans le domaine public (en 2053), on peut compter sur Nick Rodwell, époux de la veuve, pour remplir plus haut que le bord le bas de laine des ayants-droits de Hergé.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, dictionnaire amoureux plon, dictionnaire amoureux de tintin, dictionnaire amoureux des dictionnaires, alain rey, éditions plon, albert algoud, éditions de l'opportun, petit dictionnaire énervé de tintin, caramba, ramon bada, hergé, tintin, éditions moulinsart, dubout dessinateur, rabelais, jean-baptiste botul, bhl, bernard-henri lévy, frédéric pagès, gorille ranko, oumpah-pah, uderzo goscinny, astérix, serge tisseron, apostolidès, georges rémi, philippe goddin, benoît peeters, renaud nattiez, éditions champion, nattiez le mystère tintin, nattiez dictionnaire tintin, nick rodwell, moulinsart sa, alain bouldouyre, christophe georges colomb, le professeur cosinus


