dimanche, 24 février 2013
BRASSENS ET "GIBRALTAR"
L'EPICERIE-COMPTOIR
(qui ne vaudra jamais la charcuterie-comptoir des vieilles filles alsaciennes Woehrlé, 185 rue Duguesclin, qui vendirent en leur temps la plus sublime choucroute crue de Lyon tant qu'elles furent de ce monde, et qui offraient - aux seuls "bons" acheteurs -, en plus de tous leurs secrets de cuisson (un plat de côtes au fond de la gamelle, par exemple), un verre de merveilleux Gewürtz ou de Riesling formidable)
Le titre exact du livre est Brassens, le regard de "Gibraltar". Les éditions Fayard / Chorus ont publié en 2006 ce livre de Jacques Vassal. Pour dire vrai, je n’avais jamais lu de livre sur Brassens, et cela pour une raison simple : Brassens, il fait partie de l’air que je respire, non pas par ce que je sais sur lui, mais à cause de ce qu’il a mis de musique en moi. Les pores de ma peau intérieure transpirent du Brassens à la moindre occasion, et il n’est pas rare que je me réveille le matin avec en tête « Le Grand chêne », « Grand-père » ou « Un 22 septembre ».

C’était comme s’il courait en moi une « ligne de vie » signée Brassens. Ce n’est pas la seule. Celle-ci côtoie celles de Jean-Sébastien Bach, de Thelonious Monk, des Beatles ou de Beethoven, pour ne parler que de musique. On dira ce qu’on voudra : je n’ai pas tellement besoin, en fait, de savoir des choses sur Brassens. C’est tout le problème de mon rapport au savoir, j’en suis d’accord : je suis persuadé que le savoir n’apporte pas le plus petit atome de richesse à la vie. Il faut d’abord vivre.
Brassens, avec l’intégralité de ses chansons enregistrées, se suffit, je crois, à lui-même. En même temps qu’il me suffit à moi-même. Comment dire ? Je ne suis pas un « fan » de Brassens, je ne le porte pas aux nues, mais son œuvre vit en moi, de façon permanente et indélébile. Une chanson s’y est même gravée plus récemment, puisque je l’ai découverte quand j'ai acheté les CD : « A mon frère revenant d’Italie », qui est la parfaite mise en musique de plusieurs strophes d’un beau poème de Musset. C'est la plage 16 dans le CD Mourir pour des idées. La chanson, qui ne figurait pas sur les microsillons, finit ainsi :
« Frère, ne t’en va plus si loin.
D’un peu d’aide j’ai grand besoin,
Quoi qu’il m’advienne.
Je ne sais où va mon chemin,
Mais je me sens mieux quand ta main
Serre la mienne ».
Inutile de dire que cette strophe sublime résonne aujourd’hui en moi comme jamais auparavant. Des paroles qui m’atteignent au cœur.

Alors le livre, me direz-vous ? C’est un livre sérieux, posé, où, surtout, le baratin n’a pas sa place. Un livre exposant des faits, et pas de sentiments. Ce serait déplacé. Certains pourront penser que, vu le personnage de Brassens, le propos manque de chaleur. Mais l’absence de lyrisme et d’expression des sentiments convient parfaitement : les faits se suffisent à eux-mêmes, et les laissent transparaître éloquemment.
Jacques Vassal a opté pour un exposé chronologique. Il a eu des entretiens avec Pierre Onteniente, dit « Gibraltar », fidèle entre les fidèles. Gibraltar (j’imagine que c’est parce qu’il était, auprès du chanteur, solide comme le rocher du même nom, je ne retrouve pas le passage où c’est expliqué) connaît Brassens au camp STO de Basdorf, et de retour à Paris, ne cesse de rendre des services au chanteur encore inconnu, pour devenir son factotum au moment où sa renommée s’étend.
L’auteur, à partir de ces entretiens, se contente modestement de faire le lien entre les différents moments du propos de Gibraltar, mais ce lien, il l’établit à merveille, gardant une trajectoire rectiligne sur la crête qui sépare une objectivité trop distante et les ragots à sensation.
Ce qu’apporte principalement Gibraltar, c’est évidemment la proximité du témoignage. Il est de toutes les aventures du chanteur, il est de ceux qui le connaissent le mieux, dans le moindre recoin, évoquant par exemple, sans s’appesantir, la double vie sentimentale de Brassens, pris entre la Jeanne (jalouse) de l’impasse Florimont et Püppchen.
Dernièrement, Charb, de la feuille hebdomadaire Charlie Hebdo, a proprement dézingué Brassens, dont il ne peut pas supporter, dit-il, d’entendre parler. Visiblement, il en a marre. Cela le regarde. Dans le tissage complexe dont je suis fait – la chaîne comme la trame –, je vois la solidité et la couleur vive des fils nommés Brassens. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Qui pourrait me l'enlever ? Charb, certainement pas.
Le livre de Jacques Vassal est un bon livre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 23 février 2013
NATACHA KUDRITSKAYA JOUE RAMEAU
JEAN-PHILIPPE RAMEAU, Gavotte et 6 doubles.
La radio a diffusé à plusieurs reprises, en quelques jours, la même Gavottede Rameau. Pas une obsession, mais presque. On se demande si quelqu’un supervise les programmes à France Musique. Mais cette répétition a suffi à faire tourner l’air en boucle dans ma tête, jour et nuit, comme si c’était une vulgaire rengaine, genre lambada, chansonnette au succès aussi massif qu’éphémère, sur laquelle tous les vautours publicitaires se sont jetés à l’époque, et que tout le monde a oubliée aujourd’hui.

La gavotte de Rameau a ceci de commun avec la lambada que sa mélodie de base est simple (encore que ...). La parenté s’arrête là, qu'on se rassure : c'est après que les choses se compliquent. La simplicité mélodique est une des conditions requises quand on veut composer des variations. Ce qu’il y a de fascinant dans la variation sur un air, c’est l’art avec lequel le compositeur modifie sans cesse le déguisement de son personnage principal, mais en faisant en sorte qu’on le reconnaisse à chaque nouvelle apparition.
Du moins en principe. Essayez donc de reconnaître l’Aria initiale dans chacune des trente verschiedenen Veränderungen, du grand Jean-Sébastien Bach (autrement dit les Goldberg). Mais la difficulté tient ici à la longueur et à la complexité de cette Aria : deux fois seize mesures, et au nombre important de variations. Même chose pour les trente-trois Diabelli de Beethoven : il faut s’appuyer sur une bonne analyse de la partition pour retrouver le thème enfoui par le compositeur dans le fouillis de ses procédés. Et pourtant on y arrive, en insistant un peu.
Mais Goldberg et Diabelli sont des monstres écrasants, des Everest quasiment inhumains. Rameau, avec sa Gavotte variée, reste à hauteur d’homme. Sept ou huit minutes (selon les interprètes) lui suffisent pour exposer son thème et le faire suivre de ses six « doubles ». En gros, une minute par séquence. Le thème, qui doit être joué sur un « tempo modéré », est donc une mélodie simple et chantante, facile à mémoriser. Dans les variations, il passe alternativement de la main gauche à la droite, pendant que l’autre main brode ses déguisements savants et diversement colorés.
J’arrête là mes velléités d’analyse musicale. J’ai découvert la Gavotte de Rameau sous les doigts d’Olivier Beaumont. Je viens de l’entendre sous ceux de Natacha Kudritskaya (son disque "Rameau" vient de paraître). Je suis allé écouter Blandine Rannou, Shura Cherkassky et quelques autres sur Youtube. Mon copain Fred m’a dit grand bien de la version de Marcelle Meyer. Mais je ne vais pas rejouer la « Tribune des critiques de disques » du regretté Armand Panigel.
Je comparerai juste les deux premières versions citées : je dirai que Beaumont, au clavecin, joue la carte de la solennité et de la noblesse, et que jusqu’à maintenant, c’est de cette façon que je voyais et aimais la pièce. Le problème du clavecin, c’est que les modernes moyens techniques d’enregistrement permettent de faire croire à l’auditeur que l’instrument possède la puissance d’un grand orgue.
Quand vous l’entendez au concert, s'il n'est pas amplifié, la salle doit être impérativement la plus petite possible : vous ne l’entendriez pas, comme je l'ai découvert il y a fort longtemps, au musée des Tissus lors d'un concert de Blandine Verlet, qui jouait sur le luxueux clavecin Donzelague. C’est un instrument de chambre. Pour le faire sonner comme on l'entend au disque, l'ingénieur du son ou directeur artistique doit, à mon avis, placer ses micros dans le clavecin. Il faut donc relativiser les impressions produites par le disque.

C’est la raison pour laquelle j’ai été saisi par l’interprétation de Natacha Kudritskaya au piano : contrairement à ce qu’on peut craindre, à cause du piano, elle joue cette Gavotte tout en grâce, sans jamais appuyer, comme si elle effleurait les touches. Du coup, la pièce devient lumineuse et d’une légèreté de papillon coloré. C’est cette évidence aérienne qui m’a fait suspendre toute activité durant les sept ou huit minutes de l’exécution. A la fin, j'ai dit merci.
Voilà ce que je dis, moi.
mercredi, 20 février 2013
EUGENE SAVITZKAYA
EN FACE DE LA PHARMACIE
Bison percé de flèches.
La flèche décochée l’attei-
gnit au talon. Bison recouvert
d’un linceul, d’un drap humide
et maculé qu’il faudra inciné-
rer et teindre après sa mort,
détruire avec divers objets
de métal. La blessure au front
est très longue et fine.
Tige froide pénètre sans
secousse le sachet du grain fort
et macule l’intérieur si bruta-
lement que le bison crie, monu-
ment de craie, mammouth presque
fou.
Atteint la région de semen-
ces et brûle. S’humecte l’os
principal, le rasoir, les bran-
ches et brûle la partie blême
du torse. Mouille le champ et
ses tissus. Flèche accède, de
biais, au poumon, à la housse
des flammes, et fléchit au mi-
lieu des serpents. Bisons châ-
tiés de tiges, de massues ar-
dentes manipulées dans la soie
ou dans le mica des étuis. Et
constriction à mi-corps. Héros
dévoré. Et le sperme macule le
bras armé.
EUGÈNE SAVITZKAYA, Les Couleurs de boucherie.

C’est une vaste cour rectangulaire cernée par de longs bâtiments de genre militaire. De longues tables et de longs bancs, en bois sommaire, y sont alignés. Sur les bancs, sont assis des rangées d’hommes à casquettes d’ouvrier, habillés comme pour un dimanche. Peut-être est-ce une cérémonie religieuse. Peut-être est-ce dimanche. Tout le monde est très propre, avec une mine sérieuse. J’essaie d’apercevoir le podium, dressé tout au fond, où doit être situé l’autel, mais le bord du toit m’empêche de voir plus que le pied d’une construction que je n’arrive pas à identifier. La cour se remplit d’eau. Les hommes restent assis, l’air sérieux. L’eau leur monte jusqu’aux épaules. De la main, plongée verticalement, je vérifie que l’eau continue d’arriver, je sens un courant. Personne ne s’affole. Tout le monde a l’air de trouver ça tout naturel. J’entends alors une phrase en allemand : « Zakur kui ». Je me penche vers H. : « T’as entendu ? Ils prononcent "Zakur kui" » (en zézeyant le z). Il paraît qu'on appelle ça un rêve.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 19 février 2013
O. V. DE LUBICZ MILOSZ
19 JANVIER - 19 FÉVRIER : DIDIER, UN MOIS DÉJÀ.
C'est un grenier plein de mémoire. Bourré à craquer des vestiges de vies qui nous ont précédés. A part les journaux, méticuleusement ficelés et montés en piles vagues par le grand-père, dangereusement entassées dans le coin d'un comble sur un plafond dont on ne sait rien, situé juste à droite sous le toit quand on monte, sonore, l'escalier en bois, on a le choix entre le rebut de matelas en paille vêtus de toile grossière mangés de la vermine, et le vestige des dragons de 1914, cette vareuse à boutons dorés et parements rouges. Il y a bien d'autres motifs de rêverie ou de dégoût. Entre les constructions précaires, en allumettes, édifiées par des esprits qui ont encore de l'espoir dans les beautés du monde, et la machine à coudre à pédale, redoutable de simplicité, avec sa courroie de cuir scellée par une agrafe, l'enfant fait des provisions de rêves, de souvenirs et de littérature. On accède au toit par une courte échelle vermoulue, il suffit, pour se trouver en danger, de soulever la tabatière par la longue tige métallique crantée. A égalité avec les oiseaux, on peut contempler, jusqu'aux collines brumeuses du lointain, la platitude de la vaste plaine écrasée de la B. Les tuiles, au plus fort de midi, sont brûlantes. Il faut engranger du regard plus qu'on n'en peut contenir, puis, à la cloche, retourner dans les ventres intérieurs du monstre familial.

LA MAISON DE DIDIER EST TOUT À FAIT À DROITE
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : o v de l milosz, photographie, poésie, littérature française
mardi, 22 janvier 2013
POUR DIDIER

"AVERSE", CIMETIERE DE LOYASSE, 2003
Il était bourru comme un ours. Il vivait dans sa caverne. Ses contours n’étaient pas ciselés par un orfèvre, ni découpés à la petite scie dont on fait les puzzles raffinés. Sa vie a croisé beaucoup de contrariétés trop lourdes pour un homme seul. Il a tenu bon très longtemps. Il était humain. Il comptait quelques vrais et fidèles amis. La dernière fois que je l’ai vu, il était enjoué et rieur. C’était mercredi dernier. Les contrariétés ont été les plus fortes. Il a choisi de nous quitter sans bruit. « Je veux être incinéré et répandu chez moi ». Je pleure.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 21 janvier 2013
ELIAS CANETTI ET LA GUERRE DE 14
Pensée du jour :

C'EST LE JOUR D'OUVRIR LE KIL DE ROUGE ET D'ENTAMER LE SAUCISSON (DE LYON)
« Un professeur, d’une façon générale, ne devrait épouser que ses meilleurs élèves. Après le bachot ; et non avant. Pour créer une émulation ».
ALEXANDRE VIALATTE
Je viens de lire un passage, à propos, encore et toujours, je n'y peux rien, de la guerre de 1914-1918, passage qu’il faut absolument que je partage séance tenante. Il se trouve que je suis plongé dans les Ecrits autobiographiques d’un monsieur qui a reçu le prix Nobel. L’auteur s’appelle ELIAS CANETTI. Le livre est publié à la « Pochothèque ».

En l’ouvrant, je m’attendais à trouver quelqu’un qui raconte sa vie du haut du piédestal où a été édifiée sa statue de son vivant, parce que je garde en mémoire ELIE WIESEL, autre prix Nobel (de la Paix), qui parle sur un ton qui me l’a rendu antipathique. Jusqu’au son de sa voix, son timbre et son élocution m’agacent dès que je l’entends. Le ton de quelqu’un qui s’écoute lui-même quand il parle, et qui s’adresse à lui-même des congratulations pour l’effet qu’il se produit. On dirait qu'il n'arrête pas de se prendre pour un "Prix Nobel".
Eh bien, ELIAS CANETTI, pas du tout ! Selon toute vraisemblance, ELIAS CANETTI ne s’appelle pas ELIE WIESEL, ce qui est heureux. Il faut se féliciter de ce hasard et remercier le sort qui, finalement, fait bien les choses. Et je pense que l'oeuvre écrite d'ELIAS CANETTI consiste davantage que celle d'ELIE WIESEL.
 Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas le ton de ce personnage qui se donne un tel air de sérieux quand il ouvre la bouche, puis qui parle sur le ton pontifiant de la componction propre au personnage de Tartufe dans la pièce de Molière, quand celui-ci se met à admonester et à faire la leçon autour de lui. ELIE WIESEL (ci-contre, avec sa façon de pencher la tête), a su intelligemment faire fructifier le petit capital offert par son statut de rescapé des camps de la mort. Je suis sûrement très injuste avec quelqu'un qui est devenu un icône unanimement célébrée.
Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas le ton de ce personnage qui se donne un tel air de sérieux quand il ouvre la bouche, puis qui parle sur le ton pontifiant de la componction propre au personnage de Tartufe dans la pièce de Molière, quand celui-ci se met à admonester et à faire la leçon autour de lui. ELIE WIESEL (ci-contre, avec sa façon de pencher la tête), a su intelligemment faire fructifier le petit capital offert par son statut de rescapé des camps de la mort. Je suis sûrement très injuste avec quelqu'un qui est devenu un icône unanimement célébrée.
J’ai lu La Nuit. C’est son témoignage sur ce qu’il a vécu en déportation. Le malheur veut que je l’aie lu après d’autres ouvrages sur le même sujet. A commencer, évidemment, par Si c’est un homme, de PRIMO LEVI, que j’ai reçu comme un coup à l’estomac. De lui, on connaît moins La Trêve. Eh bien on a tort. Toujours est-il que Si c’est un homme impose le respect. Alors que La Nuit me touche un peu, et m’agace davantage, sans que je sache bien pourquoi. Peut-être à cause de la façon - immodeste selon moi - d'apparaître dans les médias.
ELIE WIESEL, tout le monde lui doit le respect dû à ceux que le nazisme a voulu faire disparaître de la surface de la planète. Mais personne n’est obligé de se soumettre au magistère du haut duquel il distribue les bons et les mauvais points d’un humanisme révisé par l’Holocauste.

 Parce que, sur les camps de la mort, j’ai aussi lu CHARLOTTE DELBO. Franchement, si j’avais un choix à faire, c’est devant le souvenir de cette femme admirable que je m’inclinerais, et devant les trois petits livres publiés aux éditions de Minuit sous le titre Auschwitz et après.
Parce que, sur les camps de la mort, j’ai aussi lu CHARLOTTE DELBO. Franchement, si j’avais un choix à faire, c’est devant le souvenir de cette femme admirable que je m’inclinerais, et devant les trois petits livres publiés aux éditions de Minuit sous le titre Auschwitz et après.
Quand on a refermé le dernier, même Si c’est un homme apparaît un peu « littéraire », c’est vous dire. Je ne peux lire cinq pages d’affilée sans être parcouru de secousses violentes. Il faut lire CHARLOTTE DELBO (1913-1985, collaboratrice de LOUIS JOUVET, avant et après la guerre), dont on fête le centenaire de la naissance.
Mais j’en reviens à ELIAS CANETTI, né dans une famille juive sépharade espagnole émigrée en Bulgarie. En fait, j’avais l’intention d’écrire la présente note en réaction à un passage de La Langue sauvée, lu ce matin et, comme d’habitude, je me suis laissé distraire en route.

ELIAS CANETTI EN 1919
La scène se passe à Zurich, en 1917. Les Français et les Allemands envoient en convalescence en Suisse des officiers plus ou moins gravement blessés, après les avoir échangés contre des prisonniers. Mme CANETTI et son fils marchent dans la rue, quand ils voient s’approcher un groupe d’officiers français, « dans leurs uniformes voyants ». Ils marchent lentement, calquant leur allure sur celle des plus lents. Beaucoup s’appuient sur des béquilles.
Soudain, un groupe d’officiers allemands, pareillement blessés et béquillants, avance à leur rencontre, tout le monde marche très lentement, se réglant sur les pas des moins valides. Le garçon s’affole et se demande ce qui va se passer. Il sait que la guerre fait rage, et que sa mère rejette passionnément jusqu’à l’idée que des hommes puissent s'entretuer pour des motifs incompréhensibles. Or, avec sa mère, il se trouve au milieu des deux groupes. Que va-t-il se passer ? Vont-ils en venir aux mains ?
Non, rien ne se passe, et l'adolescent reste stupéfait : « Ils n’étaient pas crispés de haine ou de colère comme je m’y attendais. Les hommes se regardaient tranquillement, amicalement, comme si de rien n’était ; certains se saluaient. Ils avançaient beaucoup plus lentement que les autres gens et le temps qu’ils mirent à se croiser me parut une éternité. L’un des Français se retourna, brandit sa béquille vers le ciel et s’écria : « Salut ! ». Un Allemand qui l’avait entendu l’imita ; il avait lui aussi une béquille qu’il remua au-dessus de sa tête, renvoyant à l’autre son salut en français ». Voilà. C’est tout. Cela aussi, c’est la guerre de 14.
Quand la scène se termine, le jeune ELIAS voit sa mère, face à la vitrine du magasin, qui tremble et qui pleure. Elle met du temps à se ressaisir, elle si soucieuse d'habitude de ne rien laisser paraître de ses états d’âme. C'est la seule occasion où le garçon verra sa mère verser des pleurs en public. La scène est racontée aux pages 198-199 du volume.
La grande hantise des chefs militaires des deux camps était de voir leurs hommes FRATERNISER avec l'ennemi. Tout simplement inacceptable. C’est la raison pour laquelle les unités stationnées par exemple au mont Linge (crêtes des Vosges) « tournaient » rapidement : comme les « ennemis » pouvaient quasiment se serrer la main, vu l’ahurissante proximité des deux tranchées, cigarettes et boîtes de conserves ne tardaient jamais à traverser la « ligne ». Très mauvais, dans un contexte belliqueux. Quand on a vu le visage d'un homme, quand on lui a serré la main, on n'a plus envie de lui tirer dessus.

LA FLEUR AU FUSIL
TROIS FRANÇAIS ONT FRATERNISÉ AVEC UN "BOCHE" : UN SCANDALE !
Je ne sais pas si l'excellent JACQUES TARDI (C’était la guerre des tranchées, Putain de guerre !, Varlot soldat, La Fleur au fusil, La Véritable histoire du soldat inconnu) connaît ce passage d’ELIAS CANETTI. Peut-être qu'il lui ferait plaisir autant qu'il m'a fait. J’imagine que ça ne calmerait pas sa rage, au moins égale à la mienne (voir mes notes dans la catégorie "monumorts"), devant l’indicible absurdité de la catastrophe qui a presque détruit l’Europe.

LA HONTE ! C'EST UN FRANÇAIS QUI PARLE !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, humour, guerre 1914-1918, grande guerre, première guerre mondiale, élias canetti, écrits autobiographiques, prix nobel littérature, prix nobel paix, élie wiesel, camps de la mort, camps d'extermination, extermination des juifs, juif, rescapé, nazisme, la nuit, si c'est un homme, primo levi, la trêve, holocauste, shoah, charlotte delbo, auschwitz et après, aucun de nous ne reviendra, deuxième guerre mondiale, la langue sauvée, france allemagne, fraternisation, jacques tardi, c'était la guerre des tranchées, putain de guerre, la fleur au fusil, soldat inconnu, patriotisme
dimanche, 20 janvier 2013
HISTOIRE POUR ENFANTS GRANDIS
Pensée du jour :

BRACELET DE BRAS (ivoire), GURUNSI, BURKINA FASO, GHANA
« Le vent se déchaîne et la neige tombe. La tour de Pise a oscillé. Un tourbillon a emporté la gare olympique de Grenoble. Au sommet du puy de Dôme, il a fallu chercher, avec des sondes, dans cinq mètres de neige, le chasse-neige qu'on avait laissé là le matin ».
ALEXANDRE VIALATTE
Aujourd’hui, pour me détendre un peu, comme les enfants sont couchés et que ce blog se débrouille depuis longtemps pour tenir à distance les jeunes en général et les mineurs en particulier, du fait du raffinement des hautes considérations qui s’y bousculent, j’ai décidé de raconter une histoire. D'un goût évidemment excellent et distingué, comme il se doit.

Une pas vraie, comme toutes les bonnes histoires.

Enfin, comme c’est quelqu’un d’autre qui la raconte, je vais tout de suite lui laisser la parole.

Enfin, quand je dis la parole, je devrais plutôt dire le crayon.

Et l’on voit de quel « crayon » il s’agit.

Mais on n'aura pas la possibilité de le féliciter de la haute qualité de son dessin et de la haute spiritualité de son inspiration : l’auteur, « souffrant d’une modestie quasiment maladive » (GEORGES BRASSENS, Les Trompettes de la renommée) est si modeste qu’il a tenu à rester anonyme.

C’est bien dommage : on aurait aimé le saluer pour le louer de la délicatesse de ses oeuves.

J’espère qu’on appréciera la virtuosité du coup de « crayon ».

J'ATTIRE L'ATTENTION (SI BESOIN) SUR L'ALACRITÉ DES DIALOGUES
 Et j’espère qu’on goûtera à sa juste valeur l’exemple d’humanisme qui se dégage du scénario. L’art du découpage. Le sublime du message philosophique. Cela s'appelle du doux nom de Dirty comix, synonyme d'élégance morale, de raffinement intellectuel et de "délicatesse" esthétique.
Et j’espère qu’on goûtera à sa juste valeur l’exemple d’humanisme qui se dégage du scénario. L’art du découpage. Le sublime du message philosophique. Cela s'appelle du doux nom de Dirty comix, synonyme d'élégance morale, de raffinement intellectuel et de "délicatesse" esthétique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, afrique, art africain, alexandre vialatte, littérature, humour, bande dessinée, pornographie, dirty comics, éditions allia, sexe, érotisme, acte sexuel, vulgarité, art graphique
samedi, 19 janvier 2013
ODE A ANDRE FRANQUIN
Pensée du jour :

MAHONGWE, GABON
« Les villes remontent à la plus haute antiquité. Il n'y a qu'à voir la rue Broca ».
ALEXANDRE VIALATTE
 L’art de la bande dessinée ne consiste pas seulement à donner au lecteur l’impression d’être en face d’une réalité, mais d’y être transporté. Tout simplement : d’y être. L'impression de réel par l'expressivité du dessin. Un peu comme au cinéma (pas toujours, il faut bien dire). C’est d’ailleurs en cela qu’on peut dire que la bande dessinée est un art.
L’art de la bande dessinée ne consiste pas seulement à donner au lecteur l’impression d’être en face d’une réalité, mais d’y être transporté. Tout simplement : d’y être. L'impression de réel par l'expressivité du dessin. Un peu comme au cinéma (pas toujours, il faut bien dire). C’est d’ailleurs en cela qu’on peut dire que la bande dessinée est un art.
Regardez les BD japonaises, que dévorent au kilomètre les jeunes générations. Mangas, on appelle ça. Je veux bien qu’on appelle ça des produits, mais pas plus. C’est fabriqué comme l’œuf dur destiné aux cantines scolaires : à la chaîne, vous savez, ces tubes où le jaune est introduit en continu dans un habitacle de blanc, pour être, au bout, découpé en tranches où jaune et blanc sont uniformément répartis sur les tranches. En continu. Avec une armée de gens spécialisés, chacun dans son secteur : les décors, les personnages, les trames de gris ou de couleurs, etc.
générations. Mangas, on appelle ça. Je veux bien qu’on appelle ça des produits, mais pas plus. C’est fabriqué comme l’œuf dur destiné aux cantines scolaires : à la chaîne, vous savez, ces tubes où le jaune est introduit en continu dans un habitacle de blanc, pour être, au bout, découpé en tranches où jaune et blanc sont uniformément répartis sur les tranches. En continu. Avec une armée de gens spécialisés, chacun dans son secteur : les décors, les personnages, les trames de gris ou de couleurs, etc.
 D’accord, il y a un metteur en scène. Mais je comparerais ça à l’opposition traditionnelle littérature / cinéma. D’un côté la solitude du romancier. De l’autre, l’entreprise industrielle. En BD, c’est exactement pareil. A mes yeux, comme on dit au Japon : « Yapafoto »).
D’accord, il y a un metteur en scène. Mais je comparerais ça à l’opposition traditionnelle littérature / cinéma. D’un côté la solitude du romancier. De l’autre, l’entreprise industrielle. En BD, c’est exactement pareil. A mes yeux, comme on dit au Japon : « Yapafoto »).
Personnellement, je suis resté fidèle à l’artisanat d’art et à quelques-uns de ses éminents représentants. Au premier rang, je ne citerai que des « grands anciens » : GIR (alias GIRAUD, alias MOEBIUS), JACQUES TARDI, HERMANN, BILAL, pour ne parler que de ceux qui créent encore.
de ses éminents représentants. Au premier rang, je ne citerai que des « grands anciens » : GIR (alias GIRAUD, alias MOEBIUS), JACQUES TARDI, HERMANN, BILAL, pour ne parler que de ceux qui créent encore.
 Pour JEAN GIRAUD, je sais que j’ai tort, puisqu’il est mort très récemment (10 mars 2012), mais sa dernière série (Monsieur Blueberry) mérite qu’on rende hommage à son art du flash-back, à sa virtuosité dans la superposition des trames narratives et à la profondeur qui caractérise les personnages secondaires (alors que le dernier épisode de la prometteuse trilogie Marshall Blueberry a été carrément bâclé : visiblement, il voulait s’en débarrasser).
Pour JEAN GIRAUD, je sais que j’ai tort, puisqu’il est mort très récemment (10 mars 2012), mais sa dernière série (Monsieur Blueberry) mérite qu’on rende hommage à son art du flash-back, à sa virtuosité dans la superposition des trames narratives et à la profondeur qui caractérise les personnages secondaires (alors que le dernier épisode de la prometteuse trilogie Marshall Blueberry a été carrément bâclé : visiblement, il voulait s’en débarrasser).
Et puis il y a FRANQUIN. J’avais un collègue qui portait aux nues les aventures de Chevalier Ardent, le guerrier de petite noblesse, amoureux de Gwendoline, la fille du grand roi Arthus qui le lui rendait bien, mais dont le papa avait pour elle d’autres ambitions matrimoniales que de la marier avec cet obscur nobliau.
aventures de Chevalier Ardent, le guerrier de petite noblesse, amoureux de Gwendoline, la fille du grand roi Arthus qui le lui rendait bien, mais dont le papa avait pour elle d’autres ambitions matrimoniales que de la marier avec cet obscur nobliau.
 C’est sûr, il y a dans Chevalier Ardent de nobles sentiments, un "besoin de grandeur" (titre d’un ouvrage curieux de CHARLES-FERDINAND RAMUZ, où l’auteur explique les raisons de son enracinement définitif dans son canton de Vaud, en Suisse). Mais l’héroïsme a déserté depuis lurette la bande dessinée, comme il l’avait fait bien avant dans les œuvres des romanciers.
C’est sûr, il y a dans Chevalier Ardent de nobles sentiments, un "besoin de grandeur" (titre d’un ouvrage curieux de CHARLES-FERDINAND RAMUZ, où l’auteur explique les raisons de son enracinement définitif dans son canton de Vaud, en Suisse). Mais l’héroïsme a déserté depuis lurette la bande dessinée, comme il l’avait fait bien avant dans les œuvres des romanciers.
Ce qui frappe, chez FRANQUIN, c’est donc la virtuosité bluffante de son trait, qui lui permet de donner à tout ce qu’il dessine un effet magistral, une expressivité qu’on ne trouve nulle part ailleurs. La faculté inouïe de donner une vraie forme identifiable à l’idée qui lui vient, dans le moindre détail. Prenez Monsieur De Mesmaeker, dont le portrait écumant de rage (sauf en une occasion, où il signe un contrat, mais c’est avec Gaston) parsème cette note.
son trait, qui lui permet de donner à tout ce qu’il dessine un effet magistral, une expressivité qu’on ne trouve nulle part ailleurs. La faculté inouïe de donner une vraie forme identifiable à l’idée qui lui vient, dans le moindre détail. Prenez Monsieur De Mesmaeker, dont le portrait écumant de rage (sauf en une occasion, où il signe un contrat, mais c’est avec Gaston) parsème cette note.
 La marque du grand dessinateur, c’est, entre autres, sa capacité à camper un personnage immédiatement reconnaissable (silhouette, détail vestimentaire, forme de la tête, etc.). Et ce, quels que soient son geste, son attitude, sa position dans l’image. Pour qu’il reste sans cesse lui-même, il faut l’imaginer en trois dimensions, mais aussi en dessiner de multiples études. On pense au Lucky Luke de MORRIS.
La marque du grand dessinateur, c’est, entre autres, sa capacité à camper un personnage immédiatement reconnaissable (silhouette, détail vestimentaire, forme de la tête, etc.). Et ce, quels que soient son geste, son attitude, sa position dans l’image. Pour qu’il reste sans cesse lui-même, il faut l’imaginer en trois dimensions, mais aussi en dessiner de multiples études. On pense au Lucky Luke de MORRIS.
Monsieur de Mesmaeker est de ceux-là. Mais aussi, évidemment, Spirou (uniforme rouge du groom), Fantasio (tête ronde à huit cheveux absolument rebelles), Gaston (pull vert et silhouette incurvée en S), etc. Gaston est le plus grand ennemi de monsieur de Mesmaeker, l’empêcheur de signer en rond. Ce n’est pas qu’il lui veut du mal, bien au contraire.
Spirou (uniforme rouge du groom), Fantasio (tête ronde à huit cheveux absolument rebelles), Gaston (pull vert et silhouette incurvée en S), etc. Gaston est le plus grand ennemi de monsieur de Mesmaeker, l’empêcheur de signer en rond. Ce n’est pas qu’il lui veut du mal, bien au contraire.
 Le génie de FRANQUIN est aussi d’avoir défini des forces antagonistes, résolument irréconciliables, comme source inépuisable de situations : Gaston et la vie de bureau, Gaston et l’ordre établi (Longtarin), Gaston et le monde des affaires, (...). Entre Gaston et Moiselle Jeanne, ce n’est évidemment pas de l’antagonisme. J’ai même eu sous les yeux une planche où FRANQUIN se lâchait, et où le garçon et la secrétaire folle de lui passent enfin à l’acte « dans les positions les plus pornographiques » (BRASSENS, Trompettes de la renommée). Pas dans Spirou, bien sûr.
Le génie de FRANQUIN est aussi d’avoir défini des forces antagonistes, résolument irréconciliables, comme source inépuisable de situations : Gaston et la vie de bureau, Gaston et l’ordre établi (Longtarin), Gaston et le monde des affaires, (...). Entre Gaston et Moiselle Jeanne, ce n’est évidemment pas de l’antagonisme. J’ai même eu sous les yeux une planche où FRANQUIN se lâchait, et où le garçon et la secrétaire folle de lui passent enfin à l’acte « dans les positions les plus pornographiques » (BRASSENS, Trompettes de la renommée). Pas dans Spirou, bien sûr.

Bref, ce n’est que de la bande dessinée ! Mais dans le genre, ANDRÉ FRANQUIN, on peut dire qu’il a du génie.
Voilà ce que je dis, moi.
PS : pour les amateurs, je joins un extrait de pastiche de Gaston par l'excellent ROGER BRUNEL, où les contrats avec De Mesmaeker se trouvent perforés par l'ardeur déployée par notre héros pour Moiselle Jeanne.

Ce n'est ni du français, ni du pataouète, mais s'il n'y a pas le sous-titrage, il y a au moins l'image. Ceci étant dit pour annoncer la note de demain. « Enfants voici les boeufs qui passent, cachez vos rouges tabliers ». Attention les yeux !
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, humour, andré franquin, bande dessinée, gaston lagaffe, journal spirou, bd, bd japonaise, mangas, gir, giraud, moebius, tardi, hermann, bilal, blueberry, chevalier ardent, craenhals, héros, héroïsme, georges brassens
vendredi, 18 janvier 2013
ODE AU GAFFOPHONE
Pensée du jour :

ASTANIHKYI, "COME SINGING", COMANCHE, PAR EDWARD S. CURTIS
(je salue le dernier Indien à apparaître dans cette série de photos)
« Le kangourou date de la plus haute antiquité. Scientifiquement, il se compose, comme l’Auvergnat, de la tête, du tronc et des membres ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : nous avions laissé Gaston Lagaffe au moment où il vient d’inventer le bien nommé GAFFOPHONE.
 Cet extraordinaire instrument mérite qu’on lui consacre quelques instants. Pour le créer, FRANQUIN s’est inspiré d’une harpe africaine exposée en Belgique. Quant à l’entourage de Gaston, il peut s’attendre aux pires catastrophes, dès l’instant où passe, dans son esprit le démon qu’on appelle une IDÉE.
Cet extraordinaire instrument mérite qu’on lui consacre quelques instants. Pour le créer, FRANQUIN s’est inspiré d’une harpe africaine exposée en Belgique. Quant à l’entourage de Gaston, il peut s’attendre aux pires catastrophes, dès l’instant où passe, dans son esprit le démon qu’on appelle une IDÉE.

Le gaffophone sort en droite ligne de ce genre d’instant privilégié. En s’inspirant d’un instrument africain, qu’il a néanmoins « perfectionné » (« au secours », disent déjà les voisins), il arrive à créer, sans amplification électrique : « Une vibration du tonnerre avec une résonance maximum ». Autant dire qu’il n’y a pas besoin d’attendre le deuxième essai pour obtenir un coup de maître concluant, dépassant même les espérances. Disons que FRANQUIN a fait inventer par Gaston un « instrument de destruction massive ».
 Peut-être même a-t-il regretté qu'il n'existât pas dans la réalité, car Spirou lança, auprès de ses lecteurs, un concours de fabrication concrète d’instruments. Résultat : un Néerlandais envoya au journal, par le train, un engin de 125 kilos. Ce ne fut pas le seul. Pour dire son incroyable audience, mais aussi l’incroyable popularité acquise rapidement par le personnage tout à fait génial d’ANDRÉ FRANQUIN, à qui il arrive de faire du gaffophone une arme antimilitariste : il n’aime guère l’armée, semble-t-il.
Peut-être même a-t-il regretté qu'il n'existât pas dans la réalité, car Spirou lança, auprès de ses lecteurs, un concours de fabrication concrète d’instruments. Résultat : un Néerlandais envoya au journal, par le train, un engin de 125 kilos. Ce ne fut pas le seul. Pour dire son incroyable audience, mais aussi l’incroyable popularité acquise rapidement par le personnage tout à fait génial d’ANDRÉ FRANQUIN, à qui il arrive de faire du gaffophone une arme antimilitariste : il n’aime guère l’armée, semble-t-il.

Mais tout arrive, y compris l’inimaginable : le gaffophone peut rendre service. D’accord, c’est tout à fait involontaire de la part de Gaston, mais le résultat est là, rapide, soigné, gratuit : le client est ravi, et l’ouvrier récalcitrant n’y comprend rien. Gaston est passé pas loin.

MIEUX QUE LES ARTIFICIERS SUR LES GRANDES BARRES DE LA DUCHÈRE
La règle est tout de même, en général, le gros dégât, sinon ça ne vaudrait pas le coup. Qu’il sévisse au journal ou à la campagne, les effets sont garantis : si le son fait fuir les taupes chez le voisin, comme s’en réjouit le paysan, il ne limite pas ses effets aux taupes.

Il est évident que le personnel de bureau fait tout pour se débarrasser de l’instrument, mais rien à faire. Que Lebrac introduise des termites à l’intérieur, c’est tout l’immeuble qui menace de s’effondrer, bouffé par les bestioles qui n’ont pas voulu du bois musical.

L'EXPRESSIVITÉ DU TRAIT ABSOLUMENT VIRTUOSE DE FRANQUIN EST EVIDEMMENT UN DES FACTEURS ESSENTIELS DE L'EFFET PRODUIT
Que Fantasio fasse venir des déménageurs pour obliger Gaston à débarrasser l'immeuble Spirou, quitte à faire un cadeau au musée de l’homme, c’est d’abord susciter la curiosité amusée de ceux-ci, qui voudraient bien savoir ce que c’est, c’est ensuite faire prendre au camion de très gros risques, comme il aurait dû s’y attendre. Voici ce qui lui arrive, au camion.

Quand arrive la 600ème planche, je veux dire la 600ème gaffe, toute l’équipe décide de fêter la rondeur du nombre atteint. MAIS Gaston ne s’en offusque qu’un court instant. ET décide de participer à sa façon à la fête, et de lui donner un certain « retentissement ». Pour l’occasion, avec ses complices Bertrand et Jules-de-chez-Smith-en-face, il décide d’électrifier les instruments de leur orchestre. Gaston, qu’on se le dise, n’est jamais à court de ressources.

Je réserve pour la fin la planche 467, qui démontre, d’une certaine manière, le caractère intouchable du gaffophone, j’allais dire sa valeur SACRÉE. Et si Fantasio m’avait demandé mon avis, je lui aurais volontiers dit, comme EDITH PIAF disant à Manuel de ne pas y aller (N’y va pas, Manuel) : « N’y va pas, Fantasio ! ».

Et une fois la démonstration faite, j’aurais ajouté : « Je te l’avais bien dit, de pas y aller ! ».

ADMIREZ L'ART DU MONTAGE DES DIALOGUES.
L'ART DE L'ELLIPSE AUSSI.
Je compte ANDRÉ FRANQUIN parmi les bienfaiteurs de l’humanité, pour avoir inventé un personnage aussi inassimilable que celui qu’avait imaginé HERMAN MELVILLE en écrivant Bartleby (vous savez : « I would prefer not to »). Mais comme son versant ensoleillé, un versant éminemment jovial, positif et sociable. Exactement le contraire de ce personnage sombre, négatif et suicidaire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, chroniques de la montagne, humour, bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, gaffophone, musique, fantaisie, antimilitariste, sacré, édith piaf, journal spirou, spirou et fantasio, herman melville, bartleby, i would prefer not to
jeudi, 17 janvier 2013
POUR UNE POIGNEE DE SABLE EN FEU
Pensée du jour :
« Le malheur est un marche-pied [sic] pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l’homme habile, pour les faibles un abîme ».
HONORÉ DE BALZAC
Alors, fallait-y y aller, fallait-y pas y aller ? Où ça ? Comment ? De quoi ? Ben les Rafales, les bombes, la France à l’assaut de ses anciennes colonies ! La guerre, quoi ! Fallait-il, une fois de plus, endosser l'uniforme du justicier et du redresseur de torts, du défenseur de la veuve et de l'orphelin ? S'occuper des affaires des autres ? Ils ont appelé l'opération du nom d'un charmant félin, le SERVAL, qui, paraît-il et dans les temps anciens, fut un compagnon de chasse de l'homme (je crois ce qu'on me dit, moi, je fais confiance, vous pouvez pas savoir).
Alors, fallait-il que le président de la France, FRANÇOIS HOLLANDE, décidât que la France entrât en guerre ? Personnellement, j’ai tendance à penser qu'oui (l'apostrophe, c'est juste pour éliminer l'hiatus - et non pas "le" hiatus, comme disent les étourdis et les ignorants). Pour la raison simple que, certes, ce sont les affaires des autres, mais pas complètement quand même, à cause, par exemple, de l'importance de la communauté malienne en France. Eh oui, l'industrie a eu besoin des bras maliens. Faut assumer.
Si, face à la pétaudière géopolitique que constitue la Syrie, rien ne semble bouger, en revanche, face à la main de fer que quelques centaines de gangsters, de sadiques et, pour tout dire, de FASCISTES ont abattue sur les populations du nord du Mali, il fallait donc agir sans attendre qu’ils se fussent implantés à demeure et qu’ils eussent étendu la surface de leur conquête à l'ensemble du Mali. Et plus, si affinités, comme on dit. Pour la France, c'est d'une certaine manière de l'autodéfense.
Que ces fascistes soient aussi musulmans n’y change rien, et en plus il est permis d’en douter fortement : des salafistes tunisiens n’ont-ils pas fait brûler le sanctuaire soufi (la tendance mystique et pacifique de l’Islam, s'il en est) de Sidi Bou Saïd, avec les Corans qui y étaient. Des musulmans qui brûlent le Coran ? Voilà un scoop, coco. Fascistes j’ai dit, fascistes je maintiens. Et des bandits par-dessus le marché, dont le projet est, à travers le Sahara, la construction d'une autoroute de la drogue à destination de l'Europe. Coupeurs de mains pour compléter la panoplie et soigner l'image médiatique.
Parmi eux figurent d’ailleurs peut-être des Toubous tchadiens, les anciens mercenaires sur lesquels KHADAFI faisait pleuvoir l'or de son pétrole. Il y avait en tout cas beaucoup de Touaregs qui, une fois le mécène tué atrocement (= lynché sans procès), sont rentrés chez eux (façon de parler, ils sont nomades, nous dit-on), en emportant tout un tas de lance-missiles perfectionnés qu'ils avaient appris à manœuvrer.
Remarquez, KHADAFI est mort, mais l'argent continue à affluer dans les caisses des salafistes pour qui l'Arabie saoudite est le paradis sur terre, mais qui, au passage, ne peuvent pas encadrer les Frères musulmans. Et on nous raconte que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont nos alliés ?
En tout cas, on leur achète tellement de pétrole qu'ils peuvent tout se permettre : acheter le PSG ou des hôtels particuliers du XVIIIè à Paris, et donner aux salafistes et autres djihadistes assez d'argent pour former des armées anti-occidentales. Heureusement, tous sont des sunnites, et s'entendent pour vouloir exterminer ces salopards de chiites et leurs cousins alaouites. On prend les paris sur ce qui va se passer entre eux, quand ils auront eu la peau d'ASSAD, en Syrie ?
Les Toubous du Tchad et les Touaregs de nulle part et de partout croient-ils seulement en quelque chose d’autre que l’argent ? C'est quoi au juste, ce fantasme des « droits des peuples à disposer d'eux-mêmes », au moment où la cocaïne des cartels de Colombie et d'ailleurs nous arrive à travers le Sahara ? Au nom du « droit à l'autodétermination », sans doute ?
Je pose juste la question. Reste que couper des mains et brûler des sanctuaires est le fait d'une petite bande de "tableraseurs du passé", qui me semblent autrement dangereux que les "sans-culotte" de 1793, qui n'avaient au moins dans le collimateur que tout ce qui déparait la sacro-sainte égalité. Les bandits fascistes du Sahel, eux, sèment leur bon plaisir et leur mafia partout où ils font le malheur des autres en débarquant dans leur existence. Et tout ça, grâce à la guerre en Libye.
Les LE PEN, à côté, c’est du pipi de chat et de la roupie de sansonnet, et quand on compare, ça fait même étrange de les entendre traiter de « fachos ». Ils n’ont pas encore coupé de mains, eux. LE PEN en Algérie ? Certes, mais il n’a rien fait d’autre que ce qu’ont fait les AUSSARESSE, BIGEARD, MASSU et compagnie. Je le dis d’autant plus volontiers que je ne suis pas près de voter pour MARINE. Il ne faut pas confondre fascisme et "créneau porteur".
Bref. Personnellement, je suis aussi assez favorable à l’entreprise au Mali, parce que j’ai entendu un général déclarer sérieusement que l’opération n’était que la 2ème phase de ce qui avait été commencé en Lybie par un certain … NICOLAS SARKOZY. Car ce qui est prouvé, c’est que la catastrophe malienne découle directement de la décision va-t-en-guerre de NICOLAS SARKOZY, inspiré par son « Père Joseph » nommé BERNARD-HENRI LÉVY, de tuer le Colonel KHADAFI.
Les charmants garçons d'AQMI (ex-GSPC), du MUJAO et d'Ansar Eddine ne sont que des ingrats : ils devraient savoir gré à NICOLAS SARKOZY de leur avoir ouvert en grand les portes des arsenaux pléthoriques et superbement garnis de MUHAMMAR KHADAFI.
Digne successeur de son prédécesseur, FRANÇOIS HOLLANDE prend bien soin de placer ses pieds dans les traces laissées par ceux du gars à qui il sortait, en plein débat préélectoral : « Moi, président de la République, … Moi, président … ». Mais pour être honnête, il faut dire que HOLLANDE a été obligé de prendre sa décision d’intervenir à cause de la situation créée par l’irréflexion congénitale propre à SARKO, et par son besoin souverain de faire du spectaculaire (dictature du 20 heures de TF1).
« Le changement c’est maintenant », qu’il disait. Remarquez, SARKOZY nous avait déjà fait le coup de la « rupture » en 2007. Et en fait de « rompre », il avait surtout « cassé » (l’hôpital, l’école, la justice, la police, …). Ah c’est sûr, HOLLANDE prend bien soin de ne rien casser. Moi dans mon coin, j’avais déjà pensé qu’il ne « cassait rien » (comme on dit vulgairement), HOLLANDE. Et pourtant si : il a envoyé l’armée « casser du nègre et du bougnoule », comme on disait joliment, du temps de la « coloniale ».
Surtout, il prend soin de ne rien casser de ce qu’a fait le prédécesseur, NICOLAS SARKOZY. C’est sûr qu’il veille à ce que les ruines laissées par lui restent en l’état, aussi propres et nettes qu’il les a trouvées en entrant dans les « lieux » (si vous voyez ce que je veux dire). Rien n'est plus seyant que de belles ruines bien entretenues. Voyez Pompéi.
Reste que les frontières dessinées par les colonisateurs de l’Afrique avant leur départ relèvent la plupart du temps de la plus haute fantaisie. Cela vient en grande partie, ai-je cru comprendre, du fait que ce sont des officiers de l’infanterie terrestre qui ont manié le crayon. Alors que les frontières tracées sur les cartes, mettons, en Asie du Sud-Est, l’ont été par des officiers de marine, et que sur le plan ethnique, en gros, ces frontières ont du sens (idée de l'immense géographe YVES LACOSTE). Pas celles des pays du Sahara.
Le marin, il a un peu étudié le terrain, il a vu les populations dont il a fumé l’opium, il agit avec un certain tact et une certaine subtilité. Le biffin, lui, il carbure à l'alcool, il ne se tracasse pas, il prend une grande règle et c’est parti pour tracer de beaux traits bien rectilignes. Ça y est, vous avez un Etat. Ben non, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Un Etat, avec tous ses attributs, pour que ça ait une cohérence, il faut procéder autrement. Les seuls traits qui aient un peu de sens, là, sont ceux qui suivent le tracé des fleuves. Et encore : quels fleuves ?
A cet égard, de la Mauritanie au Soudan (c'est-à-dire de l’Atlantique à la Mer Rouge), en passant par le Mali, le Niger et le Tchad, ainsi que par le sud de l’Algérie, de la Lybie et de l’Egypte, l’arbitraire des tracés relèverait du registre le plus comique si, dans la réalité, ceux-ci n’étaient pas de pures fictions. Je crois rêver quand j’entends un journaliste déclarer doctement que « l’Algérie va fermer ses frontières ». Il sait ce que c'est, une frontière de 1400 kilomètres ? Dans le désert ? C’est ce qui s’appelle avoir le sens des réalités. Oui : des réalités virtuelles. Voilà ce que c'est quand on joue trop à la console.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, honoré de balzac, littérature, france, langue française, guerre mali, al qaïda, terrorisme, sahel, aqmi, mujao, ansar eddine, gspc, guerre, françois hollande, nicolas sarkozy, fascistes, musulmans, islam, bamako, opération serval, bernard-henri lévy, bhl, khadafi, lybie, parti socialiste, niger, tchad, sahara, algérie, otages, mokhtar belmokhtar
mercredi, 16 janvier 2013
ELOGE D'HENRI BERGSON 2
Pensée du jour :

PAWNEE, par EDWARD S. CURTIS
« Quand un auteur est ennuyeux, c’est pour longtemps ».
ALEXANDRE VIALATTE
Alors, vous me direz, qu’est-ce qui me restera de cette lecture studieuse, et parfois, je peux l’avouer, laborieuse ? D’abord que BERGSON n’aime pas ZÉNON D’ELÉE, mais alors vraiment pas. Enfin, pas la personne, même pas le philosophe (480-420 avant JC). Juste ses paradoxes. Un certain PAUL VALÉRY les a popularisés dans un poème célèbre. Enfin, quand je dis popularisé … Le poème ? C’est Le Cimetière marin, pour vous dire. C’est moins populaire que le dernier « slam » du déplorable ABD AL MALIK, j’en conviens. La strophe se situe vers la fin.
« Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Elée !
M’as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !
Le son m’enfante et la flèche me tue !
Ah ! le soleil … Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas ! »
Je résume : la flèche n’atteint jamais quoi que ce soit, puisqu’elle franchit la moitié de la distance qui la sépare de son but, puis la moitié de la moitié, puis le quart, etc. En sorte qu’il reste toujours un chouïa à franchir. Je crois qu’en math, on appelle ça une « asymptote », sauf que là c’est quasiment en ligne droite. Sauf que la flèche, elle atteint quand même son but, malgré ZÉNON. Comme Achille, à qui il arrive le même tracas, face à la tortue qui avance à côté de lui : il arrive quand même avant elle. Malgré ZÉNON.

C'ÉTAIT L'ÉDITION DU CENTENAIRE (1959)
Bref, pour BERGSON, ZÉNON se paie de mots. Il déplace toute la réalité dans un pur jeu de langage, du coup, il peut en faire ce qu’il veut, de la réalité. Car ce qui préoccupe HENRI BERGSON, c’est l’authenticité du rapport de la philosophie avec la vie. Mais attention : avec la vie en train de vivre, au moment où elle surgit. Enfin, plus précisément, au moment précis où le curseur du temps est posé sur le point nommé « présent ». Elle est là, son obsession.
Comment la philosophie peut-elle rendre compte du temps en train de passer ? De garder le processus de l’écoulement sans en faire une chose ? Et me revient sa définition du comique, dans Le Rire (1900) : « Du mécanique plaqué sur du vivant ». La même obsession. C’est ce qu’il « reproche » à la science, qui ne peut, sous son microscope et dans ses éprouvettes, observer que des choses, jamais des processus. Oui, comment penser le vivant sans en faire une chose morte ?
Ce que j’admire, dans la philosophie d’HENRI BERGSON ? Très simple : sa préoccupation centrale de ne pas chosifier ce qui respire, ce qui circule, ce qui éprouve. De ne pas immobiliser ce qui bouge, simplement pour le mettre sous un microscope. Finalement, d’après lui, qu’est-ce qui est humain dans l’humain ?
Deux choses : la conscience (c'est son terme) et le cœur qui bat (il ne le dit pas comme ça). Sachant que pour lui, la conscience, c’est quoi ? Si j’ai bien compris, c’est une échelle. L’instinct qui pousse l’abeille et la fourmi à former société constitue un état (rudimentaire) de conscience. L’instinct qui pousse l’humanité sur la voie de l’intelligence, c’est-à-dire, pour BERGSON, de la science. La conscience n’est pas un monopole humain, ni le cœur qui bat.
Ce qui est drôle (attention : façon de parler), c’est qu’il va au plus profond, par exemple, du fonctionnement de l’œil, du protozoaire à l’homme. Il ne laisse rien passer, entre dans les moindres détails pour différencier les corps élémentaires et les organismes complexes, dans les moyens qu’ils ont développés pour percevoir leur environnement.
Avec cette conclusion (je crois) : un organe comme l’œil humain peut s’être développé d’une façon monstrueusement complexe, que la science peut découper en autant de segments qu’elle voudra (jusqu’à l’infini) pour en reconstituer le fonctionnement, rien ne saurait expliquer l’immédiateté de la fonction de voir, qui va droit au but. L’organe pourra être aussi compliqué qu’il veut : pas la fonction.
Si vous voulez, je comparerai son idée avec le gamin qui veut savoir ce qu'il y a dans le réveil (je parle des anciens réveils, les purement mécaniques) : il va le dévisser, le réduire en d'innombrables pièces détachées, mais ce qui est clair alors, c'est que le réveil ne donnera plus l'heure.
D'où sa "haine" de ZÉNON D'ÉLÉE, le décomposeur en chef et, au fond, précurseur de la science. Il ne faut pas confondre, dit BERGSON, comme semble le faire ZÉNON, l'accomplissement de la trajectoire par la flèche qui atteint son but et la représentation que l'observateur en dessine sur le papier, sous la forme d'une ligne qu'il pourra dès lors diviser, s'il veut, en une infinité de morceaux qu'il scrutera sous toute les coutures. Dans la réalité, la ligne n'existe pas.
Dit autrement, à propos de l'oeil humain, les milliards d’opérations effectuées par la nature, depuis les temps originaires (quelques millions d’années), pour arriver à l’organe de la vision qui est le nôtre, construisent une complexité de nature infinie, mais aboutissent à une opération d’une simplicité miraculeuse, qui s’appelle VOIR, aussitôt que l’homme ouvre l’œil. Je pense aux réflexions du personnage de Zénon (tiens donc !), dans L’œuvre au noir, de MARGUERITE YOURCENAR, sur la fonction de « cuisson » dévolue au système digestif humain.
Je reviendrai prochainement à HENRI BERGSON, mais pas tout de suite.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, humour, henri bergson, philosophie, essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, l'évolution créatrice, les deux sources de la morale et de la religion, paul valéry, zénon d'élée, paradoxe, le cimetière marin, poésie, le rire, l'oeuvre au noir, marguerite yourcenar, philosophie des sciences, épistémologie
mardi, 15 janvier 2013
ELOGE D'HENRI BERGSON 1
Pensée du jour :
« La brute se couvre, le riche ou le sot se pare, l’homme élégant s’habille », Traité de la vie élégante.
HONORÉ DE BALZAC
Ce n'est pas pour me vanter, mais je viens d’achever la lecture des œuvres d’HENRI BERGSON. Drôle d’idée, non ? Remarquez, on me dira que la tâche est loin d’être insurmontable. D’abord parce que ces « œuvres » ne sont pas si nombreuses que ça. C’est tout à fait vrai. Quatre livres, en tout et pour tout, ça reste à hauteur d’homme. Je ne parle pas des deux recueils d’articles, du petit bouquin intitulé Le Rire, des Ecrits et paroles, et de divers papiers plus récemment publiés.
Je me suis limité aux quatre piliers du temple bergsonien : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), L’Evolution créatrice (1907), Les Deux sources de la morale et de la religion (1932). Un peu moins de mille pages. J'avais acheté (45 francs, si je me souviens bien) le volume chez le libraire du péristyle de l'opéra quand j'étais en classe de première. Oui, il ne faut jamais désespérer.
Oui, ça n’a l’air de rien, je sais. Encore faut-il s’y mettre, et puis s’y cramponner. Les trois premiers livres (augmentés de toutes les activités annexes) suffisent, en 1927, à lui faire attribuer le prix Nobel, même si c’est celui de littérature (révélateur, d'un certain point de vue).
Résultat des courses ? D’abord une impression curieuse : BERGSON écrit dans un français absolument parfait (en plus, absolument accessible et dépourvu de jargon) une philosophie qui exige une attention soutenue, pour ne pas dire un important effort de contention. N’a-t-il pas déclaré un jour : « Il faut avoir poussé jusqu’au bout la décomposition de ce qu’on a dans l’esprit, pour arriver à s’exprimer en termes simples », c’est-à-dire, comme PASCAL, DESCARTES ou ROUSSEAU, dans « la langue de toute le monde ». Voilà un philosophe qu'il est bon !
Voyez plutôt les dernières lignes de son dernier grand livre (1932) : « L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle. A elle de voir si elle veut continuer à vivre. A elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l’effort nécessaire pour que s’accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l’univers, qui est une machine à faire des dieux ». Prémonitoire ou carrément utopique ?
Il a eu le temps d’écrire, juste avant, cette phrase merveilleuse, au sujet du « monde inconnu » qu’il appelle de ses vœux : « Le plaisir serait éclipsé par la joie ». Considérons cela comme le point d’orgue de l’œuvre du philosophe. Mort en 1941, il a eu le temps de voir venir l’horreur sur ses tout vieux jours. Pas celle de la bombe atomique. C’est déjà ça.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’épastrouille, ces phrases. Cette force. Pour clore son œuvre sur de pareilles considérations, il faut être soit devenu sénile (en 1932, il a 73 ans), soit resté complètement culotté, tout comme un jeune con. Pour quelqu’un qui prend ça direct en face, ça peut sembler du n’importe quoi.
Pour quelqu’un qui referme le bouquin là-dessus, ça fait un effet incroyable, même si, la nuit et dans le brouillard, ça vous a un arrière-goût du fossile EDGAR MORIN, vous savez, le boursoufleur d’idées générales, le gonfleur de baudruches conceptuelles globalisantes et creuses.
Certains riront de mon pléonasme, toute globalisation abusive étant forcément creuse : « On ne saurait remplir du tout avec du rien » (je cite de mémoire et en substance). Quand je conduisais l’attelage de bœufs du père PIC, ce qu’il me disait là, c’était l’évidence. Et ça l’est restée. Il reste qu’EDGAR MORIN aura mouliné beaucoup de vent. Et « gonflé » beaucoup d’auditeurs. J’espère. Peut-être à tort.
BERGSON, contrairement à MORIN, ne dit jamais qu’il est en train de dire le sens du monde. Certes, dans son dernier livre, il se laisse aller à une exaltation, à un optimisme au sujet de l’avenir humain. Mais d’après ce que j’en ai compris, HENRI BERGSON ne brasse jamais du vent. Mais c'est un philosophe, lui. C’est peut-être pour ça qu’il ne passe jamais à la télé.
Ah, on me dit qu’il est mort en 1941. Soit. D’ailleurs, il aurait peut-être aimé les plateaux de TF1 : les « belles dames » à la mode se bousculaient à ses cours au Collège de France, et ce ne sont pas les dignités et responsabilités internationales qui l’ont effarouché ou fait fuir. Il avait une « cause » à défendre : ne fait-il pas l’éloge de la Société des Nations (SDN, ancêtre de l’ONU) à la fin des Deux Sources … ?
Je crains qu’HENRI BERGSON, en effet, n’ait appartenu au camp des increvables optimistes.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, honoré de balzac, littérature, henri bergson, philosophie, essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, l'évolution créatrice, les deux sources de la morale et de la religion, prix nobel de littérature, langue française, france, edgar morin, sdn, onu, collège de france
lundi, 14 janvier 2013
ODE A GASTON
Pensée du jour :
« Nous n’avons plus le sens du pompeux. Sans quoi, comme je le faisais remarquer si justement dans ma dernière chronique, nous ferions de notre sous-préfet, tels les Mossi de la Haute-Volta, le héros d’un grand psychodrame destiné, tous les vendredis, à l’empêcher de partir pour la guerre, et qui se jouerait devant la sous-préfecture. Rien ne serait plus majestueux. Mais nous n’avons plus le sens de la cérémonie ».
ALEXANDRE VIALATTE
Un des plus beaux héros de bande dessinée qui furent un jour inventés est, à n’en pas douter, l’énorme, l’immense, le démesuré GASTON LAGAFFE. Un personnage créé par ANDRÉ FRANQUIN, qui, après une entrée quasi-clandestine, illumina progressivement la revue Spirou de son aura au rayonnement éblouissant, à partir du 28 février 1957.
Je ne vais pas refaire après tant d’autres l’éloge de Gaston Lagaffe. On ne peut plus dire du bien de Gaston Lagaffe. Je le dis clairement : il est désormais impossible d’ajouter quelque fétu que ce soit à la meule, que dis-je, à la montagne des hommages. Le fétu serait perdu comme l’aiguille dans la botte de foin.
Je ne viens pas au secours d’une ambulance. Je viens ici déposer mon gravier au pied du monument, comme j’ai vu les mots hâtifs tracés sur des bouts de papier lestés d’un petit caillou couronnant en majesté la belle tombe, toujours pieusement et nombreusement visitée, du poète espagnol ANTONIO MACHADO à Collioure.
Gaston, on me dira ce qu’on voudra, au bout de trois planches, il me dilate déjà les viscères, au bout de cinq (j’aime les nombres impairs), je suis plié en deux (zut, c'est un nombre pair). Au bout de sept, je n’en peux plus, je demande grâce. La première vertu zygomatique de Gaston est dans l'ingéniosité qu'il met en oeuvre pour aboutir à la SIESTE. La deuxième vertu de Gaston est dans la GAFFE, bien évidemment. La troisième vertu de Gaston est l’INVENTION, si possible improbable. Les vertus 2 et 3 découlent souvent l’une de l’autre.
Qu’on se le dise : le rêve de tout homme honnête avec lui-même est dans l’inaction consécutive à la décision de faire une bonne sieste. La sieste, en plus d'être une soustraction aux activités du monde, est un désordre. Gaston y est comme un poisson dans l’eau.
Et comme un grain de sable dans la machine productive, qu’il fasse un reportage au zoo ou qu’il fasse rissoler on ne sait pas bien quoi (peut-être des sardines à la confiture de fraise) au fond d’une caverne creusée au cœur des archives de Spirou, en compagnie de son transistor, de son chat et de sa mouette rieuse, dans l’harmonie parfaitement régressive d’un ventre maternel d’un nouveau genre.
Le grain de sable agit en général seul, car c’est son seul esprit qui prend l’initiative des catastrophes, mais FRANQUIN ne rechigne pas à l’assortir de divers complices. Je viens d’en citer deux, mais il y a aussi Jules-de-chez-Smith-en-face et Bertrand qui viennent prêter leur savoir-faire en la matière. A eux cinq, ils représentent à peu près la puissance de feu du porte-avions Enterprise, fleuron de l’US Navy.
Autour de notre grain de sable explosif, une pléiade de personnages dansent une sarabande endiablée. D’abord ceux qui se définissent comme « hors-Spirou », au premier rang desquels l’agent Longtarin (sujet principal : une voiture improbable, jaune et noire) et M. de Mesmaeker (sujet principal : des « contrats » qui resteront à jamais jamais signés). Les avanies que leur fait subir Gaston (jamais dans une mauvaise intention, notez-le) ne se comptent plus.
Plus en retrait, les talents de Gaston s’exercent aux dépens de l’armée, dont les scrogneugneus sont toujours présentés de façon à ce que les dégâts qu'il leur occasionne apparaissent comme une manifestation de la justice immanente. Mais on voit aussi son ingéniosité à l’œuvre quand il va à la campagne ou à la plage (pauvres lapins, quand même !).
Quant à l’équipe de Spirou, qui constitue le centre des principales victimes des bonnes intentions de Gaston, on s’intéressera en priorité à Fantasio, Prunelle, Lebrac, Bertje, Monsieur Boulier, quelques autres, plus intermittents (la femme de ménage aux prises avec la mallette antivol imaginée par notre héros). Je situe à part Moiselle Jeanne, qui en pince méchamment pour notre anarchiste à tout faire. Le champ d’épandage des gaffes semble, sous le crayon d’ANDRÉ FRANQUIN, extensible à l’infini.
L’invention, chez Gaston Lagaffe, est permanente, tous azimuts et portée à incandescence. Au premier plan de la photo des créations catastrophiques de notre garçon de bureau préféré, j’ai tendance à placer un instrument de musique, encore qu’on ne sache pas très bien, au sujet de ce qui sort du dit instrument, s’il s’agit de musique ou d’un tremblement de terre. Les amateurs ont déjà reconnu le GAFFOPHONE.
Un instrument naturel qui fait des dégâts démesurés par rapport à ses capacités physiques. Gaston a inventé le seul instrument exponentiel au monde. Mais le personnage lui-même est exponentiel. Il s'appelle GASTON LAGAFFE.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, apsaroke, alexandre vialatte, littérature, chroniques de la montagne, humour, bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, journal spirou, l'art de la sieste, gaffeur, antonio machado, poète, poésie, collioure
dimanche, 13 janvier 2013
VERS L'ANDROGYNIE TRIOMPHANTE !
Pensée du jour :

GUERRIER CHEYENNE, par EDWARD S. CURTIS
« Avant de revenir à la littérature, aux pièces, aux films dont l’homme a si inextricablement encombré le mois de janvier qu’une chatte n’y retrouverait pas ses petits, il sied peut-être de le considérer encore un peu à l’état pur, tel qu’il sortit de la main de Dieu. L’homme le voit venir avec tant de joie qu’il tombe pour l’accueillir dans mille extravagances. Il se répand en gestes arbitraires. Roseau pensant, il se conduit au premier de l’an comme un roseau qui ne penserait pas ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : les homosexuels vont pouvoir se marier. La messe est donc dite. Je finissais sur diverses considérations touchant la bague au doigt et sur l'histoire, racontée par RABELAIS, puis reprise par LA FONTAINE, de Hans Carvel, qui n'a d'autre solution, pour s'assurer de la fidélité de sa femme, que de faire du sexe de celle-ci un anneau permanent. Le Ciel en soit loué, nous ne vivons plus dans l'ère préhistorique de l'hétérosexualité monopolistique et triomphante.

OÙ SE PORTE LA MAIN DE HANS CARVEL, POUSSEE PAR LE DIABLE ?
Car ces temps obscurantistes seront très bientôt balayés. Pour le plus grand bénéfice de la société, nous dit-on. « La France est rance, la France est en retard », nous serine la propagande homosexuelle à longueur de médias, enjoignant à l’ensemble de la population, qui n’en peut mais, d’enfourcher ce nouveau dada de la modernité. « Regardez, même la très catholique Espagne s’y est mise », entend-on.
Hier matin, dans l'émission Répliques, d'ALAIN FINKIELKRAUT, il faut avoir entendu le ton méprisant d'évidence péremptoire de madame IRÈNE THÉRY, qui ne cessait de couper la parole à ses deux interlocuteurs, sur le mode : « Mais voyons, vous n'y êtes pas, a-t-on idée ? » sans doute du haut de l'autorité de la science qu'elle professe (la sociologie, si j'ai bien compris).
C’est donc l’ÉGALITÉ républicaine qui se trouve aujourd’hui convoquée devant le tribunal parlementaire. Passons sur la nouvelle confiscation de valeur que constitue cet abus de langage. Passons sur le fait que les personnes concernées représentent une minorité de la « communauté » homosexuelle (puisque communauté il y a, paraît-il). Je connais un certain nombre d'homos à qui la simple idée de "se marier" apparaît tout à fait farfelue, pour ne pas dire ridicule.
Passons aussi sur l'incroyable chamboulement symbolique qu’impose (il n’y a pas d’autre mot) cette infime minorité à la totalité d’une population de 64 millions d’individus. Si c'est une loi de clientèle qui doit être votée, pourquoi ne le dit-on pas ? Car ce qui est sûr, ici, c'est que c'est une offre légale générale qui se propose de satisfaire une demande sociétale particulière. C'est bien l'ordre des choses symboliques pour tous qui change, au bénéfice de quelques-uns. Et c'est aux Etats-Unis que nous devons l'importation en France de l'idée de loi minoritaire, instaurant ainsi une sorte de privilège réservé.
Et la volonté générale s'incline devant le désir particulier. La nouvelle gagne à être connue : le Parlement est désormais un supermarché où les lobbies peuvent venir faire leurs emplettes. Pour y faire voter ce que les juristes appellent des « lois spécifiques », peut-être ? Des lois « ad hoc » ? Remarquez, je me suis laissé dire que c'est à peu près ainsi que fonctionne la machine administrative de la Communauté Européenne, où les lobbies du chimique, de l'agroalimentaire, du biotechnologique se bousculent entre les rayons avec leurs chariots.
Attardons-nous seulement sur l’idée que le mariage homosexuel constitue une avancée, un PROGRÈS. Il me semble que le simple fait de le présenter ainsi éclaire la scène d’un jour particulier. Car il repose sur l’idée implicite que l’homosexualité, dès qu'elle est traitée à égalité avec l’hétérosexualité, acquiert la même valeur, la même dignité que celle-ci, ce qui reste à démontrer.
Que les deux sexes soient égaux en droits et en dignité, comment ne pas en être d'accord ? Mais cela autorise-t-il à décréter les différentes sexualités (ou pratiques sexuelles) elles-mêmes égales en droits et en dignité ? Qui, s'il est de bonne foi, ne reconnaîtrait pas ici un abus de langage, un coup de force sémantique, bref, un MENSONGE ?
Dit autrement : la sexualité de la personne érigée en marqueur incontestable de sa dignité. L'identité de la personne se définirait par sa sexualité ? Je vois là quelque chose d'un peu hallucinant tout de même. Assez obscène, même. C'est peut-être inactuel, voire toute à fait virtuel, mais je vivais sur l'idée (toute archaïque peut-être) que la façon dont je prends mon pied ne regarde que moi.
Formulé autrement, je dirais que la lessive « homo » exige d'être placée juste à côté de la lessive « hétéro », dans la vitrine du magasin et sur le rayon du supermarché. « Quoi ! Tu connais pas le nouvel homo ! », aurait glapi COLUCHE. Les deux lessives sont affichées au même prix. Et ça ne vous semble pas louche ?
Soit dit en passant, une pléiade d'autres sexualités, d'autres orientations et pratiques sexuelles attendent à la porte de la loi une reconnaissance pleine et entière. Je ne vais pas énumérer : où finit le goût personnel ? Où commence la perversion ? Les lobbies n'ont pas fini de faire la queue aux caisses du supermarché parlementaire.
Tout ça parce que le « client » est roi et qu’il doit avoir le choix. Dès l’enfance (je pense au projet de diffusion, sous couvert d'éducation à la tolérance, d’un film sur ce thème dans les écoles primaires), l’individu doit pouvoir se dire qu’il a le choix entre deux voies égales, et que c’est à lui de décider.
Alors qu’il faudrait savoir : l’homosexualité, qu’est-ce que c’est ? Résulte-t-elle d’un choix ? Est-elle la résultante d’une éducation ? D'une structure psychologique ? Une anomalie ? Une déviation ? Un destin ? Une fatalité ? Est-ce qu’on est (ou naît) homosexuel ? Est-ce qu'on le devient ? Est-ce qu’on le décide ? Il faudrait savoir. Des partisans du mariage gay pensent qu'on est homo.
Et je n'ouvre pas un nouveau front du côté des psys, parce que ça ferait beaucoup trop long. Certains (CHRISTOPHER LASCH, peut-être, mais il n'était pas psy, mais il faut impérativement avoir lu son livre La Culture du narcissisme) diraient sans doute que la loi sur le mariage homosexuel constitue l'irruption du narcissisme au coeur de nos institutions. Alors ?
Alors je crois que c’est exactement dans le fait de présenter l’homosexualité comme découlant d’un choix que se situe la PROPAGANDE. Autrement dit le MENSONGE. Il faut dire que le lobby (le "réseau", si vous préférez) fait le forcing depuis des lustres. Un forcing insidieux, peut-être, mais qui touche au but. Mon ami R. voit ici l'action des francs-maçons contre ce qu'il reste chez nous de chrétienté. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que la loi instaurant le mariage homo sera une loi votée sous influence.
L'entreprise qui trouve son aboutissement légal aujourd'hui vise, sous prétexte de déculpabiliser les franges marginales (ben oui, quoi, qu'on le veuille ou non) de la population qui se sentent attirées par le même sexe (ce qu'il ne me viendrait pas à l'esprit de vouloir interdire, évidemment, ni même contester), à installer en tête de gondole, à égalité de sens, de droit et de dignité, la lessive « homo » juste à côté de la lessive « hétéro » sur les rayons du supermarché qu'est devenue l'existence dans la société de consommation. Comme une alternative, quoi. Elle est là, la confiscation de l'idée d'égalité républicaine.
Et au bout du bout du raisonnement, qu’est-ce qu’on trouve ? L’idée que l’homosexualité constitue un progrès décisif par rapport à l’hétérosexualité. Examinez l’évolution de la question depuis les années 1970, vous y trouverez la recette pour qu’un dogme particulier finisse pas s’instaurer en vérité universelle, comme une avancée vers des lendemains qui chantent.
Le processus ne se restreint pas à la France. De même que le député doit transposer en droit français les directives européennes, de même, aujourd'hui, il se soumet à telle ou telle directive mondiale. Il y avait autrefois (paraît-il) une vingtaine de boîtes gay à San Francisco, elles sont (paraît-il) plus de 20.000 aujourd'hui. Qui fut premier, l'oeuf ou la poule ? L'offre ou la demande ? Curieuse évolution du sens de l'expression « société de consommation ». Le mariage homo marque le triomphe de l'idée de consommation comme seule boussole de l'existence humaine.
S’il en est ainsi, il est temps d’abolir les frontières entre les sexes. L'affaire suit son cours. Des différences faisons table rase, aurait dit EUGENE POTTIER, auteur de L’Internationale. Applaudissons à l’homosexualisation du monde ! Vive le « genre », aussi varié, divers et bigarré qu’il soit ! Longue vie à l’androgynie qui s’annonce à grands sons de trompette, comme avenir de l’humanité enfin rénovée ! L’horizon se dégage ! Pas trop tôt ! On en avait soupé, de la différence des sexes !
Ce qui change, dans l'histoire ? Oh, pas grand-chose. Juste ce qu'on appelait, dans des temps désomais révolus, obsolètes et archéologiques, le SENS DE LA VIE. Pardonnez ma ringardise, mon passéisme et mes gros sabots.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, humour, homosexualité, hétérosexualité, sexualité, société, politique, mariage gay, mariage homo, parti socialiste, androgyne, mariage, rabelais, la fontaine, france, liberté égalité fraternité, alain finkielkraut, répliques, france culture, irène théry, christopher lasch, la culture du narcissisme
samedi, 12 janvier 2013
VIVE L'ANDROGYNIE UNIVERSELLE !
Pensée du jour :

CAVALIERS CHEYENNE, par EDWARD S. CURTIS
« Endeuillé par l’anniversaire de la mort du bon roi Dagobert, qui ne savait pas mettre sa culotte (c’était le début de la civilisation, l’homme hésitait encore devant ce vêtement nouveau), le mois de janvier vient de s’écouler, dramatisé par le passage du loup et par les exigences fiscales. Le mois de janvier rappelle à l’homme combien le progrès est chose ancienne ».
ALEXANDRE VIALATTE
Justement, le progrès, on va en parler. Car c’est plié : le mariage homosexuel – habilement maquillé en « mariage pour tous » (ce qui ne veut pas dire que tout le monde devra obligatoirement se marier sous peine d’amende, ouf) – sera inscrit dans le Code Civil. La majorité « socialiste » (je pouffe !) votera pour. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la chose. La manifestation de dimanche 13 n’y changera strictement rien.
Les résistances au projet de loi sont reléguées au rang de vieilleries, mises au grenier, mises au compte d’un passéisme ringard, d’un conservatisme vieillot, d’un immobilisme paléontologique. Bref, à jeter d’urgence aux poubelles de l’Histoire. Le slogan frénétique de tout ce qui est « moderne » est, depuis déjà quelque temps : « BOUGEZ ! ». C’était déjà ce que célébrait (à sa façon) un « esprit libre » comme PHILIPPE MURAY.
Je ne sais plus quel conseiller de HOLLANDE déclare qu'il ne faut pas confondre "république stable" et "république immobile". Et j'ai entendu CHANTAL JOUANNO (du parti de BORLOO et favorable au mariage) déclarer qu'elle ne voudrait en aucun cas pouvoir être taxée de "ringardise". C'est le terme employé. Ce sont autant d'aveux de capitulation devant le nouveau "politiquement correct". Eh oui, que faire devant L'AIR DU TEMPS ? Devant ce que les médias (poussés par derrière par des lobbies influents) s'efforcent de faire apparaître comme la nouvelle idéologie dominante ?
J’ai déjà évoqué la parenté entre le débat actuel et la tentative avortée de FRANÇOIS MITTERRAND et ALAIN SAVARY de priver l’enseignement privé de tout apport d’argent public. C’était en 1984. Eh oui, bientôt 30 ans. Un million de catholiques dans les rues pour défendre la « liberté », qu’ils disaient. C’était déjà un bel exemple de CONFISCATION d’une de nos trois valeurs républicaines. Un joli tour de passe-passe. Disons aussi un joli montage de PROPAGANDE (cf. EDWARD BERNAYS). Une propagande abondamment relayée par toutes sortes d'"autorités" intellectuelles (sociologues, philosophes, etc.).
Le même tour de passe-passe est en train de se produire. Cette fois, c’est la deuxième de nos valeurs républicaines qui s’y colle. C’est au nom de l’ « ÉGALITÉ » qu’on va instaurer pour les homosexuels le droit de venir devant monsieur le maire et de se passer légalement la bague au doigt.
Remarquez, je dis ça, mais l’argot célèbre depuis longtemps ce qu’il appelle la « bagouze » : « A première vue, si j’étais un peu plus marle, un peu plus expérimenté de l’existence, je l’aurais flairé craquousette de la bagouse, chochotte probable ». C’est de l’ALPHONSE BOUDARD dans le texte. Les homosexuels mâles n’ont en effet pas attendu la loi pour se la passer, la bagouse.
 Bon, d’accord, ce n’est pas au doigt qu'ils se la passent, « bagouse » voulant dire « anus » (à ce titre, l'anus est, avec la bouche, le seul orifice "transgenre", car seul l'insecte appelé "éphémère" est dépourvu de bouche, d'anus et de tout ce qu'il y a entre les deux, ce qui amoindrit tant soit peu ses perspectives d'orgasme).
Bon, d’accord, ce n’est pas au doigt qu'ils se la passent, « bagouse » voulant dire « anus » (à ce titre, l'anus est, avec la bouche, le seul orifice "transgenre", car seul l'insecte appelé "éphémère" est dépourvu de bouche, d'anus et de tout ce qu'il y a entre les deux, ce qui amoindrit tant soit peu ses perspectives d'orgasme).
Mais RABELAIS déjà parlait de l’ « anneau d'Hans Carvel». L’anneau magique (entrevu en rêve) servait à Hans Carvel à s’assurer que nul autre que lui ne puisse visiter l’orifice féminin de sa jeune et ardente épouse. Et s’éveillant au matin, il se rendait compte qu'il avait dormi en glissant un doigt dans le dit orifice. Mais bon, Hans Carvel vivait aux temps antédiluviens de l’hétérosexualité régnante. Intolérable aujourd'hui. Inacceptable. Inenvisageable.

« Je te donne cestuy anneau [c'est le diable qui parle]; tant que tu l'auras au doigt, ta femme ne sera d'autrui charnellement connue sans ton su et consentement.
Le diable disparut. Hans Carvel, tout joyeux, s'éveilla et trouva qu'il avait le doigt au "comment a nom ?" de sa femme ». La périphrase interrogative entre guillemets se déchiffre aisément en prenant juste la première et les deux dernières lettres. C'est beau, la littérature.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, humour, mariage gay, homosexualité, hétérosexualité, société, politique, france, parti socialiste, françois hollande, poubelles des l'histoire, philippe muray, chantal jouanno, jean-louis borloo, politiquement correct, idéologie dominante, françois mitterrand, enseignement privé, enseignement catholique, propagande, edward bernays, argot, alphonse boudard, sodomie, rabelais
vendredi, 11 janvier 2013
"REPUBLIQUE IRREPROCHABLE", VOUS DITES ?
Pensée du jour :

SIOUX OGLALA, par EDWARD S. CURTIS
« Les enfants n'avaient autrefois que des souvenirs mérovingiens ».
ALEXANDRE VIALATTE
« République irréprochable », vous dites ? « Moi, président de la République, je n’aurai pas la prétention de nommer les présidents des chaînes de télévision publiques, je laisserai ça à des instances indépendantes ». J’ai bien entendu ? Vous vous souvenez, j’espère. Alors là je dis bravo tant que vous voulez. C’est sûr, j’applaudis le candidat qui a le courage de proclamer la pureté de ses intentions. En rupture avec les manières du président sortant.
Oui, j’applaudis à deux mains (j’ai essayé avec une seule, mais ça marche moins bien) cette déclaration du candidat FRANÇOIS HOLLANDE, face à un NICOLAS SARKOZY légèrement surpris, voire tétanisé. Malheureusement, la pureté des intentions s’est cassé le nez sur la sordidité de la réalité. Et je l’entends, le refrain de la réalité :
« Parole, parole, parole, parole, parole,
Encore des paroles que tu sèmes au vent ».
Tout le monde connaît ces mots que DALIDA réplique à ALAIN DELON en train de lui jouer la grande scène du « retour de flamme ».
Le chef de bureau qui nous gouverne, quittant les mots et la propagande pour affronter la réalité, voici ce qu'il dit : « Moi, président de la République, je nomme mon pote OLIVIER SCHRAMECK président du CSA ». OLIVIER SCHRAMECK ? Mais si, rappelez-vous, le grand copain de LIONEL JOSPIN, son directeur de cabinet (1988-1991) quand il est ministre de l’éducation, son directeur de cabinet (1997-2002) quand il est premier ministre. Un grand serviteur de l’Etat, donc, OLIVIER SCHRAMECK.

Cela méritait bien un sucre d’orge : « Qu’est-ce que tu dirais du CSA ? – Ben, à la rigueur et faute de mieux, tope là ». Je n’étais pas dans le bureau où s’est prise la décision, mais ça doit ressembler à ça. Et HOLLANDE a dû ajouter : « Les gens diront ce qu’ils voudront, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Comme dit le philosophe HENRI BERGSON : « Pour se faire une idée de la vérité, il faut se référer non aux mots qu’une personne prononce, mais à ses actes ». Qui ne serait pas d’accord ? La « République irréprochable » attendra, elle a déjà été tellement patiente.
Bon, on dira, pour être gentil : « Pour cette fois, ça va, circulez, mais n’y revenez pas. – Promis, papa ». Malheureusement, ce genre d’embrouilles (et d’arrangements avec ses propres serments prêtés la main sur le coeur) notre président élu semble en avoir rapidement fait un mode de vie ordinaire. Il le fait voler en escadrille, l'arrangement. FRANÇOIS HOLLANDE a dû pratiquer le tir en rafales, visiblement, il s’y connaît.

IL VOUS FAIT RIRE, VOUS ?
Secrétaire général de la présidence ? PIERRE-RENÉ LEMAS, ex-préfet. Directrice de cabinet du président HOLLANDE ? SYLVIE HUBAC, ex-conseillère d’Etat. Recteur de l’énorme académie de Versailles ? PIERRE-YVES DUWOYE, ex-directeur de cabinet de VINCENT PEILLON. Préfet de la très convoitée Région Aquitaine ? MICHEL DELPUECH, ex-préfet de la Région Picardie. Attendez la fin, ce n’est pas fini.
Ambassadeur en Afghanistan ? STANISLAS LEFEBVRE DE LABOULAYE. Administrateur provisoire de Sciences-Po ? JEAN GAEREMYNCK, conseiller d’Etat. Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations ? JEAN-PIERRE JOUYET (tiens, tiens, il a pas fricoté avec SARKOZY, celui-là ?). Chargé de remettre un rapport sur l’Epargne ? PIERRE DUQUESNE. Directeur de Veolia Transdev, n°1 européen des transports ? JEAN-MARC JANAILLAC. Plus que deux à caser : où va-t-il les mettre ?
Nous trouvons CLAUDE REVEL, qui a mené carrière « dans le conseil » (l’appellation est drôle, mais ça mène à tout à condition d’en sortir), chargée de rédiger un obscur rapport sur les efforts internationaux de la France pour se positionner « en matière de normes » (texto). Et la DRH du groupe La Poste, alors, alliez-vous me demander ? Voilà une question qu’elle est bonne. SYLVIE FRANÇOIS, elle s’appelle.
Alors vous allez dire : « Tout ça ne nous dit pas l’heure. Pourquoi cette énumération, blogueur compulsif ? S’il y a un lien entre tous ces gens, quel est-il ? ». Votre intuition a percé le mur de la devinette que j’avais concoctée. OUI, IL Y A UN LIEN. Il suffit de se souvenir par quelles écoles notre président hélas élu (rassurez-vous, je dirais le même hélas si ç’avait été l’autre). Sciences-Po ? HEC ? Vous n’y êtes pas.

PROMOTION "VOLTAIRE" DE L'ENA (1980)
HOLLANDE DOIT SE DIRE : "PUTAIN ! ENCORE TOUT CE MONDE A CASER !"
(mais je ne vois pas la planche d'appui pour le tir aux pipes, dommage)
Ceux qui ont dit « ENA » ont gagné (mon estime). Oui, tous ces gens sont des camarades de FRANÇOIS HOLLANDE au sein de la « Promotion Voltaire ». Et c’est GILLES MARCHANDON, autre ancien de la dite promotion, qui, dans l’association des anciens, s’occupe du service « carrières ». Retenez bien ce prénom et ce nom : monsieur PROMOTION VOLTAIRE est le meilleur ami de FRANÇOIS HOLLANDE. Qui le lui rend bien. Avec les intérêts.
Je remercie un « hebdomadaire satirique paraissant le mercredi », sans les informations duquel la population française se verrait interdire le moindre accès aux cuisines de la cantine où on les fait manger, et à la cabine de pilotage de l’avion où on les a embarqués.

QU'EST DEVENU LE SLOGAN IMMORTEL :
"LA LIBERTÉ DE LA PRESSE NE S'USE QUE SI L'ON NE S'EN SERT PAS" ?
(mais c'est vrai, qui se souvient des piles Wonder, qui ne s'usent que si l'on s'en sert ?)
Si vous tapez : « Moi président de la République », vous tombez sur un Youtube de 3’22 qui montre le candidat étalant la pureté de ses intentions. Je n’insère pas la séquence ici même, parce que je ne voudrais pas souiller ce blog, ni la pureté de ses intentions, dont je suis sûr que personne ne doute. Moi, président de cette République ? Vous rigolez ? La main sur le coeur, je le proclame : « NON MERCI ! ». Remarquez, je suis à l'abri : personne encore ne m'a demandé de me porter candidat.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, litttérature, humour, politique, société, france, françois hollande, nicolas sarkozy, président de la république, télévision, élection présidentielle, dalida, alain delon, parole parole parole, olivier schrameck, corruption, népotisme, copinage, lionel jospin, henri bergson, république irréprochable, hauts fonctionnaires, haute fonction publique, hec, sciences-po, ena, école nationale d'administration, conseil d'état, francs-maçons, le canard enchaîné, république française, journal satirique
jeudi, 10 janvier 2013
MAIS QUELLE ETAIT LA QUESTION ?
Pensée du jour :

AATSISTA MAKHAN, BLACKFOOT
« Un vent aigre balaie les rues. Le Soleil est entré dans le Bélier. Les enfants qui naissent sous ce signe feront bien d’éviter les tournois. L’astrologue les leur déconseille. C’est déjà le moment de fumer les vieux houblons et de planter la griffe d’asperge. Voire de semer la lupuline. Bientôt l’hirondelle va revenir ».
ALEXANDRE VIALATTE
Est-ce que le pou se pose la question : « Est-ce que j’existe ? » ? Non, il se contente d’exister. S’il a une tête, on ne sait pas vraiment ce qu’il a dedans. Il vit sa vie de « pou de la reine, pou de la reine, pou de la reine, le roi Ménélas » (JACQUES OFFENBACH). Y a-t-il des reines chez les poux ? Cela n’est pas prouvé, à l’heure ou nous parlons. Cela n’empêche nullement d’affirmer que l’insecte est un problème.

Je crois qu’on peut savoir gré à ANDRÉ FRANQUIN d’avoir résumé le problème dans une page de Gaston Lagaffe. Gaston, qui doit s’occuper d’un petit tout un après-midi, raconte à celui-ci l’histoire suivante : « Chez les papous, il y a les papous à poux et les papous pas à poux. Mais chez les poux, il y a les poux papas et les poux pas papas. Donc chez les papous, il y a les papous à poux papas et les papous à poux pas papas ». Tout comme ça.

On voit par là (merci pour la formule, monsieur VIALATTE) que la vie est une succession d’aiguillages, de subdivisions, de voies divergentes dont on se rend compte qu’on les a quittées quand on se trouve embarqués dans un bateau qu’on n’a finalement pas si librement choisi qu’on voudrait nous le faire croire.

Aiguillages ou pas, on est toujours sur ses rails. Pas vrai ?
En tout cas, voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, humour, je suis l'époux de la reine pou de la reine, pou, jacques offenbach, la belle hélène, andré franquin, gaston lagaffe, bande dessinée, steve reich, different trains, musique, musique contemporaine
mardi, 08 janvier 2013
BONNE ANNEE, BORIS !
Pensée du jour :

SIOUX OGLALA, par EDWARD S. CURTIS
« Il y a quelque chose de choquant à voir les conditions de la célébrité. On ne saurait être célèbre à moins de sauver son pays ou de découvrir de quelle façon tournent les étoiles ; ou alors il faut tuer une famille britannique qui vient camper dans les asperges, y compris un enfant de dix ans ; ou même, comme Lacenaire, se faire guillotiner et être capable de manger un poêle à bois ; un poêle à bois à feu continu ; en briques vernies ; tout au moins la moitié. Bref, être un grand monsieur ou un grand dégoûtant. Ou alors un grand estomac. On voit par là que, faute de pays à sauver, ou si le ciel est couvert de nuages, si la famille est française comme tout le monde, si la guillotine marche mal ou si on ne digère pas la brique de poêle à bois, il n’y a pas moyen d’être célèbre ».
ALEXANDRE VIALATTE
Le boulanger chez qui j’achetais mon pain autrefois (une formidable « marguerite » avec mie et croûte idéalement proportionnées, il travaillait « sur boulenc ») s’appelait GRILLON. Un excellent boulanger, à l’étrange physique tout en nerfs et en hauteur. Quand il a déménagé à « la Table de Pierre » pour s’agrandir, il a été obligé d’embaucher un apprenti.
Et il m’a raconté l’histoire suivante : « La première semaine, impeccable, rien à dire. La deuxième semaine, il vient le mardi, le mercredi, et le reste de la semaine, personne. Pas de message, rien au téléphone. Le lundi suivant, il débarque à l’heure normale. Je lui demande ce qui arrive : "Oh ben j’ai pas eu le temps de venir travailler" ». Il avait l’air tout surpris, monsieur GRILLON.
Pas le temps de venir travailler. Voilà tout. Loin de moi l’idée de jeter l’opprobre, le bébé, le discrédit et la pierre (avec l'eau du bain, bien entendu) à la jeunesse tout entière. Je connais des informaticiens qui sont devenus métalliers, parce qu’ils avaient, je crois, envie de continuer à avoir envie de travailler. Mais il y a peut-être malgré tout un phénomène de génération.
Je n’en veux pour preuve que l’exemple de BORIS, qui a eu les honneurs des pages « arrondissements » du Progrès de Lyon. Le gars en question zone dans le 3ème ou le 7ème arrondissement, comme l’indique le journal. Je ne veux, avec l’exemple de BORIS, que marquer l’incompréhension qui est la mienne, devant des, disons, « comportements nouveaux » ou encore « mentalités nouvelles ». Pour rester gentil.
BORIS n’est pas méchant, qu’on se le dise. Il a juste deux chiennes. A les voir, Athena et Sheeva sont des chiennes gentilles. Il a bon caractère, BORIS, nom de Dieu. C’est vrai ça. Il ne veut de mal à personne, BORIS. A condition qu’on ne l’emmerde pas. A condition que les passants ne l’apostrophent pas méchamment : « Je n’aime pas être dévisagé et entendre de sales réflexions. Je me sens incompris. Parfois, je me fâche, bien que je sois quelqu’un de gentil ». Les passants ont intérêt à se le tenir pour dit.
Heureusement, cet homme de 34 ans est tombé sur un(e) journaliste compréhensif(ve) qui a consenti à noircir du papier pour dresser son « portrait ». Alors là, pour le coup, c’est du journalisme gentil. Je dirais même qu’on ne saurait être plus aimable, si l’on se fie au titre retenu.

C’est vrai qu’il en a subi, des épreuves, dans sa vie, BORIS : la DDASS « dès sa plus tendre enfance ». L’école ? « Je n’aimais pas l’école. » Pas de veine, hein ? Pas d’école. Pas de soutien familial. Pas de soutien matériel. Pas de qualification. Dans ces conditions, pas d’insertion dans la vie professionnelle : « J’ai décroché plusieurs jobs, souvent saisonniers, comme plongeur dans un restaurant, homme de ménage, employé chez un loueur de ski ».
Arrivé à Lyon à 26 ans, il n’arrive pas à trouver de boulot stable : « Il faut dire qu’il n’a pas de toit et qu’il est confronté à l’enfer de la rue », dit l’article. L’enfer de la rue, pas moins : « J’ai vu des amis mourir autour de moi, révèle-t-il. Ça forge le caractère. Les épreuves ne font plus peur ». Pour quelqu’un qui vit en enfer, je trouve pourtant qu’il a l’apparence de quelqu’un qui s’en sort pas trop mal.

Il touche le RSA, il regarde la télévision, et pour « arrondir », il fait la manche au coin de l’avenue Jean-Jaurès et du cours Gambetta. Entre 10 et 30 euros. Parce que le RSA ne suffit pas pour tout payer. Qu’y a-t-il dans ce "tout" ? Ce n’est pas dit. L'après-midi, assis sur son tabouret, il attend que ça tombe. L’aide publique d’un côté, la charité des passants « gentils » de l’autre. Un éducateur de rue « lui déniche un petit appartement dans l’arrondissement ». Que demande le peuple ?
Conclusion ? Voici comment il envisage l’avenir, BORIS : « J’aimerais trouver un bon travail, avoir une petite amie et un jour, pourquoi pas, fonder une famille … ». Un homme normal, quoi.
Alors je demande : QU’EST-CE QUI CLOCHE, dans ce tableau ? Qu’est-ce qu’elle dit, la chanson de JACQUES HIGELIN ? Ah oui :
« Poil dans la main,
payé à rien foutre,
regarder la poutre
dans l’œil du voisin ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:54 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, sioux oglala, alexandre vialatte, littérature, humour, travail, métier, effort, le progrès
mercredi, 12 décembre 2012
GRAVIR LE MONT PEREC
Pensée du jour :

ERWIN BLUMENFELD
« Il n'est rien de plus charmant que les proverbes arabes, et même les proverbes tout court. On les trouve dans les agendas, entre une recette pour recourber les cils et la façon d'accommoder le riz cantonais. Ils parfument la vie de l'homme sensé. Ils font parler le crapaud, ils racontent la brebis, ils décrivent le rhinocéros. Ils rendent le lion sentencieux et la chèvre pédagogique. Il leur arrive de comparer le commerçant aisé à la fleur du jasmin, et l'homme sage à un vase de cuivre orné de riches ciselures par un habile artisan de Damas. On voit par là que nulle métaphore ne les effraie ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : je demandais juste : « Mais qu’est-ce que c’est, bon sang, un onzain hétérogrammatique ? ».
Très simple à expliquer : c’est un poème de onze vers dont chaque vers est composé de onze lettres. Ajoutons que ces onze lettres, à chaque vers, doivent être strictement les mêmes. Et si on met les lignes bout à bout, on est censé trouver une suite de mots, qui veuille autant que possible dire quelque chose.
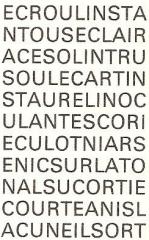
VOIR TRADUCTION PLUS BAS
Appelons ça un poème, si vous êtes d’accord. On connaît le haïku, poème comportant exactement 17 syllabes. C’est du japonais. Eh bien GEORGES PEREC invente le poème de 121 lettres, pas une de plus : c’est ça le « onzain hétérogrammatique ».
C’est autrement fortiche que le sonnet, je peux vous le dire. Avec ses Cent mille milliards de poèmes, RAYMOND QUENEAU peut aller se rhabiller, même si PEREC dédie La Vie mode d’emploi « à la mémoire de Raymond Queneau ».

CENT MILLE MILLIARDS ? VRAIMENT ? C'EST DE LA PRESTIDIGITATION !
C'EST AUSSI UNE EXCELLENTE TROUVAILLE DE "COM".
Et pourquoi « ulcérations », alors ? Très simple à expliquer, là encore. Prenez les onze lettres les plus fréquentes du français écrit, vous obtenez la série suivante, dans l’ordre : E, S, A, R, T, I, N, U, L, O, C. Vous cherchez un bon moment s’il n’y a pas un moyen de faire quelque chose de cette liste, vous cogitez, et soudain, la lumière se fait : « Ulcérations », en prenant soin de mettre le mot au pluriel. C’est PEREC qui a trouvé ça.
Je dois dire, pour être tout à fait sincère, que la valeur littéraire des poèmes ainsi obtenus est très loin de sauter aux yeux, comme on peut le voir ci-dessous. C’est sûr que c’est une prouesse digne de Tristan terrassant le Morholt ou de David assommant Goliath. Un exploit.

TRADUCTION DU ONZAIN : QUI AURAIT ENVIE D'APPRENDRE ÇA PAR COEUR ?
(rendez-moi Baudelaire)
L’accomplissement d’une tâche surhumaine. Qui me fait penser à cette très belle réplique mise par GOSCINNY dans la bouche du commerçant auquel s’adresse Lucky Luke dans Des Barbelés sur la prairie : « Pour l’impossible, nous demandons un délai de quinze jours ». Mais pour un résultat capable de réjouir les capacités de calcul d’un ordinateur. Pendant ce temps, le poète patiente à la porte. Dans le froid glacial.

DESOLE : C'EST LA SEULE PLANCHE DONT JE DISPOSE
Franchement, c’est comme les virtuosités vocales des mélismes de CECILIA BARTOLI chantant VIVALDI : à l’arrivée, je me dis : « Tout ça pour ça ! ». Tout ça pour dire que l’oulipianisme de GEORGES PEREC me laisse un tout petit peu sceptique, même si je reconnais l’absolue supériorité du maître dans tout ce qui concerne les jeux avec les lettres (et avec les Lettres). Heureusement, le génie de PEREC remplit avantageusement les formes que son goût pour les contraintes d'écriture lui suggèrent jour après jour.
Car la sécheresse du pur formalisme n’est pas loin, comme si l’on essayait de mettre au point une machine capable de produire du vivant (BERGSON, au secours !). Et en même temps, une forme de préciosité héritée de Mademoiselle de SCUDERY. Mais le JEU ne fut pour GEORGES PEREC, en quelque sorte, que la voie d'accès à l'expression de son monde à lui par la littérature. PEREC a eu besoin du jeu (les contraintes oulipiennes) pour laisser libre cours au flux (appelons ça comme ça, par convention) créatif qui le traversait.
Ce n’est pas pour rien que PEREC (et il l'est peut-être encore, je ne me tiens pas au courant des avancées de la compétition, puisqu’il y a évidemment surenchère, et que celle-ci m’intéresse, je dois dire, tout à fait moyennement) le recordman de tout le système solaire pour ce qui est du PALINDROME.
Si vous consultez un des deux volumes « oulipo » de la collection « Idées / Gallimard » (La Littérature et Atlas, mais maintenant, pour les curieux, il y a la Bibliothèque oulipienne authentique), vous saurez. Je crois me souvenir que le palindrome de GEORGES PEREC est fait de 1247 mots.
Au fait, je n’ai pas dit ce que c’est, un palindrome. J’aurais dû. En musique, ça existe aussi, ce n’est pas monsieur PHILIPPE CATHÉ qui me contredira. OLIVIER MESSIAEN a inventé les « rythmes non rétrogradables », qui reposent exactement sur ce principe : on peut lire le texte en commençant par le début ou par la fin sans que l’ordre des signes écrits ait varié d’un iota (mais s'agissant de mots, le sens change évidemment, contrairement à ce que déclare le crétin qui a rédigé la notice wikipédia).
Le palindrome a bien sûr attiré l'attention de l'humain dès que celui-ci disposa de l'alphabet. ALFRED JARRY cite dans Messaline le très connu « ROMA / AMOR ». GUY DEBORD élabora l'extraordinaire « In girum imus nocte et consumimur igni » ("Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu").

Je vous donne juste le début de l'exploit accompli par GEORGES PEREC : « Trace l’inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. »,et la fin : « Ta gabegie ne mord ni la plage ni l’écart ». Vous pouvez vérifier dans un miroir (sans tenir compte des accents et autres signes adventices).
Là encore, admirons la prouesse, mais ne nous demandons pas trop violemment ce que tout ça peut signifier. En comparaison, GUY DEBORD n'a battu aucun record, mais il a trouvé une pépite en or massif (si c'est lui qui l'a trouvée, ce que j'avoue ne pas savoir, mais il n'y a pas de raisons d'en douter).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, femme, erwin blumenfeld, corps féminin, beauté féminine, alexandre vialatte, littérature, humour, proverbes arabes, georges perec, alphabets, poésie, raymond queneau, cent mille milliard de poèmes, la vie mode d'emploi, ulcérations, goscinny, lucky luke, cecilia bartoli, préciosité, palindrome, oulipo, bibliothèque oulipienne, olivier messiaen, alfred jarry, messaline, guy debord
mardi, 11 décembre 2012
GEORGES PEREC LE JOUEUR
Pensée du jour :

EDWARD WESTON
« Il faut de temps en temps remettre les pendules à leur ... place ».
JOHNNY HALLIDAY (on ice & on the rocks, hic et nunc, et sursum corda, ad altare deo, mais ça reste surtout "on the rocks")
J’ai mentionné hier le nom de GEORGES PEREC. J’ai même évoqué le livre qui l’a fait connaître (Les Choses, Julliard, 1965), vous savez, cette « histoire des années 60 » qui commence par un chapitre au conditionnel, et dont l’épilogue est écrit au futur. Je suis allé jusqu’à exhiber sa trombine.

C'ETAIT AVANT BEN LADEN ET TOUTE SA CLIQUE
Tout ça pour dire que GEORGES PEREC est, je crois, un grand écrivain. Peut-être même, allons-y carrément, un auteur. Un vrai. On sait qu’on a affaire à un auteur quand on est face à un ensemble qu’on appelle une œuvre. Et l’œuvre est incontestable. Mais elle souffre, pour apparaître comme telle, d’un, disons, handicap.

DESSIN D'EMILIE SCHEFFER
Elle est hétérogène, je veux dire bigarrée, papillonnante, hétéroclite et disparate. Difficile à saisir dans son unité, si elle en a une. Certains soutiennent même l’idée que PEREC est moins un écrivain qu’un amateur d’énigmes cabalistiques quasiment indéchiffrables.
Pour donner un exemple de cette tare rédhibitoire, ils citent, entre autres, les 24 « portraits imaginaires » peints par l’artiste Hutting dans La Vie mode d’emploi (soit dit en passant, je me demande si ce n’est pas le seul livre qui porte, au dessous du titre, la mention « Romans », au pluriel) : prenons au hasard le n° 19. Voilà comment il est présenté : « L’acteur Archibald Moon hésite pour son prochain spectacle entre Joseph d’Arimathie ou Zarathoustra » (on trouve ça p. 354).
Passons sur l’approximation grammaticale que constitue le « ou » (on attendrait plutôt « et »), car elle est intentionnelle : elle nous révèle l’identité d’un personnage bien réel. Et pas n’importe qui, puisqu’il s’agit du grand ami de GEORGES PEREC. Il s’appelle HARRY MATHEWS, et a vécu à Lans-en-Vercors, aux côtés de MARIE CHAIX, auteur, entre autres, du très beau Les Lauriers du lac de Constance. On décrypte le nom du monsieur dans la séquence « Arimathie ou Z ». Fallait y penser !! Ce serait négligeable si cette chinoiserie cryptographique était un cas isolé.

HARRY MATHEWS EN 1984
Mais non ! Il fait passer dans cette moulinette les noms de tous les membres qui constituaient alors l’Ou.Li.Po. (Tham Douli portant… ; NOËL ARNAUD : Coppélia enseigne à Noé l’art nautique, …, etc.). Et s’il n’y avait que ça ! Mais non ! C’est tout le temps comme ça. Tenez, tout le monde a entendu parler du roman La Disparition (1969), n’est-ce pas ?

C'EST JUSTE LA PREMIERE PAGE
Je ne sais pas s’il est vrai, comme ça se raconte, que nul, parmi les « critiques » littéraires (autoproclamés) qui ont commenté le roman à parution, ne s’est aperçu du procédé (le « lipogramme » = "j'abandonne une lettre") mis en œuvre, mais si tel est bien le cas, ça veut dire au moins une chose : GEORGES PEREC est un maître.
Non seulement il use d’une ficelle qui, quand on la connaît, crève les yeux au point qu’on ne voit plus qu’elle, mais il arrive à la dissimuler aux yeux les mieux exercés et les plus perspicaces sous la trame d’un authentique roman romanesque pleinement réussi.
La Disparition raconte en effet, en environ 300 pages, l’histoire d’une disparition : celle, tout simplement, de la lettre E, la plus fréquente du français ! Cela a-t-il pu échapper à tout le monde ? Ça me paraît difficile, mais bon. Et pour faire bonne mesure, GEORGES PEREC s’offre le luxe d’un passage dépourvu non seulement de E, mais aussi de A. Vous pouvez essayer en famille, le soir : c’est un jeu de société comme un autre, après tout. Pas donné à tout le monde, quand même.

ICI, ON EST P. 296 : UN JEU D'ENFANT, COMME ON VOIT
Et le pompon, la cerise sur la crème fouettée du délectable « Forêt Noire », c’est, trois ans après (1972), l’exercice inverse : on trouve en effet dans Les Revenentes l’emploi exclusif de mots dépourvus de toute autre voyelle que E. Ce n’est pas sans diverses « acrobaties » ou « approximations » (y compris dans La Disparition, où PEREC tord le bras plus d’une fois à l’orthographe canonique ou à la syntaxe). Et ça peut laisser sceptique.
On peut le dire : pour PEREC, la littérature commence AU PIED DE LA LETTRE. Je crois que ce qui pourrait définir le mieux la démarche littéraire de GEORGES PEREC, c'est précisément qu'il prend la littérature AU PIED DE LA LETTRE pour pouvoir JOUER avec elle.
Et là, on peut le dire : c’est le virtuose. C’est le premier violon super-soliste. Même son ami HARRY MATHEWS le reconnaît avec simplicité : dans les exercices d’ « ulcérations », il n’arrive pas à sa cheville. En un tournemain, il vous torche, vite fait sur un coin de table, un onzain hétérogrammatique en se jouant des difficultés. MATHEWS, en comparaison, il tire la langue (c'est lui qui le dit). Mais vous me direz : « onzain hétérogrammatique », qu’ès aco ?
Ça vient, ne poussez pas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward weston, femme nue, corps féminin, beauté féminine, johnny hallyday, georges perec, les choses, julliard, littérature, humour, la vie mode d'emploi, harry mathews, marie chaix, oulipo, noël arnaud, la disparition, lipogramme, palindrome, les revenentes, les lauriers du lac de constance, au pied de la lettre
lundi, 10 décembre 2012
EDWARD BERNAYS, HERAUT, ZERO OU HEROS ?
Pensée du jour :

PHOTOGRAPHIE DE GUILLAUME HERBAUT, ENVIRONS DE TCHERNOBYL
« "Il y a beaucoup de choses dans le grand chosier", écrit Littré au mot "chosier", qui n'a jamais été employé qu'une fois dans la littérature française. Précisément dans cette expression-là. Par Rabelais, si j'ai bonne mémoire. Et Littré reste vague dans sa définition. Mais il n'a pas besoin d'être précis. Tout le monde comprend que dans le grand chosier il ne saurait y avoir que beaucoup de choses ».
ALEXANDRE VIALATTE
NB : la mémoire de VIALATTE (cf. Antiquité du grand chosier, éditions Julliard, tiens, à ce propos, coucou, J.) lui joue des tours, voici "in extenso" la notice de LITTRÉ : « chosier, s.m. Usité seulement dans cette locution proverbiale : va, va, quand tu seras grand, tu verras qu'il y a bien des choses dans un chosier. Cela se dit pour indiquer à un enfant et même à une grande personne qu'il y a bien des choses dont on ne peut rendre compte ».
Comme disait ma grand-mère, un peu de culture éloigne de l'absolu, beaucoup de culture en rapproche.
***
Résumé : je demandais ce qui faisait d’EDWARD BERNAYS (mort à 103 ans !!), le roi de la manipulation des foules et de l’opinion publique, un génie révolutionnaire du 20èmesiècle. Son rôle est loin d’être négligeable dans l’avènement du culte de la marchandise, promue au rang d’unique idole devant laquelle l’humanité est appelée à se prosterner.

Ben voilà : il a pioché dans deux univers radicalement différents pour élaborer une théorie radicalement nouvelle. D’un côté, les analyses de GUSTAVE LE BON sur la psychologie des foules (soit dit en passant, cet homme mériterait aussi qu’on s’intéresse à lui). De l’autre, les motivations inconscientes qui font agir les individus, mises au jour par le tonton SIGMUND FREUD de BERNAYS, avec la psychanalyse.
Pour EDWARD BERNAYS, ce qui meut une foule n’a rien à voir avec ce qui peut mouvoir un individu, et d’autre part et surtout, en aucune manière, ce qui meut la foule n’est lié à ce qu’il y a en elle de rationnel, mais dépend du « ÇA ». Dans la théorie de FREUD, le « ça » est la partie la plus enfouie de l’individu, et partant la moins contrôlée par le « moi » et le « surmoi ».
Sans entrer dans les détails, comparons simplement le « ça » à une sorte de réservoir de pulsions et de motivations secrètes, méconnues de l'individu, qui n’attendent qu’un déclic pour se manifester. Ce qui fait bouger une foule, selon BERNAYS, est situé au-dessous du seuil de la conscience. FREUD appelait ça le « subconscient ».
Aujourd’hui, les agences de publicité maîtrisent parfaitement la chose et ont élaboré en conséquence des questionnaires susceptibles de renouveler le répertoire des arguments et des images susceptibles de déclencher l’acte d’achat en allant fouiller dans les motivations secrètes que les gens portent dans leur tête, sans le savoir. Cela porte le nom d’ « enquête de motivations ».

C'EST SÛR, CET EXEMPLAIRE A BEAUCOUP VECU (année de publication) !
L’excellent GEORGES PEREC les nomme (on est en 1965, dans Les Choses, prix Renaudot, me semble-t-il) « études de motivations ». Dans ce bouquin mémorable, Jérôme et Sylvie participent à l’installation balbutiante dans le paysage social de ces lointains ancêtres des sinistres et obsédants SONDAGES (qui a tiré de son chapeau que 61 % de Français sont favorables au mariage homosexuel ? L'IFOP de madame LAURENCE PARISOT).

IL FUMAIT BEAUCOUP TROP. IL EN EST MORT.
Mais à l’époque de BERNAYS (il publie Propaganda en 1928), comme je l’ai dit précédemment, la publicité balbutiait, se contentant de vanter les mérites pratiques, la fonctionnalité et l’adéquation du produit à l’usage auquel il était destiné. Elle parlait au côté rationnel des gens. Elle avait un côté terriblement objectif. Autrement dit : dépassé.
C’est en cela que le travail de BERNAYS est révolutionnaire : il a répondu à la grave question que tous les gouvernements du monde se posent : « Comment amener des masses de gens à se comporter comme le voudraient les dirigeants, sans transformer la société en caserne militaire ? ».
Son idée principale consiste à se fixer comme objectif de vendre à des masses de gens des masses de produits AVANT que les produits précédents aient cessé de fonctionner. Tiens c’est drôle : l’idée est à peu près contemporaine de l’invention du concept d’ « obsolescence programmée ». Comme dit quelqu’un : EDWARD BERNAYS a fait beaucoup pour que l’Amérique passe d’une « économie du besoin » à une « économie du désir ». Comme c’est bien dit.
Et pour donner envie aux gens d’acheter des choses dont ils n’ont aucun besoin (sinon dans un futur bien vague), il faut aller chercher en eux la source de leur envie. C’est ainsi que, selon GEORGES PEREC, toujours dans Les Choses, toujours en 1965, Jérôme et Sylvie sont déjà atteints de la maladie du désir, qui a désormais cancérisé la planète : « Dans le monde qui était le leur, il était presque de règle de désirer toujours plus qu’on ne pouvait acquérir ». Ah ! La maladie du désir ! Plus grave que la "maladie d'amour" que chante le désolant MICHEL SARDOU.

Jérôme et Sylvie ont été contaminés (peut-être) par leur activité professionnelle. Il faut dire qu’ils passent leurs journées à poser des questions à des foules de gens : « Pourquoi les aspirateurs-balais se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de modeste extraction, de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite, et pourquoi ? Parce qu’elle est légère ? Parce qu’elle est onctueuse ? Parce qu’elle est si facile à faire : un geste et hop ? (…) ». La liste figure pages 29-30 (dans mon exemplaire, imprimé en 1965 !). Avouez qu’il y a de quoi se laisser gangrener.

LE BOULOT DE JERÔME ET SYLVIE
GEORGES PEREC ADORE LA LISTE, L'ENUMERATION, L'ACCUMULATION, ... LA PARATAXE, QUOI
La maladie de tous les désirs qu’on n’a pas eu le temps de désirer. Voilà le monde qui nous a faits. Voilà le monde qui nous habite. Qui occupe indûment notre territoire intérieur, que nous le voulions ou non. Et nous en devons une bonne part au sinistre EDWARD BERNAYS.
Accessoirement, l'efficacité pratique des campagnes de propagande menées par EDWARD BERNAYS prouve l'effroyable justesse de sa théorie, exposée dès 1928 dans Propaganda. Et par voie de conséquence, l'incontestable VÉRITÉ manifestée dans la psychanalyse. La propagande comme preuve irréfutable que SIGMUND FREUD a tout vu juste, avouez que c'est drôle, comme retour de boomerang !
Et ça prouve aussi que tous ceux qui fouillent dans l'âme humaine (les sociologues, les psychologues, les ethnologues et tous les x...logues, je veux dire concernant les « Sciences » de l'Homme) ne se contentent pas d'établir de simples connaissances, qui s'avèreraient utiles, mais élaborent et fabriquent des instruments de domination dont tous les pouvoirs se servent allègrement pour s'établir et perdurer (= mentir et manipuler). En particulier un pouvoir que je n'ai pas cité ici : le « management » (faire adhérer tous les "collaborateurs" au "projet d'entreprise"), le fléau de la "gestion" des hommes selon le modèle envoyé par ... les Américains.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, guillaume herbaut, tchernobyl, alexandre vialatte, littérature, littré, antiquité du grand chosier, edward bernays, publicité, propagande, gustave le bon, sigmund freud, georges perec, les choses, prix renaudot, sondages, ifop, sofres, laurence parisot, études de motivation, france, économie, propaganda, gouvernement, michel sardou, sciences humaines, société
dimanche, 09 décembre 2012
L'HOMME QUI FIT FUMER LA FEMME
Pensée du jour :

QUAND UN AVEUGLE PREND DES PHOTOS, VOILA CE QUE CA DONNE
IL S'APPELLE EVGEN BAVCAR, IL EST NE EN SLOVENIE
(authentique, évidemment, et il sait visiblement ce que c'est, une femme nue !)
« Rien n'est plus étrange que la mer. Elle part, elle vient, repart, revient, elle se berce ; et elle fait des songes. Elle rêve des îles, des ports et des soleils couchants ; au sud, à l'horizon, elle rêve Alexandrie, mirage nacré, impalpable vapeur, jeu d'étincelles ; au nord, houleuse et couleur de hareng, elle rêve de grands clairs de lune, et les phares de la côte anglaise. Elle rêve les jonques et les lanternes vénitiennes, les éponges et les madrépores, elle rêve de tout, elle se nourrit de reflets et se nourrit de coquillages, des baleines mortes et des cadavres de marins ; elle enfante surtout les nuages, formes mouvantes commes les sculptures de Brancusi, qui s'entre-effacent et s'entre-engendrent à la façon des musiques de Mozart : la mer est un sculpteur abstrait ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé de l’épisode précédent (d'avant-hier, en fait) : le petit EDWARD BERNAYS est devenu grand en écrivant Propaganda (1928), un livre de chevet pour GOEBBELS, HITLER, STALINE, et un « credo » pour tout publicitaire qui se respecte un peu.

SALE ENGEANCE : ÇA MEURT A 103 ANS !!!
Chargé de vendre la cigarette à toute la gent féminine (et pas « gente », qui est un adjectif qualificatif, comme l'ignorent les ignares), il « libère » la femme en établissant un lien entre la « Torch of Freedom » de la Statue de la Liberté et la cigarette allumée, que seront dès lors autorisées à arborer toutes les femmes américaines.
Soit dit en passant, on ne m'enlèvera pas de l'idée que le BOUT DE SEIN joue pour l'imaginaire des hommes un rôle assez voisin de celui du GLAND (selon la psychanalyse) pour l'imaginaire des femmes, et que l'incandescence du bout de la cigarette a quelque chose à voir avec le BOUT DE SEIN, dans l'imaginaire masculin. On nage en plein érotisme, comme on le voit, par exemple avec la photo de la pin-up à poils (de moustache) ci-dessous.

 Oui, il faut préciser que la torche que la Liberté tient dans la main droite s’appelle en américain : « Torch of Freedom ». C’est comme ça que la cigarette allumée, délicatement tenue par deux doigts d’une exquise main féminine, devint à son tour la « Torche de la Liberté ». Et vive la métaphore ! Tout est dans la nomination, on vous dit.
Oui, il faut préciser que la torche que la Liberté tient dans la main droite s’appelle en américain : « Torch of Freedom ». C’est comme ça que la cigarette allumée, délicatement tenue par deux doigts d’une exquise main féminine, devint à son tour la « Torche de la Liberté ». Et vive la métaphore ! Tout est dans la nomination, on vous dit.
Ben oui, il suffit de donner à la chose désagréable le nom adéquat pour faire passer sans douleur la dite chose : appelez donc votre plan de licenciements massifs « Plan de Sauvegarde de l’Emploi », et soudain vous verrez, tout change. On appelle ça la magie de l'EUPHEMISME.  VICTOR KLEMPERER a longuement étudié ça sous le règne d’HITLER (dans LTI, la langue du 3ème Reich, une lecture indispensable).
VICTOR KLEMPERER a longuement étudié ça sous le règne d’HITLER (dans LTI, la langue du 3ème Reich, une lecture indispensable).
GEORGE ORWELL, avec sa "novlangue" (dans 1984), a lui aussi bien cerné le problème ("l'esclavage, c'est la liberté"). C'est pourquoi on peut se demander si la théorie de SIGMUND FREUD n'a pas nourri indirectement le système hitlérien, à commencer par sa dimension de propagande ? Il y a de quoi se demander, non ? Mais pour revenir à la campagne publicitaire d'EDWARD BERNAYS, ça ne suffisait pas.
a lui aussi bien cerné le problème ("l'esclavage, c'est la liberté"). C'est pourquoi on peut se demander si la théorie de SIGMUND FREUD n'a pas nourri indirectement le système hitlérien, à commencer par sa dimension de propagande ? Il y a de quoi se demander, non ? Mais pour revenir à la campagne publicitaire d'EDWARD BERNAYS, ça ne suffisait pas.
Pour que l’événement fasse date, pour que la campagne atteigne efficacement son objectif, il faut frapper les imaginations, il faut que toute la presse en parle, il faut que tout le pays en parle, il faut du spectaculaire et du scandaleux. Et c’est là que le savoir-faire d’EDWARD BERNAYS va faire merveille.
Chaque année, la ville de New York organise une « manifestation-spectacle ». « New York Easter Parade », ça s’appelle. Un événement annuel de portée nationale, qui a lieu depuis 1880. On va stipendier une cohorte d’accortes bougresses artistement vêtues, on va prévenir en douce les photographes et autres journalistes qu’il va se passer quelque chose et qu’ils doivent se tenir prêts.

NEW YORK EASTER PARADE 2012 !!!!! ÇA CONTINUE !!!!
Et le jour du « Easter Sunday » 1929, quand la troupe des jolies femmes sort des sacs à main une cigarette, que chacune la porte à ses lèvres pulpeuses et, comble du culot, en allume l’extrémité, tout est prêt, EDWARD BERNAYS peut dire que sa campagne est un succès et qu’il a mérité son gros chèque. Les images scandaleuses s’étalent en « une » des journaux, de l’Atlantique au Pacifique.
Les femmes peuvent désormais se proclamer « libérées » par la grâce d’une magistrale campagne de publicité. On est en 1929. L’industrie du tabac peut se frotter les mains. « La moitié du ciel » (les femmes, selon MAO TSE TOUNG) va faire pleuvoir les pépètes, pésètes et autres picaillons dans son porte-monnaie largement ouvert sur les profondeurs abyssales des comptes en banque des actionnaires enchantés. Le « marché », en un clic, a tout simplement doublé de surface.
Bon, alors, le lecteur va me dire maintenant : « Mais qu’est-ce qui te permet, blogueur excessif, de considérer EDWARD BERNAYS comme un quasi-génie ? ». Bonne question. Qu’est-ce qu’elle prouve, la campagne pro-tabac de 1929 ? Qu’est-ce qui fait de son auteur un révolutionnaire ? Tiens, juste un avant-goût : le premier paragraphe de Propaganda.

Au moins, on se dit qi'il ne prend pas de gants, EDWARD BERNAYS. Et ça n'est que le tout début de 110 pages qui décoiffent (je ne compte pas la préface). J'attire juste l'attention sur "gouvernement invisible".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art, france, société, culture, alexandre vialatte, littérature, humour, edward bernays, propagande, publicité, public relations, goebbels, hitler, staline, communication, statue de la liberté, sigmund freud, victor klemperer, lti, new york, mao tse toung, grammaire, langue française, propaganda
samedi, 08 décembre 2012
LA PESTE DE LA FÊTE DES LUMIERES
Pensée du jour :

LA BEAUTE SELON CHRISTIAN VOGT
« Le désert engendre les dieux. "Jouez hautbois, résonnez musettes", c'est des sables de Palestine que nous viennent les chants des bergers ; c'est du ciel du désert qu'arrivent les anges en blanc qui sonnent dans des trompettes en or ; c'est sur les dunes de Jordanie ridées du vent, ourlées par lui, brodée comme un ouvrage de dames, que s'imptiment les pas des rois mages et que s'élève une odeur d'encens. Terre aride. On a dit que le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Et le désert, c'est le soleil et la mort. Une autre dimension de la terre. Le pur espace des géomètres. Et c'est ce sol qui ne produit rien qui donne les dieux. L'esprit souffle sur lui. L'esprit désincarné ».
ALEXANDRE VIALATTE
J’interromps momentanément ma série sur EDWARD BERNAYS, mais c’est pour une bonne cause : il y a urgence. Demain soir, il sera trop tard !
Oui, ALERTE !!! Lyon est submergé depuis deux jours par des hordes (on parle de 2.000.000 sur quatre jours) de gens affairés qui, le nez dans un plan de la ville, cherchent avidement le lieu où se passe la "Fête des Lumières".
En tant que vieux Lyonnais dûment estampillé, je voudrais ouvrir leurs yeux et dénoncer l'imposture. Une partie de mon argent de contribuable s'évanouit dans des machines sophistiquées, qui projettent sur des façades illustres (Palais des Beaux Arts, Saint Nizier, ...) le produit lumineux, dégénéré et coûteux conçu dans l'esprit tordu de quelques "artistes" autoproclamés. Je m'insurge, je me gendarme et je crie au scandale.
Qu'on se le dise : Lyon est le lieu exclusif des
ILLUMINATIONS DU 8 DECEMBRE.
Et "illuminer" consiste essentiellement dans l'alignement, au soir de ce 8 décembre (et seulement ce soir-là), sur le rebord des fenêtres, de petits verres cannelés à l'intérieur desquels tremble la flamme d'un lumignon.

Il faut avoir vu danser, sur le rebord de sa propre fenêtre, les huit ou douze rais de lumière échappés de la modeste chose modestement posée, soumise aux aléas de la brise, de la bise, de la neige et de la pluie. Qu'on est heureux, en rentrant de la Brasserie Georges où l'on a fini la promenade du soir, en constatant que les modestes flammes ont résisté.
Je plains tous ceux qui, se promenant sur les quais du Rhône et de la Saône, n’ont jamais été pris dans l’incroyable magie de milliers de flammes vacillantes, que les cannelures de verres spécialement dédiés à cette occasion démultiplient. De vraies rampes lumineuses qui traversaient la ville de part en part, voilà ce que c'était, les « Illuminations ».

Pour savoir ce que sont les VRAIES, les AUTHENTIQUES « Illuminations » de Lyon le 8 décembre, j’en suis désolé pour les autres, il faut avoir été témoin du temps où la ville n’avait pas encore été transformée en gigantesque attrape-touriste, en colossal parc d’attraction à l’américaine, en monstrueux espace « spectaculaire-marchand » (GUY DEBORD), en gros mensonge infantile, technique et malfaisant.
Voilà ce que je dis, moi, à monsieur GERARD COLLOMB.
P.S. Voilà ce que ça doit donner, les vrais lampions du 8 décembre à Lyon (ceux-là sont particulièrement bien dotés : 14 rais de lumière, qu'il faut imaginer tout tremblants, dès le plus léger souffle d'air) :
Et rien d'autre.
Voilà tout.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, humour, société, lyon, france, tourisme, 8 décembre, illuminations, fête des lumières, gérard collomb, femme, beauté
vendredi, 07 décembre 2012
LIBEREZ-VOUS, MESDAMES : FUMEZ !
Pensée du jour :

AUTRE IDEE DE LA BEAUTE SELON LUCIEN CLERGUE
« Je vous cèderais volontiers ma place, malheureusement, elle est occupée ! ».
GROUCHO MARX
 Résumé de l’épisode précédent : les femmes doivent leur « libération », non pas aux « luttes » féministes, comme la rumeur s’en colporte encore aujourd’hui avec une veule complaisance, mais à EDWARD BERNAYS, dont elles ont obtenu – et de façon spectaculaire – l’autorisation de brandir en public un petit cylindre d’une substance végétale délicatement et finement découpée, et soigneusement enveloppée d’une feuille extrêmement fine de papier de riz, dont l’extrémité peut à volonté être portée à incandescence, une fois que l’autre extrémité a été sensuellement glissée entre les lèvres féminines.
Résumé de l’épisode précédent : les femmes doivent leur « libération », non pas aux « luttes » féministes, comme la rumeur s’en colporte encore aujourd’hui avec une veule complaisance, mais à EDWARD BERNAYS, dont elles ont obtenu – et de façon spectaculaire – l’autorisation de brandir en public un petit cylindre d’une substance végétale délicatement et finement découpée, et soigneusement enveloppée d’une feuille extrêmement fine de papier de riz, dont l’extrémité peut à volonté être portée à incandescence, une fois que l’autre extrémité a été sensuellement glissée entre les lèvres féminines.

EDWARD BERNAYS, donc, et personne d’autre. EDWARD BERNAYS, que le magazine Life, en son temps, a désigné comme l’une des personnes les plus influentes du 20ème siècle. EDWARD BERNAYS, injustement maintenu dans un obscur cagibi du purgatoire des célébrités.

JOSEPH GOEBBELS, INITIATEUR DE LA "PROPAGANDASTAFFEL"
A LA DEMANDE DE SON MENTOR
Il s’agit bien de lui, et les notes que ce blog lui consacre ne visent qu’à réparer une sorte d’injustice : oui, il est temps de rendre justice à un homme dont les travaux ont brillamment inspiré des communicants aussi renommés et efficaces que JOSEPH GOEBBELS, ADOLF HITLER et JOSEPH STALINE, qui avaient sur leur table de chevet le maître-ouvrage du maître : Propaganda ou comment manipuler l’opinion en démocratie (éditions Zones-La Découverte, 2007, 141 p., 12 euros, c’est quasiment donné, et ça fait tomber quelques peau de "soss" devant les yeux qui en avaient).
Si je reformule le sous-titre, ça donne quelque chose comme : « Comment faire adhérer sans contrainte les masses aux discours d'un homme au pouvoir, et jusqu'aux folies d'un dictateur ». En regardant bien, on constate que c'est le principe qui régit tous les gouvernements actuels.

UN AMI DE L'HUMANITE QU'ON NE PRESENTE PLUS
Je vous explique : comme sa mère s’appelle ANNA FREUD, sœur de SIGMUND, et que son père est le frère de MARTHA BERNAYS, qui se trouve être l’épouse du dit SIGMUND, il devient à sa naissance neveu au carré d’un certain SIGMUND FREUD, l’écrasant papa d’une grosse bête appelée « Inconscient » et de tout ce qui se trouve dedans quand on la dissèque. Il est d’ailleurs sympa avec son neveu, le grand FREUD : il lui dédicace un exemplaire de son Introduction à la psychanalyse. Et le neveu, il va y mettre le nez, et pas qu’un peu.

En 1929, le président du consortium des producteurs de tabac, futur gros client de son officine, lui dit : « Comme les femmes ne peuvent pas fumer en public, nous perdons la moitié d’un énorme marché. Pouvez-vous faire quelque chose ? ». EDWARD BERNAYS répond : « Laissez-moi y réfléchir ». Puis il demande : « M’autorisez-vous à chercher du côté de la psychanalyse ? – Mais œuf corse ! Ne vous gênez pas ». Rappelons qu'à l'époque, la femme qui fume sur un trottoir est traitée de pute, ni plus ni moins.
Ni une ni deux, il se précipite chez ABRAHAM A. BRILL, un des premiers grands psychanalystes des Etats-Unis, non pas pour s’étendre sur un quelconque divan, mais pour poser une question au savant : « Que représente la cigarette pour la femme ? ». La réponse fuse : « Le pénis ! ». C’est clair, net et précis. Autrement dit la berdouillette, le scoubidou, la merguez (ou chipolata, au point où on en est), le cigare à moustaches, la bistouquette. En trois mots comme en cent : la BITE, la PINE, le CHIBRE.
EDWARD BERNAYS ne se démonte pas pour autant, c’est un esprit pratique. Il a un gros client, et le client, surtout le gros, est roi. Alors il a l’idée du siècle : le symbole de l’Amérique, c’est le cadeau fait par la France à l’occasion de son centenaire (celui des Etats-Unis !). J’ai nommé le chef d’œuvre d’AUGUSTE BARTHOLDI. J’ai nommé la statue de La Liberté éclairant le monde (inaugurée en 1886).

Deuxième étape dans l’élaboration du message : la torche que tient la Liberté est incandescente, le bout de la cigarette allumée est incandescent. Il faudrait être stupide pour ne pas faire le rapprochement, avouez ! Qui plus est, la Liberté, qu’elle guide le peuple ou qu’elle éclaire le monde, c’est une Femme, regardez DELACROIX. Concluez vous-même : EDWARD BERNAYS a sa campagne de « public relations » en poche, c’est comme si c’était fait.

LÀ, ELLE GUIDE LE PEUPLE.
C'EST BIEN UNE FEMME, SELON TOUTE APPARENCE.
Voilà ce que je dis, moi.
P.S. DERNIERE MINUTE : nous apprenons une triste nouvelle :

Adressons donc nos très sincères condoléances à l'U.M.P., et surtout à son "président autoproclamé".
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, féminisme, mlf, photographie, lucien clergue, beauté féminine, humour, groucho marx, edward bernays, communication, propagande, publicité, tabac, magazine life, goebbels, adolf hitler, joseph staline, propaganda, manipulation, sigmund freud, psychanalyse, sexe, cigarette, bartholdi, statue de la liberté, la liberté éclairant le monde, eugène delacroix, inconscient, anna freud, françois fillon, ump, jean-françois copé
jeudi, 06 décembre 2012
LIBEREZ-VOUS, MESDAMES !
Pensée du jour :

BOURGES
« Parmi d'autres calamités, les journaux annoncent les vacances. En grosses manchettes, avec des sous-titres effrayants : "Trains complets", "Les embouteillages", "Les villes étapes son engorgées". Cent mille [sic !] gendarmes sur les routes, vingt hélicoptères, six mille trains, quatre ou cinq millions de "vacanciers". C'est une page de Céline, un bilan de catastrophes, "et ce n'est pas encore le grand rush". L'homme fuit les HLM comme l'invasion allemande. Fatigué de faire sécher ses chaussettes au dixième, sur une ficelle, à une fenêtre de banlieue, il a formé le rêve osédant de les faire sécher au rez-de-chaussée, devant une tente inconfortable, dans un camp de cent mille Parisiens ».
ALEXANDRE VIALATTE

FEMMES "LIBEREES" PAR LA MUSIQUE "ALTERNATIVE" EN RUSSIE
A quoi voit-on qu’une femme est « libérée » ? A ce qu’elle conduit une voiture ? A ce qu’elle travaille ? A ce qu’elle a un compte en banque ? A ce qu'elle a jeté, selon la vieille injonction du MLF, son soutien-gorge aux orties ? A ce qu'elle s'habille en camionneur ou en métallo pour marquer son refus des stéréotypes de la femme-objet?

FEMME "LIBEREE" PAR L'ATHLETISME, LE PLEIN AIR ET L'AIR DU LARGE
A ce que la pilule anticonceptionnelle lui permet de faire l’amour aussi souvent qu’elle veut et avec qui elle veut, et à partir de là, de décréter : « Mon corps est à moi. Des enfants, si je veux, quand je veux », et d’imposer la loi de son « bon plaisir » ? A ce que c’est elle, désormais, qui tient la porte aux messieurs ? Vous n’y êtes pas. On voit qu’une femme est « libérée » à ce qu’elle FUME. Enfin, en disant ça, il faut remonter aux années 1930.

FEMME "LIBEREE" PAR LA CIGARETTE LUCKY STRIKE
C’est entendu : la femme est l’égale de l’homme. La femme est libre. Du moins aussi libre que l’homme. Il faudrait même peut-être dire : plus libre. La preuve irréfutable en est vestimentaire : le pantalon a conquis les femmes, alors que la robe a déserté les curés et que la jupe a été recalée chez les hommes. L’égalité homme-femme est un idéal, à la seule condition de rester à sens unique. Un beau hold-up sur la notion d’égalité, soit dit en passant. Mais foin de controverses : nous sommes ici pour célébrer.
Il est vrai qu'aujourd’hui, la lutte anti-tabac a tant soit peu modifié les aspects du problème. Car on n’a pas toujours voué le tabac aux gémonies. Et au contraire, il fut même assimilé à un instrument de « libération », comme je vais tâcher de le montrer. Et ça ne remonte pas au déluge, aux cavernes ou aux « âges farouches » (n'est-ce pas, Rahan ?). Cela remonte exactement à 1929. Et cette « conquête » de la liberté est due, certes, au mouvement de l’histoire, aux circonstances, aux évolutions de la société, mais aussi (et peut-être surtout) à un homme, et un seul (ou peu s’en faut).
Cet homme est celui qui a fait admettre à l’opinion publique américaine l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917. Celui qui a constaté, en accompagnant WOODROW WILSON à Paris en 1919, l’effet de sa campagne de « public relations » sur les Français, qui ont fait un triomphe ahurissant et inimaginable au président américain, et ont fêté en lui le « libérateur des démocraties européennes ». Même que lui, l’auteur de la campagne, en est resté sur le cul.
Cet homme s’est alors demandé comment gagner de l’argent pour assurer sa subsistance. Et cet homme s’est dit que, étant donné l’extraordinaire effet de la propagande qu’il avait contribué à mettre au point en temps de guerre, pourquoi ne pas en appliquer les principes en temps de paix ? Lumineux, non ?
Malheureusement, le mot « propagande » blessait les oreilles, les esprits, les âmes de tout démocrate confiant dans la puissance de la Raison. La raison sociale de la boutique que cet homme ouvrit fut en conséquence baptisée « council in public relations », « conseil en relations publiques ». Comme c’est bien dit. Ça vous a tout de suite une autre gueule, plus avenante, plus souriante, moins compromettante, n’est-ce pas ?
La publicité de l’époque était ridiculement arriérée. Rendez-vous compte que, pour vendre un produit, la firme qui le produisait se contentait d’en vanter l’utilité, la fonctionnalité, l’efficacité. Bref, dans cette publicité préhistorique, on se contentait de vanter l’exacte conformité d’un objet avec l’usage auquel il devait servir : le principal mérite de l’aspirateur est d’aspirer, celui de la casserole, de contenir la nourriture à cuire, etc. Tout ça est minable et bêtement primitif. « Attendez que je m’en mêle, et vous allez voir ce que vous allez voir ! », clame EDWARD BERNAYS.

LE "LIBERATEUR" DE LA FEMME, LE SEUL, L'UNIQUE
Effectivement, cet homme va changer le monde, rien de moins (et pas "rien moins", comme le croient certains qui veulent faire cultivé, et qui mettent un subjonctif imparfait dans la complétive qui suit un conditionnel présent, il ne faut jamais oublier la grammaire, disait ALEXANDRE VIALATTE).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cathédrales, plan, dessins, alexandre vialatte, littérature, humour, libération de la femme, féminisme, égalité hommes-femmes, états-unis, woodrow wilson, president des états-unis, edward bernays, propagande, publicité, public relations, relations publiques




