dimanche, 07 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE

COUPLE BOURGEOIS, PAR AUGUST SANDER
***
Montaigne fut le premier écologiste. Je ne l’affirme pas, je le prouve : « Mais, quand je rencontre, parmi les opinions les plus modérées, les discours qui essaient à montrer la prochaine ressemblance de nous aux animaux, et combien ils ont de part à nos plus grands privilèges, et avec combien de vraisemblance on nous les apparie, certes, j’en rabats beaucoup de notre présomption, et me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu’on nous donne sur les autres créatures. Quand tout cela en serait à dire, si y a-t-il un certain respect qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle ». Qui y trouverait à redire ?
Peut-être Carolyn Christov-Bakargiev, responsable d’une foireuse foire d’art contemporain (« arcon » en abrégé, opposé à l’ « art temporain », je crois que la dame sévit à la Documenta de Kassel), qui a par ailleurs rédigé une Déclaration des Droits des plantes (elle travaille même sérieusement à leur faire accorder le droit de vote, des élections locales jusqu'à l'ONU) : elle trouverait Montaigne d’une insupportable pusillanimité. Une femme tonique, une merveilleuse éradicatrice de civilisation, à l'image exacte des canons de l'époque où elle a été condamnée, hélas, à exister.

ELLE A POURTANT L'AIR NORMAL, MADAME CAROLYN CHRYSTOV-BAKARGIEV
Dans l’Apologie de Raymond Sebond (II, XII), Montaigne tourne dans tous les sens la question de ce qui différencie l’homme de l’animal. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas convaincu que l’homme est un animal si différent que ça des autres animaux : « ceux qui entretiennent les bêtes se doivent dire plutôt les servir qu’en être servis ».
On n’est pas plus net, ce me semble, et la hiérarchie établie par la doxa biblique, le Vatican et la Sorbonne latinisante entre les êtres vivants n’est, aux yeux de Montaigne, qu’une manifestation d’arrogance dérisoire. Pascal Picq et tous ses copains de l’abolition des frontières entre l’homme et l’animal doivent hoqueter de bonheur en voyant se profiler à l'horizon la tombe à venir de l’humanité. Et toc ! Pascal Picq voit une amorce du politique dans les rituels tribaux des groupes de chimpanzés, c'est vous dire ce qui nous pend au nez. Moi je dis à Pascal Picq : « Ben mon pote, on n'est pas sortis de l'auberge espagnole ». Remarquez que Sarkozy en chimpanzé (avec Hollande en Cheetah ?), ça n'aurait rien de bien défrisant. Notez que "cheetah" veut dire "guépard" (d'après mon dictionnaire).
Marcel Gauchet, dans Le désenchantement du monde (1985), rappelle que « le christianisme est la religion de la sortie de la religion ». Je soupçonne quant à moi le sieur Michel de Montaigne d’y être pour quelque chose. Vous voulez une preuve ? Prenez le chapitre XVI du Livre II des Essais (De la gloire) : « Le marinier ancien disait ainsi à Neptune en une grande tempête : Ô Dieu, tu me sauveras si tu veux ; tu me perdras si tu veux. En attendant, je tiendrai mon timon toujours ferme et droit ».
La Fontaine, au siècle suivant, a dit la même chose autrement : « Aide-toi, le ciel t’aidera ». Eh oui, l’homme chrétien n’attend plus passivement le bon vouloir de la providence : il fait quelque chose pour faire advenir la providence. L'action humaine entre en action. C'est une révolution, car c’est le début de la fin du christianisme. Si l’homme doit agir pour que le Ciel l’aide, c’est que le Ciel n’est pas tout-puissant, et que l’homme est devenu impatient, et il s'agace de cette bizarre impuissance du Ciel à combattre le Mal qui le menace. La remarque de Montaigne, comme celle de La Fontaine, c’est une marque du slogan futur : « Deviens ce que tu fais ». Dit autrement : agis, et tu seras sauvé. Tout le monde actuel, quoi, à part le "sauvé", vu la façon dont tourne ce qui reste de la nature. Mais comme dit l'autre (c'est toujours "l'autre") : il suffit d'y croire.
Et l'on se demande pourquoi nous sommes déchristianisés !!! Je le disais : avec Montaigne, le ver est dans le fruit : il voit l'homme non plus comme l'exclusive créature de Dieu, mais comme l'une parmi toutes les autres. Une sorte de « primus inter pares ». Avec Montaigne, le vrai n'est plus légitime. Tout simplement parce que, avec Montaigne, il n'y a plus de vrai de vrai.
Montaigne n'est peut-être qu'un symptôme de la montée en puissance qui attend l'Occident au tournant, mais ce ver dans le fruit que j'y vois, cette démission de légitimité du vrai, c'est exactement au même rythme qu'il croque dans la pomme que nous sommes. Le « canard du doute », qu'on trouve dans Les Chants de Maldoror, d'Isidore Ducasse, alias Comte de Lautréamont. Comme dit Maldoror : « Je te salue, vieil océan ! ».
Voilà : je te salue, vieil océan.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, montaigne, les essais de montaigne, littérature, écologie, carolyn christov-bakargiev, art contemporain, documenta kassel, apologie de raymond sebond, pascal picq, sarkozy, françois hollande, marcel gauchet, le désenchantement du monde
samedi, 06 juillet 2013
MON ANTHOLOGIE MONTAIGNE

COUPLE D'INDUSTRIELS, PAR AUGUST SANDER
***
Je pioche dans mon anthologie personnelle des Essais de Montaigne : « Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu’elle porte, et ai raison, car j’en ai vu des effets très-dommageables » (I, XXIII, De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue). Cette pathologie tout uniment avouée porte un nom savant : c’est le misonéisme, c’est-à-dire la haine de tout ce qui est nouveau. S'il recevait comme nous sur le crâne le déluge de nouveau dont tous les marchands de la terre et autres planètes voisines nous assaillent, dans quel état respiratoire se trouverait-il ?
J’aime bien ceci : « Tout ainsi qu’en l’agriculture les façons qui vont avant le planter sont certaines et aisées, et le planter même ; mais depuis que ce qui est planté vient à prendre vie, à l’élever il y a une grande variété de façons et difficulté : pareillement aux hommes, il y a peu d’industrie à les planter ; mais, depuis qu’ils sont nés, on se charge d’un soin divers, plein d’embesognement et de crainte, à les dresser et nourrir » (I, XXVI, De l’institution des enfants). Messieurs et bien chers frères, sachons rester humbles : pour ce qui est des hommes, "il y a peu d'industrie à les planter". Il n'a malheureusement pas tort. Heureusement, il dit quelque part ailleurs : « Madame, j'espère que vous avez eu autant de facilité à le faire sortir que de plaisir à le faire entrer » (cité de mémoire).
Au sujet du « devoir conjugal », Montaigne conseille aux maris la modération sexuelle « à l’accointance de leur femme ». Car « il y a de quoi faillir en licence et débordement », dont il craint les pires dommages. Et il conclut sur ce point : « Qu’elles apprennent l’impudence au moins d’une autre main. Elles sont toujours assez éveillées pour notre besoin. Je ne m’y suis servi que de l’instruction naturelle et simple. (…) Certaines nations, et entre autres la Mahumétane, abominent la conjonction avec les femmes enceintes ; plusieurs aussi, avec celles qui ont leurs flueurs » (I, XXX, De la modération). Le Kama-Sutra débridé, ce n'est pas son affaire, on a bien compris. Mais "qu'elles apprennent l'impudence d'une autre main" ! Franchement, il a de ces formules ! Tout le monde aura compris "flueurs", je pense.
Montaigne décrit ainsi son blason : « Je porte d’azur semé de trèfles d’or, à une patte de lion de même, armée de gueules, mise en face » (I, XLVI, Des noms). Traduction de l’héraldique, qui est un langage, un art et une science : sur fond bleu, un champ de trèfles jaunes, sur lequel est posé horizontalement une patte de lion dont les griffes sont rouges, comme le montre l’illustration. Je ferai éventuellement quelque chose sur le langage du blason, m'étant arrivé de voir mes modestes propos publiés dans de modestes revues modestement savantes.

Montaigne n’aimait pas la nouveauté (voir plus haut), ce qui lui faisait parfois manquer singulièrement de flair : au combat, il aime mieux se fier à la qualité de son épée (et de son bras) qu’au « boulet qui échappe de notre pistole, en laquelle il y a plusieurs pièces, la poudre, la pierre, le rouet, desquelles la moindre qui viendra à faillir, vous fera faillir votre fortune ». Il ajoute pour faire bonne mesure : « et sauf l’étonnement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprivoisé, je crois que c’est une arme de fort peu d’effet, et espère que nous en quitterons un jour l’usage ». Comme quoi, mon Mimi (Montaigne se prénomme Michel, nobody's perfect), tout le monde peut se tromper : que dirais-tu si tu lisais nos journaux, entre les écoliers américains abattus par dizaines de milliers, les escrocs politiques français par centaines de milliers, les rebelles syriens par millions et les journalistes russes sous le règne de Poutine par milliards ?
J’aime bien l’anecdote suivante, concernant une de ses amies, que Montaigne rapporte dans De l’ivrognerie (II, II) : la dame est veuve et chaste. Un beau jour, catastrophe, horreur, enfer et damnation, elle est enceinte, il n’y a pas de doute. Bravant le risque de la honte, elle fait demander au coupable, par le biais du curé en chaire, de se dénoncer, promettant de lui pardonner « et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. Un sien jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble ». Je traduis « indécemment » par « le cul à l'air » ...ou pire.
Ah le vin ! Je note ici que ce n’était pas un valet de pâturage, mais de labourage : comme dit la chanson : « Emmener sa femme au champ pour la…bourer ». C’est peut-être à cela que Sully pensait, en évoquant les mamelles de la France, allez savoir ? Montaigne achève ainsi une digression où il est question de son père (« Pour un homme de petite taille, plein de vigueur et d'une stature droite et bien proportionnée ») : « Revenons à nos bouteilles ».
Et cette autre histoire gaillarde, où il conte « le bon mot que j’appris à Toulouse, d’une femme passée par les mains de quelques soldats : Dieu soit loué, disait-elle, qu’au moins une fois en ma vie je m’en suis soûlée sans péché » (II, III, Coustume de l’île de Cea). J'adore ce cri du coeur : "Je m'en suis soûlée sans péché !". Presque une apologie du viol, vous ne trouvez pas ? On ne risque pas de trouver ces quelques histoires dans Lagarde et Michard. On va peut-être dire que je les choisis exprès ? Et moi, impavide, je rétorque : « Ben tiens, je vais me gêner ! ».
Maintenant, je voudrais m’adresser à tels grands-pères de ma connaissance, qui se mettent à fondre comme beurre en casserole chaude et deviennent gagas quand le petit-fils les regarde dans les yeux, grave comme un pape le jour de la messe de Pâques : grands-pères fondus et gagas, lisez donc le chapitre VIII du Livre II des Essais de Montaigne. Son titre ? De l’affection des pères aux enfants. Il me semble que c’est en mesure de décoiffer quelques chauves. Montaigne s’adresse (respectueusement) à madame Geoffroy d’Estissac :

« Comme, sur ce sujet de quoi je parle, je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine nés, n’ayant ni mouvement en l’âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas soufferts volontiers nourris près de moi. Une vraie affection et bien réglée devrait naître et s’augmenter avec la connaissance qu’ils nous donnent d’eux ; et lors, s’ils le valent, la propension naturelle marchant du même pas que la raison, les chérir d’une amitié vraiment paternelle ; et en juger de même, s’ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle ». J'insiste sur "s'ils le valent". En clair : si le bébé montre en grandissant qu’il mérite notre affection, allons-y, mais s’il ne la mérite pas, n’y allons pas. Autrement dit : c’est au gamin de prouver qu’il mérite d’être aimé. Que penserait Montaigne de l'actuelle divinisation de l'enfant ?

CES DEUX VIGNETTES SONT TIRÉES DE DINGODOSSIERS 1, DE GOSCINNY ET GOTLIB
Mais ce n’est pas fini. Il conclut même très fort : « Il en va fort souvent au rebours ; et le plus communément nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous ne faisons auprès de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes ». Ce n’est peut-être pas gentil pour les guenons. Notez que Montaigne ne s’exclut pas de la réaction niaise de l’adulte face au bébé. Peut-être même qu’il s’agace de réagir ainsi. Eh oui, ma pauvre dame, on ne fait pas toujours comme on veut.
Voilà ce que je dis, moi, aux grands-pères de ma connaissance !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, les essais de montaigne, de l'institution des enfants, blason, armoiries, lagarde et michard
vendredi, 05 juillet 2013
POURQUOI J'AI LU MONTAIGNE

COUPLE, PAR AUGUST SANDER
***
Alors pour finir : « Mon Montaigne à moi, c’est quoi ? » (sur l'air célèbre d’Edith Piaf). La réponse à la question, tout le monde connaît, c’est : « Je suis toujours à la fête ». Mon Montaigne à moi, c’est devenu une anthologie. Mon anthologie. Ou ce que vous voulez, appelez ça épitomé, miscellanées, chrestomathie, analectes, je n’y vois aucun inconvénient. J’accepte même « florilège », c’est vous dire si j’ai l’esprit large.
Parfaitement, je me suis fait ma collection de citations de Montaigne. Je vous rassure, elle ne ressemble guère à ce dont monsieur Lagarde et monsieur Michard ont toléré la présence dans leur relevé laborieux des balises du parcours obligé du lycéen. Je ne dis pas que mes quarante-cinq pages A4 leur feraient toutes dresser leurs trois cheveux sur leur crâne chauve, mais ils seraient horrifiés à l’idée qu’on puisse en mettre quelques-unes sous les yeux de la jeunesse. Et pourtant, ils auraient à y gagner. Je parle des yeux des lycéens.
Tiens, pour mettre en appétit, vous apprécierez ceci : « Les outils qui servent à décharger le ventre ont leurs propres dilatations et compressions, outre et contre notre avis, comme ceux-ci destinés à décharger nos rognons. Et ce que, pour autoriser la toute puissance de notre volonté, Saint Augustin allègue avoir vu quelqu’un qui commandait à son derrière autant de pets qu’il en voulait, et que Vives, son glossateur, enchérit d’un autre exemple de son temps, de pets organisés suivant le ton des vers qu’on leur prononçait, ne suppose non plus pure l’obéissance de ce membre : car en est-il de plus indiscret et tumultuaire ». On trouve ça au chapitre XXI du livre I, intitulé De la Force de l'imagination, p. 102-103.
Trois cents ans avant que Joseph Pujol, le virtuose du pet volontaire (nom de scène : « le Pétomane», à partir de 1891) se produisît devant des salles combles de Parisiens en délire ! « Premièrement, il faisait le Pet de la jeune fille timide, puis le Pet de la couturière, le Pet du monsieur bègue, etc. Ensuite, écartant les basques de son habit rouge et, tirant de sa petite culotte un tuyau de caoutchouc, fumait une cigarette ... par sa bouche postérieure », écrivent Jean Feixas et Romi dans Histoire anecdotique du pet (Ramsay/Pauvert). Il jouait aussi à la flûte "Au Clair de la lune" et "Le Roi Dagobert". Mais revenons à Montaigne.

Pour faire bonne mesure : « Joint que j’en sais un si turbulent et revêche, qu’il y a quarante ans qu’il tient [retient] son maître à péter d’une haleine et d’une obligation constante et incessante, et le mène ainsi à la mort ». L’édition de 1595 ajoute cette fragrance délicate de méthane intestinal : « Et plût à Dieu que je ne le susse que par les histoires, combien de fois notre ventre par le refus d’un seul pet, nous mène jusqu’aux portes d’une mort très angoisseuse ; et que l’Empereur qui nous donna liberté de péter partout, nous en eût donné le pouvoir ». J'en conclus que Lagarde et Michard se sont privés d’un moyen facile de motiver les adolescents à la lecture de Montaigne.
Rien ne serait plus efficace au lycée pour faire comprendre qu’il est dangereux de réprimer chez l’homme, par souci de convenance, ce qui vient de la nature. C’est ce qui est arrivé à Claude Chabrol, qui a eu un « malaise vagal », parce qu’il retenait un énorme pet (qu'il commit finalement sur le brancard qui l'emportait à l'hôpital), par pure courtoisie pour Sacha Distel, qui poussait des roucoulades interminables à la fin d’un banquet (c'est Claude Chabrol lui-même qui raconte l'épisode).
Il était culturellement intolérable à Lagarde et Michard de ne pas infliger au lycéen le ciseau des censures paralysantes qu’eux-mêmes avaient subies étant jeunes, comparables au rituel de la piqûre du TABDT (ou DTTAB) imposé aux jeunes recrues du service militaire, quand il y en avait encore un (une piqûre qui paralyse l’épaule, enfin c’était à l’époque d’Hérodote ou d'Hippocrate pour le moins).
Mon anthologie à moi, si quelque hiérarque éducatif de la technostructure ministérielle en prenait incidemment connaissance, serait en deux temps trois mouvements déclarée hérétique et brûlée séance tenante en place de Grève, s’il existait encore une « Place de Grève », et si l’on brûlait encore les livres. Aujourd’hui, c’est moins spectaculaire : il suffit de ne pas en parler. Le mutisme sur un grand livre est devenu plus efficace qu’un incendie volontaire. Ou que son étude par Lagarde et Michard.
Parce que je vais vous dire : la philosophie de Montaigne, je m’en tamponne le coquillard. Non, ce n'est pas vrai, mais c’est vrai qu’apprendre les étapes de son trajet philosophique (pyrrhonien ou sceptique ?) n’est pas le plus sûr moyen de provoquer (et de ressentir) l’intérêt. Pour mon compte, je voulais, en ouvrant une bonne fois pour toutes le bouquin, savoir ce que ce monument avait à me dire. À me dire à moi. Personnellement. Je l’ai dit : n’avoir en perspective que « ce qu’il faut savoir » (tous les vade-mecums de la terre), cela suffit à me décrocher la mâchoire à force de bâiller.
Quand le « Commendatore » lance son invitation (c’est chez Mozart) : « Verrai tu a cenar meco ? », Don Giovanni répond : « Verro » (« Viendras-tu manger en ma compagnie ? – Je viendrai »). Pendant ce temps, Leporello souffle : « Oibo ; tempo non ha, scusate ». N'étant pas Commandeur, j’ai invité Montaigne à ma table, et je dois dire que nous avons devisé agréablement, même si nos propos n’auraient en aucun cas pu être insérés dans le Lagarde et Michard 16ème.
Il faut bien dire que les deux auteurs, riches rentiers du manuel scolaire connu sous l'appellation « lagardémichar », ont réduit à presque rien, sinon quelques poncifs, l’incroyable et riche matière contenue dans les 1116 pages du livre. Mais pouvaient-ils faire autrement ? Et est-il possible d'enseigner vraiment les Lettres ? J'en doute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, montaigne, humanisme, anthologie, lagarde et michard, essais de montaigne, bac de français, claude chabrol, philosophie, don giovanni, joseph pujol, pétomane
jeudi, 04 juillet 2013
POURQUOI JE LIS MONTAIGNE

FORGERONS, PAR AUGUST SANDER
***
J'AI OMIS DE PRECISER (VOIR MA NOTE DU 2 JUILLET) COMBIEN LES PORTRAITS REALISÉS PAR SANDER ET CURTIS REPRESENTENT LES PERSONNES DANS TOUTE LEUR DIGNITÉ.
DE CERTAINES PHOTOS, ON PEUT MÊME DIRE QU'EMANE UN VERITABLE SENTIMENT DE FIERTÉ, COMME CI-DESSUS, PAR EXEMPLE.
***
Nous en étions restés aux origines supposément normandes de Michel, seigneur de la châtellenie de Montaigne. Je galèje évidemment : rien qu’à son accent, on devait savoir à l’époque qu’il n’était pas né à Gravelines, à Strasbourg ou à Bretteville-sur-Laize (Calvados).
Ce qu' « il faut savoir » de Montaigne, selon Lagarde et Michard, ce sont quelques billes noirâtres tombées sur le chemin de Joux (le chalet, le château, le père Pic, Joseph et Marie, le lait bourru), et que quelque tante Monique portera à sa bouche, croyant, dans sa toute jeune ignorance, que ce sont des pastilles contre la toux (d'après un récit familial authentique). Les billes en question étaient tombées, peu de temps auparavant, de l'anus d'une vingtaine de chèvres qui rentraient du pacage.
Il est vrai que la crotte de chèvre fraîchement pondue, encore luisante, revêt tous les attraits d'une friandise incomparable, tout au moins aux yeux d'une âme inexpérimentée. Il est vrai aussi que les effets physiologiques de l'excrément sphérique de ces bêtes à cornes est à peu près négligeable, quand elles s'alimentent dans un environnement globalement préservé, comme c'était le cas au temps de Monique.
En disant que Montaigne doute de sa propre légitimité (d’individu, de catholique, de civilisé, etc.), je me contrefiche de ce qu’en pensent et en disent l’Ecole et l’Université. Ma certitude, après aboutissement autour de la 1200ème page (1116 pour être précis, formidable édition PUF, annotée, de Pierre Villey) : avec Montaigne, pour notre pomme de civilisation occidentale, le ver est déjà dans le fruit. « Le canard du doute », comme dira bien plus tard Isidore Ducasse, alias Lautréamont, dans Les Chants de Maldoror.
Car « le vendredi suivant, le canard était toujours vivant » (clin d’œil en passant à Robert Lamoureux et à un de ses sketches les plus connus). Ben oui, quoi, le canard du doute, en occident, c’est ce qui a fait boiter très bas, dès ses premiers pas, la civilisation occidentale.
La jambe droite, fière et conquérante, proclame : « A l’assaut du monde et des étoiles ! ». Pendant ce temps, la jambe gauche traîne la patte et dit : « Pas si vite ! Savez-vous seulement où vous allez ? ». Pendant longtemps, disons-le, c'est la jambe droite qui a eu la primauté et tenu le haut du pavé. Et je crois que le problème de l’Occident, c’est que la jambe gauche a toujours avancé bien après la jambe droite. Comme si la jambe gauche ignorait ce que faisait la jambe droite, et réciproquement.
Pour preuve, cette scène incroyable où Montaigne rencontre des ambassadeurs des Amériques (avec l’aide d’un « truchement » = « traducteur ») : « Quoi, tous ces hommes faits, forts et redoutables, ils obéissent à cet enfant ? » (citation en substance, et même reconstituée). Cet étonnement des Indiens frappe Montaigne. Les hommes sont les guerriers, et l’enfant, c’est juste le roi de France. Incompréhensible aux yeux des « sauvages ».
Du coup, Montaigne va inventer une machine démoniaque : le RELATIVISME. Et je dois confesser que cette manie d’énumérer les coutumes dans leur diversité et leurs contradictions m’a terriblement agacé au cours de la lecture. Il collectionne le bariolé des coutumes dont il constate l’hétérogénéité radicale, comme les losanges du costume d’Arlequin, pour en conclure que – au moins en termes de coutumes – il n’y a pas de vérité absolue.
Le relativisme absolu (si l’on peut oser cet oxymore) est atteint dans le Livre II, chapitre XII, plus connu sous le titre : Apologie de Raymond Sebond. Un chapitre dont le caractère imposant (par ses dimensions : 167 pages à lui tout seul) m’a très longtemps fait reculer. Mais quand tu es entré là, tout s’éclaire, en particulier l’idée centrale que toutes les coutumes, les plus incroyables, dégoûtantes, choquantes ou révoltantes, dès lors qu’elles sont possibles, représentables ou imaginables, existent. Montaigne a l'air de croire sur parole toutes sortes de « témoins ». Il n’y a pas de vérité universelle.
Je ne sais plus si c’est dans ce très long chapitre que se situe l’épisode de l’éléphant à ce point amoureux d’une femme que, lorsqu’elle paraissait sur le marché où il était, il glissait le bout de sa trompe dans le corsage de la dame pour lui peloter les seins, ne pouvant refréner l’expression de sa flamme. On a l’impression que, aux yeux de Montaigne – y compris les fantasmagories zoologiques qui couraient à l’époque – tout est possible. Rigoureusement. Peut-être imaginait-il sa propre main en lieu et place de la trompe ? Partant de là, tout se justifie. Aucune coutume n’est condamnable par un jugement au-dessus des partis.
Je sais bien que cette particularité en fait un précurseur du combat anticolonialiste, sur le thème « nous n’avons de leçon à donner à personne ». Cette modestie, cette retenue dans le jugement honore le monsieur qui le prononce, mais on voit que Montaigne limitait son propos au point de vue spécifique qui était le sien, et on voit combien il était ennemi de toute généralisation. Familier du particulier, la notion du général lui est totalement étrangère.
Je ne sais pas comment il réagirait aux « associations » (les armées des militants munis de leur bonne conscience, de leurs drapeaux et de leurs uniformes cérébraux, reconnaissables à la justesse éclatante du combat qu’ils mènent « au nom de leurs valeurs ») qui réclament, par exemple, l’interdiction de la barbarie que représente l’excision du clitoris des fillettes. Qu’aurait-il dit de l’infibulation ? Autre exemple (évidemment pris au hasard) : comment aurait-il réagi au mariage des homosexuels (au nom de la valeur universelle que constitue l’ « égalité ») ?
Claude Lévi-Strauss écrivait : « Le barbare est celui qui croit à la barbarie ». Eh bien Montaigne, lui, est celui qui ne croit pas à la barbarie.
Comme Archimède, il chante : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais de point fixe, il n’en trouve aucun (sinon Dieu, mais ça, au 16ème siècle …). Comme il dit : « Pour juger des apparences que nous recevons des objets, il nous faudrait un instrument judicatoire ; pour vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration ; pour vérifier la démonstration, un instrument : nous voilà au rouet. Puisque les sens ne peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison ; aucune raison ne s’établira sans une autre raison : nous voilà à reculons jusques à l’infiny ». En même temps que je me dis qu’il a tort quelque part, je suis obligé de confesser l’admiration : « Nous voilà au rouet » !
Ce qui me rend Montaigne sympathique, dans cette manière de voir les choses, c’est que si quelqu’un, à son époque, s’était avisé d’inventer les statistiques, les sondages et le découpage des populations en « catégories socioprofessionnelles » et autres élucubrations, il se serait insurgé. Je l’imagine, proposant au roi de France, pour ces généralisateurs outranciers, au choix, l’estrapade, l’arrachage de la langue ou la décollation pure et simple. Et pourquoi pas les trois à la fois ?
Aux yeux de Montaigne, si j'ai bien compris, seul compte l'individu : tout individu n'est-il pas un cas particulier, inassimilable à tout autre ? Partant de là, je me dis que, d'une part, il est un ancêtre fondateur de la Déclaration des Droits de l'Homme ; mais que, d'autre part, il faut renoncer à comprendre ce qu'est une société.
Et partant de là, je me dis aussi que, si tant de spécialités diverses (qu'on appelle orgueilleusement "Sciences Humaines" : socio, psycho, ethno, etc.) se donnent pour but de comprendre ce qu'est une société, c'est qu'on a résolu de bien raboter l'individu sur les bords. Et peut-être plus que sur les bords.
Au sujet de l'individu, on peut même se demander ce qu'il en reste ... au milieu.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 03 juillet 2013
POURQUOI JE LIS MONTAIGNE

JEUNES PAYSANS, PAR AUGUST SANDER
***
CE QUE J’AI RETIRÉ DE LA LECTURE DES ESSAIS DE MONTAIGNE
Quand on parle de Montaigne, dans les conversations des dîners en ville, les yeux se font sérieux, les mines se font graves et les visages s’allongent. Ce qui est très curieux, c’est que tout le monde connaît Montaigne. Enfin, quand je dis « connaît Montaigne », je devrais préciser « le Montaigne de Lagarde et Michard ». Or il faut savoir que le Lagarde et Michard contient exactement « ce qu’il faut savoir », selon l’échelle de valeurs de monsieur Lagarde et de monsieur Michard. Reconnaissons que l’Université n’est pas loin derrière. Et puis aussi l'Inspection Générale de l'Education Nationale et le Ministère du même nom.
Or, « ce qu’il faut savoir », c’est ce que quelques générations de « responsables » ont jugé assez important pour en imposer l’inculcation à des générations entières d’adolescents plus ou moins fumeux et boutonnés (fumés et boutonneux ?), dans l’espoir que tout cela leur restât, le jour où ils auraient tout oublié, sauf le goût de la confiture qu’on étale quand on en a le moins (c’est nettement meilleur à la petite cuillère, alors qu’à la main, c’est non seulement salissant, mais aussi collant : détestable).
Comme cet auteur espagnol (Lope de Vega ? Calderon ?) attendant d’être couché sur son lit de mort pour avouer enfin un péché mortel (« Dante m’a toujours profondément ennuyé »), je suis prêt, la main sur le cœur et les yeux au ciel, à clamer à la face du monde : « Ce qu’il faut savoir m’a toujours profondément emmerdé ». Voilà, c’est lâché, j’assumerai les suites, « jusques au feu exclusivement » (François Rabelais).
Pour continuer à creuser ma tombe d’homme cultivé, dans l’uniforme duquel j’exige d’être inhumé, j’ajoute que, si la lecture des Essais de Montaigne ne m’a pas, pour l'essentiel, ennuyé, et heureusement, je peux dire qu'on ne rigole pas à toutes les pages. Vivre en sa compagnie au quotidien, ça ne devait pas être drôle tous les jours. Un homme très sérieux, voire grave, parfois même pontifiant. Un homme qui prend son rôle très au sérieux, même quand il écrit. Il ne s'en cache d'ailleurs pas, se jugeant globalement assez lourd.
Pour le contenu même du livre, je passe sur « la tête bien faite ou bien pleine » et autres formules sacrales, voire sacerdotales, devenues des sortes de tics ou de ponctuations dans les discours mécaniques. Au passage, je signale que, sous prétexte de favoriser la tête bien pleine, les pédagoguenots en ont profité pour la vider, comme la fosse septique dont ils sont issus.
Surtout ne plus apprendre, mais « apprendre à apprendre ». Et par-dessus tout ça, ne plus rien savoir par coeur, surtout la poésie française. Oh que je plains toutes ces pauvres générations qui sont maintenant dans l'incapacité de se réciter El Desdichado, Le Bateau ivre, La Mort des amants ou Le Cimetière marin (pour ce dernier, quelques strophes, n'exagérons pas).
Au sujet de l’uniforme d’homme cultivé, je refuse ici même et par avance l’incinération au four crématoire municipal : ça aurait trop l’air d’un autodafé de livres interdits, même si on sait désormais qu’aucun livre n’a plus à être interdit, puisque tous les livres sont devenus insignifiants. Ce qui sous-entend qu'on pourrait tout aussi bien les brûler. Je détaillerai par testament olographe, voire authentique si le notaire me fait un prix, les informations rendant possible la réalisation d’un tel uniforme, dont les frais de confection devront être prélevés sur les mirifiques droits d’auteur générés par ce blog.
Alors les Essais ? Ce n’est pas parce que ça m’a ennuyé que j’en ai arrêté la lecture, rassurez-vous. J’ai le sens du devoir. Laborieusement, pesamment, comme un cheval de labour magnifique et besogneux, j’ai mené ma tâche à bonne fin. Les Essais de Montaigne sont un livre finalement assez ennuyeux pour une raison rétrospectivement assez simple. Rétrospectivement, j’ai bien dit.
Cette raison ? La voici (et je me dis que si j’avais lu Montaigne à l’âge adolescent, ma vie aurait sans doute pris un autre chemin) : Montaigne est le premier homme que je connaisse à avoir douté de la légitimité de soi-même. Quand je dis « soi-même », j’entends Michel de Montaigne, mais aussi la civilisation occidentale. En ces deux matières, qu’on se le dise, Montaigne n’est sûr de rien.

Finalement, Montaigne a p'têt ben des origines normandes : « P’têt ben qu’oui, ptêt ben qu’non ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 02 juillet 2013
SUR MON ALBUM DE PHOTOS

PORTEFAIX, PAR AUGUST SANDER
***
Je place en en-tête de mes billets, depuis quelque temps, des photos empruntées à August Sander. Ceux qui suivent ce blog se souviennent peut-être que j’avais fait la même chose avec des photos d’Edward S. Curtis des Indiens d’Amérique du Nord. Mon idée, c’est qu’August Sander et Edward S. Curtis sont cousins. Sur le plan photographique s’entend.
Ce que l’Amérique a eu en Edward S. Curtis (1868-1952), l’Europe l'a eu avec August Sander (1876-1964). Tous les deux furent des photographes, et de grands photographes, dont les clichés les plus célèbres courent aujourd’hui les rues de toutes les villes qui s’appellent New York ou Berlin. Ils auraient eu du mal à se rencontrer : s’ils appartenaient à peu près à la même génération, Edward Sheriff Curtis étant né en 1868 dans le Wisconsin, et August Sander en 1876 en Rhénanie-Palatinat, ils n’étaient pas du même continent : le Wisconsin est aux Etats-Unis, la Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
avec August Sander (1876-1964). Tous les deux furent des photographes, et de grands photographes, dont les clichés les plus célèbres courent aujourd’hui les rues de toutes les villes qui s’appellent New York ou Berlin. Ils auraient eu du mal à se rencontrer : s’ils appartenaient à peu près à la même génération, Edward Sheriff Curtis étant né en 1868 dans le Wisconsin, et August Sander en 1876 en Rhénanie-Palatinat, ils n’étaient pas du même continent : le Wisconsin est aux Etats-Unis, la Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

ASTANIHKYI (COME SINGING), COMANCHE
Je connais un peu certaines belles régions de « Rheinland-Pfalz », mais ce n’est pas grave, parce que ça ne compte pas, même si je pourrais en dire deux ou trois mots qui ne me feraient pas de mal à moi non plus. Nul n’est prédestiné à la photographie. Ce qui rassemble ces deux-là, dans leur folie photographique, c’est la clarté de leur projet. L’unicité, l’homogénéité, la pureté ontologique de leur projet.
Les Etats-Unis dans lesquels est né Edward Sheriff Curtis laissaient subsister tant bien que mal 40.000 Indiens, sur les 2.000.000 (estimés) qu’ils étaient avant le monde des blancs. L’Allemagne de August Sander ne souffrait pas encore de dénatalité. Ce qui est étonnant (et, disons-le, ahurissant, même si certains diront que je me laisse facilement ahurir), c’est que tous les deux, sans se connaître le moins du monde, sans se donner le mot, ont décidé de faire un inventaire, et se sont lancés dans la même entreprise gigantesque.

LE PIANISTE MAX VAN DE SANDT
Curtis, ceux qui suivent ce blog, savent ce que lui doivent les derniers Indiens non contaminés du continent nord-américain, car j’ai publié nombre de ses photos ici même : des Indiens fiers, auxquels l’Occident n’a rien appris qu’ils ne sussent déjà, et auxquels il a imposé des objets et des façons qui, s’il est vrai qu’ils les ignoraient, ont détruit leur civilisation.
 Sander, ça fait moins longtemps que je connais son œuvre, mais celle-ci m’a touché de la même manière : le photographe ne fait pas de manières. Il photographie les Allemands de toutes régions, de tout âge, de toutes professions. Il appelle ça Hommes du 20ème siècle. Il a raison. Son ambition est la même que celle de Curtis : mettre en boîte, sur papier photosensible, un inventaire de l’humanité de son temps.
Sander, ça fait moins longtemps que je connais son œuvre, mais celle-ci m’a touché de la même manière : le photographe ne fait pas de manières. Il photographie les Allemands de toutes régions, de tout âge, de toutes professions. Il appelle ça Hommes du 20ème siècle. Il a raison. Son ambition est la même que celle de Curtis : mettre en boîte, sur papier photosensible, un inventaire de l’humanité de son temps.

PLENTY COUPS (ou CUPS), APSAROKE
Tous les deux plantent leur appareil, demandent aux personnes de s’immobiliser, soignent la lumière, et voilà le travail. C’est cadré, c’est précis. Très souvent hiératique. Pas d'acrobaties, pas de virtuosité, pas d'entourloupes. Mais surtout ce n’est pas original. Ah, surtout, ne pas être original ! Un seul angle de vue, un statisme absolu : le contraire de la saisie du mouvement, qui demande au photographe lui-même de suivre le mouvement. L’ « instant décisif » à la Cartier-Bresson, ce n’est pas leur tasse de thé. Ni l’un ni l’autre n’envisage de seulement surprendre le spectateur. Quelque chose de brut, ça leur suffit : le réel parle de lui-même.
Ce qui permet de rapprocher les deux photographes, c’est qu’ils ne conçoivent pas leur entreprise comme susceptible de produire une œuvre d’art. Je peux me tromper, mais je ne crois pas qu’ils se considéraient comme des artistes. Si j’ai bien compris l’objet de leur quête (car c’en est une), je les comparerais davantage à des anthropologues, de la même espèce qu’un Béla Bartók ou un Zoltan Kodaly parcourant les campagnes de Hongrie pour recueillir les mélodies populaires avant que tous ceux qui connaissaient soient morts.

REPRESENTANT DE COMMERCE
J’exagère, au moins en ce qui concerne Sander. Mais je n’en suis même pas sûr : que reste-t-il, en effet, de l’Allemagne qu’il a fixée ? Toujours est-il qu’ils ont fait de l’anthropologie, sans doute sans le savoir (mais allez savoir) : surtout, sans théorie et sans jargon, ni au départ, ni à l’arrivée. La photo est sage comme une image. Des témoins actifs, tant qu’on veut, certainement pas des savants. Des collectionneurs à la rigueur, poussés, par la joie ou l’angoisse, et peut-être les deux, à accumuler des images du vivant, des vivants qui les entourent.

BEARSBELLY, ARIKARA
L’autre point qui rapproche Curtis et Sander est leur obstination. On peut dire en effet qu’ils ont consacré leur vie à leur tâche. Ce sont deux hommes d’une idée fixe, des monomaniaques, pourquoi pas. On a l’impression que pour eux, le monde se réduisait aux milliers (dizaines de milliers dans le cas de Curtis) de visages et de silhouettes qu’il leur fallait encore faire entrer dans leur « camera oscura ».

MEMBRE DU PARLEMENT
C'est vrai que les Indiens ont de plus belles gueules que les Allemands, mais c'est l'exotisme qui fait ça. Mais de toute façon, la question n'est pas là, car je vais vous dire, pour arriver à déblayer le sujet de toutes les scories anecdotiques, à nettoyer l’essentiel de toutes les impuretés qui l’encrassent, à faire surgir de tout ce qu’il n’est pas le cœur de ses préoccupations, il faut être animé d’une force particulière. Je dirais volontiers que cette force est celle d’aimer ce qu’on s’est donné pour objectif.
« Objectif », tiens, puisqu’on parle de deux photographes, ce n’est pas mal de finir sur ce mot.
Voilà ce que je dis, moi.
09:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, august sander
lundi, 01 juillet 2013
SALE TEMPS POUR LE LIVRE 2
La presqu’île lyonnaise a vu se fermer la plupart des librairies, ces antres où fermentait un peu de littérature, de poésie et de la noblesse de vivre, à mesure que la pression de la fringue et du fric s’est faite de plus en plus forte et voyante. Un vrai coup de balai ! Et pour un coup de balai, ce fut un coup de maître.
De « Desvignes » (ou peut-être « Didier » ?) place des Jacobins et « La Proue » rue Childebert à « Henri IV » et « Lavandier » rue Victor Hugo ; de « Demortière », « Bellecour-Livres » et « Nouveautés » place Bellecour à la « Librairie Nouvelle » (l’ancienne, quand elle était rue Paul Lintier, puis la nouvelle, déménagée quai Saint Antoine) et à la très belle « Librairie des Archers » rue Gasparin ; – de la « Librairie du Lycée » rue Gentil à la « Librairie du Péristyle » (c’était avant que Jean Nouvel transformât l’Opéra en chambre mortuaire et son péristyle en piste de « danse » hip-hop) jusqu’à celles dont j’ai oublié le nom à l’angle des rues République et Neuve (« Desvignes » ?) et sur le quai Jules-Courmont (« Dumortier » ?), en passant par la « Librairie des Terreaux» de Jean Honoré, que je salue, bien qu'il vendît de l'ancien, mais il fut aussi éditeur (je crois que c'est un salon de coiffure afro qui lui a succédé, signe des temps) ; – ajoutons la « Librairie Lardanchet », rue Président-Carnot, qui accueillait les « signatures » du général René Chambe, quand celui-ci sortait un nouveau livre. C'est chez Lardanchet que j'ai déniché, ahuri et reconnaissant, l'improbable volume des Oeuvres complètes du poète Max Elskamp, que les plateaux de télévision se disputent et s'arrachent (il est mort en 1931). J'ajoute qu'il faut la voir, aujourd'hui, la rue Président-Carnot. Depuis que le quartier Grôlée a été vendu par le merdelion Gérard Collomb au fonds spéculatif Cargill qui, après avoir revendu les immeubles, par appartement et à prix d'or, s'est débarrassé des rez-de-chaussée dans le giron des Docks Lyonnais (j'ai suivi les opérations de très loin), tous les espaces commerciaux (ça fait de la surface) restent désespérément vides, vacants, inanimés. Quand on y passe, l'impression est tout à fait bizarre, presque lunaire.
Les librairies de la presqu'île, donc. Quelle hécatombe, mes aïeux ! Sale temps pour le livre ! Le typhon genre « Carré d’Or » (Cartier, Vuitton, Hermès et consort) s’est abattu, nettoyant tout ce que, du Rhône à la Saône, la presqu'île comportait d’improductifs et autres amateurs de littérature, de poésie et d’idées. Tout ce qui ne sert à rien, quoi (je veux dire : tout ce qui ne crache pas du cash).
Et ce n'est pas fini, grâce à notre grand merdelion, Gérard Collomb : le monumental et historique Hôtel-Dieu (eh oui, monsieur le Maire, ça ne passe pas, cette histoire !) va abriter un hôtel ***** et des magasins de luxe [c'est désormais chose faite]. Et quelques structures amuse-populo pour dorer la pilule. Faut dire qu'un hôpital, ça fait moins d'argent et de tape-à-l'oeil.
En dehors du supermarché culturel qui s’est installé en lieu et place du siège du Progrès, qu’est-ce qui subsiste, dans ce paysage de ruine ? « Gibert », « Flammarion » (qui ne s’appelle plus ainsi depuis lurette, au gré des mouvements de capitaux, et qui va d’ailleurs disparaître, paraît-il [c'est désormais chose faite]), « Decitre » (qui réduit la voilure, ce qui signifie peut-être « avis de tempête »).
« Camugli » survit, languit et se ratatine, après avoir fait briller le nom sur trois devantures. Restent « Passages », « Le Bal des ardents », « Musicalame », qui ont eu bien du mérite à ouvrir en période de vaches maigres. Pardon, j’allais oublier la « Librairie Saint-Paul », dont la raison sociale missionnaire dit bien ce qu’elle veut dire, mais Decitre (anciennement librairie Vitte, porte-drapeau catholique) n’était plus depuis déjà quelque temps la librairie chrétienne de la ville.
Chez l'ancien Decitre, certaines connaissances étaient surprises de me croiser. C'est vrai qu'à l'époque, je bouffais du curé. Elles ne se doutaient pas que pour moi, une librairie, avant d'être une église, était une salle de réunion, que dis-je, un Palais des Congrès pour les livres. Qui d’autre (je ne parle pas des librairies de quartier ni des « libraires d’ancien ») ? Ah oui, « Expérience », place Antonin-Poncet, pour les BD, mais ce n’est plus la même chose : Adrienne n’est plus là. Et la BD a changé. Je crois que c'est tout.
Qu’on me comprenne bien : ce bref panorama d’un désastre désormais accompli n’a rien, mais absolument rien de nostalgique. Je constate juste que « La Proue » a laissé la place à un commerce de matériel photographique (à présent déménagé), sans qu’on puisse incriminer monsieur (†) et madame Péju (n’oublions pas le frangin sur le quai, qui a cassé sa pipe tout récemment), véritables amiraux qui ont coulé bravement avec leur navire. Personne ne voulait ou ne pouvait reprendre l’affaire. Je vous salue, M. et Mme Péju !
Grâces vous soient rendues pour « faits de résistance » authentiques (ceux qui connaissent estampilleront la remarque d'un hochement de tête approbateur).
Pour les « Nouveautés », je crois que monsieur Bouvier (qui occupe la maison de Joséphin Soulary, dans la rue du même nom, c’est vilain de cafter, mais bon), était un peu trop gourmand pour que l’excellent et érudit Claude pût nourrir quelque espoir de reprise que ce fût. Résultat, c’est une banque tout ce qu’il y a de moderne qui est là, et qui a eu la merveilleuse idée sadique de mettre en vitrine d’immenses photos de livres bien rangés sur des rayons, pour bien faire sentir aux amateurs le prix de ce qu’ils ont définitivement perdu.
La nostalgie n’est pour rien dans mon propos. Je pencherais plutôt pour une colère impuissante et vindicative contre un présent désagréable, peut-être repoussant, face au mépris croissant auquel est confronté ce que les gestionnaires (le vrai pouvoir) appellent le « monde de la culture ». Un monde qui, fasciné par la gadgétisation numérique et la promotion de nouveaux « outils culturels » flambant neufs, oublie aujourd’hui que son pilier principal, son « Palmier des Jacobins » (Ô Toulouse ! voir ci-contre), est un parallélépipède de papier qu’on peut ouvrir pour en tourner les pages.
Les tapoteurs de tablettes, les branloteurs hystériques de claviers, pris jusqu'aux sourcils dans les mailles de leurs « réseaux sociaux », pour ce qui est de « la ramener », ont éliminé du paysage les Marseillais façon « klaxon » (celui du César de Marius, Escartefigue, et Panisse) et « kakou » (celui du cabriolet Z4 qui passe en vrombissant sur le Vieux Port, en pleine bouillabaisse des vieux de la contrée), que, du coup, on a presque envie de protéger, à la façon d’une espèce menacée. Le klaxon des kakous technologiques n’a pas fini de nous pourrir le paysage sonore et mental.
Face à ce monde bientôt débarrassé du livre, je m’estime en droit de souffleter de mes verges verbales le groin de l’arrogance impudique et barbare dont le cerveau trop matériel piétine, avec les mains grasses de sa vulgarité, ce qui reste du cœur battant d’une civilisation (esprit de Champignac, es-tu là ?). Et qu’on ne me « tabuste point l’entendement » (Fr. Rab.) avec des rengaines du genre « il faut vivre avec son temps » : si « mon temps » m’impose sa laideur niaise et son épaisseur surfaite, ne suis-je pas en droit de lui dire « merde » ?
Et ce qui ne me console pas du tout, c'est le fait que les Parisiens n’ont pas fait mieux que les Lyonnais pour préserver leurs librairies, puisque leur « Quartier Latin » est désormais colonisé par des magasins où l’on vend, au choix, de l’argent ou des sapes, exactement comme chez nous. Lyon n’avait pas de « Quartier Latin », la mise en bière de ses librairies s’est donc passée sans même les quelques tapages (où en est la librairie « La Hune », au fait ?) qui ont accompagné les coups de marteau frappés sur les derniers clous dans les cercueils parisiens.
Mais comme le chante Robert Smith, de The Cure : « Boys don't cry ! ». Comme la moule par son byssus au rocher, je reste accroché au livre. Jusqu'à ce que ma mort s'ensuive. Pas trop tôt j'espère.
C’est sûr : sale temps pour le livre ! Selon moi, ça veut dire : sale temps pour l'homme ! Si je pouvais me tromper, ce serait pas mal !
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 30 juin 2013
SALE TEMPS POUR LE LIVRE 1
J’ai grandi parmi et avec les livres. Sans doute aussi grâce à eux. J’en ai même, comme je le disais, « soustrait quelques-uns au commerce légal ». Mais il y a prescription depuis longtemps. Et puis, dans certaines circonstances, n’est-ce pas, « nécessité fait loi ». Passons sur ces temps révolus depuis lurette. Les librairies ont toujours exercé sur moi l’attraction irrésistible que la lueur de la flamme exerce sur le papillon de nuit. De vrais phares dans l’obscurité dont le marin perdu attend le salut. Ou l'autodafé.
Je parle d’une époque où la fringue et la banque n’avaient pas atteint le paroxysme de l’arrogance du haut de laquelle elles toisent depuis quelque temps déjà les passants anonymes que nous sommes, à qui elles ne daignent décerner de nom et d’identité qu’au prorata de l’épaisseur des liasses de banknotes (« Je suis Brésilien, j’ai de l’or, et j’arrive de Rio de Janeire. (…) Prenez mes dollars, mes banknotes, mais dites-moi que vous m’aimez ! », chante Dario Moreno, dans La Vie parisienne, d'Offenbach) que les portefeuilles sont prêts à cracher, aligner, allonger ... Je parle du temps d’avant, d’avant que l’argent et le tape-à-l’œil ne se soient rendus presque totalement maîtres de nos espaces, de l’air que nous respirons, et bientôt de nos vies, si ce n'est déjà fait.
Je parle du temps où l’amateur de livres, cet inutile essentiel, pour satisfaire ses goûts et sa curiosité, n’avait que trois pas à faire. La presqu’île était farcie de librairies, du minuscule estanco à peine éclairé au quasi-salon de réception façadé de larges baies vitrées, entre lesquelles on avait l’embarras du choix, et où la disposition et l’aménagement des lieux, mais aussi le choix des livres prioritaires, étaient liés à la personnalité propre du libraire, donnant à son local une identité qu’il était seul à posséder.
C’est pourquoi il fallait poser un pied dans chacune, donner à chacune sa chance. Si j'avais été naturaliste, j'aurais parlé de l'ère de la « bibliodiversité », bien avant que les espèces se raréfient, voire disparaissent. Parce que, après tout, la biodiversité, c'est bien joli, et ça satisfait le désir de nature de quelques illuminés manquant de lucidité sur le processus en cours, processus qui n'est rien d'autre qu'une éradication en bonne et due forme de la nature.
Après ? Quoi après ? Après la mort de la nature, décidée par tous les négateurs de la nature, qu'ils soient spéculateurs financiers ou promoteurs du mariage homosexuel (l'homme détient la toute-puissance sur toutes les formes de liberté, grâce aux marchés, quintessences de la liberté, et la toute-puissance sur toutes les lois de la nature, grâce à la glorification de l'homosexualité), l'homme sera bien obligé de trouver des solutions pour survivre sans la nature.
Malheureusement, ce ne sera peut-être pas possible. L'idéologie a toujours le nez plus cassable que la réalité. Et pour le livre, ce n'est pas comme dans la forêt primaire : il n'y a pas de canopée pour reproduire les espèces rares. Je définis la canopée : « Ce qui était hors de l'atteinte de l'homme ». Je dis "était", à cause des « radeaux des cimes », ces merveilleuses inventions qui se produisent au moment même où on cessera très bientôt d'en avoir besoin.
Au motif que même le plus invisible à l'oeil nu des animalcules n'a plus le droit d'échapper à la connaissance scientifique. La civilisation actuelle a horreur du vide : elle a horreur des vides juridiques (« Vite, une loi ! criait Sarkozy) ». Elle a horreur des vides scientifiques qui s'élargissent au moment même où les savoirs se font logiquement plus pointus (« l'avancée même du savoir crée de l'ignorance sur ses propres bords », c'est de moi, ça : relisez cette petite phrase, et dites-moi si j'ai tort ; et dites-vous que, si j'ai raison, c'est l'ignorance qui ne cesse de progresser ; bizarre, vous avez dit bizarre ?).
La biodiversité a existé, mais c'était bien avant que le mot fût fabriqué. Quand le mot n'existait pas, ça voulait dire que la chose existait encore. On n'avait donc pas besoin de la nommer, tout simplement parce qu'elle allait de soi. On commence à vouloir "biodiversifier" quand on se rend compte que tout se bioraréfie. Mais la bioraréfaction est une tendance lourde.
De toute façon, ce n'est que des générations après ceux qui ont commis les actes que l'homme se met à réfléchir aux conséquences, et qu'il commence à accuser les ancêtres des autres de ses malheurs présents. Et, éventuellement, à essayer de tâcher de tenter de corriger le cap du navire, un navire qui met des dizaines d'années, désormais, à infléchir sa route. Etonnant, non ? Mais revenons à la question du livre.
Rendez-vous compte que j’ai acheté mon volume de Henri Bergson (Œuvres, édition du centenaire, 1600 pages de papier bible, 43 francs) chez un libraire dont l’échoppe était blottie sous les arcades du péristyle de l’Opéra. J’ajoute que je lui achetais aussi mes Marc Dacier, Jean Valhardi et autres Jerry Spring (dessinateurs Eddy Paape et Jijé) : « Il faut de tout pour faire un monde. – Bien parlé, Madame Michu ». C'étaient des bandes dessinées, il n’y a pas de raison.
Il y avait aussi Jacques Glénat-Guttin, le même qui a viré son Guttin pour devenir le Glénat de la grande maison grenobloise de bandes dessinées, celle-là même qui éditait l’excellente revue Circus. Glénat était un copain du libraire, et la feuille périodique qu’il publiait vaillamment (Les Equevilles : le mot « équevilles » désigne, à Lyon, tout ce qu’on destine à la poubelle) égratignait et horripilait le maire d’alors.
Le merdalor se nommait Louis Pradel, grand bétonneur, à qui les Lyonnais doivent le « Blockhaus » (alias Centre d’Echanges de Perrache), et à qui tous les automobilistes traverseurs de Lyon chantent des actions de grâce, chaque fois qu’ils se rendent soit sur la Côte d’Azur soit à Paris. Tout le monde a compris que je parle du Tunnel de Fourvière, que le monde entier nous envie. Et tout le monde regrette amèrement que Pradel ait visité Los Angeles, voyage qui lui inocula illico la folie des grandeurs : il voulut à tout prix que l’autoroute traversât la ville, tout comme dans la ville américaine.
Je reviens à mon péristyle de l’Opéra : pensez, des boutiques, dont une librairie, installées dans les flancs même de ce temple ! Inimaginable. Heureusement, Jean Nouvel a été appelé pour mettre bon ordre à tout ça, il a viré du péristyle les bouquins, les accessoires de danse, les pipes Nicolas et le marchand de timbres (qui était, lui, côté rue Joseph Serlin, je m’adresse aux quelques « happy few » qui ont connu), comme indignes de l’altitude sinistre et sépulcrale de son « inspiration » architecturale.
Jules Vallès (aux Editeurs Français Réunis), on le trouvait, évidemment et tout naturellement, à la « Librairie Nouvelle », qui occupait fièrement l’angle des rues Paul Lintier et Du Plat. Il fallait le faire ! Imagine-t-on aujourd’hui qu’il ait pu y avoir une librairie communiste implantée au cœur du quartier bourgeois par excellence ?
J’adorais le vieux qui tenait la boutique : pas trop doctrinaire, voire parfois un peu hérétique. Mais il devait être assez inoffensif, ou alors plus « dans la ligne » que je ne croyais, car il resta jusqu’au transfert de la librairie du Parti, oh, pas très loin, sur le quai Saint-Antoine, à l’angle de la rue du Petit-David, la rue de l’Adrienne de la première librairie « Expérience ». De toute façon, la « Librairie Nouvelle » n'a mis que quelques années à défunter pour de vrai. Comme le parti dont elle était l'émanation et l'instrument de propagande.
La « Librairie des Nouveautés » (ne pas confondre), alors tenue par une adorable dame blonde à haut chignon, je l’ai connue toute petite boutique assez sombre, quand elle était le rendez-vous de tous les amateurs de philosophie, dont le célèbre Henri Maldiney, dont le visage (je crois bien que c’était la joue, sans plus en être bien sûr) était gratifié d’une étonnante boule, comme un gros pois chiche. La dame blonde à haut chignon se piquait de poésie, et faisait partie de diverses confréries à ce destinées. La « Librairie des Nouveautés » fut reprise par monsieur B., qui sut en faire un lieu intéressant, voire important et qui a pris sa retraite sur les pentes nord-est de la Croix-Rousse.
Les librairies pullulaient donc dans la presqu’île, pour ainsi dire autant que faisans d’élevage un matin d’ouverture de la chasse (évitons, si vous le voulez bien, de parler de ce qu’il en restait le soir même, des faisans d'élevage). Et pour ce qui est de la chasse, on peut dire que les fanatiques du « bibliocide », dûment munis de leurs permis de construire, n’ont pas fait de quartier : ils ont fait feu sur toute oreille de libraire qui dépassait, transformant la presqu’île, peut-être pas en désert, mais pas loin. Seules quelques grosses usines sont restées debout, si elles ne flageolent pas sur leurs cannes. Le tableau n’est pas gai.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, libraire, librairie, lyon, lyon presqu'île, place bellecour, la vie parisienne, offenbach, dario moreno, éditions glénat, louis pradel, maire de lyon, tunnel de fourvière
samedi, 29 juin 2013
POURQUOI JE LIS

RANDONNEURS, PAR AUGUST SANDER
***
Ce n’est pas non plus parce que j’aime lire que je lis. Je sais, ça peut surprendre. Je lis parce que je n'envisage pas l'existence sans les livres. Et ça tombe bien, il y a toujours eu des livres autour de moi. Enormément de livres. Un décor permanent de livres. Des falaises de livres. Encore aujourd’hui. Comme si c'était moi qui perpétuais la tradition. Bien sûr, il y a ceux que j’ai achetés et les quelques-uns, en un temps précis, que j'ai soustraits au commerce légal. Mais il y a eu surtout, dès le départ, l’omniprésence des livres. Que ce soit au 39, cours de la Liberté (3ème étage avec ascenseur), ou à Corbeyssieu, c’était vraiment des livres partout. Au point que je n’imagine pas de pouvoir vivre sans être cerné par des murs de livres. Oui, ça vient de très loin.
La haute bibliothèque en acajou du grand-père médecin (j’ai pieusement recueilli la plaque de porte) était bourrée à craquer, remplie à ras bord de volumes de toutes sortes et de toutes tailles, depuis les petits in-12 de Hérédia ou Leconte de Lisle de chez Alphonse Lemerre, jusqu'à l’imposante monographie consacrée exclusivement au sublime « aurige de Delphes », que j'ai fait la bêtise (hélas rétrospective) de donner à je ne sais plus qui.
Il suffisait de s’asseoir bien en face, d’ouvrir les portes du bas et les portes vitrées du haut, et de se laisser porter par l’envie, par l’humeur, une couleur, une reliure, un titre : tout pouvait accrocher. Le problème survenait au moment de partir : l’espace était si exactement mesuré qu’il fallait être d’un extrême soin dans la remise en place pour espérer refermer correctement les portes. Une remarque : cette façon de stocker est déconseillée, si l'on veut conserver un peu longtemps ses livres. A moins de ne jamais y toucher.
Le contenu de cette bibliothèque a été dispersé. C’est le sort de tout ce qui s’assemble un jour : un autre jour viendra le désassembler. Je ne suis pas sûr que le grand-père avait fait quelque effort personnel pour constituer le fonds qui dormait au fond du meuble de bois rouge. Il préservait ainsi ce qu'il avait reçu, mais comme un poids mort. Je ne suis même pas sûr que le grand-père ait ouvert le meuble pour se plonger ne serait-ce qu’un instant dans cette curieuse édition de Gil Blas de Santillane, ou dans cette édition précieuse de Rabelais (reliure de Kieffer, pour ceux qui connaissent).
Ce qui reste, chez celui qui a ouvert le meuble à de nombreuses reprises et s’est plongé longuement dans les volumes ouverts au gré des vents de l’esprit, c’est une image globale, homogène. L’image d’un monde encore « un », saisissable d'un seul regard. Une illusion, évidemment. Une illusion persistante cependant : l’esprit renonce difficilement à l’unité du monde.
Au premier étage, chez l’autre grand-père, cela s’appelait « La Bibliothèque » : une vaste pièce ceinturée de rayonnages remplis, souvent sur deux rangs, d’une incroyable (et identique, quoique différente) variété de livres. L’avantage de Corbeyssieu, c’est que tous les dos du premier rang étaient visibles, et donc identifiables. La manutention était réduite au minimum. L'Histoire de France de Lavisse, tous les Gaston Lenôtre (un Alain Decaux de l'ancien temps), que le grand-père avait fait joliment relier, un Buffon complet, les Jules Verne de Hetzel, des collections reliées de Sélection du reader's digest et d'Historia, j'arrête. Le grand-père en question était féru d'Histoire et de catharisme.
Confortablement installé sur la méridienne, on pouvait extraire l’un des vingt énormes volumes reliés (en rouge) du Journal des voyages, un hebdomadaire illustré relatant les aventures les plus exotiques et les plus dangereuses, dont les lecteurs, le soir, dans leurs pantoufles et devant la cheminée, attendaient de délicieux frissons d’horreur, semaine après semaine.
Mais des volumes d’un poids ! Les parents, qui voyaient leurs enfants étudier je ne sais quoi dans ces volumes d’aspect trop sérieux pour être des menaces, ne se doutaient guère des violences, haines et cruautés dont la progéniture se pourléchait et se mettait plein les yeux, grâce aux gravures méticuleuses : un noir voyageant en train se suicide en plaçant sa tête ente deux tampons ; un barbu à l’air farouche, dans une cabine de navire, plante la main d’un autre dans la table qui les sépare au moyen d’un grand poignard ; un médecin de brousse retire, après avoir incisé la peau, un filaire de Médine de la cuisse d’un indigène en l’enroulant sur un bâtonnet. Tout à l’avenant. Que des merveilles, quoi ! S'ils avaient su !
En empruntant l’escalier en bois qui menait au grenier après avoir ouvert une porte malcommode, on accédait à une chambre éclairée par une lucarne, et sur deux côtés entiers de laquelle couraient des rayonnages conçus spécifiquement pour recevoir la collection complète de la Revue des deux mondes.
Cela montait jusqu’au plafond. Je dis « complète » alors que ce n’est pas tout à fait vrai : l’écriture fine (et légèrement tremblée) de ce grand-père-là avait noté avec exactitude sur une petite feuille de papier – que j’ai encore je ne sais où – les onze numéros qui lui manquaient, et qu’il n’a jamais désespéré d’acquérir, jusqu’à son dernier jour. Mais quel collectionneur au monde, même effréné, voire frénétique, peut se vanter de posséder la collection véritablement complète de ce qui est son idéal ?
La Revue des deux mondes ! Il faut se rendre compte de la masse de papier. Représentez-vous un bimensuel (deux numéros d’environ 200 pages par mois), et cela de 1829 à 1981 (153 ans) : essayez d’imaginer ce que ça fait, comme longueur de rayons occupés, 4800 pages par an, et pendant cent cinquante-trois ans ! Pas loin de 750.000 pages ! Je piochais au hasard dans l’énormité (l'éternité ?) de la chose.
C’est ainsi que j’ai lu, en tapant au hasard, pendant des après-midi entiers, des nouvelles de Mérimée (La Vénus d’Ille, 15 mai 1837 ; Colomba, 1 juillet 1840 ; …) ; une étude d’Emile Littré (Du Progrès dans les Sociétés et dans l’Etat, 15 avril 1859) ; quelques poèmes de Ch. Baud. (Les Fleurs du Mal, 1 juin 1855) ; quelques pages de Saint-Simon (15 novembre 1834) ; et bien des choses que ma mémoire n’a pas retenues. Au total, un invraisemblable fatras culturel.
Mais c’est dans la Revue des deux mondes que j’ai lu pour la première fois Sylvie, de Gérard de Nerval (15 août 1853). La pluie battait comme plâtre les vitres de la lucarne, et j’étais très mal installé, sur un pouf à quatre pieds noirs, couvert de velours vert.

SYLVIE FUT PRÉPUBLIÉ DANS CE NUMÉRO
C’est aussi là que je suis tombé un jour sur une drôle d’étude zoologique, où l’auteur disait avoir greffé à l'envers une queue de rat dans la colonne vertébrale de l'animal, de sorte que la queue se dirigeât vers l’avant. Peut-être est-ce l'article de monsieur F. Papillon du 15 décembre 1872 : Les Régénérations et les Greffes animales. Il paraît qu’elle était agitée de mouvements, et passa un temps pour une trompe. Le canular avait fait du bruit à l'époque. C'est possible.
Mais j'ignorais alors tout d’Alfred Jarry et de la 'Pataphysique, et la trouvaille, dont je me souviens comme si c’était hier, s’est perdue inutilement, car d’autres y ont mis le nez avant moi. Ce n’est donc pas moi qui m’enorgueillis d’avoir mis au jour la source du « ratatrompe », que l’on trouve au chapitre VI de L'Amour absolu, cette fascinante énigme poétique.
Je passe sur la grande bibliothèque noire qui occultait tout un mur du bureau du grand-père, dans laquelle je n'ai pu fouiner que tardivement. L’ultime endroit pour trouver des livres, quand nous étions à Corbeyssieu, c’était en haut de l’escalier de la « Petite Maison », où s’affichaient les livres du "dernier rayon", selon les échelles de valeurs alors en vigueur : les Jean Bruce, les Peter Cheney, bref, les « Presses de la Cité » et autres « Fleuve Noir ».
Et je suis obligé de l’avouer, de même qu’au moment où j’écoutais fervent les Etudes opus 25 de Chopin, j’entendais sans déplaisir Belles belles belles de Claude François, de même, tout en partant pour la Corse avec la Colomba de Mérimée, je goûtais la vulgarité vaguement sulfureuse des aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath (traduction de ce nom argotique : « Hubert qui la baille belle » ou, si vous préférez, « le bonimenteur »), alias OSS 117, particulièrement quand il s’approchait par derrière de l'espionne aux belles cuisses (en général fuselées) et en chemise de nuit qui, de son côté, attendait fiévreusement qu'il lui saisît les seins (en général plantureux), à pleines mains, dans un geste viril (et brûlant si possible).
Il ne faut pas confondre après-midi pluvieux et soirées tumultueuses.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 28 juin 2013
POURQUOI JE LIS

JEUNES PAYSANS, PAR AUGUST SANDER
***
Je ne lis pas pour lire. La lecture est un moyen, pas une fin en soi, je ne sors pas de là. C’est vrai que si je me pose la question de savoir pourquoi je lis, la réponse ne vient pas de soi. Mais après tout, est-il si important de savoir pourquoi on fait les choses ? Et puis aussi : peut-on vraiment le savoir ?
Pour mon propre compte, les lecteurs qui viennent incidemment ou fidèlement sur ce blog s’en sont fait une idée plus ou moins précise : je l’avoue sans honte, sans fard et sans vergogne : je lis pour jubiler. Disons-le carrément : je lis pour jouir. Comme le chien rongeant son os, j'ai la lecture d'un égoïsme carabiné et d'une possessivité intempérante. En cette matière, l'injustice que je mets constamment en pratique est à toute épreuve, hors de portée des magistrats les plus empreints de rectitude morale et juridique.
Jubiler, donc. Pas que. Mais je déteste perdre mon temps, en particulier avec ce que l’actualité appelle « Littérature ». La petite crotte intitulée Qu’as-tu fait de tes frères ? est le dernier étron en date (chié par un certain Claude Arnaud) sur lequel je me suis penché, et à la non-écriture duquel j’ai consacré, hélas et en vain, de précieuses minutes, et accessoirement une note ici même, je veux oublier quand. Ces minutes et cette note eussent été mieux employées si j'eusse laissé le livre fermé. Mieux : si j'avais laissé le volume au libraire. La note eût eu le privilège de ne même pas être appelée à naître. Pauvre libraire, finalement, d'être obligé de vendre ça ! Pour ceux que ces propos défrisent, je renvoie à l'esprit d'injustice radicale revendiqué plus haut.
Oui, je lis pour jubiler. Cela veut dire que je ne lis pas pour savoir. Si du savoir découle, c'est en plus. Cadeau. Encore moins pour apprendre une leçon qu’il faudrait réciter. Je ne lis pas pour me conformer aux impérieux diktats de l’époque, qui vous ordonnent : il faut avoir lu Walter Benjamin.
Qu’est-ce qu’ils ont tous à aboyer le nom de Walter Benjamin (prononcer béniamine) ? Et qu'est-ce qu'ils en font, de leur lecture ? Ils se sentent coupables ? Redevables (Walter Benjamin, juif, s'est suicidé en 1940 à la frontière avec l'Espagne, faute, me semble-t-il, d'un visa) ? Je n'ai rien contre ce monsieur. La preuve, j’ai essayé : j’ai laissé tomber. De la tortillonnade de circonvolution cérébrale (mais je réessaierai peut-être, j’ai bien fini par lire Le 19ème … de Philippe Muray).
Jubiler, oui, ça m’a été donné par des livres très divers. J’ai déjà parlé de Moby Dick, un livre qui transporte la matière humaine infiniment loin, jusqu'aux confins, presque jusqu'à l'esprit, juste à côté de l'âme, je veux dire juste un peu avant ; un livre que j’ai regretté de fermer quand je l’ai fini, mais un livre qui a comblé mon âme d’un enthousiasme presque indécent. C’est vrai ça : comment Herman Melville a-t-il pu aligner vingt chapitres de description du cachalot sans me donner envie de jeter le bouquin ?
Je n'en suis toujours pas revenu. Comment a-t-il fait pour que, au contraire, tout au long de ces vingt chapitres ahurissants, la joie n’ait pas cessé de grandir (je précise quand même, pour les connaisseurs, que je l'ai lu dans la traduction de personne d'autre que l'immense Armel Guerne, qui exerçait, en plus du sacerdoce de poète, celui, combien plus exigeant et combien plus religieux à ses yeux, de traducteur) ?
Bien sûr, je peux analyser la chose, dire que Melville entre dans le cachalot comme on fait le tour du monde, pour l’explorer, et en découvrir, pays par pays, les merveilles, pôles compris. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le très curieux Mardi, ce gros livre bizarre où quelques personnages montés dans une modeste pirogue (« royale » quand même) voyagent jusqu’à l’extrême des quatre points cardinaux, pôles compris.
Mais jubiler ne suffit pas, quand on lit. Encore faut-il pouvoir en faire quelque chose ensuite. Prenez le pur bonheur de Cent ans de solitude (dirai-je le nom de l’auteur ?). Ce livre pareil à nul autre vous plonge dans l’ambiance primordiale de la famille Buendia, native du village colombien de Macondo, avec Arcadio Buendia, Remedios la Belle et bien d'autres personnages, dans les générations desquels on se perd (j’ai lu ce livre une seule fois, il y a fort longtemps, sur le conseil de mon ami Bosio, merci Bosio, car il n'a toujours pas fini de faire résonner ses harmoniques). Ce que la grande Marthe Robert appellerait un « Roman des Origines »
Mais finalement, ce livre-monde, quels effets a-t-il produits en moi ? Même question avec ce livre formidable de Yachar Kemal, Mémed-le-Mince : un tout petit endroit du monde que le talent (ou le génie) de l’écrivain transforme en univers par la seule magie du verbe : on comprend bien que le cadi est un petit chef local qui impose la loi de son bon plaisir arbitraire et minable, mais on est emporté dans les dimensions quasiment célestes dans lesquelles le récit et les personnages sont enchâssés (les savantasses appellent ça de « l'épique »).
Ces livres, si je regarde ce qu’ils m’ont laissé, restent un peu comme ce que les physiciens appellent des « solitons », ces « ondes solitaires qui se propagent sans se déformer dans un milieu non linéaire et dispersif ». Ce que je retiens ici, c’est « ondes solitaires ». Le reste m’échappe évidemment : c’est de la physique, n’insistez pas.
Des livres sans cause et sans conséquence. Sans cause parce que leur lecture est venue par hasard, au gré des circonstances. Sans conséquence parce que, comme le nuage dans le ciel ou l’homme dans la femme (proverbe chinois idiot, mais peut-être que celui qui l'a inventé connaissait la pilule contraceptive, et qu'il ne parlait que du plaisir), ils ne laissent pas de trace. Tout au moins visible : je n'aimerais pas qu'on voie sur ma figure que j'ai lu les romans de Goethe.
Je veux dire que ces livres ne construisent rien en vous après être passés. Un buron, une borie, un bastidon, je ne sais pas, mais quelque chose qui ait à voir avec un abri de berger. Ou alors à votre insu. Des livres morts en vous, des morts sans descendance apparente et dont vous êtes le cul-de-sac, bon gré mal gré.
Des livres dont vous ne saurez jamais comment vous pourriez restituer le bonheur qu’ils vous ont procuré. Sinon en en conseillant la lecture aux gens que vous aimez, piètre consolation. Des livres dont vous auriez envie, si c'était possible, de rendre au monde les bienfaits qu'ils vous ont offerts. Des livres qui vous laissent inconsolable d'avoir à les fermer, et dont le deuil en vous ne finira jamais. Oh, l'amour de ce deuil qui est une joie !
Des livres qui sont à eux-mêmes des culs-de-sac définitifs, parce qu’au-delà d’eux, il n’y a plus rien. Dans la même direction, personne n'est en mesure d'aller plus loin. Ils ont vidé le paysage. Non : ils ont vidé le fini du monde sans limite dans l’infini de leur espace borné. Ils ont transféré la soluble et frêle substance de l’univers dans la matière indestructible dont ils ont été faits, grâce au génie d’un homme unique et désespéré, comme le sont tous les hommes, car en lui s’est déversé, on ne sait pourquoi ni comment, le sens entier de l’existence humaine. Et que s'il n'en est pas mort, c'est juste parce qu'il a tout délégué, jusqu'à sa propre mort, à l'encre posée sur le papier.
Ce ne serait pas mal, comme définition d'un chef d'oeuvre : un livre qui est allé tout au bout de lui-même, un cul-de-sac qui a vidé son auteur de toute sa mort pour en faire un être vivant, et au-delà duquel il n'y a plus rien, que le vide sidéral. Oui, ce ne serait pas mal. Là, je verrais bien Au-dessous du Volcan. A la Recherche du temps perdu. Qu'en pensez-vous ? Mais moi qui ne fais jamais de liste, même pour faire les courses, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Chacun pour soi.
C'est de l'ordre de l'accomplissement. C'est seulement pour ça que je lis des livres. Chacun pour soi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, claude arnaud, qu'as-tu fait de tes frères, librairie, lecture, moby dick, herman melville, armel guerne, cent ans de solitude, gabriel garcia marquez, yachar kemal, mémed-le-mince, goethe
jeudi, 27 juin 2013
POURQUOI JE LIS
Je ne suis pas un immense lecteur. Je suis même un lecteur un peu laborieux. Ce que je lis, il faut que je le mâche longuement, que je le mastique, que je le contemple en train de s'écraser en nourriture entre mes dents, avant d'aller alimenter et irriguer les canalisations de mon moi littéraire. Si je devais me comparer, je dirais que, dans l’ordre des lecteurs, j’appartiens à la famille placide et patiente des ruminants contemplatifs.
A propos de contemplatif, je me consolerais en me disant que Julien Gracq, qui n’a pas couvert de ses œuvres des kilomètres de rayons, a écrit sur le tard ce merveilleux petit bouquin intitulé Les Eaux étroites, qui, en condensant une matière longuement ruminée pour en polir le pur éclat de chacune des facettes, ouvre sur cette sorte d’infini en profondeur que recèle ce paysage minuscule, sa rivière de l’Evre, qui passe à Saint-Florent-le-Vieil.
Le paysage de mes lectures n'est pas aussi vaste, et n'a rien à voir avec les horizons des mers vides à perte de vue, avec ceux des plats pays aux ciels sillonnés de nuages, ou avec ceux de ce désert de sable où se découpe une caravane au sommet de la dune, sur fond de ciel, si possible en contre-jour (en fin de journée). Mes paysages de lecture sont bornés par les arbres qui dressent leur opacité bienfaisante et lumineuse au bout de mon jardin affectif. Même s'il arrive qu'un cachalot pointe sa mandibule débonnaire et souffle ses vapeurs non loin de mon embarcation.
Pour dire le vrai, ça fait déjà quelque temps que je n’ai plus envie de lire pour lire. Et même de lire pour avoir lu. Vous savez, ces œuvres qu’il faut avoir lues si l’on ne veut pas mourir idiot. Si, bien sûr, je m’en suis collé, des Mémoires d’Outre-tombe et des Rougon-Macquart. Mais souvent par devoir. Il ne faudrait jamais lire par devoir. Je plains de tout mon coeur les élèves de lycée : pour rien au monde, je n'aurais souhaité être à leur place. Même si ... Comment pourraient-ils aimer la littérature, s'il ne s'agit que « d'avoir 10 en français » ?
Pour les Mémoires … de Chateaubriand, j’exagère, car j’ai pris du plaisir en beaucoup d'endroits, - moins pour les tableaux historiques, où l'auteur s’efforce toujours de ne pas dessiner son propre personnage en trop petit dans un coin en bas, comme un vulgaire donateur, tiens, comme un « Chanoine van der Paele » dans un tableau de Jean Van Eyck, comme on faisait à la Renaissance et avant, - que pour les routes européennes (en particulier alpines) parcourues en tout sens et les portraits, en pied ou collectifs, aux contours dessinés d’un beau trait précis.
Les 20 Rougon-Macquart, je me les suis avalés dans l’ordre, enfin presque : non, je n’ai pas fini Le Docteur Pascal, c’était au-dessus de mes forces, le curé laïc, sa probité inentamable, son cœur gros comme ça, sa "bonne âme". Mais le docteur Pascal, on sait que c'est Zola en personne, c'est sans doute pour ça que je n'ai pas pu finir l'assiette.
Mais avant d’en arriver à ce dernier épisode, j’avais eu le temps de détester Le Ventre de Paris, Au Bonheur des dames et La Faute de l’abbé Mouret : Zola se serait amusé à décrire par le menu chacune des milliards de milliards de gouttes de pluie pendant les quarante jours et les quarante nuits qu’a durés le Déluge, il ne s’y serait pas pris autrement. De quoi noyer tout lecteur moyennement bien intentionné. Ces énumérations ! Epaisses comme des Dictionnaires de Cuisine, commes des Catalogues de la Redoute ou comme des Traités de Botanique Paradisiaque (dans l'ordre des titres) !
Au moins, mon verdict sur les romans de Zola, je ne le tiens de personne d’autre que de moi : tout ça est, à quelques exceptions près, épais, lourd, bourratif et indigeste. Parmi les exceptions, je dirais volontiers qu’il y a quelques friandises délectables à se mettre sous la dent, dans La Débâcle, La Bête humaine, malgré l'obsession gynophobique du héros, mais dont Robert Musil, dans L’Homme sans qualités, s’est peut-être souvenu pour son incroyable personnage de Moosbrugger.
Je goûte aussi quelques douceurs cachées dans La Conquête de Plassans, Son Excellence Eugène Rougon, L’Argent, La Curée. Non, tout n’est certes pas à jeter, même si j’aurais eu parfois envie de lui dire : « N’en jetez plus, la cour est pleine ! ». Zola a possédé vraiment la science (à défaut de l'art) d’écrire, mais je regrette qu’il ait écrit sous la dictée de l’idéologie, de la théorie et du poids documentaire. Et cette obsession de l’hérédité, ma parole ! Un vrai petit Lyssenko avant la lettre, vous savez, l'adepte stalinien de la transmission à tout crin des caractères acquis.
En revanche, quelqu'un qui n'a jamais lu L'Iris de Suse ne sait pas ce qu'est l'émerveillement. Il est vrai que, lorsque je l'ai ouvert, j'étais tout prêt et disposé, car je m'étais de longtemps familiarisé avec le bonhomme Giono et les concrétions romanesques qu'il a laissées sur son passage, comme par exemple le cycle du capitaine Langlois, ou alors Deux Cavaliers de l'orage, ce livre tout à fait improbable (ce colosse qui abat d'un seul coup de poing un cheval qui sème la panique, mais ça finira mal), ou encore le long cycle d'Angelo, ce héros chéri de Jean Giono (pour qui a lu Le Bonheur fou, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi Angelo enferme son sabre dans un placard avant de sortir dans la rue où il sait que rôdent des spadassins, peut-être envoyés par sa propre mère ?). Giono n'explique rien : il montre. Voilà un romancier.
En fait, je peux bien l’avouer, je n’ai jamais lu « pour lire ». Je connais des gens (on en connaît tous, j’imagine) qui ne peuvent pas sortir de chez eux sans un livre à la main. Dans le métro, dans la rue, à la terrasse des cafés, c’est un enfer de livres ouverts, d'écrans de portables et de casques sur les oreilles, comme si les gens ne voulaient pas risquer de communiquer avec les gens présents en y frottant une parcelle de leur corps ou de leur tête, et se servaient de ces moyens pour s’embusquer dans leur tanière impénétrable, toutes griffes dehors.
On dirait que les gens se bouchent les oreilles avec leurs casques et les yeux avec leurs livres. Et c’est eux qui, ensuite, cherchent anxieusement l’âme sœur sur quelque site de rencontre. Je me dis que la peau virtuelle sur écran, l'écran fût-il tactile, est moins douce à caresser que celle qu’on vient de frôler, ici, là, dans le métro ou sur le trottoir, au rayon de ce magasin ou à l’arrêt de ce bus, et qu'on se met à suivre, à aborder, ... et plus si affinités. On ne sait jamais.
Car la peau qu'on vient de frôler et de laisser se perdre dans la foule, et qui t'inflige ce regret qui te mange le coeur et la mémoire si tu n'as pas fait le geste ou l'effort (Les Passantes, Georges Brassens), cela s'appelle le désir. Mais un désir rétrospectif, celui où tu te dis : « Merde, j'ai loupé l'occase du siècle ! ». Trop tard. Au sujet du regret que nous infligent après coup nos désirs désormais timorés et frileux, voir la rubrique « Transports Amoureux » dans le journal Libération.
Je conseille à tous les avanglés (« Te bâfres comme un avanglé ! », trouve-t-on dans Le Littré de la Grand-Côte) de « contact » électronique de relire comme un manuel de savoir-vivre les dernières pages de Ce Cochon de Morin, de Guy de Maupassant, c'est le beau Labarbe qui est envoyé pour arranger la sale affaire de Morin : « ʺJ’avais oublié, Mademoiselle, de vous demander quelque chose à lire.ʺ Elle se débattait ; mais j’ouvris bientôt le livre que je cherchais. Je n’en dirai pas le titre. C’était vraiment le plus merveilleux des romans, et le plus divin des poèmes. Une fois tournée la première page, elle me le laissa parcourir à mon gré ; et j’en feuilletai tant de chapitres que nos bougies s’usèrent jusqu’au bout ». Les bougies, c'était donc ça ! Maupassant ne reculait devant aucun "sacrifice" ! Quel salaud ! Quel macho ! Non : quel homme ! Au moins, lui, il donne envie de "lire" des "livres" !
Au lieu de ça, à cause de la musique portable, mais aussi, hélas, du livre de poche, on est dans la civilisation du « On ferme ! », au moment même où celle-ci se proclame à renforts de trompettes « Ouverte 24/24, 7/7 ! ». On n’en a pas fini avec le paradoxe et l’oxymore. Et la morosité tactile, éperdue et portable. Et les petites annonces amères « Transports amoureux » de Libé.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, lecture, livre, librairie, julien gracq, les eaux étroites, mémoires d'outre-tombe, chateaubriand, les rougon-macquart, peinture, jean van eyck, émile zola, le ventre de paris, au bonheur des dames, la faute de l'abbé mouret, la débâcle, la bête humaine, robert musil, l'homme sans qualités, moosbrugger, la conquête de plassans, l'argent, la curée, littré de la grand'côte, lyon, maupassant, ce cochon de morin, journal libération, les passantes, georges brassens
mercredi, 26 juin 2013
NE VOTEZ PLUS !

LE CÉLÈBRE ET MAGNIFIQUE NOTAIRE D'AUGUST SANDER
***
Je ne suis pas mécontent de Villeneuve-sur-Lot, où s’est produit un amusant 21 avril au niveau local. Que le Parti Socialiste se soit fait tailler le croupion, les croupières et les joyeuses n’est pas pour me déplaire. Que le monsieur UMP de par là-bas ait été élu ternit un peu ma joie, il est vrai.
Vous vous dites donc que j’aurais applaudi si monsieur Bousquet-Cassagne l’avait emporté. Je réponds : que nenni ! Quoi, monsieur Bousquet-Cassagne est membre du Front National ? Bien sûr que je sais. Mais j’apprends aussi par les gazettes qu’il termine un BTS. Plus exactement un BTS « Négociations Relations Clients », alias NRC. Anciennement « Force de Vente ». Que nous appelions entre nous « les Forces du Vent ». Pour dire l’estime extraordinaire dans laquelle je tiens cette spécialité professionnelle en général.
Ainsi que monsieur Bousquet-Cassagne en particulier, et à travers lui, une formation politique qui donne des boutons, des nausées et la chiasse (ne mégotons pas) aux brebis socialistes, à monsieur François Bayrou, à une partie (variable) du parti fondé par Jacques Chirac et à madame Caroline Fourest, la pasionaria (ça veut dire flic-en-chef) des sans-papiers, des féministes, des homosexuels et de la laïcité à elle toute seule, qui veille au créneau, prête à lancer son cri de guerre à la vue du premier macho homophobe venu. Si, en plus, il est islamophobe, ce sera pain béni. Et il n'est pas sûr que Caroline Fourest n'aurait pas un orgasme en direct, si par hasard l'individu était par-dessus le marché anti-féministe.
Je n’ai présentement nulle envie d’appliquer diverses pommades sur des urticaires, et encore moins de faire disparaître du sol, à coups de serpillière, les traces des repas régurgités ou très mal digérés par ces gens-là. Ils sont trop nombreux.
Qu’on se le dise, le Front National ressemble comme un jumeau au BTS « Forces du Vent », rebaptisé NRC pour mieux en dissimuler la vacuité essentielle. Si je pensais que le Front National possède les clés de la guérison de toutes les maladies dont souffre la France, primo, je voterais sans doute pour ses représentants. Mais, secundo, cela se saurait ailleurs que dans les quelques chaumières où quelques ambitieux font bouillir la soupe d’un discours qui ne fait rien d’autre que de pêcher au filet les sujets de crainte et de mécontentement des Français.
Ce que je crains, ce n’est pas Marine Le Pen, qui ne fait somme toute que recycler le menton de son père après l’avoir rhabillé de ses rondeurs féminines (je sais, ça se discute). Ce que je crains, ce sont quelques individus, voire quelques groupes, auxquels je n’aimerais pas du tout – mais alors pas du tout ! – que fût conférée la moindre parcelle du moindre pouvoir. Vous imaginez de confier les manettes à l’adjudant Kronenbourg, une fois débarrassé du commandant de bord ?
Nous n’en sommes pas là. Restent les électeurs, dont les bulletins se reportent sur les candidats FN. Ils existent bien, ceux-là, ma parole ! Tous fachos, alors ? Qui aurait vraiment l’intention de nous faire avaler pareille calembredaine, même si la France s'est droitisée ? Que le discours porte, sans doute. Mais qui ne voit l’imposture que constituerait un Front National au pouvoir ?
Ce qui me reste incompréhensible, c’est la crédulité insondable des bulletins de vote imprimés au nom de monsieur Bousquet-Cassagne à Villeneuve-sur-Lot, qui se sont retrouvés au fond des urnes. C'est, en général, la crédulité des bulletins de vote. Quoi ? Qui serait assez niais pour confier son espoir d'un sort meilleur à quelqu'un qu'il ne connaît « ni des lèvres ni des dents », comme on disait dans les autrefois à Lyon ?
Cela dit, j’ai trop daubé sur le compte de François Hollande, Nicolas Sarkozy et de leurs troupes de choc, pour prendre leur défense aujourd’hui. Et ce n’est d’ailleurs pas dans mes intentions. Mon propos est le suivant : puisque le bocal qui sert de vivier d’élevage (hors-sol) à tout notre personnel politique est incapable de produire des poissons incapables de s’alimenter autrement qu’en imposant leurs appétits parasites (réserve parlementaire de 130.000 euros x par 577, cumul indéfini des mandats, retraite des députés, etc. …) au corps social, il ne reste qu’une seule solution : casser le bocal.
Pour en arriver là, je vois, là encore, une seule solution : ne plus voter du tout. Puisque le carburant qui alimente notre véhicule malade conduit par des incompétents, c’est le bulletin de vote, provoquons la panne sèche. Le véhicule s’arrêtera forcément, et les poissons qui nous gouvernent crèveront asphyxiés. Ôtons-leur le peu de légitimité qui leur reste. Que les enfants gâtés, une fois dans leur vie, se retrouvent tous à poil ! Qu'un délégué du peuple ne soit plus un aristocrate bardé de privilèges !
Quoi, pousse-au-crime ? Je sais bien que je propose le pire. Mais est-on bien sûr que ce serait le pire ? De toute façon, je n'imagine à aucun moment que les électeurs français pourraient avoir l'idée de suivre mon conseil.
Citoyens, si vous voulez accélérer la mise à la réforme et l’envoi à l’équarrissage de toutes les vaches et autres vieilles carnes qui nous broutent la laine sur le dos, osez le sevrage brutal : ne votez plus !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie, august sander, allemagne, hommes du 20ème siècle, politique, france, société, parti socialiste, ump, françois hollande, nicolas sarkozy, villeneuve-sur-lot, front national, bousquet-cassagne, françois bayrou, caroline fourest, marine le pen
mardi, 25 juin 2013
PARLONS DE PHILIPPE MURAY

PAYSANNE, PAR AUGUST SANDER
***
Pour finir ce petit parcours informel dans un livre – Le 19ème siècle à travers les âges de Philippe Muray – fort, quoique fondé sur une thèse qui ne me convainc pas vraiment, il faut quand même essayer de dire d’où il tire sa force. C’est sûr, il reste un livre qui plane très haut au-dessus de la mêlée.
Au premier rang – c’est là-dessus que je finissais hier – vient une érudition étonnante (je disais « écrasante »). Il vous parle en effet des têtes d’affiches (Hugo, Balzac, Zola, mais aussi allumeurs de réverbères intellectuels et autres becs de gaz du 19ème, comme Auguste Comte, Ernest Renan, et autres acharnés anti-catholiques). Mais il vous parle aussi des queues d’affiches.
C’est vrai que la liste des noms cités par Muray tout au long du bouquin a un côté affolant. Pour vous dire, l’index des pages 675 à 686 ne compte pas moins de 726 noms propres. Beaucoup d’entre eux ne sont cités qu’une fois, alors que le nom de Victor Hugo apparaît à 214 reprises. Bon, on peut se demander si toutes ces lectures sont vraiment de première main, mais quoi qu’il en soit, cet aspect encyclopédique du livre demeure impressionnant.
L’intérêt de très nombreuses références est de mettre en lumière des facettes tout à fait méconnues de certaines célébrités littéraires. Si tout le monde connaît à peu près le penchant développé par Victor Hugo pour faire tourner les guéridons, c’est que tous les spectres bavards qui s’y sont manifestés (y compris Jésus Christ) parlaient le Victor Hugo sans peine, parfois même en alexandrins hugoliens, en revanche, les dernières œuvres d’Emile Zola sont à peu près totalement ignorées.
Il n’est pas sûr que la foule se précipite sur les vingt romans de la suite épuisante des aventures des familles Rougon et Macquart, mais des titres comme Nana, Au Bonheur des dames, Germinal ou La Bête humaine font partie d’un patrimoine littéraire commun, scolaire sans doute, mais réel. Muray s’attache quant à lui à la trilogie réunie sous le titre Les Trois villes (Lourdes, Rome, Paris) et à la tétralogie Les Quatre évangiles (Fécondité, Travail, Vérité, Justice). Que personne ne lit plus. En grande partie parce que c'est tout à fait illisible.
Il s’en prend à la logorrhée qui s’empare de la plume de Zola sur le tard : « Je passe sur le fait que, bien entendu, au fur et à mesure qu’il approche de sa fin, Zola se dispense de plus en plus de l’obligation fatigante d’écrire, tout simplement ». Il voudrait dire que Zola devient gaga et se contente de laisser courir sa main sur le papier, il ne s’y prendrait pas autrement. Mais c’est vrai qu’il n’est pas le seul à juger toutes ces dernières œuvres assez nulles sur le plan littéraire.
Je passe sur l’étrange multiplication que Muray opère deux pages avant la phrase citée : « Il ne faut pas moins de trois gros livres, trois livres de huit cents pages chacun, soit environ mille huit cents pages, pour … » (authentique). Il reste que Zola s’imagine en Grand-Prêtre et en Prophète, il se rêve en fondateur de la « Cité Nouvelle ». Son anti-catholicisme (la nouvelle « religion » étant fondée sur l’enseignement généralisé et sur la science) fait qu’il donne pour finir dans le panneau de la Littérature Edifiante. Ecoeurant.
Bon, je ne voudrais pas que mon propre commentaire tire à ce point en longueur qu’on puisse le qualifier de logorrhéique, alors je vais conclure. Je ne reviens que pour mémoire sur l’hypothèse occultiste : à mon avis, le « socialoccultisme » n’existe guère que dans le livre de Philippe Muray. Un regard original qui fait voisiner le progressisme des théories et utopies sociales et l’illuminisme des théories spiritistes les plus abracadabrantes, mais qui, selon moi, échoue à en montrer les implications réciproques de l’un dans l’autre : la cloison reste debout, épaisse, étanche.
Je ne voudrais pas insister trop lourdement sur ce qui fait la puissance du livre, mais il faut redire que son apport principal est dans le grand brassage de toutes sortes de matières, dont l'aboutissement est une remarquable synthèse sur la grande coalition des intérêts qui se sont ligués depuis les Lumières et la Révolution, pour abattre une bonne fois pour toutes le grand ennemi du Progrès : l’Eglise Catholique, rejetée dans l’obscurantisme moyenâgeux, au nom de la marche de l’humanité vers son avenir radieux, et de la nouvelle croyance : la Religion du Progrès.
J’ai oublié d’en parler, mais Philippe Muray mentionne un dommage « collatéral » de cette exaltation du Progrès grâce à la Science : l’antisémitisme, qui culmine en France à la fin du 19ème avec l’affaire Dreyfus, et au 20ème avec les chambres à gaz.
A cet égard, le regard de Philippe Muray est clairvoyant : la logique du Progrès de la Science et de la Technique, sorte de mécanique infernale mise en route par cette promotion démesurée de la Déesse Raison, si magnifiquement qu’il soit habillé, c’est l’horreur de la 1ère Guerre Mondiale (dont François Hollande s’apprête à « célébrer » le centenaire l’an prochain, en très grande pompe), c’est l’horreur des camps de la mort, c’est l’horreur de la première bombe atomique, c’est l’horreur des génocides qui ont jalonné le 20ème siècle d’un bout à l’autre (Arméniens, Juifs, Tziganes, Cambodgiens, Rwandais, …). Pardon, j’exagère, nous avons la télévision, les smartphones et les sachets de récupération des crottes de chiens sur les trottoirs. Ça compense largement.
A tout prendre, je considère Le 19ème siècle à travers les âges comme un excellent ROMAN du siècle romantique. Par la place centrale qu’il donne aux grands écrivains et poètes (ce n’est pas rien que le dernier chapitre soit un salut au maître Baudelaire dans ses derniers temps : « Crénom ! Non ! Crénom ! »), mais aussi par le style dont il maintient le caractère flamboyant d’un bout à l’autre, Philippe Muray, s’il n’a pas rédigé la meilleure des thèses universitaires possibles sur le sujet qu’il se proposait, a néanmoins écrit un chef d’œuvre : le meilleur roman possible sur un siècle dont, dit-il en 1984, nous ne sommes toujours pas sortis (d’où la formule du titre).

On voit, si l'on tient vraiment à le qualifier de réactionnaire, le sens qu'il faut donner à l'adjectif. Merci Maître Muray.
Voilà ce que je dis, moi.
09:35 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, auguste sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, société, histoire, philippe muray, le 19ème siècle à travers les âges, victor hugo, balzac, émile zola, église catholique, les lumières, révolution française, auguste comte, ernest renan, jésus christ, les rougon-macquart, nana, au bonheur des dames, germinal, la bête humaine, les trois villes, les quatre évangiles, occultisme, spiritisme, obscurantisme, religion, antisémitisme, chambres à gaz, génocides, baudelaire
lundi, 24 juin 2013
PARLONS DE PHILIPPE MURAY

PAYSANNE, PEUT-ÊTRE L'EPOUSE DU PAYSAN D'HIER (FAUTEUIL), PAR AUGUST SANDER
***
Parlons-en donc, de l’occulte et de l’occultisme. Philippe Muray, dans son livre Le 19ème siècle à travers les âges, en fait une ritournelle, qui tourne, à mon avis, à l’incantatoire et à l’obsessionnel. Il évoque évidemment les piliers de la « pensée occultiste » du 19ème : Mme Blavatski (Isis dévoilée, La Doctrine secrète), Pierre Leroux (inspirateur du Spiridion de George Sand, seul roman exalté par Renan, qui détestait les romans), Allan Kardec (Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums), Eliphas Levi (Philosophie occulte), Fulcanelli (Les Demeures philosophales, Le Mystère des cathédrales), etc.
tourne, à mon avis, à l’incantatoire et à l’obsessionnel. Il évoque évidemment les piliers de la « pensée occultiste » du 19ème : Mme Blavatski (Isis dévoilée, La Doctrine secrète), Pierre Leroux (inspirateur du Spiridion de George Sand, seul roman exalté par Renan, qui détestait les romans), Allan Kardec (Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums), Eliphas Levi (Philosophie occulte), Fulcanelli (Les Demeures philosophales, Le Mystère des cathédrales), etc.
D’autre part, il ne cesse de parler de tous les courants « socialistes » (Saint-Simon, Fourier, Proudhon, ...) qui fermentent ou bouillonnent au fond de la marmite de ce qu’il appelle le « progressisme ». Il fait de Hugo, de Michelet, de Renan (et quelques autres) les « Maîtres Autels » ou les Grands Prêtres de la « religion » qui est appelée à supplanter le règne tyrannique du christianisme.
Cette religion emprunte à divers horizons du monde d’alors, spécialement aux croyances asiatiques en général et indiennes en particulier. Là où je crois que Philippe Muray a raison, c’est quand il parle de « syncrétisme » : toutes les religions sont invitées à se fondre en une seule, dans le creuset d’une nouvelle religiosité (plutôt que d’une religion), assez vague et vaseuse pour réunir un consensus unanime de l'humanité tout entière (croit-on).
Le fondement de tout ça est la conviction que l’humanité, sans autre transcendance qu’elle-même, possède en elle-même les moyens de se sauver. Enfin débarrassée des oripeaux catholiques et de l’attirail prétendument universel (sens du mot « catholique ») qui accaparaient injustement toute la légitimité de l’autorité dans la direction des esprits, l’humanité peut enfin s’élancer vers un salut qu’elle ne devra qu’à elle-même et à ses propres mérites.
Philippe Muray, tout au long de son livre, fait avancer ses deux navires amiraux de front : le Socialisme et l’Occultisme, regroupés sous une même bannière (le « progressisme »), voguent de conserve, depuis le « charnier natal » (ah, « routiers et capitaines, vol de gerfauts, rêve brutal ») jusqu’à leur port de destination, comme si leurs destins respectifs étaient indissolublement liés.
Et si j’ai un reproche à faire au concept qui sert de base au livre, c’est celui-là : le « socialoccultisme », tout bien considéré, me laisse diantrement sceptique. Pour une première raison, relativement simple, c’est que le limon que charrie l'Amazone des pensées socialistes du 19ème siècle représente une masse tellement disproportionnée par rapport aux divers ruisseaux occultistes qui se sont jetés dedans tout au long, que je ne pense pas qu’il ait eu le moins du monde besoin de ces minuscules, et somme toute ridicules, affluents.
Que l’occultisme ait fait voile vers le « progressisme » (anti-catholique) des pensées socialistes est une chose. Qu’il ait en quoi que ce soit contribué à l’émergence des « consciences de classe » et à la formulation d’un quelconque progrès social, en est une autre, et tout à fait différente. J’admettrais à la rigueur que les deux soupes aient mijoté dans le même chaudron au départ, mais je doute fortement que les occultistes aient exercé quelque action sur les mouvements politiques et sociaux qui ont conduit à l’instauration de la 3ème République. Les soupes n'ont pas attendu très longtemps avant de séparer leurs substances.
La deuxième raison de mon scepticisme tient à la composition même du livre. Philippe Muray pointe sans doute avec raison que Brejnev faisait appel à un voyante-guérisseuse, dans la dernière ligne droite qui a conduit la tête du communisme dans le mur de Berlin quand celui-ci s’est effondré, mais il peine beaucoup à retracer le fil généalogique (et disons-le : logique) qui ferait comprendre de quel lien organique serait faite la parenté, s’il y en avait une. La juxtaposition (coïncidence, concomitance, si vous voulez) ne saurait tenir lieu de lien logique. Que a et b soient simultanés n'implique pas que a soit cause de b et inversement.
Les deux vaisseaux (l’Occulte et le Socialiste), peut-être qu’ils « voguent de conserve », mais leurs trajectoires, non seulement ne se confondent jamais, mais finissent par diverger. Quelques bulles d’aveux de Muray éclatent d’ailleurs à la surface quand il écrit que tel occultiste (j’ai oublié qui) se fait carrément prendre pour une pomme et foutre de sa gueule chez les gens normaux.
Peut-être qu’il y a un « bouillon » primordial où cohabitent et mijotent tourneurs de tables et imagineurs et organiseurs de sociétés idéales. Mais à mon avis, la mayonnaise ne prend pas : les deux substances se séparent avec le temps, comme l’huile et l’eau dans la bouteille. Même le géant de la synthèse syncrétiste dix-neuviémiste et du tournage de guéridon spiritiste – Victor Hugo en personne – suscite les tapotements déférents de mentons, les index respectueux tapotant les tempes, et les ricanements des plus irrévérencieux des admirateurs.
C’est là qu’intervient la méthode d’exposition de Philippe Muray : enfoncer le clou, enfoncer le clou, enfoncer le clou. Pour cela, il martèle sa formule « socialocculte » à longueur de pages. J'ai parlé de ton incantatoire. Et pour tout dire, ce qui apparaît le mieux dans l’effort de démonstration, c’est le martèlement de l’idée centrale, comme le bruit des bogies sur les rails dans les trains d’autrefois. A coups de formules, a coups de listes : qu’est-ce qu’il y a comme liste de noms, par exemple ! Peut-être davantage dans la première partie.
Et ce n’est pas le recours au sexuel par Lacan interposé (« tout acte sexuel est un acte manqué ») qui peut arranger le tableau et renforcer la conviction du lecteur. L’idée du ratage sexuel, assumée par le catholique mais niée par le socialoccultiste, me laisse dubitatif. Et faut-il le dire : faute d’une argumentation en bonne et due forme.
Ce livre est un livre fort, écrit par un intellectuel de toute première force, mais qui vacille quand le lecteur y cherche des appuis concrets, des arguments qui aient l’air de preuves, du solide quoi. Car Muray peut bien aller chercher les correspondances des auteurs qu’il cite, les aspects les plus méconnus de leurs œuvres ou de leur vie, ce qui me manque, à l’arrivée, c’est le vrai ciment.
Je le dis d’autant plus volontiers que, n’ayant jamais érigé une statue de bronze à Philippe Muray, je n’ai pas à la déboulonner. C’est un livre de littérature, écrit par un grand écrivain. Il m’est arrivé de le comparer à Masse et puissance, d’Elias Canetti. Mais c’est une erreur. Canetti, lui, a construit sa vie autour et à partir de l’idée de « masse », qu'il a portée pendant quarante ans avant d'en faire un livre.
Muray a une intuition, fulgurante si l’on veut : l’inconscient du rationalisme révolutionnaire (figuré par toutes les tendances de l’occulte) habite secrètement l’idée de Progrès Social et d’amélioration du sort de l’humanité (figurée par toutes les tendances du socialisme). J’espère que les inconditionnels de Philippe Muray me pardonneront, mais je crois vraiment qu’il remplace, dans ce livre malgré tout formidable, la faiblesse de l’idée par la prolifération de la formule, du style et de l’expression.
Et par un poids écrasant d’érudition, cela va sans dire.
Moralité de tout ça : méfiez-vous de tous ceux qui se déclarent prêts à faire le bonheur de l'humanité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, allemagne, hommes du 20ème siècle, littérature, philippe muray, le 19ème siècle à travers les âges, mme blavatsky, allan kardec, george sand, éliphas lévi, fulcanelli, occultisme, spiritisme, saint-simon, proudhon, charles fourier, victor hugo, michelet, religion, église catholique, socialisme, masse et puissance, elias canetti
dimanche, 23 juin 2013
PARLONS DE PHILIPPE MURAY

LA PHOTO EST PRISE EN 1913. LE MONSIEUR EST PAYSAN (SI !). PHOTO D'AUGUST SANDER.
***
Philippe Muray cherche ses références chez les ennemis de la Révolution et des Lumières. Par exemple, il se tourne de temps en temps vers Joseph de Maistre, dont il dit, par exemple : « Plus on cesse de croire au démon, prophétise-t-il, et plus il s’imprime en vous comme une séduction ». C’est, soit dit modestement, dans cette voie que s’engageaient mes balbutiements récents autour de la question : « Que faire avec le Mal ? ».
C’est vrai que je suis gêné aux entournures, et même davantage, face à ce problème, parce que, pour parler franchement, j’appartiens à cette race des enfants des Lumières, et j’ai grandi dans la vénération de 1789 et de 1848. Ce n'est certainement pas hérité de famille : grand-mère Croix-de Feu, Grand Oncle adepte des "Charles Martel", ...).
Puisqu'il en était ainsi, je me suis mis à téter la République à la mamelle, et j’ai bien longtemps eu le culte de Marianne et de sa fière devise. J’ai frissonné au récit de la soirée du 26 août 1789 et au tableau de cet élan fraternel et généreux qui guida la main des rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Je l’avoue, j’ai gobé comme un œuf primordial l’espoir d’une émancipation humaine universelle et la croyance dans un Progrès ininterrompu, dans la marche opiniâtre d’une humanité pacifiée vers l’amélioration de son sort dans tous ses aspects. J’ai fait mienne toute la mythologie narrant par le menu cet avenir riant qui s’ouvrait devant l’humanité régénérée, dans laquelle tout individu est réputé en valoir un autre (Egalité), et où chacun est invité à promouvoir et à défendre si besoin la Liberté contre tout ce qui la menace.
C’est de là que je viens, et j’ai encore du mal à m’en défaire. Et le  propos de Philippe Muray ne vient qu’appuyer le doute qui s’est glissé dans mon paysage depuis déjà quelque temps (j'en parlerai peut-être). Son 19ème siècle à travers les âges confirme diverses lectures précédentes. Je suis frappé par la justesse de considérations comme la suivante.
propos de Philippe Muray ne vient qu’appuyer le doute qui s’est glissé dans mon paysage depuis déjà quelque temps (j'en parlerai peut-être). Son 19ème siècle à travers les âges confirme diverses lectures précédentes. Je suis frappé par la justesse de considérations comme la suivante.
Montrant que le 19ème a réhabilité Satan et retourné le Mal en Bien (il faut extirper jusqu’au moindre germe de culpabilité chrétienne, dans le même temps qu’on arrache jusqu’aux racines de l’Eglise catholique) : « … ce qui apparaissait comme négatif se révèle comme persécuté … » (p.645). Les signes se sont inversés. Quelle formule géniale ! Le « négatif » (alias le Mal, le démon, Satan, la sorcière, les anormaux, les pécheurs, …) devient le « persécuté » (le handicapé, le sans-papiers, la femme, l’homosexuel, le musulman, …). Le porteur du Mal est transformé en victime. La Trouvaille !
Selon cette nouvelle grille de lecture, c’est donc la Société qui est coupable, ce qui inaugure mécaniquement l’ère du règne de la victime. L'avènement de la victime, prise dans les griffes de la Société. Corollaire immédiat : puisque la Société n'est plus détentrice de la Vérité et du Bien comme de critères normatifs intangibles, c'est elle-même qui produit le Mal dont elle pâtit. Et elle ne va cesser de se fouiller les entrailles et de se battre la coulpe à coups de Michel Foucault, pour extirper ce Mal d'un nouveau "genre". Cela rejoint finalement les préoccupations que j’exposais dans ma petite série de billets intitulée : « Qui est normal ? ». Tout cela semble donc se tenir assez bien.
La réponse à cette question, la conclusion logique du défroquage général (les hommes revêtus du noir de la soutane sont devenus, au sens propre, les « bêtes noires ») et en profondeur de la Société et de l’enfouissement des restes du catholicisme dans ce qu’on espère être des oubliettes ? « Tout le monde est normal », chante la Société, dans le grand cantique de l'élan de communion universelle et de syncrétisme total dont elle se sent portée vers la Lumière apportée par les « Lumières ».
Et : « Il ne faut laisser personne sur le bord de la route ». Voilà le grand nouveau Credo, l’hymne supranational, la grande marche non-militaire qui doit conduire l’humanité, au prix, il est vrai, de torsions et supplices divers infligés à la langue et au sens des mots.
Je parle d’ « enfouissement » : c’est le sujet du premier chapitre du livre de Philippe Muray. Une idée lumineuse ! Peut-être un trait de génie, je ne sais pas trop. C’est l’histoire du déménagement officiel mais nocturne du Cimetière des Innocents. En 1786, ce n’est plus un cimetière, c’est un dangereux entassement de morts. L’espace dépasse la chaussée, par endroits, de plusieurs mètres. Les murs de certaines caves s’effondrent. Le voisinage des morts, sous la pression des « Lumières », est devenu gênant, voire incompréhensible. Pensez : depuis le moyen âge, qu’on enterre les morts dans ce lieu.
Muray fait du déménagement du cimetière et de l’enfouissement des restes humains qu’il contenait dans ce qu’on appela « Catacombes de Paris » le fait inaugural de ce qu’il désigne sous le nom de « dixneuviémité », d’ « homo dixneuviemis ». Muray avance le nombre de 11 millions d'individus, dont les os sont entreposés dans les Catacombes, à la fin du siècle « nécromantique ». Un précurseur de la Révolution, pas moins. En même temps qu’un aboutissement des Lumières. Et en même temps que l’offensive déterminante qui devait en finir théoriquement avec le règne de l’Eglise catholique.
Certains (n’est-ce pas, R. ?) pensent que ce sont les francs-maçons qui ont eu la peau de l’Eglise catholique. C’est sûr, ils font partie de la conjuration. Peut-être même un élément moteur. Mais je suis convaincu, pour ma part, que jamais cette élite de l’élite n’aurait pu peser d’un poids suffisant pour mettre la papauté et tout son clergé hors d’état de nuire, et cela en un peu plus d’un siècle, s'il n'y avait pas eu consentement général (voir la fin peu glorieuse des Bourbons en 1830 et la farce louis-philipparde et "juste-milieu" qui s'en est suivie).
Les francs-maçons, je veux bien, mais s’il n’y avait pas eu un mouvement intellectuel dans les profondeurs de très larges couches du « corps social », et si les francs-maçons avaient été seuls à la manoeuvre, l’offensive anti-catholique aurait pu durer encore des siècles.
C’est ce qui apparaît de façon claire dans le livre de Philippe Muray. La coalition des forces anti-pape est tout à fait hétéroclite et multiforme. A ses yeux s’esquisse une sorte de ligue : celle de tous ceux qui, à coups de théories socialistes, souvent fumeuses, parfois carrément délirantes, de plans phalanstériens et de tables tournantes, ont pour objectif de conduire, d’une main sûre, l’humanité vers les jours radieux d’un bonheur sans mélange.
C’est sûr que les théories, projets et utopies socialistes, voire communistes, ont fleuri au 19ème siècle comme bleuets et coquelicots en champ de blé (c’était autrefois). Heureusement, tous ces mirages sont allés jusqu’à effacer leurs propres traces, pour bien montrer qu’il n’aurait pas fallu, qu’ils n’auraient pas dû. Exactement la définition du mirage. Ils avaient eu le tort d’apparaître aux yeux de quelques Dupondt en train de traverser le désert sur une Jeep, allant se fracasser le nez sur l’étendue de sable qui leur faisait miroiter faussement les eaux d’un lac hospitalier (Tintin au pays de l’or noir, p. 20).

NOTONS QUE DANS LA JEEP, LES DUPONDT AVAIENT LEURS MAILLOTS DE BAIN. C'EST LA FORCE D'HERGÉ.
Là où j'ai un peu de mal à suivre la thèse de Muray, c'est dans l'effort incroyable qu'il fait pour mettre l'occultisme au centre du processus. Ou plutôt dans les fondations et soubassements du processus. Comme une sorte d'impensé ou de refoulé de la rationalité révolutionnaire, sous la forme des croyances bizarres partagées par un grand nombre d'écrivains (George Sand, Hugo, Nerval, ...) : tables tournantes, revenants, esprit des morts, ectoplasmes, métempsycose, etc.
Mais là où je le rejoins totalement, c’est quand il pointe le lien de filiation assez direct qu’on peut établir entre les rêveurs infernaux du 19ème siècle (Saint-Simon et les saint-simoniens, Fourier, Proudhon, Marx, Engels et beaucoup d’autres) – qui avaient dressé les plans du bonheur définitif et universel de l’humanité sur leurs planches à dessin, magiques comme des tapis moins lourds que l’air et doués de motilité grâce aux « forces de l'esprit » (F. Mitterrand en personne, avant de mourir), – et les réalisateurs de ces rêves fous au 20ème siècle, qui portèrent les noms délicieux de Lénine, Staline, Hitler, Pol Pot et quelques autres.
Franchement, une fois le livre refermé, je ne vois vraiment pas ce que l’hypothèse occultiste − à laquelle Philippe Muray s’accroche comme Ismaël à son cercueil flottant à la fin de Moby Dick, quand le cachalot universel a détruit le Pequod particulier, le capitaine Achab et tout ce qui s’ensuit – apporte à l’histoire de la guerre menée par toute une société (ou pas loin) à la religion catholique, dans un gigantesque effort qu'on appelle « sécularisation », et qui aboutira au confinement de l'exercice catholique dans la seule sphère spirituelle. Autrement dit à la « laïcité ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : photographie, august sander, allemagne, hommes du 20ème siècle, philippe muray, le 19ème siècle à travers les âges, révolution, 1789, lumières, déclaration des droits de l'homme, progrès, liberté égalité fraternité, cimetière des innocents, église catholique, francs-maçons, roi de france, bourbons
samedi, 22 juin 2013
PARLONS DE PHILIPPE MURAY

BERGER, PAR AUGUST SANDER
***
Parlant récemment de Philippe Muray (sur Le Portatif), j’avouais avoir reculé devant les cumulo-nimbus, proliférant et champignonnant à la façon des mycicultures du comte de Champignac, de son livre Le 19ème siècle à travers les âges.

GRÂCE AUX CHAMPIGNONS DE CHAMPIGNAC, LA FUSEE DE ZORGLUB A PRIS LE GROS VENTRE. MAIS GARE EN DESSOUS A CE DONT ELLE ACCOUCHE !
Eh bien bonne nouvelle : surmontant l’horripilation que me procure toute complaisance exagérée dans la recherche et l’accumulation baroquisantes de formules brillantes, et n’écoutant que mon vif désir de savoir une fois pour toutes de quoi ce bouquin retournait, j’ai braqué mon monoplan monomoteur personnel sur ce chou-fleur atomique et n’ai pas hésité à plonger en apnée prolongée au cœur du nuage. J’en suis sorti intact et j’ai repris mon souffle. Comme dit le dentiste nazi à Dustin Hoffman dans Marathon man : « Vous verrez, c’est sans danger » (mauvaise traduction, mais que je préfère au célèbre : « Is it safe ? » original).

Moralité : des bouquins comme le bouquin de Philippe Muray, je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route comme ça. Même s'il faut le mériter. Alors de quoi elles causent, les presque 700 pages (en plus, c'est écrit tout petit) du 19ème siècle à travers les âges ? D'abord, bravo pour le titre, cher maître ! Passons. J’ai envie de commencer par l’avant-dernier « chapitre » du bouquin, en précisant que ce que j’appelle « chapitres », Muray se contente de les numéroter, le découpage consistant en deux « Livres », chacun divisé en quelques grands « Chapitres ». J’espère que vous suivez.
Dans le maniaque du découpage en divisions, subdivisions et diverticules, de toute façon, Philippe Muray n'aurait jamais surpassé l’insurpassable en la matière : j’ai nommé Le Capital, de Karl Marx. Donc je commence par le n°4 du chapitre III du livre II : l’avant-dernier « moment », si vous voulez, c'est-à-dire les 15 pages intitulées « Les avocats du diable ».
Je le fais parce que ça tombe bien, car j’ai consacré ici même, à partir du 20 avril, une série de billets laborieux à laquelle j’avais donné le titre : « Que faire avec le Mal ? », et que Philippe Muray propose, bien mieux que je n’eusse jamais su le faire, ses hypothèses au sujet de la curieuse disparition du Mal de la surface de la Terre, répondant à sa façon (péremptoire) à la question que je posais.
Selon lui, le 19ème siècle est le siècle de la « réhabilitation de Satan », ou plutôt (mais c’est la même chose), de la transformation du Mal en Bien. La toile de fond de cette révolution est l’effort gigantesque déployé tout au long du siècle – et depuis 1789 et l’instauration des « Lumières » – pour liquider purement et simplement le christianisme en général et l’Eglise catholique en particulier.
C’est logique, si on y réfléchit : le « et libera nos a malo » du Pater Noster, la confession, le péché originel, tous les pécheurs, tout ça n’existe que si l’Eglise existe en tant qu’autorité universelle. Que si les gens admettent qu’ils commettent des péchés et que l’homme en robe noire, derrière sa grille, est en mesure de vous délivrer par l’absolution. Mais le mot « péché » a été tellement rayé du vocabulaire et de l'existence qu'on se demande même si ça a existé un jour.
Du temps que c'était vrai, les gens ressortaient du confessionnal plus légers, l’âme repassée au blanc amidonné, immaculée, vouée au Bien. La culpabilité avait été effacée. Mais il faut bien dire que ça marche tant que ça marche. Je peux dire que je ne ressortais pas plus léger de l'église Saint-Polycarpe et du confessionnal du père Béal ou du père Voyant. Au contraire.
C'est peut-être ce qui m'a rendu soupçonneux, puis lointain, puis carrément étranger. Un jour, à 17 ans, en comptant les tuyaux de l'orgue (91 en façade), j'ai compris que désormais, je ne parlais plus la langue, et que je ne la comprenais plus. Si j'avais été serpent, j'aurais dit que l'Eglise, la religion et la foi gisaient derrière moi comme la peau sèche des mues ophidiennes.
Qui lui voulait tout ce mal, à l’Eglise catholique ? Eh bien si on fait le total, ça fait pas mal de gens. Pour résumer, tout ce que le siècle a pu produire en matière de francs-maçons, d’illuminés, de socialistes, de communistes, d’occultistes, d’athées, etc. En bref, la marée montante de tous les insupportables qui voulurent coûte que coûte faire le bonheur de l’humanité, qui désirèrent qu’elle s’élevât d’un pas unanime et synchrone vers des lendemains qui chantassent et vers la totalité de la lumière possible.
Pour ça, rien de plus urgent que de débarrasser l’humanité du poids du péché, donc de tout ce qui va avec : tout ce qui portait soutane. L’Enfer, dans cette perspective, est juste considéré comme une saloperie faite aux hommes, l’invention par le clergé d'une culpabilité générale, moyen irremplaçable de s’assurer sur eux un pouvoir sans limite. Heureusement, cet Autel est désormais renversé, de même qu’a été renversé le Trône des despotes qui ont régné sur la France. C'est vrai (soit dit entre nous) que c'est périmé, le Trône et l'Autel. Un variante de "le sabre et le goupillon", à la rigueur. Fini.
Les ennemis de l’Eglise, c’est-à-dire les promoteurs de l’avènement du Peuple sur la grande scène de la grande Histoire, soutiennent que le bonheur de l’humanité trouvera sa source dans l’humanité elle-même, seule « transcendance » que l’homme trouve au-dessus de lui. Muray cite Flaubert (p. 587) : « C’est une chose curieuse comme l’humanité, à mesure qu’elle se fait autolâtre, se fait stupide. Ô socialistes, c’est là votre ulcère ; l’idéal vous manque ».
Notez "autolâtre" : adoratrice d'elle-même. Ce qui veut dire : je ne tire mes forces de nulle part ailleurs que de moi. Car Flaubert, et plus encore Baudelaire, selon Philippe Muray, restent seuls lucides sur le fond de l’affaire. L'humanité (h min), avec le Progrès Technique et la Science, devient l'Humanité (H Maj), c'est-à-dire autosuffisante. Et surtout autarcique. « Quelle folie ! », disent dans leur barbe absente l'auteur de Madame Bovary et l'auteur des Fleurs du Mal (d'ailleurs deux procès pénaux marquants).
L’hypothèse de Muray est d’une grande force, et il ne cessera d’y confronter le réel de son temps, dans L’Empire du Bien et autres Exorcismes spirituels, qui ont suivi. La réhabilitation de Satan, le retournement du Mal en Bien reflètent la pensée utopique de tous ceux qui font des projets globaux pour résoudre les problèmes de l’humanité, et Muray ne se fait pas faute de voir dans les deux grands totalitarismes du 20ème siècle l’aboutissement logique, presque mécanique, de cette lame de fond, née au 18ème siècle, qui a submergé les esprits au 19ème, et qui a failli emporter la planète au 20ème. Dans quel état cette lame de fond a-t-elle laissé le siècle ?
Avoir été capable de voir ça et mettre tout noir sur blanc, même si le livre a des côtés agaçants, il fallait vraiment avoir l’envergure. Philippe Muray a cette envergure. Il est donc normal que ce soit lui qui s’y colle. Et de quelle haute manière ! Réactionnaire, Philippe Muray ? Non mais vous voulez rire !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 21 juin 2013
BERNARD TAPIE LE CROCROCRO !

BAUERNMÄDCHEN (JEUNES PAYSANNES), PAR AUGUST SANDER
***
Tout le monde connaît par cœur cette chanson enfantine, ou tout au moins le refrain :
« Ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles,
Sur les bords du Nil ils sont partis, n’en parlons plus ! » (bis).
Je propose de réécrire les paroles pour les faire coller à l’actualité récente. Cela pourrait donner quelque chose comme :
« Ah les socialo, les socialo, les socialistes,
Dans la pourriture ils sont tombés, n’en parlons plus ! » (bis).
Mais comme, dans la boutique en face, il n’y en a pas un pour racheter l’autre non plus, je propose la version suivante :
« Ah les sarkoko, les sarkoko, les sarkozystes,
Dans la corruption ils sont tombés, n’en parlons plus ! » (bis).

MANCHETTE DU CANARD ENCHAÎNÉ DU 19 JUIN
C’est vrai ça, ils se tiennent par la barbichette. Ecoutez le monologue intérieur de François Hollande, j’y étais, j’aime vivre dangereusement : « Ah tu m’as fait virer Cahuzac ! Eh bien ça ne va pas se passer comme ça ! Tu vas voir comment je vais te l’essorer, ton Tapie ! C’est bien le diable si, entre la Bettencourt et le Tapie, je peux pas le flinguer une bonne fois, le Sarkozy ! Au moins, ça déblaiera le terrain pour 2017 ! Le Fillon ou le Copé, j’en croque un à tous les petits déjeuners, alors ! Et si quelques seconds couteaux prennent des balles perdues, elles ne seront pas perdues pour tout le monde ». Tel que, texto, juré, craché ! J’y étais, dans la matière G. à François H. Et je peux en témoigner : elle est vraiment très grise. Dire que ça a fait HEC et l'ENA ! Plus Sciences-Po pour faire bon poids. C'est bien la peine.

LE CANARD ENCHAÎNÉ DU 19 JUIN 2013, 6 ANS APRES LE 7 MAI 2007
(ça reste un peu déchiffrable; ça commence par :"Le petit est élu. Je suis sauvé dans Adidas, maintenant le pognon va couler", paroles de BT prononcées le 7 mai 2007 - tiens tiens !?)
Je ne vais pas me donner la peine de commenter Tapie, pour la raison qu’il fait partie de cette catégorie dont je raffole : les preneurs de balles perdues. On dit bien qu’il y a des coups de pied au fondement du derche du croupion de l'arrière-train qui se perdent ! Le cul des salopards finis est un cul comme les autres. Il défèque sa merde tous les jours, comme tout le monde. Mais la merde, cette fois et pour le coup, est vraiment trop grosse. Et elle pue.

UNE ASSEZ BONNE SYNTHÈSE DE LA QUESTION, PAR CABU
Qu’est-ce qu’ils attendent, les petits Marseillais shootés à la kalachnikov, plutôt que de gaspiller des balles ou du bon combustible fossile plein de CO² pour des lampistes de banlieue, tout ça parce qu’ils se sont trompés dans leurs additions et leurs soustractions au moment du partage du butin ? Ils ne pourraient pas apprendre à « rectifier le tir » (le verbe étant à comprendre comme dans : « Le vieux Nanar, il s'est fait rectifier ») ? Pour une fois, le vulgum pecus (alias la « foule des anonymes ») aurait l’impression qu’il y a parfois un semblant de justice ou de providence en ce bas monde. Pour un peu, sait-on jamais, le vulgum pecus se remettrait à croire en Dieu. Mais ce n'est pas gagné d'avance.

De l’affaire Tapie-Sarkozy, je retiendrai surtout l’énormité de la ficelle qui a abouti à l’énormité de cette filouterie, mais j’y ajouterai l’énormité des calembredaines balancées à la télé par Tapie en personne, sur l’air de : « s’il y a du louche, j’annule tout » (ce qu’il serait bien en peine de faire, même s’il était sincère), alors que j’aurais bien aimé l’entendre dire : « s’il y a du louche, je rends l’argent », mais pas fou, le Nanar.
Il ne rendra pas l’argent, ou alors il faudra lui mettre la corde au cou ou le pistolet sur la tempe, avec quelque chose d'ogival et blindé entre les deux yeux (je trouve que le 11,43 conviendrait assez bien : c'est le calibre préféré du "milieu"). Oui je sais, avoir la tempe entre les deux yeux, c'est plutôt rare. Mais Tapie a montré de quelles prouesses il était capable : j'essaie de hisser mon imagination à la hauteur de l'enflure.
C’est bien connu, les plus grosses fadaises passent comme des lettres à la poste quand elles sont prononcées avec le monstre de culot dont est capable l’ancien tricheur (OM-VA), l’ancien condamné, l’ancien détenu. Posséder à ce point l’art de la démesure dans le mensonge a quelque chose de stupéfiant. Autre point proprement stupéfiant : comment se fait-il que tant de gens encore aujourd'hui lui veulent du bien, à Tapie ? Qui comprend ça me l'explique, merci d'avance.
Je me dis aussi que si le « journaliste » qui interroge BT avait un peu potassé son dossier, Tapie serait depuis longtemps dans les oubliettes. Mais quels journalistes ont aujourd’hui les bras, les couilles et le culot d’affronter des chefs de gangs adoubés au sommet de l’Etat ? Ils tremblent pour leurs abattis ou quoi ? Ah oui, c'est vrai, il faut encore croûter demain... Soit.
Car mine de rien, ça jette une lumière intéressante sur la profondeur pornographique du machiavélisme latrinier d’un François Mitterrand, sans lequel ce grossier menteur de Nanar (initiales BT ; au passage BT est le nom d’un célèbre et délétère maïs OGM, parce que les plantes aussi sont capables de mentir, y a pas de raison) serait encore en train de vendre des cacahuètes, des lacets et des salades sur les marchés.
Après tout, Mitterrand a réussi à mettre sur orbite deux sacrées perdrix dans le ciel politique français : en plus de Bernard Tapie, il ne faut pas oublier en effet un certain Jean-Marie Le Pen. Dommage que la chasse de ces gibiers soit interdite. Nous serions nombreux sans doute à avoir envie de tenir le fusil du père de Marcel dans La Gloire de mon père. Cela ne vous dirait pas, vous, un beau doublé de ces bartavelles-là ? On pourrait même les manger, après avoir retiré les dents en or. Cela renouvellerait de façon intéressante l'idée du banquet républicain. Comme dans Astérix et les Normands, on trinquerait avec les crânes. Voilà une idée qu'elle est bonne !
Finalement, « Sur les bords du Nil ils sont partis », c'est une vieille rengaine. Et « n'en parlons plus », un rêve qui n'est pas près de se réaliser. Nous sommes pris entre un passé trop lointain et un avenir trop improbable : les temps sont durs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, august sander, allemagne, ah les crocrocro, parti socialiste, ump, ps, nicolas sarkozy, françois hollande, cahuzac, bernard tapie, kalachnikov, marseille, justice, françois mitterrand, canard enchaîné, cabu, société, france, politique, corruption, tous pourris, jean-marie le pen
jeudi, 20 juin 2013
ORWELL N'AIME VRAIMENT PAS DALI

ENFANTS DE PAYSANS, PAR AUGUST SANDER
(BAUERNKINDER)
***
« Dali est un bon dessinateur et un être humain répugnant ». C’est là que nous en étions restés.
Le verdict moral de George Orwell à propos de Salvador Dali est sans appel. Mais il ne se contente pas d’un jugement moral. Car sans être un spécialiste de l’art pictural, il sait raisonner en s’appuyant sur le bon sens, mais aussi sur les choses qu’il connaît, et là, on peut dire qu’il a le sens de l’histoire de la peinture. Il va donc parler de Dali peintre. Et ça devrait décoiffer tous les adeptes séduits par la « palette » du « maître » !
« Ah, Dali le déliquescent, on ne comprend pas tout, mais qu’est-ce que c’est bien fait ! » Eh bien on peut dire que les adeptes devraient s’améliorer en matière de culture picturale. Il y a comme un « chaînon manquant ». Et il faut l’inculte (!) Orwell (en matière de peinture) pour débusquer l’escroc sous l’avant-gardiste.
Il n’est pas question pour lui d’exiger l’interdiction de l’autobiographie (réelle et fictive tout à la fois) de Salvador Dali : « … c’est une politique contestable que d’interdire quoi que ce soit ». Une variante, somme toute, quoique bémolisée, de la célébrissime phrase de Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai etc. », parce qu’il ne faut pas exagérer, et qu’on ne peut lui demander l’impossible. Et puis finalement, ce n’est pas un problème d’accord ou de désaccord, mais un problème de choix de vie, voire une question de principe.
Car il prend soin de préciser, dans la suite de la phrase citée ci-dessus : « … les fantasmes de Dali éclairent sans doute utilement sur le déclin de la civilisation capitaliste. Mais ce dont il a assurément besoin, c’est d’un diagnostic ». Selon George Orwell, le résultat visible de la production « artistique » de Salvador Dali contient quelque chose de résolument avilissant pour l’homme : « Il ne devrait faire aucun doute que nous avons affaire ici à un esprit malade … ». Et encore ceci : « Il représente un symptôme de la maladie du monde ». Pour dire de quelle sorte est sa « grille de lecture ». Et combien je suis d’accord avec cette façon de voir.
Et puis en plus, George Orwell sait regarder. Il n’est pas historien de l’art, il n’est pas spécialement calé en critique de peinture, mais il dispose quand même d’un certain nombre de références. Et quand Dali ne fonce pas tête baissée sur la route surréaliste, l’attention de notre moraliste est attirée par « un indice qui constitue peut-être un début de réponse ». Cet indice est le style de dessin, qu’il juge en 1944 « démodé, surchargé d’ornements, édouardien ». C’est curieux d’ailleurs, car « édouardien », d'après ce que je crois en savoir, c’est plutôt la sobriété, opposée à l’exubérance victorienne du décor, mais je ne suis pas spécialiste. Peut-être un problème de traduction ?
Toujours est-il qu’il repère quelques influences dans le travail de Dali : Albrecht Dürer, Aubrey Beardsley, William Blake. Et puis, après avoir été troublé par une sorte de ressemblance générale qu'il a du mal à préciser, un détail attire son attention : un chandelier ornemental qui lui rappelle quelque chose. Bon sang mais c’est bien sûr : « la fausse bougie que l’on voit sur les lustres électriques, dans les hostelleries de campagne qui veulent se donner un style Tudor ». Et cela provoque immédiatement en lui « une vive impression de mièvrerie ». La mièvrerie de Salvador Dali ! C’était donc ça. Et les mouchetures d’encre semées pour dissimuler la chose n’y changent rien.
Il voit ici une image digne d’illustrer le conte de Peter Pan, là un crâne de sorcière de conte de fées. Et Orwell déduit : « Le pittoresque fait irruption à tout instant. Oubliez les têtes de mort, les fourmis, les homards, les téléphones et autres bric-à-brac, et vous vous retrouvez plongé dans l’univers de Barrie, de Rackham, de Dunsany et de Where the Rainbow Ends ». Le pittoresque ! Que des histoires pour enfants ! Ça la fout mal, pour celui qui se veut un grand pervers !
J. M. Barrie est le créateur de Peter Pan, Arthur Rackham un illustrateur de livres pour enfants, dont le dessin est empreint de préciosité, Lord Dunsany un auteur fantastique (La Fille du roi des Elfes), et le conte cité en dernier raconte l’histoire d’enfants qui voyagent sur un tapis volant. George Orwell voit Salvador Dali comme un enfant qui n’aurait grandi que physiquement. A tout prendre, il le juge indécrottablement infantile (scato, copro, nécro, sado, en un mot : pervers polymorphe). Etonnant, non ?
Pour enrichir son autobiographie, Dali n’a-t-il pas, au surplus, pioché dans les Ruthless Rhymes de Harry Graham, ces « comptines sans pitié pour foyers sans cœur » qui ne sont pas sans rappeler (c’est moi qui l’ajoute) Max und Moritz, les cruels enfants du grand Wilhelm Busch, finalement punis ? Par exemple, cette anecdote complaisante où il se vante d’avoir shooté dans la tête de sa petite sœur ressemble curieusement à la comptine féroce de Graham citée par Orwell.

LES IMPAYABLES, INÉNARRABLES ET INFERNAUX
MAX UND MORITZ,
DE WILHELM BUSCH
("Hélas, pourquoi faut-il souvent lire ou entendre parler de méchants enfants, comme par exemple les deux, ici présents, qui se nommaient Max et Moritz, qui, au lieu de se convertir au Bien au moyen d'un apprentissage ...", la suite un autre jour.)
Cet aspect de la pratique de Salvador Dali s’apparente à du pastiche. Sur ce, Orwell se lance dans une interprétation : « Mais il se peut que ces choses soient là également parce que Dali ne peut s’empêcher d’exécuter des dessins de ce genre, parce que c’est à cette période et à ce style de dessin qu’il appartient en réalité ». Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça intéressant.
Orwell enfonce le même clou : « Et supposez que vous n’ayez rien d’autre en vous que votre égoïsme et un bon tour de main ; supposez que votre véritable don soit pour le style de dessin minutieux, académique, figuratif, et votre véritable métier celui d’illustrateur de manuels scientifiques. Comment faire, dans ce cas, pour être Napoléon ? Il reste toujours une solution : la perversité ». Nous y voilà.
Ce procédé, consistant à provoquer, heurter et choquer le spectateur, qui est devenu extrêmement banal aujourd’hui, et quasiment obligatoire, Dali a su en faire une mine d’or à son profit : « Lorsque vous lanciez des ânes morts à la tête des gens, ils vous lançaient de l’argent en retour ». Comme quoi derrière l'argent que des élites faisandées investissent sur des artistes orduriers, il y a toujours un calcul des retombées potentielles en termes de prestige social. Le prestige d'un âne mort. Ce qui nous change de Rabelais, qui dit (Gargantua, 16) : « et ne fut possible de tirer de luy une parolle non plus qu'un pet d'un âne mort ». Les temps changent. C'est le progrès.
Ce que je retiens de cette étude de George Orwell sur un des peintres les plus célèbres du 20ème siècle, c’est d’abord cette formule, à propos de l’individu : « Dali est un bon dessinateur et un être humain répugnant ». Cette autre : « Il ne devrait faire aucun doute que nous avons affaire ici à un esprit malade ».
C'est ensuite une remarque sur l'état moral du monde. Car il est loin d’être seul coupable : les amateurs, snobinards et richissimes qui font fête à des artistes comme Dali sont tout aussi dépravés. Je ne dis pas « dégénérés », parce que c’est ainsi que les nazis désignaient les peintres et les musiciens qui n’était pas dans leur ligne (Die entartete Kunst). Et la dépravation de Dali trouve son exact reflet dans la dépravation des amateurs : « Il représente un symptôme de la maladie du monde ».
La maladie du monde, le premier à la rendre visible, c'est un certain Marcel Duchamp : un destructeur, sans doute, pas un pervers. Un malin qui fait de l'art avec les objets existants, et qui va torpiller les critiques d'art en inventant l'art intellectuel (l'inépuisable Mariée mise à nu ..., l'indéchiffrable Etant donnés : 1° la chute d'eau ...). Salvador Dali est un malin d'un autre genre : l'ordure et le difforme sont élevés au rang d'oeuvre d'art. Avec Andy Warhol, vous avez enfin l'oeuvre d'art indéfiniment polycopiée, vous avez définitivement l'art commercial des sociétés de masse. Duchamp, Dali, Warhol : c'est le trépied sacré sur lequel est assis tout l'art du 20ème siècle.
Pour moi, Orwell prenant Dali comme preuve de la déliquescence morale de la civilisation occidentale, voilà un point de repère auquel les paumés que nous sommes peuvent à l'évidence se référer. Et chaque jour qui passe confirme le diagnostic de George Orwell. Autrefois, on parlait avec respect d'un homme dont la droiture était insoupçonnable. J'ai le bonheur de saluer à mon tour la personne droite et l'oeuvre intègre de GEORGE ORWELL. Même si c'est lui qui a perdu la guerre morale, et que la saloperie a gagné. Il faut être héroïque pour se tenir droit, quand c'est le monde qui est tordu.
Que dire de Salvador Dali ? Que dire des goûts de François Pinault ? De Bernard Arnault ? De tous ces milliardaires qui couvrent d’or des Jeff Koons et des Damien Hirst ? Que dire, sinon que tout ça est OBSCÈNE et LAID, VULGAIRE et SALE ?
Vous êtes très moches, messieurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, littérature, arts, peinture, salvador dali, george orwell, acrt pictural, peintre, morale, 1984, peter pan, jm barrie, arthur rackham, contes enfants, wilhelm busch, max und moritz, pastiche, marcel duchamp, andy warhol
mercredi, 19 juin 2013
ORWELL N'AIME PAS DALI

PÂTISSIER, PAR AUGUST SANDER
***
George Orwell donc. Et pas dans le maître-livre qui l’a propulsé au rang de superstar de la science-fiction. Je trouve personnellement que 1984, un chef d’œuvre, évidemment, est plus alambiqué, plus complexe et plus allégorique que La Ferme des animaux.
Nous sommes d'accord : 1984 va incomparablement plus loin et plus profond, et son propos ne se limite pas finalement au stalinisme qu'il dénonçait explicitement (l'expression « Big Brother » comme pastiche de  « Petit père des peuples »). Et puis de toute façon, j’ai envie de parler d’un autre aspect de l'activité de l'auteur, plus proche du journaliste qu’il fut. George Orwell a écrit des centaines de textes de natures très diverses. Ivréa et L’Encyclopédie des nuisances ont publié une partie non négligeable de ceux-ci, sous le titre Essais, articles, lettres. Une édition chronologique.
« Petit père des peuples »). Et puis de toute façon, j’ai envie de parler d’un autre aspect de l'activité de l'auteur, plus proche du journaliste qu’il fut. George Orwell a écrit des centaines de textes de natures très diverses. Ivréa et L’Encyclopédie des nuisances ont publié une partie non négligeable de ceux-ci, sous le titre Essais, articles, lettres. Une édition chronologique.
Quatre forts volumes. Environ 2000 pages. Je regarde ça, et je me reprends à espérer – oh non, pas dans l’humanité, rassurez-vous, simplement dans le courage et la ténacité d’éditeurs qu’on peut dire, pour le coup, indépendants. Je veux dire : libres. Et pour être en mesure de se dire libre, il faut avoir assez de coffre pour sacrifier quelque chose de soi. C’est Michel Noir, ancien maire de Lyon, qui déclarait : « Il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme ». Une phrase qui a de la gueule, ne serait-ce que parce qu’elle est rare. Editeur peut être un beau métier, si l’on fait ce qu’il faut pour que ça le soit et le reste.
Alors évidemment, il n’est pas question de résumer ici 2000 pages, à moins que le résumé ne tienne sur 2000 pages. Non, je voudrais juste donner une idée de ce qu’on peut y trouver, en évoquant tel ou tel sujet que George Orwell a abordé à l’occasion. Tiens, pourquoi pas L’immunité artistique : quelques notes sur Salvador Dali, qui date de 1944 ?
J’aime bien quand quelqu’un de l'envergure aquiline de George Orwell, planant dans les hautes couches de l'atmosphère, repère soudain au ras du sol un charogne à sa mesure et plonge de tout son bec et de toutes ses griffes sur ce vil escroc qui a réussi à faire croire qu’il révolutionnait la peinture. Je passe sur « Avida Dollars » (anagramme de S. D.) dont André Breton l’a habillé pour l’hiver. Reconnaissons-lui une vraie créativité si vous voulez, mais seulement jusqu’en 1935, dans le cadre du groupe surréaliste.
Après, il a juste fait du pognon, du pognon et encore du pognon. J’exagère sans doute, mais pas tant que ça. Le soin qu’il apportait à la mise en scène de soi-même (il se déclarait lui-même narcissique) me le rend tout à fait antipathique. C’est ce qui parvient peut-être à gâter la perception que je peux en avoir, même si, quoi qu’il en soit, il me semble qu’il a fait naufrage dans l’incongru et le tape-à-l’œil, dont il a fait commerce, en produisant à tire-larigot des images pieuses d'un nouveau genre, quasiment sulpiciennes à force d'être parfaitement léchées.
Orwell aborde Dali d’un point de vue un peu voisin, puisqu’il le regarde sous un angle moral, comme le laisse entendre le titre ci-dessus (qui n’est pas la traduction de l’original). Il relève son goût marqué pour « la perversité sexuelle et la nécrophilie », le « thème excrémentiel », note que Dali « se targue de ne pas être homosexuel », et conclut : « … mais à part cela, il semble détenir la plus belle panoplie de perversions dont on puisse rêver ». On ne saurait être plus net dans le reproche.
Enfin, quand je dis « reproche », tout cela est formulé (pour le moment) sans jugement : pour Orwell, qui se veut davantage objectif que moralisateur, les faits parlent d’eux-mêmes, et il n’a pas besoin d’en rajouter, même si la morale, ici, est le critère : « L’obscénité est un sujet dont il est très difficile de parler en toute sincérité. Les gens ont trop peur soit de paraître choqués, soit de paraître ne pas l’être, pour être en mesure de définir les rapports entre l’art et la morale ». Il écrit ça en 1944, et il meurt en 1949. Il n’a pas eu la chance d’admirer le gobelet d’urine de Ben (1962), la scène de pénétration de la Cicciolina par Jeff Koons (1992) ni la machine à merde de Wim Delvoye (2000).
En fait, le commentaire d’Orwell est suscité par la parution de l’ « autobiographie » (on ne sait pas trop) de Dali The Secret Life of Salvador Dali. L’artiste s’y vante de certaines dépravations, de certains actes sadiques et autres turpitudes. Je dirai qu’il « en remet ». Et le commentaire d’Orwell montre que, s’il avait été médecin, il aurait été célèbre pour la qualité de son diagnostic : il met le doigt là où ça fait mal. Il sait que les saloperies révélées par Dali dans le bouquin peuvent tout aussi bien être réelles que fictives. Ce qui porte un nom : complaisance dans le sordide.
Voici, in extenso, le paragraphe que je crois névralgique de l'étude d'Orwell : « Ce que revendiquent en fait les défenseurs de Dali, c’est une sorte d’immunité artistique. L’artiste doit être exempté des lois morales qui pèsent sur les gens ordinaires. Il suffit de prononcer le mot magique d’ « art », et tout est permis. Des cadavres en décomposition avec des escargots qui rampent dessus, c’est normal ; donner des coups de pied dans la tête des petites filles, c’est normal ; même un film comme L’Âge d’or [où l’on voit une femme en train de chier, selon Henry Miller] est normal. Il est également normal que Dali s’en mette plein les poches pendant des années en France, puis détale comme un rat aussitôt que la France est en danger. Dès lors que vous peignez assez bien pour être consacré artiste, tout vous sera pardonné ». Ce paragraphe, est-il utile de le préciser, me réjouit au plus haut point. Au passage, les lecteurs un peu assidus de ce blog auront goûté à sa juste valeur la répétition du mot « normal ».
Il dit encore quelques petites choses intéressantes : « Il est aussi antisocial qu'une puce. Il est clair que de tels individus sont indésirables, et qu'une société qui favorise leur existence a quelque chose de détraqué ». Et même des choses assez drôles : « Si vous dites que Dali, tout en étant un brillant dessinateur, est une sale petite fripouille, on vous regarde comme si vous étiez un sauvage. Si vous dites que vous n'aimez pas les cadavres en putréfaction, et que les gens qui aiment les cadavres en putréfaction sont des malades mentaux, on en déduit que vous manquez de sens esthétique ».
Sans se gargariser de formules brillantes, c'est avec sobriété qu'Orwell assène les coups de son bon sens sur la tête du reptile.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, littérature, george orwell, 1984, arts, peinture, salvador dali, la ferme des animaux, animal farm, ben, jeff koons, wim delvoye, cicciolina, andré breton, surréalisme, avida dollars, éditions ivréa, encyclodédie des nuisances
mardi, 18 juin 2013
ORWELL N'AIME PAS DALI

COUPLE DE PAYSANS (BAUERNPAAR), PAR AUGUST SANDER
***
Je ne sais pas si on lit encore beaucoup 1984 de George Orwell. Il paraît que les ventes aux Etats-Unis ont été multipliées pas 6 depuis les révélations dans The Guardian (journal anglais) sur les activités de la NSA dans le pays, orientées vers l’écoute indifférenciée de toutes les communications des citoyens. L’émoi des dits citoyens est à la hauteur de l’enjeu.
Rendez-vous compte. Le système d’écoute baptisé « Echelon », révélé au grand jour il y a une dizaine d’années, avait déjà fait sensation, alors qu’il se réduisait (si l'on peut dire) à surveiller, sur les réseaux de communication, un certain nombre de mots-clés qui, une fois situés et correctement décryptés, étaient censés procurer à l’hyperpuissance un niveau de sécurité jamais atteint auparavant, en désignant aux spécialistes les individus dangereux. C’était encore sélectif, voire artisanal. Juste un vernis de démocratie, mais bon.
La puissance informatique est devenue telle aujourd’hui qu’ils peuvent se permettre de ne rien filtrer, de tout enregistrer. De façon indifférenciée. Pas de sélection, « ce que nous voulons : TOUT ». C’est drôle, c’était le titre d’une revue ou d’un mouvement en 1968. C’est devenu le nec plus ultra d’une des agences de renseignement les plus secrètes et les plus sophistiquées. Comme le chante Charles Trenet : « C’est la vie qui va toujours, Vive la vie, Vive l’amour ! Quand tout vit, c'est que tout va ! ». La couleur désuète de ces paroles a quelque chose d'attendrissant.
Donc admettons que George Orwell, c’est 1984. Big Brother ? Le télécran ? « Big Brother is watching you » ? De la gnognotte, parce qu’Orwell l’ayant écrit avant 1950, s’il pouvait imaginer l’irruption de la caméra et de la télévision dans l’espionnage de la vie privée des individus, comment aurait-il pu prévoir la carte à puce, le téléphone portable, la puce RFID, Google, Facebook, Twitter et autres joyeusetés. Qui vous « tracent », comme on dit depuis peu, pour ne pas dire qu'on vous « traque », mot qui traduit exactement l'idée, puisqu'un « tracker dog » n'est rien d'autre qu'un chien policier. La technique permettrait de reconstituer la trajectoire d'une fourmi dans la fourmilière. D'ici qu'on y voie un traquenard ...
Grâce à ces innovations si intéressantes, la technique a permis de livrer à des responsables politiques ou économiques les informations les plus précises et les plus pointues sur les comportements des gens, dans le but de leur faciliter le commerce et la gestion des masses. Quoi, me dit-on, si je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à craindre. Ah la belle âme. Ah le gros naïf, ravi de se faire espionner, sans doute parce qu'au moins, ça montre qu'on s'intéresse à lui. Ça lui donne le sentiment d'exister.
Et puis monsieur, j'ai au moins le droit de ne pas avoir envie d'être suivi, observé, espionné, décortiqué. Et si l'envie m'en vient, j'ai le droit de disparaître sans laisser la moindre trace. De la gnognotte, donc, que 1984, quand on voit les dernières avancées offertes aux instances de contrôle et de manipulation, mais quel magnifique sens de l’anticipation de la part de son auteur !
La novlangue ? Une autre anticipation géniale de George Orwell, au point qu’on peut dire que tous ceux qui fabriquent à tour de bras de la reformulation et de l’ « élément de langage » (tout ce que politiciens et marchands mâchonnent devant les micros et sur les affiches) ont à peu près piqué la méthode estampillée "Big Brother" pour repeindre la réalité dans la couleur du jour voulue par celui-ci.
On nage en effet depuis des lustres dans la novlangue, sans s’en formaliser, au point que le mot « euphémisme » est admis sans discernement ni discussion, comme un article de la loi fondamentale. Il est interdit d'utiliser les mots qui tranchent, ceux qui correspondent directement à la chose qu'ils désignent. Le détour par la périphrase adoucissante et menteuse, ou par l'euphémisme sucré qui fait passer l'amertume de la pilule sont désormais obligatoires. Euphémisme et périphrase règnent en maîtres absolus : « crise » mis pour « festin des grands carnassiers », « plan de retour à l’emploi » pour « licenciements massifs », et le reste à l’avenant.
L’expression américaine colonisatrice – « politiquement correct » – est devenue l’objet de gags ironiques au 128ème degré, où plus personne n’est en mesure de détecter l’intention première de celui qui parle (sincère ou duplice ?). Ce faisant, on oublie que la « political correctness » fut conçue au départ, aux USA, pour permettre aux « minorités » victimes de « discriminations », « stigmatisations », etc. (nains, noirs, homosexuels, femmes, etc.) de se venger de leurs « tortionnaires » à coups de rafales de procès aux retombées parfois tout à fait lucratives.
Dans la novlangue d’aujourd’hui, plus personne n’a les compétences pour affirmer qu’un mot veut dire ce qu’il dit, ou le contraire de ce qu’il dit, ou même le contraire du contraire de ce qu’il dit, qui n’est pas forcément réductible à son sens premier. J’espère que vous suivez.
Les pessimistes parleront de perversion toujours plus infernale des  mots de la langue, les indécrottables optimistes se réjouiront des progrès et de l’évolution. Pour mon compte, je suis d’avis de laisser les optimistes continuer à se laisser couvrir de crotte par l’anus du monde comme il va, de la même façon que Numérobis est couvert d’or à la fin d’Astérix et Cléopâtre, mais je ne vais pas refaire le coup de l’argent matière fécale, je ne m’appelle pas Sigmund F.
mots de la langue, les indécrottables optimistes se réjouiront des progrès et de l’évolution. Pour mon compte, je suis d’avis de laisser les optimistes continuer à se laisser couvrir de crotte par l’anus du monde comme il va, de la même façon que Numérobis est couvert d’or à la fin d’Astérix et Cléopâtre, mais je ne vais pas refaire le coup de l’argent matière fécale, je ne m’appelle pas Sigmund F.
Moralité : on peut considérer le 1984 de George Orwell comme un schéma approximatif mais juste, quoiqu'incomplet, de l'avenir radieux offert à la liberté humaine par l'innovation technique. Je n'ai pas dit "progrès" technique, car il est désormais clair que la voie royale de l'innovation permanente diverge de plus en plus nettement de ce qu'il serait légitime de considérer comme le "progrès".
Selon moi, il serait même salutaire de bannir définitivement de notre lexique l'expression « Progrès Technique ». Du point de vue de la liberté humaine, si celle-ci a encore un sens, je propose même de parler désormais de « Régrès Humain ». Certains économistes parlent bien de « décroissance », alors hein !
Je propose de regarder la courbe ascendante de l'innovation technique (par exemple, Motorola vient de mettre au point une pilule-puce qui, aussitôt dans l'estomac, prendrait les commandes de toute l'électronique domestique) à la lumière de la courbe de l'évolution humaine : je suis prêt à parier qu'elle lui est inversement proportionnelle, et que plus la technique innove, plus l'humanité régresse.
On va me dire que j'exagère d'abuser, mais si l'on met bout à bout toutes les innovations, on voit se dessiner, maille après maille, le filet technique, invisible et parfait, dans lequel certains projettent d'enfermer les humains, sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est comme dans Loft Story : on s'est habitués aux micros et aux caméras, jusqu'à oublier leur existence.
C'est ça, le Régrès : permettre à la police et aux marchands de retrouver instantanément n'importe quelle fourmi humaine grâce aux traces électroniques dont elle balise chacune de ses activités, à l'exception du jardinage. Enfoncé, le Petit Poucet. Chacun de nous est devenu un « Enorme Poucet » : même plus besoin de chien policier. Pauvres parents, qui ne peuvent même plus aller perdre leurs enfants dans la forêt !
Si les gens se mettent à dire un de ces jours : « On n'arrête pas le Régrès », ce sera grâce à moi, vous vous rendez compte ? Mais George Orwell avait vu ça bien avant moi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, allemagne, george orwell, littérature, nsa, 1984, espionnage, mai 68, big brother, puce rfid, google, facebook, twitter, novlangue, éléments de langage, euphémisme
lundi, 17 juin 2013
LE CAS MERIC

FONCTIONNAIRE NAZI. CHEF DU SERVICE CULTUREL DE COLOGNE EN 1938, PAR AUGUST SANDER
***
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse de « JNR » ou d’« antifa », ce sont sûrement tous des enfants de chœur prêts à servir la messe, agenouillés en aube blanche en agitant leurs grelots, des angelots inoffensifs et peut-être asexués, dévoués et prêts à aider les vieilles dames à traverser les rues. C’est pour ça qu’ils fréquentent les clubs de muscu et d’arts martiaux, certaines vieilles dames ayant de l'embonpoint.
Malheureusement pour Clément Méric, il avait à peine commencé l’entraînement et n’avait pas atteint la taille (il ne « faisait pas la maille ») et la carrure réglementaires pour les circonstances auxquelles il s’est trouvé mêlé. Il ne méritait pas de mourir, c’est sûr, mais il a eu le tort d’être là. Et Esteban Morillo a vraiment frappé très fort. Il était apparemment très bien entraîné. Et il faisait la maille, lui.
Quant aux journaux, au milieu desquels Libération s’est spécialement distingué, ils se sont de nouveau illustrés dans l’interprétation des faits. On a eu droit à un festival de « sursauts démocratiques ». Un des aspects tout à fait comiques de leur « couverture » de l’événement (on parle de « couverture » sans doute pour garder l’événement bien chaud) a été un drôle de « constat », fait selon une drôle de grille de lecture. Que n’a-t-on entendu ?
Ils nous avaient déjà fait le coup, au moment du mariage homosexuel (vous avez remarqué que je me refuse à appeler autrement ce que tout le monde désigne au moyen d'une généralité euphémisante) et des manifs de Frigide Barjot et consort. Ils parlaient de la « libération de la parole homophobe ». J’avais déjà cru rêver en découvrant que des recoins secrets de la société française recelaient, tapis dans les tréfonds d’antres obscurs, un potentiel dormant de « parole homophobe », qui n’attendait qu’un signal, une étincelle pour se réveiller. Pour se libérer.
Les « manifs pour tous » et divers débats parlementaires auraient ainsi suffi pour allumer un mèche qui n'attendait que de faire exploser « la parole homophobe » qui, trop longtemps contenue (par on ne sait quelle magie), n'attendait que cette occasion pour se manifester à l'air libre. A moins que « la parole homophobe » n'ait attendu, comme un fauve hypocrite, que le moment tant attendu de sauter enfin sur sa proie pour enfin la dévorer !
Quelle que soit l'hypothèse, j'avoue que je reste épastrouillé et confondu devant l'IDEE géniale. Qui ne repose en fait que sur la capacité pour l'un des deux adversaires de se donner à lui-même le rôle enviable de la VICTIME, et à l'autre le rôle satanisé du MECHANT. En l'occurrence, la victime est homosexuelle et le méchant (tous ceux qui s'opposent au mariage homo) est homophobe.
Celui qui a fabriqué, avec les petites mains des boyaux de sa tête, l'expression « libération de la parole homophobe » mérite d'être considéré comme un maître dans l'art de la com. Digne de Stéphane Fouks, Euro RSCG et Jacques Séguéla réunis. Une prouesse dans l'art de fermer la gueule à toute contestation et récrimination, en faisant porter le chapeau du coupable aux soi-disant et a priori homophobes. A mon avis, ça vaut la trouvaille de la "fracture sociale", si favorable en son temps à Nicolas Chirac. Ou celle de "travailler plus pour gagner plus", qui avait bénéficié à Jacques Sarkozy.
Nous n'aurons garde d'oublier cependant "la force tranquille", la "génération Mitterrand" ou "Yes we can". Comme quoi l'exercice de la démocratie est devenu une simple bataille de publicitaires. Mais je ne comprends toujours pas comment l'extrêmement ringard "le changement c'est maintenant" a pu faire élire François Hollande. J'attends qu'on m'explique pourquoi, sur cette base dérisoire (et dont tout le monde savait ce qu'elle valait), un tout petit peu plus de la moitié des votants se sont déclarés en sa faveur.
Moi je sais bien qu'il n'y a pas eu de « libération », mais que s'il y eut effectivement « parole homophobe », elle a été sciemment, méticuleusement calculée, provoquée par François Hollande, qui a mis cette loi au programme, et par tous ceux qui l’ont soutenu, voire qui l’ont poussé à l’imposer, de force et sans vrai débat : « Qui sème le vent … » (proverbe connu). Jouer le rôle enviable de la « victime », de nos jours, est devenu un rôle si gratifiant. Et si je dis "enviable", c'est que ce genre de victime sait qu'il a tous les droits. Parlons si vous voulez de « victime triomphante », ou de « colonisateur victimaire ». Passons.
Et voilà-t-il pas qu'avec le cas Méric, ils remettent le couvert, et cette fois ils parlent de « libération de la parole d’extrême-droite » et autre « pensée fasciste », qui auraient été couvées par les « manifs pour tous ». Et allez donc ! Qu'on se le dise : la parole d'extrême-droite était en prison. Frigide Barjot l'a libérée en manifestant contre l'hypothèse qu'on puisse marier du masculin avec du masculin, du féminin avec du féminin.
Je note au passage que c'est une libération dont les sans-culotte de l'égalité ne veulent à aucun prix : la liberté est une bien belle chose aux yeux des adeptes du « mariage pour tous », mais faudrait voir à pas exagérer ! Certains étaient déjà plus égaux que d'autres. Voici le temps des gens plus libres que les autres (puisqu'ils décident de la liberté de ces autres).
Quand je pense que je dénigrais Nicolas Sarkozy au motif qu’il coupait violemment la France en deux et qu’il provoquait sciemment la fracture entre les deux camps. C’était d’ailleurs vrai, personne ne peut dire le contraire, puisque Sarko se vantait précisément d’être très « clivant ».
Mais on n’avait pas vu à l’œuvre le chef de bureau qui nous gouverne, avec sa suavité digne, son sens lubrifié de la componction et son élocution ravie d’ancien bègue. En matière de clivage, le « capitaine de pédalo » en connaît un rayon, et « Flanby » a parfaitement fait la preuve que, pour ce qui est de monter une France contre l’autre, front à front, il ne « pédale pas dans le yaourt », même avec le grade de capitaine.
Pour provoquer la haine des uns pour les autres et retour, François Hollande ne me semble pas malhabile (la litote n'est pas l'euphémisme : elle vise à faire entendre le plus en exprimant le moins). Au moins, François Mitterrand portait sur son machiavélisme le visage de la vérité, même s'il a fait des dizaines de millions de dupes en 1981. Le problème, avec François Hollande, il a tellement mal l'air sincère, que tout le monde est persuadé qu'il est vraiment très bête.
Je donne gratuitement ces formules assez brillantes à l'équipe de communicants qui entoure notre lambeau de président. Les deux phrases ne sont pas trop mal écrites, je le reconnais bien volontiers.
D’une certaine manière, Hollande surpasse Sarkozy dans l’art de diviser les Français, en usant du même stratagème qu’un certain François Mitterrand qui, par pur calcul politicien, pour affaiblir et diviser la droite, envoya en son temps dans son jeu de quilles un chien nommé Jean-Marie Le Pen.
Mais on a peut-être grand tort de donner une aura politique à la mort de Clément Méric. Après tout, s’il n’y avait pas tant de renards gauchistes (???) glapissant au retour des hurlements des loups fascistes (???), la tragique bagarre devant un magasin de vêtements à la mode ne serait pas sortie de la rubrique « faits divers ». Franchement, quelle différence entre les violences réciproques des bandes voisines d’Aubervilliers et de La Courneuve et la confrontation entre les « antifa » et les « JNR », vu le niveau d’éducation politique en vigueur dans ces deux groupuscules ?
Et je signale à tous les journalistes qui ont crié à la menace fasciste que, dans leur précipitation, ils ont oublié de rappeler les saccages récents commis par les supporters du PSG au Trocadéro pour fêter dignement le titre de champion de France conquis par le club parisien. Au grand dam du financeur qatari. Ben oui : c’était des « anars » ou des « fachos » ? Chi lo sa ?
De toute façon, et je l'ai déjà dit, si le Parti « Socialiste » a conquis bien des terrains réservés autrefois à la droite, c'est parce qu'il a compris que la population française n'en veut plus, de la Révolution, et que ce qu'elle veut a plus à voir avec un rêve de petits-bourgeois qu'avec l'exaltation lyrique et unanimiste des masses ouvrières : elle est en masse passée à droite pour tout ce qui touche le logement, la voiture, le travail, même s'il flotte encore des effluves largement fictifs et illusoires d'une gauche des moeurs et d'un progressisme sociétal (vote des étrangers, mariage homo, ...).
Demandez à l'ouvrier chinois, en passe de s'enrichir, s'il n'en rêve pas, de sa voiture. Ensuite, parlez-lui donc un peu de la "conscience de classe". Et puis tiens, demandez-lui donc, à l'ouvrier chinois, ce qu'il penserait de ses dirigeants, s'ils voulaient imposer le vote des étrangers ou le mariage des homosexuels. Ah mais voilà, j'oubliais, là-bas, « ils ne sont pas en démocratie ». Ils sont fous, ces Chinois ! En plus, ils ont des principes ! Ils ont des valeurs ! C'est vraiment une dictature.
Pour conclure (il faut bien), il faut savoir ce qu'on veut : si tout le monde pousse à droite, il est mécanique et normal que la droite vraiment de droite s'extrémise, et produise ses petites mains qui n'ont pas froid aux yeux, des mains qui savent, à l'occasion, ne pas se croiser les bras, façon « SturmAbteilungen » (que Hitler, très tôt, en 1934, a "purgées" de Röhm et de quelques comparses lors de la "Nuit des longs couteaux", avis transmis à Serge Ayoub). Quant aux antifascistes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner davantage de consistance et de visibilité à l'épouvantail qu'ils disent combattre, pour légitimer leurs propres hantises.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : clément méric, facho, fascisme, anarchisme, esteban morillo, jnr, antifa, nazi, photographie, august sander, journal libération, mariage pour tous, frigide barjot, manif pour tous, homophobe, jacques chirac, nicolas sarkozy, françois hollande, publicité, propagande, génération mitterrand, fracture sociale, fait divers, presse, journaux, révolution, hitler, serge ayoub
dimanche, 16 juin 2013
LE CAS MERIC

MEMBRE DE "LEIBSTANDARTE ADOLF HITLER", PAR AUGUST SANDER
("Leibstandarte" veut dire "garde du corps", c'était une division SS)
***
Alors bon, Clément Méric, les médias nous ont tellement tabassé le crâne et piétiné les burettes avec cette histoire, depuis le 5 juin, qu’il faut bien en extraire quelque chose qui ait un peu de sens. Et puis il ne saurait être dit que je n’en aie rien dit, quand même. On a sa dignité. Alors quoi ?
D’abord une remarque amusée : « Fred Perry » (le « Lacoste » britannique, paraît-il) est une marque de vêtements qui sert de signe de reconnaissance et de ralliement à des groupes que les journalistes prudents regroupent sous l’appellation sablonneuse de « mouvance d’extrême-droite », le sablonneux étant la qualité inhérente à la mouvance.
Malheureusement, la même marque sert de signe de reconnaissance et de ralliement à des groupes appartenant cette fois à la sablonneuse « mouvance d’extrême-gauche », parfois baptisée « anarcho-autonome » et autres joyeusetés lexicales. On voit que ça devient très vite très sablonneux et très mouvant.
Premier étonnement du néophyte que je suis : la condition première de l’appartenance à ces « mouvances » est la tenue : il s'agit de s'habiller "dernier cri", en s'adressant aux marques les plus en vogue. Deuxième étonnement : qu’on soit « anar » ou « facho », la tenue est la même. Plus fort encore : la marque est la même. Il paraîtrait que des codes couleur permettent de s'y retrouver. Vous peut-être, mais moi ...
Bizarres, bizarres, toutes ces « fashion victims », vous ne trouvez pas ? De facho à fashion, en quelque sorte. A l’esprit de quelle personne normale viendrait l’improbable idée de porter sur elle ses opinions politiques, reconnaissables à la marque, à la forme, à la couleur de ses vêtements ? Quel plaisir peut-il bien y avoir à se transformer en étendard de soi-même ? Et j’imagine très bien que ces gens, tous très persuadés que leurs idées sont les meilleures, se mettent tout d’un coup, quand ils sont entre eux, une fois autour de la table, à « parler chiffon » : la température de lavage, l'adoucisseur, le repassage.
Les journaux ont offert un historique détaillé de cette préoccupation vestimentaire et primordiale, remontant jusqu’aux affrontements londoniens entre « mods » et « rockers ». Ma foi, je veux bien, parce que j’y apprends l’importance de la musique dans les « cultures » (!!!) respectives des adversaires, radicalement différentes, paraît-il, selon le clan auquel on appartient. Vu du dehors, la différence ne saute pas aux yeux (Bérurier noir chez les anars contre je ne sais plus que (heavy) métal chez les fachos), et vraiment pas, mais le principal, n'est-ce pas, est que les intéressés s’y retrouvent.
Petite parenthèse « culturelle » : l’interview de cette journaliste grecque par une chaîne de radio a réjoui mon âme à travers quelques remarques bien senties. Au sujet des députés « fascistes » envoyés au Parlement grec aux dernières élections, elle parle de « niveau intellectuel de camionneur », ce qui n’est pas très gentil pour la profession (revoir le sketch de Jean Yanne et Paul Mercey), mais elle sait peut-être de quoi il retourne.
Elle éprouve la même tendresse pour les Français (anars comme fachos), totalement ignares en histoire, en politique, en économie et quelques autres domaines indispensables à qui prétend conduire une réflexion politique. Selon elle, leur intelligence a à peu près la hauteur de la pâquerette officinale. Plafond bas, front bas. Masse de manoeuvre à la rigueur, main d'oeuvre occasionnelle sans doute. Mais action politique ? Que nenni !
Les faits, maintenant. Vous voulez vraiment que je vous dise ? Je ne peux certes que déplorer la mort de Clément Méric, mais à la place de ses parents, professeurs de droit dans une université bretonne, je n’aurais à l’esprit et à la bouche que cette question de Géronte à Scapin dans la pièce qui met en scène les « fourberies » de ce dernier : « Que diable allait-il faire dans cette galère ? ». Vu son âge, peut-être ce qu’il a fait en adhérant aux « antifa » s’apparente-t-il à ce qu’on appelait, dans les autrefois, « jeter sa gourme », dans la série « ma première biture », « ma première pute », « ma première vérole » ? Allez savoir.
Quelle idée, aussi, d’aller se fourrer dans les pattes d’un groupe intitulé « antifa » ? Dialogue : « Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? – Antifa. – Ah, antifa, c’est intéressant, et ça rapporte ? – Des gnons. – Il n’y a pas de sot métier. A voir votre visage convenablement tuméfié, c'est un métier seyant et bien porté ».
Le problème, quand on se déclare « antifasciste », c’est qu’on a besoin du « fasciste » pour exister, autant que les Capulet ont besoin des Montaigu (et inversement) dans Roméo et Juliette, et que les Sharks ont besoin des Jets (et inversement) dans West Side story. L'un engendre l'autre, et vice-versa, comme le pôle positif de l'aimant a besoin du pôle négatif. Ils ne seraient rien si l'autre n'existait pas.
J'imagine que c'est l'existence de groupes tels que 3ème Voie, JNR et autres Bloc identitaire qui a suscité la création d'Antifa, mais franchement, est-ce que quiconque de sensé peut se définir "anti" ? Qu'est-ce donc que ce programme, dont la seule raison d'exister est de lutter contre ? Si c'est tout ce qu'ils ont à proposer, c'est donc qu'ils souffrent juste d'une démangeaison, peut-être d'une allergie. Ils devraient aller se faire gratter. Une réaction allergique, certainement pas une action politique (je me répète).
Quant aux « fascistes », j’avoue que ma documentation personnelle est trop pauvre pour en dire quoi que ce soit de sensé. Il m’est plus souvent arrivé de croiser la route de leurs adversaires antifa, sans doute parce que leur IBM (Indice de Bruit Médiatique) est plus élevé, pour cause de propagande mieux relayée, sous des noms divers (anarcho-autonomes et autres petites bières) dans les radios et télévisions, même si Serge Ayoub a réussi à projeter en peu de temps son groupe sur le devant de la scène, et de façon spectaculaire. C’est vrai que le logo adopté pour décorer son bar associatif laisse deviner quelles curieuses références historiques ont ses préférences.

DES AMOUREUX DE LA NATION FRANÇAISE, VRAIMENT ? LAISSEZ-MOI RIRE ! S'ILS N'ETAIENT PAS DES DEMI-PORTIONS DE NAZIS EN MIE DE PAIN, ILS L'AURAIENT GAMMÉE EN ENTIER, LEUR CROIX ! LÀ, ILS SONT OBLIGÉS DE RECOURIR A DES SUBTERFUGES POUR LA DISSIMULER, LEUR CROIX GAMMEE. ILS BIAISENT, QUOI, SANS DOUTE POUR FAIRE CROIRE QU'ILS SONT RUSÉS.
MÊME PAS CAP' D'ÊTRE DES PATRIOTES, DES VRAIS ! PENDANT LA GUERRE, ILS SE SERAIENT ENGAGÉS DANS LA LVF, LA CHARMANTE ET MOINS PETAINISTE QUE NAZI LEGION DES VOLONTAIRES FRANÇAIS CONTRE LE BOLCHEVISME. DES COSMOPOLITES, QUOI.
***
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, adolf hitler, ss, nazi, clément méric, esteban morillo, fred perry, lacoste, droite, extrême-droite, fascisme, extrême-gauche, anar, anarchistes, facho, fashion victim, mods rockers, les fourberies de scapin, molière, que diable allait-il faire dans cette galère ?, antifa, jnr, serge ayoub, roméo et juliette, west side story, capulet montaigu
samedi, 15 juin 2013
OBELIX ET LE PREJUGE NORMAL
CECI EST UN POST-SCRIPTUM NORMAL.

IL FAUT CONDAMNER OBELIX
Oui, il faut condamner Obélix. Rendez-vous compte : il est intolérant, il est xénophobe, il véhicule des stéréotypes. Il est sûrement homophobe, a force d'être normal. Aujourd'hui, il serait aussi islamophobe, ça fait bien dans le paysage des "phobies" de la modernité. Ben oui, Hergé était raciste, c'est bien connu, voyez Tintin au Congo.

Le Congolais qui voulait faire judiciairement la peau à l'album africain de Tintin avait bien raison d'attaquer. On ne sait jamais, ça aurait pu lui rapporter gros. Les Juifs ont bien fait condamner la SNCF (soixante ans après !) en tant que responsable de convois de déportés. N'ont-ils pas droit, les Noirs, à leur tour, à quelque dividende substantiel ? Faut pas se gêner : la République déclarée coupable est tellement généreuse avec Bernard Tapie que tous les espoirs sont permis à ceux qui veulent empocher des dommages-intérêts, justifiés ou farcesques.

Avant de poursuivre, je précise que, selon moi, la série des Astérix a décliné de plus en plus vite après la mort de Goscinny en 1977, et la reprise par le seul Uderzo a fait atterrir nos Gaulois dans un marécage toujours plus niais. Je ne suis peut-être pas seul dans mon cas à constater cette niaiserie. Je crois bien que Le Combat des chefs est le dernier épisode sur lequel a travaillé le tellement fertile Goscinny (Dingodossiers, Le Petit Nicolas, Oumpah Pah, Lucky Luke, etc.).

Si Goscinny et Uderzo s’étaient mis dans l’idée de mettre en scène la campagne puis le vote de la loi sur le mariage homosexuel, Obélix aurait sans doute été traité d’homophobe. Car il l'aurait sûrement prononcée, sa phrase fatidique : « Ils sont fous, ces ...» (je préfère m'autocensurer, on ne sait jamais).

Et je n’ai pas trouvé mieux que notre tailleur de menhirs pour synthétiser le message porté par la majorité silencieuse dans une formule choc, désormais célébrissime, y compris hors du petit monde des amateurs de Bande Dessinée.

Une petite phrase toute bête, qui commence obligatoirement par trois  petits mots, toujours les mêmes : « ILS SONT FOUS », obligatoirement suivie de la catégorie désignée à la vindicte populaire par l’épouvantable esprit de clocher qu’on peut voir répandu dans l’énorme panse de Français moyen du héros moustachu, parfois désigné comme « gros monstrueux » (Le Tour de Gaule), comme on sait : « … tombé dans la marmite de potion magique étant petit ». Il faut imaginer Obélix en béret et charentaises, la baguette sous le bras. Bon sang, mais c'est bien sûr : c'est Superdupont !
petits mots, toujours les mêmes : « ILS SONT FOUS », obligatoirement suivie de la catégorie désignée à la vindicte populaire par l’épouvantable esprit de clocher qu’on peut voir répandu dans l’énorme panse de Français moyen du héros moustachu, parfois désigné comme « gros monstrueux » (Le Tour de Gaule), comme on sait : « … tombé dans la marmite de potion magique étant petit ». Il faut imaginer Obélix en béret et charentaises, la baguette sous le bras. Bon sang, mais c'est bien sûr : c'est Superdupont !

La phrase fatidique que prononce rituellement le « gros monstrueux » s'accompagne d'un geste fatidique : l'index frappe la tempe, désignant l'état supposé lamentable de la substance grise logée derrière la paroi osseuse. De l'ordre, pour le moins, de la diarrhée cérébrale. Obélix est NORMAL. Guy Béart aurait-il pour autant chanté : « Obélix a dit la vérité, il faut donc l'exécuter » ?
J'espère que non.
Voilà ce que je dis, moi.
POST-POST-SCRIPTUM : J'aime beaucoup, dans certaines bandes dessinées, quand l'auteur glisse un minuscule détail que seule une lecture attentive permet de relever. Ainsi, dans Astérix aux Jeux Olympiques, voit-on page 29 deux fonctionnaires du "Bureau des inscriptions", dont l'un se réjouit de la décadence de Rome. Le petit détail se situe à l'arrière-plan, et consiste en un bas-relief montrant deux personnages en toge, la main posée sur la tête d'un taureau agenouillé.
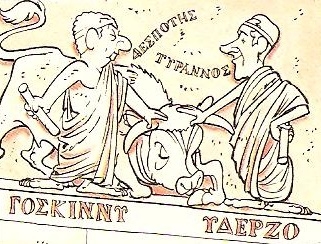
Les profils des deux compères, sont certes caricaturés, mais aisément reconnaissables et proches des originaux : Goscinny et Uderzo en personne. Le nom de chacun figure en "légende" du bas-relief, et des lettres grecques en phylactères sortent de leur bouche. Les noms sont ceux, évidemment, de Goscinny (ΓΟΣΚΙΝΝΥ) et Uderzo (ΥΔΕΡΖΟ).
Pour corser le tout, Goscinny dit, s’adressant à Uderzo : « Despote ! » (ΔΕΣΠΟΤΗΣ), tandis que celui-ci lui lance : « Tyran ! » (ΤΥΡΑΝΝΟΣ). Bon, c'est vrai que les deux mots grecs veulent d'abord dire « maître », et seulement ensuite « maître absolu », avec éventuellement le sens que nous leur avons donné, mais on ne va pas chipoter, hein !
Ce sont des petits plaisirs de gourmet qu'on a plaisir à partager : servez-vous, si par hasard vous n'étiez pas déjà avertis.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, astérix, obélix, ils sont fous ces romains, goscinny, uderzo, tintin au congo, hergé, bernard tapie, auschwitz, le combat des chefs, le petit nicolas, dingodossiers, français moyen, le tour de gaule d'astérix, superdupont, gotlib, guy béart, astérix aux jeux olympiques
vendredi, 14 juin 2013
LE TERRITOIRE DES NORMAUX

COUPLE DE FIANCÉS PAYSANS, PAR AUGUST SANDER
(BAUERLISCHES BRAUTPAAR)
***
Les gens normaux (sans guillemets) constituent donc l'immense majorité de la population : statistiquement, ils sont ceux qui se servent dans la grande marmite commune des traditions, coutumes, règles majoritaires. Dans ce qui bout dans la marmite, il y en a cependant pour tous les goûts. C'est une marmite à la fois homogène et diversifiée, qui évite tout autant le menu unique dans des cantines aussi uniformisées que des casernes, que la segmentation de la carte de restaurant en une infinité de compartiments étanches. C'est une table commune, certes, mais où l'on peut s'installer librement.
Il va quand même falloir mettre un point final à cette série sur les normaux et les anormaux, sinon, je vais bientôt être en mesure de soutenir une thèse en Sorbonne. Je me vois déjà, en grande toge solennelle, avec mon mortier [« C’est même pas un mortier, eh ! »] sur la tête, m’entendre instituer : « Dignus est intrare », au son des trompes majestueuses et escorté par une double haie de jeunes femmes peu vêtues, ondulant et se déhanchant, jusqu’à l’effigie statufiée et sacrée du Savoir pour m’y incliner en signe de stricte et dévote allégeance.
C’est curieux, comme les choses se passent : ça a démarré tout plan-plan, et puis ça a continué, comme si j’avais tiré un fil, et que ça n’en finit plus de venir. « Tant que je gagne, je joue ! », clamait le Belge de Coluche, devant le distributeur de boissons. Ma grand-mère raisonnait autrement : « Il faut finir, sinon ça va rester ». Nous ne nous doutons pas que le bon sens habite en général pas trop loin de chez nous. Le bons sens des gens normaux.
C’est vrai qu’à propos de « normal / anormal », le filon s’épuise, mais il reste des questions, et le point final de ma petite série ni ne clora la liste des questions, ni ne pacifiera les champs de bataille du débat. Par exemple, je me suis demandé si les anormaux étaient nuisibles. Si l’on pouvait trouver des bons anormaux à côté des mauvais. Si des anormaux pouvaient devenir célèbres, voire entrer dans l’Histoire. Si les anormaux étaient sur terre seulement pour faire chier les normaux. Que des questions urgentes et de portée vitale, comme on voit.
Alors sont-ils nuisibles ? Pas facile de répondre. Je ne sais plus bien où et quand j’ai lu ça, mais le gars, Bernard Vincent, défendait une thèse marrante à propos de la place des marginaux dans la société. En gros, il soutenait que ces « parias » lui étaient utiles en étant précisément des parias. C’est intéressant. Remplacez « marginaux » par « anormaux », et vous retombez dans la marmite où je touille une soupe analogue depuis trop de jours.
Je parlais hier de « poste frontière » avant la sortie du territoire de la norme. Avec les anormaux (je préfère ce terme à « hors-norme » qui lui est le plus souvent préféré, jugé plus « propre » (moins « stigmatisant » pour parler novlangue), alors qu’il signifie strictement la même chose), l’immense majorité de la population, qui vit en se référant à la « common decency » (Orwell), sait à peu près où elle en est : quand on est normal, l’anormal est celui à la place duquel on ne voudrait pas être (voir le titre judicieux de Romain Gary, Au-delà de cette Limite, votre ticket n’est plus valable).
Là se trouve la terre étrangère : en y abordant, on quitte le monde commun, le bien commun, la « common decency ». De ce monde commun, les anormaux dessinent, par leur seule existence et leur seule présence, le contour en négatif, chacun avec son style particulier : débile mental, alzheimer, phocomèle, homosexuel (ou trans), etc. Les anormaux (= ceux qui ne vivent pas selon la norme statistique) sont en quelque sorte des bornes : ils délimitent le territoire de l’immense majorité en montrant ce que ça donne quand on en sort.
Oui, je sais, je mets les homosexuels parmi les anormaux. Mais c'est pour rester fidèle à ma définition statistique de la norme : l'homosexualité caractérisée est-elle le fait d'une minorité ou pas ? Je réponds que, étant donné que oui, l'homosexualité concerne somme toute une partie infime de la population. Qui dit hors de l'écrasante majorité, dit en dehors de la norme. Les homosexuels, de ce point de vue, sont anormaux.
La campagne pour le mariage fera d'ailleurs figure de cas d'école pour les professeurs de techniques de propagande : comment donner à un groupuscule social un retentissement inversement proportionnel à son importance numérique ? On examinera comme un chef d'oeuvre en la matière la méthode employée pour en arriver au vote de la loi. L'énorme et écrasant matraquage médiatique auquel il a donné lieu servira de modèle, de parangon, de prototype, de daguerréotype, de stéréotype, et pour tout dire de totem, et tout propagandiste futur sera obligé de s'en inspirer.
Ensuite, que ça donne envie ou que ça fasse peur, rien de plus compréhensible. Certains ne peuvent pas faire autrement : l’écrivain François Augiéras (1925-1971, il n’est pas mort très vieux, Une Enfance au temps du Maréchal, Le Vieillard et l'enfant, L'Apprenti sorcier, Domme ou l'essai d'occupation, ...), par exemple, « ne renoncera jamais à une vie nomade et misérable, avant de s’éteindre dans un hospice » (M.P. Schmitt). Radicalement hétérogène, qu’il vive au Sahara, au Mont Athos ou dans les grottes de la cité de Domme, c’est certain, il ne peut pas s’amalgamer, c’est au-dessus de ses forces. En contrepartie, cela fait de lui « un écrivain hors du commun » (Olivier Houbert), « une personnalité hors du commun » (Philippe Berthier).

LA VIEILLE CITÉ DE DOMME
Hors du commun, voilà, et au sens propre. Pas comme d’autres qui paradent et multiplient les tours de piste dans l’uniforme du réfractaire, et qui se proclament rebelles, insoumis, contestataires et anticonformistes. Et qui ne manquent pas de passer le chapeau, après leur numéro, parmi le public émerveillé par les outrances de ces bateleurs avides de réussite et de confort et dont l'âme est, au fond, profondément bourgeoise, mais des bourgeois qui voudraient faire croire qu’ils sont en rupture de ban. Et qui finissent parfois, s’ils savent s’y prendre, plus riches qu’un patron du CAC 40 (une BD de Martin Veyron s’intitule Caca rente).
Les gens normaux aiment frôler l’anormal (= tester ce qui se passe de l'autre côté de la frontière) : ça fait des impressions. Ils vont au « Chat noir » se faire insulter par Aristide Bruant, qui a fini sa vie comme un rupin de la haute, dans son château de Courtenay, après avoir chanté sa vie durant, et en argot, les marlous, les filles du trottoir, les petits macs, les « joyeux » des bat. d’Af. (bataillons d’Afrique), bref la lie de la société. Monsieur Séchan, plus connu sous son nom de scène (Renaud), a fait de même, le château en moins, peut-être, et en plus fade.
Même notre cher Georges Brassens est à la limite du crédible, quand il chante, par exemple, La Mauvaise herbe : « Les hommes sont faits, nous dit-on, Pour vivre ensemble comme des moutons. Moi je vis seul, et c’est pas demain que je suivrai leur droit chemin ». Dans le genre anormal, on fait quand même mieux que Tonton Georges.
Les gens normaux aiment à l’occasion aller s’enfriponner (avec « canaille », le verbe n’est pas mal non plus, mais plus banal) dans des lieux plus ou moins glauques. On va effleurer la limite, vite éprouver le frisson qui mouille la culotte ou qui gonfle la braguette, avant de vite revenir au bercail de la vie normale, et allonger en quelques minutes la liste de nos futurs payeurs de retraites avant le dodo réparateur.
Je n’explique pas autrement le succès stupéfiant de spectacles mettant en scène le « dérangeant », le « perturbant » : comme si les gens n’en pouvaient plus d’être normaux. C’est peut-être ça : les gens n’en peuvent plus d’être normaux. Peut-être ce que le sociologue Alain Ehrenberg appelle, dans un bel ouvrage au beau titre, La Fatigue d’être soi ?
Alors ils vont se faire pisser dessus au « théâtre » dans les premiers rangs du Festival d’Avignon (Jan Fabre ?), et applaudissent à tout rompre les pisseurs, pour avoir l’impression de rester « normaux ». Ils vont se faire foutre de leur gueule à en redemander, aux expositions d’ « art plastique » au Grand Palais (Anish Kapoor, Daniel Buren) ou au château de Versailles (Jeff Koons, Takashi Murakami), pour avoir l’impression de rester « normaux ».
Ils vont écouter les concerts de « musique » contemporaine de Brice Pauset ou Ondrej Adamek, pour avoir l’impression de rester « normaux ». Ils vont à la Sorbonne entendre disserter du « genre » par Raphaël Enthoven, Mathieu Potte-Bonneville ou Eric Fassin pour avoir l’impression de rester « normaux ». C’est-à-dire pour se convaincre qu’ils sont en phase avec l’époque, car c’est ça, maintenant, être normal. Quoi ? Normaux, ces gens-là ? Je dis qu’il ne faut pas confondre normal et conformiste : voilà, ils se conforment à l’air du temps. Il est à craindre qu’ils en prennent en même temps la consistance. Evanescente.
Pour parler franchement, moi qui me crois statistiquement normal, et même à pas mal de points de vue – même si je ne dis pas tout –, cette époque, c’est quoi ? Non mais entre nous et les yeux dans les yeux, c’est quoi, cette époque où le jeu du « n’importe quoi » est mené par du « n’importe qui » ? J’attends qu’on me dise qui, dans ce jeu, est normal.
Peut-être que oui : les gens n’en peuvent plus d’être normaux.
Voilà ce que je dis, moi.
Fin du feuilleton pour le moment. Mais il fallait que cela sortît.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, société, humour, coluche, bernard vincent, marginaux, normal anormal, common decency, george orwell, romain gary, françois augiéras, une enfance au temps du maréchal, le vieillard et l'enfant, l'apprenti sorcier, mp schmitt, philippe berthier, domme ou l'essai d'occupation, aristide bruant, renaud séchan, georges brassens, la mauvaise herbe, alain ehrenberg, la fatigue d'être soi
jeudi, 13 juin 2013
LA NOUILLE ET LE RUTABAGA

LIBERATION, POUR MIEUX EMANCIPER LA FEMME, ERIGE LA PIPEUSE EN MODELE
(MAIS "je vois tes dents")
LE PROGRESSISME NOUVEAU EST ARRIVÉ
***
J’en étais resté à la logique de notre monde en ruine (Hermann Broch, Logique d’un monde en ruine, éditions de l’Eclat, 2005), qui peut se résumer dans cette forte formule : « Moi d’abord ». J’avançais (avec prudence mais fermeté d'âme) que la norme, c’est d’abord, à l’inverse de cette logique individualiste, la logique majoritaire de modes de vie, de règles, de coutumes, de pratiques sur lesquelles il se fait un consentement général. Le problème du consentement général, c’est qu'il est horriblement compliqué d'en inventorier et énumérer les éléments. Il est plus facile de dire ce qu'il exclut.
Tout simplement parce que la norme repose sur un ensemble de choses non dites. Et non dites parce qu’évidentes : c’est le mode de vie, qui peut se résumer dans cette forte formule : « C’est comme ça ». Certes, le consentement général, quand on est français, se visualise dans un drapeau bleu-blanc-rouge, un béret, une baguette, des charentaises . Bidochon, quoi.
Bidochon, c’est-à-dire stéréotype. Caricature. Comme on sait, le stéréotype est faux et mensonger. Mais il condense. Il condense peut-être des choses qui ne sont plus, mais il perdure. Il est loin, le temps où Gotlib pouvait faire rire quelques générations autour du personnage de Superdupont, sorte de Superbidochon, mais enfin, il reste une référence. Peut-être même qu'il y a de la vérité là-dedans.
C’est cette formule qui permet de faire un départ assez net (mais pas trop) entre le normal et l'anormal. En forçant le trait, on pourrait s’inspirer de ce programme de vie dessiné par des jeunes quand on leur demande comment ils envisagent l’avenir : fonder une famille, avoir un travail, faire des enfants, avoir une voiture, … (authentique, évidemment). On ne se doute pas combien les jeunes sont effroyablement conformistes.
Rendez-vous compte : ils veulent faire comme les autres. Ils veulent faire comme tout le monde. Être dans la norme. Il est là, le consentement général. Ensuite, on voit que la mise en œuvre de ce programme revêt l’infinité des formes que revêtent les individus, avec leur histoire personnelle, qui sert de centre à leur univers, comme c’est le cas pour chacun de nous autres, occidentaux.
Chez nous, donc, les gens vont sur deux jambes et deux pieds en état de marche, dans leur immense majorité. Chez nous, peu de gens se promènent avec une crête de cheveux verts ou violets dressée, héroïque, au milieu du crâne rasé. Chez nous, dans leur immense majorité, les gens convolent en justes noces avec un partenaire « du sexe opposé » (variante : « d’un genre qu’on n’a pas », c’est Guy Béart qui chantait ça, déjà le « genre », on n’en sort pas !). Sinon, ils « cohabitent ». Ah ce verbe qui commence par une question (« quoi ? ») et qui finit par une réponse.
On a compris, l’immense majorité de la population est formée de gens dont la vie, dans ses infinies variétés individuelles, est relativement homogène. Appelons cet ensemble « Population Majoritaire ». C'est un animal qui pond un œuf, plein de jaune et de blanc à la fois homogène et divers. Un oeuf baptisé « La Norme ». Comme tout œuf, celui-ci a une coquille, mais un peu spéciale, parce que, ni trop dure ni trop molle, elle est, en fait, plastique.
La coquille est faite pour signaler le poste frontière qui signale qu'on va sortir du territoire de la norme. En-deçà, on peut voisiner en bonne entente entre voisins, même quand on ne s’apprécie guère. Au-delà, certains envisagent, par exemple, de marier du masculin avec du masculin. Au-dedans, la forme de tout ça est un peu indéterminée. Au-dehors, les formes se découpent beaucoup plus nettement. Il est plus facile de dire ce qui n'est pas normal que ce qui est normal.
Le consentement général forme donc une réalité molle, difficile à saisir. Un exemple : le voisin, on ne le connaît pas bien, mais ça ne viendrait pas à l’esprit de ne pas le saluer dans l’escalier. Ce salut peut être qualifié de normal. Le problème, aujourd’hui, c’est qu’il est de plus en plus introuvable, le « consentement général ». L’œuf majoritaire semble avoir perdu sa coquille. Le blanc et le jaune se sont répandus sur le sol. On patauge dans le glaireux.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Ben non, pas de nouille, pas de rutabaga. Comme dans Le Parapluie de l'escouade, d'Alphonse Allais, où il n'est question ni de parapluie, ni d'escouade.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libération, photographie, presse, journalisme, libération de la femme, progressiste, individualisme, normal anormal

