lundi, 03 février 2014
LAÏCITE : ISRAËL ET TUNISIE
C’est entendu, il faudrait que moi aussi je commente un peu l’actualité, que je fasse mon petit « Café du Commerce », que j’ajoute mon grain de sel sur la queue de la pie qui bavarde, qui jacasse, qui nous soûle d'informations, qui nous gave d'événements et qui tente de saturer notre imaginaire avec le spectacle du monde en nous faisant croire qu'il illustre la phrase de Rimbaud : « La vraie vie est ailleurs ». Ma vraie vie à moi, elle est ici. Mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j’ai le commentaire difficile, l’envie tiède, le goût mou, l’appétence renâclante, la fringale épuisée. Peut-être ai-je par surcroît le besoin satisfait et le désir comblé ? Allez savoir.
Il y a sans doute aussi la conscience ou la certitude que, à l’instar de chacune des quarante-trois millions de petites feuilles que les Français se préparent à glisser dans des petites enveloppes bleues puis à laisser tomber dans un cube transparent aux sons lugubres d'un timbre de compteur et d’une voix caverneuse proférant un « a voté » fatidique, ce que je peux dire ici ne sert à rien, noyé qu'il est dans le flot des avis, le déferlement des opinions, la cataracte des idées et l’avalanche des points de vue. Sans parler du foisonnement des jugements.
Et ce n’est pas qu’il n’y aurait rien à dire du spectacle du monde tel qu’il s’offre en divers lieux de notre encore belle planète. Tenez, prenez cette innocente confidence faite au premier ministre norvégien par le premier ministre israélien, comme quoi son fils Yair couchait avec la belle Sandra Leikanger.

YAÏR NETANYAHU AVEC SA NORVEGIENNE
Je me moque de savoir dans quelles positions variées ils ont accompli la chose. A les voir ici, on se dit qu'ils ne se sont pas trop ennuyés ensemble. Mais l’intéressant dans l’affaire est ailleurs : c’est la réaction des noyaux de fondamentalistes et autres intégristes juifs, souvent membres du parti Shass (que je situerais volontiers à l'extrême-droite de Jean-Marie Le Pen), que des journalistes peu scrupuleux qualifient d’ « orthodoxes ». Je ne vois pas bien ce qui les empêche de les appeler des « fascistes religieux ».
Bref, en apprenant les aventures de Yair Netanyahu avec Sandra Leikanger, ce minuscule monde qui fait un bruit énorme s’est dressé sur ses ergots, partant en guerre contre ce scandale innommable. Qu’est-ce qui les défrise à ce point, ces fanatiques ? Oh presque rien, c’est seulement que ça ne se fait pas, à leurs yeux. C’est seulement que Sandra la norvégienne n’est pas juive. Horreur ! Au fait, personne n’a pensé à l'occasion à demander à Anders Bering Breivik, fasciste déclaré, tueur de l’île d’Utoya en 2011 (77 victimes suivant une source), pensait du fait qu’une de ses compatriotes consente à se faire sauter, sans déplaisir apparent, par un juif ?

ANDERS BERING BREIVIK, FASCISTE ET FIER DE L'ÊTRE
Qu’on se le dise, il est interdit à un juif d’épouser une non-juive. Les juifs intégristes détestent ça. Et mêmes quelques autres, considérés je ne sais pourquoi comme plus tolérants (voir La Vérité si je mens). Le crime ? L'agression ? L'attentat ? Cela s’appelle « assimilation » (en passant, les médias français se gargarisent avec la tisane idéologique qui porte le nom d' « intégration »). Sans entrer dans les détails des prescriptions et proscriptions religieuses, je voudrais juste qu’on réfléchisse à une drôle de comparaison que l’actualité nous met sous les yeux.
Regardons un peu du côté de la Tunisie. Qu’est-ce qui se passe là-bas ? Pas grand-chose : après des mois de luttes politiques, de tractations tortueuses, parfois de crimes contre des représentants de la Tunisie démocratique, la Constituante vient d’adopter une nouvelle Constitution. Tiens donc, diable et stupéfaction, c’est le premier pays musulman à rayer de la liste des crimes inexpiables celui d’apostasie, puni de mort en Arabie Saoudite et dans d'autre contrées accueillantes.
Ça ne vous fait pas quelque chose, d’apprendre que dans un pays musulman, la religion, non seulement cesse d’être LA source du droit, mais qu’il soit en plus admis de la renier ? Pendant ce temps, tous les pays où le pouvoir est viscéralement uni à la religion font leur possible pour criminaliser sa contestation.
Or c’est très curieux, ce qu’on constate : c’est sûr que la Constitution tunisienne, la presse en a parlé. Mais finalement pas tant que ça. Et pas forcément avec la précision souhaitable. Et c’est sûr que le parti Ennahda, les islamistes majoritaires (dans les urnes, mais …), a accepté de laisser le gouvernement à des « technocrates », mais n’en garde pas moins un assez bon appétit de pouvoir.
Toujours est-il que la France entière (j’exagère beaucoup) célèbre l’extraordinaire avancée que représente cet article de la Constitution qui décriminalise le rapport des individus à la religion. Tout en ne protestant pas violemment contre les vociférations fascisantes des fanatiques du parti Shass, qui conditionne son adhésion au gouvernement Nétanyahu à son respect de l’intégrité absolue des prescriptions et proscriptions du Livre.
Je ne sais pas combien il y a, respectivement, de juifs et de musulmans en France. Il paraît qu’ils sont entre 30000 et 40000 à porter l’étoile de David en Rhône-Alpes. Sur la France entière, les musulmans sont (à ce qu’on m’a dit) plusieurs millions. Encore faudrait-il différencier croyants et pratiquants, mais bon.
Ce que je retiens, c’est la différence de traitement : pendant que tous nos démocrates saluent la nouvelle Constitution tunisienne, considérée comme un immense Progrès, parce qu'elle consacre un article à l'effacement des infractions à la religion de la liste des crimes, c'est à peine si l'on entend quelques vagues échos vite assourdis quand des fascistes religieux menacent le premier ministre israélien de lui retirer leur soutien politique s’il persiste à autoriser son fils à baiser avec une femme qui a sans doute, avant de croiser sa route, déjà frayé avec des non circoncis.
La différence de traitement, pour ne pas dire la contradiction flagrante, entre les deux faits montre à mon avis deux influences inégales en France, toujours présentée comme la Terre Promise de la laïcité. Mais si la France était à ce point laïque, laïciste ou laïcarde, l’Etat français aurait célébré à grand coup des trompettes de la Garde Républicaine le vote quasi-unanime de la Constitution tunisienne (islamistes compris, alors qu’ils sont légalement majoritaires), avec sa volonté d’instaurer la laïcité, pour la première fois de l’histoire dans le monde musulman !
Les ronchons diront qu’il reste interdit, dans ce texte novateur, de s’en prendre au « sacré ». J’en suis d’accord, et l’histoire n’est pas finie. Mais que la France laïque, laïciste ou laïcarde, pays en tout cas où l'on fait si grand cas de la laïcité, n’ait strictement rien à dire sur le statut du religieux dans l’Etat d’Israël, je le dis comme je le pense, voilà qui me semble à la fois inconséquent et assez répugnant.
Que des citoyens d'Israël puissent revendiquer fièrement l'idée que l'Etat d'Israël soit admis comme un « Etat Juif », voilà du rétrograde racorni qui dépasse mon pauvre entendement républicain. Que faire des Arabes israéliens ? Sont-ils des citoyens à égalité avec les autres ? Il ne faut pas confondre théocratie et démocratie.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, journaux, informations, juifs, antisémitisme, laïcité, israël, assimilation, intégration, tolérance, tunisie, constitution tunisienne, intégrisme, fondamentalisme, fascisme
dimanche, 02 février 2014
22 BALZAC : UNE DOUBLE FAMILLE (1830)
Cette nouvelle, assez brève pour intéresser par sa vivacité et assez longue pour permettre une certaine complexité, raconte, comme le titre l’indique, la double vie d'un homme. Il s'appelle Roger de Granville. Le début présente un homme âgé de la quarantaine environ, qui passe mystérieusement dans une petite rue, obscure et humide en toute saison, tous les jours, à heures à peu près fixes. L’une des maisons est habitée par une femme assez vieille et une jeune fille très jolie, qui s’applique studieusement à ses travaux de broderie. Le tableau respire la gêne et la pauvreté. Leur vie est très difficile.
L’homme aperçoit un jour un « papier timbré » sur la table. Il revient spécialement en pleine nuit pour poser sur la table, par une fente dans la vitre, une bourse pleine, qui sauve momentanément les deux femmes de la saisie. De fil en aiguille, ils font connaissance, se plaisent et se promènent ensemble, sous le regard de la vieille madame Crochard. Pour elles, il restera longtemps « monsieur Roger ».
On retrouvera Caroline Crochard sous le nom de « de Bellefeuille », douillettement et confortablement installée dans un bel appartement, nantie de deux enfants. Roger passe régulièrement la voir. Elle l’attend fiévreusement, en état de dévotion amoureuse. Sa mère est logée ailleurs, à l’abri du besoin. Fin de la situation n°1.
Balzac opère alors ce qu’on appelle au cinéma un « flash-back ». Nous découvrons un Roger de Granville juvénile et promis au plus bel avenir, vu qu’il est dans les bonnes grâces de gens importants. Son père, le « seigneur » de Granville le convoque à Bayeux : il veut lui faire épouser une demoiselle de la meilleure société, et surtout nantie d’une superbe dot.
Il le prévient toutefois que la mère de la donzelle, la veuve Bontems, est une effroyable bigote, qui plus est entièrement soumise à la « direction de conscience » telle que l’envisage le redoutable et, osons le dire, intégriste abbé Fontanon. Le fils découvre sa promise, et Balzac nous avertit d’emblée : « Granville commit alors l’énorme faute de prendre les prestiges du désir pour ceux de l’amour ». Si l’amour est aveugle, le désir l’est, semble-t-il, tout autant.
Il serait d’ailleurs intéressant de rapprocher Une Double famille de La Peau de chagrin, ce roman qui établit une équation impitoyable entre l’expression ou la force du désir et la durée de la vie, étant posé que plus l’individu modère ses désirs, plus longtemps il peut espérer vivre, comme le prouvent les cent deux ans du vieux marchand qui donne la peau à Raphaël. Mais les excès raccourcissent-ils l’espérance de vie ? Les Rolling Stones prétendraient à bon droit être une preuve du contraire. Seuls les cyniques survivent à toutes leurs intempérances, peut-être ?
Quoi qu’il en soit, le résultat ne se fait pas attendre : catastrophique ! Granville, très pris par ses hautes fonctions, laisse la bride sur le cou à son épouse pour aménager, décorer et meubler son hôtel particulier. Je crois que Balzac s’est payé un plaisir de gourmet raffiné en décrivant l’intérieur de l’héritier « de Granville » comme l’antithèse pure et simple de l’univers grand-bourgeois et aristocrate (les deux étroitement mêlés) qui figurait son rêve ultime.
Pour résumer, Madame a élaboré une lugubre caverne, mais où les pierres, les objets, les couleurs, les matières seraient systématiquement dépareillés. Je vois l’ensemble sur un fond marronnasse, pour situer visuellement. Granville, inutile dès lors de le préciser, a beau faire à sa femme, ponctuellement, un enfant par an, il finit par ne plus supporter la vie, d’où la mine terrible que Balzac décrit au tout début du récit, quand il se met à passer dans la rue de madame Crochard, et la double famille, clandestine celle-là, qu’il décide de fonder.
L’auteur renoue ensuite avec la descendance de Caroline : l’histoire se finit en effet dans l’amertume exécrable de Roger de Granville. Un soir, il rencontre Horace Bianchon le médecin dans une vilaine rue. Celui-ci lui parle d'une pauvre femme qu'il soigne dans la maison dont il sort : son fils lui a mangé sa fortune en vin et en femmes, et la pauvre s'est laissé faire.
Le comte tressaille en apprenant qu'elle se prénomme Caroline, puis il plante là Bianchon stupéfait après lui avoir déclaré : « Quant à Caroline Crochard, reprit-il, elle peut mourir dans les horreurs de la faim et de la soif, en entendant les cris déchirants de ses fils mourants, en reconnaissant la bassesse de celui qu'elle aime : je ne donnerais pas un denier pour l'empêcher de souffrir, et je ne veux plus vous voir par cela seul que vous l'avez secourue ...».
Ses enfants légitimes ont embrassé de très belles carrières : une fille est comtesse de Vandenesse, un fils Procureur du Roi. Tiens justement, Eugène rend ce soir à son père une visite inopinée, au désagrément du vieillard, mais c'est pour lui apprendre qu'un jeune homme vient d'être arrêté chez un de ses amis, ayant « commis un vol assez considérable » : il « s'est réclamé de vous, il se prétend votre fils ». Apprenant qu'il s'appelle Charles Crochard, n'ayant plus aucun doute, il part pour l'Italie en laissant à son fils le magistrat assez d'argent pour régler cette affaire à sa guise.
L'histoire s'achève sur quelques considérations peu encourageantes au sujet du mariage et du choix d'une épouse : « Le défaut d'union entre deux époux, par quelque cause qu'il soit produit, amène d'effroyables malheurs ». On peut à son gré trouver Balzac terriblement cruel, effroyablement pessimiste, ou simplement lucide et réaliste. Rayer la mention inutile.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 31 janvier 2014
21 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Le roman est, selon l’histoire, celui qui a procuré la renommée au jeune écrivain, qui avait préalablement « fait ses classes » avec ce que la tradition appelle « romans de jeunesse ». Je suis pour ma part persuadé que La Peau de chagrin est un roman fondateur, un roman pourtant mal bâti. Je n’y peux rien, c’est mon avis : à la lecture, je vois un grave défaut, mais en refermant le livre, je suis saisi par la force de l’ensemble. Allez comprendre.
Le défaut, il est vite vu. Quand Raphaël sort du magasin, ayant glissé dans sa poche la peau fatale. Miracle ! Il tombe en effet (c’est vraiment le mot) sur son ami Emile, entouré de quelques copains, qui l’entraîne chez le banquier Taillefer, pour se lancer dans une bombance et une orgie acharnées. Emile lui annonce tout de go qu’il vient d’être bombardé directeur d’une revue financée par le banquier : il n’a pas intérêt à faire défaut.
La description de l’orgie est parfaite. Le problème, à mon avis, vient après le dialogue entre les deux amis et deux prostituées, Euphrasie et Aquilina. Sans entrer dans le détail, elles y exposent leur « philosophie » de l’existence, elles qui se savent promises à finir à « l’hôpital ». On verra qu’Euphrasie aura un autre, mais étonnant destin. C’est elle qui déclare aux deux amis : « J’aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Je n’ai ni la manie de la perpétuité ni grand respect pour l’espèce humaine à voir ce que Dieu en fait ! Donnez-moi des millions, je les mangerai … ».
Ce n’est qu’ensuite que Raphaël commence à raconter sa vie à Emile. Et je vous jure, ça n’en finit pas. C’est qu’il faut faire tout un chapitre (le fameux « La femme sans cœur »), que diable. On a droit à tout. La vie de Raphaël défile donc, depuis la solitude auprès d’un père très autoritaire, intraitable et riche. Le destin (encore lui) veut qu’il soit ruiné, et il aura beau lancer son fils, devenu juriste par force, dans des procès à n’en plus finir, il ne lui restera rien ou presque (une petite île au milieu de la Loire, où est la tombe de sa femme).
Raphaël, devenu maître de sa vie, envisagera d’abord de se lancer dans la littérature et la science, entreprenant un énorme « Traité de la volonté » à la lueur d’une chandelle, dans la mansarde d’un petit hôtel tenu par une femme, qui vit seule avec sa fille Pauline, âgée de quatorze ans. Toutes deux vivent pauvrement et, voyant la grande austérité du régime que s’impose le jeune homme, se mettent à veiller sur lui sans qu’il s’en doute, sur son linge, sur ses repas, bref deux anges gardiennes. La dame attend le retour de son mari, prisonnier des Cosaques depuis si longtemps qu’il faut vraiment avoir la foi pour y croire. Mais sa certitude est entière.
Le malheur de Raphaël lui vient par Rastignac, soi-disant son ami, qui vient lui instiller la « philosophie » d’un certain Honoré de Balzac : avoir des dettes, c’est risquer de se ruiner, mais c’est avoir une chance d’attirer la chance. Rastignac est le premier tentateur : après lui avoir permis de gagner quelque argent facile par l’écriture de quelques traités grassement payés, il lui prend ses dernières pièces d’or pour aller les jouer. Le malheur c’est qu’il gagne gros.
Cela tombe très bien et très mal, car il a présenté Raphaël à Foedora. La femme sans cœur, c’est elle. Il en tombe éperdument amoureux, raide dingue et c’est peu dire. Il s’agit d’une femme, certes, mais ce n’est pas n’importe qui. Et le curieux de l’affaire, c’est que le bouquin est écrit en 1831, et que Balzac ne rencontre Madame Hanska qu’en 1833. Or il écrit en toutes lettres, à propos de Foedora : « Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié Russe, une Russe à moitié Parisienne ». Intuition ? Prédestination ? Fantasme ? Hasard pur ? Allez savoir.
Ce qui me reste de ça, c’est la course désespérée du pauvre Raphaël derrière la trop belle et trop cruelle Foedora, qui désespère tous les hommes par sa façon d’attirer tous leurs hommages. Et pour parler franchement, cet étalage des tourments d’un Raphaël écartelé entre l’idéal austère de l’œuvre à élaborer et l’espoir de jouissances beaucoup plus terrestres autant qu’immédiates, a quelque chose de fatigant.
Finissons. Le coup de théâtre est tellement théâtral que j’ai du mal à y croire. C’est au pénible réveil de tous les convives du banquier Taillefer que se présente l’homme de loi qui déclare à la face du monde ici rassemblé que Raphaël est le légataire tant recherché, qui hérite de l’immense fortune de son aïeul maternel. Le côté spectaculaire et m’as-tu-vu de toute la scène, en particulier la solennité tapageuse du notaire Cardot, a quelque chose de peu vraisemblable.
Car ce qui est sûr, c’est que Raphaël voit ici se réaliser son désir et que ce désir le fait penser à la mort. Il est saisi d’horreur. Ayant aussitôt mesuré le rétrécissement de la « peau de chagrin », il sait que le moindre de ses désirs précipite sa fin. Il s’enferme donc dans son luxe, servi par Jonathas, le vieux domestique dévoué, revenu se mettre à son service.
Jusqu’à ce qu’un jour il retrouve la jeune Pauline, mais transformée. En effet, le papa est revenu et, tenez-vous bien, nanti d’une fortune colossale amassée au cours de ses voyages dans les lointains. Et elle est amoureuse de son Raphaël, Pauline. Les deux amants sont bientôt mariés et vivent dans une fusion totale.
Tout ça finira mal, comme on sait, après quelques péripéties liées aux angoisses de mort de Raphaël, que Pauline ne comprendra qu’à la dernière extrémité, lançant à Jonathas accouru : « Que demandez-vous ? dit elle. Il est à moi, je l’ai tué, ne l’avais-je pas prédit ? ». Un drôle d’épilogue, rêveur et poétique, laisse entendre que Pauline est devenue vapeur et brume, « fantôme de la Dame des Cousines », du côté de quelque château de la Belle au Bois Dormant.
Je garde du livre cette impression partagée entre l’admiration pour la conception du roman et le regret dû à une composition que je me permets de trouver faible. Je sais, on me dira que « La femme sans cœur » permet à Balzac d’établir un contraste tranché entre le vain amour pour Fœdora dans lequel Raphaël manque de se perdre et l’amour réciproque et comblé pour Pauline, qui le tue.
Je crois que le défaut se situe dans la volonté de symétrie : l’auteur veut à tout prix découper son récit en trois parties équilibrées, ce qui l’oblige à étirer démesurément l'exposé que fait Raphaël à son ami, n’épargnant au lecteur aucun détail des tourments et déboires éprouvés, qu’ils soient pécuniaires ou amoureux. Pour le coup, on peut appeler ça du « tirage à la ligne ». Enfin, c’est mon avis, et je le partage, comme dit Dupont ou Dupond, je ne sais plus.
Cela dit, le fait que j’aie pu m’attarder (trop, et encore, j’aurais pu …) longtemps sur cette œuvre montre qu’elle recèle de riches profondeurs, ce qui n’étonnera guère les habitués de l’écrivain. Maintenant, ce qu’ont pu écrire des gens très savants sur les sources de La Peau de chagrin, je leur laisse les considérations oiseuses. Balzac s’est-il inspiré du mesmérisme ? A-t-il emprunté à L’Homme au sable (ETA Hoffmann) ?
Autant de questions que je n’ai même pas l’idée de me poser. J'aurais plutôt celle de ne pas trouver géniaux les deux coups de baguette magique que sont la spectaculaire annonce du fabuleux héritage et les spectaculaires retrouvailles avec Pauline, devenue elle aussi richissime grâce à l'incroyable retour de son père. On me dira qu'un miracle ne vient jamais seul.
On ne va pas chipoter.
Voilà ce que je dis, moi.
08:59 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, la peau de chagrin
jeudi, 30 janvier 2014
20 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Je vous assure que je ne fais pas exprès de m’attarder sur La Peau de chagrin. J’ai l’impression que c’est le livre lui-même qui m’y conduit. Je ne fais que suivre le mouvement. Mais je vais tâcher moyen de faire en sorte de ne pas m’y enterrer. Pour l’instant, j’y prends trop de plaisir pour déjà passer à autre chose. Les accords de grave produits à sa lecture résonnent avec encore assez d’ampleur pour que je m’efforce d’en prolonger les vibrations.
******
Maintenant, après la destruction de la Science par le pouvoir inconnu et indestructible de la peau, voici sa présentation inaugurale au héros Raphaël. Retour au premier chapitre. Toujours conduit par le « gros garçon joufflu », il parcourt les « magasins » du « magasin », assailli par les sensations étranges, multiples et confuses qu’il reçoit d’objets amoncelés sans ordre, dans une profusion ahurissante, symbolisant toutes les richesses les plus rares produites par les peuples du monde.
La « boutique de curiosités » présentée au début se révèle un puits sans fond, d’où le visiteur curieux tire, au hasard de sa progression, merveille après merveille. C’est alors qu’il s’exclame : « Vous avez des millions ici, s’écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d’appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. – Dites des milliards, répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n’est rien encore, montez au troisième étage, et vous verrez ! ». On a l’impression que la maison est un ventre qui s’amplifie à mesure qu’on le parcourt.
Parvenu au troisième étage, le visiteur, ébloui par tant de trésors (et il n’est pas au bout de ses surprises), demande : « Votre maître est-il un prince ? – Mais, je ne sais pas, répondit le garçon ». Car c’est le moment pour Balzac de faire paraître le maître des lieux. Et ce n’est pas sans une certaine solennité dans l’annonce de sa venue que l’événement se produit, précédé de considérations sur les états d’âme de Raphaël, qui s’effraie en constatant l’irruption soudaine et silencieuse d’un vieillard d’âge immémorial.

Je ne citerai pas le portrait que Balzac trace, trop long pour les dimensions de ce billet, du personnage, je devrais dire de l’apparition. Juste cette notation qui laisse le reste à deviner : « Une finesse d’inquisiteur trahie par les sinuosités de ses rides et par les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait une science profonde des choses de la vie » (voir l’illustration qui, sauf erreur, date de 1842).
Le vieillard commence par demander à Raphaël : « Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël ? lui dit courtoisement le vieillard d’une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique ». Vous avez bien entendu, il appelle Raphaël par son prénom, enfin si ce n’est pas lui, c’est du moins comme ça qu’il s’appelle. Vous avez dit « pure coïncidence » ? C’est parfait, n’en disons donc rien. Toujours est-il que la vue du chef d’œuvre replace les pieds du héros sur la terre ferme de la réalité.
« J’ai couvert cette toile de pièces d’or, dit froidement le marchand – Eh ! bien, il va falloir mourir, s’écria le jeune homme ». Le vieillard, qui craint soudain pour sa vie, serre les poignets du garçon « comme dans un étau ». Aussitôt rassuré par les paroles qu’il entend, il écoute Raphaël lui révéler la décision qui a précédé son entrée dans le magasin, son intention d’en finir. C’est alors que : « Retournez-vous, dit le marchand, en saisissant tout à coup la lampe pour en diriger la lumière sur le mur qui faisait face au portrait, et regardez cette ʺPeau de chagrinʺ, ajouta-t-il ». L’instant fatidique.

Il contemple l’objet, présenté comme un « talisman », dont émane une sorte de lumière, qu’il attribue, pour être tranquille, à l’âge d’une peau que le temps a polie et repolie. Profondément incrusté dans l’épaisseur du cuir, un texte apparaît. Raphaël essaie de l’entamer de la pointe d’un stylet : peine perdue. Puis il déchiffre les « paroles mystérieuses » (voir illustration) : « Ah ! vous lisez couramment le sanscrit, dit le vieillard ». Passons sur le « sanscrit » de Balzac. Curieusement, la rigidité de la peau fait penser à une feuille de métal.
Le vieillard révèle alors à Raphaël le secret de sa longévité (il a cent deux ans) : très tôt, il a compris que « vouloir » et « pouvoir » sont les deux fléaux de l’humanité, qui s’use à désirer ce qu’elle n’a pas. Lui, il a opté pour cette sagesse d’inspiration orientale fondée sur le « savoir », et qui s’efforce d’éteindre au-dedans tout désir : « J’ai tout vu, mais tranquillement, sans fatigue ; je n’ai jamais rien désiré, j’ai tout attendu ». Ah, le bonheur de vivre sans aucun désir ? La peau de chagrin figure concrètement ces deux modalités du désir que sont vouloir et pouvoir, deux façons pour l’homme de se consumer.
Je note en passant l’incroyable et géniale trouvaille de Balzac, consistant à donner corps à une « philosophie » (le livre appartient à la série des "Etudes philosophiques") dans un objet romanesque aussi nettement identifié, un support aussi « parlant » fourni à l’imaginaire. Vient alors la déclaration qui enchaîne le destin de ce suicidaire récent : « Eh ! bien oui, je veux vivre avec excès, dit l’inconnu en saisissant la peau de chagrin » (il ne s'appelle pas encore Raphaël). Le vieillard résumera son avertissement : « Après tout, vous vouliez mourir ? Eh bien, votre suicide n’est que retardé ». C’est évidemment le programme de la suite.
Je tâcherai demain de comprendre pourquoi Balzac a placé dans ce tableau finalement assez simple ce bizarre deuxième chapitre (« La femme sans cœur »), qui montre Raphaël aussi aveugle aux charmes de la pauvre Pauline qu’il est aveuglé par les prestiges de la riche Foedora.
Je ne suis pas sûr d’être à la hauteur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 29 janvier 2014
19 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Je ne fais pas exprès de passer du temps sur La Peau de chagrin : c'est le livre lui-même qui m'y conduit. Qui m'y oblige peut-être. Et pour dire les choses franchement, je trouve du plaisir à en parler. C'est peut-être un signe, après tout.
Alors en fait, qu’est-ce que c’est, concrètement, une peau de chagrin ? C'est le problème du jour. La deuxième partie, intitulée « La femme sans cœur », est totalement muette sur ce point, puisqu’elle raconte en long, en large et en détail ce qu’a été la vie de Raphaël avant la rencontre avec le vieux marchand d’antiquités.
Dans la première, la présentation et la description de la peau sont expédiées en cinq pages. Il est vrai que ces pages sont d'une densité rare. Tout le monde connaît le thème, ressassé dans les manuels scolaires et les dictionnaires et histoires de la littérature. Tout le reste est dans la dernière, quand la peau de chagrin, en entrant en possession, entre en action. Et c'est bien elle qui possède celui qui la possède. Une variante du pacte faustien, en quelque sorte.
Je commencerai donc logiquement par la dernière partie, lorsque Raphaël a déjà commencé à subir les effets de la peau magique. Et encore plus logiquement, je débuterai par cet épisode tout à fait étonnant, dans lequel Balzac raconte les démarches accomplies par le héros pour percer le secret de ce talisman incroyable, dont il a scrupuleusement tracé le contour d’origine sur une grande surface blanche, et dont il a constaté le rétrécissement, déjà conséquent au moment où j'en parle.
Balzac décide, à ce moment du récit où la vie de Raphaël se résume à une petite pièce de cuir qui rapetisse dès qu’il exprime un désir, de confronter la Science à un phénomène qui la dépasse. Le premier spécialiste qu’il consulte est le zoologiste Lavrille, qui lui révèle (ou lui affirme) que la peau est celle d’un âne de Perse, plus précisément un onagre.
Cela ne lui apprend strictement rien, puisqu'au moment où il découvrait l'existence de la peau (au début du livre), il déclarait : « J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre ». Mais il n'est pas impossible que ce détail soit une étourderie de Balzac : ce ne serait pas la seule.

UN ONAGRE
Comme Raphaël aimerait bien faire retrouver à la peau sa surface d’origine, Lavrille l’aiguille sur le professeur Planchette, célèbre spécialiste de mécanique, en plein siècle de la mécanique toute-puissante (et de son exaltation). Planchette, comme Lavrille et la plupart du temps les scientifiques, est un illuminé perdu dans ses raisonnements et ses découvertes, et insoucieux de la gloire et de l’argent.
Rendus chez le métallurgiste Spieghalter, Planchette introduit la peau entre les deux platines d’une presse hydraulique. Que croyez-vous qu’il arrive ? La presse se brise, incapable de venir à bout de cette peau animale : « Non, non, je connais ma fonte. Monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans ». L’Allemand en colère aura beau flanquer un énorme coup de masse sur la peau posée sur une enclume, la faire brûler dans une forge, celle-ci ressort absolument intacte de tous les mauvais traitements : « Un cri d’horreur s’éleva, les ouvriers s’enfuirent ».
Planchette emmène alors Raphaël chez Japhet pour voir si la Chimie viendra à bout du problème, mais là encore : « La Science ? Impuissante ! les acides ? Eau claire ! La potasse rouge ? Déshonorée ! La pile voltaïque et la foudre ? Deux bilboquets ! ». La conclusion des deux savants, après avoir baptisé « diaboline » la substance de la peau est la suivante : « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l’Académie, nos collègues s’y moqueraient de nous ». Echec sur toute la ligne.
Ce n’est pas pour rien que le mot « cuir » a produit le mot « coriace ». C’est sûr, au sujet de la « Science », on ne saurait confondre Balzac et Zola. Ce qui les différencie ? Pour schématiser, je dirais volontiers que Balzac ressemble à un moteur à explosion, émotif par nature, quand Zola descend par filiation des animaux à sang froid, scientifiques par profession, par nature et par vocation. Le passionnel opposé au rationnel. L’observation du vivant, par contraste avec la dissection des cadavres sur le marbre d’un amphithéâtre de faculté de médecine. La palpitation des émotions contre l'esprit de système. Les battements du cœur contre la Raison toute-puissante et desséchée.
Pour résumer, je vote Balzac, et je jette (pas tout) Zola à la corbeille.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, émile zola
mardi, 28 janvier 2014
18 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Préambule : voilà-t-il pas que je tombe, dans l'avis « Au lecteur » qui ouvre L'Elixir de longue vie, sur cette jolie phrase d'Honoré de Balzac : « La lecture nous donne des amis inconnus, et quel ami qu'un lecteur ! nous avons des amis connus qui ne lisent rien de nous ! l'auteur espère avoir payé sa dette en dédiant cette œuvre Diis ignotis ». Je dédie cette déclaration aux curieux qui me font l'honneur de venir jeter un œil dans ce blog et d'y passer un moment.
Post-préambule : dernières nouvelles d'Egypte, où le général Sissi a été nommé maréchal : "Après Sissi Impératrice, Sissi Maréchal". Et ça commence à se savoir, que l'époque est au changement de sexe et au « trouble dans le genre ».
*******
LA PEAU DE CHAGRIN (1831)
La visite du magasin d’antiquités au début de La Peau de chagrin permet à Balzac de faire un inventaire de tout ce qu’on peut trouver d’original, de rare, voire d’unique dans toutes les contrées de la terre. Il faut savoir qu’il n’aimait rien tant que le beau et le cher, et quand il décrit l’intérieur somptueusement aménagé d’un hôtel particulier parisien, impossible de ne pas ressentir son goût pour les belles choses et le luxe.
Il s’ingéniait par exemple à se faire faire des cannes toutes plus curieuses et intéressantes les unes que les autres. Il va sans dire que son goût pour les meubles, les tentures, les rideaux, les objets, la vaisselle, tout était à l’avenant. On comprend sans mal que Madame Hanska, à la mort de l’écrivain, fut mise en face d’un monceau de dettes et en présence des figures patibulaires de la foule des créanciers du défunt.
Son principe était simple : s’endetter, c’est se mettre dans l’obligation de faire rentrer l’argent. Et puis rien de tel qu'un intérieur princier pour en mettre plein la vue à l'imprimeur, à l'entrepreneur, voire au créancier impatient, avant de traiter avec eux : faire croire qu'on est en mesure de dépenser sans compter, Balzac le considérait comme une mise de fonds, dont il attendait et espérait de généreux « retours sur investissement ». Ce n'est pas en paraissant misérable qu'on peut escompter entrer dans les affaires et faire fortune.
Et lui qui connaissait son Rabelais sur le bout des doigts, on peut se dire qu’il avait fait sienne la conviction exposée par Panurge dans les chapitres III et IV du Tiers livre, où il fait un long discours à la louange des « debteurs et emprunteurs », qui vaut son pesant de ʺPrix Nobel d’Economieʺ qui, comme chacun sait, n’existe pas, Alfred Nobel ayant toute sa vie professé une solide haine des mathématiques et de l’économie. Tant pis si j'exagère. Il est vrai que Rabelais corrige le chenapan au chapitre V, où Pantagruel expose sa réprobation et sa détestation de ces « acteurs du marché ».
Et les biographes se sont plu à commenter en parallèle les fortunes impressionnantes que Balzac a fait entrer dans ses caisses grâce à son acharné travail d’écrivain, et les richesses fabuleuses qu’il a prodiguées et englouties sans compter pour se créer un décor intime luxueux et prestigieux, digne de la haute idée qu’il se faisait de lui-même. Cette tendance de fond, est perceptible dans la visite qu’il nous fait faire du magasin de curiosités, où sont accumulés tous les objets capables de satisfaire son appétit insatiable ou son inextinguible curiosité.
Pour alimenter cet appétit et faire fonctionner la machine à faire rentrer l’argent, il ne lésina pas. La Comédie humaine tout entière fut écrite en dix-sept ans seulement ! Ce monument, unique dans l’histoire littéraire avec ses cent trente-trois œuvres (!!!!), fut conçu en 1833, l’année où il déboula chez sa sœur Laure, devenue Madame Surville, pour déclarer : « Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie ». Proclamation stupéfiante. Mais il avait diantrement raison. Revenons à nos moutons.
Quand Raphaël de Valentin, pour attendre l’heure nocturne de plonger dans la Seine, entre dans la boutique de curiosités, il n’est pas tout à fait dans son état normal : « … laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d’un ivrogne. N’était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort ? ». Sa vision des choses est troublée par son état, il s’en rend compte : « Il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s’ils ne renfermeraient pas quelques singularités à sa convenance ». Un « gros garçon joufflu » va le guider.
Je n’essaierai pas de résumer la visite, autant vaudrait réécrire le livre. En attendant ce moment improbable, il faut le lire. Qu’on imagine simplement un invraisemblable capharnaüm, où voisinent les objets les plus hétéroclites, les armes avec la vaisselle, les tableaux avec les marbres, les animaux empaillés avec les bibelots exotiques, que Balzac synthétise dans la jolie expression « fumier philosophique ». Raphaël, dans « ces trois salles gorgées de civilisations, de cultes, de divinités … », sous l’action de la mystérieuse émanation de ce fumier, quitte le monde réel.
Il est conseillé de prendre le mot « magasin » dans son premier sens d’ « entrepôt ». C’est une accumulation, un amoncellement, un bric-à-brac, une rubrique-à-braque, tout ce qu’on veut. Je soupçonne Balzac d’avoir soigneusement placé, au fur et à mesure de l’avancée de Raphaël dans la cataracte des objets énumérés dans cette scène ahurissante tout ce qui avait guidé les rêves de grandeur du jeune homme, quand il feuilletait le « Catalogue de la Manufacture des Armes et Cycles de Saint-Etienne ». Je plaisante à moitié : tous ces trucs, ces machins, ces bidules insolites, dont beaucoup coûtent la peau du cul, Balzac ne les a pas sortis de son chapeau. Je veux dire que, dans son imaginaire, ça vient de loin.
Ils font partie intégrante de son rêve de grandeur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, l'élixir de longue vie
lundi, 27 janvier 2014
17 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Il paraît que La Peau de chagrin est un des chefs d’œuvre de Balzac. C’est sûrement vrai, puisque des autorités éminentes en la matière l’ont affirmé. C’est en tout cas, encore aujourd’hui, un des romans les plus lus de l’auteur. Pour mon compte, je reste partagé. Pour une raison simple, tenant à la composition, qui donne l’impression d’une vaste digression placée au cœur même du livre et qui nous éloigne du sujet annoncé dans l’introduction.
Il est en effet divisé en trois parties, dont la première, introductive en quelque sorte, forme un petit tiers, la suite constituant les deux autres (gros) tiers : 1) Le Talisman ; 2) La femme sans cœur ; 3) L’agonie. La deuxième partie semble au premier abord, et surtout pendant la lecture, n'avoir aucun lien avec les deux autres. Le livre s’ouvre sur le pressentiment d’une tragédie : un jeune homme à la mine de déterré vient perdre son dernier écu dans une salle de jeu, puis se dirige vers la Seine, avec l’intention d’y finir sa triste existence.
Comme il fait grand jour et que Raphaël de Valentin (le lecteur ne découvre son identité que plus tard) ne veut pas rater sa mort et risquer d’être sauvé par la barque du « Secours aux asphyxiés », il doit attendre la nuit. Pour cela, rien de mieux que de passer le temps, par exemple en pénétrant dans cette boutique d’un « marchand de curiosités » : « … un magasin d’antiquités dans l’intention de donner une pâture à ses sens, ou d’y attendre la nuit pour y marchander des objets d’art ». Il ne sait pas encore que franchir le seuil va décider de son destin, en même temps que retarder sa fin.
Et là il faut dire quelque chose de la description de l’antre du maître des lieux. Bien souvent, les amateurs de littérature, quand ils sont tièdes, sont rebutés par ces longues pages où Balzac plante un décor avec le soin méticuleux d’un artiste peignant un paysage ou un bouquet de fleurs. Je pense aux pages introductives du Père Goriot, dans lesquelles l’auteur nous amène jusqu’à la salle à manger de la mère Vauquer (« Cette pièce est dans tout son lustre … »), que le lecteur moyen (disons le lycéen qui doit rendre son devoir lundi prochain) saute avec lassitude et empressement, déjà fatigué.
Le lecteur paresseux a toujours tort de délaisser ces passages qu’il juge fastidieux, car, surtout chez Balzac (ou Dostoïevski), si l’auteur se donne la peine de décrire longuement (voir la peinture de la Nature dans Les Chouans, déjà), c’est qu’il a une intention : en général, c’est de faire ressentir une ambiance, un climat, parfois même d’annoncer de façon métaphorique ce qui va se passer. Se passer des descriptions quand on lit Balzac, c'est s'exposer à ne rien comprendre aux profondeurs morales et psychologiques sur le flot desquelles il fait aller l'embarcation de son récit.
Dans La Peau de chagrin, dans cette boutique emplie de vieilles choses, que nous montre Balzac ? C’est simple : l’univers. L’impression qui domine en effet, est quasiment que : « Rien de ce qui est humain n’est absent ». Une concentration de trésors accumulés, sur lesquels veille un gros garçon joufflu : « Vous avez des millions ici, s’écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d’appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. – Dites des milliards, répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n’est rien encore, montez au troisième étage et vous verrez ! ».
On a l’impression que l’espace de la boutique s’est distendu aux dimensions de l’imaginaire de l’auteur, c’est-à-dire aux dimensions de l’infini. J’ai l’impression de retrouver la maison marseillaise des frères Sourbidouze dans L’Antiquaire (Henri Bosco) avec ses invraisemblables sous-sols démesurés, ses interminables boyaux tortueux à peine éclairés, ses portes épaisses et ses immenses cavernes secrètes.
Il ne faut à aucun prix bâcler la lecture du cheminement de Raphaël dans le magasin d'antiquités.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, l'antiquaire, henri bosco
dimanche, 26 janvier 2014
16 BALZAC : PETITES MISERES DE LA VIE CONJUGALE
Petites misères de la vie conjugale est donc un livre brillant, plein de ce qu’on appelait à l’époque de Balzac « l’esprit parisien ». Il s’agit de causer. Je veux dire qu’on est dans un salon élégant et impitoyable, où la survie dépend de l’originalité et de la vivacité d’une repartie, et où la cruauté d’une épigramme bien tournée est capable de ruiner pour toujours la réputation d’un homme, même quand il est « en vue ». Et au style dont le livre est rédigé, on sent que Balzac, non seulement a fréquenté ce genre de société assidûment, mais aussi qu'il ne devait pas être maladroit dans le lancer de piques et autres formules incisives.
L'ouvrage adopte en effet le ton qu'on imagine bien qu'aurait une conversation entre quelques jeunes gens célibataires fumant et devisant joyeusement, accoudés à la cheminée, et observant les manèges et les allées et venues des couples invités dans les salons d'un riche bourgeois. Comme s'ils se donnaient les uns aux autres toutes les raisons de la terre de ne pas se marier, et se renforcer ainsi dans leur décision.
On les entend presque se livrer gaillardement à la dissection du spectacle qu'ils ont sous les yeux, et à l'énumération par le menu des mille détails qui pourrissent la vie d’un mari, quand il se rend compte que son épouse ne ressemble que très approximativement à la mignonne petite fée dont il était tombé amoureux trois ans auparavant et dont il a étourdiment demandé la main à des parents nantis comme des huîtres grasses.
Car toute la première partie du livre s’apitoie sur les calamités qui s’abattent sur l’homme qui, inconsidérément, s’est aventuré dans les sentiers tortueux et hérissés d’épines du statut de « mari ». Notre époque, superbement « libérée » des normes et des conventions, est à des années-lumière de pouvoir comprendre des temps où, au moins dans une certaine classe sociale (supérieure), les dites normes et conventions apparaissaient encore comme intangibles.
Et s’il m’est permis de formuler un avis personnel, la façon dont Balzac dépeint l’intelligence féminine dans les relations du couple conjugal est d’une subtilité et d’une justesse incomparables.
Sans vouloir généraliser à outrance (vous savez, tous ceux qui disent : « La Femme …», mais aussi toutes celles qui disent : « Oh vous, les Hommes … »), et sans vouloir paraître misogyne à l’excès, Balzac indique aux malheureux qui ont, sous le coup de l’illusion que donne le désir (pris pour de l'amour) pour une jeune, gracieuse et jolie personne, décidé de sauter le pas et de comparaître en sa compagnie devant monsieur le Curé puis monsieur le Maire, les deux caractéristiques essentielles, les deux grandes spécificités de l’intelligence féminine sont : 1) la manipulation par torsion ou réversion du sens des mots, 2) une mauvaise foi à toute épreuve, essentiellement manifestée dans la dénégation des évidences. Ce n'est pas mal vu.
Certains titres de chapitres attirent et aiguisent l’attention : « La logique des femmes » commence ainsi : « Vous croyez avoir épousé une créature douée de raison, vous vous êtres lourdement trompé, mon ami ». C’est un épisode à enfant, ce surnuméraire familial dont la mère se sert comme d’une arme contre le père (toujours putatif, rappelons-le).
Celui-ci veut envoyer son fils au Collège dans le but qu’il reçoive une éducation et une instruction, mais aussi au motif qu’il mène au logis une sarabande dévastatrice : « La mère lui dit ʺPrends !ʺ à tout ce qui est à vous ; mais elle dit : ʺPrends garde !ʺ à tout ce qui est à elle ». Le père, qu’il soit bien entendu, se soucie de faire former son fils, la mère de le protéger du monde réel. Et quand la bonne déclare que le petit n’a jamais eu d’engelures, « Vous sortez suffoqué de colère ». On n’est pas plus retors. Que le mari le sache : la femme est passée maitresse dans l’art du retournement d’argument.
Quelques titres de chapitres : « Jésuitisme des femmes », où leur dextérité extrême de la casuistique déploie des ailes de grand rapace ; « Le taon conjugal » expose toutes les piqûres d’amour-propre que la femme plante dans l’épiderme de son mari en comparant ce qu’il fait pour elle à ce que fait monsieur Deschars pour son épouse ; « Nosographie de la villa » déroule tout le caprice d’une femme qui se met à aimer la campagne par vanité, et qui, sitôt satisfaite, regrette son appartement parisien. Bref, chapitre après chapitre, l’enfer du mari. On n’en finirait pas.
Il est juste de préciser qu’il ne s’agit que de la première partie du livre. La seconde est présentée comme celle où l’auteur rend justice à la femme, en lui faisant à son tour jouer le rôle de la victime, la précédente s’étant achevée sur le chapitre « Le solo de corbillard ». Essayons d’être objectif, et admettons pour le coup que, dans le livre, les tracasseries que le mari fait à sa femme n’ont aucune commune mesure avec celles qu'il en a subies. Balzac a bien du mal à revêtir la sensibilité féminine.
Cela n’empêche pas l’auteur de farcir son texte de considérations intéressantes, parfois passionnantes, qui ressemblent à des professions de foi. Parlant de petits hommes qui n’écrivent que des petites choses (voir la tirade de Figaro au dernier acte du Mariage de Figaro : "Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits") : « Ceci est l’histoire des médiocrités en tout genre, auxquelles il a manqué ce que les titulaires appellent le bonheur. Ce bonheur, c’est la volonté, le travail continu, le mépris de la renommée obtenue facilement, une immense instruction et la patience qui, selon Buffon, serait tout le génie, mais qui certes en est la moitié ».
Je ne peux m’empêcher de lire dans cette déclaration comme un autoportrait d’Honoré de Balzac en personne. Une sorte de charte déontologique traçant le contour de la silhouette de l'homme qui a l'ambition de devenir un "grand écrivain". C'était en effet un travailleur acharné, impitoyable avec lui-même et avec son secrétaire, et qui voulait que celui-ci le réveillât à minuit pour se consacrer à ses travaux d'écriture. Parmi quelques autres, Jules Sandeau, premier mari de George Sand, à ce régime, se retrouva assez vite sur les rotules et hors d'état.
En tout cas, un autoportrait très juste. Et magnifique. Et en une phrase, s'il vous plaît !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, france, balzac, petites misères de la vie conjugale
samedi, 25 janvier 2014
15 BALZAC : PETITES MISERES DE LA VIE CONJUGALE
Physiologie du mariage disséquait tous les risques encourus par l’homme qui décidait de se marier, à commencer par celui de se faire « minotauriser » par un « célibataire » au bout d’un temps plus ou moins long, qu’il appelait la « lune de miel », évaluée par Balzac à la durée approximative de trois ans. L’ouvrage se voulait en quelque sorte un traité scientifique, un manuel théorique.
Et de même que la science fondamentale est complétée par la science appliquée (où la technique joue le rôle déterminant), Balzac jugea utile d’adjoindre à ses hautes considérations un « manuel pratique » consignant un ensemble de faits observés dans la réalité et scrupuleusement rapportés.
Il le déclare dans le bien nommé chapitre « Ultima ratio » : « Cette œuvre qui, selon l’auteur, est à la Physiologie du mariage ce que l’Histoire est à la Philosophie, ce qu’est le Fait à la Théorie, a eu sa logique, comme la vie prise en grand a la sienne ». Cela donne Petites misères de la vie conjugale, livre brillant, qui braque cette fois la longue vue – et avec quelles délices de gourmet ! – sur le champ de bataille où ces deux armées que sont le mari et la femme s’affrontent sans que mort s'ensuive (en général).
Certains voient ici un roman. Quelle drôle d’idée ! Franchement, s’il y a du romanesque dans ce livre, c’est sous une forme fragmentaire et esquissée. Je m’explique. Certes, le couple est formé d’une Caroline et d’un Adolphe, mais ce sont une Caroline et un Adolphe purement virtuels, que Balzac se plaît, au fil des courts et nombreux chapitres, à plonger successivement dans toutes sortes d’éprouvettes et de corps chimiques pour en décrire la couleur, l'odeur et la teneur du précipité ainsi obtenu.
Je veux dire que l’auteur mêle allègrement les situations, les époques, les contextes et que, dans ces conditions, on ne saurait parler d’un roman à proprement parler, avec sa scène d’exposition, ses péripéties, sa construction et son dénouement. Comme le dit encore l’auteur, c’est un « livre plein de plaisanteries sérieuses ».
Concédons cependant que l'auteur suit une sorte de trame chronologique, qui irait du premier appétit pour la jolie personne et la jolie dot qui l'accompagne jusqu'au moment où le mari se résout et se résigne à la plus vaste indifférence pour tout ce qui concerne la personne de son épouse.
Ce qui est sûr, c'est que Balzac s’amuse énormément aux dépens des malheurs conjugaux de tous les Adolphes de la terre : « Il a lu des romans dont les auteurs conseillent aux maris gênants tantôt de s’embarquer pour l’autre monde, tantôt de bien vivre avec les pères de leurs enfants … ». On sent l’habitué des salons mondains qui, en compagnie de quelques amis, se divertit en taillant en pièces la réputation de quelques figures qui se pavanent sous ses yeux.
Qu’est-ce que vous pensez de « maris gênants » ? Et de « bien vivre avec les pères de leurs enfants » ? C’est pas beau, ça ? Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à Georges Brassens, et plus précisément à la chanson « A l’ombre des maris » : « Si madame Dupont, d’aventure, m’attire, Il faut que, par surcroît, Dupont me plaise aussi ! ». Brassens a le « célibataire » difficile.
Mais la strophe que je préfère, et celle qui commente avantageusement l’ouvrage de Balzac, c’est l’avant-dernière : « Et je reste et, tous deux, ensemble on se flagorne. Moi je lui dis ʺC’est vous mon cocu préféréʺ. Il me réplique alors : ʺEntre toutes mes cornes, Celles que je vous dois, mon cher, me sont sacréesʺ ». Cet éloge, ce dithyrambe en l’honneur de la femme adultère (« Ne jetez pas la pierre ...») ressemble fort à une adhésion sans réserve à la théorie de Balzac développée à la fin de Petites misères … Cocu et content de l'être, en somme ?
Après tout, Balzac et Brassens, ça commence par la même lettre. Et ce sont deux célibataires. Rien de mieux pour partager une "philosophie" identique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, balzac, physiologie du mariage, petites misères de la vie conjugale, georges brassens, à l'ombre des maris, mariage, cocu, adultère
jeudi, 23 janvier 2014
14 BALZAC : PETITES MISÈRES DE LA VIE CONJUGALE
Balzac n’eut pas de chance avec la vie conjugale : la seule et unique fois que, enfin amoureux fou d’une femme, il envisagea de « faire sa vie » avec elle, celle-ci tergiversa et le fit lanterner si longtemps, qu’il ne connut l’état d’homme marié que quelques mois avant sa mort, alors que sa santé était trop dégradée pour qu’il pût espérer combler son épouse. Eve (Evelyne) Hanska était veuve d’un riche propriétaire terrien et grande dévoratrice de romans français. Mais très sourcilleuse quant à la réputation.
Il faut dire que la réputation orageuse produite par l'homme autour de sa vie « affective » – l'homme, dont elle admirait le génie littéraire – avait de quoi l’effaroucher, et même de l’inquiéter, même si elle lui trouvait du charme. C’est ainsi que dix-sept ans s’écoulèrent entre leur première rencontre (1833) et le mariage (1850). Quand il mourut, elle hérita de lui toutes ses dettes, mais acquitta fidèlement jusqu’à la moindre facture impayée.
Et puis il faut dire, aussi et surtout, que la vie amoureuse de Balzac justifiait assez bien la réputation qui éloigna si longtemps la belle comtesse du consentement à confier sa main à un homme au parcours « tumultueux ». Balzac ne disait-il pas lui-même : « Je n’ai que deux passions, l’amour et la gloire » ? On peut dire que ces deux passions furent satisfaites.
La première de ses belles conquêtes féminines (en 1822), après une attente longue et pressante, est celle de Laure de Berny qui, à quarante-cinq ans, pourrait être la mère de cet amoureux qui n’en a que vingt-trois, qui lui écrit le lendemain (le lendemain de quoi, demandera-t-on ? Un peu de patience, ça vient) : « Oh ! Je suis environné d’un prestige tendrement enchanteur et magique ; je ne vois que le banc … ».
Car il faut savoir que la dame, d'abord "raisonnable", s’est donnée à lui (comme on ne dit plus) sur un banc du jardin de sa maison, et il ne devait pas être manchot, puisqu’elle devient elle-même très amoureuse, et qu’elle restera sans doute pour l’écrivain le grand amour de sa vie, eh oui, bien avant l’irruption de madame Hanska.
Il est vrai qu’elle aura le bon goût de laisser la place à cette dernière en mourant en 1836, faisant une grande peine à l'écrivain. Inutile de dire que les trois enfants de Laure de Berny, qui ont à peu près l'âge d'Honoré, voient cette relation d'un très mauvais œil. De même d'ailleurs que Madame Balzac mère, qui parviendra à éloigner pendant quelque temps son fils de Villeparisis et de ce nid de péché.
Mais trêve de détails biographiques, qui ne devaient au départ servir qu’à souligner la répugnance instinctive de Balzac pour le joug du mariage ("joug" c'est juste à cause de l'étymologie). Je retiens qu’il a épousé à trois mois de sa mort : il serait intéressant de se demander si l’écrivain n’était pas un intégriste du célibat. Du reste, La Physiologie du mariage abordait la question en long, en large et en travers : l’ennemi public n°1 du « mari » et le plus à craindre n’est personne d’autre que le « célibataire ».
Seul le célibataire semble, au moins aux yeux de l’auteur, en mesure de « minotauriser » le front d’un époux. Le drôle aujourd'hui, c'est qu'être célibataire est devenu un argument de drague (Meetic et compagnie). Bon, certains se diront que toutes les situations sont devenues des arguments de drague (voir un épisode d'Exterminateur 17 de Bilal).
Sachant évidemment qu’être « minotaurisé », surtout par le premier « célibataire » venu (mettons Balzac), est le déshonneur suprême du « mari ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 22 janvier 2014
L'"ART CONTEMPORAIN" POUR LES NULS
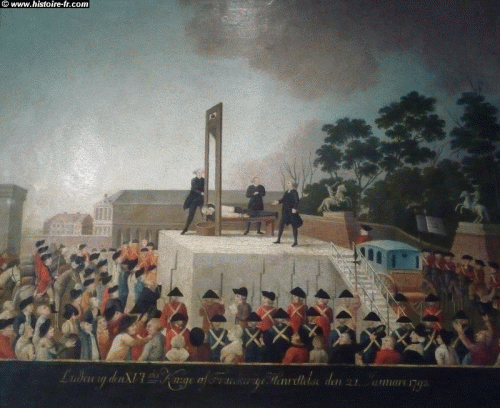
22 JANVIER. C'EST LE JOUR EXACT DE RELIRE BALZAC : UN EPISODE SOUS LA TERREUR.
*****
Le hasard de la découpe des dalles, la nature de la pierre, l'état plus ou moins sec ou humide de l'atmosphère sont capables de faire infiniment mieux en matière d'"Art Contemporain" que n'importe quel paresseux, que n'importe quel esbroufeur dont le seul souci est d'en mettre plein la vue. Pour détecter ces "œuvres" dues au hasard, à la nature et à l'atmosphère, ce n'est pas difficile : il suffit de regarder. Et de regarder d'assez près.
J'AI APPELE CETTE SERIE
SILHOUETTES
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
mardi, 21 janvier 2014
L'"ART CONTEMPORAIN" A LA PORTEE DES ENFANTS

C'ETAIT IL Y A 221 ANS, JOUR POUR JOUR
******
Recette pour réaliser un tableau d' "Art Contemporain". Vous voulez passer pour un "Hartiste Con-Temporain" ? C'est très facile. Munissez-vous de n'importe quel appareil photo (ça va du vieil Instamatic Kodak au Hasselblad avec tous ses dos, moteurs et accessoires). Sortez de chez vous et regardez. Quand l'objet observé vous semble en accord avec certaine tendance en vogue dans les galeries et autres Biennales, cadrez à loisir et appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
lundi, 20 janvier 2014
L'"ART CONTEMPORAIN" A LA PORTEE DE TOUS
J'AI APPELE CETTE SERIE
IDEOGRAMMES PIETONNIERS
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art contemporain
samedi, 18 janvier 2014
13 BALZAC : LA MAISON NUCINGEN
La Maison Nucingen (1838) consiste en un dialogue débridé de quatre amis, tenu dans un des « cabinets particuliers » d’un célèbre cabaret (non nommé) de Paris, et fidèlement reconstitué par le narrateur qui, dans le cabinet mitoyen séparé par une mince cloison, a entendu et mémorisé l’intégralité de la conversation.
Aux voix, il a reconnu les personnages, qui se nomment Blondet, Finot, Couture et Bixiou : « C’était quatre des plus hardis cormorans éclos dans l’écume qui couronne les flots incessamment renouvelés de la génération présente ». Il est utile de préciser que les langues vont bon train, du fait qu’on a fait venir un nombre respectable de bouteilles de champagne, au point qu’à la fin les compères sont un peu gris.
Bixiou raconte à ses amis comment Eugène de Rastignac, qui vivait si pauvrement à la pension Vauquer, vit aujourd’hui confortablement, à la tête d’une fortune de quarante mille livres de rentes, tout en ayant pu richement "doter" ses sœurs, restées au fond de leur province.
Accessoirement, il va dénouer l’écheveau qui rend incompréhensibles au bon peuple les calculs et manœuvres hautement raffinés qu’on voit à l’œuvre dans les milieux de la haute finance, incarnés ici par le richissime banquier alsacien Nucingen. Ah ! les interventions de Nucingen, plus alsaciennes que le vrai : « Hé pien ! ma ponne ami, dit Nucingen à du Tillet en tournant le boulevard, location est pelle bire ébiser Malfina : fous serez le brodecdir teu zette baufre vamile han plires, visse aurez eine vamile, ine indérière ; fous drouferez eine mison doute mondée, et Malfina cerdes esd eine frai dressor ».
Traduction : eh bien mon bon ami, l’occasion est belle pour épouser Malvina : vous serez le protecteur de cette pauvre famille en pleurs, vous aurez une famille, un intérieur ; vous trouverez une maison toute montée, et Malvina certes est un vrai trésor. On trouve dans le Nouveau dictionnaire des œuvres le commentaire suivant : « De plus, Balzac, par un souci exagéré de réalisme, s'obstine à reproduire le singulier jargon parlé par le baron, ce qui rend pénible la lecture des dialogues ».
Pas faux, mais ma parole, si le commentateur met un jour les pieds dans l'Alsace profonde pour dialoguer avec un vieux de la vieille, il verra ce que c'est. Je pense aussi à Victoire, la servante du colonel dans Le Sapeur Camember, et à son accent superlativement alsacien, qui provoque quelques malentendus. Ainsi : « Le colonel est-il visuel, mam'selle Victoire ? - Foui ! mossieu Gamempre, ché fiens te le foir ... tant son gabinet ... il ... é...grivé », dont le dernier mot fait croire au sapeur que le colonel est "crevé". Toute la caserne se précipite chez lui. Comme il est bien vivant, on convoque Victoire : « Oh ! mossieu Gamempre (...) c'est pas chentil te faire arrifer tes misères à une bôvre cheune fille innocente ... Ch'ai pas tit : "Le golonel il est grévé" ... Ch'ai tit : "Le golonel il égrivé ... avec une blume, quoi ! ».
Ailleurs, elle va faire les courses, et fait deviner à Camember ce qu'elle va acheter : « ... ça gommence par un C ». Le sapeur ne trouve pas : « Eh ! pien ! mossieu Gamempre, puisque fous ne tefinez pas : c'est tes cuernouilles et un chigot ! ». Dans les Contes drolatiques, Balzac se laissera carrément aller à une débauche toute rabelaisienne dans ce genre, en imitant cette fois la langue du XVI° siècle. Revenons à nos moutons.
Je laisse de côté la complexité des tripatouillages boursiers décrits par Bixiou-Balzac, pour en venir à ce que Blondet dit des canuts de Lyon, qui se révoltèrent en 1831 et en 1834 contre le sort qui leur était fait, et dont l’étendard portait en ces journées la fière devise : « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ».
Voici ce que déclare Blondet : « Voici, reprit Blondet. On a beaucoup parlé des affaires de Lyon, de la République canonnée dans les rues, personne n’a dit la vérité. La République s’était emparée de l’émeute comme un insurgé s’empare d’un fusil. La vérité, je vous la donne pour drôle et profonde. Le commerce de Lyon est un commerce sans âme, qui ne fait pas fabriquer une aune de soie sans qu’elle soit commandée et que le paiement soit sûr. Quand la commande s’arrête, l’ouvrier meurt de faim, il gagne à peine de quoi vivre en travaillant, les forçats sont plus heureux que lui. Après la Révolution de Juillet, la misère est arrivée à ce point que les CANUTS [sic] ont arboré le drapeau : Du pain ou la mort ! une de ces proclamations que le gouvernement aurait dû étudier, elle était produite par la cherté de la vie à Lyon. Lyon veut bâtir des théâtres et devenir une capitale, de là des Octrois insensés. Les républicains ont flairé cette révolte à propos du pain, et ils ont organisé les Canuts qui se sont battus en partie double. Lyon a eu ses trois jours, mais tout est rentré dans l’ordre, et le Canut dans son taudis. Le Canut, probe jusque-là, rendant en étoffe la soie qu’on lui pesait en bottes, a mis la probité à la porte en songeant que les négociants le victimaient, et a mis de l’huile à ses doigts : il a rendu poids pour poids, mais il a vendu la soie représentée par l’huile, et le commerce des soieries françaises a été infesté d’étoffes graissées, ce qui aurait pu entraîner la perte de Lyon et celle d’une branche de commerce français. Les fabricants et le gouvernement, au lieu de supprimer la cause du mal, ont fait, comme certains médecins, rentrer le mal par un violent topique. Il fallait envoyer à Lyon un homme habile, un de ces gens qu’on appelle immoraux, un abbé Terray, mais l’on a vu le côté militaire ! Les troubles ont donc produit les gros de Naples à quarante sous l’aune. Ces gros de Naples sont aujourd’hui vendus, on peut le dire, et les fabricants ont sans doute inventé quelque moyen de contrôle. Ce système de fabrication sans prévoyance devait arriver dans un pays où Richard Lenoir, un des plus grands citoyens que la France ai eus, s’est ruiné pour avoir fait travailler six mille ouvriers sans commande, les avoir nourris, et avoir rencontré des ministres assez stupides pour le laisser succomber à la Révolution que 1814 a faite dans les prix des tissus. Voilà le seul cas où le négociant mérite une statue. Eh ! bien, cet homme est aujourd’hui l’objet d’une souscription sans souscripteurs, tandis que l’on a donné un million aux enfants du général Foy. Lyon est conséquent : il connaît la France, elle est sans aucun sentiment religieux. L’histoire de Richard Lenoir est une de ces fautes que Fouché trouvait pire qu’un crime ».
Bon d’accord, Blondet finit par laisser tomber les canuts et son propos dérive, mais tout le dialogue est pareillement décousu, mené « à sauts et à gambades » (Montaigne, III, 9). Balzac nous a d’ailleurs prévenus dès le début : « Ce pamphlet contre l’homme que Diderot n’osa pas publier, le Neveu de Rameau ; ce livre débraillé tout exprès pour montrer des plaies, est seul comparable à ce pamphlet dit sans aucune arrière-pensée, où le mot ne respecta même point ce que le penseur discute encore, où l’on ne construisit qu’avec des ruines, où l’on nia tout, où l’on n’admira que ce que le scepticisme adopte : l’omnipotence, l’omniscience, l’omniconvenance de l’argent ». Je confirme : La Maison Nucingen est bien un livre « débraillé ». Les quatre amis se lancent donc dans une longue "improvisation" (le mot est de B.), qui fait penser à la manière dont Béroalde de Verville conduit (ou fait semblant, ou ne conduit pas) son Moyen de parvenir. Et Balzac ajoute à propos de cette improvisation : « … et, quoique souvent interrompue, prise et reprise, elle fut sténographiée par ma mémoire ».
J’ai raconté ici même (31 janvier) l’événement que fut pour la ville de Lyon, ses habitants et ses autorités la venue de Franz Liszt. C’est bien connu : tout ce qui est important se passe à Paris. Ce n’est pas dans La Maison Nucingen que Balzac va nous dire le contraire, même s’il prouvera maintes fois par ailleurs que la vie de province n'a aucun secret pour lui (il faut voir avec quelle jubilation maligne Balzac assaisonne Alençon dans La Vieille fille, avec quelle poétique mélancolie il décrit les rives de l’Indre dans Le Lys dans la vallée, etc., etc.). S’il fait ici référence à Lyon, c’est presque par hasard, au détour d’une conversation entre amis, lancés dans une agréable beuverie.
Ce que dit des canuts le passage cité est trois fois rien. Ce n’est pas une raison pour le bouder.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lyon, balzac, la maison nucingen, le père goriot, rastignac, pension vauquer, le sapeur camember, christophe georges colomb, nouveau dictionnaire des œuvres, littérature française
vendredi, 17 janvier 2014
12 BALZAC : LA VENDETTA
Nous étions dans l’atelier du peintre Servin, au moment où les « jeunes filles de très bonnes (ou très riches familles) » commencent à quitter leur professeur, peut-être à cause de ses opinions bonapartistes, compromettantes, mais surtout à cause du fait que, Ginevra, la fille de Bartholoméo di Piombo, l’indéfectible Corse, y rencontre secrètement un jeune homme, et que leur réputation risquerait d’en être entachée, ce qu’à Dieu et au Roi légitime ne plaise.
Ce jeune homme n’est pas n’importe qui, mais un bel officier de la « Grande Armée », que Servin cache dans une sorte de cagibi attenant à son atelier. C’est par hasard que Ginevra l’a aperçu, couché sur un lit dans son uniforme de grenadier de la Garde, où il était colonel chef d’escadron. Un des derniers à quitter le champ de bataille de Waterloo, il est très lié à Labédoyère, ce héros fait général par Napoléon au cours des Cent Jours, et bientôt exécuté par les Bourbons, à peu près au même moment que Ney.
La jeune fille, que, curieusement, Balzac nomme tour à tour Ginevra ou « l’Italienne », a commencé par être intriguée par la présence du militaire, puis elle s’est intéressée à lui, au point d’en faire un remarquable portrait au lavis, au sujet duquel le maître sans un éloge hyperbolique : « Mais vous en saurez bientôt plus que moi. (…) Ceci est un chef d’œuvre digne de Salvator Rosa, s’écria-t-il avec une énergie d’artiste ». Il y a sûrement du vrai, Balzac n’a-t-il pas montré, dans La Maison du Chat-qui-pelote, quel chef d’œuvre est capable d’enfanter l’artiste enflammé par une passion amoureuse ?
Car Ginevra est tombée raide amoureuse de l’inconnu, qui ne va pas tarder, de son côté, à lui rendre sentiment pour sentiment. Ils se l’avouent bientôt, et puis dans la foulée, elle commence à en parler à ses parents. Ce faisant, elle, la fille trop aimée, la fille qui a vécu une jeunesse favorisée, elle ne se rend absolument pas compte qu’elle va déclencher la catastrophe.
Dans un premier temps, c’est son intention d’épouser un homme qui plonge les parents dans l’affliction : ils n’envisageaient leur avenir et leur vieillesse qu’accompagnés fidèlement, puis soignés par leur enfant, et Bartholoméo di Piombo commence par se sentir trahi, pour accepter de s’effacer devant le bonheur de Ginevra et l’embrasser avec une tendresse retrouvée. Elle est autorisée à leur présenter son « fiancé ». C’est le deuxième temps de la catastrophe.
Car le jour fixé, Ginevra présente l’officier sous le nom de Louis. Première réaction du père envers un homme supposé avoir été récompensé pour sa bravoure : « Monsieur n’est pas décoré ? ». A quoi Louis répond timidement : « Je ne porte plus la Légion d’honneur », ce qui satisfait d’abord le futur beau-père.
Malheureusement, la future belle-mère a la très mauvaise idée de souligner la ressemblance du futur gendre avec Nina Porta : « Rien de plus naturel, répondit le jeune homme sur qui les yeux flamboyants de Piombo s’arrêtèrent. Nina était ma sœur … ». La foudre tombée dans le salon n’aurait pas fait plus d’effet : « Tu es Luigi Porta ? demanda le vieillard. – Oui ». On se souvient que Piombo avait attaché le jeune Luigi dans son lit avant de mettre le feu à la maison des Porta, pour venger les siens, assassinés par les mêmes Porta. Il ne pouvait savoir que l’enfant avait été sauvé.
La suite est à l’avenant : « Bartholoméo di Piombo se leva, chancela, fut obligé de s’appuyer sur une chaise et regarda sa femme, Elisa Piombo vint à lui ; puis les deux vieillards silencieux se donnèrent le bras et sortirent du salon en abandonnant leur fille avec une sorte d’horreur ». Les deux jeunes gens sont passés brutalement de la plus grande insouciance à la plus grande désolation.
Car le vieux Piombo, qui est du bois dont on fait les Corses, a décidé une fois pour toutes : « Il faut choisir entre lui et nous. Notre vendetta fait partie de nous-mêmes. Qui n’épouse pas ma vengeance n’est pas de ma famille ». Il ne reviendra plus sur sa décision. Un rideau de haine s’est abattu, séparant désormais la fille et le père.
La suite est comme une mécanique fatale. Et ce n’est pas l’intervention administrative (et racontée de façon presque burlesque) du notaire de Ginevra, destinée à contraindre légalement le père, qui a des chances de le fléchir. En effet, après la lecture de l’acte officiel par l’homme de loi, le père saisit un poignard pour en frapper sa fille, mais jette son arme, dont la lame s’enfonce dans la boiserie. Il renie sa fille et la chasse de chez lui.
Le couple, désormais sans ressources, se cramponne à l’amour qui les unit, comptant que le sentiment, puissant et intact, leur tiendra lieu d’air à respirer et de nourriture. Mais c’est bien compliqué de vivre à Paris en se passant de tout argent. Leur mariage aura bien lieu, mais ressemblera à l’état de leur compte en banque. Ginevra est bientôt enceinte, mais le dénuement est trop grand pour que les choses s’arrangent.
La chute de l’histoire est spectaculaire. Certains pourraient reprocher à Balzac de verser dans un pathétique outrancier, dans une hyperbole grand-guignolesque. Toujours est-il que Luigi Porta vient s’écrouler sur le tapis du vieux, de l’intraitable, de l’inflexible Bartholoméo di Piombo en lui jetant la chevelure de sa fille morte. Seule oraison funèbre prononcée par le vieillard : « Il nous épargne un coup de feu, car il est mort, s’écria Bartholoméo en regardant à terre ». Ainsi s'éteignent deux familles. Amen.
Peut-être Mérimée avait-il lu La Vendetta quand il se mit à écrire Colomba. Ce qui est sûr, c’est que le personnage de Piombo me paraît beaucoup plus terrible et sauvage que celui de la sœur d’Orso della Rebbia (lui aussi officier d'Empire), quelque trempé que soit le caractère de celle-ci, même si elle lui fera le même reproche que Piombo à Bonaparte et son frère (ne plus être Corse).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 16 janvier 2014
11 BALZAC : LA VENDETTA (1830)
La scène inaugurale de cette nouvelle précède de quinze ans le corps du récit, le temps qu’il a fallu à Bonaparte pour se muer en empereur Napoléon vaincu. Un jour de l’an 1800, on voit en effet le Premier Consul en compagnie de son frère Lucien. Celui-ci vient d’introduire auprès du futur souverain un compatriote, je veux dire un Corse, Bartholoméo di Piombo.
Le Corse vient solliciter de cette vieille connaissance devenue puissante « asile et protection ». C’est qu’il n’a pas fait les choses à moitié, Piombo : « J’ai tué tous les Porta », lui dit-il. Il faut dire aussi que ce sont les Porta qui ont commencé, en incendiant sa maison et en tuant son fils Gregorio. L’épouse et la petite Ginevra ont pu s’échapper. Pour être sûr de tous les expédier chez Saint Pierre, il précise même qu’il a attaché le petit Luigi Porta dans son lit avant de bouter le feu à la maison.
Quelqu’un a beau prétendre que l’enfant a été sauvé des flammes, pour lui, les sept Porta y ont passé. Il rappelle ensuite qu’il a sauvé la famille Bonaparte des poignards des Porta et permis à la mère (vous savez, Letizia Ramolino, alias « Madame Mère » : « Pourvou qué ça doure ») d’arriver à Marseille. Piombo a beau remuer ce passé et citer le nom de Porta : « ces mots ne réveillèrent aucune expression de haine chez les deux frères », au point de lui tirer cette exclamation : « Ah ! Vous n’êtes plus Corses ». Tout juste Auguste ! La France, c’est mieux que la Corse ! Et merde en passant à tous les particularismes ! Comme le chante Brassens : "Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part".
Bonaparte accepte de fermer les yeux sur le septuple meurtre, bien que la « tradition » de la vendetta lui apparaisse comme complètement hors de saison : « Le préjugé de la vendetta empêchera longtemps le règne des lois en Corse, ajouta-t-il en se parlant à lui-même. Il faut cependant le détruire à tout prix ». Mais ça n’empêche pas Napo et Lulu d’apporter au réfugié toute l’aide dont leur position les rend capables, et de lui assurer une position sociale confortable : on ne sait jamais, le premier peut avoir besoin d’un ami dévoué auquel il puisse se confier à l’occasion.
Transportons-nous quinze ans plus tard : les Ultras sont aux commandes, et il ne fait pas bon avoir été bonapartiste, encore moins avoir servi dans les rangs de la « Grande Armée ». Transportons-nous également dans l’atelier du peintre Servin, dont la renommée est grande à l’époque. Il a été le premier à ouvrir un atelier où il enseigne sa discipline à une douzaine de jeunes filles de bonne maison, dont Ginevra di Piombo, la fille rescapée, âgée maintenant de vingt-deux ans.
Cette meute féminine est partagée entre le camp des riches bourgeoises, « filles de banquier, de notaire et de négociant », et le camp des filles de la noblesse, fières de pouvoir, grâce à la Restauration et aux Bourbons, retrouver tous leurs droits à l’arrogance aristocratique.
Balzac n’est pas tendre avec ces dernières : « Si leurs attitudes étaient élégantes et leurs mouvements gracieux, les figures manquaient de franchise, et l’on devinait facilement qu’elles appartenaient à un monde où la politesse façonne de bonne heure les caractères, où l’abus des jouissances sociales tue les sentiments et développe l’égoïsme ». On dira ce qu’on voudra, mais tout cela est aussi bien observé qu’envoyé.
La proscription qui vise les bonapartistes atteindra évidemment Servin, dont l’atelier sera bientôt déserté par les jeunes filles, dont les parents, soucieux de « bien-penser », manifestent bientôt des réticences à laisser ces demoiselles fréquenter un milieu devenu louche. Mais il y a aussi la moralité. Car si les élèves quittent l’atelier, c’est peut-être à cause des opinions politiques du peintre, mais c’est surtout parce qu’elles soupçonnent Ginevra di Piombo d’entretenir une relation coupable avec un homme. Et c’est là que se noue le drame.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 14 janvier 2014
10 BALZAC : UN EPISODE SOUS LA TERREUR
Cette nouvelle d’une petite vingtaine de pages raconte une toute petite histoire, mais tendue comme une corde de piano. La Terreur dont il est ici question la situe évidemment en 1793. Le 22 janvier exactement. Le récit commence en un hiver couvert de neige épaisse.
Le suspense est immédiat : une frêle silhouette féminine avance fiévreusement, suivie par une ombre menaçante. Arrivée chez le boulanger, elle se fait remettre un mystérieux colis par le boulanger qui, craignant d’être espionné ou dénoncé, la chasse en essayant vainement de lui reprendre la « boîte ».
Tout aussi fiévreusement, la femme, dont Balzac ne décrit qu’une tête aux manières d’ancien régime, se hâte sur le chemin du retour, toujours suivie par l’ombre noire. Elle rejoint son logis, où l’attendent une autre femme et un vieillard. Elle demande instamment à celui-ci de se cacher « dans une espèce d’armoire », ce qu’il consent à faire, après avoir tenté de rassurer les deux femmes : « Sœur Marthe, dit-il en s’adressant à la religieuse qui était allée chercher les hosties, cet envoyé devra répondre Fiat voluntas, au mot Hosanna ». Il s’agit du mot de passe convenu avec un réseau royaliste.
Le vieux prêtre réfractaire et les deux nonnes ont en effet échappé au massacre qui a fait disparaître tous les occupants du couvent des Carmes. Et on ne peut célébrer une messe sans hosties, d’où l’expédition nocturne qui sert d’introduction. On entend des pas lourds résonner dans l’escalier. Un homme entre. Drôle de personnage, à vrai dire. Informé de la présence des trois religieux dans le taudis, il ne les a pourtant pas dénoncés.
Ayant rassuré les trois proscrits, il prie le vieux prêtre de célébrer une messe pour l’âme d’un mort, « une personne sacrée, et dont le corps ne reposera jamais dans la terre sainte ». Le prêtre a compris de qui il s’agit. « Revenez à minuit », répond-il. A l’heure dite, ce petit monde se prépare à la cérémonie dans une ambiance marquée de ferveur et de gravité. Arrivé au Pater Noster, l’abbé ajoute cette phrase : « Et remitte scelus regicidis Ludovicus eis remisit semetipse ». On comprend qu'il y a eu crime sur un certain Louis. Deux grosses larmes roulent alors sur les joues de l’inconnu. Sa douleur n’est pas feinte.
L’inconnu s’en va ensuite, après avoir refusé de se confesser comme le prêtre l’en priait, mais après lui avoir légué une « sainte relique ». Il garantit aux trois réfugiés la sécurité de leur asile, et se chargera de les faire approvisionner. Balzac appelle curieusement le propriétaire de la maison Mucius Scaevola, grand héros romain de la guerre contre les Etrusques (brûlant volontairement sa main droite pour montrer à Porsenna qu'il ne craint rien). L’inconnu leur donne rendez-vous au 21 janvier suivant. La relique s’avère être un mouchoir de baptiste marqué de la couronne royale et taché de sang. L’horreur saisit les trois personnes.
L’année se passe sans encombre, sous la mystérieuse aile protectrice du maître des lieux et de l’inconnu. Celui-ci ne manque pas le rendez-vous, puis, la messe dite, s’éclipse sans en dire davantage sur lui-même. Arrive le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), qui délivre le monde de Robespierre et de ses « complices ». L’abbé de Marolles et les deux religieuses peuvent à nouveau circuler librement.
Du temps passe. Quatre jours après la messe pour le 2ème anniversaire de l’exécution de Louis XVI, le prêtre se trouve sur le seuil de la boutique de Ragon, un ancien parfumeur de la Cour resté fidèle au roi. Il aperçoit un convoi qui passe par là, emmenant les derniers robespierristes à l’échafaud. Stupéfait, il reconnaît, debout, l’homme qui, fidèlement, chaque 21 janvier, lui demande de célébrer la messe.
Il demande au parfumeur qui est cet homme : « C’est le bourreau, répondit monsieur Ragon en nommant l’exécuteur des hautes œuvres par son nom monarchique ». Le prêtre s’effondre sur le sol : « Il m’a sans doute donné, dit-il, le mouchoir avec lequel le roi s’est essuyé le front, en allant au martyre … Pauvre homme !... Le couteau d’acier a eu du cœur quand toute la France en manquait !...
Les parfumeurs crurent que le pauvre prêtre avait le délire ».
Balzac ne sait pas écrire, comme le prétendent étourdiment et un peu vite quelques méchantes langues. Mais bon dieu de saprelotte de vertuchou, ce qu'il sait raconter une histoire !
Voilà ce que je dis, moi.
PS : pour ce qui est des messes commémorant à Lyon la décollation de Louis le seizième, je signale celle de l'église Immaculée-Conception, avec la présence de SAR (Son Altesse Royale) le prince Rémy de Bourbon-Parme. Elle sera accompagnée de la sonnerie des trompes de chasse de la Diane lyonnaise. On regrettera qu'elle ait lieu le samedi 18 janvier à 10 h 30. Une hérésie, quoi.
La seule, la vraie, l'authentique sera bel et bien célébrée le 21 janvier en l'église Saint-Denis de la Croix-Rousse, quoique sans roulement de tambours et sans sonnerie de trompes. Pour l'heure, prudent se renseigner (comme disent presque les restaurants qui souhaitent tirer argument d'un succès d'affluence purement hypothétique).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, balzac, la comédie humaine, un épisode sous la terreur, révolution française, robespierre, louis 16, 21 janvier 1793, messe royaliste
lundi, 13 janvier 2014
9 BALZAC : LE BAL DE SCEAUX
(1830)
Voilà encore une histoire où se déploie l’ironie du regard que Balzac jette sur l’aquarium social, où des poissons de toutes couleurs, les uns ternes, les autres dardant leurs mille feux sur les yeux fascinés des autres, évoluent, tour à tour se côtoyant, s’accouplant ou se dévorant. Emilie de Fontaine appartient à la famille balzacienne de ces créatures brillantes comme des flammes dans la nuit où viennent se brûler les ailes les phalènes imprudentes.
Malheureusement pour elle, toute l’éducation qu’elle a reçue de sa famille a consisté à se prosterner devant sa beauté rayonnante et à louer ses manières de déesse. En sorte que la petite Emilie (non, pas la p’tite Emilie qui m’avait promis quelque chose), une fois devenue grande, a fini par se prendre pour la statue d’Athéna Parthenos, celle même qui a donné son nom au temple d’Athènes et qui, entièrement d’or et d’ivoire, était pour cette raison appelée « chryséléphantine ». Ne parlons pas du piédestal imaginaire sur lequel ce bourrage de crâne l'a incitée à monter.
Et le pauvre (quoique richissime) comte de Fontaine son père, a beau organiser dans son hôtel les fêtes les plus somptueuses et les bals les plus courus de la capitale, aucun des plus riches, des plus nobles et des plus prestigieux des jeunes gens qui viennent plier le genou devant elle n’a l’heur de retenir son attention. Elle, ce qu’il lui faut, c’est un jeune homme à particule antique, mais surtout qui soit « pair de France ». Elle n’en démordra pas.
On a compris, c’est la vanité qui guide l’esprit de la jeune femme. Elle n’a pas de mots d’esprit assez vifs pour décourager les téméraires qui brigueraient son suffrage sans avoir rempli au préalable le cahier des charges rédigé par ses soins. Elle s'en mordra les doigts jusqu'au cœur.
Heureusement, son père, héros de la guerre de Vendée, à cheval sur la question d’honneur et fidèle au trône légitime jusqu’au-delà du raisonnable, a réussi, au retour du roi, à rétablir sa fortune, que la Révolution avait anéantie : ses autres enfants, filles et garçons, ont été « placés » mieux que bien, même s’il a fallu faire des concessions à l’époque, concernant le prestige de la particule : M. de Fontaine, toujours réaliste et pragmatique, sait que l’époque veut que l’argent et la "position" précèdent la particule. Reste sa fille Emilie, qu’il aimerait tant caser.
Arrive l’été des vingt-deux ans d’Emilie de Fontaine. La famille, comme tous les Parisiens dignes de ce nom, se réfugie dans ses terres campagnardes. Pour M. de Fontaine, c’est à Sceaux que ça se passe. Si le 20ème siècle a mis en vogue le bal musette, Sceaux possédait sous la Restauration une attraction comparable, la populace en moins et la bonne société en plus.
Il s’agit d’un « bal champêtre » hebdomadaire, donné dans un endroit intéressant : « Au milieu d’un jardin d’où se découvrent de délicieux aspects, se trouve une immense rotonde ouverte de toutes parts dont le dôme aussi léger que vaste est soutenu par d’élégants piliers. Ce dais champêtre protège une salle de danse ».
Attention, ce n’est pas le « Balajo » de la rue de Lappe, de célèbre mémoire, où la canaille allait en suer une et frotter son lard à l’autre sexe au son de l’accordéon (« Java, qu'est-ce que tu fais là, entre les deux bras d'un accordéoniste ? ») : « Il est rare que les propriétaires les plus collets-montés du voisinage n’émigrent pas une fois ou deux pendant la saison, vers ce palais de la Terpsichore villageoise, soit en cavalcades brillantes, soit dans ces élégantes et légères voitures qui saupoudrent de poussière les piétons philosophes ». Oui, je sais, la répétition d’ « élégant » d’une phrase à la suivante ternit un peu la jolie trouvaille des « piétons philosophes », mais ne chipotons pas.
C’est là que la jeune Emilie fait la rencontre d’un jeune homme qui ressemble comme deux gouttes d’eau au portrait mental du seul époux auquel elle envisagerait de se donner. Oui, « se donner », parce que j’ai oublié de préciser que le comte de Fontaine, lassé de dépenser des fortunes pour trouver pour sa fille un oiseau aussi rare qu’un merle blanc, a pris une décision qui a pris de court toute la famille : « J’ai laissé ma fille Emilie maîtresse de son sort ».
Le jeune homme en question présente toutes les apparences de la plus haute distinction dans les manières et les attitudes, en même temps qu’il donne une parfaite impression de naturel dépourvu de toute affectation. Emilie commence par le trouver intéressant. Puis elle fait sa connaissance avec la complicité d’un vieux marin aguerri, son oncle l’amiral de Kergarouët, « une vieille ganache d’ultra ».
Invité à dîner dans la famille, le jeune homme, « Maximilien Longueville, rue du Sentier » (c’est sa carte de visite), se comporte à la perfection, à ceci près que personne n’est en mesure de dire vraiment qui il est et ce qu’il fait. Est-il noble ou roturier ? Quel est son "état" ? Sa "position" ? Impossible de se faire une certitude, tant il maîtrise à merveille l’art de l’esquive. Une habileté redoutable.
Cela n’empêche pas les deux jeunes gens de développer l’un envers l’autre un sentiment qui prend bientôt sur leur âme un empire absolu. Ils se le disent, et tout le monde les considère bientôt comme des fiancés. Emilie serait même prête à passer sous silence la roture de Maximilien : « Mais, mon père, il y a de fort bonnes maisons issues de bâtards. L’histoire de France fourmille de princes qui mettaient des barres à leurs écus. – Tes idées ont bien changé, dit le vieux gentilhomme en souriant ». Faut-il qu’elle soit amoureuse ! Mais Balzac n’aurait pas fait une nouvelle si l’histoire d’amour avait fini en bluette. Il lui faut du plus consistant. Tiens, pourquoi pas une petite catastrophe ?
Remarque à l'usage des curieux de symbolisme héraldique, à propos de "mettaient des barres à leurs écus" : les familles nobles prenaient soin de distinguer les lignées directes des « collatérales » ou des « bâtardes », au moyen de signes particuliers comme le « lambel », sorte de couronne inversée et crénelée, ou le « bâton péri en barre » placé au centre de l'écu (ici, on lit "De France (càd d'azur à trois lis d'or, placés 2 et 1, mais ceci va sans dire) au bâton péri en barre").
La catastrophe se produit un jour où Mlle de Fontaine, en compagnie de deux belles-sœurs, sort pour « voir une pèlerine qu’une de leurs amies avait remarquée dans un riche magasin de lingerie ». Horreur ! Qui est assis au comptoir, en train de rendre de la monnaie à une lingère ? Maximilien Longueville : « Le bel inconnu tenait à la main quelques échantillons qui ne laissaient aucun doute sur son honorable profession ». Le sang d’Emilie ne fait dans son cœur qu’un tour de rage glaciale. La rupture est immédiate, et le dernier regard qu’ils échangent est de haine implacable.
Je passe sur quelques péripéties. La déconvenue de la jeune femme est assez cruelle pour lui faire adopter le parti, en désespoir de cause, d’épouser son vieil oncle Kergarouët. Et son dépit atteindra un apogée quand, deux ans après son mariage, dans un vénérable salon de la grande aristocratie du faubourg Saint-Germain, elle entend annoncer le vicomte de Longueville, devenu pair de France après la mort de son père et de son frère aîné : « En ce moment, il apparut à la triste comtesse, libre et paré de tous les avantages qu’elle demandait jadis à son type idéal ».
Bien fait pour elle !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 12 janvier 2014
ALORS ? DIEUDONNé ?
Quatrième et dernier billet, je le jure, consacré aux modestes réflexions que m’inspire le battage médiatique et politique autour du cas Dieudonné. J’ai dit le dégoût que m’inspire l’atmosphère de chasse à l’homme dans laquelle baigne cette affaire. Le dégoût que m’inspirent tous les moralistes (sincères ou non) et tous les calculateurs qui s’efforcent de planter leurs incisives de roquets dans les mollets de la liberté d’expression n'a d'égale que ma répugnance à envisager de réprimer la libre parole.
Je me demande si les instigateurs de cette campagne de chasse à courre, Manuel Valls en tête, se rendent compte que leur volonté de faire taire, à l’inverse de ce qu’ils attendaient, a d’ores et déjà sculpté une belle caisse de résonance publicitaire aux spectacles qu’ils voulaient interdire. S’ils étaient conscients de ce qu’ils faisaient, peut-être après tout est-ce avec l'intention secrète de rééditer le coup de Mitterrand qui, en mettant le pied de Le Pen à l’étrier électoral (1986 ?), voulait fait éclater la droite.
L’antisémitisme en France, à présent. J’ai lu ici et là des interviews de spectateurs ayant assisté dernièrement aux productions du Théâtre de la Main d’or (le théâtre de Dieudonné). Ceux qui pensent qu’ils sont tous antisémites se fourrent le doigt dans l’œil. Ou alors ils mentent effrontément, montés sur un cheval de bataille supposé favoriser d’obscurs projets, à moins qu’ils s’en servent comme d’un énorme moyen de diversion.
De telles mayonnaises médiatiques ne demandent qu’à monter. Il leur suffit pour cela d’un petit coup de pouce au départ. En tout cas, Manuel Valls a réussi, par le surprenant (un euphémisme !) arrêt du Conseil d’Etat rendu jeudi soir, à torpiller proprement le coup de com’ programmé par François Hollande pour « reprendre contact avec les Français » (en Corrèze, je crois).
Je signale à ceux que ça intéresse que Le Monde publie une interview, dans son n° daté 12-13 janvier, du vice président du Conseil d'Etat. Tenez-vous bien, il s'appelle Sauvé. Jean-Marc de son prénom. Il faut le faire. Digne et très droit dans ses bottes, le monsieur, même s'il justifie péremtoirement l'arrêt inique qu'il a rendu précipitamment à l'encontre de Dieudonné. Il enfonce assez bien le poignard dans la poitrine de la liberté d'expression. Ce n'est pas la première fois que la plus haute instance de la juridiction administrative de France exhale cette odeur infecte (on n'y est pas très clair sur la laïcité, cf. crèche Babilou).
Tout cela empeste la cuisine rance, comme si certains avaient intérêt à instrumentaliser la « question juive ». Il faudrait chercher à qui le crime profite. Je ne peux pas m’empêcher de penser que quelqu’un ici me bourre le mou, et ça me chiffonne les boyaux de la tête et l’idée que je me fais de la vérité.
Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que le problème de ce que beaucoup sont convenus d'appeler l’ « antisémitisme », en France (ou ailleurs), et qui ne concerne pour l'essentiel qu'une partie assez bien déterminée de la population, n’a aucune chance de disparaître aussi longtemps que se perpétuera la guerre au Proche-Orient, entre Israéliens et Palestiniens. Et il semble bien que, dans les deux camps, il y ait assez d’allumés, d’exaltés, de fanatiques pour que ça ne s’arrête jamais.
Si les islamistes les plus radicaux (Iraniens, Hezbollah, Hamas, tous chi’ites, et bien d’autres) parviennent à produire dans le concret le « choc des civilisations » redouté naguère par Samuel Huntington, ils pourront rendre grâce aux plus exaltés et fanatiques des juifs orthodoxes, qui orientent les décisions de Nétanyahou (et du Congrès américain) dans le sens le plus rigide et le plus arrogant, et dont les convictions bien arrêtées sont placées sous les signes irréfutables que sont les idées de « peuple élu » et de « Terre Promise ». Quand l’un de ces hallucinés déclare le plus sérieusement du monde que cette terre leur appartient en exclusivité, j’en reste sans voix et sur le cul.
Tant que nul parmi cette collection de cinglés ne sera disposé à partager la terre, le monde méditerranéen dans son entier (et au-delà : le lobby sioniste est très puissant aux Etats-Unis, comme l'ont montré l'arrogance de Nétanyahou à New York et la capitulation d'Obama, resté la queue et la mine basses) restera englué dans la panade de ce conflit, à cause des relais et des réseaux que les ennemis sur le terrain entretiennent hors de leurs frontières.
Au surplus, de moins en moins de gens auront le discernement et le courage de continuer à faire la différence entre antisionisme et antisémitisme, puisque même les exaltés d'Israël donnent l'exemple, en s'empressant d'accuser d'antisémitisme tous ceux qui ont le culot de prendre la défense des Palestiniens et de l'injustice que leur Etat fait régner et développe sans cesse. Brandi au moindre frémissement d'opinion désapprouvant la colonisation de la Cisjordanie, que devient la notion d'antisémitisme ?
Et les pays qui accueillent sur leur sol des immigrés d’origine arabe et leurs descendants auront bien du mal à les convaincre que ce conflit ne les concerne pas : comment les empêcher de ressentir une solidarité avec des gens, de même langue et de même religion, qui subissent la violence de l’obsession sécuritaire et de la folie colonisatrice des Israéliens ? Et ce n'est pas fini. Aux dernières nouvelles, ils veulent même, toujours pour des raisons sécuritaires évidemment, s'approprier toute la vallée du Jourdain.
Sans doute n’est-ce pas la seule cause. Sans doute y a-t-il aussi l’obsession de certains (LICRA, MRAP, CRAN, SOS Racisme, CRIF, par exemple – au fait, pourquoi ne s’appelle-t-il plus le CRIJF ? –, bref « les associations », à l'action souvent délétère) prêts à hurler à l’antisémitisme à la moindre anicroche, souvent à tort et à travers, vidant peu à peu le mot "antisémitisme" de sa substance véritable. A force d'exacerber, au prétexte de la prévention du risque de retour des "années sombres", le sentiment victimaire de la communauté juive, on finira par user la patience compassionnelle de l'opinion publique.
Sans doute y a-t-il le sentiment (exagéré ?) des descendants d’immigrés d’être des citoyens de seconde zone en France, qui renforce leur parallèle avec le sort peu enviable des Palestiniens. Et « peu enviable » est encore trop doux : sans même parler du mur de séparation, des obstacles mis à la libre circulation ou de la confettisation de la Cisjordanie palestinienne, quelqu’un de sensé peut-il admettre les expropriations arbitraires, les destructions d’habitations ou de champs d’oliviers par les colons ou par Tsahal ?
Non, la France n’est pas antisémite. Peut-être est-elle trop « poreuse » à certains produits d'importation que des groupes définis et belliqueux, que je ne me hasarderai pas à désigner, faute d'informations neutres, ont intérêt à y faire circuler. Chacun de ces groupes (soyons clair : pro-palestinien et pro-israélien) tient aux Français un discours insupportable, qui rappelle le chantage auquel s'était livrée l'administration américaine au temps de George W. Bush, qui se préparait à envahir l'Irak sur la base de mensonges gros comme des montagnes.
Ce chantage tient en une phrase simple, trop simple, pour ne pas dire simplette, quoique répugnante d'intimidation : « Qui n'est pas avec nous est contre nous ». Il y a des chances que le succès des spectacles de Dieudonné soit dû à sa façon habile de surfer sur ce climat d'hostilité soigneusement entretenu par les deux parties en présence.
Un seul message à leur adresse : foutez-nous la paix, en la faisant entre vous, et ne nous tabustez plus l'entendement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 11 janvier 2014
ALORS ? DIEUDONNé ?

Ah quel beau journal que Le Monde ! Quels preux journalistes que ceux qui écrivent dans Le Monde ! Et quelle ingéniosité que celle des rédacteurs chargés de formuler les titres des articles du journal Le Monde ! « Dieudonné : le Conseil d'Etat encadre la liberté d'expression ». Farpaitement : « encadre » ! Quel joli mot !

C'est sûr que « porte atteinte à la liberté d'expression », ou « abolit », ou encore pire « assassine » ç'aurait été tendancieux. Vous pensez bien qu'un journal comme Le Monde ne pouvait pas se le permettre. Encore bravo ! Le double tour de prestidigitation est très au point : du chapeau du Conseil d'Etat, le magicien sort un lapin qui a pour fonction, dans un deuxième temps, d' « encadrer la liberté d'expression ».
Enfin, tout ça pour dire que, par principe, je réprouve toute interdiction, tant qu’il s’agit de paroles, d’images, c'est-à-dire de représentations. Je veux dire tant qu’il ne s’agit pas d’actes s’en prenant à la personne physique ou d’injures publiques. Je redoute la confusion entretenue par tous ceux qui, prenant les mots pour des choses, ne tardent pas à en faire des actes. Je redoute les gens qui croient qu'il existe une « violence verbale ». Un pamphlet ne sera jamais un poignard ou un revolver. Condamner quelqu’un pour des paroles qu’il a dites ou écrites est une infamie.
J’ai récemment consacré plusieurs billets au dessinateur Reiser, mort en 1983. Mon arrière-pensée (pas si « arrière » que ça, d’ailleurs) était de montrer le poids du couvercle qui s’est abattu depuis sur la liberté d’expression, et que certains (disons « les associations », dont trop souvent les autorités ne tardent pas à emboîter le pas) s’efforcent de visser définitivement sur la marmite où bouillonne la libre parole.
A propos de « liberté d’expression », j’ai même entendu quelqu’un manifester sa réprobation envers des gens qui défendent Dieudonné « au prétexte de la liberté d’expression ». Comme si la liberté d'expression pouvait servir de prétexte ! Décidément, heureusement que les mots ne sont pas des choses : certains leur feraient dire le contraire de ce qu'ils veulent dire, comme n'importe quel vulgaire Big Brother inventant la novlangue.
Défendre Dieudonné est le cadet de mes soucis. Tout le monde dit qu'il est antisémite. Si c'est vrai, je dirai que c'est idiot, mais que c'est après tout son affaire. J'ai même entendu un journaliste déclarer : « ... un antisémite qui se prend pour un humoriste ». Je me dis que si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Et alors ? Des sociologues renommés (Vincent Tiberj ...) le disent : l'antisémitisme n'est pas un problème en France.
Pour mon compte, j’en reste à l’idée que la liberté d’expression est un droit fondamental. Et ça, ça ne se coupe pas en morceaux, ça ne se négocie pas. Les lois inspirées par une morale quelle qu’elle soit devraient être ressenties comme des insultes. Aussi longtemps que la personne qui parle n’en vient pas à des injures publiques ou à des actes portant atteinte à l’intégrité physique, il est permis de TOUT dire.
Que je sache, Dieudonné n’a porté atteinte à l’intégrité physique de personne. Que ses propos aient des relents nauséabonds, c’est possible. Mais d’une part, est-il prouvé que ceux-ci aient un contenu antisémite ? J'avoue que je n'ai pas cherché à savoir, parce que le problème, selon moi, n'est pas là. Et puis en général, à quelques rares expressions près, les comiques m'ennuient.
D’autre part, tenir des propos, fussent-ils nauséabonds, demeure un droit fondamental. Si l'envie m'en prenait, je tiendrais moi-même des propos nauséabonds. Et je n'aimerais pas qu'on m'en empêche. Il se trouve simplement que l'envie ne m'en a jamais pris. Voilà ce que tous les roquets aboyeurs qui appellent à la censure et à l’interdiction ne supportent pas.
Ils ne supportent pas qu’on leur écorche les oreilles avec des paroles qui blessent leurs convictions. Est-ce que c'est ça, la tolérance ? Au nom de leurs idéaux, il faudrait donc se taire et faire taire ? Ils ne supportent pas d’être incapables d’imposer leur point de vue à des gens qui ne pensent pas comme eux.
Leur rêve : régenter la parole. Introduire la matraque de la police pour régler la circulation des idées. Revêtir d’un uniforme mental gris armé d'un bâton blanc tous les esprits auxquels ils font subir leur propagande exaltée. Leur seul avantage aujourd'hui est d'être du côté du manche, de la force et de la loi. Franchement, le manche, la force et la loi auraient mieux à faire.
Tiens, mon ami R. me raconte qu’un professeur de lycée a porté plainte contre des élèves au motif qu’ils ont eu l’audace invraisemblable de faire le geste de la « quenelle ». Si c’est vrai (?), j’ai bien peur que ce cinglé ne soit pas seul dans sa frénésie policière.
J’imagine ce que donnerait un tel rêve, s’il était appliqué à la création littéraire. Ça a d’ailleurs déjà été fait. Ce n’est pas un hasard en effet si les plus grands écrivains et poètes russes (Maïakovski, Mandelstam, Vassili Grossman, Soljenitsyne, …) du 20ème siècle ne furent pas autorisés à publier leurs œuvres, et que le nom des autres a déjà quitté les colonnes des dictionnaires de littérature. Et je ne parle pas des autodafés allumés en Allemagne en 1933.
Comme Voltaire s’adressant à je ne sais plus qui, je dis à monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala :
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ».
Je ne sortirai pas de là.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, nathalie nougayrède, journalisme, journalistes, liberté d'expression, reiser, critique, société, politique, dieudonné, racisme, antisémitisme, théâtre de la main d'or, quenelle
vendredi, 10 janvier 2014
ALORS ? DIEUDONNé ?

C'EST VRAI, ÇA, IL N'Y A PAS QUE KALACHNIKOV DANS LA VIE, IL Y A AUSSI LE FAMAS
(Explication à la fin)
« Saint Dieudonné ou Deusdedit (6ème siècle). – A Rome où il était cordonnier de son état, il avait eu le futur pape, saint Grégoire le Grand, comme voisin. C’est par lui que nous savons que, chaque samedi, Dieudonné allait porter aux pauvres et aux malades ce qu’il avait économisé durant la semaine à leur intention. » (Omer Englebert, La Fleur des saints, Albin Michel).
Voilà, c'est fait. Monsieur Manuel Valls a obtenu satisfaction : le spectacle de Dieudonné à Nantes a été interdit in extremis et précipitamment par une justice qui donne toutes les apparences d'être à la botte. « Victoire de la République », entend-on tomber de la bouche prétentieuse du ministre franc-maçon. J'ai plutôt l'impression que le ministre a eu la peau d'un homme érigé en ennemi personnel, peut-être pour des raisons de calcul personnel qui ne m'intéressent pas.
Alors l’antisémitisme supposé de Dieudonné, maintenant ? Oui, je sais, il a fait monter Faurisson sur scène, je ne sais qui (Jean-Marie Le Pen ?) est le parrain d’un de ses enfants, et autres fatrasies que j’ignore ou que j’ai oubliées. Il existe, semble-t-il, des « indices concordants », voire, comme on dit dans les enquêtes, un « faisceau de présomptions ». Peut-être. A cela j’ai envie de répondre : « So what ? ». Oui : et alors ? Je ne suis pas policier et, même si je porte des jugements, je ne suis pas juge, puisque je n'en ai pas l'habit.
Excusez-moi si je ne suis pas comme l’ahurissant chroniqueur du Monde Gérard Courtois, qui reprend le refrain : « L’antisémitisme n’est pas une opinion, c’est un délit ». Façon superbe et commode d'effacer d'entrée le contradicteur du paysage, exactement comme les Soviétiques éliminaient des photos officielles les dignitaires tombés en disgrâce. Jolie façon de réécrire l'histoire en la niant.
Une telle phrase illustre exactement ce qu'est un déni de réalité, car si l’antisémitisme est un délit, il n’en reste pas moins, qu’on le veuille ou non, une opinion. Autant dire, à ce moment, que le « grand excès de vitesse », tout en étant un délit, n'est pas un comportement. Ou que le viol, qui est un crime, n'est pas un acte sexuel.
Une opinion, un comportement peuvent parfaitement être délictueux, sans cesser d'être pour autant une opinion et un comportement. Une telle dénégation est purement et simplement idiote. Aucun interdit n'a jamais anéanti son objet de facto. La preuve ? L'envie de meurtre chez le serial killer cesse-t-elle à cause de l'interdit légal censé le dissuader ?
Et le violeur sait exactement le risque qu'il prend en agressant sa proie. La loi freine le passage à l'acte et dissuade ceux qui contrôlent à peu près leurs pulsions (et qui n'ont le plus souvent pas besoin de la menace légale pour ne rien commettre d'illégal), mais ne saurait abolir le délit. Elle n'est d'ailleurs pas faite pour ça. Et on le comprend : comment faire pour empêcher les gens de penser ce qu’ils pensent ? Surtout, de quel droit certains s'arrogeraient-ils le droit de le leur interdire ?
La loi devrait être faite pour punir exclusivement des actes. Toutes celles qui ont été faites pour satisfaire la « sensibilité » de telle communauté, de telle minorité, de tel groupe, pour quelque motif que ce soit, sont des lois infâmes. En particulier, celles qui punissent de simples paroles : les motifs pénaux inventés pour rassasier les appétits de vengeance des clientèles minoritaires des partis politiques avides de bulletins de vote, comme « incitation à la haine raciale », « négationnisme » et autres joyeusetés, sont à considérer comme des infamies.
Une telle liste, appelée à s'allonger perpétuellement (« homophobie, sexisme, islamophobie, machisme, ... », pourquoi cela s'arrêterait-il ?), est un nœud coulant passé au cou de la liberté. Le lynchage en est l'aboutissement logique, mais armé du sceau de la légitimité officielle. Ce sont autant de bombes à retardement où le législateur fou a mis la haine à mijoter, en espérant qu'elle n'explosera pas de son vivant. « Après moi le déluge » semble être le raisonnement de ce grand courageux. Nous verrons ce qu'il en est aux prochaines élections.
Appelons les choses par leur nom : l’antisémitisme, selon la loi française, est un « délit d’opinion », vous savez, ce scandale dénoncé en son temps par Voltaire en personne : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire », phrase souvent citée, phrase ô combien fondatrice, mais de plus en plus mise à mal dans la pratique, dans le pays même où est née la belle idée de « tolérance ».
Imaginez un beau « débat démocratique », où l’on donnerait la parole à un seul orateur. Ah oui, ça aurait de la gueule. Et écoutez-la, la clameur publique ! Unanime ou presque ! Je ne sais pas vous, mais moi, l’unanimité, ça me fout la trouille. Reniflez bien : l’unanimité laisse exhaler des relents d’Union Soviétique, de Politburo et de Commissaire du peuple, à l'époque bénie où les artistes étaient sommés, par Jdanov et sa clique, dans toutes leurs démarches créatrices, de se soumettre à la loi du Parti, qui ne respirait et ne chantait que l'air du « réalisme socialiste ». L'artiste qui refusait d'entrer dans le moule était forcément un ennemi du peuple.
Toutes proportions gardées, regardez, dans le Vie et destin de Vassili Grossman, le représentant du Parti qu’on a collé dans les basques des soldats qui se battent héroïquement à Stalingrad, et qui ne craint pas d’envoyer un de ces héros à la Loubianka se faire broyer par la machine KGB pour des motifs de non-conformité. On n’en est pas là, et Dieudonné n’est sûrement pas un héros. Mais la mentalité écœurante qui appelle à interdire ses spectacles n’est pas si éloignée que ça.
De même que la loi et les forces qui vont avec n’empêchent pas la drogue (voir hier) de se vendre et de s’acheter, de même la loi ne saurait empêcher un antisémite d’être antisémite. Le problème, me semble-t-il, est peut-être logé dans le fait qu’il y a des antisémites chez nous. Je regrette cette présence, mais je doute que quiconque soit en mesure (je me répète) d'interdire à qui que ce soit de penser ce qu’il pense.
Et d’abord, je demande que les bonnes âmes bien de chez nous et bien confites dans le sucre unanime du moralisme le plus conforme fassent un petit détour par les discours tenus au vu et au su de tous dans beaucoup de journaux du Proche-Orient, appelant aujourd’hui même à l’éradication de l’Etat d’Israël, voire à l'extermination des juifs. Nul ne peut nier cet antisémitisme.
Ensuite, le problème, si je regarde seulement ce qui se passe en France, je demande qu’on se demande s’il est bien normal et acceptable que certains (appelons-les « les associations ») veuillent contrôler ce qui se passe dans l’esprit des « gens », et s’érigent en gourdins mâtinés de guillotine pour assommer et décapiter toutes les têtes qui « pensent mal » au motif que « c’est pas bien » de penser ce qu’on pense. Si je ne suis pas d’accord avec Untel, de deux choses l’une : je discute ou je me barre. Je ne suis pas Commissaire du Peuple.
Ce qui me fait peur dans l’ambiance actuelle, du genre « les chiens sont lâchés », c’est ce que souligne Elias Canetti dans Masse et puissance : la meute, dernier stade avant la formation d’une « masse ». Dans les moments les plus forts de l’application du « plan Vigipirate », l’omniprésence d’uniformes de policiers et de militaires armés dans les lieux publics ne m’a jamais rassuré, bien au contraire. Rien de tel pour instaurer un vrai climat de peur.
Enfin, tant qu’ils gardent l’index posé bien droit sur le pontet de leur FAMAS, en prenant bien soin de ne pas effleurer la queue de détente. On ne sait jamais, un mauvais coup est si vite parti (le 5,56 NATO a une vitesse initiale de 1300 m/s, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut faire dans une gare bondée).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dieudonné, manuel valls, quenelle, antisémitisme, racisme, journaux, journal le monde, gérard courtois, omer englebert, la fleur des saints, jean-marie le pen, marine le pen, bleu marine, faurisson, négationnisme, voltaire, vie et destin, vassili grossman, kgb, loubianka, elias canetti, masse et puissance, plan vigipirate, société, france, politique, union soviétique, stalinisme, réalisme socialiste
jeudi, 09 janvier 2014
ALORS ? DIEUDONNé ?

« Saint Dieudonné ou Deusdedit (6ème siècle). – A Rome où il était cordonnier de son état, il avait eu le futur pape, saint Grégoire le Grand, comme voisin. C’est par lui que nous savons que, chaque samedi, Dieudonné allait porter aux pauvres et aux malades ce qu’il avait économisé durant la semaine à leur intention. »
Ce portrait d’un saint homme se trouve à la page 261 de La Fleur des saints. On est prié d'attendre le 10 août pour dire à tous les Dieudonné : « Ça va être ta fête ! ». L’auteur inoubliable de cet inoubliable ouvrage se nomme Omer Englebert, qui ne se serait jamais permis de vouloir le faire publier s’il n’avait obtenu, de prime, le « Nihil obstat » de Pierre Médebielle S. C., daté de Jérusalem le 23 décembre 1979 et, de seconde, l’ « Imprimatur », toujours à Jérusalem, mais de la main du patriarche Jacques Joseph Beltritti, le 26 décembre suivant. Ah, Dieudonné, mes bien chers frères !
La France était un beau pays. Un pays normal, quoi. Un pays comme tout le monde, et même mieux : un modèle. « La patrie des droits de l’homme », on disait. Eh bien je vais vous dire : tout ça, c’était un conte de Noël, une jolie fable. Il est possible que le 11 septembre 2001 soit passé par là, qui avait déjà rendu folle la démocratie américaine de George W. Bush, qui avait commencé à enterrer la dite démocratie (Patriot Act, Guantanamo, …).
Peut-être aussi que les gens en ont assez, de la liberté. Comme le prêche le Grand Inquisiteur d’Ivan Karamazov, la liberté produit dans le cœur de l’homme une inquiétude de tous les instants, et il n’a de cesse que de se débarrasser de ce fardeau encombrant qui l’oblige à décider lui-même de son sort comme un aveugle choisit sa route, aux pieds de l’Autorité (ou du « Guide Suprême »), attendant de celle-ci, avant toute chose, qu’elle le rassure en prenant sur elle l’angoisse qui accompagne nécessairement une décision prise en toute liberté.
C’est peut-être sur ce raisonnement (mais Dostoïevski se trompe-t-il tant que ça ?) que s’appuie monsieur Manuel Valls, haut dignitaire franc-maçon (démissionnaire du Grand Orient aux dernières nouvelles, pour vous dire si je suis bien informé) et ministre, pour interdire à Dieudonné de se produire en public. C’est Marguerite Duras, me semble-t-il, qui voulait ériger un « barrage contre le Pacifique ».
S’il me prenait l’idée saugrenue de contester la légitimité de la circulaire Valls, je comparerais volontiers le combat contre le racisme et l'antisémitisme avec la lutte contre le trafic de drogue. Ben oui, je trouve que ce n’est pas sans analogie, si on y réfléchit deux minutes. Héroïne et cocaïne sont des fléaux, on est d’accord. C’est la raison pour laquelle des armées de lois, de juges et de policiers sont déployées pour empêcher les trafiquants de trafiquer. Avec l’efficacité que l’on sait : est-il certain que cet énorme (et horriblement coûteux) dispositif répressif parvienne à mettre la main sur plus de 10 % de la « marchandise » ?
Les conséquences sont connues en même temps qu’innombrables et fatales : gangstérisation, par exemple, de certains quartiers « défavorisés » (voir la banalisation de la kalachnikov à Marseille) ; montée des prix proportionnée à la difficulté d’approvisionner le marché ; enrichissement invraisemblable de quelques seigneurs de la drogue quasiment aussi riches que des Etats : Pablo Escobar avait en son temps proposé au gouvernement colombien de payer l’intégralité de la dette extérieure du pays en échange de l’impunité ; création de véritables petites armées capables de tenir tête aux forces militaires et policières d’un grand pays (le Mexique) ; installation et pérennisation de circuits économiques parallèles carburant à l’ « argent sale », et soucieux de passer les sommes astronomiques engrangées dans de grandes lessiveuses, avant d’en inonder le marché (par exemple immobilier) ; etc.
Tout ça pour arriver à quoi ? La drogue continue à arriver par « go fast » audacieux, par camions entiers, par bateaux aux cales pleines, par avions de ligne se posant en plein Sahara, par caravanes de Touaregs vaguement alliés à des terroristes islamistes qui acheminent les produits d’importation du sud vers le nord. Moralité ? Pas de moralité évidemment. Impossible d’arrêter le flux, tant qu’il sera possible d’acheter des complicités dans les rouages mêmes des Etats. Pourtant il faut une moralité : l’interdiction entraîne beaucoup d’effets néfastes. Rapporte-t-elle des bénéfices ? Rien n’est moins sûr.
Voilà ce que je dis, moi.
Alors, Dieudonné maintenant ?
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dieudonné, quenelle
mercredi, 08 janvier 2014
8 BALZAC : LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE
Si Honoré de Balzac, dans La Paix du ménage, raconte une réconciliation conjugale obtenue grâce aux savantes manœuvres d’une vieille aristocrate rompue à toutes les intrigues, La Maison du Chat-qui-pelote, en revanche, examine comment, après la naissance d’une passion amoureuse entre deux jeunes gens égaux en sentiments, mais de classes sociales très différentes, après la concrétisation conjugale de cette passion, celle-ci boit la tasse et se noie au bout de quelques années de bonheur. Comment un couple que tout semblait unir indissolublement fait-il pour se désagréger impitoyablement ?
L’histoire commence rue Saint-Denis, devant une maison très particulière, « une de ces maisons précieuses qui donnent aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l’ancien Paris ». Une maison à colombages (comme Balzac ne dit pas, mais : « ... aux X et aux V que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales ... ») qui, à tout point de vue, est une vivante preuve d’antiquité, autrement dit de stabilité et de solidité.
Je dis « à tout point de vue » parce que monsieur Guillaume, patron de la boutique, autrefois premier commis de monsieur Chevrel, a pris la succession de celui-ci en épousant sa fille, et qu’il n’y a pas de raison que ça s’arrête. On a l’impression que les mœurs familiales sont léguées avec le bâtiment, avec une impression d’éternité, de permanence et de transmission. Il faut que ça se sache : on est ici dans le Commerce. C’est-à-dire qu’on est sérieux de père en fille et de beau-père en gendre.
Le monsieur Guillaume (portrait ci-dessus) de l’histoire ressemble à la fonction qui est la sienne depuis toujours : « La figure de M. Guillaume annonçait la patience, la sagesse commerciale, et l’espèce de cupidité rusée … ». Si la maison « Guillaume, successeur de Chevrel » a une belle renommée de solidité sérieuse et de sûreté en affaires, c’est qu’elle est tout à fait immobile. Je veux dire que Balzac offre ici une vision du Commerce tel qu’il doit être s’il veut avoir des chances de durer.
Le portrait de la famille Guillaume est à cet égard impitoyable, et l’on sent qu’il y a du vécu dans la peinture qu’il en fait. On ne saurait inventer sans l’avoir vue l’énergie de cette application déployée quand il s’agit de compter, de mesurer, de faire un inventaire et d’aligner des chiffres dans les colonnes d’un registre.
Le sérieux en affaires est incompatible avec des choses telles que la rêverie, l’amour ou la gratuité de l’art. Être sérieux, cela suppose d’avoir constamment l’attention fixée sur la notion de quantité. Un homme sérieux est tout entier orienté vers le concret et le matériel de la vie, et cela depuis le premier temps de l’éducation, comme on le constatera en suivant les destins respectifs de Virginie et Augustine Guillaume.
Elles sont en effet « éduquées » dans le seul et unique but de perpétuer l’entreprise familiale : tout ce qui se rapporte à l’imagination n’existe tout simplement pas, et ce qui est certain, c’est que tout ce qui ressemble à de l’amusement ou même simplement au plaisir d’être en vie n’a pas droit de cité chez les Guillaume.
Ce qui va les différencier, et plus tard les séparer, c’est le hasard, en la personne de Théodore de Sommervieux, vicomte de son état et, pour ne rien arranger, artiste peintre de talent. Le malheur d’Augustine a voulu que, passant devant l’antique maison, il a aperçu les yeux angéliques de la jeune fille, et que cela a suffi pour qu’il en tombe éperdument amoureux, au point de faire d’elle un portrait d’une si grande qualité que les responsables du Salon l’exposent sans barguigner.
Il a au surplus peint la scène familiale du repas du soir, qu’il a observée de la rue. Deux toiles qui font l’admiration de la foule des visiteurs de l’Exposition, et qui valent à Théodore les louanges du grand peintre Girodet (mort en 1824, soit six ans avant la publication : rien ne vaut de mêler un peu de réel à la fiction pour lui donner corps et vraisemblance).
A force de ruse et d’intrigue (madame Roguin), Théodore parvient à se faire admettre chez les Guillaume et, comme bien l’on se doute, il finit par épouser sa dulcinée. Le couple vit d’abord dans une sorte d’ivresse amoureuse, un bonheur vaporeux et léger planant sur un nuage rose. Un fils vient bientôt matérialiser ce bonheur éthéré, auquel, pendant une année entière, Augustine va consacrer tous ses soins assidus.
Et puis voilà, c’est la vie conjugale, on s’habitue, on se lasse, et c’est là que la vérité des différences initiales, irréductibles parce que situées à l’origine, vient semer sa perturbation dans le bonheur sans nuage de cet homme et de cette femme. Elle n’a aucune culture, aucune repartie dans la conversation qu’on tient dans les salons parisiens. Elle finirait, s’il continuait à sortir en sa compagnie, par porter sur lui l’ombrage de ses limites intellectuelles et de la maigreur de ses connaissances esthétiques.
Quant à lui, il était très « lancé dans le monde », avant de s’amouracher de cette boutiquière, fille de boutiquier. Il est donc logique que, au moment où le sentiment tiédit et où le désir se refroidit, il ai ait envie de nouveau de voir ses anciens amis d’atelier et ses anciennes connaissances de salon. Or, comme chacun sait, tous ces gens s’entendent à merveille sur le dos des « sentiments vrais » et des « attachements durables ».
Les yeux de Théodore de Sommervieux se décillent donc soudain, après le trop long sommeil de sa raison, pour se réveiller au bord du précipice de la bêtise d’Augustine, dans lequel il est hélas tombé. Mais pour mieux se relever, quand il se reprend à respirer l’oxygène de son atmosphère naturelle.
Quand Augustine prend conscience de son infortune, il est évidemment trop tard. Elle aura beau avoir l’audace de défier sa rivale en amour, la « duchesse de Carigliano », au sujet de laquelle elle a reçu d’une amie « quelques avis méchamment charitables », elle sera vaincue par le désamour qui a gagné son Théodore. Après s’être amèrement et inutilement plainte auprès de sa sœur Virginie et de ses parents, elle meurt à vingt-sept ans.
Virginie ? Elle se porte à merveille. Monsieur Guillaume, au moment de prendre sa retraite, a agréé la demande en mariage formulée auprès de lui par Lebas, le premier commis, qui est devenu son successeur. L’obstination concrète et mesurable du Commerce a aisément triomphé des vapeurs et des mirages des sentiments humains.
Balzac raconte ce qu’il a appris de l’âme humaine. Et ce n’est par forcément gai. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’on puisse tirer une règle morale de cette histoire. Même si tout ça paraît bien pessimiste, je crois que pour Balzac, le monde est comme il est. Il faut le prendre ainsi. Ou alors se flinguer.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 07 janvier 2014
7 BALZAC : LA PAIX DU MÉNAGE
Le troisième volume de l’édition complète de La Comédie humaine parue au Cercle du Bibliophile recueille une douzaine de nouvelles de dimensions variées. J’avais déjà évoqué la première, dont le titre espagnol – El Verdugo (« Le Bourreau ») – indique assez, sinon une volonté d’exotisme, du moins un souci de « couleur locale ».
Pour en rappeler brièvement la teneur, je dirai juste que cela se passe pendant la guerre de Napoléon en Espagne, dans le château du marquis de Léganès, « hidalgo » distingué en même temps que « grand d’Espagne ». Un détachement français est proprement massacré par les partisans, sauf un jeune officier qui parvient à s’enfuir (prévenu par la fille de la maison qui l'a trouvé mignon).
La vengeance du général « G…t…r » est terrible : la famille entière est condamnée à mort. Mais dans un sursaut de bonté sadique, il accorde au noble vieillard la survie de son nom à travers son fils, à condition que celui-ci se fasse le bourreau de tous les siens et leur coupe la tête. Court récit sec, net et violent, dramatique et spectaculaire. Un coup droit dans l'estomac.
Bien loin de cette ambiance intense de sang, de larmes et de frissons, La Paix du ménage nous introduit dans un grand salon parisien, au cours d’un bal prestigieux donné par un grand personnage de l’Empire (on est en 1809), le « citoyen Malin » devenu comte de Gondreville, sénateur et ami de Napoléon. C’était l’époque où, écrit Balzac, « l’engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie, et concorda trop bien aux vues de l’empereur pour qu’il y mît un frein ». La phrase sent son épigramme rétrospective. Peut-être aussi un regret pour un temps qu'il n'a pas connu.
Dans la foule formée par cette somptueuse et splendide société, et après avoir établi tout le cadre historique et social, Balzac braque le lorgnon du lecteur sur quelques individus choisis, entre lesquels l’intrigue est savamment circonscrite, et qui, s’observant mutuellement avec une attention qui a quelque chose de sauvage, sauront interpréter le moindre des regards des autres protagonistes pour en tirer des conclusions sur les intentions des uns et des autres et sur l’état de leurs relations. L'évocation de ces regards dans le récit est en soi un petite merveille de mise en scène romanesque.
Deux amis, le baron Martial de la Roche-Hugon et le général Montcornet font le pari d’être chacun le premier à mettre dans son lit une femme mystérieuse, très belle quoique très mélancolique, restée à l’écart près d’un candélabre, avec toutes les apparences de la tristesse, voire de la souffrance. Personne ne semble la connaître.
Le baron est l’amant en titre de Mme de Vaudremont, l’une des plus belles femmes de Paris, jeune et belle veuve d'un militaire mort bravement, dont le plus grand souci est de n’apparaître, pour faire contraste, qu’au moment du bal où les autres femmes ainsi que leurs toilettes apparaissent déjà un peu fatiguées.
Elle semble s’intéresser à un autre militaire, le général comte de Soulanges, soit par jalousie (elle surprend son amant Martial empressé auprès de la belle inconnue), soit par inclination (le monsieur a de la prestance). Mais sur le conseil avisé de la duchesse de Lansac, vieille renarde rusée (« volpa astuta », comme dit Leos Janacek) des salons parisiens, qui fut, dit-on, maîtresse de Louis XV, elle se laisse détourner de l’amant en titre, informations désobligeantes à l’appui (« Il a des dettes »), pour s’intéresser, si elle veut du « solide », à Montcornet.
Puis la vieille duchesse se débrouille pour se faire raccompagner chez elle par Soulanges, qui se révèle n’être autre que le mari de la belle inconnue, qui s’apprêtait à brûler spectaculairement la cervelle de La Roche-Hugon, qui, à son goût, serre son épouse d’un peu trop près pour être honnête. Mais il n’en aura pas le temps, et qui plus est, sa crainte est infondée, puisque sa femme n’est venue (incognito) à cette soirée que pour reconquérir son époux volage en suscitant sa jalousie.
Et quand elle rentre chez elle, après avoir repoussé les avances du piètre La Roche-Hugon, au moment où elle pénètre dans sa chambre, elle est très surprise et bien heureuse d’y trouver son mari installé qui, sans doute sermonné par la vieille Lansac, juge plus sage de se réconcilier avec sa femme. « Tout est bien qui finit bien », comme il est dit à la fin du Trésor de Rackham le Rouge (c'était juste pour ça, l'illustration du début).
Une magnifique nouvelle, toute en subtilité, du jeune Balzac. Un bel exercice d’observation du monde, et une intrigue assez ramassée pour que la construction, sans une once de gras, en paraisse aussi savante qu’économe en moyens. Suprême habileté du futur grand romancier. Délectable d'intelligence.
Moralité : il faut lire Balzac.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la comédie humaine, la paix du ménage
lundi, 06 janvier 2014
DESSINER DU TAC AU TAC

Puisque j’ai évoqué hier la vieille émission de télé de Jean Frapat, Tac au tac, j’ai eu envie d’en dire un mot. La raison en est que l’éditeur Balland avait publié en son temps un volume, sobrement intitulé Tac au tac, consacré aux traces laissées par les cinquante (tout de même) rencontres de dessinateurs de BD sur un plateau de télévision, aux fins d’en découdre à la façon des jazzmen « faisant le bœuf » entre eux, une fois le turbin en club expédié. Je trouve que le terme de « jam session » conviendrait assez bien à ces confrontations.

"PROPOSITION" DE PEYO
Le principe est d’une simplicité angélique, même s’il peut être soumis à des variations dues aux circonstances, à la disponibilité des gens et à la concordance des agendas.

"PIEGES" TENDUS PAR ROBA, FRANQUIN ET MORRIS
L’un des invités est désigné volontaire pour amorcer le débat, je veux dire pour proposer un dessin simple qui servira de support et de base de lancement à la fusée des imaginations. Par exemple, le producteur propose un motif : trois points alignés horizontalement.

LES "PARADES" TROUVEES PAR PEYO
Alexis imagine une tête humaine à trois yeux, trois bouches et six oreilles ; Gébé voit un vampire à trois dents qui vient de les planter dans le cou d’une fille ; pour Fred les trois points sont autant de bouts de cigarettes à allumer à un chandelier à trois branches, et Gotlib se prend pour Lucky Luke : une main tenant un pistolet fumant a laissé dans la palissade du fond trois trous inquiétants. Seul le manque de place motive ici l’absence d’illustration.

LE POINT DE DEPART, C'EST MORRIS
On peut commencer par regarder (voir plus haut) le schtroumpf proposé par Peyo au trio formé de Roba (Boule et Bill), Franquin (Gaston) et Morris (Lucky Luke), chargés de tendre un piège au gnome bleu.

REPLIQUE DE ROBA
Et l’on jettera un œil amusé sur les parades trouvées dans l’instant par Peyo pour sauver sa trouvaille, les schtroumpfs, apparue, je le rappelle, dans La Flûte à six schtroumpfs.

LÀ, C'EST FRANQUIN
Je passerai sur le duo formé par Gébé (L’An 01) et Claire Bretécher (Cellulite, Les Frustrés), qui n’est pas inintéressant, mais … Je m’intéresserai à une drôle d’aventure appelée « escalade ». Elle consiste en une série de seize interventions successives de quatre compères : les mêmes Morris, Peyo, Franquin et Roba.

ETAT INTERMEDIAIRE
Je laisse de côté quelques épisodes de ce match merveilleux : seize images, ça ferait vraiment beaucoup. Je me contente de la séquence initiale, d’un état intermédiaire et du résultat final. Au lecteur sourcilleux de reconstituer en partant de la fin la totalité des phases de cette compétition amicale.

RESULTAT FINAL APRES QUINZE PASSES DU BALLON
Je me permets encore de trouver merveilleuse l’idée de Jean Frapat de confronter entre eux des virtuoses du crayon, et de persister dans l’idée qu’elle a quelque chose à voir avec tout ce que je préfère dans le jazz : l’interaction « en temps réel » (comme on dit aujourd’hui) entre les idées des musiciens (les trios de Keith Jarrett, Ahmad Jamal ou Brad Mehldau), de préférence aux grosses machines (Count Basie, Duke Ellington), où toute la musique est écrite par un arrangeur, et que les musiciens n'ont plus qu'à exécuter.
C’est l’idée formidable d’un bonhomme, Jean Frapat, désireux de voir se produire un événement sous ses yeux, par la grâce de la rencontre de quatre dessinateurs talentueux. Quatre jazzmen virtuoses du crayon qui ont du plaisir à s’amuser ensemble, dans des jam sessions détendues et stimulantes.
Toute une époque !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, tac au tac, ortf, editions balland, humour, bande dessinée, bd, peyo, schtroumpfs, roba, boule et bill, franquin, gaston lagaffe, morris, lucky luke, gébé, bretécher, la flûte à six schtroumpfs, bd cellulite, les frustrés, keith jarrett, ahmad jamal, brad mehldau, jazz, jam session, faire le boeuf, count basie, duke ellington

