mardi, 07 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE
A présent que j’ai bien déballé et commenté les photos que je portais dans mon sac avec une bonne partie de ce qui allait avec, je peux bien passer aux aveux : j’aime les photos des grands photographes. Pas toutes, pas toujours, pas forcément. De toutes façons, qu'est-ce qu'on dit, quand on dit « J'aime la photo » ? Alceste répondrait : « L'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait ». Tout le monde a ses préférences, d'abord parce que c'est bien "normal" et "humain", ensuite parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Enfin, quand je dis "tout le monde", ce n'est pas vrai. Don Juan est l'exception. Il n'a pas de préférences ! Il les veut toutes ! Leporello chante à Dona Elvira : « Non si picca se sia ricca, Se sia brutta, se sia bella, Purche porti la gonella, Voi sapete quel che fa » (Riche, laide, belle, peu importe : pourvu que ça porte un jupon, vous savez ce qu'il fait). C'est dans l'air "du catalogue". Quelle absence de goût ! Un aristocrate si raffiné !
En matière de femmes, Don Juan est dépourvu de préférences : on n'est pas plus niais, ni plus rustre. Ah, ça vous fait penser à Nafisatou Diallo ? Au Fond Monétaire International ? A trois consonnes initiales (dont l'une vaut cher au scrabble) désormais passées à la postérité pour des raisons tellement poétiques ? « Voi sapete quel che fa », on vous dit.
Chez Molière, ce n'est pas mieux : « Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre; et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses ». Heureusement, personne n'est Don Juan, quoi qu'en pense la psychanalyse. Ceux qui veulent tout finissent très mal. La préférence est dans la nature de l'homme. Or la préférence c'est la liberté ; or être libre, c'est choisir ; or choisir c'est éliminer ; or éliminer, c'est Contrex. Euh non ! Erreur d'aiguillage. Je prie le monde civilisé de m'excuser. Je reviens à la photo.
Je suis donc un admirateur inconditionnel de photos qui ont été réalisées par des gens qui portent à bon droit le titre de "grands photographes". Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai : ce n'est pas le nom du bonhomme qui tire mon attention du sommeil, c'est un objet précis, une photo particulière. Je ne sais pas comment font les gens, mais moi, je privilégie certaines images qui sont à mes yeux dotées de la parole. A mes yeux, mais surtout aux oreilles de mon esprit : des photos qui s'adressent à moi, ce qui n'est pas le cas, loin de là, de toutes les photos d'un même bonhomme.
Entendons-nous : pas à moi en exclusivité, mais des images qui me parlent, me disent quelque chose à moi. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais rien ne permet de penser que mon cas est unique. Alors, au fil du temps, je me suis constitué un album, j'ai rassemblé une anthologie de clichés qui, plus que d’autres, tendent la main à mon esprit, à ma sensibilité, à mon histoire, quoi encore ?
A présent que j’ai découpé mon gâteau personnel en les vingt-huit parts qui viennent de paraître, je voudrais partager avec qui voudra quelques images qui ont compté pour moi. Le visiteur repèrera aisément au fil et au hasard des pages (j’ai opté pour l’ordre alphabétique), parmi les photographes présents, le fou de peinture, le graveur, l’architecte, l’ethnographe, le paysagiste, et toute cette sorte de choses.
Certains photographes, certains clichés sont très connus, d’autres beaucoup moins. Il y a de la couleur et du N&B. Il y a des femmes, des paysages, des scènes, des moments. Il y a des « anciens » et des « modernes » : mon désaccord est total avec cet étrange ami qui me déclarait, péremptoire et monté sur ses ergots, que les photographes d'aujourd'hui sont infiniment et fatalement meilleurs que les anciens. Il n'y a pas de progrès en art. Mais je ne sais pas si nous parlions de la même chose.
Je n’en tire aucune conclusion.

ANSEL ADAMS, 1947
L'album qui vient est précaire. Ce n'est pas le même que celui que j'aurais constitué avant-hier ou après-demain, car s'il y a des constantes, il y a aussi des variantes, en plus ou en moins. Je les livre sans commentaire. Parmi les constantes (que l'habitué de ce blog reconnaîtra, car j'ai déjà donné), il y en a une à laquelle je prête un pouvoir tout à fait spécial. Celle-là, je la commenterai peut-être le moment venu. Pour cela, il faudra attendre la lettre K de l'alphabet (le 26 octobre, pour être précis).
Un délai raisonnable.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alceste, le misanthrope, molière, mozart, don juan, don giovanni, leporello, dona elvira, nafisatou diallo, dsk, dominique strauss-kahn, fmi, ansel adams
vendredi, 15 août 2014
LE LIEVRE DE PATAGONIE 4/4
 Le titre du livre, pour finir. L’auteur tente d’expliquer l’incongru de la formule avant de poser le point final. J’avoue que j’ai beau écarquiller les yeux, je n’arrive pas à discerner les contours des raisons de ce choix. Et pourtant j'essaie.
Le titre du livre, pour finir. L’auteur tente d’expliquer l’incongru de la formule avant de poser le point final. J’avoue que j’ai beau écarquiller les yeux, je n’arrive pas à discerner les contours des raisons de ce choix. Et pourtant j'essaie.
Claude Lanzmann est un « passionné » congénital. Il a un impérieux besoin de se sentir en parfaite adéquation avec ce qu’il fait. Il a un impérieux besoin de ressentir, d’éprouver intimement le « vrai » de la situation où il se trouve. Un « vrai » capable de justifier pleinement sa présence en ce lieu à ce moment. Et tant qu’un certain déclic ne s’est pas produit, il a l’impression d’avancer en aveugle dans sa vie. De ne pas "y être" complètement.
Je suis d'accord avec ce besoin d'authenticité, mais je dirai qu'après tout, ça le regarde : ce lièvre patagon-là exprime l'émoi particulier de l'auteur dans une circonstance qui lui appartient. Il n'apporte rien de significatif au lecteur parce qu'au fond c'est un lièvre gratuit. Un cheveu sur la soupe si vous voulez.
Lanzmann évoque le déclic qui s'est produit sur la « piazza del Duomo » de Milan, où il s’est mis à réciter à voix haute le début de La Chartreuse de Parme. Il évoque le même déclic, de façon beaucoup plus forte, par la façon dont lui est venue l’idée des images de Treblinka pour Shoah : « Il y a eu, à Treblinka, l’ébranlement hallucinant, aux conséquences sans fin, déclenché par la rencontre d’un nom et d’un lieu, la découverte d’un nom maudit sur les panneaux ordinaires des routes et de la gare, comme si rien, là-bas, ne s’était passé ». Que vient donc faire le lièvre, face à un tel choc ?
Certes, on croise des lièvres, au cours du récit. Son pare-chocs n’en tue que trois au cours d’un voyage nocturne (Serbie ?), sur les dizaines qui traversent les faisceaux de ses phares (à la différence du lièvre qui bondit en travers, le lapin, lui, quand il voit les phares, se met à courir le long de la route). Il observe les animaux qui franchissent en toute insouciance les barbelés de Birkenau. Mais son choix se porte sur ce lièvre aperçu, là encore de nuit, non loin d’El Calafate, dont il parle à la page 192.
Il affirme, dans la conclusion du livre : « …me poignardant littéralement le cœur de l’évidence que j’étais en Patagonie, qu’à cet instant la Patagonie et moi étions vrais ensemble. C’est cela, l’incarnation » (p. 546, antépénultième et pénultième phrases du livre). Bon, moi je veux bien, ce lièvre qui poignarde le cœur. J'espère, je veux bien croire que l’éditeur n’est pour rien dans le choix de la Patagonie, parce que : « C’est un titre qui pète, ça, coco ! ». Car ce lièvre n’occupe dans la réalité du livre et de la vie (racontée) de Claude Lanzmann qu’une toute petite lucarne à peine visible. Disons que ce sont des "hors-champ". Mais pourquoi pas ?
Le titre du film, c'est autre chose. L'auteur raconte à la fin du Lièvre de Patagonie (pp. 525-526) comment et pourquoi il a choisi ce mot de la langue hébraïque : « Le terme apparaît dans la Bible à plusieurs reprises. Il signifie "catastrophe", "destruction", "anéantissement", il peut s'agir d'un déluge, d'un tremblement de terre, d'un ouragan. Des rabbins ont arbitrairement décrété après la guerre qu'il désignerait "la Chose". Pour moi, "Shoah" était un signifiant sans signifié, une profération brève, opaque, un mot impénétrable, infracassable. Quand Georges Cravenne, qui avait pris sur lui l'organisation de la première du film, voulant faire imprimer les bristols d'invitation, me demanda quel était son titre, je répondis : "Shoah". - Qu'est-ce que cela veut dire ? - Je ne sais pas, cela veut dire "Shoah". - Mais il faut traduire, personne ne comprendra. - C'est précisément ce que je veux, que personne ne comprenne ». On me dira ce qu'on voudra, cette intention est proprement géniale.
Je veux dire qu'elle se place à la hauteur du crime : l'extermination d'une race, aucun mot humain ne peut la signifier. Même si le mot est aujourd'hui devenu un nom propre, passé tel quel dans le langage (pour Lanzmann, le film en est de toute évidence à l'origine), mais plus ou moins galvaudé, utilisé par les uns et les autres, tour à tour, comme bouclier, comme étendard, comme arme, voire comme image de marque.
Ce que je ne comprends pas, pour achever le parcours, complexe parce que contrasté, dans ce livre généreux, d’une richesse bourrée jusqu’à la gueule, c’est la raison pour laquelle le film a été refusé par beaucoup de Juifs. Lanzmann raconte ça : c’est comme si le film se heurtait à un tabou. Et pour moi, c'est un mystère. Et c'est l'étonnement de l'auteur.
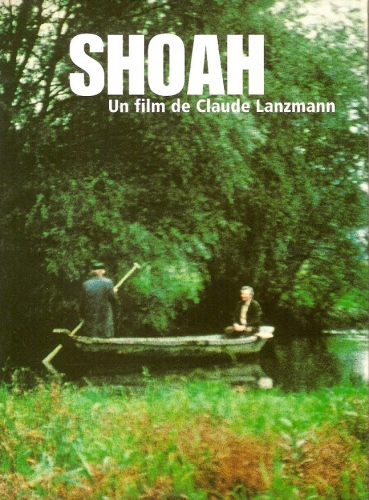
Simon Srebnik rejoue à 47 ans, pour Claude Lanzmann, la scène de ses treize ans. Il chante la même chanson (un petite maison blanche). Il dit, en parcourant paisiblement le site de Chelmno, où fut expérimentée l'extermination des Juifs par le gaz : « C'était aussi paisible à l'époque qu'aujourd'hui ».
Car chez beaucoup de Juifs, d'après Lanzmann, le refus est total et spontané. Si absolu que beaucoup d’entre eux n’ont même pas pu envisager de visionner Shoah. Comme si un mur sacré s’était tenu devant eux pour leur en interdire l’accès. Même que le cardinal Lustiger, grand Catholique mais Juif à l’origine, a joué devant l’auteur la comédie : « Je l’ai vu ! », avant d’avouer lamentablement que cela ne lui était vraiment pas possible.
Il y a là quelque chose qui me reste en point d’interrogation : que se passe-t-il, là, précisément ? Peut-être est-ce, tout simplement, insoutenable.
Ce qui me vient alors, c'est une scène au début du film. C'est vrai qu'on est frappé par le visage obstinément souriant de Michael Podchlebnik, comme s'il l'avait figé en y appliquant un masque. Il s'est comme cuirassé dans son sourire, ouvert sur ses dents impeccables. Mais Claude Lanzmann est impitoyable : « Pourquoi souriez-vous toujours ? – Si on est vivant, il vaut mieux sourire ». Mais il poursuit, cruel : « Quand vous étiez dans le Sonderkommando, quelle a été votre réaction ? – Un jour, j’ai reconnu le cadavre de ma femme et de mes enfants, et là … ».
La tête, soudain, de Michael Podchlebnik, quarante ans après !
La décomposition du sourire de Michael Podchlebnik !
Les sanglots de Michael Podchlebnik, ! …
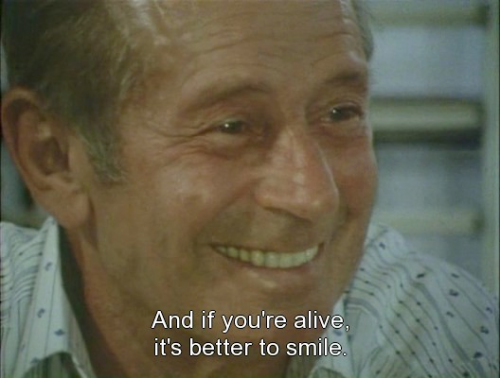
Je comprends que ce ne soit pas possible, là où ma raison s’arrête.
Vous voulez que je vous dise ? Le film Shoah, de Claude Lanzmann, est la version contemporaine du Mur des Lamentations : le vestige d’un Temple détruit. Et c'est Claude Lanzmann et nul autre qui l'a édifié, ce vestige.
Et Le Lièvre de Patagonie, en racontant concrètement comment le cinéaste est finalement parvenu, après douze ans de démarches de toutes sortes, à bâtir ce monument, en donne une idée d'une force irrésistible. Toute cette partie du livre est parcourue d'une profonde et puissante vibration, imposant un sentiment d'oubli de soi, d'urgence et de nécessité impérieuse. Tout cela emporte le lecteur.
De ces « Mémoires » de Claude Lanzmann, c'est décidément ce que je retiendrai, loin devant tout le reste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, shoah, juifs, judaïsme, extermination des juifs, solution finale, camps d'extermination, auschwitz-birkenau, sobibor, maidanek, chelmno, treblinka, la chartreuse de parme
jeudi, 14 août 2014
LE LIEVRE DE PATAGONIE 3/4
 Mais le plat de résistance et le point culminant de tout le livre est certainement le récit des innombrables tribulations, péripéties, émotions et souffrances qui ont jalonné la conception puis la réalisation de ce que Claude Lanzmann considère (à juste titre selon moi) comme l’œuvre de sa vie : Shoah.
Mais le plat de résistance et le point culminant de tout le livre est certainement le récit des innombrables tribulations, péripéties, émotions et souffrances qui ont jalonné la conception puis la réalisation de ce que Claude Lanzmann considère (à juste titre selon moi) comme l’œuvre de sa vie : Shoah.
En 1985, Jean Daniel (Le Nouvel Observateur) lui dit, le soir après la première projection du film (« film sans cadavre, sans aventure individuelle ») enfin achevé après cinq ans de montage : « Cela justifie une vie ». Je ne suis pas loin d'être d'accord.
Au fond, tout le livre est écrit pour aboutir à ce moment décisif (un moment qui a quand même duré douze ans) : un film de neuf heures dix minutes fait de tous les souvenirs des derniers témoins oculaires de l'extermination des Juifs, membres des Sonderkommandos, survivants, SS gardiens des camps ou ayant appartenu aux Einsatzgruppen (auteurs de ce qu'on appelle - improprement selon Lanzmann - la "Shoah par balles"). Une entreprise colossale que Claude Lanzmann a menée à bien contre vents et marée. Si les collaborateurs et techniciens divers sont nombreux, sa volonté à lui est absolument centrale : il s'est fixé cet objectif, il s'y tiendra. Il s'y est tenu.
Il nous fait entrer dans les coulisses, nous décrit les obstacles, nous dresse des portraits remarquables, tels que ceux d’Abraham Bomba, de Simon Srebnik, de Henrik Gawkowski et d’autres. Je regretterai tout de même que l’auteur n’essaie pas d’exposer davantage les liens de causalité entre Shoah et le reste de sa vie, qui n’a pas forcément préparé le lecteur à cette épreuve finale.

Henrik Gawkowski remonte dans la machine à vapeur qu'il conduisait quarante ans avant, et refait le même chemin vers le camp de Treblinka (600.000 Juifs). Henrik Gawkowski ne supportait de faire alors ce qu'il faisait que grâce aux doses massives de vodka qu'il s'envoyait.
J’avoue que cette partie – la plus intense – m’a définitivement conquis, même si l’auteur n’explique rien à proprement parler. Mais il fait mieux que ça : il montre. Et ça, je le dis, il sait faire. Chapeau bas, monsieur Lanzmann. Il amène le lecteur au cœur de son sujet, dans un récit dont le suspense n'est pas absent.
Il nous montre toutes les ruses qu’il lui a fallu déployer pour approcher, amadouer et apprivoiser ceux qui pouvaient et devaient lui servir de témoins dans son œuvre sur l'extermination. La Destruction des juifs d’Europe est le titre exact du monumental livre-phare de Raul Hilberg. Il a servi de Nord à la boussole que Lanzmann a posée sur sa carte de travail cinématographique, quand il a eu l’idée inouïe de faire un film avec les gens de l’époque même où les faits s’étaient déroulés. Les derniers témoins oculaires.
Il raconte surtout – et c’est l’essentiel – ce qui se passe au fond de ces hommes, en particulier ceux qui faisaient partie des « Sonderkommandos » (qui devaient extraire les cadavres des chambres à gaz), à partir du moment où ils sont conduits à évoquer l’inévocable, à dire l’indicible : l’horreur. Très fort ! Ces témoins se mettent à exister, puissants de vérité, au moment où l'innommable surgit de leur mémoire, formulé par leur bouche : quelque chose en eux, soudain, se brise.
Il raconte comment il a amené Abraham Bomba, l’ancien coiffeur revenu des camps, à faire semblant de couper les cheveux à un copain dans un vrai salon de coiffure, en Israël, pendant qu’il se confiait à la caméra. Il raconte comment il a amené Simon Srebnik, qui avait treize ans à l’époque, à lui chanter la chanson qu’il chantait pour le SS dans la barque à fond plat qu’il poussait sur les eaux de la Ner, aux abords de Chelmno, le camp où fut expérimentée l’extermination par le gaz (400.000 juifs, je reprends les chiffres de l'auteur).
Il raconte aussi l’imposture : pour intégrer à son film le témoignage d’anciens SS, comme il n’arrivait à rien en y allant sincèrement et de bonne foi, il décide d’utiliser une caméra cachée (la « paluche », reliée sans fil à une régie installée dans un minibus banalisé), ce qui lui permet de recueillir les confidences de quelques-uns (Franz Suchomel).
Cette ruse manque de lui causer les pires ennuis avec la justice allemande, sans compter le cassage de gueule qu’il a subi, à cause de ses amis qui, du fait de la chaleur, avaient ouvert la porte du minibus : les propos enregistrés clandestinement s’entendaient dans la rue, ce qui avait alerté les voisins et la famille ! Tant pis pour le témoignage de cet ancien chef des Einsatzgruppen !
Je ne reviens pas sur le mal que j’ai dit des récits de vie. J'insiste : il n’y a pas de vies exemplaires, chacun devant se démerder avec ce qui lui a été donné. Le Lièvre de Patagonie comporte des parts non négligeables d’autobiographie. Je m’en serais passé sans problème. Encore une fois, que m’importent les amours d’un monsieur avec une dame, s’appelât-elle Simone de Beauvoir ? Que m’importent les louanges que les uns et les autres ont adressées à monsieur Lanzmann pour ce qu’il écrivait (sur le curé d’Uruffe, par exemple) ?
La preuve, c’est que, visitant le cimetière du Montparnasse, je me suis bien volontiers incliné sur la tombe d’Honoré Champion, je me suis récité avec dévotion « Le Mort joyeux » sur la tombe de Baudelaire (« Dans une terre grasse et pleine d’escargots, Je veux creuser moi-même une fosse profonde… »), mais je n’aurais pour rien au monde fait le plus petit détour par la tombe de ce couple infernal, dont le nom divinisé continue de nous brasser et empuantir l’air du temps : la tombe de « SartretBeauvoir », symbole - paraît-il - de la « Modernité ».

Je regrette vivement que les deux soient omniprésents dans le livre, comme le montre l'index des noms (ci-dessus) qui complète le récit.
Un saint patron pour les libraires et les éditeurs.
Le Lièvre de Patagonie a donc été conçu et voulu pour être un récit de vie. J’y vois pourtant quelque chose de plus et de mieux qu’une vie particulière : une forme, à mes yeux, d’incarnation de l’Histoire (grand H). Le Lièvre de Patagonie est un livre où s’incarne jusque dans la chair rouge et vivante de l’homme la volonté de la vie de vaincre l’Histoire. C’est-à-dire la Mort.
Je veux dire que, pour Claude Lanzmann (enfin, comme je l’ai compris), l’humanité peut se rendre maîtresse de son destin. Personnellement, j’en suis beaucoup moins sûr : c’est une forme d’idéalisme. Et d’idéalisation de la liberté. Mettons que je ne suis pas du tout sartrien. Encore moins « sartretbeauvoirien ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, shoah, jean daniel, le nouvel observateur, extermination des juifs, sonderkommandos, einsatzgruppen, shoah par balles, simon srebnik, abraham bomba, henrik gawkowski, raul hilberg, la destruction des juifs d'europe, chelmno, sobibor, treblinka, auschwitz-birkenau, maidanek
mercredi, 13 août 2014
LE LIEVRE DE PATAGONIE 2/4
 J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.
J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.
Je passe sur les divers événements auxquels l’auteur est confronté. Ce qui est sûr, c’est que le père, juif, a remarquablement organisé la vie et la survie de sa famille pendant toute la période, puisqu’elle en est sortie entière et bien vivante. Cela passe par exemple par les exercices minutés auxquels le père oblige ses enfants pour échapper à une éventuelle rafle en se réfugiant, dans le plus grand silence et le plus vite possible, dans la cache qu’il a aménagée au fond du jardin, à n'importe quelle heure de la nuit. Le père sait. Curieusement, la suite et la fin du bouquin l'escamotent : qu'est-il devenu ?
On apprendra que la mère a pris le père en haine au moment même de la nuit de noce. En juive orthodoxe et sourcilleuse, elle n’a pas supporté que son époux la sodomise, précisément cette nuit-là. Les enfants reverront leur mère (flamboyante quoique bégayante, sauf quand elle est en colère), qui vit désormais avec un certain Monny, juif fils d’un banquier bulgare ou serbe, à l’esprit brillantissime, à l’entregent époustouflant.
Il savait convaincre un Eluard et quelques autres de la bande de manuscrire leurs poèmes à tire-larigot pour les vendre sans cesse aux amateurs d'autographes (mais les surréalistes, Tzara en tête, avaient déjà pillé les collections nègres du Musée de l'Homme). Quelques figures vraiment intéressantes parsèment ainsi le récit. Lanzmann sait à merveille raconter, tirer le portrait, ne retenir que l'essentiel. Pour tout dire : Lanzmann sait ce qu'écrire veut dire.
Passons très vite sur toutes les parties de ce gros ouvrage (546 pages !) où Lanzmann raconte ses relations avec Jean-Paul Sartre, personnage qui me rebute radicalement. Passons sur la puissante relation amoureuse qu’il entretint avec Simone de Beauvoir, ce soleil de la « condition féminine » (un soleil qui me glace), avec laquelle il vécut sept ans, aventure dont il raconte quelques épisodes, en particulier dans les montagnes suisses. Passons sur l’activité de l’auteur au sein de la célèbre revue Les Temps modernes, fondée par Sartre. Je passe finalement sur beaucoup de choses, qui m’ont moyennement intéressé.
Je m’arrête un instant sur la première cohorte de visiteurs occidentaux en Corée du Nord, dont il fait partie, et sur ce qui la sépare de la seconde vingt ans plus tard. Vingt ans qui permettent à Lanzmann, stupéfait, de voir à l’œuvre le processus de glaciation et de régression de la société nord-coréenne.
Autant la première fois cela grouillait de monde et il avait pu, malgré l’espionnite aiguë qui sévissait déjà, ébaucher une histoire d’amour avec la belle Kim Kum-Sun, qu’il n’oubliera plus par la suite, autant la seconde fois il atterrit dans un désert humain où il se sent carrément ligoté. L'étrange comédie des scènes de piqûres de vitamine par la belle infirmière sous le regard omniprésent de six ou sept « casquettes », est à ne louper sous aucun prétexte. Vingt ans après, c'est devenu absolument sinistre.
Tout au moins jusqu’au moment où il révèle à ses interlocuteurs qu’en fait ce n'est pas la première fois, et qu'il est venu vingt ans auparavant et qu'il a même partagé à trois reprises le repas de leur « Grand Leader », l’immense Kim Il-Sung, père fondateur de la patrie. Alors là, coup de théâtre et changement à vue : c'est comme si Dieu en personne apparaissait ! Tout d'un coup c'est courbette, sourire et tapis rouge. La gloire, quoi.
Je passe sur les activités de l’auteur pendant la guerre d’Algérie, sauf que je tiens à signaler l’excellente analyse qu’il fait de la situation. On exalte en effet la « guerre d’indépendance » des Algériens contre l’infâme puissance coloniale (c'est nous, la France), mais on oublie en général qu’il y eut une lutte féroce pour la conquête du pouvoir, lutte impitoyable et fratricide entre Algériens, suivant qu'ils étaient « de l’intérieur » ou « de l’extérieur », ceux-ci réfugiés en Tunisie. Qui s’achève sur la victoire totale de ces derniers, menés par un Ben Bella sans pitié.
Une authentique guerre civile meurtrière entre Algériens, qui explique pourquoi l’Algérie n’est pas encore une démocratie : la guerre civile rougeoie encore sous la cendre. Un semblable accaparement de l'Etat par un seul clan explique selon moi le chaos meurtrier qui s'est instauré après la mort de Tito en Yougoslavie, de Khadafi en Libye, de Saddam Hussein en Irak, en attendant le Bachar de Syrie et quelques autres : quand le chat despotique n'est pas là, les souris carnassières se déchaînent les unes contre les autres, et ça, ça fout vraiment la merde. Regardez les effets de l'obstination de Nouri Al Maliki à s'approprier l'exclusivité du pouvoir à Bagdad.
Je passerais aussi sur la complexité des relations entre Claude Lanzmann et l’Etat d’Israël, si elles n’étaient pas déterminantes pour toute la dernière partie du livre. L’auteur ne cache pas que l’Etat d’Israël repose sur un mensonge, comme il le constate au spectacle des milliers de tentes du camp de réfugiés où les Israéliens ont fourgué tous les juifs séfarades accourus en Israël parce qu’on leur y promettait un sort enviable. Les Falachas d'Ethiopie ne connaîtront pas un sort plus enviable à partir du milieu des années 1970.
Le mensonge encore : « Comme le dirait vingt ans plus tard dans mon film Pourquoi Israël Léon Rouach, conservateur du musée de Dimona : "Mentir, ce n'est pas bien, mais le pays, qui venait lui-même de naître, était gravement menacé. Pour le construire, il fallait le remplir et pour le remplir, il fallait mentir !"» (pp. 224-225). Déjà cette puissante et imperturbable volonté de conquête. Et déjà cette négation, totale et inentamable, de la légitimité historique de la présence arabe en Palestine : c'est comme si l'Arabe n'existait pas.
Et puis le meurtre : « Ben Gourion était impressionnant, comme Begin, mais le premier était le vainqueur de l'autre puisqu'il n'avait pas hésité à faire tirer sur l'Altalena, le navire qui, l'Indépendance à peine prononcée, amena sur les côtes d'Israël, outre des passagers, des armes pour l'Irgoun. Ben Gourion ne pouvait tolérer un double pouvoir et s'étaient résolu à ce que des Juifs en tuent d'autres, acte fondateur de la naissance d'un Etat véritable» (p. 237).
Il y a du Lénine (celui qui fusille les marins de Cronstadt en 1921) chez Ben Gourion (et le Ben Bella de l'indépendance algérienne n'a rien à lui envier). Et la fondation de l’Etat d’Israël est issue entre autres des actes terroristes et des assassinats commis par l’Irgoun dès avant la 2ème guerre mondiale. Terrorisme israélien contre terrorisme arabe : ça n'a pas changé depuis 1937 (bien avant la décision de l'ONU).
Quelques remarques qui permettent de comprendre que la situation au Proche-Orient et le conflit entre Arabes et Israéliens ont encore l'éternité devant eux pour que la paix - à laquelle tout le monde dit aspirer - n'arrive jamais.
Je note que l'état de guerre remonte à l'époque où des Juifs se sont persuadés que leur "Terre" était là, depuis des temps à les attendre, "Promise" par on ne sait qui. Ils s'appelaient les sionistes, qui obéissaient à la logique : « Pousse-toi d'là que j'm'y mette ! ». Le sionisme seul est à l'origine de la guerre en Palestine. Il se trouve que tous les sionistes se trouvaient être des Juifs. C'est encore le cas.
En décidant, avec le consentement de presque toutes les nations (ONU), de constituer un Etat en Palestine, les Juifs sionistes ont déclaré aux Arabes une guerre qui ne peut pas connaître de fin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, deuxième guerre mondiale, juifs, extermination des juifs, shoah, tristan tzara, surréalisme, paul éluard, jean-paul sartre, simone de beauvoir, revue les temps modernes, corée du nord, kim il sung, guerre d'algérie, ben bella, état d'israël, david ben gourion, palestine, guerre israélo-palestinienne, terrorisme, terre promise
mardi, 12 août 2014
LE LIEVRE DE PATAGONIE 1/4
Claude Lanzmann : Le Lièvre de Patagonie (Gallimard, 2009).

Pour parler franchement, je n’avais pas du tout l’intention de lire Le Lièvre de Patagonie, de Claude Lanzmann. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Il se trouve que, passant un matin devant la vitrine du « Livre à Lili », rue Belfort, je l’ai vu bien en évidence, et au prix imbattable de trois euros, s’il vous plaît, au lieu de vingt-cinq vendu neuf. Comme dit le futur "parrain", dans Le Parrain 2 : on me faisait une offre que je ne pouvais refuser. Pas le pistolet sur la tempe, quand même. Neuf, le bouquin l’était, je suis prêt à parier qu'il n’avait jamais été ouvert. Je n’ai pas hésité trois secondes. Je n’ai pas regretté mes trois euros.
J’avais un préjugé : les apparitions médiatiques controversées, tonitruantes et péremptoires de l’auteur m’avaient fait fuir. J’avais eu en son temps un préjugé analogue à l’égard de Michel Houellebecq qui, en suscitant des "pour" enthousiastes et des "contre" furibards qui s'étripaient en place publique, m’avait rebuté, avant que je franchisse le pas un jour avec Les Particules élémentaires, livre qui m’avait convaincu que son auteur était un authentique et excellent romancier. Du genre qui a tout compris de la société où il vit et de celle qui s’annonce. Et puis qui sait l'écrire pour le faire passer. Et qui, à cet égard tout au moins, me fait penser à Balzac.
Pareil pour Lanzmann : le personnage public, qui ne se privait pas d’intervenir avec véhémence quand on parlait des Juifs ou d’Israël, m’avait fait fermer les écoutilles. Quand la rumeur publique dépasse un certain nombre de décibels médiatiques, je n'y suis plus pour personne, je me mets aux abonnés absents. En plus, quand j’ai ouvert le bouquin, je dois dire que je n’ai pas été encouragé.
Le personnage, encore lui, a quelque chose d’assez déplaisant : que m’importe à moi, qu’un haut gradé de la chasse israélienne propose à monsieur Lanzmann de faire un tour sur le siège passager d’un F16 ? Et que monsieur Lanzmann, pourtant âgé de soixante ans, en sorte frais comme l’œil et sans avoir rempli de vomi le sac fourni à cet effet, mais de respect l’officier ébahi, sous les applaudissements du tarmac entier ?
Que m’importe que Claude Lanzmann ait fait ceci, cela, et encore ça et ça et ça ? Rien à faire du fatras biographique, où l’auteur « en installe » complaisamment. Mais c’est vrai que ça me saoule très généralement, le déluge de « vies des autres » dont les médias nous submergent. Car il n'y a pas de vie exemplaire. Au point que je me demande pourquoi l'on nous bombarde de confitures biographiques en nappes denses sur des tartines épaisses comme ça.
Ce ne sont que « portraits » dans Libération et Le Monde, ce ne sont que « talk shows » radiophoniques, où un animateur complaisant (Marcel Quillé-Véré sur France Musique, entre autres) déroule le tapis devant l’invité, avec une dévotion plus ou moins fabriquée, en vue de lui faire raconter les mille péripéties de son existence évidemment passionnante. Je ne parle pas de la télévision, qui passe son temps à étaler des vies intimes, ni du genre « biopic », qui envahit le cinéma des rangs serrés de toutes ses Edith Piaf, de tous ses Ray Charles et de tous ses Truman Capote.
Le récit de leur petite vie par de petits comédiens, de l'écriture de leur premier roman par des premiers romanciers, du couronnement de leur œuvre quand il s'agit de Jean d'Ormesson (notez que son dernier est toujours le couronnement de son œuvre), ou même de leur grande carrière par de grands pianistes, à qui l’on demande de raconter par le menu comment ils ont fait pour arriver là, ça finit par saturer l’espace. Et ne dit strictement rien de l'œuvre pour laquelle ces VRP de leur propre image sont en « tournée de promo ». Et rien, à plus forte raison, de ce qui en restera.
Je suis même d’avis que cette inflation de « vies des autres » dans les médias a pour effet de tenir en respect, d’intimider les gens genre « monsieur tout le monde », à la masse desquels j'appartiens, mais dont il ne viendrait l’idée à aucun journaliste de solliciter une interview approfondie. Selon les journalistes et les directeurs d'antenne, il y a les vies intéressantes, et puis il y a toutes les autres, qui s'appellent "la plupart". Ou encore mieux : « La foule des anonymes ». Tout ça a pour effet de convaincre tous les « monsieur tout le monde » que la vie qu’ils vivent, non, ce n’est pas ça, « la vraie vie ». On les a convaincus que la vraie vie, c'est quand ils ont pu se voir à la télé. Comme une preuve officielle.
A force de voir que tant de gens ont « réussi leur vie », puisqu’on leur fait l’honneur de leur demander de la raconter à un public ébloui, chacun n’est-il pas tenté de se dire que la sienne est ratée ? De se dire que tant qu'il n'a pas raconté sa vie à la télé, il n'existe pas ?
A force de s’intéresser à la « vie des autres » (tout au moins ce qu’ils en montrent ou en disent), pour un peu, on oublierait qu’on a une seule vie à vivre pour son propre compte, et qu’il n’y a personne pour la vivre à notre place. Et que la télévision a été inventée pour nous faire oublier cette tragédie. Avec soi-même, on est constamment "en direct". Et il n'y a pas de "rewind". Revenons à nos moutons.
Dès l’avant-propos du bouquin de Lanzmann, on est prévenu : « Il est vrai, on m’a dit mille fois, de mille côtés, que je devais à tout prix écrire ma vie, qu’elle était assez riche, multiple et unique pour mériter d’être rapportée ». Que ce soit clair : tout le monde s'y est mis, à genoux : « Claude, allez, raconte ta vie ! ». Monsieur Lanzmann a cédé à des instances plus fortes que lui qui, à force d’insister, sont venues à bout de sa réticence à parler de lui-même. Sans ça vous pensez bien que …
Et attention les yeux : « J’en étais d’accord, j’en avais le désir, mais après l’effort colossal de la réalisation de Shoah, je n’étais pas sûr d’avoir la force de m’attaquer à un travail de si grande ampleur, de le vouloir vraiment ». Il est d'accord pour considérer sa propre vie comme infiniment digne d'intérêt. Et elle est d'une "si grande ampleur" ! Qu’on comprenne bien : monsieur Lanzmann n’a jamais été effleuré par le doute, ce qui ne me prépare pas à éprouver une grande sympathie pour lui. La force de son moi est incommensurable. Heureusement, le monsieur n'est pas du tout porté au narcissisme. C'est un qualité essentielle du livre : pas d'étalage.
Pourtant on pourrait le croire quand il affirme : « Je me tiens pour un voyant ...» (p. 285). Heureusement, son hommage à Moby Dick de Melville (p. 254) m'avait prévenu en sa faveur. Mais on comprendra peut-être que le bonhomme puisse susciter des réactions pour le moins "contrastées", génial pour les uns, insupportable pour les autres. Pour moi, c'est les deux à tour de rôle.
Voilà ce que je dis, moi.
lundi, 11 août 2014
L'ARBRE BARBARE
L'ARBRE BARBARE,
ou "ILS L'ONT BIEN MÉRITÉ, CE NE SONT QUE DES SAUVAGES"
Je réchauffe aujourd’hui, en l'améliorant j'espère, un billet (alors intitulé « La Galéjade absolue ») publié le 16 juillet 2013. Pour une raison simple : je l’avais trouvé trop désopilant pour en priver les lecteurs de ce blog. On se moque volontiers des fantaisies farfelues rapportées par les voyageurs du moyen âge européen, et des bestioles fabuleuses qu’ils avaient "observées", dont on trouve le dessin, par exemple dans Aldrovandus, la Chronique de Nuremberg ou la Weltchronik de Schedel (quelques exemplaires tirés de cette dernière ci-dessous, ma préférence allant aux Sciapodes, qui se servaient de leur pied unique comme parasol, ce qu'ils appelaient "prendre son pied" ; il est vrai que la nature n'était pas exempte de fantaisies comparables, avant qu'il existât le diagnostic prénatal, doux euphémisme mis pour eugénisme : j'en ai quelques-unes en réserve).


On croit en général que les explorateurs des 18ème et 19ème siècles, imprégnés des Lumières du rationalisme, envoyés par la vieille Europe à la conquête concrète du monde, dont une des missions était de le cartographier scientifiquement et de le décrire objectivement, étaient, contrairement aux Marco Polo et autres amateurs de « merveilles », soucieux de la plus grande rigueur et d’une objectivité exacte et sans faille.
Eh bien grossière erreur, comme le montre ce « reportage » paru en 1878 dans Le Journal des Voyages : l’imagination au pouvoir, comme vont le voir ceux qui ne l'ont pas lu l'an dernier.
Le Journal des Voyages est une véritable caverne d’Ali Baba pour l’amateur de curiosités diverses et variées. Pour qui, par exemple, n’a jamais entendu parler de « l’arbre anthropophage », il est plus que temps de combler cette lacune. L’histoire nous est contée par Bénédict-Henry Révoil, sous un « chapeau » indiquant « Souvenirs de Madagascar ». Cela se présente donc comme un témoignage personnel. Quelque chose de vécu.
L’auteur commence par nous planter dûment le décor. Nous sommes chez les Sakataves (on connaît les Sakalaves, côte ouest de Madagascar, voir ci-contre une "maternité"), l’une des trois races peuplant l’île de Madagascar, île – soyons toujours précis – mesurant « 132 myriamètres du nord-est au sud-ouest » et « 54 myriamètres de l’est à l’ouest ». La définition du myriamètre donnée par le Nouveau Larousse Illustré de 1903 est : « Mesure itinéraire de 10.000 mètres. Peu usité ».
chez les Sakataves (on connaît les Sakalaves, côte ouest de Madagascar, voir ci-contre une "maternité"), l’une des trois races peuplant l’île de Madagascar, île – soyons toujours précis – mesurant « 132 myriamètres du nord-est au sud-ouest » et « 54 myriamètres de l’est à l’ouest ». La définition du myriamètre donnée par le Nouveau Larousse Illustré de 1903 est : « Mesure itinéraire de 10.000 mètres. Peu usité ».
Vient ensuite un petit morceau de bravoure (citation au point de suspension près) : « Les Sakataves ont la peau noire et les cheveux crépus : ils ont conservé tous les instincts, tous les errements de la race africaine à laquelle ils doivent leur origine, c’est-à-dire qu’ils sont ignorants, superstitieux et … anthropophages ». Leurs relations avec les autres populations de l’île sont assez « guerrières ». Et « leur seule religion est celle d’un culte abominable qu’ils rendent à un arbre » : le Tépé-Tépé (voir plus bas : l’illustration surpasse de loin le récit, car il faut frapper d’horreur le bourgeois qui, bien au chaud dans ses pantoufles et son fauteuil, feuillette à la veillée sa revue préférée).
Qu’on se le dise : c’est un « arbre satanique ». Imaginez une énorme pomme de pin de 3 mètres de haut, avec à son sommet un entonnoir (ou « suçoir ») contenant « un liquide visqueux et douceâtre, dont les propriétés sont à la fois morphiques [lisez « hypnagogiques » = somnifères] et intoxicantes ». L’entonnoir est entouré de jeunes pousses, longues et souples (les scions), qui s’agitent « dans une sorte de sifflement fait pour donner le frisson au plus courageux ». Des feuilles complètent le tableau, nerveuses et « terminées par des pointes d’une acuité sans pareille et creuses à l’intérieur », et leurs bords sont hérissés de piquants.
Maintenant l’histoire. Lambo, jeune homme adoré de sa mère, doit monter sur le trône dans pas longtemps. Hélas, sa mère, huit mois après son veuvage royal, met au monde un autre garçon, qui non seulement détrône l’aîné, mais en plus le condamne à mort le jour où il sera roi : c'est la tradition qui le veut. Conseillé par sa mère, Lambo s’enfuit, vit quelque temps à la cour du roi des Howas, mais décide un jour de retourner chez les siens, quels que soient les risques.
Au bout de quelques jours dans le palais maternel, il est dénoncé par un « vieillard très-superstitieux et d’un fanatisme sans pareil ». Les guerriers s’emparent de Lambo : « Tu vas mourir : ta vie appartient à Tépé-Tépé ». « Tout autour de lui, des femmes demi-nues, des Sakataves enivrés, affolés, poussaient des hurlements sinistres et chantaient des hymnes propitiatoires ». On hisse Lambo jusqu’à l’entonnoir, sur lequel on l’assied « au milieu des scions qui s’agitaient déjà autour de sa tête ». Le plus beau est à venir.
On lui fait boire « un peu de ce liquide étrange et sinistre ». « A peine fut-il debout, les deux pieds dans le creux de l’arbre, qu’il se vit entouré par les scions du Tépé-Tépé. Sa tête, son cou, ses bras furent serrés comme dans des étaux de fer ; son corps fut de même enlacé par ces serpents végétaux. » On sent que ça ne rigole ni ne plaisante, y a pas intérêt. Pour le bouquet final, je laisse la parole à M. Bénédict-Henry Révoil.
« A ce moment suprême, les grandes feuilles du Tépé-Tépé se redressèrent lentement, comme les tentacules d’une énorme pieuvre ; venant à l’aide des scions placés autour du cœur de l’arbre, elles étreignaient plus fortement la victime si odieusement sacrifiée. Ces grands leviers s’étaient rejoints et s’écrasaient l’un l’autre, et l’on vit bientôt suinter à leur base, par les interstices de l’horrible plante, des coulées d’un liquide visqueux, mêlé au sang et aux entrailles de la victime. » A votre santé et bon appétit. Mais ce n’est pas fini.

"L'ARBRE ANTHROPOPHAGE : CE FUT UNE EPOUVANTABLE ORGIE"
« A la vue de cet odieux mélange, les sauvages Sakataves se précipitèrent sur l’arbre, l’escaladèrent en hurlant et à l’aide de noix de coco, de leurs mains disposées en creux, recueillirent ce breuvage de l’enfer qu’ils buvaient avec délices. Ce fut alors une épouvantable orgie suivie de convulsions épileptiques et enfin d’une insensibilité absolue. » La crise est passée. Vient la somnolence postprandiale.
La conclusion à elle seule est un morceau d'anthologie : « Lorsque l’arbre anthropophage eut achevé son repas, quelques heures après le moment où la victime lui avait été livrée, il ne restait plus du corps de Lambo que des ossements broyés et des nerfs desséchés. Les grandes feuilles s’étaient détendues, les scions voltigeaient toujours et le cône intérieur de l’arbre rejetait sa liqueur visqueuse, âcre et intoxicante ». Voilà les choses passionnantes qu’on apprend en ouvrant le Journal des Voyages.  On se croirait dans L'Enigme de l'Atlantide d'E.P.Jacobs (je pense à la dionée géante dont Mortimer délivre un ami), ou encore dans Le Rayon U.
On se croirait dans L'Enigme de l'Atlantide d'E.P.Jacobs (je pense à la dionée géante dont Mortimer délivre un ami), ou encore dans Le Rayon U.
On regrettera que le nom de Bénédict-Henry Révoil, ne soit pas passé à la postérité, bien qu'il ne soit peut-être jamais sorti de son quartier de la rue Mouffetard. Il mérite au moins, par la fertilité de son imagination, l’exhumation à laquelle je me livre ici.
Voilà ce que je dis, moi.
Note 1 : je mentionne en passant un autre article du Journal des Voyages (16 juin 1878), qui parle d'un "arbre insectivore" poussant en Australie, lui aussi doté d'une illustration gratinée.
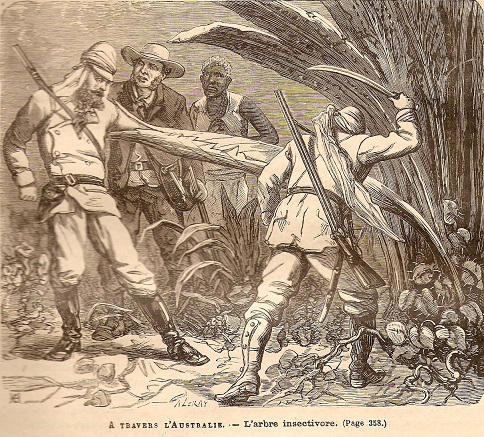
Note 2 : ceux que la question des arbres carnivores intéresse peuvent aller faire un tour sur le site suivant :
http://lostcities.weebly.com/articles/first-post
Ou sur celui-ci (hoax = canular)
http://www.museumofhoaxes.com/hoax/archive/permalink/man_...
On peut aussi taper la requête "man-eating tree of Madagascar".
dimanche, 10 août 2014
C'EST BEAU, UN MASQUE AFRICAIN
Résumé : après une visite à la galerie Ratton, pour la très belle exposition d'objets de Côte d'Ivoire, j'évoquais mon vieil intérêt pour l'art africain.
Il fut des temps et des lieux où le nom de l'individu, de l'auteur, de l'artiste ne comptait pas. Il ne signait pas ses œuvres, se trouvant assez payé d'avoir glorifié Dieu (ou ce qui en tenait lieu) dans son art. D'avoir été au service de quelque chose (n'est-ce pas ça, ce quelque chose d'autre en quoi nous ne savons plus comment nous abolir ?) qui le dépassait. Quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. Mais on ne reconstitue pas une ligue dissoute : c'est devenu un délit. Plus rien ne dépasse l'homme. Cela veut aussi dire, accessoirement, que plus rien ne rassemble les hommes.
De plus, l'objet ethnographique exerçait une fonction "religieuse" ("magique" ?) que les Africains eux-mêmes ont désormais à peu près perdue, malgré la fable du "retour à l'origine" dont on ne cesse de nous rabâcher le refrain baveux, pâteux ou incantatoire. Et malgré les efforts de "survie des traditions" auxquels se livrent de vains militants.
La modernité moderne a décidé d'éradiquer toutes les traditions vivantes, pour les remplacer par de la marchandise brevetée, autrement lucrative. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de le faire. Ne parlons pas des pauvres survivances folkloriques, locales, touristiques et moyenâgeuses, tout ce qui fait croire que ..., élaborées uniquement pour distraire les nostalgiques, en même temps que les ignorants avides de distraire leurs enfants qu'ils ne savent plus comment occuper. Et les Africains aussi, ils savent faire semblant de danser quand il y a des touristes à la peau blanche, et de fabriquer à la demande des « objets africains authentiques » dans des ateliers industriels pour les marchés européens.

Kota (Gabon/Congo Brazzaville) : figure de reliquaire d'ancêtre dite "à front bombé", collection du Gouverneur Honoraire des Colonies Amédée Lefilliatre (1870-1932). Estimé entre 700.000 et 900.000 francs par maître Jean-Louis Picard, pour la vente du mardi 8 octobre 1991 à Drouot Montaigne, Guy Montbarbon expert.
Le reliquaire Kota est un sujet en soi. L'œil averti de l'amateur ne saurait confondre les sujets à "front bombé", les "concaves lamellés" et les figures dites "Janus", entre autres variantes. Mais l'expert est là pour mettre le holà aux errements de l'amateur néophyte.
A quoi servaient les masques ? Les statuettes ? Les fétiches ? Qu'on ne me raconte pas que cela nous fait quelque chose à nous, occidentaux, héritiers des prédateurs qui nous ont précédés et enfantés ! Les prédateurs étaient rationnels, sensibles, matérialistes. Et calculateurs. Et ces amateurs se gargarisent aujourd'hui avec le refrain de l'authenticité. Mais comme nous aussi avons irrémédiablement perdu nos traditions (le « folklore »), nous faisons semblant tout aussi bien.
La documentation précise et sérieuse dont les marchands d'art africain entourent les objets qu'ils mettent en vente servent seulement d'alibi a posteriori à la prédation. Pour dire (blabla) qu'on ne fait pas seulement de la spéculation, mais qu'on porte un intérêt authentique aux populations. Une façon d'inventer la catégorie du prédateur altruiste. Le prédateur altruiste ! Un oxymore de plus. Mais une façon aussi de faire monter les prix : l'authenticité est un gage de plus-value.

Splendide masque Senoufo (Côte d'Ivoire) : masque de danse à configuration humaine stylisée d'ancêtre "Kpélié". Estimé entre 120.000 et 180.000 francs dans le catalogue Ader Picard Tajan, pour la vente du lundi 27 février 1989 à Drouot Montaigne, Guy Montbarbon expert. A noter que les prix des salles des ventes et le chômage ont suivi la même courbe ascendante. Etonnant, non ?
Quant à moi, je persiste à plaider "non-coupable", car ça ne m'empêche pas d'être ému à la vue du remarquable masque Senoufo contemplé à la galerie Ratton ; époustouflé par l'inventivité formelle des sculpteurs ; émerveillé par l'infinie variété de chaque forme aboutie, en ce qu'elle exprime le caractère unique de l'ethnie à laquelle appartient l'artiste.
Rien qu'en Côte d'Ivoire, on ne saurait confondre les objets suivant l'ethnie dans laquelle ils ont été produits, Guéré, Yaouré, Bété, Dan, Senoufo, Baoulé, Lobi, Gouro et j'en oublie. Chacune a une identité forte et bien particulière. Ici, on n'a pas peur d'accuser le plus possible ses différences avec les autres ethnies, bien au contraire.
Ici, pas de consensus mou à la sauce européenne, pas de chewing-gum amorphe, pas de bouillon indifférencié où tout ressemble à n'importe quoi (et inversement), c'est certain. Ce que nous autres oublions tout à fait, c'est que plus s'affirme l'identité, plus s'accuse l'opposition avec les autre. Nous ne savons plus symboliser et socialiser cette hostilité, pourtant logiquement née de la différence.
J'admire donc, même si je ne sais pas exactement pourquoi. Après tout, que le mélomane athée que je suis sache que Jean-Sébastien Bach eut une foi intense et ardente m'est une garantie que sa musique est vraie. Cette certitude me suffit. A plus forte raison, une foi qui s'ignore. Car elle est une vérité qui ne se sait pas foi (à méditer). Les traditions vivantes ignorent qu'elles sont des croyances. Alors je peux bien être touché par les imaginaires magiques (allez-y, chauffez, théologiens et anthropologues !).

Masque Punu (Gabon). Un exemplaire de ce type a été vendu en 2006 à Drouot pour la somme de 950.000 euros (frais compris, faudrait pas abuser).
Et peu me chaut qu'à peu de distance de là existe une autre galerie (Lucas Ratton, ils sont nombreux, dans la famille Ratton, et depuis longtemps, à s'intéresser à l'art africain), où le très beau reliquaire Kota est vendu 28.000 euros, alors que pour acheter l'ancien masque Punu, il faut en aligner 31.000. C'est donné ! Et il y a des acheteurs à ces prix, alors ....
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, art africain, arts primitifs, arts premiers, reliquaire kota, côte d'ivoire, baoulé, guéré, sénoufo, galerie ratton
jeudi, 17 juillet 2014
DU RIFIFI EN LAPONIE 2/2
Olivier Truc, Le Dernier Lapon, Métailié.
L’histoire est celle d’un grand malheur qui s’est abattu autrefois sur un village lapon, du fait même du « trésor » indiqué. Une vague légende rapporte qu’il s’agit d’or. Mais il ne s’agit pas d’or, comme le croit le vieil Olsen, un paysan, petit politicien véreux du coin, impatient de déposer une demande de licence, dans le seul but de s’approprier cette richesse démesurée.

Autant le savoir : les frontières, ici, n'ont aucun sens. Elles n'ont d'ailleurs commencé à exister que lorsque les industriels ont trouvé des ressources pour s'enrichir. Le territoire des Sami transcende les frontières, au point que les trois pays concernés ont créé un corps de police transfrontalier.
J'ai un peu traîné mes guêtres par là-haut, de Tromsø à Kirkenes (à deux pas de Mourmansk, en Russie), et de Narvik à Rovaniemi.
(La carte ci-dessus est celle qui figure dans le livre.)
C’est le géologue Racagnal, un Français, qui révèlera qu’il s’agit d’uranium. La roche est même d'une teneur proprement inouïe. Racagnal est une ordure sans scrupule en même temps qu’un géologue exceptionnel, qui travaille « à l’ancienne » et à l’instinct : il rigole bien quand Kallaway (qu’il surnomme Mickey) arrive en renfort et débarque de l'hélicoptère envoyé en urgence tout un matériel sophistiqué pour ne faire que confirmer ses conclusions.
Mais ce qu’il préfère (et qu'il ne perd jamais de vue), Racagnal, ce sont les filles de quinze ans environ. C'est plus fort que lui. C’est ce qu’a vite compris Brattsen le flic pourri, qui demande à la très jeune et jolie Ulrika d’être gentille avec le monsieur, histoire d’avoir barre sur lui (mais le vieil Olsen garde aussi une coupure de journal relatant un fait divers compromettant arrivé à Alta, où il est question du bonhomme).
L’histoire ? Le tambour lapon (rarissime) a été volé avant que qui que ce soit ait eu le temps de l’étudier, et même de le photographier. C’est un vieux Français qui voulait en faire don au musée local avant de casser sa pipe. Il était très jeune quand il a accompagné Paul-Emile Victor, en 1939, dans une mission d’exploration. Un chaman lapon lui avait fait cadeau de l’instrument.
On apprendra qu’un certain Flüger, géologue de son état, avait trouvé la mort au cours de l’expédition, soi-disant du fait d’une mauvaise chute, en réalité tué par le propre père du vieil Olsen, le paysan-politicien, qui a conservé dans son coffre secret la vieille carte géologique dressée autrefois par Flüger, où figurent les indications permettant de retrouver l’emplacement de l’ancienne mine.
Le problème, c’est que vient s’ajouter à l’histoire le meurtre de Mattis Labba, et que le vieil Olsen et le policier Brattsen font tout pour éloigner les enquêteurs de la piste de la mine, allant même jusqu’à faire destituer par des amis politiques « le Shérif », Tor Jensen, au profit de cet adjoint peu scrupuleux. Heureusement, la patrouille P9, qui comprend Klemet et Nina, garde (secrètement) le nez sur les traces, aidée (secrètement) par l’ancien commissaire. Ils reconstituent patiemment la chaîne en agençant les maillons l’un après l’autre.
La fin a d’autant plus à voir avec l’apocalypse que tous ceux qui participent à l’action convergent vers un point où va bientôt se déchaîner une tempête polaire. Disons que la folie des hommes rejoint la rage de la nature. Disons aussi que la mine n’ouvrira pas. Et que l’auteur ne clôt pas son livre sur un épilogue dressant un bilan général des différents destins croisés au cours du récit : Aslak s’enfonce pour ne pas en revenir dans les solitudes glacées, pendant que Klemet sanglote sur sa motoneige. Les autres, il n'en est plus question. On imagine que tout est rentré dans l'ordre.
Aslak, c'est lui "le dernier Lapon". Considéré par la vieille Berit Kutsi (qui en fut autrefois amoureuse) comme un saint, parce qu’il a épousé Aila malgré le viol subi à l’âge de quinze ans par un prospecteur étranger, qui aimait les filles très jeunes (tiens donc). Enceinte, elle n'a pas pu avorter, alors elle a tué son enfant à la naissance. Elle en est devenue folle, et sa folie consiste à pousser des cris effrayants, et à être dans l'incapacité d'assumer son existence.
Et non seulement Aslak lui est resté fidèle, mais il a tout fait pour préserver, en ce qui le concernait, le mode de vie traditionnel des Lapons, refusant toutes les facilités offertes par la technique moderne, à commencer par le scooter des neiges. Il accepte les hurlements sauvages qu'Aila pousse régulièrement, parfois pendant une journée entière. Mieux : il est aux petits soins pour elle, et l'entoure avec dévotion.
Il lui prépare du feu et des vivres pour huit jours quand il accepte de servir de guide au prospecteur Racagnal. S'il accepte, c'est parce que quand il l’a fait entrer sous sa tente, Aila a reconnu à son poignet la gourmette de l'homme qui l’avait violée jeune fille (avec l'inscription MOSO, pour MinO SolO, l'entreprise qui avait envoyé Racagnal). Mais même sans cela, quand l’autre est arrivé sur son scooter, la première chose qu’Aslak s’est dite, c’est que le Mal en personne venait de faire son apparition. Inutile de dire que les jours de Racagnal sont comptés. Et sa fin, je peux vous dire qu'elle n'est pas piquée des hannetons.
Au total, un livre agencé de main de maître, que le lecteur aurait tort de délaisser à cause de son volet ethnographique. Car l’auteur l’a construit en virtuose : techniquement, le puzzle est irréprochable. C'est du grand art. Il faut cependant surmonter sa répugnance à avaler l’épais documentaire qui alourdit indéniablement le récit. Y avait-il moyen de rendre l’exposé plus fluide, mieux intégré à l’action proprement dite ? Franchement, je ne sais pas.
Olivier Truc frappe très juste en nous emmenant sur la frontière qui nous sépare du monde ancien. Un monde quasiment disparu sous les chenilles d'acier du char de la "modernité" et des artifices de la technique. Si Klemet est le personnage principal, Aslak est un personnage absolument magnifique. Il n'occupe pourtant dans le récit qu'une place assez marginale, mais qui se révèlera cruciale au bout du compte.
Que se passe-t-il dans un individu (Klemet) quand l'acculturation est passée par là, le coupant radicalement du peuple dont il est issu ? Quand il est sans cesse confronté à la présence d'un homme intègre (Aslak), qui lui fait peur parce qu'il n'a jamais transigé sur ses principes, au prix de lourds sacrifices touchant les facilités de la vie offertes par le "progrès" ? Klemet est Lapon, mais il travaille dans la police norvégienne. Il ne vient pas d'une famille d'éleveurs. Il ne connaît pas les vieilles traditions de son peuple. Aslak, contre vents et marées, est resté petit éleveur de rennes, et éleveur « à l'ancienne ». Pénétré de l'esprit de ses racines.
Racines dont Klemet est coupé. D'ailleurs il s'en veut de sa lâcheté. Il s'en veut d'avoir trahi la promesse faite autrefois à Aslak de s'évader en sa compagnie de l'orphelinat. Au dernier moment, il a flanché : « Tu sais quoi ? hurla Klemet, dont les yeux s'emplissaient de larmes qui lui faisaient mal. On avait sept ans ! Bon Dieu, sept ans ». Mais ce n'est pas une raison pour que le remords ne le ronge pas, même cinquante ans après : « Mais nous devions le faire ensemble, Klemet. C'était notre promesse », répond Aslak. Rien de pire qu'une promesse non tenue pour foutre en l'air un homme normal.
Aslak s'enfonce alors et disparaît dans la nuit polaire, tandis que Klemet sanglote comme un enfant sur son scooter des neiges, sous le regard éberlué et impuissant de Nina.
Une enquête policière, un documentaire sur les mœurs actuelles et traditionnelles des Lapons, des rudiments de prospection géologique, un aperçu des mœurs politiques dans les pays nordiques, une critique en règle de la "civilisation", non, je ne regrette pas d'être entré là-dedans, ce qui n’est déjà pas si mal. Et le dénouement est d'une grande force. Ce qui est mieux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:03 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, olivier truc, éditions métailié, le dernier lapon, laponie, peuple sami, norvège, suède, finlande, paul-émile victor, roman policier, polar
mercredi, 16 juillet 2014
DU RIFIFI EN LAPONIE 1/2
Le Dernier Lapon, d'Olivier Truc, aux éditions Métailié, 2012.
J’ai dit du mal récemment du genre appelé « thriller » (voir ici même au 30 juin dernier). Le livre d’Olivier Truc, Le Dernier Lapon, pour un peu, parvient presque à atténuer ma naturelle aversion pour les récits qui se bornent à l’élaboration d’histoires se réduisant à elles-mêmes, et qui ne portent rien de plus grand et de plus fort qu’elles-mêmes. Rien qui les dépasse. Des récits qui donnent des livres dont l’essence est d’aider à passer le temps les gens qui s’ennuient dans les transports en commun.

J’ai dit il y a longtemps tout le bien que je pense des romans de Michel Houellebecq au motif que leur auteur nous propose un regard aigu et décapant sur le monde actuel. Sans complaisance, il nous parle du sens de ce qui non seulement se passe sous nos yeux, mais nous entraîne sans que nous y puissions rien, ou si peu que rien.
Le livre d’Olivier Truc se situe quelque part sur cette ligne d’horizon littéraire, même si l’on reste très en-deçà des œuvres de Houellebecq. Ce n’est pas pour rien que la maison Métailié en limite le champ à sa collection « Noir ». Passer de Houellebecq à Truc, c’est en quelque sorte descendre du général au particulier.
Ce qui sauve le livre à mes yeux et en fait un objet intéressant, ce sont, disons les cent dernières pages (sur 450), où l’auteur parvient excellemment à faire sentir la montée de la tension, jusqu’au dénouement. Mais celui-ci, il faut le mériter. Avant d’y arriver, il faut croquer l’espèce de traité d’ethnographie lapone dont Olivier Truc a entrelardé (et alourdi) son récit. Et puis bien mâcher. Puis avaler.
C’est sûr que ça part d’un sentiment louable. C’est sûr aussi que s’il ne fournissait pas au lecteur un minimum de clés d’interprétation, le fond de l’affaire policière nous échapperait. Pour le coup, je m’en veux presque d’avoir éprouvé, tout au long de l’ascension de ce bouquin un peu aride, une impression qui m'a rappelé celle éprouvée à la lecture du Théorème du perroquet, de Denis Guedj, « roman » qui se proposait rien de moins que d’initier (ou de convertir) le lecteur à la jouissance de la pratique des mathématiques.
J’avais trouvé le résultat bourratif au possible, le romanesque disparaissant sous l’amas compact de l’exposé. Je dis peut-être ça parce que je ne suis guère mathématicien (ceci dit pour euphémiser). Mais Denis Guedj avait peut-être voulu tenter pour les maths ce qu'un autre avait réussi pour la philo, en surfant sur la vague initiée par Le Monde de Sophie, le livre de Jostein Gaarder au succès foudroyant, qui faisait croire au lecteur qu'il avait tout compris à la philosophie en le refermant.
Avec Le Dernier Lapon, sans aller aussi loin, j'ai eu parfois l’impression, de me trouver d’un coup sur un banc d'école : ce qu'il faut savoir de la société traditionnelle lapone. L’art proprement littéraire du roman dépasse le documentaire et la transmission d'un savoir. A cet égard, désolé, je trouve qu’il y a une part de reportage dans Le Dernier Lapon, d’Olivier Truc, dans une proportion infime toutefois par rapport au livre de Denis Guedj, qui me reste, lui, carrément indigeste.
Tant mieux, car ce livre mérite malgré tout d'être visité. L’action se situerait en Amérique du Nord au début du 20ème siècle, l’esprit n’en serait modifié qu’à la marge. En tant que civilisation, les Lapons n'ont rien à envier aux Indiens d’Amérique du Nord. Surtout au moment où les vestiges de leur culture ancestrale en est venue à être conservée dans les musées (c'est-à-dire qu'elle est au moins moribonde, si ce n'est agonisante). Un musée ethnographique est un mausolée.
Et au moment où leurs descendants plus ou moins abâtardis ou corrompus ont oublié leurs racines, qu’ils soient tombés dans l’alcool, comme Mattis Labba, ou qu’ils aient accepté, de gré ou de force, une acculturation qui les prive de fait de leur passé, comme Klemet. Un seul résiste encore à la "civilisation". Il s'appelle Aslak. Tout le monde pense qu'il est fou. Il est simplement buté, fidèle à ses racines, du genre « et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ».
Klemet, Lapon d’origine, après des études à l’école de police de Kiruna, a intégré le corps de la police des rennes. Il fait tandem avec Nina, fraîche émoulue de l’école de police, et accessoirement féministe (on est en pays scandinave : les mecs ont intérêt à faire gaffe, cf. Julian Assange, coupable d'agression sexuelle à cause d'un préservatif déchiré au cours d'un rapport sexuel consenti).
Nina a grandi dans le sud de la Norvège ("civilisé"), elle arrive donc dans la ville de Kautokeino (voir carte demain) sans rien connaître de la culture des Lapons (on dit les « Sami »). Le commissaire de la police locale est surnommé « Le Shérif », il est du côté des bons. C'est même pour cette raison qu'il sera mis sur la touche par le clan des méchants.
Brattsen, son adjoint, est, lui, on s’en apercevra, du côté de ces derniers. Comme les méchants des westerns américains classiques – des alcooliques qui ne rêvent que de casser de l’Indien –, il méprise les Lapons. C’est un brutal borné, dont ce vieux gredin d'Olsen manipulera sans peine la marionnette.
Je ne vais pas résumer l’histoire. En gros, d’un côté on a le monde lapon, de l’autre la civilisation technique et matérialiste. Le lien entre les deux consiste en un très vieux tambour traditionnel. Ces tambours, il n'en reste dans le monde que soixante et onze exemplaires dûment répertoriés, parce que les pasteurs calvinistes chargés de la christianisation du pays n'y sont pas allés par quatre chemins pour tenter d'éradiquer le chamanisme avec ces instruments du diable : ils en ont fait passer des milliers par les flammes, je suppose que c'est la vérité.
La peau de ce tambour comporte une particularité sous la forme d'un dessin symbolique. Après maintes péripéties, on découvre qu’il raconte une histoire tragique en même temps qu’il indique le plan d’un « trésor ».
Rien de tel pour appâter, n’est-ce pas ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, olivier truc, le dernier lapon, éditions métailié, polar, roman policier, laponie, peuple sami
mardi, 15 juillet 2014
ERROLL GARNER, BIENFAITEUR
Bien des « critiques » (je pouffe) de jazz font la fine bouche en entendant le nom d’Erroll Garner : « C’est du jazz, ça ? » (je brais). Boris Vian, qui n’est pas connu pour être un grand trompettiste (malgré une réputation flatteuse, avec sa « trompinette » dans les caves germanopratines), mais enfin qui était un vrai connaisseur du jazz, l’appréciait beaucoup. Il avait raison. C’est d’ailleurs un des disques d’Erroll Garner (Concert by the sea, avec Eddie Calhoun (b) et Denzil Best (dm)) qui, de toute l’histoire du jazz, s'est le mieux vendu dans le monde.
C’est sûr qu’Erroll Garner, c’est assez spécial pour qu’on l’identifie au bout de la deuxième seconde d’écoute. Et d’abord cette main gauche incroyable, qui plaque ses accords (on appelle ça « block chords ») sur les quatre temps, avec de curieuses notes intermédiaires et certains accords singulièrement martelés, donnant l’impression de sautiller (on voit bien faire le pianiste sur son tabouret). Et puis cet incroyable léger décalage de la main droite, qui donne envie de bondir.
La musique d’Erroll Garner donne une idée exacte de ce qu’est le bonheur d’être vivant à faire de la musique : sur les photos, on le voit jubiler d’être là. Et ça s’entend à ses grognements de satisfaction. Voilà : c’est une musique de la jubilation. Il adorait jouer en public et détestait répéter avant les concerts. Ou alors il ne tenait aucun compte de ce qu’il avait fait en répétition. Il était dans l’improvisation permanente.
C’est sûr que c’était difficile pour le bassiste et le batteur (respectivement Eddie Calhoun et Denzil Best sur Concert by the sea), jamais capables de prévoir, à l’écoute, dans son introduction du morceau suivant, dans quelle tonalité et sur quel titre ses pieds allaient retomber. Tiens, par exemple, écoutez l'introduction de « I’ll remember april » (Concert by the sea), pour voir : même que le public met plusieurs secondes à identifier le titre et à applaudir quand il en attaque le thème ! Le moins qu’on puisse dire, c’est que les « sidemen » devaient faire preuve de vigilance et de réactivité. Paresseux et fonctionnaires s’abstenir !
Si on me demandait quel titre en particulier il faut écouter, je serais bien embarrassé. Si on me poussait dans mes retranchements, j’avouerais avoir un faible pour « Sweet and lovely » (One world concert). Et je conseillerais à ceux qui se demandent encore ce que c’est que le « swing » d’être particulièrement attentifs à ce que les trois comparses font dans la séquence qui commence aux alentours de la quatrième minute. Moi, chaque fois que je l'écoute, ça me laisse sur le cul : rien de spectaculaire, mais de l'énorme à l'arrivée. Cela s'appelle l'art du swing.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musique, jazz, erroll garner, one world concert, concert by the sea, sweet and lovely, i'll remember april, boris vian
lundi, 14 juillet 2014
ART CONTEMPORAIN ?
Œuvre de monsieur Népomucène Hasard, début 21ème siècle, en hommage aux valeureux acteurs du « minimal art ».

Cette « œuvre » (je ne veux pas connaître le nom de l'auteur) est peut-être dans un musée (je ne veux pas savoir lequel).
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 13 juillet 2014
PALEONTOLOGIE ?
Fossile remontant à l'ère népomucène inférieure, période ikéa, trouvé lors de fouilles dans des couches marneuses profondes des grandes plaines arides et quasi-désertiques de la Barbarie occidentale. L'exemplaire est unique. Les chercheurs s'interrogent.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
lundi, 07 juillet 2014
VIALATTE MIEUX QUE GUY DEBORD
Très vilaine peinture sous verre achetée à Bucarest en 1990, pour quelques virgules de porte-monnaie.
*******
« Voilà pourtant où va la civilisation. Elle ne vit plus qu’en état de guerre. Dès qu’un homme d’Etat parle de paix, on sait que c’est pour lui faire la guerre. Il y a toujours quelque Corée, quelque Tibet ou quelque Irak où on la garde à la glacière ; c’est la guerre froide ; ou alors sur le coin du fourneau ; c’est la guerre tiède ; on la retire à moitié, on la remet, on l’enlève, on la réchauffe un peu ; plus elle est vieille, meilleure elle est, comme le civet ; quand elle réduit, on lui ajoute un petit oignon, un verre de vin, un brin de laurier, un filet d’eau bouillante, et ça se remet à faire des bulles. Voilà pourtant la vie que nous menons. La civilisation est couverte de plaies. Qu’on entretient en les grattant ; comme l’eczéma ».
Je cite de nouveau ces quelques lignes de Profitons de l’ornithorynque, d’Alexandre Vialatte, qui terminaient la note parue hier, pour montrer que la littérature est supérieure à n’importe quelle théorie, qu’elle soit scientifique, politique, économique, sociologique et tout ce qu’on voudra. Pour une raison finalement très simple : elle les contient toutes, parce que c’est elle qui reste seule humaine, où que soit située sa qualité sur l’échelle des valeurs. Les théories, en détruisant la liberté individuelle (en traduisant l'homme en statistiques et en moyennes), détruisent l’humanité.
Et pour montrer qu’Alexandre Vialatte sait tout ce qu’il faut savoir pour expliquer les choses du monde dans lequel il vit mieux que Guy Debord, et sans prendre la pose du penseur en usant de termes théoriques et de concepts compliqués, et en dédaignant de professer des vérités du haut d’une chaire, voici toute la fin de la chronique citée hier. Elle est intitulée « Eva Peron ». On finissait sur l’eczéma. Je ne peux m’empêcher de trouver ça remarquable d’acuité et de perspicacité.
*******
Et qui les gratte ? C’est surtout la radio, le cinéma, la publicité. Ils font les vedettes en tous domaines. Et non seulement les vedettes, mais la pièce, l’événement. Ils ont fait Hitler, le nazisme, Mussolini, Nasser et tous les dictateurs. D’une bataille perdue au pas de course, ils ont fait à Nasser une guerre victorieuse aux yeux de tous les Orientaux. Ils commandent le rire et les larmes, ils dirigent les admirations. Ils remplacent la pensée, ils remplacent le cerveau. Ils installent l’opinion là où ils veulent la mettre. Ils ont fait Peron et Eva, Eva Peron, l’idole de l’Argentine. D’une fillette sans dons, armée de son seul toupet et de sa fureur d’être applaudie, de sa rage de se venger de tout ce qu’elle n’avait pas, la radio a fait quelque chose d’intermédiaire entre le Bon Dieu et la Sainte Vierge, qui a disposé de l’armée de tous les syndicats, des tueurs des abattoirs, des producteurs de films, qui a fait un dictateur et des révolutions, qui a symbolisé l’Argentine, qui a failli être canonisée, qui a eu de son vivant ses rues, ses villes, ses timbres (avec défense de les oblitérer, pour ne pas altérer son profil !), en faisant de la charité un spectacle publicitaire, en adoptant pour hygiène quotidienne, à la radio, un numéro de striptease du cœur qui hallucinait les ménagères. Et le cœur sec comme un coup de trique ! Du néon à la place du cœur ! Lisez cette histoire étonnante : Eva Peron, de Sylvain Reiner ; vous verrez comment l’Argentine n’a été pendant des années qu’une aventure publicitaire. Vous apercevrez au passage des personnages extrêmement pittoresques, comme ces vieilles dames de la pampa qui sont coiffées d’un chapeau melon, armées d’une pipe et couvertes d’un châle, ou comme ce chef de la police dont le nom a l’air d’être sorti du délire d’un enfant de sept ans : Aristoboulo Mittelbach. Ce qui est peu sérieux pour un roi des gendarmes.
A côté d’Eva, Juan Peron : une sorte de Tino Rossi qui aurait pris Goering pour modèle ; une réclame de pâte à rasoir ; un dictateur qui sent la savonnette. Je ne crois pas l’ouvrage impartial : le tigre lui-même oublie parfois de se rappeler sa férocité, Néron lui-même avait ses moments de gentillesse, l’Eva de Sylvain Reiner n’oublie jamais son rôle. Car cette histoire d’une vie n’est que l’histoire d’un rôle (mais parce que cette vie ne fut qu’un rôle ; le cabotinage est une seconde nature ; et une seconde nature ne s’oublie peut-être pas).
Cette aventure a mal fini pour Eva. Elle est morte en voyant des poules qui venaient picorer sur son lit, dans sa chambre et sur son cadavre. Il n’est pas drôle au moment de mourir de voir sa chambre envahie par les poules. Surtout en rêve.
Juan Peron, vêtu avec soin, promène à Saint-Domingue, où il s’est retiré, ses quatre caniches tous les matins. Il réclame le corps d’Eva. Le cadavre est publicitaire. La loi dit qu’il lui appartient.
Au Portugal, deux cents moutons viennent d'être mangés par des loups.
A Paris, à la suite d'une réanimation (on a remis en mouvement par le moyen de massages le cœur d'une fillette qui ne battait plus), un savant professeur a dit aux journalistes : "Un homme n'est réellement mort que lorsque ses fonctions vitales ne sont pas seulement suspendues mais définitivement arrêtées".
C'est à peine si on ose y croire.
Mais c'est ainsi qu'Allah est grand.
Alexandre Vialatte, Profitons de l’ornithorynque, Eva Peron, La Montagne, 12 avril 1960.
******
Que dit-il de plus, Guy Debord, dans La Société du spectacle ? Des choses finalement bien compliquées.
Ayons les complicateurs en horreur. La vraie vie est peut-être ailleurs, comme disait l'autre, mais elle est surtout plus simple.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature, alexandre vialatte, chroniquies de la montagne, c'est ainsi qu'allah est grand
dimanche, 06 juillet 2014
VOUS REPRENDREZ DU VIALATTE ?
 Allez, encore un peu d’Alexandre Vialatte. Toujours tiré de Profitons de l’ornithorynque (Julliard, 1991). L’admirable très long paragraphe qui suit constitue la moitié (approximativement) de la chronique intitulée « Eva Peron » (La Montagne, 12 avril 1960), et recueillie par la grande amie de l’auteur, Ferny Besson.
Allez, encore un peu d’Alexandre Vialatte. Toujours tiré de Profitons de l’ornithorynque (Julliard, 1991). L’admirable très long paragraphe qui suit constitue la moitié (approximativement) de la chronique intitulée « Eva Peron » (La Montagne, 12 avril 1960), et recueillie par la grande amie de l’auteur, Ferny Besson.
Le ciel est gris, la conjoncture est molle, la civilisation s’affaisse comme un soufflé. Autrefois on vantait l’art d’un film, maintenant on vante son prix de revient ; autrefois on parlait du talent d’un poète, maintenant de la marque de son auto ; autrefois on habitait des maisons. C’étaient des endroits faits pour l’homme qui procuraient à chaque activité le paysage qui lui était naturel ; les oignons séchaient au grenier, le vin mûrissait à la cave, la mauvaise marche du perron cassait la jambe au visiteur insupportable, les rats avaient un champ raisonnable mais limité pour faire rouler les noix sur le plancher du grenier entre la malle en poil de chèvre et l’ombrelle de la bisaïeule ; le saucisson pendait à la solive,les enfants trouvaient aisément quelque niche naturelle pour jouer à Guignol ; on savait où mettre ses souliers, sa pipe, son grand-père, son vélo. Maintenant il n’y a plus de maisons, mais des taudis ou des chambres d’hôtel, et ce placard nu, cette tombe, ce désert de la soif, bref cette aventure saharienne qu’on a appelée H.L.M., où l’homme meurt de claustrophobie, par un record du paradoxe, au sein d’un vide illimité. J’ai vu un rat de quatre cent dix grammes y périr en une heure quatorze sur un sol en fibrociment. D’ennui. De dégoût. D’écœurement. De solitude métaphysique. Je l’ai vu maigrir progressivement, perdre ses joues, pencher la tête, fermer les yeux, raidir les pattes. Est-ce raisonnable ? On vous explique que ces surfaces arides sont très faciles à balayer ; plus fort : qu’il n’y a même pas à le faire ! Mais l’homme passe-t-il sa vie à ne pas balayer ? Victor Hugo écrivait-il ses Mémoires pour qu’ils soient faciles à épousseter ? Ou même ses Odes ?... C’est une logique qui dépasse mes moyens. Mais après tout … j’ai vu un homme vendre une règle à calcul en expliquant qu’elle était faite d’une matière imperméable ! J’ai même vu acheter cet engin par des mères de famille nombreuse qui ne descendaient jamais sous l’eau, même en scaphandre, et qui ne s’en serviraient jamais, même une fois revenues au soleil. Après quoi on peut tout admettre. Et cependant je persiste à penser qu’on achète des logements afin de les habiter et non de ne pas les balayer. Sinon on achèterait un trottoir en asphalte. Et d’ailleurs on se lasse vite de ne pas balayer. C’est un plaisir qu’on épuise en deux jours. L’homme, qui n’est pas plus bête qu’un autre (pas moins non plus) (mais enfin pas plus), s’aperçoit vite, au demeurant, qu’il y a bien plus à balayer sur une surface parfaitement lisse, où les rainures n’absorbent rien, que sur un plancher raviné par les ans. On ne devrait construire que du vieux. En prévoyant l’espace vital des choses qui réclament de la place, du temps, des soins et de la piété : le vin qui veut vieillir, le fromage qui veut vivre, et la grand-mère qui veut le manger. Les mettra-t-on au frigidaire ? à l’hôpital ? Quelle indécence ! Voilà pourtant où va la civilisation. Elle ne vit plus qu’en état de guerre. Dès qu’un homme d’Etat parle de paix, on sait que c’est pour lui faire la guerre. Il y a toujours quelque Corée, quelque Tibet ou quelque Irak [tiens, déjà en 1960] où on la garde à la glacière ; c’est la guerre froide ; ou alors sur le coin du fourneau ; c’est la guerre tiède ; on la retire à moitié, on la remet, on l’enlève, on la réchauffe un peu ; plus elle est vieille, meilleure elle est, comme le civet ; quand elle réduit, on lui ajoute un petit oignon, un verre de vin, un brin de laurier, un filet d’eau bouillante, et ça se remet à faire des bulles. Voilà pourtant la vie que nous menons. La civilisation est couverte de plaies. Qu’on entretient en les grattant ; comme l’eczéma.
Est-ce que c'est pas bien tapé, ça ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, littérature française, style, humour, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, journal la montagne, profitons de l'ornithorynque, ferny besson, éditions jullliard
samedi, 05 juillet 2014
L'ECLAT ET LA BLANCHEUR
La vie, naguère, était dictée par le décalogue, l’opinion des voisins, les snobismes locaux et les ouvrages de la baronne Staffe. Elle laissait assez de place à l’homme pour se livrer, par le moyen de quelque gymkhana exécuté entre ces tabous, à la vertu, au dévouement, à l’adultère mondain, au dressage des bassets, à l’assassinat des caissières, au trépas sur les champs de bataille, bref pour avoir une âme immortelle et en faire un usage grandiose et personnel. L’homme avait le droit d’être sublime ou sordide. Sa vie était un jeu dramatique et passionnant.
Adieu ces libertés et ces exaltations ! L’homme a perdu le loisir charmant de falsifier un testament, de lire Montaigne ou de tuer des petites filles. Il ne s’agit plus aujourd’hui que d’obtenir la blancheur Cerfeuil, de sourire Kibrille et de vivre Marie-Chose. On n’a plus le temps que d’être un client. Et d’obéir aux magazines. La conduite de l’homme est dictée par le réfrigérateur Machin, le bloc-évier, la poubelle à pédale. Il est vaincu par ses conquêtes. C’est le bagnard de l’appareil électroménager.
Son cerveau a été savamment remplacé par le prospectus publicitaire. Il pense Kimousse, Kiastik, Kipenspourvou. Sa vie se résume dans un bulletin de commandes. Elle a le style du jargon de prestige des périodiques et des marchands de « cités heureuses ». La femme n’a plus qu’à se laisser guider.
*****
 Je ne mets toujours pas les guillemets, qui s'imposent théoriquement. Ces lignes d'Alexandre Vialatte, parues dans La Montagne le 18 février 1968, sont toujours tirées de Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
Je ne mets toujours pas les guillemets, qui s'imposent théoriquement. Ces lignes d'Alexandre Vialatte, parues dans La Montagne le 18 février 1968, sont toujours tirées de Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
Eh oui, on n'a plus le temps que d'être un client.
Pour dire que Vialatte n'avait rien à apprendre de Guy Debord, des intellectuels en général et des situationnistes en particulier. Il n'avait rien à apprendre des révolutionnaires : il se contentait de regarder. Sans se raconter d'histoires. Et sans brandir l'étendard compliqué et systématique de la théorie. La « société du spectacle », Vialatte, il sait ce que c'est. Je respecte Guy Debord. J'admire Alexandre Vialatte. Au motif que, si Guy Debord a raison, c'est Alexandre Vialatte qui dit vrai. Même Günther Anders, qui ne dit pas autre chose, est plus compliqué.
intellectuels en général et des situationnistes en particulier. Il n'avait rien à apprendre des révolutionnaires : il se contentait de regarder. Sans se raconter d'histoires. Et sans brandir l'étendard compliqué et systématique de la théorie. La « société du spectacle », Vialatte, il sait ce que c'est. Je respecte Guy Debord. J'admire Alexandre Vialatte. Au motif que, si Guy Debord a raison, c'est Alexandre Vialatte qui dit vrai. Même Günther Anders, qui ne dit pas autre chose, est plus compliqué.
Cela fait une différence. Je veux dire entre celui qui se pose en penseur, contempteur et réformateur du monde, et celui qui se contente de vivre la vie qui lui a été donnée, qu'il essaie de comprendre, sans pour autant la disséquer, en se contentant de la vivre le plus plaisamment possible, et d'en exprimer dans un français impeccable la « substantificque mouelle » coulée de sa propre expérience. Sans s'en laisser conter par les baratineurs, bonimenteurs et autres camelots : humain, simplement humain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, guy debord, la société du spectacle
vendredi, 04 juillet 2014
LES FEMMES FRIGIDES
Celui [le mystère] des « femmes frigides » n’est pas moins ténébreux. Je n’ai jamais su exactement ce que c’était qu’une « femme frigide ». C’est un vocable énigmatique qui me fait à peu près le même effet que les mots « verdure » ou « arthritisme » lorsque j’avais quatre ou cinq ans. Les médecins savent ces choses savantes, les grandes personnes. De tout façon, la presse signale un « mystère de la femme frigide ». Et elle a bien raison ; car c’est un phénomène d’un caractère si saisonnier qu’on ne parvient pas à s’expliquer la chose ; c’est un mystère intermittent : tantôt il n’y a pas de femme frigide, et par conséquent pas de mystère, tantôt les journaux en sont pleins. Surtout quand ils manquent de Spoutniks ou de « conférence au sommet », ou quand Joanovici ne part pas pour la Suisse ; ce ne sont plus que photos de femmes frigides, graphiques, diagrammes, toutes les femmes sont frigides ; d’ailleurs, sur les photos, on ne s’en rendrait pas compte, elles n’ont pas l’air de délinquantes, elles ressemblent à toutes les autres, on dirait des femmes non frigides ; il paraît qu’elles le sont quand même ; c’est ce qui prouve bien qu’on est en plein mystère. Mais ce que je préfère ce sont les coupes de femmes frigides. Au trait blanc sur fond noir, avec des pointillés. C’est très intéressant ; ça fait très scientifique. On se sent en plein dans le vrai de la chose, la vraie médecine, la vraie physiologie. On se sent pénétré par la science ; malgré soi. On n’y comprend rien ; et puis on n’a pas le temps de tout lire ; et c’est affreusement ennuyeux (il ne faut pas lire), mais on voit les schémas. Et alors on sent qu’on apprend. Quoi ? On ne sait pas. Mais enfin on apprend. A l’état pur. Sans aucun objet. Comment dire ? C’est un état d’âme : l’état d’âme d’un homme qui s’instruit. On s’instruit jusqu’aux yeux. J’aime bien les femmes frigides.
*****
Ben voilà. Je sais, j’aurais dû mettre des guillemets et tout écrire en italiques. Ces considérations datent de 1958. On les trouve dans le numéro de mai de la NRF.
Les vrais amateurs ont reconnu depuis le début qu’elles ne peuvent avoir été signées que par Alexandre Vialatte. Cette chronique a été recueillie par Ferny Besson dans Profitons de l'ornithorynque, éditions Julliard, 1991. Qui me rendra Antiquité du grand chosier, que j'eus la faiblesse de lui prêter, sans doute un jour de beuverie excessive ?

******
Ainsi, on apprend le retour du petit fouteur de merde en chef monté sur talonnettes. Je ne veux plus écrire son nom ni publier l'effigie de sa trombine. Le chef de file de ceux qui veulent foutre par terre l'institution judiciaire quand celle-ci ne se prosterne pas devant eux : les gorets hurlent qu'on les égorge, avant d'avoir senti le fil de la lame. Le chef de file des malfrats qui ne conçoivent les institutions de la République qu'au service de leurs intérêts personnels. La politique réduite au coup de menton. La politique réduite à la promotion narcissique de quelque Nabot-Léon qui a le culot monstre de se prendre pour un homme d'Etat et qui, dans la foulée, accuse des magistrats de n'obéir qu'à des besoins de vindicte personnelle quand ils ont l'audace ahurissante de s'en prendre à son auguste personne. Faut-il que les Français soient nuls à chier pour avoir été neuf millions à gober avidement à la télé les rodomontades, les bravades et les mensonges de ce jean-foutre ! Qui aurait dit que la France s'apprêtait à retomber de Charybde (le mou du bulbe qui nous gouverne) en Scylla (l'agité du bocal, qui se rêve de nouveau en calife à la place du calife) ?
Que préférez-vous, du mou du bulbe ou de l'agité du bocal ?
Mais qui, maintenant, pour nous préserver du pire ? On va faire comme Diogène, une lanterne à la main en plein jour : « Je cherche un homme ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, femmes frigides, frigidité, nouvelle revue française, nrf, sexualité, nicolas sarkozy, politique, société, france, corruption
jeudi, 03 juillet 2014
L'OMBRE D'UN DOUTE
La vie est plus vaine une image
Que l'ombre sur le mur.
PAUL-JEAN TOULET
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, paul-jean toulet, littérature
mercredi, 02 juillet 2014
L'OMBRE D'UN DOUTE
Je vais à la musique les yeux fermés, et je la laisse en moi agir et me toucher ; je ne connais pas la musique, c'est elle qui me connaît mieux que moi-même.
FRANÇOIS MAURIAC
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, musique, françois mauriac
mardi, 01 juillet 2014
GOTLIB ET LE TEMPS
J'ai déjà dit tout le bien qu'il faut penser (et que je pense que tout le monde pense) du dessinateur Gotlib, inventeur des Dingodossiers (avec Goscinny), de La Rubrique-à-brac (tout seul), de Pervers pépère, de Cinémastock (avec Alexis), de L'Echo des savanes (avec Bretécher et Mandryka), de Fluide glacial (« umour et bandessinée ») : on n'en finirait pas. Inutile d'ajouter que je révise régulièrement (pour les amateurs et les autres, la formule qui introduit la présente phrase s'appelle une « prétérition », pour dire qu'on ne va pas dire ce qu'on va dire et qu'on dit quand même, c'est toujours amusant, enfin, souvent).

Je ne vais pas énumérer mes innombrables pages préférées, il faudrait tout citer. Je m'arrête juste aujourd'hui sur le délire inspiré à Gotlib par le thème bien connu des amateurs de science-fiction : les voyages dans le temps. Et le paradoxe qu'il en tire me paraît toujours aussi rigolo. On trouve ces vignettes dans le volume ci-dessus.







Bon, certains diront peut-être : « Œdipe, quand tu nous tient, les mères juives, ... » et tout ça. Excusez-moi, mais la psychanalyse, franchement... Ce qui est plus rigolo, c'est de constater aujourd'hui que Gotlib ne faisait qu'anticiper sans le savoir les énormes débats sur la filiation (adoption, mères porteuses, enfin non : « gestation pour autrui », vous savez ce truc où on apporte les ingrédients à la cuisinière qui vous vendra ensuite le gâteau qu'elle a concocté pour vous) qu'a suscités le vote de la loi sur le mariage homosexuel. On n'a peut-être pas fini de rigoler.
Je signale aux adeptes de Gotlib les excellentes adaptations radiophoniques que Gabriel Dufay propose en ce moment de la Rubrique-à-brac et de Trucs en vrac. C'est tous les jours sur France Culture à 11h 50. Il y en aura 10 en tout. Et ça s'arrête vendredi. Et on peut réécouter sur le site de France Culture. C'est très réussi.
lundi, 30 juin 2014
LE THRILLER EST A LA MODE
HERVÉ LE CORRE, Après la Guerre, (Rivages/ Thriller, 2014)
« On ne lit pas toujours ce qu’on devrait ». Appliquant cette maxime, qu'il ne faudrait pas confondre avec un proverbe bantou, j’ai donc lu Après la Guerre, de Hervé Le Corre (éditions Rivages / Thriller, 2014). Mais j’avais une excuse : des amis sûrement bien intentionnés m’en avaient fait cadeau. Je me suis senti obligé d'aller jusqu'au bout. Et je peux vous dire que le thriller se portera épais cet été.
Est-ce que c’est ça, le « thriller » d’aujourd’hui (il a reçu le prix du Point, 2014) : un cadeau fait par des amis qui ignorent vos préférences ? Ah, « préférence », petit mot beaucoup entendu lors du vote de la loi sur le mariage homo. Tiens au fait, c'est quand la gay pride ? Alors, cher individu, vos préférences préférées ? En l'occurrence, votre « orientation culturelle », si vous voyez ce que je veux dire. Cela fait comme un malentendu. Mes amis ? Je ne leur en veux pas, vous pensez bien : l'intention de faire plaisir était là.

En tout cas ça commence bien crade et bien saignant : trois mastars cuisinent (je veux dire lui caressent à grands coups d'extrémités carpiennes - qu'ils ont particulièrement contondantes - le nez, l'arcade sourcilière et le menton) Lucien Potier pour lui faire cracher l’adresse de la cachette du Crabos, qu’ils soupçonnent d’avoir saigné Penot la semaine d’avant. Ils vont jusqu’à lui griller l’œil à la cigarette pour qu’il se mette à table, et qui finit par cracher, en même temps que ses dents, dans l'espoir d'en finir enfin avec la douleur : « Rue du Pont-de-la-Mousque ! Il est chez Rolande avec sa pute dans une piaule pour la nuit ! ». C’est tout ce qu’ils voulaient, les mastars. On est à Bordeaux, au milieu des années 1950.
Ils n’ont plus qu’à liquider Lulu, ce que Jeff fait, salement, comme à son habitude : c'est ce qu'il préfère. Albert lui en veut de savourer trop visiblement la mise à mort, car lui, quand il torture, c'est purement fonctionnel, juste parce que l'autre rechigne à lui donner l'info qu'il attend. Torturer, là, c'est du pragmatisme. Albert est un pragmatique, ce qu'il veut, c'est être efficace. Le lecteur a du mal à faire la différence. Il paraît que ce genre de littérature a ses amateurs.
Le trio est composé de Jeff, costaud et porte-flingue, mais un peu « imprévisible » (euphémisme pour "carrément chtarbé"), Francis, un mec sûr, un vrai dur pour lequel turbinent assez de filles pour le faire vivre confortablement, et puis Albert, le chef. Lui, c’est le commissaire Darlac. Suivant les moments du bouquin, il « tient la ville » ou « la moitié de la ville ». Du double au simple (ou de l'entier au demi), mais baste, ne chipotons pas.
On comprend vite que le vrai méchant, c’est ce flic. Une longue histoire. Avec Poinsot, Penot et quelques autres, jusqu’en 1943, il a « travaillé » pour les Allemands, dans la torture, la rafle de juifs et le pillage des biens (ils - les fripouilles - sont tous meublés comme des princes). Sentant le vent tourner, il s’est arrangé pour sauver quelques juifs, quelques résistants : ça vous refait un état civil présentable aux yeux des intégristes de la Libération (à l'occasion des lâches brusquement reconvertis en héros de la Résistance), et ça fait oublier les « erreurs de jeunesse ».
Appelons ça la « transition politique », puisqu’il y a bien une « transition énergétique » de nos jours. Certains appellent encore ça la « Libération » : comme on ne pouvait pas flinguer tous les salauds, on a pratiqué le recyclage des ordures à grande échelle. Papon est évidemment en filigrane (on est à Bordeaux).
Parfaite quintessence de la pourriture humaine, le commissaire Albert Darlac a monté son affaire en entretenant plus de connaissances chez le diable que chez le bon dieu : tout le monde – flics et voyous – le connaît, et il connaît tout le monde, avec une nette préférence toutefois pour les voyous. Comme on dit : « Il en croque ». Un vrai parrain.
En plus, contrairement à ce que me disait un ancien inspecteur de la DST, le Code de Procédure pénale (il s'y référait en permanence, dans la crainte du « vice de forme », cause de tant d'invalidations d'enquêtes et de procédures), non seulement il ne l’ouvre jamais, mais il doit servir de béquille à sa table branlante, s’il ne l’a pas depuis longtemps jeté au feu (j'espère que vous vous y retrouvez, dans les pronoms personnels). Darlac, c’est le mec de la manière forte, il n’y va pas avec le dos de la cuillère à pot de moutarde forte (de Dijon) : celle qui monte au nez plus vite que son ombre.
En fait, le lecteur (disons : moi) se fiche pas mal des embrouilles et entourloupes dont le commissaire Darlac, sorte de figure du Mal enkystée dans le monde normal (commissaire Laborde, inspecteur Mazeau, …), est capable de faire preuve. On sent qu'il y a du Lucifer Exterminateur dans le personnage du commissaire Darlac.
De toute façon, dans tout le bouquin, il n'y a pas une personnage pour racheter l'autre : tout autant que les mauvais, les bons sont éliminés, sauf les huiles comme de bien entendu. Ce pauvre type n’est pas un stratège. C’est sûr qu’il ne manque pas d’habileté tactique, mais quand Jean Delbos lui fait dire qu’il est revenu d’entre les morts pour se venger, il va commencer à les accumuler, les morts. Et aussi les erreurs.
Il faut dire que Delbos a de quoi lui en vouloir : pris dans une des dernières rafles bordelaises avec sa chère Olga (son épouse juive qu’il trompait pourtant allègrement), il passe pour avoir disparu à Auschwitz. Pour plus de sûreté, il s'est fait appeler André Vaillant. C’est lui qui a rectifié Penot, le copain de Darlac. Rencardé par Mazeau, il a donc commencé à faire le ménage parmi les amis du ripou.
L’auteur, Hervé Le Corre, a cru bon, sans doute pour « mettre en perspective », peut-être pour « replacer dans l’époque », « faire couleur locale » ou créer de la « profondeur de champ », d’ajouter la guerre d’Algérie au tableau. Car Jean Delbos a un fils, on est au temps de la conscription, il a l’âge, il part pour le bled, comme tireur d’élite. Après diverses péripéties fonctionnant comme des diverticules narratifs, Il désertera, rentrera en France, et sera tué par Darlac en même temps que son père. Rideau.
Le Corre complète par quelques chapitres en italiques et à la première personne, où c’est l’ancien déporté qui est censé parler, pour retracer les grands moments de sa trajectoire. Moi je veux bien. Si l’on sait que la femme de Darlac est une ancienne pute, à qui un occupant nommé Willy Müller (la Wehrmacht a aussi fini en fauteuil roulant) a fait une fille (Elise, que Darlac a officiellement adoptée et dont la puberté avancée lui fait des effets dans la moelle épinière, et pas seulement) avant d’aller se faire à moitié exploser la tronche à Stalingrad, et qu’elle lui rend régulièrement visite en cachette de son mari, on commence à demander grâce : n'en jetez plus.
Si Jean Delbos tue les copains de Darlac, celui-ci ne se gêne pas pour lui faire attribuer les quelques cadavres qu’il laisse sur son chemin, parmi lesquels l’inspecteur Mazeau, mais aussi ses amis, l’imprévisible Jeff, et surtout le gars Francis, qu'il flingue sans même un petit frisson de l'âme. Son ennemi le commissaire Laborde, un flic réglo et républicain (le personnage existe à peine et n'est là que comme repoussoir et alibi moral), lui, a beau renifler autour de lui, il se fait embrouiller par ses manœuvres et fait chou blanc. Il n'arrivera pas à lui mettre le nez dans sa bouse.
Bref, le commissaire Albert Darlac, ayant fait le ménage en grand et le désert autour de lui, pourrait presque dormir tranquille. Malheureusement, il a eu la mauvaise idée d’aller rectifier Müller, le père allemand d’Elise, dans son fauteuil roulant, en même temps que sa vieille mère. Et ça, son épouse ne pourra pas lui pardonner. Ne disons pas tout quand même : il reste juste assez pour qu’un peu de sang s’ajoute aux flots déjà versés, et que le bouquin dépasse les 500 pages.
Dans l’ensemble, donc, le genre de livre que j’évite en général de lire, livre d’un bon faiseur de scénario, pensé, construit, agencé et écrit pour le cinéma, mais je suis désolé : Hervé Le Corre écrit peut-être des livres, il ne fait pas pour autant de la littérature. Je me permets ce jugement péremptoire et tranchant à cause de la langue.
C'est simple : il écrit à la diable, dans un français débraillé, relâché, sans caractère, où il fait un usage erratique, et parfois incongru d'un argot peut-être d'époque. Une langue mal dégrossie, cahotante et globalement plate comme une limande, qui se soucie seulement d'obéir aux critères d' « efficacité narrative ».
Ne dites rien à mes amis bien intentionnés qui me l’avaient offert.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : polar, thriller, littérature, littérature française, france, collabos, seconde guerre mondiale, nazis, hervé le corre, éditions rivages
mardi, 24 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 3/3
Résumé : pourquoi Chopin ? Parce que Chopin, quand il invente sa musique, cherche sa propre vie. Et cette vie est âpre. Comme celle des personnage du livre.
 Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».
Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».
Malheureusement pour lui, Konstantin a la rage. Il est en guerre contre le communisme et les communistes. C'est un bloc de refus. Plus grave, il est en guerre avec le monde : il déteste ses parents, qui ont eu le tort de s’adapter au moule du système. Et ses parents ne l'aiment guère. Pour le coup, à peu près asocial, aimé par personne et n'aimant personne (croit-il), c’est un authentique révolté, qui ne supporte pas le règne de la bêtise la plus abjecte, surtout jointe à la médiocrité la plus criante, qui exercent un pouvoir sans partage sur les êtres et les choses. Son seul exutoire est dans le piano de Frédéric Chopin. Une condition de survie.
Il le dit : « S’il y avait une raison de rester en vie, de supporter le torrent diurne de la bêtise, de la détresse, de l’insulte et de la bassesse, c’était bien ces moments de ravissement où je respirais au même rythme que Chopin, où le code secret du divin s’inscrivait dans les airs. Il me suffisait de promener les doigts sur le clavier pour y accéder, pour que les portes s’ouvrent toutes grandes ». Sa relation à la musique a quelque chose de névrotique, de pathologique même. Je le sais : je souffre d'un syndrome clinique voisin, sauf que je ne suis pas pianiste, à plus forte raison virtuose. Je suis obligé de me contenter de.
Mais pour lui, c’était ça ou mourir. Le système en effet est tel que si l’on veut espérer survivre, il faut être cinglé. Les seuls personnages vivants, dans Wunderkind, ont tous un grain. Un gros grain. La belle Irina, dont Konstantin se rend compte trop tard qu’il est amoureux, finira d’ailleurs à l’asile, à dix-sept ans, ayant déjà avorté deux fois, capable de déclarer, prémonitoire : « J’ai peur de ne pas atteindre mon vingtième anniversaire. J’ai tout expérimenté, j’ai goûté à tout. Je suis vieille et fatiguée. […]
Ici, le temps ne passe pas à la même vitesse, une année paraît une décennie, voire plus. Mon enfance a pris fin le jour de mes neuf ans. A quatorze ans, j’en avais terminé avec la puberté. Je me suis mariée, j’ai eu des enfants, j’ai voyagé … en quelque sorte. J’ai déjà perdu chacun de ceux qui m’étaient chers. Et tout cela pendant que je jouais de ce foutu violon. Je ne m’en suis même pas rendu compte ». Elle se suicidera. Et le grand Vadim devient militaire, après avoir été chassé de ce « paradis ». Et le superbe Igor le Cygne, un personnage flamboyant, est destitué de son poste.
Tous ces adolescents baisent sans amour, se saoulent à n’importe quoi, fument dès qu’ils le peuvent. La vie les a brutalisés, ils sont vieux avant l’heure. Seule la musique. La musique seule. Comme Irina, Vadim, pianiste prodigieux que Konstantin juge tellement supérieur à lui, est fou à sa façon. L’un des personnages les plus incroyables de tout le livre est professeur de violon. C'est lui qu'on appelle Igor le Cygne. Foutraquement poète, on se demande comment il a fait pour échapper aux camps de travail communistes.
Quand il fait répéter quelque sonate de Bach à Irina son élève et à Konstantin (BWV 1014, 1017 et 1018), les envolées lyriques échevelées dans lesquelles il se lance à deux ou trois reprises sont de vrais morceaux de bravoure : « Les démons de la joie ! Le concierge se fait sucer au moment où je vous parle, c’est de la folie. Je n’en peux plus. Voilà longtemps que j’aurais dû m’inscrire dans une chorale d’eunuques. Peut-être que vous devriez tout bonnement vous mettre nus sous le piano à queue pour baiser, Irina et toi, presto, un menuet, peut-être même une sarabande, et je regarderai de loin … Discrètement ! Je ne dirai pas un mot. C’est une proposition à prendre ou à laisser, je vous mettrai à tous les deux un Très Bien. Une affaire à saisir ! Vous ne savez même pas jouer d’un instrument, de toute façon … Petits merdeux ! De mon temps, on répétait dix heures, quatorze heures par jour, on jouait jusqu’à l’aube, on jouait pour rester en vie ». Comme ça sur des pages.
Seuls quelques-uns sont en vie, tous les autres sont morts ou ressemblent au « Père de la Nation », à la momie duquel la classe entière est allée rendre visite et hommage : « Tu trouves ça drôle Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. – Qu’on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l’empêcher de puer ». Ce serait hilarant si ce n'était pas terrible. Le surnom de Peppy est « le Voleur ». Et il ne se fait jamais prendre, même quand il vole des kalachnikovs dans les sous-sols du Conservatoire. Lui aussi fait partie des vivants : il connaît par cœur le manuel de survie en milieu hostile.
Et ils sont peu nombreux, les vivants : Igor le Cygne, Irina, Vadim, Peppy, Konstantin, Alexander à la rigueur, bien qu’il sache qu’il peut se permettre d’être insolent, puisque son père est quelqu’un dans le Parti. Il y a aussi « la Coccinelle », le professeur de piano qui considère Konstantin comme le plus doué de ses élèves, et qui finira par émigrer, ayant épousé un Américain.
N’oublions pas de nommer le dédicataire du livre : Ilya. Cet oncle du narrateur a passé quasiment toute sa vie à Lovech puis dans l’île de Parsin à casser des cailloux comme « espion des impérialistes ». Apparition d'une ombre fantomatique surgie du fond des âges totalitaires, qui raconte à son neveu l’horreur du camp de travail, où le kapo Gazdov décide, selon son humeur, de la mort de tel prisonnier, dont le cadavre ira engraisser les cochons, dans l'enclos réservé.
Le prononcé de la sentence se fait par l’entremise du petit miroir où l’officier invite le condamné à se regarder une dernière fois. C’est ainsi, crânement, que finit l’admirable violoniste appelé « le Maestro » : d’un seul coup de club de golf à l’arrière du crâne, après avoir roulé les pointes de sa moustache, en souriant.
Voilà pour le noyau dur des vivants. Tout ce qui les entoure donne l'impression minérale, pétrifiée de la haine (la Hyène, la Chouette, ...). Et la seule « preuve de vie » que les vivants peuvent se donner est la musique qu’ils font, non pas pour « réussir dans la vie », mais parce qu’elle est leur seule manière de donner et de recevoir de l’amour dans ce monde totalement déshumanisé : « Notre corps est la première chose qui disparaît lorsque nous faisons de la musique ». Comme dit Igor, ils font de la musique pour rester en vie. La musique seule.
L’urgence, l’absence, l’impossibilité de l’amour, dans cette existence concentrationnaire, est au centre du livre. Toutes les machines humaines qui gravitent autour du noyau des vivants sont des robots, qui se sont résignés à ne pas exister par eux-mêmes, se contentant de fonctionner docilement. Et de se montrer assez cruels avec ceux qu'ils ont sous leurs ordres pour les contraindre à faire de même. Deux issues pour ceux qui veulent rester vivants : le suicide ou la musique.
Quel tableau terrible, mes amis !
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je ne sais pas si Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un grand (voire même un bon) livre de littérature. Ce qui me reste de sa lecture, c'est le choc reçu au spectacle de l'affrontement meurtrier de deux mondes : d'un côté celui de la musique des grands (Bach, Beethoven, Chopin) et des rares qui se mettent au service de cette expression sublime de la vie à l'état pur (appelons ça l'amour de l'art) ; de l'autre celui d'un système où la musique n'est qu'une brique de prestige parmi d'autres, dans la muraille à l'abri de laquelle s'édifie l'avenir radieux du paradis socialiste, et qui à ce titre constitue la négation même de la vie.
Le pays totalitaire, ici, est pris dans une contradiction, un double impératif contradictoire : produire des musiciens qui permettent à la Bulgarie de rayonner dans le monde, mais tout faire, dans le même mouvement, pour qu'aucune tête ne dépasse.
Rien que pour l'exactitude radicale dans la peinture de cette bataille de fin du monde, merci monsieur Nikolai Grozni !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, frédéric chopin, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, bulgarie, communisme, sofia, virtuose, artiste, jean sébastien bach
lundi, 23 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 2/3
Résumé : je me demandais juste pourquoi Wunderkind, le livre de Nikolai Grozni, m’a secoué. C’est à cause de Chopin.
 « J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »
« J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »
Bien sûr, Grozni exagère. Il sait forcément que c’est injuste et faux, et que le mouvement lent de la sonate opus 106 de Beethoven ou l’adagio de son quatuor opus 132 (« Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart ») sont pour l’âme humaine d’autres Everest de sincérité absolue. Je note en passant qu’il n'ose pas citer Jean-Sébastien Bach dans sa liste des compositeurs qu’il juge impersonnels. Faudrait quand même pas abuser.
Quoi qu’il en soit, la musique de Chopin constitue le socle sur lequel est construit le livre, dont les chapitres, en même temps que les dates précises, s’ouvrent sur les morceaux de musique que travaille Konstantin, le jeune musicien qui raconte son existence au « Conservatoire pour Enfants Prodiges » de la capitale bulgare et communiste. Rachmaninov fait une apparition, Beethoven, Brahms et Moussorgski deux, Bach trois (eh oui), mais Chopin occupe royalement la première place, très loin devant : quinze chapitre sur vingt-cinq lui sont dédiés.
A ce sujet je me serais presque attendu à ce que les chapitres soient au nombre de vingt-quatre, comme il y a vingt-quatre tonalités dans la musique européenne, célébrées par Bach dans Le Clavier bien tempéré, nombre auquel Chopin lui-même a déféré en composant vingt-quatre Etudes (deux fois douze, opus 10 et 25) et autant de Préludes opus 28.
Je me fais une raison en me souvenant du motif pour lequel Georges Perec a fait exprès de composer La Vie mode d’emploi en quatre-vingt-dix-neuf chapitres et non pas cent, en souvenir de la petite fille de la publicité Lu qui a croqué juste un angle du petit-beurre. Grozni a fait en plus ce que Perec a fait en moins, en quelque sorte. S’est-il seulement préoccupé du nombre ? Pas sûr.
Ce qui m’a secoué, c’est ce que dit Grozni : la musique de Chopin, c’est une personne vivante, avec un épiderme d’écorché vif (si l'on peut dire) connaissant et portant la condition misérable de l’humanité tout entière. A propos de l’opus 20 : « Vadim se redressa, prit une profonde inspiration et déplaça les mains vers le haut du clavier, prêt à frapper le premier accord. Le Scherzo n°1 s’ouvre sur un cri de désespoir absolu : on s’éveille d’un cauchemar pour découvrir que tout ce qu’on a rêvé est vrai ». On trouve ça p. 41. Le Chopin de Grozni, il faut le chercher du côté du tragique.
Et puis : « Le second accord semble à la fois plus résigné et plus agressif : enfermés dans le sablier, on est condamnés à attendre. Prisonniers du temps, hors du temps, conscients de notre finitude. Puis vient la folie qui brise toutes les fenêtres, abat tous les murs, tourbillon de conscience cherchant la sortie. Se peut-il qu’il n’y ait aucun passage secret ? Aucune porte dérobée ? ». La vie, quoi. En plus intense.
Moi qui suis incapable de « voir » des circonstances, des situations ou des personnages (une « narration ») dans la musique (il faut dire que je n’essaie pas : pour moi, à tort ou à raison, les sons musicaux sont des abstractions, ensuite seulement viennent (ou non) les effets parfaitement concrets et physiques), voilà qu’un pianiste doué qui, en plus, sait écrire, met des mots jaillis de sa propre expérience, qui me font « voir » ce que cette œuvre raconte. Des propos que je trouve assez justes et pertinents pour en être intimement touché.
Attention, le Chopin que raconte Grozni n’a rien à voir avec l’éphèbe alangui, légèrement efféminé, que certains pianistes ont longtemps voulu voir, produisant des dégoulinades de sons mélodramatiques et narcissiques : essayez de jouer le Scherzo n°1, tiens, si vous n'avez pas des bras, des poignets, des mains et des doigts en acier !
Ce n'est pas non plus (au risque de paraître paradoxal) le Chopin qui a fait de Vincenzo Bellini son dieu, et qui demande à son piano de porter l'expression la plus accomplie de son profond amour pour le « bel canto » du maître italien de l'opéra (mort à trente-quatre ans, Chopin, mort à trente-neuf a un peu mieux résisté).
Le Chopin de Grozni est âpre, dur comme le granit. Un Chopin confronté à un monde qui, situé à une altitude très inférieure à celle où il a placé ses idéaux. Un Chopin qui affronte des épreuves morales d'une dureté qui met à mal son âme, voire la dévaste.
Mettons que ce Chopin-là s'appelle Nikolai Grozni et soit né en Bulgarie à l'époque de la décrépitude communiste, où plus personne dans le système ne sait où il en est. Où tout le monde s'accroche désespérément aux lézardes du mur. Qui ne tardera pas à tomber.
Avec Wunderkind, le lecteur est face à la figure d’un destin implacable : le Chopin de Grozni est en acier, blindé contre les forces de mort qui l'assaillent. Si c’était une embarcation, ce ne serait en aucun cas une gondole, mais un cuirassé puissant. Une fois le livre refermé, vous ne l'entendrez plus comme avant.
Le Chopin de Grozni est un navire de guerre lancé contre la mort.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, musique, chopin, beethoven, mozart, liszt, schumann, ravel, debussy, jean-sébastien bach, sonate opus 106, quatuor opus 132, brahms, rachmaninov, moussorgski, le clavier bien tempéré, georges perec, la vie mode d'emploi
dimanche, 22 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 1/3
Nikolai Grozni, Wunderkind, Plon, « Feux croisés », 2013

Je ne comprends vraiment pas l'expression de Patti Smith, "prose miroitante", posée bien en évidence sur le guéridon de l'entrée du volume.
Je le dis sans ambages : Wunderkind, du Bulgare Nikolai Grozni, n’est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Peut-être même n’est-il que pour quelques-uns (comme La Chartreuse de Parme, dont le point final s'écrit « to the happy few »). Ce que je ne souhaite pas à l’auteur. Car c’est un livre admirable. Mais Grozni n’a pas choisi la facilité, c’est le moins qu’on puisse dire.
Moi, il m’est rentré dans le chou direct et frontal. Je dirais comme Lino Ventura : « C’est du brutal ». Sauf que là, de la première à la dernière page, personne ne rit, ni les personnages, ni le lecteur. C’est un livre qui vous fait prendre un bain de granit : « Le ciel de Sofia est en granit ». C’est la première phrase. Or nager dans le granit, ce n’est pas évident. Un bain dans un passé sinistre pas si lointain : l’action commence à Sofia, Bulgarie, le 3 novembre 1987 et finit deux ans plus tard, au moment de la chute du mur de Berlin.
On passe trois cents pages enfermé dans l’étroite cellule qu’était un pays communiste où, quand on n’a pas à faire à un mouchard, c’est que c’est un bureaucrate ou un « agent en civil ». Parfois un militaire chargé d'enseigner l'éducation physique, armé de son Makarov 9 mm. En tout cas un médiocre qui peut à tout moment vous menacer de son pouvoir. L’effet est poignant. Comme le narrateur, le lecteur se sent à l'étroit, en permanence traqué par les yeux malveillants au service du « Parti ». Et les yeux sont partout, et ils cognent à l’occasion.
Car ce livre met le lecteur à l’épreuve. Comment fait l’auteur pour lui donner l’impression de passer par les épreuves où lui-même est passé ? Mystère. Ce qui est sûr c’est que c’est violent. Et d’autant plus violent qu’il raconte une guerre impitoyable. Cette guerre de destruction voit s’affronter deux ennemis : Frédéric Chopin et le Communisme (avec tout le système soviétique en prime). Et je peux vous dire qui a gagné : c’est Chopin. Mais à quel épouvantable prix !
Je dois dire, pour être honnête, que, comme lecteur, je suis dans une position singulière, qui ne fait pas de moi un élément statistique décisif. Car moi, Chopin, j’avais huit ans. J'étais vacant, donc disponible, il m’est tombé dessus. Pendant des jours et des jours, j’ai passé et repassé sur le Teppaz du 39 Cours de la Liberté la face du 78 tours où je n’ai jamais su quel pianiste (Braïlovski ?) avait gravé l’étude opus 25 n°11.
Combien de fois l’ai-je fait tourner, pour que le chant implacable et volontaire de la main gauche et les cataractes étincelantes de la droite soient définitivement imprimés, fondus ensemble dans les battements d’un cœur gros comme l’univers, au plus profond de mes profondeurs ? Quarante ? Cinquante ? Cent ? En tout cas, Grand-mère n’en pouvait plus et demandait grâce. J’étais impitoyable. J'avais une excuse : Chopin m’avait révélé la vraie vie.
Le plus étonnant : j’ignorais le nom du compositeur, seule la musique, pendant de longues années, est remontée régulièrement de tout au fond vers la surface, inoubliée et pour ainsi dire originaire, comme un événement fondateur, mais aussi comme un point aveugle. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché : quel enchanteur pouvait avoir écrit cette musique prodigieuse ? Je n’ai plus entendu ce morceau par la suite. Il vivait quelque part, comme un point d’interrogation obstiné.
C’est le hasard d’une programmation de France-Musique entendue sur un mauvais transistor, quelque part au fin fond de la Haute-Loire, qui m’a valu, beaucoup plus tard, de pouvoir enfin nommer l’œuvre et attribuer sa paternité au grand Polonais de France. Je le dis sans fioritures : une commotion ! Un ébranlement vertébral ! A l’instant même, je retrouvais le paradis perdu, pas moins. Je n’y peux rien : c’est comme ça que ça s’est passé.
Ensuite, mon carquois s'est garni d'autres flèches. Le Nocturne opus 48 n°1, par exemple, avec cet extraordinaire changement de tonalité qui suit l'exposé du thème, pour annoncer la brutale mutation de l'humeur, avant le retour à une sorte de paix, mais crépusculaire. Ou bien le Scherzo n°3 (op. 39), avec ses contrastes complexes qui déboulent (« presto con fuoco ») dans une sorte de folie furieuse. Mais l'Etude opus 25 n°11 gardera toujours pour moi le même ineffaçable aspect inaugural que « la première fille qu'on a tenue dans ses bras » (comme dit Tonton Georges).
Devenu le profond sillon dans lequel cette œuvre s’est déposée, je m’autorise à voir dans l’auteur de Wunderkind une sorte de frère éloigné dans l’espace et dans le temps, qui m’apporte soudain sur un plateau les mots et les phrases qui collent exactement à l’idée, jamais formulée, que je me faisais de la musique de Frédéric Chopin.
Là où il est très fort, c’est qu’il m’a fait découvrir des choses que je savais déjà.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nicolai grozni, bulgarie, roman, wunderkind, éditions plon, collection feux croisés, communisme, urss, guerre froide, parti communiste, sofia, musique, frédéric chopin, études opus 10, études opus 25, france musique
mardi, 17 juin 2014
GABRIEL TYR, PEINTRE

Ce tableau de Gabriel Tyr (1863) n'est pas au musée Crozatier du Puy-en-Velay, où sont rassemblées ses œuvres. Peut-être y sera-t-il un jour. Ci-dessous, un autre portrait (1857) : elle est pas mimi, la dadame au bonnet, avec ses anglaises amidonnées ? Et visez un peu le camée !
Je connais d'autres Gabriel. Peut-être celui auquel je pense avec prédilection parviendra-t-il à échapper, en prenant de l'âge, comme Tyr a su le faire, au fardeau qu'une vaine célébrité fait toujours peser sur ceux qu'elle a choisi d'écraser, et qui, trop souvent, n'ont pas mérité ça. Il ne faudrait jamais que la gloire (de même que le pouvoir) aille à ceux qui l'ont le plus ardemment désirée.

Gabriel Tyr (1817-1868) : né à Saint-Pal-de-Mons, mort à cinquante et un ans.
Entré à seize ans à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Travaillé avec Victor Orsel à la décoration de l'église parisienne de Notre-Dame de Lorette. Avec Alphonse Périn et Hippolyte Flandrin (qui a sa rue à Lyon, ce qui n'est pas une preuve de ... - de quoi, au fait ?).
On parle volontiers de son talent à réaliser pour la religion des œuvres « délicates, pures et lumineuses », mais il a aussi peint de très beaux portraits, dans lesquels il délaisse toute « anecdote » et toute fioriture pour que l'attention se concentre sur l'essentiel.
Saint-Pal-de-Mons est la riante bourgade natale du peintre, située dans l'arrondissement d'Yssingeaux, qui appartient au canton de Sainte-Sigolène, et rattachée à la perception de Saint-Didier-en-Velay.
Au recensement de 1990, mille cinq cent quarante-deux individus peuplaient neuf cent soixante-quinze logements (dont trois cent cinquante-huit résidences secondaires), répartis sur deux mille sept cent onze hectares, ce qui faisait alors une densité de cinquante-six virgule neuf habitants au kilomètre-carré. Il semblerait que la population dépasse aujourd'hui les deux mille âmes.
Les vingt kilomètres qui, en 1990, séparaient la commune de l'accès à l'autoroute n'ont pas dû varier significativement.
Impossible, en l'état actuel des choses, d'en savoir plus. Mais nous promettons au lecteur de le mettre au courant, dès que nous en aurons appris davantage.
*******
Dernière minute : nous avons de la chance. Nous apprenons qu'il se passe bien des choses à Saint-Pal-de-Mons. Ainsi l'installation sonore de l'église, connue pour ses pénibles effets de réverbération, a été entièrement rénovée. Le système de sonorisation choisi est composé de deux enceintes Rayon 100V Active Audio pour la nef de dix-huit mètres, de deux enceintes SM400i-WH pour le chœur, d'un ampli CXV 225 de Cloud, d'un lecteur CD CDT1U, d'un Furman PLPRODMCE pour la protection des éléments, d'un processeur numérique NUT ainsi que de microphones Clock Audio, dont la nouvelle application "Speech conformer" permet de régler automatiquement la hauteur en fonction de l'orateur. L'ambon a été doté d'un col de cygne C33ERF avec une embase XLR SM10, l'autel d'un col de cygne C34 ERF avec une embase S210. Les célébrations seront animées grâce à deux microphones HF main CW9000C. Ci-dessous un aperçu.

*******
Dernier arrivage : nous apprenons que Saint-Pal-de-Mons est une commune d'avant-garde. Impatiente d'essayer les merveilleux moyens techniques dont on a doté son église, elle a décidé d'organiser sa "Fête de la Musique" le 14 juin, avec l'excellente fanfare Zigomaclique.
Il était bon que cela fût su. Il est donc nécessaire que cela soit dit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, gabriel tyr, saint-étienne, lyon, saint-pal-de-mons, musique, sonorisation, église
lundi, 16 juin 2014
PLAISIR DE LIRE ARSENE LUPIN 2/2
Résumé : nous parlons du succès d'Arsène Lupin, fripouille de grande classe au charme fou, tour à tour cambrioleur de haut vol, bienfaiteur de la France (Le Triangle d'or, sans parler de L'Eclat d'obus, où il se montre poilu impeccable et intelligent), séducteur de ces dames, flic privé ou inspecteur (voire directeur : M. Lenormand) de police, prince (Sernine, Rénine, etc.) saltimbanque et funambule aristocrate.
Nous en étions restés à ce que la créature a comblé les attentes du créateur au-delà de ses espérances, et même au-delà du raisonnable. Les héros, dans l'esprit du public, ont phagocyté leurs auteurs, au point de faire disparaître le reste de leurs œuvres derrière le monument qu'ils sont devenus.
C’est arrivé à Sir Arthur Conan Doyle, comme tout le monde sait, qui avait en vain espéré tuer son Sherlock Holmes (dont il ne savait comment se défaire), au grand dam des lecteurs, qui obligèrent l’auteur à le ressusciter acrobatiquement (qui a lu les innombrables livres non Sherlock Holmes de Sir Arthur ?).
Mais le détective britannique, tout de froide cérébralité opiomaniaque et violonistique, ressemble à l’idée qu’on se fait de « l’Anglais » sorti d’Eton et fréquentant, comme le capitaine Blake et le professeur Mortimer (ah, Edgar Pierre Jacobs !), le « Centaur Club », quelque part dans Piccadilly, pour boire un sherry ou un whisky (servis par l’impeccable James). Auguste lieu où, quand un inconnu vous gratifie d'un « How do you do ? », vous êtes tenu de répliquer par un identique « How do you do ? », sinon ça fait tache.

Je veux dire que Holmes n’attire pas la sympathie. On admire (si l’on est amateur), on applaudit, mais on n’est pas « attiré » par le personnage. Il y a de la machine dans Sherlock Holmes. De la machine autant que de la voyante extralucide. Un être anormal, quoi. La preuve, c’est qu’il est à peu près asocial. Arsène Lupin, au contraire, on ne peut imaginer d’être plus sociable. Plus affable. Pour tout dire : plus escroc.
Ben oui, quoi, la première règle impérative qui s’impose, pour faire un bon escroc, c’est de se rendre sympathique, c’est bien connu : tous les vrais escrocs sont charmants. Condition sine qua non pour réussir le concours d’escroc professionnel : être « l’ami du genre humain». Si vous êtes plutôt du genre Alcestueux, aucune chance. Carrément rédhibitoire, même. En plus, Arsène a du talent : bourré d’élégance, son savoir-faire fait des merveilles, que ce soit avec les serrures les plus compliquées (l’énigme de Thibermesnil) ou avec les dames.
Car pour parler franchement, Maurice Leblanc, quand il élabore une intrigue, le fait à la paresseuse. Prenez, dans Les Confidences …, la nouvelle intitulée Le Piège infernal. Vous y croyez, vous, à la fille Dugrival ? On la suit depuis le début sous les traits d’un garçon ? Hop, le garçon devient tout d'un coup une jolie fille, qui libère Lupin avant l’irruption de Ganimard, parce qu’il lui a tapé dans l’œil et qu’elle en pince pour lui. Vous y croyez une seconde ?
Au fond, sans doute y a-t-il de l’escroc chez l’auteur lui-même. Chez lui, en effet, il y a quelque chose du camelot, dont on prend plaisir à écouter le bagou aussi longtemps qu’il parle, et dont on se rend compte à la fin qu’il nous a refilé de la camelote. Leblanc fait passer sa muscade au gogo derrière un incontestable talent de narrateur, mais il ne faut pas mettre le nez dans la mécanique policière, dans l’espoir d'amener au jour l’agencement impeccable d’une intrigue usinée par un orfèvre, genre Chase ou Chandler (encore que ...).
Une part de l’œuvre de l’auteur des Lupin repose sur l’esbroufe, la pirouette narrative, le coup de théâtre improbable (voir par exemple comment devraient finir des bouquins comme L’île aux Trente cercueils - la dalle qui se soulève au-dessus de la falaise à pic - ou La Demoiselle aux yeux verts - l'eau du lac qui envahit la caverne -, s’il n’y avait pas le « coup de pouce » de l’auteur pour sauver son héros et la femme qui lui tient compagnie, tous deux pourtant promis à une mort certaine).
On a la même impression dans la série BD de Vance et Van Hamme, XIII, qui raconte l’interminable ascension du héros amnésique vers sa véritable identité : la vérité s’obtient au moyen de torsions des faits relatés, d'enchaînements obtenus grâce à la formule "abracadabra", autant d’oublis opportuns de certains maillons de la chaîne, dont le lecteur est invité à ne pas remarquer l’absence.
Et le premier cycle des aventures du pauvre XIII tient quand même sur 19 épisodes (c'est vraiment l'époque des séries, tout le monde veut enchaîner le client à son boulet préféré, comme n'importe quel bagnard) vendus par dizaines de milliers ! L'amateur d'histoires veut croire en son héros. Son attention logique s'en ressent. Cela simplifie la tâche de l'auteur, qui peut alors laisser flotter les rubans, quand on attendrait qu'il édifie une intrigue en pierres de taille.
Dans l'épisode Rouge total, vous y croyez, à la façon dont les « bons» s'en tirent quelques secondes avant l'explosion, alors qu'ils étaient étroitement ficelés au fond de ce bureau souterrain fermé à quadruple tour, et retournent la situation comme par magie ? Du même ordre que « Zorro est arrivé» (sauf que Zorro, c'est l'auteur en personne). L'effet (de manche) prime sur la vérité et la logique.
Ce genre de narration repose sur le bluff. Maurice Leblanc aimait peut-être jouer au poker, vu son aisance à bluffer pour emporter la mise. Heureusement, c’est aussi la raison du plaisir qu’on a à lire les aventures d’Arsène Lupin. Au motif qu'aucun plaisir, même petit, même mitigé par une déception rationnelle, n’est à négliger.
Petite littérature peut-être, mais je ne sais pas ce qu'on ferait si elle n'était pas là.
Il n'y a pas que Balzac dans la vie. Je veux dire l'Everest. Il est maintes collines verdoyantes qui ont un charme fou.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, maurice leblanc, arsène lupin, arthur conan doyle, sherlock holmes, les confidences d'arsène lupin, l'île aux trente cercueils, la demoiselle aux yeux verts, zorro est arrivé, le triangle d'or, l'éclat d'obus, ep jacobs, blake et mortimer, xiii, vance et van hamme







