dimanche, 11 mai 2014
OMBRE SUR LE MUR
TELLE QUELLE : BIZARRE, NON ?
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
samedi, 10 mai 2014
LE MONDE DANS LA VITRE
09:01 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
vendredi, 09 mai 2014
FRANCOIS HOLLANDE INVENTEUR
Il était une fois ...
Un jour, dans l'histoire humaine, un homme a inventé le fil à couper le beurre. Un autre jour ce fut l'eau tiède. Encore un peu de temps passa, et puis ce fut la poudre qui, comme le dit Georges Brassens, n'est d'aucune utilité dans les choses de l'amour (« Mais pour l'amour on ne demande pas Aux filles d'avoir inventé la pou-ou-dre »). Et puis un jour naquit François Hollande, l'inventeur bien connu. Et l'univers entier entonna une antienne venue du plus profond des âges : « Halleluïa ! Gloria ! ». La ferveur était générale, l'humanité se jeta à genoux pour chanter : « Il est né le divin enfant ! ». « Enfin ! » fut le cri unanime.

En lisant ces mots, le lecteur encore sceptique se tapote le menton en posant la question : « Qu'a donc bien pu inventer ce dindon ? ». Eh bien il est temps de lever le voile. Monsieur François Hollande a inventé
LA FUMÉE SANS FEU.
Eh oui, monsieur François Hollande est passé maître dans l'art de produire de la fumée hors de toute production d'incandescence. En quelque sorte, il vapote. Il est passé maître dans l'art de produire des mots enfin détachés de toutes les pesantes réalités. C'est un artiste virtuose. Son art consiste à faire de la fumée sans feu.

BEL EXEMPLAIRE D'ENARQUE ISSU DE LA PROMOTION VOLTAIRE
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : france, société, politique, parti socialiste, françois hollande, ena, enarque, école nationale d'administration, promotion voltaire, humour
jeudi, 08 mai 2014
EUROPEENNES : VOTEZ PROUT
J’appelais il y a quelques jours (25 avril) à « voter prout ». Avec le sens habituel donné par la bouche populaire à une onomatopée malodorante (« A cul de foyrard toujours abonde merde », dit l’excellent Rabelais citant un proverbe du temps, c'est dans Gargantua, chapitre IX, intitulé « Les couleurs et livrée de Gargantua »). Mais il m’est revenu que le mot « prout » est aussi un nom propre.
Et pas n’importe quel nom propre : une frontière. Et pas n’importe quelle frontière : la rivière Prout sépare en effet la Roumanie de la Moldavie. Autrement dit, le Prout constitue l'extrême limite orientale de l’Europe. Et je signale accessoirement que l'est de la Moldavie (Transnistrie) sert de base à quelques troupes de l'armée russe.

Avant agrandissement, bien sûr (je parle de l'inexorable agrandissement de l'Europe conquérante ... quand je dis ça, excusez-moi, j'entends « prout », et ça sent mauvais) : le Prout est loin d’être infranchissable. Mais je ne suis pas sûr que la Russie de Poutine demande un jour prochain à adhérer à notre bienheureuse « Union Européenne ». Il paraît que le Bosphore non plus n'est pas infranchissable. A quand l'Europe de l'Atlantique à l'océan Indien ? Et plus si affinités, bien entendu.
La rivière Prout se jette dans le Danube un peu en aval de la ville de Galaţi (le ţ se prononce ts). Je me rappelle avoir traversé le Danube (Dunarea) non loin de ce confluent, avec famille, armes, bagages et véhicule, sur un vieux bac (1leu par personne, 17 lei pour la voiture, sauf erreur le leu est toujours la monnaie roumaine, une monnaie qui, à l'époque, m'a donné l'impression d'être une réincarnation de Crésus), à une époque où tout, en Roumanie, était vieux et noir. Telle était la ville de Galaţi.

VOUS CROYEZ QUE NOS JEAN NOUVEL A NOUS ONT DES LEÇONS A DONNER ?
Remarquez que, venant de Tulcea, on n’était pas trop dépaysé. En aval de Tulcea, on ne peut pas se tromper, c’est le delta du Danube (où il fallait éviter de boire l'eau du fleuve, non exempte de germes du choléra). Jolie ville, avec son « combinat » crachant ses épaisses fumées juste à côté de la « Promenade des Anglais » du coin, et ses énormes conduites de chauffage à ciel ouvert.

SI ON MET ICI LES CAPTEURS D' "AIRPARIF" (Qualité de l'air à Paris/Ile de France), ILS EXPLOSENT.
C'était l'époque où les Roumains roulaient tous (quand ils avaient les moyens de rouler, c'est fou le nombre de gens qui marchaient sur des routes interminables, les bras chargés de sacs plastique) en R 12 Renault, rebaptisées Dacia, dont ils ôtaient les essuie-glace le soir pour ne pas se les faire piquer pendant la nuit. Il y avait aussi, plus rares, des Visa Citroën, rebaptisées Oltcit, Olt pour Olténie je suppose, région natale du « Danube de la pensée » qui présidait à l'époque au destin du pays (Nicolae Ceaucescu).

AGRANDISSEMENT DES DEUX "R 12" APERÇUES PLUS HAUT : DANS CE VASTE IMMEUBLE, DEUX FAMILLES AU MOINS EN AVAIENT LES MOYENS.
Tout ça pour dire : « Votez Prout ». En même temps mettez un cierge et dites une prière pour que l’Europe, ce grand corps mou, quasi-paralytique, ce vieillard sénile sous tutelle, cesse un jour d’être le n’importe quoi qu’elle est actuellement, terrain de jeu de prédilection pour les marchands et autres spadassins des multinationales, et les pondeurs compulsifs de règlements et autres « directives ».
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je ne suis ni eurosceptique, ni "euro-hostile", ni europhobe. Au contraire, plus je vois la mondialisation mercantile, plus je sens profondes mes racines européennes. Un rêve, quoi. Seulement cette Europe-ci, cette Europe compliquée, concoctée par on ne sait qui, cette Europe déshumanisée, essentiellement procédurale, administrative et juridique, cette Europe de chefs de bureau et de cabinets d'avocats, sans compter les lobbies frénétiques, corrupteurs et puissants, ce gloubi-boulga d'Europe-marchandise, je dis juste : non merci, sans façon.
Ceux que ça intéresse pourront ici même, à propos de l'Europe, admirer Jean Gabin en savourant, que dis-je, en se délectant d'un flamboyant morceau de bravoure oratoire. C'est à l'Assemblée Nationale, dans le film Le Président (1961), d'Achod Malakian, alias Henri Verneuil. Dialogues de Michel Audiard, évidemment. L'extrait dure moins de douze minutes.
Je note pour finir qu'à la différence des Allemands, qui envoient à Bruxelles des députés qui prennent leur tâche à cœur et planifient leur action sur la longue durée et font preuve de professionnalisme, les députés que la France envoie sentent souvent ce poste comme une relégation ou une punition, souvent comme un lot de consolation du genre « faute de grives on mange des merles », après une déroute électorale (les « recalés », comme disent les journalistes). D'où l'absentéisme. Ensuite, demandez-vous pourquoi la France a perdu une grande partie de son influence. Ah ? Vous avez la réponse ? Moi aussi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élections européennes, europe, rabelais, gargantua, prout, rivière prout, roumanie, moldavie, transnistrie, frontière, armée russe, vladimir poutine, danube, renault, dacia, euroscepticisme, eurosceptique
mercredi, 07 mai 2014
REFLETS
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
mardi, 06 mai 2014
PLACE BELLECOUR
VU DANS UNE ENTREE D'IMMEUBLE
LA MÊME, AVEC ZOOM
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, place bellecour
lundi, 05 mai 2014
AUTOPORTRAIT
1 MAI 2014, 19 H 29
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
dimanche, 04 mai 2014
BAUDRUCHES DE FRANCE
LE JOURNALISTE ET LE POLITIQUE (FABLE)
Ahurissant non ? Je parle de la mauvaise farce que les députés viennent de nous jouer. Mais si, vous savez : « pacte de stabilité », ça s’appelle. Est-ce que Valls va passer ? Combien de députés socialistes vont se rebiffer au moment de voter ? Ah, être « homme politique » ! Le pied ! L’extase ! En fait qu’est-ce qu’on voit ? Une cour de récréation, où des sales gosses jouent aux grandes personnes. « Toi tu serais de gauche. – Ah non ! C’est moi qui l’ai fait la dernière fois ! – Mais tu serais de gauche pour du beurre ! … ». Etc. Gamins, va ! Des mômes et des mômeries.
Je ne leur demande pas d’être des surhommes, ni même des « hommes providentiels ». Je voudrais juste que les « hommes politiques » qui gouvernent la France, ou qui aspirent à la gouverner, soient à la hauteur de la tâche, à la hauteur de leurs ambitions. Bref, à la hauteur tout court.
Et ce n’est pas la façon dont ces farces sont commentées par les professionnels de l’ « information politique » qu’on appelle les « journalistes politiques » qui peut nous convaincre que cette hauteur attendue est atteinte.
C’est même drôle (hum !) de constater que la vie politique française fonctionne sur la base de ce couple infernal étroitement enlacé qui danse pour nous le même tango dérisoire que celui raconté par le grand Hermann dans Sarajevo Tango, pour dénoncer la lâcheté impuissante de l'ONU, en pleine guerre de Bosnie : l’homme politique est inséparable du journaliste politique, à tel point qu’ils exécutent devant nous un ballet obsessionnel, mais bien réglé. Je dirai même minutieusement codifié.

ON LES A OUBLIÉS (ET ON A BIEN FAIT) : BOUTROS GHALI, C'ETAIT L'ONU, JE SUPPOSE QUE L'AUTRE FIGURE L'OTAN.
Soit dit par parenthèse, Hermann avait figuré la même lâcheté impuissante de l'insaisissable « communauté internationale lors du siège de Sarajevo par ce qu'il avait appelé des « Gros Doigts Grondeurs », c'est-à-dire ni plus ni moins que des baudruches, mais internationales cette fois.

On a entendu de semblables risibles menaces il n'y a pas longtemps, à propos de certaine « ligne rouge », qu'Assad ne devait en aucun cas franchir en Syrie (ça voulait dire la guerre chimique, dans la mouche d'Obaba, pardon, dans la bouche d'Obama. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon couple de danseurs mondains tendrement enlacés : le journaliste politique et l'homme de mêmes acabit, texture et teneur en inconsistance. Je me dis que si l'on mesurait le taux d'inconsistance de nos personnels d'élite nationale avant de les autoriser à exercer, ça ferait de la place aux initiatives nouvelles.
L’un des partenaires est donc le journaliste franco-français, pour ne pas dire franchouillard. Celui qui est spécialisé dans la relation, l’analyse et le commentaire de ce qu’on appelle la « politique intérieure ». Son instrument favori et principal est le microscope.
Ben oui, il faut bien un microscope pour donner à des micro-événements assez d'épaisseur pour faire croire aux gogos qu'il s'agit de vrais événements grandeur nature ! Qu'on se le dise, dans le secret de leur bureau, les journalistes politiques de France sont outillés de microscopes à balayage électronique pour le moins, et même peut-être de microscopes à effet tunnel !
C’est le minimum pour observer les micro-événements qui se produisent dans le bouillon de culture qui stagne dans le minuscule bocal où grenouillent un certain nombre de centaines de politiciens qui croient tirer les ficelles du monde, alors qu’ils ne sont que des schtroumpfs qui pataugent dans le marigot ! Des galapiats qui se courent après et se disputent dans la cour de récréation. Aux frais de la République. Sous l'œil microscopique de journalistes dont la rémunération est suspendue à leur art du grossissement à l'infini.
Ils se tiennent tous tellement par la barbichette qu’il ne se passe en réalité jamais rien de notable. Disons le mot : en matière de politique intérieure, en France, il ne se passe rien ! Et le plus fort, c’est que le journaliste politique a tout l’air de croire à l’importance effective du spectacle qui se déroule sous ses yeux. Ou alors il sait rudement bien faire semblant d’en être captivé.
Parce que je ne sais pas si vous serez d’accord, mais les attractions minable du cirque minable où évoluent les clowns de troisième zone et autres hommes caoutchouc de la politique qui nous gouvernent, les Français en mangent dans les médias plus souvent qu’à leur tour. A croire qu'il n'y a rien de plus important que de disséquer la moindre velléité d'action d'untel ou la moindre petite phrase d'autretel.
A en croire les faramineux temps d’antennes et les surfaces imprimées que leurs valets d’écurie (pardon, les « journalistes politiques ») leur consacrent, on pourrait croire que le sort de la planète se joue dans les bacs à sable élyséens, dans les aires de jeux élaborées pour que les gosses de Matignon, des palais Bourbon et du Luxembourg se dégourdissent les jambes à la récréation. Une indigestion !
Tout ça parce que les « journalistes politiques » sont armés d’un microscope électronique qui leur permet de faire croire à tout le monde (mais qui y croit vraiment ?), en grossissant dix mille fois les micro-événements qu’ils narrent dans les moindres détails des aspérités et mini-vaguelettes, que le sort de la France dépend des questions qu’ils posent aux gamins qui font du toboggan et du cheval à bascule à la tête de l’Etat. C’est vrai que plus leurs acrobaties paraissent importantes, plus le « journaliste politique » est fondé à se gonfler d’importance.
Tas de baudruches, va ! Tas de « Gros doigts Bluffeurs » !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalisme, journalistes, presse, journaux, politique, société, france, assemblée nationale, députés, bande dessinée, hermann, sarajevo tango, guerre de yougoslavie, guerre de bosnie, onu, bachar el assad, syrie, barack obama, palais bourbon, palais luxembourg, palais élysée, françois hollande
vendredi, 02 mai 2014
QU'EST-CE QUE C'EST ?
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
mercredi, 30 avril 2014
QU'EST-CE QUE C'EST ?
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
mardi, 29 avril 2014
REBONJOUR MONSIEUR MAIGRET
Ce doit être la fatalité, ou alors une malédiction, allez savoir. Depuis que j’ai fait le tour du monde de l’écrivain Henri Bosco, quand j’ouvre un bouquin d’un écrivain, je me sens obligé d’ouvrir les autres. Ça s’est passé comme ça avec Balzac, voilà que ça se reproduit avec Georges Simenon. Pour le moment, j'en suis à une dizaine de Maigret. Cela veut peut-être dire que j'y trouve un intérêt. Lequel ?
M. Gallet, décédé (1930)
Apparemment, c’est un crime : dans une auberge de Sancerre, un homme est mort. Non seulement il a la joue arrachée par une balle tirée d’une distance ce sept mètres, mais il a dans le flanc, l’entaille d’un poignard qui a touché le cœur. C’est M. Gallet, représentant de la maison Niel et Cie pour toute la Normandie, et à ce titre supposé à Rouen. Du moins si l’on en croit la carte postale expédiée de cette ville par son mari. Elle croit à une erreur.
Ce n’est pas une erreur. C’est une imposture : il y a douze ans que la maison Niel et Cie a remercié M. Gallet, douze ans que celui-ci fait semblant d’aller vendre sa camelote en simili-argent, alors qu’en réalité, sous l’alias de M. Clément, il écume toute l’aristocratie finissante quoique royaliste, pour lui soutirer des sous au prétexte de « défense de la cause ». Eh oui, M. Gallet alias Clément était devenu un vulgaire escroc.
En fait, quand il est né, M. Gallet ne portait pas ce nom, mais celui ô combien plus prestigieux de « de Saint-Hilaire ». Malheureusement, dernier rejeton de la famille, il s’est retrouvé tellement désargenté qu’il a accédé à la demande de l’ambitieux et dynamique Gallet de lui vendre son patronyme. J’espère que vous suivez : Saint-Hilaire n’est pas plus Saint-Hilaire que Gallet n’est Gallet, ni même Clément.
Pour faire simple, autant on avait, dans Pietr-le-Letton, le dévoilement d’une gémellité, source de la mystérieuse confusion d’identité entre deux frères, dont l’un était le chef de bandes internationales de perceurs de coffres et de murailles, autant on a, dans M. Gallet, décédé, une confusion d’identités reposant sur une substitution. Drôle quand même de constater que les deux premiers Maigret développent ce même thème de l’identité vue sous l’angle judiciaire, non ?
Même si la chute (la solution, si l’on veut) est pour le moins tirée par les cheveux. Ce jumeau de bandit qui a toujours été fasciné par son frère et qui pourtant, au début du bouquin, le tue dans les toilettes du train pour prendre sa place à la tête du réseau criminel, bon, je veux bien, mais bof. Quant à la façon dont le soi-disant « M. Gallet » organise son suicide de façon à faire porter les soupçons d’un crime sur le soi-disant « Saint-Hilaire », franchement, je me dis que Simenon pousse le bouchon.
Ce qui est rigolo, c’est que ces bouquins se lisent très bien malgré tout. La façon dont l’auteur semble mettre le lecteur à la place du commissaire et de lui donner ses yeux, ses oreilles, voire son cerveau, constitue selon moi la caractéristique principale de son « style ».
Cela me donne l’impression (je dis bien l’impression) d’en être toujours au même point que Maigret dans le suivi de l’enquête. Au moins au tout début. Même si je sais qu’à partir d’un moment, celui-ci prend de l’avance sur moi, que son pas s’accélère et que ses certitudes prennent une consistance pour des raisons qui nous échappent. Ce qui attire dans les Maigret tient peut-être tout simplement au rythme. Ou plutôt au tempo, d'abord plutôt lent (c'est quand Maigret patauge). Au deux tiers, on sent que la silhouette du commissaire se redresse, qu'il respire mieux, que ses épaules retrouvent leur carrure.
Bon, c’est sûr qu’il s’agit d’une technique : le romancier met son protagoniste et son lecteur sur la même ligne de départ, comme si celui-ci était l’égal du policier. Il entre de plain-pied dans l’histoire, familièrement en quelque sorte. A l’écrivain, ensuite, de lui démontrer qu’un bon flic façon Maigret, s’il est devenu un commissaire dont le nom apparaît régulièrement dans les journaux, c’est pour la raison qu’il a une forme de supériorité.
Je me demande si ce n’est pas ce mélange de proximité égalitaire (« mon semblable, mon frère... ») et d’ascendant distancié (« et voilà le travail, petit ! ») qui a fait le large succès du commissaire Maigret. Familiarité et supériorité, en somme.
Simenon, ce dragueur impénitent – qui déclarait sans forfanterie apparente avoir « possédé » 3000 femmes dans sa vie – a appliqué dans ses œuvres un principe analogue en littérature et en amour. Mettre le lecteur dans sa poche ou une femme dans son lit suivait la même marche à suivre.
D’une part tu t’intéresses à la mignonne en te mettant à sa portée et tu t’efforces de la mettre en valeur, d’autre part tu te débrouilles pour produire à la fois, à ton propre sujet, l’impression d’un mystère capable de la captiver et de la promesse de son dévoilement. On appelle ça la séduction. Ses polars semblent obéir à la même logique séductrice.
Ça a l’air simple, dit comme ça. La force de Simenon est d’avoir élaboré les principes de la chose et de les avoir mis en œuvre.
La théorie et la pratique, quoi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature policière, polar, roman policier, commissaire maigret, georges simenon
dimanche, 27 avril 2014
BONJOUR MONSIEUR MAIGRET
MAIGRET ET LA JEUNE MORTE
Je viens de lire Maigret et la Jeune Morte. Pas de quoi se relever la nuit pour l’apprendre par cœur. Le positif de la chose, c’est que c’est vite lu. Je veux imaginer que Simenon avait la modestie de ne pas se prendre pour un grand écrivain, et qu’il ne prétendait à rien d’autre qu’à gagner beaucoup d’argent en publiant ses histoires. Je crois qu’il le disait lui-même : l’écriture d’un roman lui prenait environ trois semaines. Quand ce n'était pas trois jours.
J’avais lu je ne sais plus où qu’il avait adopté, pour écrire, un rituel immuable. Il s’installait le matin à son bureau, devant sa pile de feuilles blanches avec, à portée de sa main droite la pile des dizaines de crayons qu’il avait taillés la veille, avant d’aller déjeuner, dans le taille-crayons mécanique fixé au bord, sur un côté, parce qu’il ne supportait pas de s’interrompre pour le faire en cours d’écriture. Et qu'il ne supportait pas d'écrire quand la pointe du crayon était trop émoussée.
Maigret, dans cette histoire terne, ressemble à Maigret : vieux. A-t-il un jour été jeune ? C’est douteux. Le personnage est forcément un vieux de la vieille, un renard expérimenté à qui on ne la fait pas. Faut pas le prendre pour un canard sauvage ou un perdreau de l’année. La preuve qu’il est célèbre, c’est que son nom est connu des autres personnages du roman.
Il suffit qu’il leur dise son nom pour qu’ils déballent ce qu’ils savent. Ils se mettent alors en quatre. A se demander si les acheteurs des « Maigret » n’ont pas fait leur succès en s'imaginant témoins interrogés par le célèbre commissaire. Il a suffi pour cela, en somme, que l’auteur atteste la renommée incontestable de son policier pour qu’elle devienne effective dans la société réelle. Le nom du personnage sur le même piédestal que celui de son inventeur ! Bel exemple d’une campagne d’autopromotion réussie.
L’histoire ? On s’en fiche. Une fille est retrouvée morte, une nuit, sur une place déserte, le crâne défoncé. Simenon ici fait de Maigret un psychologue : c’est en s’efforçant de cerner la personnalité de la fille et de se pénétrer de l’essence de son caractère qu’il découvrira le meurtrier, un malfrat bien connu de lui.
En attendant, il nous balade dans Paris, à la rencontre d’une ribambelle de personnages minables, de meublés crades en chambres sordides, avec les détours obligés par le « Quai » (des Orfèvres) et le Boulevard Richard-Lenoir (où le commissaire habite et où l’attend l’éternelle Germaine armée de son éternel ragoût). Il agrémente ici le tableau en doublant la silhouette compacte de Maigret de celle, fantomatique, de l’inspecteur Lognon, dit « le Malgracieux », sorte de « loser » indécrottable, tenace et malchanceux.
La première chose que le lecteur cherche quand il ouvre un « Maigret », ce sont des pantoufles. Façon de parler, bien sûr. Ce que je veux dire, c’est que les livres de Simenon, y compris la foule innombrable des romans privés du commissaire, forment une littérature confortable, une littérature de coin du feu et de fauteuil profond. Une littérature d’intérieur douillet et de décor familier.
Je sais que j’exagère, parce que, ayant refermé Maigret et la Jeune Morte, j’ai enchaîné sur Pietr-le-Letton, qui est le premier (publié en 1929) épisode qui met en scène le « commissaire Maigret » en tant que protagoniste. Et Simenon sait dès ce moment qu’il sera un personnage hautement récurrent. Or, dans Pietr-le-Letton, il lui en arrive, des choses, au commissaire : il prend une balle de revolver dans les côtes, il marche dans la boue jusqu’aux genoux, bref, il paie de sa personne, je veux dire physiquement.
Il faut donc nuancer. Disons que Maigret, au fur et à mesure que son inventeur avance en âge, a tendance, comme lui, à s’embourgeoiser. C’est un peu ce que Simenon sous-entend dans La Naissance de Maigret : « J’ai maintenant soixante-trois ans, Maigret environ cinquante-deux. Lorsque je l’ai créé, à vingt-cinq ans, il en avait quarante-cinq. Ainsi a-t-il eu la chance de vieillir beaucoup moins rapidement que moi et sans doute lui garderai-je encore longtemps son âge actuel ».
En clair, en trente-huit ans, Maigret en a juste pris sept. Après tout, en presque un demi-siècle (des Soviets aux Picaros, je ne compte pas le posthume Alph-art), Tintin aussi a gardé l’éternel même âge indéterminé. Même sa houppe n’a pas pris une seule ride. Simplement, dans les « Maigret », au fil du temps, le ragoût de Germaine et les pantoufles prennent davantage d’importance.
Inversement, j’imagine que Simenon a de moins en moins éprouvé le besoin de décrire son commissaire. Dans Pietr-le-Letton, il en précise la silhouette : « Lui restait là, énorme, avec ses épaules impressionnantes qui dessinaient une grande ombre. On le bousculait et il n’oscillait pas plus qu’un mur ». Voilà qui est dit.
Ce qui ne change pas en revanche, de ce premier Maigret à Maigret et la Jeune Morte (1954), c’est la façon dont l’intrigue avance, la façon dont l’auteur opère le dévoilement progressif de ce qui fait le nœud et le nerf de l’intrigue : posément, méthodiquement, implacablement. On pardonnera à Simenon d’avoir tué dans Pietr-le-Letton son inspecteur Torrence, qui reviendra dans un des rôles d’indispensables bras droits du commissaire. Après tout, même chez Balzac, il y a parfois des problèmes de « raccords ».
Je laisserai de côté les considérations sur l’art de Simenon de peindre des « ambiances », des « climats », des « atmosphères ». Je garderai seulement la nette impression qu’aux yeux du romancier, les individus ont plus souvent l’air crapoteux que l'apparence de belles âmes. L'image la plus constante qui se forme à la lecture des « Maigret » (mais aussi des autres romans), est celle d'une population faite de petitesse, de crasse et de médiocrité. Maigret se meut dans un univers gris et bas. Parfois gluant.
L’impression aussi qu’il observe l’humanité souffrante et grouillante comme s’il était assis en spectateur de l’autre côté de la vitre de l’aquarium où elle évolue, le plus souvent péniblement et laborieusement, mais aussi, à l'occasion, avec la cruauté de qui n'a aucune gratitude envers les parents qui l'ont fait naître. Ses congénères de marigot n'ont aucun geste secourable à attendre de lui. L'empathie n'est pas son fort.
L'œil de Georges Simenon est un organe froid. En même temps qu'une curiosité (toujours clinique, parfois étonnée) d'entomologiste chevronné, sa littérature respire l'indifférence.
Mais comment dire, une indifférence fascinée.
Une indifférence passionnée. Qui rappellerait presque, de loin, le Louis-Ferdinand Céline de Mort à crédit. Ou alors La Vie des insectes de l'entomologiste Jean-Henri Fabre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : polar, littérature, littérature policière, georges simenon, maigret, commissaire maigret, quai des orfèvres, loui-ferdinand céline, mort à crédit, pietr-le-letton, maigret et la jeune morte, tintin
vendredi, 25 avril 2014
EUROPEENNES : VOTEZ PROUT !
La Grèce va mieux. Youpi !

Le Monde daté du 23 avril nous invite à l'optimisme. C'est dans son supplément

Mais catastrophe ! Le même jour, dans le corps du journal cette fois, dans la rubrique « International », voilà ce qu'on lit (page 5) :

Avec, extraite de l'article, une citation synthétisant un point essentiel :

Je suis perdu. Dites-moi, je vous en supplie, qui il faut croire. Est-ce Le Monde ? Ou alors est-ce Le Monde ? Quelle main faut-il serrer ? La droite, qui se félicite de la bonne santé des banques ? La gauche, qui présente un bilan de la mauvaise santé des individus ? Eh bien ça dépend de ce qu'on regarde, les vrais gens ou l'argent. Mais on risque de se démancher la vision et de se mettre à loucher.
Belle image de ce qu'est l'Europe : entre les gens et l'argent, l'Europe a fait son choix. Les gens ? Peuvent crever ! L'argent ? Faut le sauver ! Le Monde, lui, se contente de relever, d'enregistrer et de juxtaposer les deux informations. Neutre, on vous dit ! Neutre jusqu'à la moelle des os. Plus neutre, tu meurs ! Comme un Grec ! Stoïque !
Brice Couturier, chroniqueur sur France Culture, a lui aussi fait son choix : il se félicite de la santé retrouvée des banques grecques. Il s'est rangé fièrement du côté de l'Europe. Tant pis pour les Grecs concrets. Brice Couturier n'aime pas les gens.
A la place des Portugais, je me méfierais : la "troïka" s'intéresse de près aux finances (donc aux banques) du Portugal. Faites gaffe, le peuple ! Faites gaffe les vrais gens ! Faites gaffe, les individus vivants ! Quand la structure se porte à merveille et que l'individu agonise, il y eut un temps où il y avait des Hannah Arendt pour appeler ça "totalitarisme".
Une belle preuve que l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui n'a pas de plus grand ennemi que la chair et les os des peuples, quand ils se permettent de péter de travers. Et même plus simplement quand ils se permettent d'exister. Et je ne parle pas de l'Ukraine.
Un seul bulletin dans l'urne aux européennes : votez
PROUT !
Et ce n'est pas le rapport que vient de publier Transparency International qui risque de me faire changer d'avis (mes excuses pour le choix du site auquel renvoie le lien : j'ai pris le premier venu, et j'ignore tout du PRCF, même si je me doute "d'où il parle").
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, europe, crise financière, france culture, brice couturier, élections européennes, presse, journaux, journal le monde, économie, entreprise, système de santé, banques
jeudi, 24 avril 2014
QUE PEUT LE POLITIQUE ?
DE L’IMPUISSANCE DU POLITIQUE 4/4
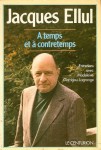 Oh certes, ce n’est pas le pouvoir de décider. Mais, pour revenir à Jacques Ellul, il signale dans son livre d’entretiens A temps et à contretemps (avec Madeleine Garrigou-Lagrange) qu’il était obligé de se fier aux auteurs des dossiers qu’on lui présentait, sans en connaître précisément le contenu, encore moins les tenants et aboutissants : « On me fournissait des dossiers qui ne s’appuyaient pas sur des études sérieuses ou encore on me demandait de donner ma signature, juste ma signature ». Mais lui au moins, il n’a envisagé qu’un court instant de faire carrière dans la politique.
Oh certes, ce n’est pas le pouvoir de décider. Mais, pour revenir à Jacques Ellul, il signale dans son livre d’entretiens A temps et à contretemps (avec Madeleine Garrigou-Lagrange) qu’il était obligé de se fier aux auteurs des dossiers qu’on lui présentait, sans en connaître précisément le contenu, encore moins les tenants et aboutissants : « On me fournissait des dossiers qui ne s’appuyaient pas sur des études sérieuses ou encore on me demandait de donner ma signature, juste ma signature ». Mais lui au moins, il n’a envisagé qu’un court instant de faire carrière dans la politique.
Car lui, ce qu’il voulait, c’est proprement exercer une action sur le réel, une action dont le but unique était de modifier les structures mêmes de l’organisation sociale. Il a abandonné quand il a vu que ce n’était pas possible :
« Et nous nous sommes heurtés par exemple au quadrillage des partis politiques traditionnels, exactement les mêmes qu’avant-guerre. Les radicaux-socialistes et les socialistes notamment, avec leurs permanents, bloquaient rigoureusement tout. (…) Et nous nous trouvions en présence de vieux matois chevronnés qui savaient comment on fait une réunion politique et comment on la bloque. Les réseaux politiques se sont reconstitués instantanément. C’est lors de cet échec et de ces manipulations que j’ai conçu une défiance et même une détestation à l’égard des milieux politiques. Je ne parle pas seulement de la classe politique dirigeante mais de la micro-classe, des responsables de sections et de comités à l’échelon local, c’est désolant et irrécupérable ».
Cela a beau être dit en 1981 à propos des années suivant la Libération, qui contesterait la validité d’un tel propos, une fois appliqué à la situation de la France aujourd’hui ? On peut toujours nous bassiner, à longueur de télévision, de radio et de journaux que la France est une société bloquée du fait de la crispation des Français sur les avantages acquis ou des fonctionnaires cramponnés à leurs privilèges, ce discours accusatoire ne tient plus debout.
Ce qui est sûr, c’est que les bonnes volontés qui se sont manifestées à l’occasion d’un séisme comme la 2ème guerre mondiale, ont vite été mises au pas, prises en tenaille entre l’élite administrative des hauts fonctionnaires de l’Etat et une classe politique soucieuse de se rétablir et de se conserver. Jacques Ellul était sans doute naïf en 1945, mais une fois refermée la parenthèse de l’Etat français pétainiste, la vie normale a repris son cours, avec les mêmes structures, la même organisation et les mêmes mécanismes. Aucune bonne volonté ne résiste à la puissance d’une telle inertie.
Or une structure, dès lors qu’elle existe, veut à tout prix se pérenniser. Comme dans la fourmilière, où peu importe l’identité de chaque fourmi, pourvu que la fonction soit exercée au bénéfice de la fourmilière entière, l’Administration existe par elle-même. La tête du ministre peut changer, les services demeurent, avec leurs habitudes, j’allais dire leurs routines.
Il y a fort à parier qu’un tel système est irréformable. S’il vient à l’idée de monsieur Manuel Valls de vraiment « réformer en profondeur » (comme il l’annonce et comme cela se susurre avec complaisance), n’en doutez pas : la réforme se fera aux dépens du peuple. Ne comptez pas sur les élites politiques pour se réformer. Ne comptez pas non plus sur les élites administratives qui composent la haute fonction publique pour accepter que quiconque leur impose de se réformer.
Or les élites politiques et les élites administratives (auxquelles il faudrait ajouter les élites économiques et médiatiques) constituent le cœur du système qui conduit la France aujourd’hui. J’attends de tous ces gens confortablement installés dans l’existence un signe qui me permettrait de ne pas désespérer d'eux et des leurs gesticulations bavardes, médiocres et impuissantes.
Par exemple, ils pourraient passer aux aveux, comme Lionel Jospin, alors premier ministre, avait commencé à le faire, avant de se faire balayer par Le Pen en 2002. Et pourtant, qu'avait-il dit comme énormité ? Ah oui : « L'Etat ne peut pas tout ». Comme Rocard autrefois, avec son : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». L'expression "... ne peut pas ..." est un tabou absolu. Un homme politique qui avoue son impuissance à façonner le réel commet un suicide politique. Il sait que s'il déroge au principe sacré du « N'avoue jamais », politiquement cramé, il met fin à sa carrière.
C'est la raison pour laquelle nous pouvons attendre longtemps. La classe politique française, en chemise et la corde au cou, façon Eustache de Saint Pierre et Bourgeois de Calais en 1347, ce n'est pas pour demain. C'est dommage : ç'aurait été particulièrement jouissif. Pour une fois.
Voilà ce que je dis, moi.
NB : Il va de soi que je n’ai pas parlé ici des contraintes qui pèsent sur les politiques français du fait de la « construction européenne » (laissez-moi pouffer, quoique jaune) ou de la « mondialisation économique », deux raisons supplémentaires de désespérer de l’avenir. Inutile, je crois, d’en rajouter.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, morale, jacques ellul
mercredi, 23 avril 2014
QUE PEUT LE POLITIQUE ?
DE L’IMPUISSANCE DU POLITIQUE 3/4
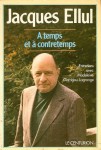 Le ministre « compétent », vous savez, celui qui « connaît ses dossiers », n’est donc en soi presque rien. Car ce qu’il a ingurgité avant un débat parlementaire ou avant de se faire cuisiner par une meute de chiens journalistes dressés à montrer les crocs et à caresser ses mollets, ce n’est rien d’autre que de la note de synthèse à la file, jusqu’à en perdre l’appétit.
Le ministre « compétent », vous savez, celui qui « connaît ses dossiers », n’est donc en soi presque rien. Car ce qu’il a ingurgité avant un débat parlementaire ou avant de se faire cuisiner par une meute de chiens journalistes dressés à montrer les crocs et à caresser ses mollets, ce n’est rien d’autre que de la note de synthèse à la file, jusqu’à en perdre l’appétit.
Conclusion : « Je me suis dit finalement : si c’est ça la situation d’un conseiller municipal, qu’est-ce donc pour un ministre qui ne reçoit pas trente dossiers mais trois ou quatre cents ! On se trouve dans la dépendance des services » (Jacques Ellul).
Le ministre, tout fiérot et fringant qu’il paraisse, n’est en effet rien d’autre qu’un « premier de la classe » qui continue, trente ans après avoir quitté les bancs du lycée, à apprendre par cœur ses leçons pour les réciter ensuite. Sa seule part de créativité, ici, consiste en la façon qu’il a de « mettre en musique » le texte pondu par ses sous-fifres, chefs et sous-chefs de bureau. Le ministre, par lui-même, n’est rien. A la rigueur un plastron, parfois un faux-nez. En réalité, le ministre n’existe pas. Ce qui existe, c’est l’ADMINISTRATION.
Une preuve tout à fait actuelle ? Regardez la bisbille qui vient de faire des étincelles entre le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Economie et des Finances. Laurent Fabius voulait que tout ce qui relève du Commerce Extérieur soit rattaché au Quai d’Orsay. Des voix « autorisées » jugent cette demande rationnelle et justifiée.
Que croyez-vous qu’il arriva ? François Hollande accéda à la requête de Fabius mais, pour ne pas se mettre à dos Montebourg, qui hurlait comme un goret qu’on va égorger, décida que, certes, l’autorité habilitée à diriger ce service serait transférée aux Affaires Etrangères, mais que le dit service serait maintenu physiquement à Bercy. Un coup de pommade pour Fabius, pour que rien ne change et que l’essentiel reste en place. Belle paralysie en perspective.
Moralité ? C’est la patte terriblement griffue des hauts fonctionnaires de Bercy qui est la plus forte : quand elle tient une proie, elle ne la lâche plus. Car le poids politique d’Arnaud Montebourg, s’il est certes réel, ne saurait expliquer à lui seul la décision de François Hollande de faire plaisir à tout le monde. Sans doute ce qu’on appelle la « synthèse ». Si François Hollande avait été Salomon, il aurait fait trancher le bébé tout vif pour en donner une moitié à chacune des mères.
L’Ecole Nationale d’Administration vomit ainsi chaque année autour d’une centaine d’individus passés maîtres dans l’art de la confection de dossiers, de la rédaction de « notes de synthèse » en vue de la « préparation à la décision ». Inutile de préciser que tous ces « Grands Serviteurs de l’Etat », selon le point d’avancement dans leur carrière, détiennent, du fait du poste qu’ils occupent, ce qu’il est convenu d’appeler un « pouvoir ».
Un pouvoir indissolublement lié à la capacité du fonctionnaire à aller au-devant des besoins du politique censé tout diriger. La servilité inhérente à une telle anticipation s'apparente en effet méchamment à l'exercice d'un vrai pouvoir qui ne dit pas son nom.
Voilà ce que je dis, moi.
mardi, 22 avril 2014
QUE PEUT LE POLITIQUE ?
DE L’IMPUISSANCE DU POLITIQUE 2/4
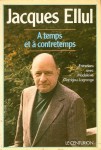 Il a fini par déchanter : « J’ai appris le peu de marge d’action de l’homme politique, et le poids de l’administration. Et précisément, dans la mesure où cela se situait dans une période troublée, où en apparence on repartait presque à zéro et où les structures auraient pu être remises en question. Or c’est là que j’ai appris par exemple l’incroyable dépendance à l’égard des services administratifs ». Et il n’est que conseiller municipal, pas ministre. Et comment se rend-il compte du « poids des services » ?
Il a fini par déchanter : « J’ai appris le peu de marge d’action de l’homme politique, et le poids de l’administration. Et précisément, dans la mesure où cela se situait dans une période troublée, où en apparence on repartait presque à zéro et où les structures auraient pu être remises en question. Or c’est là que j’ai appris par exemple l’incroyable dépendance à l’égard des services administratifs ». Et il n’est que conseiller municipal, pas ministre. Et comment se rend-il compte du « poids des services » ?
Oh c’est très simple à comprendre : recevant de trente à quarante dossiers à régler et boucler dans la journée, il n’a évidemment pas le temps de travailler sérieusement sur chacun. A peine celui de survoler à grands coups d’ailes. Et alors, résultat ? Ce sont les services qui rédigent et fournissent les notes de synthèse et les « digests » qui vont lui permettre de s’en faire une vague idée. On appelle ce travail préalable « préparation à la décision ».
Or il faut savoir que la « préparation à la décision » constitue l’essentiel du contenu de l’enseignement que reçoivent les crânes d’œuf qui réussissent le concours d’entrée à l’ENA. La recette est à la portée de tous. Qu’est-ce qu’une note de synthèse ? C’est bête comme chou.
On vous donne un dossier de, supposons, soixante pages, mettons par exemple un dossier qui a trait aux activités du Conservatoire du Littoral, et il faut que sur le bureau du supérieur qui l’a demandée, atterrissent le plus tôt possible quatre pages. Le plan est tout trouvé, presque une obligation : grand 1, constat descriptif d’une situation donnée ; grand 2, analyse des causes qui ont produit cette situation ; grand 3, exposé des solutions envisageables pour résoudre le problème.
C’est bête comme chou, on le voit. Il n’empêche que cela peut être compliqué, délicat, épineux, risqué, dangereux, etc. Et puis, tout dépend du crâne d’œuf, car certains ont du bon sens, mais ce n’est pas une condition nécessaire pour être admis à l’ENA, donc pour servir ensuite de truelle aux maçons responsables, je veux parler des chefs de service, dans les ministères. Ce qui est exigé, c’est en revanche la clarté : il faut avant tout faciliter la prise de décision par le décideur en chef.
On n’imagine pas, parmi les gens normaux – dont vous et moi faisons partie –, sur le piédestal de quelle invraisemblable fourmilière est posée la tête du ministre, la seule visible, la seule à énoncer devant micros et caméras, en termes plus ou moins clairs, des analyses plus ou moins pénétrantes sur le problème de l’euthanasie, de l’écotaxe ou des rythmes scolaires.
Les gens normaux ne sont pas en mesure d’imaginer tout ce qui se passe en amont (mais aussi et surtout selon le principe de la pyramide hiérarchique) de l’instant fatal où la bouche ministérielle énonce les mots fatidique que tous les quotidiens imprimeront le lendemain. Car la crotte de mouche qui tombe de ce quasi-anus est la quintessence d’une quintessence elle-même quintessenciée. C’est la goutte extrême du distillat qui sort de l’alambic toute prête à exploser. Ou à s’abouser dans l’indifférence.
Sans pousser son analyse jusque-là, c’est bien ce que Jacques Ellul (je ne l’ai pas perdu de vue) reproche à la bureaucratie en place. Dans le fond, en un an et demi passé à travailler au sein de la municipalité de reconstruction à Bordeaux, de quoi a-t-il souffert, Jacques Ellul, à son petit poste de petite décision ? D’avoir été posé comme un bouchon à la surface d’une substance vaguement mouvante ou liquide dont il était le jouet :
« Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes… ».
J’exagère sans doute, mais l’essentiel est là.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 21 avril 2014
QUE PEUT LE POLITIQUE ?
On ne se refait pas : personne ne peut se remettre définitivement de l'idée qu'il lui est radicalement impossible ou interdit de refaire le monde. Donc.
DE L’IMPUISSANCE DU POLITIQUE 1/4
Jacques Ellul, outre le pilonnage en règle que sa plume (Le Système technicien, Le Bluff technologique, entre autres) a fait pleuvoir sur une civilisation qui a fait de la technique une idole au pied de laquelle elle se prosterne, les bras chargés d’offrandes, et aux bons soins de laquelle elle s’abandonne comme dans de nouvelles délices de Capoue, avec une lâcheté aussi merveilleuse qu’opiniâtre, a aussi écrit des ouvrages de théologie.
Autant je suis intéressé par toutes ses études au sujet de la technique, autant je suis rebuté par celles qu’il consacre à Dieu, à ses attributs et à sa présence, réelle ou supposée, dans les œuvres humaines, où certains voient sa manifestation concrète. C’est ce qui m’a fait reposer sans le finir A temps et à contretemps (Le Centurion, 1981). Avec ce commentaire laissé sur la page de garde : « Trop de théologie ! ».

A chacun ses infirmités : les raisonnements sur des abstractions – fussent-elles eschatologiques –, aussi subtils ou percutants soient-ils, ont le don d’ajouter au poids de mes paupières supérieures les quelques tonnes qui manquent à ceux qui ignorent tout de ce que signifie l’expression « s’endormir en sursaut ».
C’est pourquoi, chaque fois que je commence à compter les moutons, j’ouvre Sémantique structurale d’Algirdas Julien Greimas ou Ce que Parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques de Pierre Bourdieu, avec la certitude souriante de celui qui sait que le sommeil, avec son gourdin, l’attend au coin du bois de la page 2, juste avant qu’il ait tourné celle-ci. Je ne me décide à me rabattre sur Anthropologie philosophique de Bernard Groethuysen qu’en cas d’urgence ou de nécessité, à cause de la violence du somnifère et des mauvais rêves qu’il induit.
J’ai donc zappé les propos théologiques de A temps et à contretemps. En revanche, je n’ai pas laissé passer les moments où, dans ce livre d’entretiens où Jacques Ellul livre débonnairement une partie de son parcours personnel, il évoque ses « acquis de l’expérience ». En particulier, j’ai braqué ma loupe sur quelques passages où il raconte « sa » seconde guerre mondiale, et la façon dont elle s’est achevée pour lui.
Très instructif en vérité, y compris et avant tout quand on observe à la lumière de ce propos les mœurs et paroles des animaux qui occupent aujourd’hui les fauteuils des bureaux directoriaux de la France. Après une guerre où il eut un comportement impeccable (sur lequel il ne s’étend d’ailleurs pas outre-mesure, on aurait même aimé qu’il détaille), on lui propose de participer, à Bordeaux, à la « municipalité dite de la Libération » : « C’était très sympathique, nous avions beaucoup de travail, il fallait tout remettre sur pied ». Cette période va durer « à peu près un an et demi ». Il y est allé franco, croyant qu’il était possible de changer de grandes choses à la base.
On n’est pas plus naïf.
Voilà ce que je dis, moi.
samedi, 19 avril 2014
WILLIAM CLAXTON PHOTOGRAPHE
WILLIAM CLAXTON ET CEUX QUI FONT LE JAZZ


CHUT ! C'EST CHET ...



AUX ABRIS ! C'EST JOHN !





09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 18 avril 2014
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Tout le monde doit mourir un jour. Pas d'éloge funèbre. Mais à l'occasion de la mort de l'écrivain colombien, des souvenirs de ma lecture d'un livre unique, d'un livre sans équivalent :
Cent ans de solitude.

Le village de Macondo, pauvre localité tropicale devenue le centre d'un univers aux dimensions du cosmos.
Le seul livre qui m'ait jamais donné cette impression d'un microcosme humain gros comme un confetti, mais dilaté et comme multiplié jusqu'à prendre des airs de planète entière, c'est Mémed le mince, de Yachar Kemal.
Le saisissement du gamin de Macondo quand il pose la main sur le bloc de glace que lui présente son grand-père (on est au niveau de l'équateur).
La beauté ensorcelante de Remedios-la-belle.
La vieille éternelle, Ursula Buendia, pour laquelle « le temps ne passe pas ».
L'innombrable tribu de la famille Buendia, dont j'avais été obligé, pour me retrouver un peu dans le fourmillement des noms (parfois identiques) et des personnes, de dessiner l'arbre généalogique, pour démêler Aureliano d'Aureliano le Second et d'Aureliano José, celui-ci de José Arcadio et ce dernier d'Arcadio tout court, bref, un écheveau savamment entortillé.
Inoubliable et vivant.
Mais je garde aussi une place pour L'Automne du patriarche, vaste coulée de lave folle qui se moque des limites de la phrase pour mieux laisser bourgeonner l'impression de folie qui habite (mais sait-on ?) le cerveau du dictateur vieillissant.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gabriel garcia marquez, cent ans de solitude, l'automne du patriarche
jeudi, 17 avril 2014
SAM SZAFRAN PEINTRE
SAM SZAFRAN, INVOLUTIF, ONIRIQUE ET PROLIFERANT

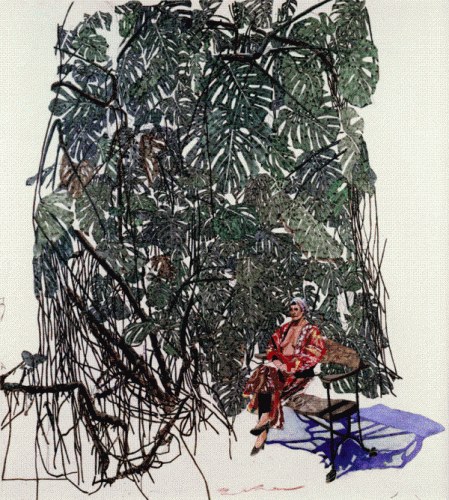





09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts, peinture, artiste peintre, sam szafran
mardi, 15 avril 2014
ALVIN L. COBURN "VORTO"-GRAPHE
ALVIN LANGDON COBURN
ET LA FASCINATION GEOMETRIQUE







09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 14 avril 2014
DEVINETTES PHOTOGRAPHIQUES
QU'EST-CE QUE ÇA REPRESENTE ?
TOUS MES COMPLIMENTS A CEUX QUI AURONT TROUVÉ
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie
dimanche, 13 avril 2014
RIEMENSCHNEIDER LE FLAMBOYANT
TILMAN RIEMENSCHNEIDER
ET LE VISAGE HUMAIN

ANDRÉ

JACQUES

JOSEPH D'ARIMATHIE

MATHIAS

NICODÈME

UN PHARISIEN

PHILIPPE

JEAN

TILMAN RIEMENSCHNEIDER PAR LUI-MÊME
Beaucoup d'œuvres de Tilman Riemenschneider sont visibles dans la bonne et belle ville de Würzburg (Allemagne). Eternel merci, au consul Yorck von Wartenburg, à sa cousine la Gräfin von Moltke (Probstei, 7108, Möckmühl), vœux auxquels je joins Angelika, Schwesti, et même Karl von Pritwitz. Un coucou à Clärlä Aheimer, où qu'elle soit aujourd'hui.
samedi, 12 avril 2014
QU'EST-CE QUE C'EST ?
CE QUE ÇA PEUT BIEN ÊTRE ?
Voilà, une fois n'est pas coutume, je lance un appel. Il y a bien des années, j'ai trouvé l'objet dont les photos suivent au bas d'une falaise de Carqueiranne. Cela ressemble à de l'os fossilisé (aspect spongieux sur une face). Je n'ai aucune idée de ce que cela peut être. S'agit-il d'une rotule d'animal ? Dimensions hors-tout : L. 105 x l. 70 x h. 55 mm. Poids 198 g. Merci aux connaisseurs de m'éclairer.
09:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fossiles, préhistoire
vendredi, 11 avril 2014
AUGUST SANDER PHOTOGRAPHE
AUGUST SANDER ET LES PAYSANS










09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander











