dimanche, 19 juillet 2015
BANDE DESSINÉE : CHARLIE MENSUEL
Tous les amateurs de bandes dessinées connaissent les principales revues de l’âge d’or de la BD (le « neuvième art », comme certains se plaisent à dire, bon, je veux bien) : Tintin, Spirou, Pilote, les pères fondateurs en quelque sorte, qui s’adressaient exclusivement à la jeunesse, sous l’œil vigilant de la loi de 1949, qui permettait de surveiller les publications qui lui étaient destinées.
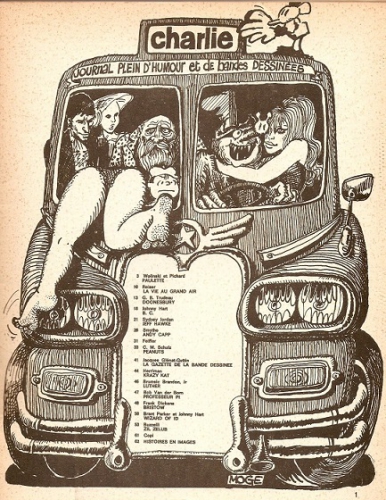
N° 42 de Charlie mensuel. J'ai croisé, dans le temps, un Moge. Il était professeur de couleur à l'Ecole des Beaux-arts de Lyon. Il trouvait qu'à son âge (autour de la quarantaine), ça devenait difficile de draguer les étudiantes. Est-ce le même ?
C’était l’époque innocente où Marlier pouvait dessiner ses « Martine » avec leur petite culotte, bien avant qu’on lui conseille de la mettre en pantalon pour des raisons « convenables » (traduction : moralisme policier, gare au soupçon de pédophilie). Et puis Goscinny est arrivé, a pris en main les destinées de Pilote, a fait évoluer la BD vers l’âge adulte en recrutant, entre autres, Cabu, Gébé, quelques autres grands.
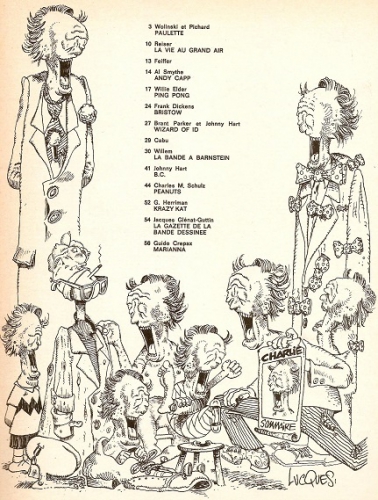
N° 47. Lucques est l'auteur des Freudaines, souvent drôles, parfois désopilantes.
Et puis Delfeil de Ton lance Charlie mensuel. Il passe rapidement à Wolinski les rênes de ce « Journal plein d’humour et de bandes dessinées » (c’est la devise).
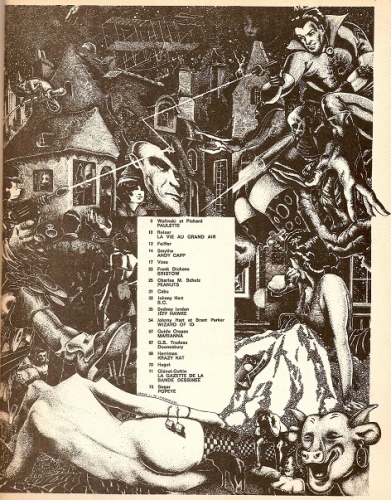
N° 49. Cathy Millet, qui signe ce dessin, est-elle la papesse qui régna, avant Catherine Francblin, sur cette Pravda de l'art contemporain qu'est la revue Art press ?
Le titre Charlie est un hommage direct à Charles M. Schulz, créateur d’une série célèbre entre toutes : Peanuts, où évoluent, entre autres, Charlie Brown et Snoopy, le chien philosophe (ci-dessous). J'aime bien, sans plus.
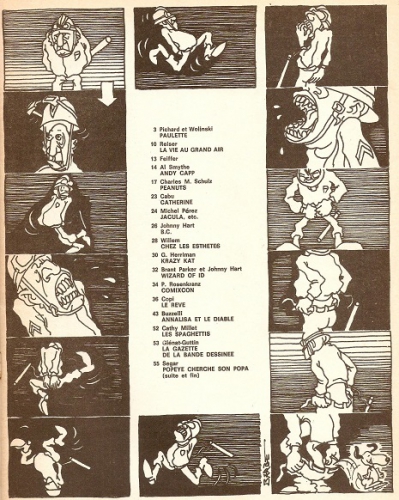
N° 54. Les visiteurs de ce blog connaissent André Barbe, depuis mon billet du 15 juillet. C'est Snoopy qui mord le flic aux fesses.
Je m’épargnerai non seulement l’effort de faire l’éloge de Charlie mensuel, mais aussi d’énumérer les illustres maîtres et les « petits maîtres » de l’art de la BD qui y ont vu publier leur travail. Eloge de toute façon inutile, « car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus » (Alfred Jarry, « Linteau » des Minutes de sable mémorial).
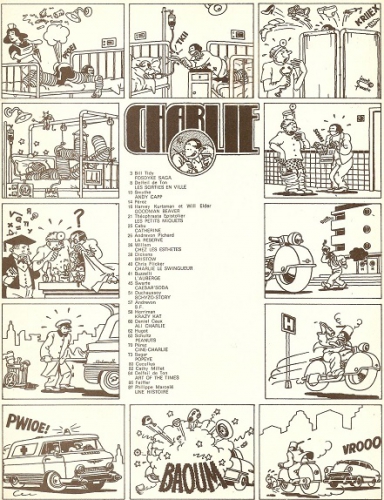
N° 63. Joost Swarte, le Hollandais dessinant spécialement pour Charlie. Et facétieux avec ça.
Je veux juste rendre hommage à cette revue mémorable, mais en braquant le projecteur sur une face jamais mise en avant. Wolinski rédigeait une sorte d’éditorial, qu’il publiait en p. 2, en l’agrémentant de dessins venus sous la plume de gens parfois connus, qu’il leur demandait pour l’occasion. On ne s’étonnera pas du dessin (ci-dessous) offert par Guido Crepax pour l’édito du N°37 (février 1972).
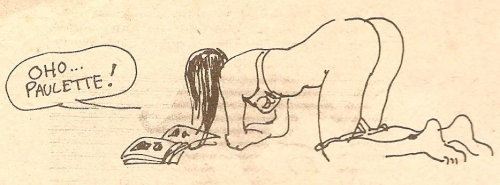
Ça se voit : c'est pondu "vite fait sur le gaz".
Mais sans vouloir vexer les mânes de Wolinski (que la terre lui soit légère), c’est la page 1 qui m’intéresse ici. Parfaitement : la page du sommaire, qui indique à quelle page il faut aller pour trouver ci et ça, et dont des exemples jalonnent le présent billet.

N° 67. Guitton, l'indécrottable baba-cool, les petites fleurs, les petits oiseaux, les étoiles ... et les femmes.
Le sommaire de Charlie mensuel : voilà une manière marrante de jouer avec la contrainte. Un défi pour un dessinateur.
Voilà ce que je dis, moi.
La suite à demain.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bandes dessinées, tintin, spirou, pilote, bd, charlie mensuel, wolinski, marlier martine, goscinny, cabu, gébé, lucques, freudaines, delfeil de ton, cathy millet, catherine millet, catherine francblin, art press, art contemporain, peanuts, charles m schulz, charlie brown, snoopy, andré barbe, alfred jarry, minutes de sable mémorial, joost swarte, guido crepax, guitton, baba-cool
mercredi, 15 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)
2/4
 Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).
La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.
Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.
De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.
Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.
Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).
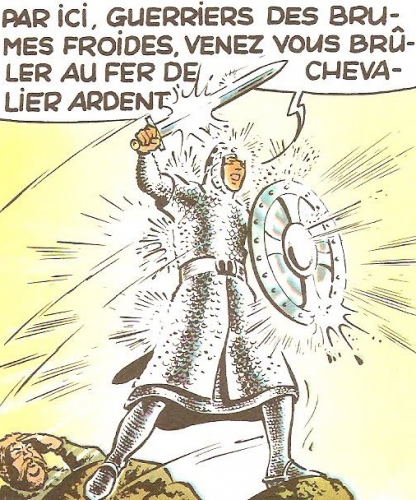
BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.
Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).
Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.
Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?
Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.
Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.
Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton
samedi, 04 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
2/2
 Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Disons-le, l’étude du style m’est tombée des mains : un relevé énumératif consciencieux des tournures, formules, termes favoris de l’écrivain. Même si tout est juste et bien observé, c’est tout à fait indigeste, comme un découpage de cadavre à la morgue. Que celui qui est allé à l'école lise ! Comme l'écrit Alfred Jarry dans le "Linteau" des Minutes ... (qui, j'imagine, n'a pas de secret pour Noguez) : « ... car il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ».
L’étude sur le « réactionnaire » supposé est en revanche intéressante, montrant que le concept est brumeux et marécageux à souhait, et qu'il fonctionne comme certains bars, où l'on signale au client : « Ici on peut apporter son manger ». Noguez donne trois ou quatre listes de gens peu recommandables, qualifiés successivement de « réactionnaires » par Daniel Lindenberg (Le Rappel à l'ordre) et quelques autres après lui : certains voisinages sont pour le moins étranges ou inattendus. Si "réactionnaire" est un concept, ce qui n'est pas sûr, il est singulièrement élastique, plastique et déformable dans toutes les sauces idéologiques. Pour autant, l’analyse est-elle efficace ? Peut-elle servir à quelque chose ? Pas sûr.
Les « éléments » du langage mouliné en permanence par les médias privatisés (qui ont contaminé les chaînes publiques, que plus grand-chose n'en distingue) se moque allègrement de ce qu’on appelait autrefois la « justesse des termes » (cela s’appelle aussi la « rigueur intellectuelle »). Le média spectaculaire régnant (la télévision) se contente de la vitesse et de l'éclat de l’expression, au mépris de son poids, de son exactitude et de sa profondeur. La catastrophe « Philippe Sollers » a triomphé. Briller est un impératif.
Je crois, monsieur Noguez, qu’il ne sert à rien de définir le mot « réactionnaire » : tout le monde s’en fout. Son rôle est de servir de flash (de piquouse), d’étiquette, d’identifiant immédiat, de blason, d'étendard, voire de mot de passe. Bientôt peut-être de lieu de détention.
C’est la tâche de purification lexicale assignée par les tenants de la nouvelle « bien-pensance » (p. 252) à quelques projectiles fabriqués spécialement à l'intention des survivants de l’esprit critique et de la liberté de penser (qu’il suffit, pour les disqualifier, de désigner « facho », « macho », « réac », « sexiste », « homophobe », et j’en passe). S’attarder sur le contour du mot « réactionnaire », je vais vous dire, c’est du temps perdu. Dans un duel arme au poing, l’explication rationnelle et argumentée est programmée pour échouer.
Dominique Noguez est écrivain. Je n’en doute pas. Pas plus qu’il ne doute des qualités de son livre Les Derniers jours du monde. Je dirai ce que j’en pense quand je l’aurai lu. Mais, comme Daniel1, le personnage de La Possibilité d’une île, il est foncièrement honnête (bien que j'ignore l'extension sémantique exacte du mot "foncièrement" dans ce contexte) où on lit : « ... j'étais, par rapport aux normes en usage dans l'humanité, d'une honnêteté presque incroyable » (p. 400), phrase qui sonne a posteriori comme une déclaration de théorie littéraire.
Car Houellebecq lui-même est honnête, en ce que ses livres ne se racontent pas d'histoire. Etonnant comme ses fictions romanesques semblent porteuses d'une vérité très nue, presque écorchée (peut-être ce qui le rend insupportable aux yeux de beaucoup). Houellebecq déclare ainsi à Frédéric Martel : « Je connais les réponses simples, celles qui vous font aimer de tous (…) ; si je ne les emploie pas ce n’est pas par provocation, mais par honnêteté » (cité p. 252). Noguez est donc honnête : il reconnaît que Houellebecq est un plus grand écrivain que lui. Il n’est pas jaloux. Il a au moins ce mérite, et cela m’incite à aller y voir de plus près.
Il écrit d’un roman de M. H. (Extension du domaine de la lutte) : « Après trois lectures, je tiens que ce roman est un des plus grands d’aujourd’hui. Je dis bien "d’aujourd’hui". Je n’en vois pas en effet qui disent mieux un certain nouvel air du temps – du temps social et économique – que celui-là » (pp. 29-30). Il écrit ça en 1994, c’est-à-dire avant Les Particules élémentaires, avant La Carte et le territoire. Je regrette quant à moi de l’avoir lu après ces deux livres, beaucoup plus forts et accomplis, auprès desquels Extension … fait un peu pâle figure, tout en tenant fort bien son rang : l’univers maintenant bien connu de l’auteur est déjà pleinement présent.
Noguez, tenant son journal, montre donc qu'il est intervenu en faveur de Michel Houellebecq, dans la presse comme critique, au tribunal comme témoin de la défense. Il lui écrit aussi des lettres, où il note ses impressions de lecture, par exemple sur Les Particules ….
Le procès intenté contre l’auteur de ce roman à parution ajoute au ridicule du motif le contradictoire de la chose : un directeur réclamant l’anonymat pour le camping qu’il dirige reproche à M. H. de donner des informations qui permettent de le reconnaître et situer. Evidemment, l’action en justice donne une publicité énorme à ce qui serait resté inaperçu et cru fictif s'il avait fait le mort. Conclusion de Noguez : « Cela ressemble fort à une opération publicitaire faite sur le dos de la littérature » (p. 62). Auguste en personne aurait dit « tout juste ».
Le procès intenté par Dalil Boubakeur, de la grande mosquée de Paris, suite à la publication de Plateforme, est plus crucial et plus révélateur. Houellebecq islamophobe ? Et alors, quand bien même ? Ne pas aimer l'islam est un droit, que je ne me prive pas d'exercer pour mon propre compte, moi qui suis, de façon générale, religio-incompatible. Noguez écrit : « Avoir un avis sur les religions, préférer l’une à l’autre ou les rejeter toutes relève de la liberté d’expression la plus élémentaire dans une démocratie comme la nôtre » (p. 211). Je ne peux qu’approuver. J'irais même volontiers plus loin, jusqu'à paraphraser Lino Ventura dans Les Tontons, à propos de Claude Rich, le petit ami de sa protégée : « ... il commence à me les briser menu ».
Et Noguez de rappeler que M. H. n’est pas le premier à traiter l’islam de « religion la plus stupide », avec des citations de Montaigne, Pierre Charron, Pascal, Spinoza, Tocqueville, etc. (p. 210). Voltaire n’a-t-il pas écrit une pièce de théâtre intitulée Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète ? Jusqu’au respectable Claude Lévi-Strauss qui y voit « une religion de corps de garde » (p. 211, ce que l’actualité nous confirme tous les jours).
Là où j'ai le grand plaisir de me retrouver en bonne compagnie, dans ce livre, c’est chaque fois que Dominique Noguez aborde la question de la « bien-pensance » et de l’ambiance policière qu’elle tend à instaurer dans le monde de la pensée, de la création et de l’expression, amalgamant sans sourciller des actes répréhensibles ou délinquants et des personnages éventuellement déviants, mais pures créatures fictives. Noguez se paie en passant Claire Brisset, la « Défenseure » (!) des enfants, « une folle avérée » (p. 176, mais il ne la nomme que trois pages plus loin – par prudence ? –, je précise que c’est moi qui interprète) : certaines formules font du bien, c’est sûr. Du coup, on se sent moins seul.
Là aussi où j’ai l’impression de trouver une « tribu » où je puisse me sentir un peu moins mal dans mon époque, c’est en apprenant que Dominique Noguez a donné une conférence intitulée « Le livre sans nom » (BNF, 15 décembre 1999), qu’il évoque dans la note 48 (p. 165) : « J’y donnais, comme explication de la multiplication actuelle des procès en matière de littérature, "l’immense privatisation de tout à laquelle on assiste depuis une douzaine d’années" dans les sociétés occidentales capitalistes ou, plus exactement, dans la manière dont elles se donnent à voir. "Tandis que la fiction romanesque semble saisie d’un appétit de plus en plus grand de réalité, ajoutais-je, la réalité qu’elle veut ingurgiter se privatise et se dérobe. Il n’y a plus de nature, il y a des propriétés privées ; plus de pays, mais des multinationales ; plus de ville, mais des chaînes de magasins et des marques ; plus de foule, mais des individus qui peuvent interdire ou monnayer leur image." (Publié dans La Nouvelle Revue Française n° 555, octobre 2000) ». Je salue l'expression "l'immense privatisation de tout". Les curieux peuvent se reporter à mon billet du 17 mars, où j'évoque « La Grande Privatisation de Tout » (GPT pour les intimes). Depuis la publication de Houellebecq, en fait, il y a douze ans, Noguez à dû pouvoir constater la nette aggravation du processus. Mais quand même, ça fait plaisir de se retrouver en pays de connaissance. Je me dis : chouette, encore un que Laurent Joffrin ne doit pas porter dans son cœur !
Tiens, à propos de Laurent Joffrin, voici ce qu’on lit p. 229, à propos d’un article sur « les nouveaux réactionnaires » : « Pour sa phrase sur l’islam, "l’excellent Laurent Joffrin", explique-t-il [il s'agit de Houellebecq], l’a traité dans Le Nouvel Observateur de "beauf lambda" ». J’imagine que la phrase en question est celle où il qualifie l’islam de « religion la plus stupide » (voir plus haut). Je renvoie à mes deux billets consacrés à ce monsieur. Houellebecq et Noguez doivent se dire, à la façon de Courteline : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Si j’étais à leur place, c’est en tout cas ce qui me viendrait à l’esprit. Avec délectation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, houellebecq en fait, réactionnaire, lindenberg les nouveaux réactionnaires, alfred jarry, minutes de sable mémorial, philippe sollers, les derniers jours du monde, la possibilité d'une île, frédéric martel, extension du doomaine de la lutte, les particules élémentaires, la carte et le territoire, dalil boubakeur, grande mosquée de paris, plateforme, voltaire, le fanatisme ou mahomet le prophète, islam, claude lévi-strauss, claire brisset, laurent joffrin, le nouvel observateur
vendredi, 06 février 2015
QU'EST-CE QU'UN GRAND ROMAN ?
Nous étions en train de causer de Soumission, de Michel Houellebecq, et de l'effet déflagrant produit, en général, par les livres du monsieur, et en particulier par le dernier, dans le tout petit nombril du monde des Lettres parisiennes. Bien que j'aie une idée floue de ce qu'un « effet déflagrant » donne dans un « tout petit nombril » (merci d'admettre la licence poétique des images !).
2/2
« Qu’on pèse donc les mots, polyèdres d’idées, avec des scrupules comme des diamants à la balance de ses oreilles, sans demander pourquoi telle ou telle chose, car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. » Il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. Voilà, c’est lumineux. Remarquez que c'est contraignant : il faut avoir appris à lire. C’est Alfred Jarry qui écrit ça (dans le Linteau des Minutes ...). Vrai qu'Alfred Jarry était ambitieux et qu'il « n'écrivait pas pour les paresseux » (c'est Noël Arnaud qui dit ça). Rien à ajouter.
Mais il faut croire que non, soit ça crève les yeux tellement c’est simple, soit ça demande un effort tellement c'est simple. Je me demande si ce n’est pas précisément l’effort qui rebute mesdames Angot et Devarrieux. Ajoutons Raphaëlle Leyris (Le Monde, 8 janvier), pour faire bon poids. En tout cas, j'en conclus que ces dames préfèrent le tarabiscoté.
Pour elles, cette simplicité de l'évidence qui saute aux yeux à la lecture de Soumission est éminemment suspecte, alors que c'est, tout simplement, le summum actuel de l'art romanesque. Modiano est, dans une tout autre tonalité, du même tonneau, du genre qui coule de source. Essayez donc, pour voir si c'est facile. Je vous jette mon gant : allez-y, faites aussi bien.
Je signale libéralement aux bons amateurs, aux lecteurs de Faustroll et autres pataphysiciens à qui la chose avait échappé, que le « scrupule » dont parle Jarry correspond visiblement à la définition 1 du Littré (éditions du Cap, 1968, p. 5786) : « petit poids de vingt-quatre grains (proprement, petite pierre, prise primitivement pour peser) » (noter la rafale d’allitérations en p). Ce scrupule est en fait une unité de poids : 1,272 gramme, le grain pesant 0,053 g. Vous pouvez vérifier : ça vient du latin « scrupulus : petite pierre pointue». Comme quoi, avoir la conscience légère n'est pas seulement une métaphore. Passons.
Je reviens à mon idée de machine. Il faut noter que le romancier est dans l’absolue solitude pour fabriquer chacune de ses pièces. Supposons qu’il a une image globale précise de l’ensemble. Eh bien je vais vous dire, s’il veut que « ça marche », il est obligé de se mettre tout entier dans la fabrication de chacune des pièces. Chacune contient l'écrivain tout entier.
S’il veut que ça marche, il ne peut pas se permettre de prendre parti pour l’un de ses personnages contre un autre. Il ne peut se permettre d'en juger aucun. Il n'a pas le droit d'en penser quoi que ce soit. D'abord parce que tout le monde s'en fout. Ensuite parce que l'histoire s'effondrerait avant de commencer.
Ou alors s'il juge, il faut qu'il endosse successivement la tenue du président du tribunal, puis celle des assesseurs, puis celle de chacun des jurés, puis celle du procureur, puis celle de l'avocat, puis celle des parties civiles, puis celle des témoins, puis celle des experts, puis celle du greffier, puis celle des policiers de garde, puis celle de chacun des individus composant le public qui assiste au procès, puis celle des bancs, de la barre, des colonnes et des lambris, puis celle des plantes vertes en pot, puis celle de la serpillière qu'on passera après la fermeture, puis celle de la pendule, bref : il faut qu'il fasse tout à lui tout seul. Mieux : il faut qu'il soit tout, du président jusqu'à la serpillière. Tout simplement parce qu'il doit laisser chacun de ses personnages aller jusque tout au bout de sa logique. C’est précisément ce que sait faire Michel Houellebecq. Admirablement.
Oui : il doit impérativement être chacune des pièces, à 100 %, à tour de rôle, pour qu’elle joue son rôle vivant le moment venu. Le romancier joue successivement les rôles de toutes les marionnettes dont il manipule les gestes, les membres, les silhouettes, les âmes. Le grand roman est la machine qui parvient à donner chair à ces êtres de bois, comme la fée à la fin du Pinocchio de Walt Disney, pour le bonheur de Gepetto.
Le romancier se situe au sommet de l’échelle du métier d’acteur de théâtre : son art de la métamorphose vestimentaire, faciale, vocale et gestuelle n’a pas de rival dans toute la littérature dramatique. Le génie romanesque habite celui qui a su suivre modestement, pas à pas, la logique interne de la machine qu’il a conçue et mise au point, au point d'en faire un être vivant.
Quand on a cette maîtrise, ça donne Michel Houellebecq. Et pas besoin de fée : ce qu'il écrit est à prendre pour ce que c'est : un diagnostic froid, mesuré, raisonnable, impeccablement formulé, posé sur le spectacle du monde qui est le nôtre.
Imaginez : s’il prend parti pour telle pièce plutôt que pour telle autre, le roman est foutu, puisque c'est adopter le même langage binaire et manichéen qu'un certain George W. Bush en 2003 : « Ceux qui ne sont pas avec nous, dans cette croisade pour le Bien, sont contre nous, du côté de l’Axe du Mal ». En matière de littérature romanesque, ça donne du Christine Angot : ça ne fait pas de vrais livres, mais alors qu'est-ce que ça écrit !!!!!!
Allah nous en préserve ! Nous sommes modestes. Nous, ce qu'on aime, c'est seulement la littérature.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, soumission, les particules élémentaires, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, journal le monde, christine angot, claire devarrieux, raphaëlle leyris, faustroll, scrupule, pinocchio, gepetto, george w. bush, axe du mal
samedi, 24 mai 2014
LE MONDE DANS LA VITRE
DEUX PHOTOS D'UN DES ANCIENS KIOSQUES DE FLEURISTES DE LA PLACE BELLECOUR (avant destruction)
RAYER LA PHOTO INUTILE
******
Reportage intéressant d'Omar Ouamane sur France Culture ce vendredi soir. On est en Libye. C'est où, la Libye ? Alfred Jarry, avant la première représentation d'Ubu roi, déclarait : « Quant à l'action, qui va commencer, elle se passe en Pologne, c'est-à-dire Nulle Part ». S'agissant de la Libye aujourd'hui, on ne saurait mieux dire.
Ce qui s'est passé en Pologne après la fuite d'Ubu n'a sûrement rien à voir avec ce qui se passe en Libye depuis la mort de Khadafi, ce dernier n'ayant absolument aucun trait en commun avec la marionnette du père de la 'Pataphysique ! Nul n'en doute, j'espère !
C'est donc le moment d'entonner l'hymne d'action de grâce à l'adresse de Nabot-Léon Sarkozy, qui partage avec un Anglais la responsabilité de la situation actuelle. Pour quelle extatique raison ? Mais parce que les Libyens lui doivent une fière chandelle. Et pas seulement les Libyens, mais les Tchadiens, les Tunisiens, les Algériens, les Nigériens et, un peu plus loin, les Maliens et les Centrafricains.
Ben oui, Khadafi, en plus d'être un abominable dictateur, accaparait injustement tout ce qui se faisait en matière d'armes. Il confisquait abusivement le monopole de la détention et du commerce des armes dans toute la région. Que c'en était écoeurant, ce monopole d'Etat. Ah l'Europe a bien raison, vous savez, d'avoir obtenu de la France qu'elle détruise les siens (SNCF, EDF, GDF, ...).
Et regardez maintenant : liberté totale en Libye, mon frère ! Dans la joie, la bonne humeur et l'anarchie bienheureuse. Bakounine ne disait-il pas : « L'anarchie, c'est l'ordre de la vie » ? Eh bien qu'est-ce que ça vit, mon frère, en ce moment en Libye ! Et dans toute la région ! Ça vit énormément, que ce soit au Mali, en Centrafrique. Jusqu'à Boko Aram qui bénéficie de cette nouvelle liberté de circulation des moyens létaux.
Bon, évidemment, à propos de moyens létaux, qu'est-ce que ça meurt aussi ! Ah ça, pour mourir, on ne peut pas dire que les Libyens font les choses à moitié. J'ai entendu dire que les Centrafricains font ça très bien aussi. Tiens, et aussi les Maliens. Mais ça, on dira que c'est vachement collatéral.
La voilà, la fière chandelle qu'ils lui doivent, à Nabot-Léon Sarkozy, les Libyens, les Tchadiens, les Tunisiens, etc. Soit dit en passant, si le chaos règne à Tripoli comme dans tout le pays et s'il n'y a plus vraiment d'Etat, c'est à Benghazi que les islamistes ont pris le pouvoir. Et c'est vers Benghazi que Khadafi avait lancé ses colonnes blindées que les Rafale de Sarkozy ont arrêtées. Ironie, vous avez dit ?
Parodiant Louis XV, Sarko pourrait lancer fièrement : « Après moi le Chaos ! ». Hélas il n'est pas mort ! Et le roquet qui s'est vêtu d'une défroque aux dents aussi longues que le loup qu'il n'est pas, qui n'a donc pas dit son dernier mot, semble avoir l'intention de revenir, dans l'espoir sans doute de faire encore mieux.
NB : je prie le lecteur de pardonner l'emprunt que j'ai fait à Jean-Marie Le Pen, qui avait surnommé Nabot-Léon le dissident du FN, Bruno Mégret, qui aurait voulu se faire aussi gros que le bœuf. Si je l'ai fait, c'est que je trouve le jeu de mot aussi congru qu'approprié à la personne que je vise. Je ne le ferai plus. Enfin, je tâcherai.
******

Et n'oublions pas, en ce 24 mai 2014,la soirée et la nuit du 24 mai 1968 à Lyon, sur le pont Lafayette, et un certain commissaire Lacroix, qui paya de sa vie la malencontreuse idée de vouloir arrêter un camion jaune, sur l'accélérateur duquel un pavé avait été posé.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, place bellecour, libye, khadafi, dictateur, omar ouamane, france culture, nicolas sarkozy, tchad, tunisie, algérie, niger, mali, centrafrique, alfred jarry, ubu roi, jean marie le pen, front national, bruno mégret, fn, commissaire lacroix, 24 mai 1968, mai 68
jeudi, 14 mars 2013
MON DERNIER VISAGE APRES LA VIE ?

CHARLES TRIPP & ELIE BOWEN, LE MANCHOT ET L'HOMME-TRONC, DANS LEUR CELEBRE NUMERO
***

MASQUE MORTUAIRE DE GIOVANNA GASSION, DITE EDITH PIAF, MOULÉ PAR EDWARD A. MINAZZOLI, QUI A AUSSI MOULÉ LA MAIN D'YVONNE CASADESUS
Peut-on encore se fier à ces artistes – le plus souvent des sculpteurs – quand ils sont appelés au lit de mort d’une célébrité pour prélever, sur son visage encore intact, comme son identité exclusive, le moulage de ses traits tels que la mort les a figés ?
Les morts, c’est l’affaire des vivants. Les « dernières volontés », qu’est-ce que c’est, à tout prendre ? Une concession généreuse de ceux qui restent à quelqu’un qui n’est plus en mesure de formuler quelque volonté que ce soit. Enfin, c’est aussi le dernier moyen qu’a le futur mort de déclencher la guerre ou la paix entre les héritiers présomptifs, mais ça c’est de la satisfaction imaginaire autorisée par la loi, puisque ça précède le grand saut, et que le juge est là pour la faire admettre.
Maintenant, le visage du mort, tel qu’il est rendu par le moulage prélevé par un spécialiste juste après le décès ? Normalement, il est incontestable, n’est-ce pas ? Et comme un plâtre est reproductible en nombre, on imagine bien qu’une copie ne saurait être qu’identique à la suivante et à la précédente, comme le voudrait le bon sens.
 Eh bien il n’en est rien. Certes, la règle veut, pour commencer, que le masque ne soit exécuté que pour conserver les derniers traits d’une personne considérable. Mais regardez l’un des masques reproduits à un nombre absolument faramineux d’exemplaires, puisqu’il ornait les murs de tous les ateliers d’étudiants aux Beaux-arts parisiens du 19ème siècle : on l’appelle « L’Inconnue de la Seine », car on ne sait même pas le nom de la noyée. La paix souriante dans laquelle tout le visage baigne a quelque chose d'impressionnant. Comme la fille est jolie, son masque mortuaire n'a pas subi d' "améliorations". Une inconnue, c’est normal : pas d’héritiers, pas de connaissances, pas d’enjeux, rien à embellir.
Eh bien il n’en est rien. Certes, la règle veut, pour commencer, que le masque ne soit exécuté que pour conserver les derniers traits d’une personne considérable. Mais regardez l’un des masques reproduits à un nombre absolument faramineux d’exemplaires, puisqu’il ornait les murs de tous les ateliers d’étudiants aux Beaux-arts parisiens du 19ème siècle : on l’appelle « L’Inconnue de la Seine », car on ne sait même pas le nom de la noyée. La paix souriante dans laquelle tout le visage baigne a quelque chose d'impressionnant. Comme la fille est jolie, son masque mortuaire n'a pas subi d' "améliorations". Une inconnue, c’est normal : pas d’héritiers, pas de connaissances, pas d’enjeux, rien à embellir.
 Prenez maintenant Napoléon : son masque mortuaire le plus courant est d’une grande beauté, montrant un visage fin, presque émacié (ci-dessous). Mais on en trouve un autre, sous ce même nom de Napoléon, et alors là, pardon, mais ce n’est plus le même homme : la figure est grasse, presque bouffie (ci-contre), sans doute plus proche de la vérité du relégué de Sainte Hélène. Quel est le vrai masque, demande alors le ’pataphysicien ?
Prenez maintenant Napoléon : son masque mortuaire le plus courant est d’une grande beauté, montrant un visage fin, presque émacié (ci-dessous). Mais on en trouve un autre, sous ce même nom de Napoléon, et alors là, pardon, mais ce n’est plus le même homme : la figure est grasse, presque bouffie (ci-contre), sans doute plus proche de la vérité du relégué de Sainte Hélène. Quel est le vrai masque, demande alors le ’pataphysicien ?
Comme le dit Alfred Jarry quelque part, parlant des personnages chez Henri de Régnier : « Que chaque héros traîne après soi son décor (...), cela prouve, sans plus, que l'auteur a retourné ses créatures et mis leur âme en dehors ». Et plus loin : « Et si les personnages se montrent à nous par leurs masques, n’oublions pas que personnage n’a pas d’autre sens que masque, et que c’est le "faux visage" qui est le vrai puisqu’il est le personnel » (La Plume, 1er avril 1903). On ne saurait mieux dire. Entre « faux visage » et « vrai masque », donc, mon cœur balance.
 LES VERRUES DE FRANZ LISZT - La même aventure touche le grand Franz Liszt : sur
LES VERRUES DE FRANZ LISZT - La même aventure touche le grand Franz Liszt : sur l’un, il est affligé de deux verrues "historiques", sur l’autre, un chirurgien bienveillant et habile semble être passé par là avant le moment fatidique, puisqu’il en est soudain débarrassé. Pourtant, au sujet de ses verrues, sur plusieurs portraits photographiques, le musicien semble, sinon fier, du moins accoutumé. On notera cependant le curieux emplacement de la verrue supérieure, au sommet du nez sur la photo, alors qu'elle se situe en plein front sur le masque. On dira que Liszt avait la "verrue baladeuse". Pardon, maestro.
l’un, il est affligé de deux verrues "historiques", sur l’autre, un chirurgien bienveillant et habile semble être passé par là avant le moment fatidique, puisqu’il en est soudain débarrassé. Pourtant, au sujet de ses verrues, sur plusieurs portraits photographiques, le musicien semble, sinon fier, du moins accoutumé. On notera cependant le curieux emplacement de la verrue supérieure, au sommet du nez sur la photo, alors qu'elle se situe en plein front sur le masque. On dira que Liszt avait la "verrue baladeuse". Pardon, maestro.
 Et quel est le vrai Robespierre mort ? L’homme au
Et quel est le vrai Robespierre mort ? L’homme au visage pacifié, presque heureux ? Ou cet autre à la mine sombre ? Je me perds en conjectures. On sait que Robespierre s’est tiré une balle dans la mâchoire quand on est venu l’arrêter : il m’étonnerait fort qu’il eût encore les joues bien lisses quand on lui a décollé la tête du reste du corps le soir du 9 Thermidor.
visage pacifié, presque heureux ? Ou cet autre à la mine sombre ? Je me perds en conjectures. On sait que Robespierre s’est tiré une balle dans la mâchoire quand on est venu l’arrêter : il m’étonnerait fort qu’il eût encore les joues bien lisses quand on lui a décollé la tête du reste du corps le soir du 9 Thermidor.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, homme-tronc, manchot, cirque, inconnue de la seine, masque mortuaire, édith piaf, napoléon, pataphysique, pataphysicien, alfred jarry, chandelle verte, franz liszt, robespierre
mercredi, 12 décembre 2012
GRAVIR LE MONT PEREC
Pensée du jour :

ERWIN BLUMENFELD
« Il n'est rien de plus charmant que les proverbes arabes, et même les proverbes tout court. On les trouve dans les agendas, entre une recette pour recourber les cils et la façon d'accommoder le riz cantonais. Ils parfument la vie de l'homme sensé. Ils font parler le crapaud, ils racontent la brebis, ils décrivent le rhinocéros. Ils rendent le lion sentencieux et la chèvre pédagogique. Il leur arrive de comparer le commerçant aisé à la fleur du jasmin, et l'homme sage à un vase de cuivre orné de riches ciselures par un habile artisan de Damas. On voit par là que nulle métaphore ne les effraie ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : je demandais juste : « Mais qu’est-ce que c’est, bon sang, un onzain hétérogrammatique ? ».
Très simple à expliquer : c’est un poème de onze vers dont chaque vers est composé de onze lettres. Ajoutons que ces onze lettres, à chaque vers, doivent être strictement les mêmes. Et si on met les lignes bout à bout, on est censé trouver une suite de mots, qui veuille autant que possible dire quelque chose.

VOIR TRADUCTION PLUS BAS
Appelons ça un poème, si vous êtes d’accord. On connaît le haïku, poème comportant exactement 17 syllabes. C’est du japonais. Eh bien GEORGES PEREC invente le poème de 121 lettres, pas une de plus : c’est ça le « onzain hétérogrammatique ».
C’est autrement fortiche que le sonnet, je peux vous le dire. Avec ses Cent mille milliards de poèmes, RAYMOND QUENEAU peut aller se rhabiller, même si PEREC dédie La Vie mode d’emploi « à la mémoire de Raymond Queneau ».

CENT MILLE MILLIARDS ? VRAIMENT ? C'EST DE LA PRESTIDIGITATION !
C'EST AUSSI UNE EXCELLENTE TROUVAILLE DE "COM".
Et pourquoi « ulcérations », alors ? Très simple à expliquer, là encore. Prenez les onze lettres les plus fréquentes du français écrit, vous obtenez la série suivante, dans l’ordre : E, S, A, R, T, I, N, U, L, O, C. Vous cherchez un bon moment s’il n’y a pas un moyen de faire quelque chose de cette liste, vous cogitez, et soudain, la lumière se fait : « Ulcérations », en prenant soin de mettre le mot au pluriel. C’est PEREC qui a trouvé ça.
Je dois dire, pour être tout à fait sincère, que la valeur littéraire des poèmes ainsi obtenus est très loin de sauter aux yeux, comme on peut le voir ci-dessous. C’est sûr que c’est une prouesse digne de Tristan terrassant le Morholt ou de David assommant Goliath. Un exploit.

TRADUCTION DU ONZAIN : QUI AURAIT ENVIE D'APPRENDRE ÇA PAR COEUR ?
(rendez-moi Baudelaire)
L’accomplissement d’une tâche surhumaine. Qui me fait penser à cette très belle réplique mise par GOSCINNY dans la bouche du commerçant auquel s’adresse Lucky Luke dans Des Barbelés sur la prairie : « Pour l’impossible, nous demandons un délai de quinze jours ». Mais pour un résultat capable de réjouir les capacités de calcul d’un ordinateur. Pendant ce temps, le poète patiente à la porte. Dans le froid glacial.

DESOLE : C'EST LA SEULE PLANCHE DONT JE DISPOSE
Franchement, c’est comme les virtuosités vocales des mélismes de CECILIA BARTOLI chantant VIVALDI : à l’arrivée, je me dis : « Tout ça pour ça ! ». Tout ça pour dire que l’oulipianisme de GEORGES PEREC me laisse un tout petit peu sceptique, même si je reconnais l’absolue supériorité du maître dans tout ce qui concerne les jeux avec les lettres (et avec les Lettres). Heureusement, le génie de PEREC remplit avantageusement les formes que son goût pour les contraintes d'écriture lui suggèrent jour après jour.
Car la sécheresse du pur formalisme n’est pas loin, comme si l’on essayait de mettre au point une machine capable de produire du vivant (BERGSON, au secours !). Et en même temps, une forme de préciosité héritée de Mademoiselle de SCUDERY. Mais le JEU ne fut pour GEORGES PEREC, en quelque sorte, que la voie d'accès à l'expression de son monde à lui par la littérature. PEREC a eu besoin du jeu (les contraintes oulipiennes) pour laisser libre cours au flux (appelons ça comme ça, par convention) créatif qui le traversait.
Ce n’est pas pour rien que PEREC (et il l'est peut-être encore, je ne me tiens pas au courant des avancées de la compétition, puisqu’il y a évidemment surenchère, et que celle-ci m’intéresse, je dois dire, tout à fait moyennement) le recordman de tout le système solaire pour ce qui est du PALINDROME.
Si vous consultez un des deux volumes « oulipo » de la collection « Idées / Gallimard » (La Littérature et Atlas, mais maintenant, pour les curieux, il y a la Bibliothèque oulipienne authentique), vous saurez. Je crois me souvenir que le palindrome de GEORGES PEREC est fait de 1247 mots.
Au fait, je n’ai pas dit ce que c’est, un palindrome. J’aurais dû. En musique, ça existe aussi, ce n’est pas monsieur PHILIPPE CATHÉ qui me contredira. OLIVIER MESSIAEN a inventé les « rythmes non rétrogradables », qui reposent exactement sur ce principe : on peut lire le texte en commençant par le début ou par la fin sans que l’ordre des signes écrits ait varié d’un iota (mais s'agissant de mots, le sens change évidemment, contrairement à ce que déclare le crétin qui a rédigé la notice wikipédia).
Le palindrome a bien sûr attiré l'attention de l'humain dès que celui-ci disposa de l'alphabet. ALFRED JARRY cite dans Messaline le très connu « ROMA / AMOR ». GUY DEBORD élabora l'extraordinaire « In girum imus nocte et consumimur igni » ("Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu").

Je vous donne juste le début de l'exploit accompli par GEORGES PEREC : « Trace l’inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. »,et la fin : « Ta gabegie ne mord ni la plage ni l’écart ». Vous pouvez vérifier dans un miroir (sans tenir compte des accents et autres signes adventices).
Là encore, admirons la prouesse, mais ne nous demandons pas trop violemment ce que tout ça peut signifier. En comparaison, GUY DEBORD n'a battu aucun record, mais il a trouvé une pépite en or massif (si c'est lui qui l'a trouvée, ce que j'avoue ne pas savoir, mais il n'y a pas de raisons d'en douter).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, femme, erwin blumenfeld, corps féminin, beauté féminine, alexandre vialatte, littérature, humour, proverbes arabes, georges perec, alphabets, poésie, raymond queneau, cent mille milliard de poèmes, la vie mode d'emploi, ulcérations, goscinny, lucky luke, cecilia bartoli, préciosité, palindrome, oulipo, bibliothèque oulipienne, olivier messiaen, alfred jarry, messaline, guy debord
mardi, 06 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT BIOGRAPHIE ? (2)
Pensée du jour : « La forme d'une ville change plus vite, hélas ! que le coeur d'un mortel ».
CHARLES BAUDELAIRE
La dernière biographie que j’ai lue, vous ne devinerez jamais (j'ajoute que je suis aussi surpris que vous), c’est celle de JACQUES LACAN par ELISABETH ROUDINESCO. Le sous-titre ? Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée. C’est paru aux éditions Fayard en 1993, ça fait 569 pages à lire. Ajoutez 150 pages de notes diverses, et vous avez à l’arrivée un livre de 1096 grammes. Pas un gramme de moins.
que je suis aussi surpris que vous), c’est celle de JACQUES LACAN par ELISABETH ROUDINESCO. Le sous-titre ? Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée. C’est paru aux éditions Fayard en 1993, ça fait 569 pages à lire. Ajoutez 150 pages de notes diverses, et vous avez à l’arrivée un livre de 1096 grammes. Pas un gramme de moins.
Parenthèse. Je préviens juste que j'y viendrai, au bouquin, mais pas tout de suite. Entre l'intention et la réalisation, quelques interpolations ont eu le goût, le talent et l'art de se glisser. Cela viendra donc, après quelques méandres, auxquels j'avoue que je me livre paresseusement et même voluptueusement.
Je reprends le paragraphe initial : un bon kilo de papier imprimé, c’est pour vous dire si ça vise haut. Et pour tout dire, il vaut mieux endosser une légère armure de concepts pour affronter les aspects théoriques du bouquin (« système de pensée »). Je l’avais acheté à parution. Je viens de le lire. Comme quoi, un livre oublié dans une bibliothèque ne doit jamais perdre l’espoir d’être lu un jour. Comme disait un certain NICOLAS S. : « Ensemble, tout devient possible ».
Autant vous dire que, vu ma formation rudimentaire en philosophie et en psychanalyse, je n’étais pas le mieux armé pour attaquer l’escalade. Enfin, disons que j’ai quelques notions. Acquises en autodidacte, ou « presque ». Et davantage à titre, disons, de curiosité intellectuelle que par adhésion à une grille de lecture propre à la psychanalyse ou à la philosophie.
J’avoue que mon bagage « technique » est mince, et j’ai toujours lu les ouvrages des psychanalystes et des philosophes comme des œuvres littéraires. C’est une méthode que je conseille à tout le monde, parce que très pratique pour éliminer d’entrée de jeu du champ de vision tout ce que je qualifierai d’ « illisible », c’est-à-dire les (nombreux) auteurs qui se soucient moins du lecteur et de la qualité de la langue française que d’exactitude technique.
Ceux-ci choisissent la pureté de la doctrine, au détriment du partage de leur savoir avec autrui. Je range dans cette catégorie l’Anthropologie philosophique, d’un nommé BERNARD GROETHUYSEN, sûrement un ponte vénéré chez les siens, mais véritable oursin inassimilable pour le gosier du « vulgum pecus » auquel j’appartiens.
Je ne parle pas des ouvrages de « sciences dures » (physique, chimie, etc.), mais de ces sciences qu'on appelle « humaines » : je suis, encore aujourd’hui, convaincu que le spécialiste, dans ces dernières, est en mesure, s’il y consent et s'il fait l'effort, d’exprimer son savoir en utilisant « les mots de la tribu ». Mais enfin, je peux dire que j’ai quant à moi fait l’effort de m’approcher de la chose d’un peu plus près que le premier abord.
Dans ceux (souvent d’un savantisme qui me dépasse de très loin) qui écrivent des sciences humaines, je fais un départ étanche entre ceux qui écrivent pour l’homme et ceux qui s’en servent. « Au service de » est pour moi le contraire de « se servir de ». L’humaniste est le contraire de l’arriviste.
Dans le « presque » ci-dessus, en effet, j’englobe les deux « séminaires » de DENIS VASSE auxquels j’ai participé, dans le cadre des activités du Centre Thomas More (couvent de la Tourette, à Eveux, vous savez, ce quadrilatère de béton élevé par l’athée LE CORBUSIER pour les Dominicains) : cela s’appelait « Violence et dérision » et « Le poids du réel, la souffrance ».

Je m’étais inscrit au premier « séminaire » sans rien connaître de monsieur VASSE, après l’avoir vu annoncé sur une porte vitrée, lors d’une promenade dans le vaste et remarquable parc qui entoure le couvent. Et mon travail de l’époque (sur ALFRED JARRY) avait quelque chose à voir avec la dérision.
Autant dire tout de suite qu’il y avait maldonne et que le séminaire de DENIS VASSE ne m’a jamais permis d’avancer dans mon travail. Des moments forts, c’est certain, vécus avec une distance impossible à combler, faute d’une expérience vécue de la chose psychanalytique.
C’est d’ailleurs dans le même esprit que j’ai lu, du même DENIS VASSE, un livre tout à fait merveilleux, bien que je n’en aie compris qu’une partie bien modeste, si ce n’est pas infime : L’Ombilic et la voix(Le Seuil, 1974, 218 pages à lire). Un livre techniquement difficile, c’est sûr, mais un récit impressionnant de la cure effectuée par deux enfants psychotiques (en particulier le petit « Hector ») auprès du psychanalyste.

"HECTOR", DESSIN N°1
LE CHAOS, QUOI
On lit, en alternance, les dialogues entre « Hector » et le spécialiste, puis l’exposé des données techniques et théoriques auxquelles celui-ci se réfère. Ce à quoi j’ai été sensible et attentif, c’est – et je garantis que c’est vrai – qu’on voit le gamin changer, s’ouvrir et devenir humain, comme le montre la distance abyssale qui sépare le dessin n°1 du n°44 (et dernier) du gamin, reproduits en suppléments photo à la suite du texte.

"HECTOR", DESSIN N°44
LA JOIE, VOUS AVEZ DIT ?
Il y a, dans la succession de ces dessins, comme l’histoire de quelque chose qui se déplie difficilement, comme une porte qu’on voit progressivement s’ouvrir, poussée de l’intérieur. J’ai lu ce livre comme un roman, où il serait question d’une naissance, avec des péripéties, des rebondissements, des stases, des crises. Très beau et très fort. Ça va bien au-delà de l’aride technique de la psychanalyse. C’est pour ça que j’en conseille la lecture à tout le monde. Sans ça, vous pensez bien que je ne serais pas arrivé au bout. Mais moi, du moment que c’est de la littérature …
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, littérature, poésie, élisabeth roudinesco, jacques lacan, nicolas sarkozy, anthropologie philosophique, bernard groethuysen, sciences humaines, humanisme, denis vasse, psychanalyse, thomas more, couvent la tourette, le corbusier, alfred jarry, l'ombilic et la voix
mardi, 30 octobre 2012
MA PETITE HISTOIRE DE LA CURIOSITE (4)
Pensée du jour : « La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable ».
CHARLES BAUDELAIRE
Longtemps considéré comme un gouffre obscur où la déesse Raison serait tombée après l’antiquité, et comme une parenthèse refermée à la « Renaissance », c’est précisément le méprisé moyen âge (6ème au 15ème siècle) qui a rendu possible cette dernière, à travers un énorme travail de brassage des connaissances, et leur constante et patiente mise à jour.
C’est probablement autour de l’an 1000 (j’ai oublié la date et l’heure exactes, pardonnez-moi) que fut fabriquée la première horloge mécanique. Et l’horloge de l’humanité ne s’est jamais arrêtée dans un hypothétique « moyen âge » saisi dans une hypothétique glaciation, dont la Renaissance aurait constitué le dégel.
Au contraire, même, pourrait-on dire. C’est le moyen âge qui a établi, en Europe, les bases du monde moderne, celui que nous connaissons. Et parmi ces bases, au premier rang, la CURIOSITÉ. C’est même la principale condition : l’envie de savoir (en vérité) est passée devant le devoir de croire (en foi). Les psys ont une variante de la chose avec la « pulsion scopique ». Vous voyez que, finalement et malgré les détours, je n’ai pas lâché mon fil de départ. Mais il fallait bien tout ça.
Il se trouve que la curiosité est une spécificité EUROPÉENNE. Je parle de la curiosité comme point structurant d’une culture collective, pas comme aventure individuelle. Aucun continent ne s’est intéressé aux autres continents autant que l’Europe.
Bon, c’est sûr, on va me sortir l’Arabe IBN BATTUTA (1304-1377), surnommé le « voyageur de l’Islam » (environ 120.000 kilomètres parcourus en trois décennies dans les quatre points cardinaux), ZHANG QIAN ou ZHENG HE pour les Chinois, quelques autres. Mais cela reste des exceptions, et surtout, ils n’ont pas fondé des dynasties, une industrie, un commerce, des colonies. Disons-le : une nouvelle civilisation. Qui allait englober, dominer et faire disparaître toutes les autres.
L’Europe est le continent de la CURIOSITÉ. De la découverte, de l’exploration. Disons-le : de la découverte et de l’appropriation du monde sous toutes ses formes. L’appropriation la plus égoïste, la plus intolérante et la plus prédatrice. Et en même temps, la plus enthousiasmante pour l’esprit et la plus invraisemblablement créatrice.
Ce n’est pas ailleurs qu’en Europe, en effet, qu’ont été inventés, mis au point et perfectionnés les outils dont l’humanité tout entière se sert encore aujourd’hui dans la connaissance qu’elle a acquise du monde. Ce n’est pas ailleurs qu’en Europe que sont nées toutes les sciences, sciences exactes comme sciences humaines. Or les sciences, telles qu’elles existent, sont le fruit de la curiosité.
Le scientifique ne se demande pas : « A quoi ça sert ? », mais : « Comment ça marche ? ». C’est le philosophe qui se demande à quoi ça sert. Et de toute façon, il arrive toujours après coup, quand les choses sont faites. Quand les carottes sont cuites.
Il y a deux philosophes : celui qui explique ce qui est (ça veut dire traduire l’évidence actuelle en langage incompréhensible, pour qu’on croie qu’il découvre et que c’est trop compliqué pour le pékin moyen), et celui qui décrit ce qui pourrait être (l’utopiste qui veut améliorer l’humanité, dût-elle disparaître, genre LENINE ou POL POT). Je schématise.
Du scientifique, en revanche, il en est venu comme si ça pleuvait. Remarquez, on pourrait en dire autant des philosophes : des « abstracteurs de quinte essence » (RABELAIS) ont fait crouler des flots d’obscurité pour expliquer le monde à leur manière. Pendant que les penseurs pensaient, les scientifiques, bien aidés en cela par les ingénieurs, modifiaient en profondeur les conditions de l’existence humaine, changeaient en permanence les données des philosophes, qui dans la course, ont toujours été loin derrière.
Certains se demandent même aujourd’hui s’il est encore possible de penser le monde. Et l’Europe, dès le 17ème siècle, s’est mise à faire tourner la machine scientifique à plein régime. Et quand je dis « machine », c’est au sens propre.
Car avec la machine, l’Europe a rompu avec une histoire humaine vieille de quatre-vingts siècles : l’homme est allé plus vite que lui-même, plus haut que lui-même, plus fort que lui-même. On a appelé ça, dans un élan d’enthousiasme juvénile, les « Jeux Olympiques ». Vous savez, le désormais sacro-saint « citius, altius, fortius ». Moi j’appelle ça le DOPAGE.
Prenez-le comme vous voulez, mais aller plus vite, plus haut et plus fort que soi, c’est impossible sans une machine. Le dopage est cette machine. Voyez la « Course des dix mille milles » du Surmâle, d’ALFRED JARRY, avec la « perpetual motion food », ou « potion magique ». Monsieur LANCE ARMSTRONG a appliqué à la lettre les règles de la civilisation de la machine : la triche avec la nature. L’homme a commencé à tricher avec lui-même quand il a inventé les machines. BAUDELAIRE aurait-il pu imaginer le règne des machines ? Ses conséquences ?
Voilà que je me dis que j’étais parti pour faire l’éloge de la CURIOSITÉ, et que je retombe sur la malédiction technique. Comment se fait-ce ?
Voilà ce que je me demande, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, littérature, poésie, moyen âge, renaissance, religion, église, curiosité, europe, identité européenne, ibn battuta, islam, rabelais, alfred jarry, le surmâle, lance armstrong
mercredi, 03 octobre 2012
ANIMAUX DES MONUMENTS AUX MORTS
Résumé : j’ai commencé à évoquer, en même temps que le passage de la guerre artisanale, éventuellement chevaleresque, à la guerre industrielle, la disparition programmée des animaux des paysages de champs de bataille, comme le montre la quasi-absence des bêtes dans les monuments aux morts.
Cette guerre-là, donc, est encore artisanale. A propos des hommes, certains parleront volontiers des derniers « chevaliers du ciel », même si le seul point commun (et encore) avec la chevalerie est le duel que se livrent deux hommes. Je ne tomberai pas dans le ton épique et parfois grandiloquent et suranné qui est celui de René Chambe, quand il évoque dans ses livres tel ou tel épisode guerrier dont il fut témoin ou auquel il a lui-même participé. Notre époque fatiguée, où l’esprit baigne dans un bouillon où se diluent inexorablement les nations européennes, est totalement impropre et imperméable à l’idée de grandeur.
Ajoutons toutefois, pour rendre les honneurs militaires à ses mânes éminemment respectables, que ces duels étaient teintés d’élégance morale, de loyauté et de courtoisie. Je retiens aussi, pour mon compte, l’artisanat instinctif du chasseur qui guette sa proie, espérant que son œil et son doigt feront la différence.
Car la carabine, disons-le, est très tôt renvoyée à ses chères études par plus fort qu’elle : la mitrailleuse. Roland Garros a l’idée du premier bricolage (des plaques de métal sur les pales de l’hélice). L’Allemand Fokker l’améliore en concevant tout un mécanisme pour synchroniser l’hélice et la mitrailleuse. Bref, on n’arrête pas ce progrès-là, même si ce qui se passe au sol a quelque chose à voir avec un insondable « régrès ».
Si Georges Brassens, sur le mode léger (en apparence), peut chanter : « Moi mon colon, celle que j’ préfère, c’est la guerre de 14-18 », c’est qu’elle est, d’une certaine manière, entièrement nouvelle. Pour la première fois, la population masculine dans son ensemble est considérée par les chefs politiques et militaires comme un énorme réservoir de matière vivante dans lequel il suffit de puiser. L’historien britannique Eric Hobsbawm ne fait pas démarrer par hasard son histoire du « court XX° siècle » en 1914, année qui marque le début de la course à l’arme atomique. Cette guerre a amené la technique et l'industrie au pouvoir.
Le rouleau compresseur de la folie guerrière et fratricide lamine les hommes : il y a environ 40.000.000 de Français en 1914, dont la moitié approximative de sexe masculin, à laquelle il faut ôter au moins 1.712.000 morts (8,5 % des mâles), sans compter 4.000.000 de blessés (20 % des mâles) et invalides. On peut presque dire qu’un tiers de tous les hommes de ce pays ont été soit éliminés, soit marqués à vie dans leur tête et dans leur chair.
J’en arrive aux animaux : la première guerre mondiale constitue le point final (ou peu s’en faut) de leur présence sur les champs de bataille, de leur utilisation comme auxiliaires de guerre. A cet égard, il est frappant de constater leur absence pour ainsi dire complète du champ des monuments aux morts : j’en ai à ce jour recensé 14 (il y a 36.000 « monumorts » en France). Autant dire RIEN : ils ont été purement et simplement évincés du paysage.
Les quelques exceptions que je présente comportent d’ailleurs une bizarrerie : sur les 14 monuments, 6 portent des lions (si !). J’en tire quant à moi une conclusion qui ne vaut que ce qu’elle vaut : l’animal est devenu inutile, comme il le deviendra quelque temps après dans les travaux des champs, dans les transports,… La guerre de 1914-1918 est une guerre mécanique, comme le montre la naissance du char d’assaut, qui apparaît pour la première fois le 15 septembre 1916. Face au Monstre mécanique (François Jarrige, éditions imho, 2009), l’homme n’est plus rien.
Hommage soit donc ici rendu aux quelques rares bêtes parvenues jusqu’à nous dans les monuments aux morts. J’éviterai de mentionner le coq, trop tarte à la crème patriotique, surtout quand il est présenté en train de terrasser l’aigle impériale. J’ai montré dans mon billet précédent (et ci-dessus) deux monuments impressionnants, comportant des chevaux. On trouve aussi le chien.
Dommage que l'animal soit le grand oublié des monuments aux morts. Mais certainement révélateur. Et sans doute prémonitoire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, littérature, faustroll, gestes et opinions du docteur faustroll, pataphysique, monuments aux morts, guerre 14-18, rené chambe, roland garros, fokker, france, nation, patrie, georges brassens, éric hobsbawm, françois jarrige, face qu monstre mécanique
dimanche, 30 septembre 2012
L'AMOUR ABSOLU
Pensée du jour :
« J'aime le son du bois, le soir au fond du corps,
Ma louve dévêtue.
Je sonne l'olifant dans ton camp du drap d'or :
Qu'il est crépu, ce cul ! »
Trêve de calembours ? Alors, un peu de littérature ? Bon, alors voici. Je suis à vos
ordres.
« Il habite une des branches de l’étoile de pierre.
La prison de LA SANTÉ.
Comme il est condamné à mort, la branche où se cataloguent les condamnés à mort.
L’astérie pétrifiée n’a attendu pour s’épanouir, miroir des étoiles, que l’heure des étoiles. »
Ce sont les premières lignes de L’Amour absolu.
Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas parlé d’un de mes fétiches en littérature : ALFRED JARRY, l'immarcescible inventeur de la 'pataphysique et du docteur Faustroll, pataphysicien.
Cinquante pages en « Poésie-Gallimard », quarante en Pléiade, tu te rends compte, et ALFRED JARRY ose appeler ça « roman ». Bon, c’est vrai, il devait constituer, à l’origine, un simple chapitre de L’Amour en Visites. On ne va pas chipoter. Car ce livre, c’est bien une aura de beauté qui en émane.
Comme le disait le regretté NOËL ARNAUD, c’est vrai que l’auteur ne s’adresse pas au lecteur paresseux, consommateur d’histoires plus ou moins bien torchées, davantage habitué à la production qu’à la création. Qu’à une vraie littérature d’invention. Si tu penses en être, cher lecteur, il vaudrait peut-être mieux que tu passes ton chemin. Ce territoire est celui de la littérature, la vraie, la pure et dure, peut-être l’intégriste. La preuve ? Qui a lu L’Amour absolu ?
Emmanuel Dieu (c'est le "héros"), ancien enfant trouvé, le jour de Noël, dans un « doué » (lavoir en Bretagne), a été condamné à mort, et il attend son exécution. Voilà tout ce que je dirai de « l’intrigue ». A-t-il tué, d’ailleurs ? Rien n’est moins sûr : « S’il n’a pas tué, pourtant, ou si l’on n’a pas compris qu’il tuait, il n’a d’autre prison que la boîte de son crâne, et n’est qu’un homme qui rêve assis près de sa lampe ».
J’ai naturellement, comme tout le monde, découvert ALFRED JARRY par son côté face : le père Ubu. Je me rappelle même avoir, ô combien laborieusement, avec des potes, enregistré quelques scènes d’Ubu roi sur un magnétophone à bande. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à débusquer, à éplucher les autres œuvres, en particulier L’Amour absolu. C'est même cette première fusée qui m'a offert des photos de la face cachée de cette planète qu'est l'oeuvre après tout copieuse de cet auteur mort à 34 ans.
Qu’est-ce qui attire ? Qu’est-ce qui fascine, ici ? Je réponds : la force et la beauté poétiques du texte, où se télescopent les histoires et les mythes les plus divers, dans une sarabande enfiévrée : Ahasvérus, le juif errant, qui devient le « Christ-errant », le dieu Odin et ses loups, la fée Mélusine, des souvenirs de Rabelais, de Cervantès et des Mille et Une Nuits, Joseph et Marie, la Bretagne, l’enfance et l’adolescence, etc. Vous comprenez qu’on ne peut se hasarder à en dérouler l’intrigue.
Ce texte n’a pas pris une ride, contrairement à toute la littérature symbolarde, épouvantablement ligotée dans l’époque qui l’a vu produire. Je ne qualifierai pas sa modernité du trop galvaudé « stupéfiante ». Plus simplement, j’en donnerai un exemple. On sait que L’Interprétation des rêves, ouvrage fondateur s’il en est, paraît en 1895.
Bon, je sais que le professeur de philo de Jarry, M. Bourdon, faisait, dès 1890, des cours sur NIETZSCHE, non encore traduit en français, mais je doute fort qu’Alfred ait pu avoir connaissance du livre de Freud, qui définit le rêve, comme chacun sait : « un accomplissement de désir ». Or, voilà-t-il pas qu’ALFRED JARRY écrit, en 1899 :
« La Vérité humaine, c’est ce que l’homme veut : un désir.
La Vérité de Dieu, ce qu’il crée.
Quand on n’est ni l’un ni l’autre – Emmanuel –, sa Vérité, c’est la création de son désir. »
Voyez la citation de FREUD, et on dira ce qu’on voudra, mais … Convaincant, n’est-ce pas ?
D’une manière plus générale, certains font la fine bouche, et trouvent singulièrement « datée » cette façon d’écrire. Ce n’est pas impossible. Je reste malgré tout attaché à cette prose poétique, par laquelle je suis entré jadis dans l’autre facette de l’œuvre d’ALFRED JARRY, tout ce qui ne tourne pas autour de la très encombrante gidouille d’Ubu, dont les extravagances ne font plus aujourd'hui que m'ennuyer.
Ce qui me frappe, aussi, c’est l’intensité du récit, sa densité, ainsi que le mystère obstiné qui plane sur ce que certains appellent la « réalité ». Y a-t-il eu adultère ou inceste ? Meurtre ou naissance ? Est-ce la mort ou le sommeil ? Le rêve ou la réalité ? La femme s’appelle-t-elle Varia ou Miriam ? Dors-je ou veillé-je ? JARRY tente de relever à sa manière le même défi que s’est lancé GUSTAV MEYRINK dans La Nuit de Walpurgis ou dans Le Golem, deux livres qui vous font vous demander, quand vous les refermez, si vous n’avez pas rêvé.
« Absolu – ment.
C’est une charade.
Ce que ne qualifie pas le premier est le sujet du second.
Tout dans l’univers se définit par ce verbe ou cet adjectif. »
Indispensable.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, alfred jarry, l'amour absolu, amour, énigme, l'amour en visites, noël arnaud, gustav mayrink, la nuit de walpurgis, le golem, ubu roi, sigmund freud, l'interprétation des rêves, pataphysique
vendredi, 28 septembre 2012
DU RACISME ANTI-FRANçAIS
Pensée du jour :
« Entre l'absence et la chemise,
Le temps d'une exhalaison,
Fume le corps de gourmandise
De nos appétits sans raison ».
Ainsi, monsieur JEAN-FRANÇOIS COPÉ, un clone de NICOLAS SARKOZY, drague les voix d’extrême-droite en soutenant qu’il existe un racisme anti-blanc, sur le territoire même de la République Française, une et indivisible. A entendre, les bouchons dans les oreilles, les hurlements des accusateurs, on se dit que JEAN-FRANÇOIS COPÉ est un salopard fasciste.
Je ne crois pas que JEAN-FRANÇOIS COPÉ soit un salopard fasciste. Il est juste un politicien français. Pour lui, la présidence de l’UMP n'est qu'une rampe de lancement. En direction du perchoir national : la Présidence de la République. Avec son « racisme anti-blanc », il se contente de répliquer à l’annonce surprise de FRANÇOIS FILLON de 45.000 parrainages en vue du prochain congrès de l’UMP. « Il faut lâcher le congrès », lisait-on jadis dans l’Album de la Comtesse, du Canard enchaîné (contrepèterie relativement facile).
Il faut le comprendre, COPÉ : FILLON lui a grillé la politesse, en annonçant dans les médias un nombre pharamineux de signatures et de soutiens. Cramé, COPÉ. Obsédé par la Présidence, que vouliez-vous qu’il fît ? Son raisonnement ? « Comment vais-je lui faire manger ses dents, à ce Néandertal ? » Une petite séance de « brain-storming » avec son « staff » (je cause moderne), et voilà le racisme anti-blanc qui arrive sur le devant de la scène. Vas-y à fond, coco ! C’est tout bon ! La best réplique sur l’échelle de Richter. Enfoncé, FILLON.
C’est entendu : COPÉ drague les voix du Front National, c'est-à-dire la frange droite des militants UMP. Il n’est pas fasciste pour autant. Monsieur COPÉ est un pur produit de la politique à la française : la politique considérée comme une carrière. En son temps, ALFRED JARRY avait écrit un article paru dans Le Canard sauvage, n° du 11 au 17 avril 1903, intitulé « La Passion considérée comme course de côte ». De nos jours, tout est possible, et l’horizon de l’ambitieux s’élargit au-delà des dimensions humaines, comme l’horizon russe au moment où monsieur HITLER se mit dans l’idée fixe de l’envahir.
COPÉ ? Il va juste à la pêche. C’est, comme on dit, une opération de communication. Elaborée dans un bureau de petit comité. Les penseurs de ça sont dix au maximum. FILLON dispose d’une équipe identique. Tout le monde est grassement payé, en spéculant sur l’avenir, comme MANUEL VALLS et ARNAUD MONTEBOURG l’ont fait avant l’élection de HOLLANDE. Aucune de ces personnes n’a, à proprement parler, de « ligne politique ». Exercer le pouvoir est le seul objectif.
Reste, paraît-il, le « débat ». On parle ici de faits et de réalité. Existe-t-il, aujourd’hui en France, un racisme anti-français ? Existe-t-il un racisme anti-blanc ? Eh bien, mesdames et messieurs, au risque de choquer, je dis que la réponse est OUI. Il faut, certes, relativiser : le racisme anti-français se développe dans des portions très délimitées, et même très limitées du territoire national. Il n’empêche, il existe. La haine de la France se développe dans certaines villes de France.
Maintenant, regardons un peu ce qui s’est passé dans les principaux pays arabes pendant les trente dernières années : l’Egypte de ANOUAR EL SADATE, l’Algérie de CHADLI BENJEDID, la Tunisie de ZINE EL ABIDINE BEN ALI. La Libye de KHADAFI est un cas à part : j’aurais envie d'opérer un rapprochement entre le « Guide de la Révolution » et un certain JOSIP BROZ, dit TITO (Yougoslavie). Tant que le dictateur fait régner son ordre, les populations vivent dans une unité relative. Lui disparu, l’Etat central et unificateur a tendance à se désagréger.
Mais ailleurs ? SADATE, et MOUBARAK après lui, achète la paix à coups de mosquées, réprimant les Frères Musulmans, mais en ayant soin de leur laisser gérer la misère sociale, l’entraide mutuelle, les associations de secours à la population. Si la situation diffère en Tunisie, et surtout en Algérie, elle s’en approche. Tunisie ? Mosquéisation à fond la caisse, gestion du social aux islamiques. Algérie ? Arabisation à fond la caisse pour éradiquer le souvenir même de l’infect colonisateur, gestion du social aux religieux.
Vous avez repéré les termes de l’équation ? Le clan au pouvoir (MOUBARAK et sa famille, BEN ALI et sa femme, la redoutable LEÏLA TRABELSI et toute sa parentèle, une clique de généraux puissants et BOUTEFLIKA qui leur sert de faux-nez) vit sur le tas d'or qu'il a piqué, achetant ici et là les bonnes volontés influentes et utiles ; la population, pour l’essentiel, croupit dans la misère et le chômage ; l’Islam progresse, prospère, croît et embellit sur le fumier du social, négligé par le pouvoir.
Maintenant regardez les « quartiers » français. Ôtez le clan prédateur de l’équation, reste quoi ? L’Islam d’un côté, de l’autre, la misère et le chômage. Ajoutez à l’équation la guerre israélo-palestinienne : MOHAMED MERA est une exception du fait qu’il passe à l’acte, c’est le moins qu’on puisse dire.
Mais le sentiment anti-français qui l’animait, la motivation qui était la sienne, pensez-vous qu’ils demeurent une exception, dans nos banlieues ? L'identification aux Palestiniens comme victimes est largement répandue. Et imaginez maintenant cette misère chômeuse, trafiquante et islamisée avec des kalachnikovs dans les mains. C’est juste une image. J’espère.
C’est sur ces entrefaites (tiens donc !) qu’on apprend, ces derniers jours, que le Qatar, qui a déjà acheté, entre beaucoup d’autres, le P.S.G., a proposé au gouvernement de créer un fonds d’investissement qui serait là pour aider des jeunes des banlieues (d’origine essentiellement maghrébine) à créer leur entreprise. Le dit gouvernement s’est empressé d’accepter, en précisant évidemment qu’il serait présent dans le financement pour contrôler. Mon oeil !
Sans même parler des prêches dans les mosquées le vendredi, est-il vrai que les responsables politiques français, nationaux et territoriaux, laissent des « associations » plus ou moins confessionnelles s’occuper des populations « issues de l’immigration » ? Oui ou non ? Une petite subvention par-ci, on ferme les yeux par-là ? Que croyez-vous qu’il arrivera, à la longue ?
Et monsieur HARLEM DESIR (avec ses congénères prêcheurs stipendiés de la diversité, de la mixité sociale, du « métissage » et de la tolérance) s’indigne (le mot est faible) qu’un politicien français « droitise » son discours et récupère des idées du Front National.
Ces idées ne sont celles du Front National que parce qu’une portion non négligeable de la population française « de souche » a l’impression, en certains lieux, de ne plus être chez elle. Car le Front National n’existe que parce qu’il a une clientèle : toute demande suscite une offre qui se propose de la satisfaire. C’est la loi du marché.
Maintenant, prenez un politicaillon – mettons qu’il s’appelle JEAN-FRANÇOIS COPÉ – qui désire progresser en direction du pouvoir et qui, pour cela, a besoin d’occuper un poste-clé au détriment de son principal rival – mettons FRANÇOIS FILLON. « Ah, FILLON me grille la politesse en proclamant le nombre de ses soutiens UMP ? Puisque c’est comme ça, je me mets « au centre du débat » (pour parler comme les « journalistes ») en claironnant sur le thème ». Car il ne s’agit que de rassembler des voix sur son nom. Pas de résoudre un problème.
Mais cela ne veut dire en aucun cas que le problème n’existe pas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, politique, société, islam, jean-françois copé, nicolas sarkozy, ump, république, france, racisme, racisme anti-blanc, françois fillon, album de la comtesse, canard enchaîné, presse, contrpèterie, alfred jarry, la passion course de côte, hitler, man, uel valls, arnaud montebourg, françois hollande, sadate, moubarak, bouteflika, ben ali, frères musulmans, mohamed mera, kalachnikov, qatar, psg, harlem désir, front national, extrême droite
samedi, 15 septembre 2012
CARTES POSTALES DU FRONT
Pensée du jour :
 « Tu t'chopes des suées à Saïgon
« Tu t'chopes des suées à Saïgon
J'm'écris des cartes postales du front
Si ça continue j'vais m'découper
Suivant les points les pointillés
... Vertige de l'amour ».
ALAIN BASHUNG
CARAMBOLAGE
Le lauréat de la médaille Fields (comme les mathématiques furent rejetées par ALFRED NOBEL, il fallait bien trouver une récompense aussi prestigieuse pour les pionniers de la discipline, mais c'est tous les quatre ans) est prévenu de son couronnement 6 mois avant l’annonce officielle, avec interdiction absolue d’en parler à qui que ce soit. Pour le médiatique CEDRIC VILLANI, ce fut, dit-il, un « délai merveilleux ». Il vient de publier Théorème vivant. On l'applaudit bien fort.
rejetées par ALFRED NOBEL, il fallait bien trouver une récompense aussi prestigieuse pour les pionniers de la discipline, mais c'est tous les quatre ans) est prévenu de son couronnement 6 mois avant l’annonce officielle, avec interdiction absolue d’en parler à qui que ce soit. Pour le médiatique CEDRIC VILLANI, ce fut, dit-il, un « délai merveilleux ». Il vient de publier Théorème vivant. On l'applaudit bien fort.
CABRIOLET
Monsieur ANDERS BEHRING BREIVIK, le médiatique auteur de 77 meurtres en Norvège, a déclaré lors du prononcé du verdict de son procès : « Je voudrais présenter des excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes ».
le médiatique auteur de 77 meurtres en Norvège, a déclaré lors du prononcé du verdict de son procès : « Je voudrais présenter des excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes ».  Le médiatique monsieur RICHARD MILLET vient de démissionner du comité de lecture de Gallimard (cf. Le Comité, de MICHEL DEGUY, Champvallon, 1988), après avoir publié un « éloge littéraire » de Monsieur BREIVIK. On attend le prochain Indignez-vous de STEPHANE HESSEL. Mais on me dit qu'un Niagara d'indignation lui est tombé sur le râble, à RICHARD MILLET. Que c'est beau la morale ! Qu'il est grand, le moraliste ! Il y a quelque chose d'admirable et de terrifiant chez les gens qui vont au bout d'une logique, quelle qu'elle soit.
Le médiatique monsieur RICHARD MILLET vient de démissionner du comité de lecture de Gallimard (cf. Le Comité, de MICHEL DEGUY, Champvallon, 1988), après avoir publié un « éloge littéraire » de Monsieur BREIVIK. On attend le prochain Indignez-vous de STEPHANE HESSEL. Mais on me dit qu'un Niagara d'indignation lui est tombé sur le râble, à RICHARD MILLET. Que c'est beau la morale ! Qu'il est grand, le moraliste ! Il y a quelque chose d'admirable et de terrifiant chez les gens qui vont au bout d'une logique, quelle qu'elle soit.
 CATECHUMENE
CATECHUMENE
CHAVELA VARGAS (écoutez le sublime « Vamonos », Carnegie Hall 2003, sur Youtube), morte le 5 août 2012 à 93 ans, déclarait à qui voulait l’entendre qu’elle avait bu environ 45.000 litres de tequila au cours de sa vie. Si elle était morte à 123 ans, on aurait pu dire que, en commençant dès le jour de sa naissance, cela aurait fait un litre par jour de vie. En commençant à l'âge de 20 ans, elle aurait dû mourir à 143 pour accomplir une performance égale. Comme dit ALFRED JARRY : « L'alcool conserve les chairs ».
CATEGORIE
L’agence américaine de l’environnement conseille aux habitants voisins de chantiers d’exploitation des gaz de schiste (cliquez ci-contre pour vous faire des impressions fortes, ça dure 46 minutes) de ne pas fumer pendant qu’ils font couler l’eau du robinet. A cause des risques d'explosion. Voir, pour plus d'information et de spectacle, le film Gasland.
gaz de schiste (cliquez ci-contre pour vous faire des impressions fortes, ça dure 46 minutes) de ne pas fumer pendant qu’ils font couler l’eau du robinet. A cause des risques d'explosion. Voir, pour plus d'information et de spectacle, le film Gasland.
CATALEPSIE
Le respect se perd. D’une façon générale, c’est sûr. A l’égard des professeurs, c’est d’encore plus d’évidence. Ainsi, choquée par la remarque portée dans le carnet de correspondance de son enfant par le professeur d’histoire-géographie, concernant un travail non fait, ainsi que l’oubli à répétition de livres et cahiers, une mère de famille a fait irruption dans la salle de classe et a assené à l’enseignante, de source syndicale, force gifles et coups de pied. Le rectorat de Poitiers s’est porté, avec le cran administratif qu’on lui connaît, au secours de la victime, déclarant qu’elle avait reçu "une seule gifle et un seul coup de pied, sortant l’après-midi même de l’hôpital". Ce qui, indéniablement, relativise.
CARROSSERIE
En revanche, le maire de Cousolre (59), lui, parce qu'il avait giflé un adolescent parce que celui-ci avait proféré des insultes et des menaces à son encontre parce qu’il prétendait l’empêcher d’escalader un grillage, sera prochainement jugé en appel, après avoir été, en première instance, condamné à 1000 euros d’amende et 250 de dommages et intérêts. A part l'amende, monsieur BOISART n'aura qu'à échanger ses billets avec l'adolescent, lui aussi condamné à 250 de dommages.
Une question reste sans réponse : qui condamnera les juges à se flanquer 33 coups de pieds dans le derrière ?
KARABOUDJAN

Les ruines de Pompéi tombent en ruines au carré. Que fait Berlusconi ? Il organise un gang-bang. Dans l’un des monuments les plus connus de la ville (et de toute l’antiquité romaine), l'extraordinaire Villa des Mystères, une poutre de soutien du toit de tuiles s’est effondrée le 8 septembre. Très mauvais signe. On sait en effet que cette date du 8 septembre est l’appellation « vulgaire » du 1er absolu du calendrier pataphysique, jour de liesse, puisqu’il a vu la naissance du Père Ubu , autrement dit l’avènement de la ’Pataphysique en ce monde. Alléluia ! Allez en paix ! Ite missa est ! Des « Mystères » s’effacent pour laisser place à d’autres « Mystères », plus imposants et majestueux. Et laissons les ruines enterrer les ruines. Pour mieux laisser advenir le règne de Faustroll-Ubu-Jarry !!!! « Ha ! Tu resplendis dans la lumière ... Le Rock advole ! » (César-Antéchrist, Acte dernier).
, autrement dit l’avènement de la ’Pataphysique en ce monde. Alléluia ! Allez en paix ! Ite missa est ! Des « Mystères » s’effacent pour laisser place à d’autres « Mystères », plus imposants et majestueux. Et laissons les ruines enterrer les ruines. Pour mieux laisser advenir le règne de Faustroll-Ubu-Jarry !!!! « Ha ! Tu resplendis dans la lumière ... Le Rock advole ! » (César-Antéchrist, Acte dernier).
CARABISTOUILLE
Pour finir, je m'en voudrais de ne pas signaler, en ces temps qui nous rapprochent du 11 novembre et de ses commémorations de la fermeture d'une échoppe (à l'enseigne de la "Grande Boucherie du XX ème siècle"), l'existence d'un monument très particulier que nous a légué cette époque. En dehors des 17 communes françaises (sur 36 000) dépourvues de tout monument aux morts, on note qu'un monument devient facteur de division entre deux communes : Saint-Santin et Saint-Santin.

SAINT-SANTIN D'AVEYRON (12)
Car il faut savoir que l'administrateur parisien, en traçant les limites des départements, a fait passer celle du Cantal et de l'Aveyron en plein milieu de la commune de Saint-Santin. Et l'on voit, en regardant bien, successivement, les flancs du monument, que l'on est d'un côté en Aveyron, et de l'autre côté dans le Cantal. Question : a-t-on gravé deux fois les noms des morts ?

SAINT-SANTIN DU CANTAL (15)
Ils sont fous, ces Romains !
Voilà ce que je dis, moi.
Note destinée aux lecteurs interloqués par les intitulés jalonnant cette note : comme ça faisait bien longtemps que je n'avais pas évoqué BEROALDE DE VERVILLE et son inénarrable (je pèse mes mots) Moyen de parvenir, je me suis permis de m'inspirer de ses titres de chapitres. Un exemple de succession de titres (il y en a 111 comme ça) : « Mappemonde, Métaphrase, Paragraphe, Occasion, Plumitif, ... ». En espérant que cela relativisera à leurs yeux l'arbitraire de mes vocables.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gasland, stéphane hessel, karaboudjan, poésie, chanson, alain bashung, vertige de l'amour, carte postale, prix nobel, cédric villani, mathématiques, le théorème vivant, anders behring breivik, norvège, assassin, richard millet, littérature, pamphlet, michel deguy, gallimard, comité de lecture, chavela vargas, alfred jarry, gaz de schiste, violence, cousolre, professeur, villa des mystères, pompéi, ubu, pataphysique, faustroll, ruines, père ubu, césar antéchrist, félix vallotton, niagara, calendrier pataphysique, béroalde de verville, le moyen de parvenir
dimanche, 09 septembre 2012
ULTRALIBERAL ? MAIS JUSQU'OU ?
Pensée du jour : « Quand ne sera-t-il plus besoin de rappeler que les antialcooliques sont des malades en proie à ce poison, l'eau, si dissolvant et corrosif qu'on l'a choisi entre toutes substances pour les ablutions et lessives, et qu'une goutte versée dans un liquide pur, l'absinthe par exemple, le trouble ? ».
ALFRED JARRY

ALFRED JARRY SUR UN MUR DU GRAND LEMPS (38)
EN COMPAGNIE DE L'ABSINTHE ET DU PEINTRE PIERRE BONNARD
C’est ainsi que, dans un premier temps, monsieur DEGAUCHE dépénalise l’homosexualité. Comme depuis un bon moment, le délit ne saute plus aux yeux de beaucoup de gens, monsieur DEDROITE ne moufte pas. Mais cela ne suffit pas. Ainsi, les curetons (rien que des DEDROITE), en 1984, n'ont-ils pas fait plier ALAIN SAVARY et FRANÇOIS MITTERRAND au sujet de l’enseignement catholique, en brandissant le drapeau de la « liberté » (après un beau hold up sur la dite liberté) ?
Eh bien monsieur DEGAUCHE leur emboîte le pas. A ceci près que, en dehors de l'extravagante "Gay Pride", il n'aura pas à manifester par millions dans les rues. Il ne voit donc aucun inconvénient à inscrire dans le marbre de la loi le mariage homosexuel et l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. Au nom de l’ « égalité », cette fois. Mieux : pour lutter contre l’ « inégalité des droits ».
Monsieur DEDROITE, et parfois l’homme de la rue (une variante primitive d’homo sapiens), a du mal à comprendre cette spécification de la notion d'égalité, qui semble, pour l’occasion, curieusement détournée de son sens.
En fin de compte, si monsieur DEGAUCHE a admis l’ordre capitaliste des choses (comment ça, il a retourné sa veste ? Mais comment osez-vous ?), en revanche, dans le domaine "culturel" (ou "sociétal", comme on voudra), il a gardé intacte sa volonté de mettre à bas l’arbitraire qui établit des différences (rebaptisées « inégalités »), fondées sur des critères de jugement. Juger, se dit-il, c’est mal. Il est interdit de juger. Aussi importe-t-il de rendre tout jugement impossible. Et donc de brouiller les repères le plus savamment possible. Le grand tout, c'est de « décloisonner » à tout va. Abattre les frontières entre les « genres ».
Curieusement, cependant, monsieur DEGAUCHE s’arrête en chemin. On ne sait quelle vergogne le saisit au moment de franchir un autre Rubicon. Peut-être sent-il vaguement que « la société » n’est pas prête ? Toujours est-il que, alors même que toutes les forces du commerce et de la marchandise, toutes les forces des médias en général et de la télévision en particulier, concourent à élire la PETITE FILLE en icône féminine (et même sexuelle, voyez LOLITA), digne de tous les soins de peau, de tous les maquillages et de toutes les modes vestimentaires les plus « modernes », monsieur DEGAUCHE retrouve le sens du sacré. Je veux dire qu'il recule devant le risque d’accusation de pédophilie. Ici, on perçoit une légère contradiction entre commerce et morale ? Qu'allez-vous chercher ?
Alors, LGBT tant que vous voudrez, mais ne touchez pas à l’enfant. LGBT, c’est pour « Lesbienne, Gay, Bi et Trans ». Le message implicite de LGBT, c’est : « Tout est permis ». Eh bien non : on ne sait quelle pudeur saisit soudain l’homme de gauche à l’orée de la forêt enfantine.
Car monsieur DEGAUCHE, qui n’en est pas à une contradiction près, revient très fermement au répressif (qui, pour tout le reste, lui fait horreur), persistant à appeler « malade » une personne attirée sexuellement par un enfant, et à lui ordonner, dans ses cours de justice, des « obligations de soins ». Exactement l'accusation qui visait les homosexuels il n'y a pas si longtemps. Etrange, ne trouvez-vous pas ?
Un mystérieux mur invisible l’empêche de réaliser dans ce domaine la trilogie qu'il a menée à bien dans les autres : 1 - dépénaliser (abolir le délit), 2 - légaliser (accorder la respectabilité, en punissant au besoin l' « homophobie »), 3 - légiférer (accorder aux homosexuels le mariage et l'adoption d'enfants).
Ce qu’il a fait en faveur des LGBT, il ne le ferait pour rien au monde à l'égard de ces immondes pédophiles, la honte de l’humanité. Fi donc ! Jarnidieu ! La peste soit du fat ! Jusqu’à ce que peut-être, un jour futur, ceux-ci s’étant à leur tour organisés en associations "de défense" criant à la "stigmatisation" et à la "persécution", forment des groupes de pressions, s'introduisent en réseaux influents parmi les cercles du pouvoir, pour finir par faire modifier la loi en leur faveur, et établir une bonne fois le délit de « pédophilophobie ».
Monsieur DEGAUCHE pourra alors se dire en toute bonne conscience que « la société est prête ». Que « les mentalités ont évolué ». Qu’à tant faire que de « faire tomber des tabous », au fond, pourquoi pas celui-là ?
Mais on oublie trop souvent que parmi ce qu’il est convenu d’appeler les « minorités sexuelles » avides de faire reconnaître officiellement leur « orientation sexuelle », leur « choix de genre » et leurs « préférences sexuelles », il n’y a pas que les LGBT, loin de là. Certains pourraient même les accuser d’accaparer égoïstement toute l’attention, au détriment de beaucoup d'autres. Il faut voir plus loin, plus large et, si j'ose dire, plus profond.
Car, si monsieur DEGAUCHE était vraiment progressiste, il devrait, en plus des pédophiles, exempter des foudres de la loi les zoophiles (à quand le mariage entre gent humaine et gent canidée (mais à quel doigt passer l'anneau ?) ?), les coprophiles et autres scatophiles, les sadiques, les masochistes (le baron de Charlus dans Le Temps retrouvé), les exhibitionnistes, les masturbateurs, les gérontophiles, les nécrophiles, les fétichistes (à quand l’adoption de chaussures à talon haut, reconnue par la loi, par les couples fétichistes ?).
Bref, puisque la notion de « limite » fait horreur à monsieur DEGAUCHE, la liste est longue des « droits » à réclamer, à ouvrir et à inscrire dans le métal de la loi ; des « barrières » à faire tomber ; des « tabous » à abolir. Pour conclure, je finirai sur une allusion au marquis DE SADE : gens de la gauche morale, « encore un effort pour devenir … », quoi, au fait ? On trouve en effet, inséré au milieu de la débauchée Philosophie dans le boudoir, une sorte de traité révolutionnaire : Français, encore un effort si vous voulez être républicains.
Bon, si vous voulez, retranchons « républicains » à la formule du marquis. Et reprenons en chœur : « gens de gauche, encore un effort pour devenir ». Un point c’est tout. Monsieur DEDROITE n’a plus qu’à fermer sa gueule, à ruminer et à regarder passer les trains des « réformes ». Monsieur DEGAUCHE, de son côté, n'a plus qu'à devenir un point. C'est tout.
Alors, mes bien chers frères, vous voulez savoir quoi ? DEVENONS. C'est le fond de l'affaire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, alcoolisme, antialcoolisme, absinthe, politique, société, moeurs, répression, tolérance, liberté égalité, homosexualité, lgbt, capitalisme, inégalités
samedi, 08 septembre 2012
ULTRALIBERAL DE GAUCHE ?
Pensée du jour : « L'âme est un tic ».
ALFRED JARRY
Je disais donc qu’aux Etats-Unis, les libertariens travaillent à la disparition de l’Etat. Leur slogan : « L’Etat n’est pas la solution, c’est le problème ». Dès qu’on leur parle de redistribution des richesses, ils crient à la dictature communiste. Mais s’ils sont ultralibéraux en politique et en économie, ils restent cohérents quand il s’agit des rapports sociaux et des mœurs : ils sont, entre autres et par exemple, favorables au mariage homosexuel et à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. Ils vont au bout de leur logique.
En France, on n’en est pas là. A droite comme à gauche, on reste timoré, pusillanime, pour ne pas dire effarouchable, dès qu’il s’agit d’être logique. Tous deux cultivent leurs contradictions amoureusement, comme un bout de jardin où poussent quelques légumes qui leur servent de fonds de commerce. Chez l’un, la tomate du dirigisme social voisine impunément avec l’aubergine du libéralisme économique. Chez l’autre, le poivron du dirigisme économique côtoie fièrement la courgette du libéralisme social. Et tout ça fait une excellente ratatouille, à condition d'oignons et aulx à suffisance.
Mais on va voir qu’ils poussent le fétichisme de la contradiction encore plus loin, jusque dans le domaine des mœurs. C’est ainsi que monsieur DEDROITE a dressé un piédestal sur lequel il a juché, entre autres valeurs sûres, la famille, le mariage, les bonnes manières. Au nom de la tradition, d’une part, mais d’autre part parce qu’il faut bien fonder la vie commune sur quelques vérités bien senties.
La famille découle de l’union, si possible consacrée en présence de Notre-Seigneur, entre un homme et une femme. L’union est évidemment définitive, et monsieur DEDROITE sentirait ses cheveux se hérisser sur son crâne, rien que d’imaginer qu’il pût en être autrement. La respectabilité avant tout. Cela fait partie des valeurs sûres et éprouvées. Et le respect des enfants pour leurs parents est une simple base de départ, évidente. Quasiment une condition.
Monsieur DEGAUCHE, de ce côté, il faut bien l’avouer, fait beaucoup plus débraillé. La famille ? Il faut être tolérant. Elle est à géométrie variable ? Il faut être compréhensif. Avec des rejetons ouverts aux possibles ? Il faut être tolérant. A peine sortis du berceau, les enfants sont considérés comme des personnes. A ce titre, ils sont dignes de respect : c’est à eux de choisir. La conception de l’enseignement est à l’avenant : c’est à l’enfant lui-même de « construire son savoir ».
Dans La Grande bouffe, MICHEL PICCOLI, avant d’entrer dans la villa de Neuilly pour y mourir d’occlusion intestinale, laisse sa fille lui présenter un grand noir dont le principal talent est de danser comme un dieu. PICCOLI est sûrement DEGAUCHE. Tout ça, apparemment, ne porte guère à conséquence.
Le mariage ? Qu’est-ce que c’est, cette institution désuète ? Il fait partie des structures d’une société honnie. Car monsieur DEGAUCHE déteste en général tout ce qui vient de la société capitaliste, et en particulier, tout ce qui en fait l’armature morale, dont il a bien l’intention de se débarrasser quand il aura changé la société dans son ensemble.
La manière de s’habiller ? JACK LANG, ministre de la Culture, la première fois qu’il voulut aller s’asseoir sur les bancs des ministres à la Chambre, se vit refuser l’accès par les appariteurs. Sûrement soudoyés par la droite réactionnaire : il voulait entrer, rendez-vous compte, en costume impeccable et impeccable pull blanc à col roulé ! Un attentat contre les institutions ! Disons-le : monsieur DEGAUCHE a inventé le « non-conformisme ». Le pull blanc à col roulé, au risque de renverser la république.
Car monsieur DEGAUCHE a accédé au pouvoir. Il y a planté les dents avec curiosité, l'a mâché avec intérêt, avalé avec délices. Ce faisant, il s’est dit : « Pourquoi pas moi ? ». C’est pourquoi en 1983, monsieur DEGAUCHE se convertit à l’économie de marché. C’est la seule concession qu’il consent à l’ordre établi. Pour le reste, il est intraitable : il faut être tolérant avec la canaille car, si l’on y regarde de près, c’est la société qui est responsable et en a fait des victimes. C’est en tout cas ce que proclame saint PIERRE BOURDIEU, de derrière ses lunettes teintées en vert-de-rose.
Il faut aussi se montrer tolérant avec tout ce qu’une société réactionnaire nomme « déviance » (à la rigueur « perversion »). Qu'on se le dise, rien que le fait de nommer déviance ou perversion des pratiques sexuelles statistiquement marginales, c'est porter un JUGEMENT. Et c'est intolérable à monsieur DEGAUCHE.
La « norme » est une convention établie de façon arbitraire par un ordre injuste, qui introduisait un clivage sans pitié entre les « normaux » et les « anormaux ». Ça, c’est saint MICHEL FOUCAULT qui l’a "déconstruit" de façon indubitable et définitive. C’en est fini des normes, du normal et de l’anormal. C'en est fini de juger. Monsieur DEGAUCHE a inventé l'interdiction des critères, des différences et des classements. Il a décidé que poser une limite est une atteinte aux droits fondamentaux. Tout est dans tout, voilà le credo.
C’est lui qui le dit.
A suivre.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, culture, société, politique, moeurs, droite, gauche, mariage homosexuel, france, libertarien, mariage, famille, civilité, la grande bouffe, marco ferreri, michel piccoli, jack lang, pierre bourdieu, tolérance, michel foucault
vendredi, 07 septembre 2012
QUEL ULTRALIBERAL ETES-VOUS ?
Sonnet du jour :
« Vase olivâtre et vain d'où l'âme est envolée,
Crâne, tu tournes un bon regard indulgent
Vers nous, et souris de ta bouche crénelée.
Mais tu regrettes ton corps, tes cheveux d'argent,
Tes lèvres qui s'ouvraient à la parole ailée.
Et l'orbite creuse où mon regard va plongeant,
Bâille à l'ombre et soupire et s'ennuie esseulée,
Très nette, vide box d'un cheval voyageant.
Tu n'es plus qu'argile et mort. Tes blanches molaires
Sur les tons mats de l'os brillent de flammes claires,
Tels les cuivres fourbis par un larbin soigneux.
Et, presse-papier lourd, sur le haut d'une armoire
Serrant de l'occiput les feuillets du grimoire,
Contre le vent rôdeur tu rechignes, hargneux.»
ALFRED JARRY, Les trois meubles du mage surannés.
Nous avons pu voir, hier, mes bien chers frères, combien tranchée était l’opposition entre monsieur DEDROITE et monsieur DEGAUCHE en matière économique. Enfin, pas si tranchée que ça, puisque monsieur DEGÔCHE a renoncé à faire la révolution et à organiser la redistribution des richesses sur les bases d’une certaine justice. De son côté, monsieur DEDROITE ne dédaigne pas, à l’occasion, de mettre un peu d’eau sociale dans son vin capitaliste. A condition de ne pas exagérer. Notons en passant que monsieur DEDROITE se définit plutôt par un "pour", et monsieur DEGAUCHE par un "contre". L'un a un but, l'autre a un idéal.
Aujourd’hui, je vais tâcher de montrer que l’opposition est tout aussi virulente entre monsieur DEDROITE et monsieur DEGÔCHE, mais curieusement, ils ont troqué leurs costumes et enfourché le cheval de l’autre. On ne parle plus d’économie. Aujourd’hui, en effet, on va les voir s’affronter sur les questions dites de société. Inversion radicale des rôles. Ce qui nous promet quelques ricanements.
En effet, autant monsieur DEDROITE est à fond pour la liberté quand il s’agit d’entreprendre, de vendre, d’acheter, de spéculer, de s’enrichir, autant son humeur s’assombrit quand on s’avise de s’en prendre aux VALEURS. Pas touche à l’AUTORITÉ, par exemple. Celle de l’Etat, en particulier, ne se négocie pas. Elle doit s’exercer jusque dans les confins et les recoins des banlieues défavorisées, vampirisées par les mauvais garçons, les gangs et le trafic de drogue. Pour monsieur DEDROITE, l’autorité doit procurer la SÉCURITÉ. Mot-clé.
Monsieur DEGÔCHE voit les choses un peu autrement. Sans nier la nécessité (ni la légitimité) de l’autorité, il mise sur le contact, la relation et la négociation. Sur l' « adhésion au pacte social ». Il compte sur la proximité, comme il avait en son temps baptisé une forme de police mise en place dans les « quartiers » (il suffit de le dire comme ça pour savoir de quels quartiers on parle, c'est assez drôle).
Il faut avouer que ça ne marchait pas mal, que c’était efficace en termes d’ordre public, la « police de proximité ». L’ancien Guide Suprême de la France (allez, je le nomme au moins une fois : le tout petit NICOLAS SARKOZY, le mec aux talonnettes), en caricaturant la chose (« un policier n’est pas payé pour jouer au foot avec des voyous »), a fait « peter les galons » (comme on disait quand j’étais au service militaire).
Il a trompeté qu’il allait tout passer au kärcher, il a blackboulé la « proximité » pour envoyer les CRS qui, en matière de « contact avec la population », s’y connaissaient bien mieux. C’est bien connu. Et il a demandé aux flics de « faire du résultat », de « faire du chiffre » (faisant passer la réalité du terrain loin derrière la statistique, parce que la réalité, ça fait moins d'effets d'annonce dans la presse).
Résultat ? Crispation des flics sur l’autorité de l’uniforme, respect à sens unique, tutoiement obligatoire, gardes à vue comme s’il en pleuvait, recours massif au délit d’ « outrage et rébellion », bref, du grand art. La subtilité du sarkozysme (si ça existe). Car le problème de ce monsieur DEDROITE, c’est sa fascination pour l’intimidation, le muscle, la parade et la démonstration de force, exactement comme certains clubs de hooligans du PSG : mettez un uniforme bleu à un hooligan, quelle différence avec un vrai flic, d'après vous ? Ah bon, j’exagère ?
Autre sujet de crispations antagonistes entre messieurs DEDROITE et DEGAUCHE : la frontière entre Etats. Le premier tient à son inviolabilité (on appelle ça le « souverainisme »). Même quand il est européaniste convaincu, il tient à ce que la frontière, même reportée à la limite de l’ « espace Schengen », soit bien gardée (non, je ne me lancerai pas dans la digression, qui me tend pourtant les bras, sur Lampedusa, la frontière gréco-turque, etc.).
Monsieur DEGAUCHE, au contraire, favorise la porosité des frontières autant qu’il peut, et milite même pour leur abolition (« Ouvrez les frontières », chantent AMADOU et MARIAM, qui ne sont pas européens, mais qui y ont beaucoup de complices). Le premier remplit des charters ou des bateaux à destination des pays d’origine de tous ceux qui n’ont rien à faire sur le sol national.
Le second, c’est d’abord un grand cœur, une grande âme. Et ce cœur et cette âme se penchent avec compassion et altruisme sur le sort infâme que la nation ose réserver aux étrangers. Ce rocher espagnol inhabitable, qu'il soit couvert de réfugiés africains, quelle honte pour l'Etat espagnol ! Honte à MANUEL VALLS, qui ose se prétendre de gauche, et qui arrache des Roms à leur immonde favela !
Monsieur DEDROITE s’insurge contre les intrusions. Monsieur DEGAUCHE s’insurge, et même milite, contre les extrusions. Disons-le : monsieur DEGAUCHE trouve sa vocation dans le "comité d'accueil". Et quand il y a des enfants dans l'affaire, il tonitrue. C’est logique.
Le premier est crispé, pas forcément sur la couleur de peau, disons sur une certaine idée de sa propre identité. Il tient à faire la différence entre être d’ici et être d’ailleurs. Ce n'est pas si bête, pourtant. Il faut dire que ça lui fend quand même le cœur, à monsieur DEDROITE, de sortir au terminus du RER à Gagny (dans le 9-3) et de se croire débarqué à Bamako. On ne peut pas seulement lui en tenir grief. Disons qu'il y a au moins matière à réflexion, et qu'on ne peut pas lui jeter la pierre sans y avoir un peu réfléchi.
Monsieur DEGAUCHE, lui, a appelé « diversité » la libre circulation et l’installation d’étrangers sur le sol national, il s’en félicite, il s’en réjouit. Il s’en fait même un programme, un objectif à atteindre : c’est le joyeux « métissage », l’euphorisante « créolisation », dont il se promet mille merveilles de civilisation, dans « la patrie des droits de l’homme », comme il aime à se gargariser. Il s'extasie devant les "sans-papiers". Il s'émeut face aux "sans-logis". Mais que fait l'Etat, nom de Dieu ?
Bilan paradoxal provisoire : autant monsieur DEDROITE se montre libéral tant qu’il s’agit de produire, d’acheter, de vendre et de faire circuler des marchandises d’un bout à l’autre de la planète, autant il se montre rigide, voire inflexible dès qu’il s’agit d’une certaine idée de l’ordre social et de la nation. Autant les choses ne connaissent pas de frontières, autant, s’agissant des gens et des personnes, il s’en tient à l’adage : « Chacun chez soi ». Il veut rester lui-même. C’est humain.
Contradiction identique pour monsieur DEGAUCHE : lui qui, s’agissant d’économie, voudrait réprimer l’ « argent roi », les « paradis fiscaux » et l’exploitation (éhontée, disons-le avec force) de l’homme par l’homme (la formule a, notons-le, totalement déserté les discours) et qui appelle à une redistribution des richesses, et par la force si nécessaire, lui, dès qu’il s’agit des gens et des personnes dans la société, il se sent fondre de bienveillance. Et il appelle ça « humanisme ».
Je ne peux pas m’empêcher de les trouver bizarres, ces contradictions. C’est vrai, quoi, comment peut-on être, et parfois de façon caricaturale, une fois souple et une fois rigide ? Tolérant et intransigeant ? Prenez ceux qu’on appelle les « libertariens » aux Etats-Unis. Eux, ils sont cohérents : ils prônent la disparition de l’Etat et de toute régulation, mais s’agissant du social et du sociétal (puisque sociétal il y a, paraît-il), ils sont tout aussi tolérants et ouverts.
Mais ce n’est pas fini. Ça continue demain. Attention les yeux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, poésie, minutes de sable mémorial, politique, économie, société, capitalisme, gauche, droite, révolution, socialisme, parti socialiste, françois hollande, nicolas sarkozy, autorité, ordre public, enrichissement, spéculation, quartiers, police, président, crs, police de proximité, karcher, hooligans, psg, souverainisme, europe, espace schengen, amadou et mariam, manuel valls, roms, favela, droits de l'homme, humanisme
dimanche, 26 août 2012
LA METHODE VIALATTE 5/5
Pensée du jour : « Il y a un style de l'almanach Vermot. Et sans doute, ça ressemble à la nouille ; mais en plus fort ; ça la transcende ; ça la défie ; ce n'est même plus la nouille sans sel, c'est réellement la nouille sans nouille au beurre sans beurre. Du vide de nouille dans l'absence de beurre. Bref, c'est du trou de macaroni. Essayez de parler de Landru sans dire qu'il a brûlé ses femmes, ou de Ruskin sans un mot de la religion du beau ! Ils y arrivent ! Et ils s'y ébrouent. Ils donnent le rien de toutes choses dans le détail. C'est peu de dire qu'ils le donnent, ils le modulent, ils le festonnent, ils l'ouvragent. C'est étonnant. Le lecteur bien doué arrive ainsi à ne rien savoir d'à peu près tout avec des précisions affreuses ».
Alexandre Vialatte
Résumé : Alexandre Vialatte porte sur le monde et sur l’époque un regard désolé, avec un sourire fraternel et amusé qui en corrige le fatalisme d’un semblant de tendresse. Pour écrire, conseille-t-il, « commencez par n’importe quoi » et « concluez sur n’importe quoi ».
Si je voulais faire le savant (je m'en garderai bien), je dirais que Vialatte est un écrivain du paradigmatique. Or, il faut le savoir, le paradigmatique est l’ennemi juré du syntagmatique. Je traduis : le détail plutôt que le global. Je l'ai dit il y a peu. Au paradigme l'unité de base. Au syntagme la vue d'ensemble, la phrase.
Pour faire simple, Vialatte, c'est la préférence donnée au substituable sur l'enchaînable. A la liberté improvisée de la trouvaille sur la discipline rectiligne de la logique rationnelle. Axe vertical contre axe horizontal. Bref, le mot et ses semblables, plutôt que la phrase et sa logique. La perception par les sens plutôt que les généralités abstraites. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'uniforme de la syntaxe dans un état impeccable, et de prendre plaisir à tourner des phrases compliquées. Ne serait-ce que pour embêter les gens.
Je préfère moi aussi le paradigme du livreur de lait, avec ses bidons accrochés à son vélo (on a peine à imaginer, mais je jure que c'est vrai, parce que je l'ai vu, c'était la laiterie de la rue du Garet), aux syntagmes de la Critique de la raison pure. L'image plutôt que le concept. Le particulier plutôt que le général. Pourquoi ? C’est très simple : l’humain est l’hôte naturel du particulier. Et la victime du général. L'ami précis du spécifique et la cible globale du générique.
C'est exactement pour cette raison que la 'pataphysique, science du particulier qui se propose de mettre au jour les lois qui gouvernent les exceptions (essayez d'imaginer), est une véritable urgence humaine, et que Vialatte fut un lecteur attentif d'Alfred Jarry qui, à travers Ubu et Faustroll, en fut l'inventeur.
L’individu plutôt que la statistique. Dès que se pointe le général (mettons le sociologue), l’humain disparaît, réduit à sa quantité. A son nombre. Plus précisément : l'unique est éliminé. L'individu écrasé. Voyez la catastrophe des sondages. Les mensondages, qui me découpent en morceaux (avec des décimales) pour me faire dire leur vérité : 37,8 % (ou 17,2 %) de moi-même sont d'accord (ou pas d'accord).
Où voulez-vous que je les trouve, mes 37,8 % (ou 17,2 %) ? Dans le bras ? Dans la fesse ? Non, ce n'est pas possible. C'est comme la natalité en France : 2,1 enfant par femme, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est, 0,1 enfant ? Il faut une mentalité de sous-chef comptable pour raisonner ainsi, pour être obsédé par la moyenne à calculer. Sans parler de la fiabilité des chiffres qu'on lui a donné à passer dans sa moulinette, au sous-chef comptable. Et dire que les populations du globe sont gérées de cette façon, par des chefs comptables qui se fient aveuglément aux chiffres qu'on leur fait mouliner.
Voilà pourquoi la chronique de Vialatte dont je parle commence par la citation tirée d’un San Antonio : « J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur », que j’ai donnée ici il y a quelque temps. Il fait de cette phrase anodine (pas tant que ça) l’emblème d’une méthode d’écriture : « Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là [c'est une de ses formules préférées] que tout est dans tout ». Il a bien raison. Remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. C'est tellement bien dit. Tout est dans tout, peut-être, mais pas n'importe comment.
Substituer au hasard un mot à un autre, c'est exactement ce qui se passe dans le cadavre exquis, cette invention des surréalistes (le jeu des "petits papiers", vous savez, qu'on se passe autour de la table, et qui produisit l'inaugural « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » : sujet-adjectif-verbe-COD-adjectif). Vialatte excelle à tirer du procédé (substitution sur l'axe paradimatique, excusez-moi) des effets d'une grande drôlerie. L'exercice lui ouvre la porte à la surprise et à l'inattendu (« des vérités nouvelles »).
Jean-Sébastien Bach répète à l'envi (c'était un humble) que quelqu’un qui ferait l'effort de s’appliquer autant que lui arriverait au même résultat que lui. Sa méthode pour bien jouer du clavier ? Rien de plus simple : « Il faut poser le bon doigt sur la bonne touche au bon moment ». Le propre du génie, c’est de paraître évident à celui qui le possède. Ben oui, il a toujours vécu avec. C'est une excuse. Pas une explication.
« Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou toute autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (…) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses (…) : le soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le soleil date de la plus haute antiquité". »
Et c’est là qu’on arrive au cœur de la méthode Vialatte : « Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela ».
La clé de voûte de la méthode Vialatte est là, dans l'effort constant et puissant de « rétablissement » de l'esprit. Un vigoureux rétablissement de gymnaste qui soit à même de le surprendre lui-même. Il faut le savoir, c'est un vrai sportif. Qui improvise pour s'enrichir. Le « rétablissement » sert à retomber sur ses pieds, et à éviter le n'importe quoi, maladie typiquement surréaliste (vous savez, le truc piqué par André Breton au poète Reverdy : la poésie naît du rapprochement incongru de deux réalités éloignées). La preuve que c'est une maladie, c'est que la publicité en a fait son carburant principal.
Voilà, vous savez tout : si Alexandre Vialatte est un grand écrivain, c’est qu’il attend d’être surpris par ce qu'il va poser sur le papier. Parce que la réalité présente ne le satisfait pas. Parce qu’il attend de découvrir au fil de la plume ce dont lui-même est capable, et qu'il ignorait posséder. En commençant par n'importe quoi, il se met à l'épreuve.
Imaginez un auteur de polars qui met son héros dans une situation inextricable, et qui se demande comment il va faire pour l'en sortir dans le prochain épisode du feuilleton (il faut qu'il reste vivant). Lui aussi procède par un rétablissement de l'esprit. Vialatte, c'est pareil, il lui faut de l'inédit. Parce que la route sur laquelle il marche, il la trace et la goudronne au fur et à mesure. En se demandant où elle le fera aboutir. Le monde qui est le sien sort de sa plume au moment où il écrit. Il ne sait pas, en avançant le premier pied, quel sera son point d’arrivée. Et c’est ça qui compte, évidemment.
Et ça explique qu’il n’ait jamais été un ethnologue à la façon de Lévi-Strauss, mais le meilleur anthropologue autodidacte qui soit. Et même un amoureux de la littérature. Qui décoche, de sa patte aux griffes rentrées, un mot feutré sur les fausses gloires médiatiques du moment (qui se souvient de Minou Drouet (qu'il faisait semblant, quelque part, de confondre avec Françoise Sagan, en inversant les prénoms) ce feu de paille littéraire à sensation de 1955 ?), mais qui consacre de longues pages à célébrer Chardonne, Gadenne, Hellens, Frédérique (que des discrets !), et une palanquée d'autres qu’il estime dignes d’hommage.
Le n’importe quoi de la conclusion « aura été fixé d’avance », naturellement. Les orateurs du grand siècle finissaient tous leurs sermons sur un « Ave Maria » : l’admiration allait à ceux dont l’art et la technique amenaient la prière à Marie avec le plus de souplesse et d’évidence. Et Vialatte ajoute : « Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel ». CQFD. Qui arriverait aussi "naturellement" à cet oxymore ?
Je regrette de n’avoir jamais vu Alexandre Vialatte faire le saut de l’ange, qu’il exécutait, selon les témoins, à la perfection, à la piscine Deligny, oui, celle qui a bizarrement coulé au fond de la Seine en 1993, et que j’ai fréquentée avec mon ami Hans-Joachim Bühler dans l’ancien temps, un 15 août, dans un Paris totalement silencieux et désert.
Nous étions venus en stop depuis Neustadt-an-der-Weinstrasse, dans le Rheinland Pfalz. En fait, la maison était à Mussbach, juste à côté. Neustadt, c’était le chef Queyrel. Les parents de HA-JO habitaient Richard-Wagner Strasse 11 (ne cherchez pas, la rue a été débaptisée, je suis tombé sur un bec). Un jardin. Un barbecue.
Et puis : « Ich bin kein mädchen dass man einmal kusst », m'avait-elle lancé, l’idiote invitée, révoltée par mes manières. L'uppercut m’est resté. Abattu, je n’avais pas tardé à me rabattre. La loi de l'offre et de la demande, il faut la mettre en oeuvre. Cela aussi exige un « rétablissement de l'esprit ». Pas seulement. C’était en quelle année, bon dieu ?
Voilà ce que je me demande encore, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, almanach vermot, pataphysique, alfred jarry, ubu, faustroll, jean-sébastien bach, surréalisme, andré breton, reverdy, imagination, publicité, statistiques, san antonio, claude lévi-strauss, jacques chardonne, paul gadenne, piscine deligny
mercredi, 22 août 2012
LA METHODE VIALATTE 1/5
Pensée du jour : « Aussi les pères de famille avisés attachent-ils par une corde courte au piquet central de la tente les grand-mères et les enfançons. Une barrière de barbelés isole du monde ces radeaux de la Méduse. Un haillon vert y sèche à côté d'une loque rose. La vache vient, contemple et s'étonne, le prisonnier se souvient et passe, le promeneur regarde et fuit épouvanté. C'est ce qu'on appelle un camping de vacances ».
Alexandre Vialatte
***
Je m’adresse aujourd’hui – j’aime autant annoncer la couleur –, à ceux de mes lecteurs que je déboussole, que je décontenance, que je dépayse, que sais-je, que je dérange, déroute, voire désarçonne ou désoriente (j’en ai d’autres dans la musette, au cas où …, par exemple « agace ») par la tentation à laquelle je cède un peu trop volontiers, de me laisser, faute de rigueur intellectuelle, embarquer dans des « arabesques », comme les appelle Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-Tombe, c'est-à-dire des « digressions » (« parabases », pour les amateurs).
La digression, parfaitement, voilà l’ennemi, paraît-il. Je me propose de traiter le sujet en tant que tel, dignement, et de le traiter d’une manière formellement idoine à la matière. « Il ne faut pas confondre la forme et le fond », proclamait pourtant, affolé, Monsieur René Bady, dans un des cours les plus mouvementés (il n'avait jamais eu autant d'auditeurs) de sa tranquille histoire de professeur d’université. Il reste l’auteur d’une thèse de doctorat qui est restée dans les mémoires : tout le monde se souvient de De Montaigne à Bérulle. La modernité lui a répliqué : « La forme doit épouser le fond ».
Le pauvre homme, qui était admirablement humble et catholique, ne s’y est pas retrouvé. Le garnement infernal que je fus se souvient des cours sur l’ode au 16ème siècle (aussi, a-t-on idée !) : le cours durait quelques minutes, avant d’être sommairement exécuté par les ballons bondissant de mains en mains. Malheureux René Bady ! Tout perclus de savoirs précieux, mais sortis de l’usage et du respect, il rangeait tristement ses notes sérieuses et quittait l’amphithéâtre, accompagné de nos aboiements féroces et déracinés.
Cette série de notes se propose rien de moins que de faire l'éloge du contournement, de la trajectoire déviée, de l'embardée poétique et du désir de musarder en route au lieu d'aller bêtement d'un point à un autre en TGV. Car ces lecteurs bienveillants, mais exigeants, me reprochent de faire comme les parents du Petit Poucet, je veux dire de vouloir les perdre dans la forêt. L'enjeu est de taille, on en conviendra.
Je réponds d’urgence à ce reproche, dans un premier temps, que les cailloux blancs ne manquent jamais chez moi pour retrouver le râtelier parental, même quand il n’y a rien à y ruminer. Je veux dire que ma flèche ne perd jamais de vue le centre de la cible, ni le terme final de sa trajectoire ondulante et sinusoïdale. Que le Nord est toujours inscrit au fronton de ma boussole capricieuse.
Dans un deuxième temps, je dirai que la tentation est une chose trop sérieuse pour ne pas appeler une réponse vigoureuse et adéquate. Il faut y réagir vivement pour en prévenir les effets néfastes. La tentation ? Quelle horreur ! Le mieux est donc d'y céder aussitôt qu’elle se présente. Et de réserver les éventuelles velléités de résistance pour des combats plus formidables et plus essentiels.
Cette solution lumineuse, simplissime et fructueuse me fut dévoilée un beau jour, en dehors des adventicités naturelles du quotidien, dans un petit livre que je recommande vivement : La Papesse Jeanne, d’Emmanuel Rhoïdès (ou Roïdis, éditions Actes-Sud). Je ne l’aurais sans doute jamais lu s’il n’avait pas été traduit en français par Alfred Jarry en 1900 et des poussières.
Revigorant, et même coruscant. Je le confesse : il prêche une morale que les normes admises, certes, désavoueraient, mais qui le fait de façon si aimable, et sur un ton si espiègle que les normes elles-mêmes se disent qu'au fond, pourquoi pas ?
Les esprits perspicaces ont déjà perçu la digression qui me tend les bras : c’est quoi, cette histoire de « Papesse Jeanne » ? Pour vous montrer que le pire n’est pas toujours sûr, sachez que, pour une fois, je ne céderai pas à la tentation. Même si vous aimeriez bien en savoir plus. Le devoir avant tout. Plus tard peut-être. En attendant, voici une photo prise à l'époque des faits relatés (et qui illustre le scandale).
Dans un troisième temps, qu’on se le dise, si la notion de « digression » (ou d’« excursus ») existe, ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Or, il faut savoir que tout ce qui a été inventé par l’homme depuis la nuit des temps, l’homme s’en est servi, de la fourchette à la bombe atomique, en passant par le pédalo, la pince à épiler, le ticket de métro, l’assiette anglaise et le soc de charrue. Mais sait-on encore ce qu’est une « assiette anglaise » ?
J’ajoute que, si c’est à ma disposition, je serais bien bête de ne pas en profiter : après tout, la digression n’est pas faite pour les chiens. C’est vrai, ça : un chien, même mal éduqué, ne digresse jamais. La digression est hors de portée du règne animal. Le règne animal se déroule en ligne droite. Enfin je crois.
Et comme la digression est gratuite, elle est dans mes moyens. Dans le jardin où l’on cultive toutes les fleurs de rhétorique de la création, « chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite » (Georges Brassens, pour retrouver le titre, je vous laisse faire).
De toute façon, dit Antonin Artaud (c’était avant les électrochocs aimablement et doctrinalement administrés par le docteur Ferdière, dans son service psychiatrique de Rodez) : « Il n’y a pas d’art au Mexique, et les choses servent ». Il était en villégiature chez les Indiens Tarahumaras, dont il appréciait le plat principal, le cactus nain appelé « peyotl », chargé de forces mystérieuses. Après tout, c’est peut-être au peyotl qu’il la doit, Artaud, son « exaltation » ?
Pour la suite de la digression, merci d'attendre à demain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, chroniques de la montagne, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, digression, parabase, méandre, montaigne, déviation, petit poucet, la papesse jeanne, emmanuel rhoïdès, alfred jarry, morale, brassens, antonin artaud, rhétorique, docteur ferdière, peyotl, cahiers de rodez, tarahumaras, drogue
mardi, 17 juillet 2012
SUPERMASCULIN, VOUS DITES ?
Préambule d'actualité : je suis d'accord : BACHAR EL ASSAD est une épouvantable brute, un dictateur sanguinaire, et je vote à l'unanimité, comme tout le monde, pour ces gens qui sacrifient leur vie pour le déstabiliser et, si possible, le renverser. Ce qui m'embête un peu dans l'affaire, c'est toute la main d'oeuvre djihadiste et les petites mains d'Al Qaïda qui rappliquent en ce moment de partout et qui profitent de l'occasion pour faire le coup de feu, noyauter cette opposition et s'installer dans le paysage syrien. De véritables « brigades islamistes internationales » se sont mises en place. Quand on voit le sort réservé aux touaregs indépendantistes par les islamistes radicaux d'AQMI au Mali, qui les ont virés comme des malpropres, et manu militari, du fauteuil de chef, on ne peut que s'inquiéter de la couleur du prochain pouvoir qui s'exercera à Damas. Fin du préambule.
Résumé : ALFRED JARRY est un auteur maudit. Il a interposé entre lui et le monde la marionnette monstrueuse d’Ubu. Ce qui a mis définitivement à l’abri de l’attention générale une pléiade d’ouvrages qui méritent un détour, voire valent le voyage. Le pauvre, quand il se met à la littérature « alimentaire », cela donne Le Surmâle, qui est loin d’avoir tenu ses promesses, mais qui bénéficie encore d’efforts éditoriaux notables.

Dans le fond, l’homme « moderne » est une machine à ce qu’on voudra, ici André Marcueil, le « héros », est une machine à baiser. C’est publié en 1902, je le signale. C’est même un homme qui en remontre à la machine, puisque, au cours de l’invraisemblable « Course des 10.000 milles », l’homme ordinaire rattrape chaque jour, sur son vélo qui grince, le train lancé à toute allure, qui transporte sa « fiancée » Ellen Elson, pour déposer sur son wagon un bouquet de roses fraîchement coupées.
Car Ellen Elson, cette pure vierge (pas pour longtemps), qui dit à André Marcueil : « Je crois à L’indien », est à bord de ce train lancé à des vitesses « qu’on n’a jamais osé rêver », contre laquelle lutte la quintuplette emmenée par Bill Corporal Gilbey.
Un petit mot sur cette course : vous avez cinq bonshommes sur un vélo à cinq places et, en plein milieu de la course avec le train, Jewey Jacobs meurt, et le chef, pour ne pas perdre la course, décrète : « Ah ! il est mort ? Je m’en f…, dit Corporal Gilbey. Attention : ENTRAÎNEZ JACOBS ! ».

Les quatre autres forcent donc la rigidité cadavérique, et la suite : « En effet, non seulement il régularisa, mais il emballa, et le sprint de Jacobs mort fut un sprint dont n’ont point idée les vivants ». Et les quatre de s’exclamer : « Hip, hip, hip, hurrah pour Jewey Jacobs ». Un mort qui se met à pédaler plus vite que les vivants, et que ceux-ci ovationnent. Ce genre d’idée, il fallait oser, non ? La quintuplette fait même mine, à plusieurs reprises, à force de vitesse, de se prendre pour un aéroplane, mais ce n’est que du « vol de vautour ».
N’attendez, dans le livre, aucune description graveleuse. Ce n’est pas, à cet égard un de ces « livres qu’on ne lit que d’une main ». Exceptons cependant quelques – oh ! très modestes – allusions lorsque les prostituées invitées pour subir la performance seront enfermées à clefs dans un local où, s’ennuyant ferme, elles trouveront quelques moyens de se … désennuyer entre elles.
C’est Ellen Elson, fille unique et préférée du célèbre chimiste américain William Elson, père de la mythique Perpetual Motion Food : l’aliment du mouvement perpétuel, en français : la potion magique, – c’est Ellen Elson, disais-je, qui a enfermé les hétaïres, car cette très jeune femme n’a froid nulle part, encore moins là où vous pensez, bande d’obsédés, et elle veut subir à elle toute seule les assauts de « l’Indien tant célébré par Théophraste ».
Le professeur Bathybius est témoin de la scène et, au bout des vingt-quatre heures imparties, cet observateur objectif, rigoureux et parfaitement scientifique, peut inscrire le chiffre faramineux de quatre-vingt-deux "actes" (82) dans les 24 haures imparties : le public n’en revient pas : « La dépopulation n’est plus qu’un mot ! », dit un sénateur idiot, qui ne se rend pas compte que le nombre des naissances dans une population ne dépend pas du nombre d'hommes mais de femmes.
En tout cas, quatre-vingt-deux « assauts », voilà qui pulvérise la vantardise d’un grand séducteur, dragueur et baiseur devant l’Eternel, j’ai nommé VICTOR HUGO. Il dira, longtemps après la nuit de noces qui suivit son mariage avec ADÈLE FOUCHER, qu’il l’a honorée quatorze fois. Elle s’était trouvée déjà comblée des huit « postes courues » par VICTOR lors de cette nuit, et s’en était trouvée longtemps tout éblouie.
Pour revenir à ALFRED JARRY, l’apothéose finale, je devrais dire la « Passion » d’André Marcueil, se déroule de la façon suivante : l’ingénieur Arthur Gough fabrique la « Machine-à-inspirer-l’amour ». « Si André Marcueil était une machine ou un organisme de fer se jouant des machines, eh bien, la coalition de l’ingénieur, du chimiste et du docteur opposerait machine à machine, pour la plus grande sauvegarde de la science, de la médecine et de l’humanité bourgeoises. Si cet homme devenait une mécanique, il fallait bien, par un retour nécessaire à l’équilibre du monde, qu’une autre mécanique fabriquât … de l’âme. » La préoccupation de JARRY, on le voit, est physicienne : équilibrer les forces. Pour lui, la vie est une équation à résoudre par la déduction logique.
André Marcueil est donc ficelé sur un fauteuil, revêtu de diverses électrodes, finissant par ressembler à je ne sais quel Christ. Mais, au grand dam des trois savants qui suivent les événements, « c’est la machine qui devint amoureuse de l’homme », car c’est la machine dont le potentiel est le plus élevé qui charge l’autre. Elémentaire, mon cher Watson !
Dans une explosion de métal chauffé à blanc, de verre fondu et de débauche électrique, le surmâle finit donc par mourir. Ellen Elson saura dès lors de contenter d’un mari aux performances ordinaires.
Il n'empêche que ce roman d'anticipation anticipe vraiment, d'une façon terrible et authentique, le monde actuel, où une économie tyrannique et totalitaire, appuyée sur l'hégémonie d'une technique triomphante, exige de chaque individu des performances de surhomme. Tout en condamnant de la bouche le dopage. Qui est inscrit dans le code génétique de la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde.
Et le public du roman, en extase devant les performances d'André Marcueil, ne fait-il pas penser aux milliards de gogos (pardon, de consommateurs) qui se gavent, émerveillés ou ennuyés, d'un tas de réalités virtuelles devant leur écran ? L’écran est le point d’aboutissement du programme actuel de l’existence humaine, n’est-il pas vrai ? L'un des livres les plus vendus dans le monde n'est-il pas le "Guinness" des records ? Et ça ne vous fait pas peur, à vous ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, littérature, le surmâle, pataphysique, ubu, science fiction, performance, dopage, course cycliste, sexe, acte sexuel, victor hugo, guinness des records
lundi, 16 juillet 2012
DE LA VIRILITE EN LITTERATURE
ALFRED JARRY a occupé dans ma vie une place importante. Peut-être est-ce le folklore foutraque et infantile auquel son invention de la ’pataphysique a donné lieu dans les années 1950, avec la création du Collège de ’Pataphysique, et sa collection de grands enfants très savants et, au fond, très « philosophes ».

Peut-être est-ce l’intime saisissement poétique ressenti à la lecture de L’Amour absolu. Ou alors ce fut la perplexité foisonnante et vibrionnante ressentie à la lecture des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. A moins que ce ne soit la bizarrerie antimilitariste et adelphique ressentie à la lecture de Les Jours et les Nuits. Mais après tout, peut-être fut-ce à cause de l’irréductible bigarrure des onze épisodes de l’ « éducation sentimentale » que raconte L’Amour en Visites.
Quoi, pas un mot d’Ubu roi ? Evidemment ! C’est le moins intéressant. On dirait même qu’ALFRED JARRY, en produisant son Ubu roi, a dressé un mur de protection entre lui et ses lecteurs potentiels en imposant, au milieu du paysage littéraire du début du 20ème siècle (la « première » de la pièce a été donnée le soir mémorable du 10 décembre 1896). Les œuvres citées ci-dessus ont donc été publiées bien à l’abri de cet énorme succès de scandale, qui leur a assuré un incognito à peu près parfait jusqu’aujourd’hui.

LE CRÂNE PIRIFORME, LE BÂTON-A-PHYSIQUE, ET LA GIDOUILLE
(XYLOGRAVURE D'ALFRED JARRY)
Il faut dire que le bonhomme JARRY est en soi un peu « spécial ». Il se faisait appeler Monsieur Ubu, dont il avait adopté, en société, l’articulation excessivement artificielle et segmentée. Un jour où, dans le « phalanstère » de Corbeil, il tire au pistolet, une voisine fait irruption pour protester en arguant de la présence de ses enfants derrière le buisson de séparation, à quoi, seigneurial, il répond : « Qu’importe, Madame, nous vous en ferons d’autres ».
A une visiteuse de son « entresol-et-demi » qui, avisant un phallus de dimension considérable sur la cheminée, demande si c’est un moulage, il réplique : « Non, Madame, c’est une réduction ». Il hébergeait chez lui quelques chouettes hulottes qu’il observa longuement pour en tirer quelques images et réflexions, notant par exemple que la chouette ferme les yeux quand elle lève les paupières. L'inconvénient était l'odeur qui accueillait le visiteur, les animaux étant nourris avec de la viande crue, qu'ils dispersaient et oubliaient dans la pièce. Certains ont parlé d'une « chambre encharognée ».

VOUS AVEZ NOTE LA SOURIS ?
PEUT-ÊTRE EST-CE UN MULOT ?
Ces anecdotes font partie d’une collection définitive et dûment inventoriée, répertoriée et certifiée, que les amateurs se transmettent pieusement de père en fils. Elles sont plus ou moins véridiques, plus ou moins controuvées, plus ou moins apocryphes, mais sans elles, la biographie d’ALFRED JARRY serait tellement moins savoureuse qu’on persiste à se les raconter. D’autant qu’il eut une courte vie (il est mort à 34 ans, sans doute d’une méningite tuberculeuse, peut-être en réclamant un cure-dent), qu’une absorption consciencieuse et constante de divers alcools, notamment l’absinthe, ne contribua guère à prolonger.
Quand JARRY a hérité de sa famille, il a tout claqué assez rapidement dans une revue illustrée, de luxe (Perhinderion, mot qui veut dire un « pardon » en breton), pour l’impression de laquelle il a fait fondre des caractères spéciaux, enfin bref : une folie, un geste artistique, ou ce qu’on voudra.
Pour le reste (de son existence), il a vécu sans un, raide comme un passe-lacet, comme on disait dans les anciens temps. Faut dire que ce n’étaient pas ses livres qui pouvaient lui rapporter beaucoup, vu le nombre des acheteurs potentiels auxquels ils étaient destinés : ça devait tourner autour de 37 ou de 42 exemplaires vendus.
Alors il a l’idée d’écrire deux romans « populaires » qui vont lui rapporter le magot. Ce seront Messaline et Le Surmâle. Bon, inutile de vous dire que le magot, il l’attend encore. Enfin, là où il est, n’est-ce pas, mon bon monsieur, ça ne lui tire plus sur l’estomac. Mais, comme dirait Gontran, tout ça ne nous dit pas l’heure. Et au fait : quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?

ILLUSTRATION DU PEINTRE PIERRE BONNARD,
COPAIN DE JARRY, POUR LE SURMÂLE
Or donc, Le Surmâle (roman moderne) raconte l’histoire des performances d’abord physiques, puis sexuelles d’André Marcueil, « homme ordinaire », d’apparence chétive, dont une mystérieuse transformation va faire un surhomme. Au début, scène mondaine et discussion mondaine autour de l’amour. Marcueil assène cette vérité : l’amour est un acte, et l’on peut le faire indéfiniment (sans aucun « dopage », cela va de soi, mais pas si sûr) : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment ». Dans le fond, on ne peut pas dire que ce soit complètement faux.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, le surmâle, alfred jarry, docteur faustroll, ubu roi, collège de pataphysique, perhinderion, messaline, performances sexuelles
lundi, 09 juillet 2012
DES GOGUES ET DE LA CIVILISATION
Pensée du jour : « Non loin de là il y a le lac de cratère : des ténèbres au fond d'un trou. Le résineux obscur alterne sur la rive avec le sombre conifère. Ils se mirent dans l'eau comme la houille dans l'anthracite ». C'est ALEXANDRE VIALATTE qui a écrit ça. Quoi, ce n'est pas vraiment une pensée ? Et alors ? Je m'en fiche, c'est du VIALATTE. Et c'est beau. Comment voulez-vous qu'on résiste à : ils se mirent dans l'eau comme la houille dans l'anthracite ?
Avant de reprendre le fil de mon thème "goguenard", un mot sur la grande CONFERENCE SOCIALE qui se tient à Paris. Juste pour signaler que SARKOZY avait fait, paraît-il, un GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, montagne qui a accouché même pas d'une souris, à peine d'une musaraigne pygmée (5 cm, sans la queue).
Disons que, pendant les quelques premières centaines de milliers d’années de son existence, l’humanité a eu recours au plus rustique des moyens : s’accroupir, déféquer et puis se nettoyer comme elle pouvait, d’une pierre, polie dans la mesure du possible, d’un bouquet d’orties fraîches ou d’un « oison bien dumeté, pourveu qu’on luy tienne la teste entre les jambes » (Gargantua, chapitre 13).
Et disons-le nettement : il n’y eut aucun problème particulier pendant deux ou trois cent mille ans. Tout le monde savait, dans les bourgs et dans les villes du néolithique (quoi, j'exagère ?), qu’il fallait faire, quand on marchait dans la rue, attention à ce qui tombait des fenêtres le matin, comme l’apprit un jour à ses dépens le bon LOUIS IX, alias Saint Louis, et, plus tard, je ne sais plus quelle grande dame qui déambulait étourdiment juste sous les fenêtres de Versailles, dans une robe du dernier chic qui avait coûté les yeux de la tête à ses fermiers et métayers.
Les difficultés surgissent avec la concentration urbaine des hommes et la croissance verticale des villes. Les solutions artisanales s’avèrent très vite totalement dépassées, comme le montrent quelques ébauches théâtrales d’ALFRED JARRY jeune, qui vécut à une époque de transition, où l'on est passé (lentement) de la "collecte" à l'ancienne à une "évacuation" moderne. Je ne m'attarderai pas sur les péripéties. Cela s'appelle Les Antliaclastes (traduction : les briseurs de pompe à merde).
Il y met en scène les membres du Club-Antliator, autrement dit les « vidangeurs au tonneau », qui ne sont autres que les adeptes de la (« parlant par respect », dirait NIZIER DU PUITSPELU) pompe à merde, c’est-à-dire, en quelque sorte, les fervents de la tradition et de la vieille école, avec ses savoir-faire inimitables et ses tours de main amoureusement préservés et transmis. Les tenants de l'amour du métier et du travail bien fait, quoi.
Ces « militants de la pompe » sont en guerre contre les « Antliaclastes », partisans quant à eux de l’ « herpétologie ahénéenne » (= les « serpents d’airain » = les tuyaux métalliques), de la chasse d'eau, des tuyaux de descente et de l'égout, en somme, de l’évacuation industrielle, technique, anonyme et déshumanisée, qui coupe l’homme de tout contact avec sa propre activité et, disons-le, avec la « vraie vie », et qui, du jour au lendemain, a fait disparaître aux yeux de tous l’œuvre la plus constante que, jour après jour, l’homme confectionnait (qu'il y consentît ou qu'il y regimbât), qu’il neigeât, qu’il ventât ou qu’il grêlât (notez la rafale de subjonctifs imparfaits), depuis la nuit des temps.
Dans ce combat proprement homérique, c’est évidemment l’anonymat industriel et déshumanisé qui a triomphé. Il faut dire que la lutte était foncièrement inégale. Rendez-vous compte de tout ce qu’une tour haute de 400 mètres (on pense évidemment à celles du World Trade Center de Manhattan) peut produire d’ « eaux noires » (c’est le terme spécialisé, par opposition aux « eaux grises », qui viennent de l’évier, du lavabo et de la douche). La rationalisation a triomphé sans trop de mal : nécessité fait loi.
Qui pourrait imaginer la grande ville d'aujourd'hui, couverte de buildings, avec des "vidangeurs au tonneau" qui passeraient dans les rues pour vider les fosses ? La société de masse commande des solutions de masse, des solutions industrielles de masse. Regardez ce qui se passe à Marseille, à Lyon ou à Naples, dès que les éboueurs décident de cesser le travail, et imaginez la même chose, pas avec les poubelles, mais avec les « matières ». On pourrait vraiment dire, au sens « propre » (!!!), qu'on est dans la merde.
Dans les célèbres tours du WTC, désormais abolies par un décret d’Allah en personne (c'est ce que dit la rumeur) comme symboles du Mal, travaillaient 50.000 personnes. Non mais, vous vous rendez compte ? Chaque jour débaroulaient jusqu’aux égouts soixante-quinze tonnes d’excréments (il faut compter 3 livres en moyenne par personne).
Quand vous saurez qu’à la fin du 19ème siècle, des gens excessivement sérieux, en Angleterre, ont calculé, avec la plus grande exactitude, que pour évacuer la seule matière solide, il fallait 9 litres d’eau, vous saurez ipso facto que le World Trade Center de Manhattan dépensait 675.000 litres d’eau par jour. BEN LADEN se voulait peut-être un bienfaiteur de la planète ?
Petite pause anecdotique : on raconte que les Américains, quand ils ont attaqué l'archipel d'Okinawa, ont largement surestimé le nombre des Japonais embusqués, en se fiant aux tas de fiente que ceux-ci laissaient, et qu'ils ont en conséquence acheminé des effectifs beaucoup plus copieux. Comme disent les Italiens : se non è vero, è ben trovato. Fin de l'anecdote.
Le plus dur à supporter dans cette affaire, c’est que ce qui évacue l’ « engrais humain » vers les océans, c’est, ni plus ni moins, de l’EAU POTABLE. Parfaitement : DE L'EAU POTABLE. Ben évidemment, vous imaginez ce que ça coûterait, de doubler les canalisations d’eau, l’une pour acheminer ce qui se boit, l’autre pour acheminer l'eau non-potable, vouée à l'évacuation de l’indigeste et du non-digéré ? Explosé, le budget d’investissement ! Quel financier désintéressé et philanthrope scierait ainsi sa propre branche ?
Pensez juste un instant que toute l’eau que vous jetez dans la cuvette en appuyant sur le bouton, c’est de l’EAU POTABLE. Dites-vous, oh, juste un instant, que vous pourriez mettre votre verre quand vous tirez la chasse, et que l’eau, oui, vous pourriez la BOIRE ! Franchement, est-ce qu’il n’y a pas de quoi se dire qu’avec un tel gaspillage, démocratiquement étendu à 6 milliards et demi d’humains, c’est exactement, concrètement et très efficacement annoncer l’impossibilité totale de la civilisation qui a promu ce gaspillage ?
Soyons clair : un tel gaspillage n’est possible et envisageable que s’il est réservé à un tout petit nombre. Soyons même tranchant : une vraie démocratie, une démocratie avérée, authentique est le régime de la médiocrité pour tous. Le gaspillage est un luxe, et de ce fait reste définitivement hors de portée du vulgum pecus.
A cet égard, on peut accuser la planète Terre de vivre comme les grands seigneurs de la cour à Versailles. Sauf que tous les manants, tous les vilains et tous les roturiers de la planète ont pour seul désir et objectif de pouvoir se comporter en grands seigneurs. Il paraît que c'est ça, la démocratie. Jadis, je n'aurais demandé qu'à le croire. Maintenant, j'avoue que j'ai du mal. Aujourd'hui, manants, vilains, roturiers et sans-culotte ont pour ambition suprême d'imiter les ci-devant aristocrates. Tout au moins d'en imiter certains gestes. Les plus coûteux.
La planète Terre est folle, elle ne se rend pas compte : elle a totalement perdu de vue les excréments qu’elle produit (ne parlons pas des autres déchets). Parce qu’elle a le regard fixé (par la publicité, la propagande, la télévision) sur la portion de Terre vierge, pure et momentanément préservée où elle va pouvoir se ressourcer, avant les onze mois de galère que va lui coûter le pavillon qu’elle s’est offert dans la banlieue de Saint-Brévin-les-pins.
C’est sans conteste cette raison (50.000 personnes obligées chaque jour de pisser et de chier du haut de leurs 400 mètres de béton, de verre et d’acier de toutes les tours du World Trade Center) qui a décidé OUSSAMA BEN LADEN, un écologiste de pointe et un démocrate interminable et péremptoire, à faire raser par quelques personnes fatiguées de vivre ce monument du non-sens de l’orgueil consumériste qu’étaient les tours du World Trade Center. On ne peut nier qu’il a visé juste. Le tout serait d’en tirer les bonnes leçons, ce qui semble loin d’être fait.
Le World Trade Center était exactement ce qu'on appelle le défaut de l'armure. La faille dans le système. La paille dans l'acier. Ce que les Grecs anciens appelaient l'ubris (la démesure, le défi aux dieux), et ce que les chrétiens ont traduit par la Tour de Babel.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, chroniques de la montagne, conférence sociale, nicolas sarkozy, françois hollande, parti socialiste, ps, grenelle de l'environnement, hygiène, wc, cabinets, toilettes, alfred jarry, nizier du puitspelu, world trade center, manhattan, excrément, ben laden
dimanche, 08 juillet 2012
DES GOG ET DES MAGOG
Alors il semblerait que je n’aie fait qu’effleurer le sujet dans un récent billet. Quelques esprits avisés m’ont incité à le développer. Il était, si je me souviens bien, entre parenthèses. Je m’y efforçais de célébrer « les lieux », cet endroit où l’être humain « civilisé » (paraît-il) s’enferme pour méditer pendant qu’il se livre à des expulsions nécessaires, activité tenue en piètre estime par le commun des mortels.
Injustement sans doute, si j’en crois le santon acheté voilà quelques années : admirez les lignes, les couleurs, le modelé, la position. Et il tient en équilibre. Encore bravo à l’ingénieux et audacieux sculpteur, qui a tâché vaillamment de rendre un peu de lustre à cette fonction humaine, à laquelle nul ne saurait se soustraire sans dommages ou lésions.

JE VOUS PRESENTE LE SANTON CHIEUR
« Les lieux », comme on disait dans les autres fois et comme les nomme très justement ROGER-HENRI GUERRAND dans son Histoire des commodités, ne méritent ni cet excès de déshonneur, ni cette indignité. La preuve en est le très savant ouvrage que ce monsieur a écrit. La preuve en est également l’assez divertissant et documenté ouvrage d’ISABELLE MONROZIER, Où sont les toilettes ? (Ramsay, 1990).
Je ferai à l’auteur un léger reproche tout de même. Elle écrit en effet (p. 59) : « Les deux bombes qui ont explosé dans des établissements scolaires à Décines-Chartrieu [sic] près de Lyon et dans le 14ème arrondissement de Paris en janvier 1988, avaient été placées derrière les réservoirs des chasses ».
Loin de moi l’idée de nier des faits dûment avérés, mais a-t-on le droit d’estropier ainsi le nom d’une commune péri-lyonnaise ? Ceux qui connaissent l’avenue Godard à Décines-Charpieu (je parle d’une élite) s’en trouvent légitimement froissés. Jusqu’ici, le maire de Décines-Charpieu n’a toutefois pas porté plainte contre ce lâche attentat. Il est bien bon. Certains, moins miséricordieux, taxeront cela de faiblesse, éventuellement coupable, qu’ils menacent d’ores et déjà de punir prochainement dans les urnes.
Cela dit, on trouve chez MONROZIER une foule d’informations utiles, ... et scientifiques. Parmi bien d’autres, les règles militaires d’installation des latrines pour une armée en campagne : « pour une centaine d’hommes, cinq trous, de 30 cm de large sur 60 de long, espacés de 90 cm pour éviter que les cuisses des soldats ne se frôlent ». On voit par là qu’un colonel en campagne se doit de parer à toute éventualité et ne saurait négliger aucun détail, fût-il le moindre, susceptible d’affaiblir l’ardeur guerrière du combattant, à travers de coupables distractions. Notons que la profondeur des trous n'est pas indiquée : coupable négligence, mon colonel !
ISABELLE MONROZIER nous narre par le menu l’histoire de CLAIRE, 25 ans, et de quelques-unes des activités qui sont les siennes quand elle s’enferme dans « les lieux » : « Essayez de me raconter. – A chaque fois, j’accouche dans les W.-C. Je ne sais pas… C’est d’instinct… Je ne sais pas… Je me mets sur les W.-C… Je ne me souviens plus de ce qui se passe. (Elle éclate en sanglots.) C’est horrible, c’est une immense panique… – Vous pouvez me parler de cette panique ? – Je ne sais pas… Je ne m’en souviens pas… Cela va très mal pendant une demi-heure… Je ne sais pas… – Et tous les quatre, de même ? – Oui, c’est horrible… J’aime tellement les bébés… C’est mon métier ». Si j'ai bien compris, elle est sage-femme, infirmière ou puéricultrice. Pourtant, je sais qu'il y en a des bien. J'en connais. On se demande parfois pourquoi les rouleaux de papier défilent à toute allure dans une maison où il y a pas mal de femmes, mais on tient peut-être là une explication décisive, non ?
MONROZIER tente d’épuiser la question, si j’ose m’exprimer ainsi, en parlant du problème de l’évacuation des « matières » dans les prisons, de la plus moderne à la plus archaïque, et de la plus civilisée à la plus barbare ; à 8.000 mètres d’altitude, quand il faut commencer par ôter quelques épaisseurs, en commençant par les diverses couches de gants ; sur une planche à voile, comme STEPHANE PEYRON, qui y a passé 46 jours ; sur un bateau en général : « Au petit matin, l’été, aux mouillages de Port-Cros ou de Porquerolles par exemple, les bateaux nagent au milieu des étrons qui flottent ». Délicieux paysage au moment de tremper son croissant dans le café, vous ne trouvez pas ? Voilà peut-être pourquoi j’ai toujours évité de voyager sur des coquilles de noix.
Mais elle ne parle pas, la malheureuse MONROZIER, de la « course des dix mille milles » qui a lieu dans Le Surmâle d’ALFRED JARRY, ni de la quintuplette à laquelle sont enchaînés, de l’arrière vers l’avant, Ted Oxborrow, Jewey Jacobs, George Webb, Sammy White, (un nègre, le roman date de 1902), et Corporal Gilbey.

SI, SI, JE VOUS DIS QUE ÇA EXISTE
Ils sont lancés, face à un train, dans une course d’environ quinze mille km, et sont nourris exclusivement de la « Perpetual Motion Food » du professeur Elson. Comme ils sont enchaînés, et ne peuvent donc descendre de leur machine, ils sont obligés de faire « l’un et l’autre besoin dans de la terre à foulon », dont les propriétés bien connues sont d’être à la fois saponifère, détersive, dégraissante et moussante. N’en veuillons pas à ISABELLE MONROZIER, et continuons notre petit tour de piste, d’ivoire et d’horizon (pour l’ivoire, un doute me vient).
Car reconnaissons-le, quelque phénoménal progrès que l’homme ait fait depuis l’aube des temps, il n’a pas encore trouvé le moyen d’échapper à cette dure nécessité quotidienne et à se libérer de son emprise : évacuer hors de soi quelque 1.500 grammes (c’est une moyenne statistique) de matières tant liquides que solides.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gog et magog, lieux d'aisance, les commodités, chiottes, wc, toilettes, besoins, caca, scatologie, isabelle monrozier, décines-charpieu, alfred jarry, le surmâle, quintuplette, course des dix mille milles, excréter, excrément
jeudi, 05 juillet 2012
MA DOSE DE VIALATTE (ET AUTRES FETUS)
On connaît ma prédilection pour la haute littérature qu’on trouve dans les Chroniques de La Montagne, d’Alexandre Vialatte, qui ont la taille de courtes nouvelles et qui, de ce fait, constituent des petites merveilles de « livres pour les cabinets », pour qui a le désir ou l’habitude d’agrémenter ces moments quotidiens passés derrière la porte verrouillée, mais où d'autres verrous, corporels cette fois, se relâchent, pour qui, cependant, tient à maintenir dans son esprit un niveau honorable de maintien intellectuel et de contention morale.
Dans ces « lieux » destinés à accueillir des « nécessités » bien triviales, posséder, sur quelque honnête rayon de bibliothèque, des ouvrages capables d’offrir ainsi quelque satisfaction quintessenciée aux aspirations les plus nobles de l’individu en train de se soulager de sa matière la plus ignoble, tout en s’aérant les parties basses, je n’hésite pas à le dire, constitue l’indéniable marque de la haute considération dans laquelle doit être tenu, non seulement le logement où on le trouve, mais encore la personne qui l’habite.
Parenthèse : « Des gogues et démagogues ».
Cela dit, il est conseillé aux personnes « pressées » de s’enquérir auprès de leur hôte, avant d’accepter son invitation à dîner, de l’existence d’un deuxième « lieu », au cas où la situation l’exigerait. Rien n’est en effet plus disconvenable que de déposer dans un pot de fleurs son « engrais humain » sans demander à la maîtresse de maison si elle a auparavant fait le nécessaire.
J’ai parlé d’un « engrais humain » : il faut savoir qu’ainsi parle Victor Hugo dans Les Misérables : « Tout l’engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d’être jeté à l’eau, suffirait à nourrir le monde » (partie 5, livre 2, chapitre 1, pour ceux qui douteraient).
La suite est toute empreinte de parfums, je dirai même de fragrances délicates et raffinées. Jugez plutôt : « Ces tas d’ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c’est ? C’est de la prairie en fleur, c’est de l’herbe verte, c’est du serpolet et du thym et de la sauge, c’est du gibier, c’est du bétail, c’est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c’est du foin parfumé, c’est du blé doré, c’est du pain sur votre table, c’est du sang chaud dans vos veines, c’est de la santé, c’est de la joie, c’est de la vie ». Victor Hugo est bien le grand prêtre de l’antithèse (dont Chateaubriand lui a montré le chemin). Le Livre II s’intitule « L’intestin de Léviathan » : ça dit bien ce que ça veut dire.
Autrement dit, plus l’humanité produit de caca, plus l’humanité peut se nourrir. Comme quoi on a raison de dire que chez VH, il y a « à boire et à manger ». Est-ce à tort que nous n’éprouvons qu’aversion et répugnance pour ces matières vilipendées par la coutume, et qu’Alfred Jarry appelle les « immondices du corps » ?
Puisqu’on en cause, me revient à l’esprit le « lieu » du 7 quai Lassagne, où le « suivant » devait s’armer d’une très longue patience, ou se résoudre à traverser tout l’appartement à toute vitesse pour trouver refuge et salut dans l’autre « lieu ». La faute à la pile des Tintin hebdomadaires qui offrait son interminable tentation à la personne en train d’ « opérer ».
Me reviennent aussi, en même temps que les plumes de paon que nous ramassions par terre, les « lieux » du château d’Azolette, dans le haut Beaujolais, propriété de la famille Manivet : situés dans un pavillon faisant face à l’imposant bâtiment, de l’autre côté de la grande terrasse, leur lunette était recouverte d’un merveilleux velours, peut-être rouge, mais je ne peux pas le jurer.
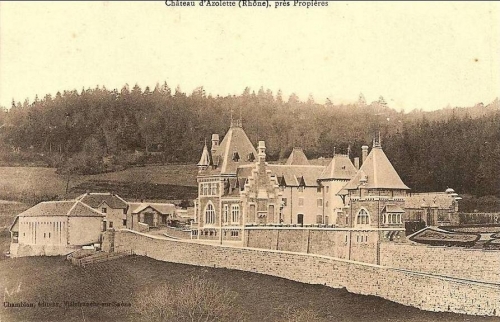
MIEUX QU'UNE PAILLOTE SUR UNE PLAGE CORSE, NON ?
(on distingue bien le pavillon en question, au premier plan)
Et pendant qu’on en est aux « mondanités », parlons du château de Joux, en Haute-Loire, dont les gogues ruraux et rustiques (auxquels on accédait en passant dans le petit bois, séparé de la haute et belle terrasse par un haut mur), étaient à deux places, ce qui m’a toujours laissé perplexe, et où l’on pouvait par là observer en direct, six ou sept mètres plus bas, le résultat des activités développées en cet endroit. Je précise que, si je parle de châteaux, ce n’est jamais moi qui y ai habité. « Simple visite », comme on dit au Monopoly.
Fermez la parenthèse.
Promis, je cesse de digresser, et je reviens à mon Vialatte. On le considère le plus souvent (quand on n’ignore pas scandaleusement son existence), comme un humoriste. Or, il faut bien se mettre dans la tête qu’Alexandre Vialatte est tout, sauf un humoriste. Avoir de l’humour ne suffit à personne pour devenir un professionnel de la chose. Alexandre le grand plaçait tout son humour dans la sphère infiniment plus vaste du regard très particulier qu’il portait sur le monde.
L'humour était un élément parmi d’autres dans la vision toute personnelle qu’il avait des choses. Si l’on veut, l’humour faisait partie intégrante de sa « philosophie » de l’existence. Une « philosophie » éminemment pessimiste. Sans espoir dans une hypothétique amélioration de l’espèce humaine. D’où la formule « Le progrès fait rage », disait-il, avant que Philippe Meyer ne popularisât la formule.
Disons que l’humour était, en quelque sorte, l’huile qui permettait au pessimisme de son moteur existentiel de ne pas « casser ». Vous trouverez ci-dessous une jolie petite illustration du pessimisme et de l’humour. Laissez Alexandre Vialatte agiter les ingrédients dans son shaker personnel, et voyez ce que ça donne.
La vérité, c’est qu’on n’a jamais vu pareille docilité des masses. Parce qu’il n’y eut jamais tant de moyens de les conditionner à son gré. L’instruction elle-même y concourt, qui permet à tous les hommes de lire le même journal. L’analphabète était bien obligé d’avoir ses idées personnelles, « de disputer, de juger, de décider par lui-même ». Aujourd’hui, il en croit le prospectus général.
Le prospectus général l’assure qu’il ne cesse de devenir plus libre, plus intelligent et plus fort. Que les siècles se superposent et qu’il y voit, par conséquent, de plus en plus loin. Mais il en va de ce socle hautain comme de celui de ce procureur auquel un avocat disait : « Monsieur l’avocat général, votre position supérieure est une erreur du menuisier ».
On trouve ça dans Les Champignons du détroit de Behring. Le pessimisme, c’est la lucidité sur l’époque qui le produit. L’humour, quant à lui, c’est un choix de vie, une attitude. Pour tout dire, c’est une morale. En plus, Alexandre Vialatte montre qu’il avait ce qu’on appelait au 18ème siècle « de l’esprit ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, wc, gogues, goguenots, chiottes, victor hugo, les misérables, alfred jarry, tintin, beaujolais, philippe meyer, les champignons du détroit de behring, château d'aazolette, château du cros
mardi, 26 juin 2012
BICYCLETTE, DOPAGE ET LITTERATURE
Résumé : ce n’est pas la peine de chercher l’exception : dans le peloton du Tour de France, celui qui ne se dope pas, c’est l’aiguille (si j’ose dire !) dans la botte de foin : on ne peut pas le trouver.
Le cyclisme (professionnel, mais aussi amateur, et très tôt) est donc le monde de la triche organisée et systématique, où les sportifs, s’ils veulent « percer », sont obligés de se procurer hors de leur organisme des « ressources » impossibles à trouver au-dedans. JACQUES ANQUETIL ne disait pas autre chose : « Il faut être un imbécile ou un faux jeton pour s’imaginer qu’on peut courir 265 jours par an sans stimulants ». Il comparait lui-même ses cuisses et ses fesses à « des écumoires ».
Je signale que LANCE ARMSTRONG, avec ses sept victoires dans le Tour de France, risque dans peu de temps de s’en voir privé, si les poursuites engagées par les instances sportives américaines aboutissent (le coureur est un gros lobby à lui tout seul).
Il semble qu’elles aient assez de « biscuits » pour conclure, si j’en crois L’Equipe (eh oui, ça m’arrive aussi !), qui sous-titrait récemment un article : « L’Agence américaine antidopage détient les preuves absolues que Lance Armstrong fut un terrifiant tricheur ». Pourquoi « terrifiant » ? Parce tout le milieu a été lâche et complice, et qu’il a si longtemps fermé les yeux ?
Le déjà nommé ANTOINE VAYER s’étonnait (?), en 1998, que l’équipe Festina au grand complet arrivât groupée, quasiment « en ligne », et « bouche fermée » au sommet de je ne sais plus quel col impossible. Il dit d’ailleurs de ce genre de coureurs : « Plus ils roulent, plus ils récupèrent ».
C’était le rêve d’André Marcueil, le personnage créé par ALFRED JARRY pour Le Surmâle, où cinq cyclistes, sur une quintuplette, font la course (de 10.000 milles) avec une locomotive, aidés par la « perpuetual motion food » (l'aliment du mouvement perpétuel) du bon Dr Elson. ALFRED JARRY fut un précurseur en matière de dopage. Il faudra que j’en parle un de ces quatre.
Il faut savoir que le taux d’hématocrite dans le sang (proportion des globules rouges) diminue dans les efforts longs et intenses, ce qui rend un sportif impropre à toute performance s’il ne se repose pas pour le reconstituer (eh oui, j’ai essayé de me documenter, mais je ne vais pas vous bassiner avec les données).
Au cours de toutes les affaires de dopage qui jalonnent la compétition cycliste depuis bientôt quinze ans, j’ai vu passer de temps en temps un article de PAUL FOURNEL, qui regrettait profondément les saloperies qu’on faisait au cyclisme et qui ternissaient son image, mais qui n’a jamais, pour son compte, renoncé à l’amour du vélo. Et on le comprend bien volontiers. Mais son bouquin Les Athlètes dans leur tête date (1988) d'avant l'arrivée de l'EPO, qui donne au pire canasson des ailes de crack.
Il fait dire à son ANQUETIL (des propos rapportés comme répétés à ses plus proches), dans son dernier livre : « Je crois bien que je n’aime pas, que je n’ai jamais aimé, que je n’aimerai jamais le vélo ». Dans la nouvelle qu’il lui consacre, il fait dire à son narrateur, parlant du vrai crack : « … un trait de caractère que je n’ai jamais eu et que je n’aurai jamais : un certain dégoût pour la bicyclette et une tendance à la laisser au garage plutôt que de s’entraîner ». Mais ce qui est sûr, c’est que FOURNEL, qui aime le vélo, est carrément baba devant le champion qui porte le nom de JACQUES ANQUETIL.
C’est qu’avec FOURNEL, on a vraiment l’impression d’être dans le bonhomme qui agite les jambes sur sa bicyclette, d’être au fin milieu du peloton, avec les amabilités diverses qui se déversent pendant une course : on ne voit pas pourquoi les mecs seraient muets, mais le spectateur se demande toujours : « Qu’est-ce qu’ils peuvent bien se dire ? ».
Dans Les Athlètes dans leur tête, je passe sur « La Course en tête », où le Portugais dont il est question fait le vide autour de lui, à cause d’une trajectoire erratique, et dangereuse pour ses voisins, surtout dans les sprints finaux. Une nouvelle qui commence par : « Il en va souvent ainsi des cyclistes : les plus malicieux manquent de cuisses et les plus cuissus manquent de malice. Ce Portugais était très cuissu ». A cause de l’ellipse, on dirait du VIALATTE.
La nouvelle finit par : « … il avait eu la sensation fugitive que le Portugais n’était pas vraiment mécontent de voir arriver cette bordure de trottoir en plein dans sa figure, à la vitesse d’une dernière gifle de béton ». Là, je ne peux pas dire qu’on dirait du VIALATTE, mais je me demande si VIALATTE n’aurait pas aimé écrire une phrase comme ça.
J’aime bien la nouvelle « Gregario » (le troupeau de l’équipe, au service exclusif de la vedette). A cause de quelques phrases, peut-être. Le gregario parle d’Yvon, le sprinter : « C’est lui qui fait rentrer l’argent dans l’équipe, c’est lui qui lève les bras sur la ligne pour qu’on puisse lire « Salami-Store » sur son maillot, à la télé, dans les journaux. Dans notre équipe, on roule pour du saucisson ». Il n’y a pas à dire : PAUL FOURNEL prend le monde tel qu’il est. Il n’en cache rien, il ne se fait aucune illusion, mais il « y va », comme on dit. C’est un choix. Ce n’est pas le mien, mais là, je respecte, parce qu’il sait écrire.
Je passe très rapidement sur « Méticuleux », canular montrant le gars qui se la joue, mais qui n’a plus envie que d’une chose : se taper la cloche dans une bonne auberge, après avoir fait semblant de partir pour l’Izoard. Je passe aussi sur « La forme », qui raconte la bonne journée (il arrive 30ème de l’étape) d’un basique qui s’étonne d’être encore dans la course. Aujourd’hui, « il était monté comme dans une chanson (…). Le revêtement rendait bien, les boyaux sifflaient juste, il passait en danseuse sans à-coups… ».
PAUL FOURNEL, on ne dira pas le contraire, aime et connaît le vélo.
Voilà ce que je dis, moi.
Le meilleur reste à venir.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cyclisme, tour de france, dopage, paul fournel, les athlètes dans leur tête, jacques anquetil, uci, lance armstrong, l'équipe, antoine vayer, alfred jarry, le surmâle, hématocrite, alexandre vialatte
lundi, 04 juin 2012
MODESTE LEçON DE RHETORIQUE
La rhétorique, on ne le sait pas assez, tout le monde l’a à la bouche. On croit que c’est uniquement un truc réservé aux savants, mais de même que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, de même les gens les plus ignorants de ce qu’on trouve dans les traités de rhétorique les plus érudits passent leur temps la métaphore à la bouche. Prenez « l’air du temps », « boire un canon », « discuter le bout de gras », etc. Rien que des métaphores.
Mais il est un domaine où un minimum de connaissance rhétorique explicite est requis : la littérature érotique. Si l’on met sur la « chose » le mot cru, le mot brut qui la désigne, on est plutôt dans le porno (comme on le dit à l’église : « priez porno »). Pour passer du pornographique à l’érotique – je parle évidemment de littérature –, il est indispensable de maîtriser au moins la métaphore.
J’ai parlé récemment, à propos d’Histoire d’O, du « ventre » et des « reins » : ce sont des métonymies, pour désigner les deux orifices de la femme, dans ce roman célèbre, mais qu’on peut aujourd’hui considérer comme excessivement compassé. La métaphore, étant plus facile à « manier », est infiniment plus fréquente.
« D’un doigt, il entrouvrit les lèvres ; elle poussa alors un petit gémissement. Elle était inondée et son sexe lui donnait l’impression d’être un abricot gorgé de soleil. »
ANNE-MARIE DE VILLEFRANCHE
L’abricot dont il est question ressortit tant soit peu de la comparaison. Mais voici une métaphore véritable :
« Un soir, ma sœur me dit : si nous étions dans le même lit, tu pourrais faire entrer ta petite broquette qui est toujours raide dans la bouche de ma petite marmotte. »
RESTIF DE LA BRETONNE
Là, c’est même deux pour le prix d’une : pour une bonne compréhension de la première, une « broquette » est un clou de tapissier. Les énumérations sont fastidieuses, n’est-ce pas ? Aussi m’en garderai-je comme de la peste. Tenez, voici un petit poème du grand VOLTAIRE.
« Je cherche un petit bois touffu que vous portez, Aminthe,
Qui couvre, s’il n’est pas tondu, un gentil labyrinthe.
Tous les mois, on voit quelques fleurs couronner le rivage.
Laisse-moi verser quelques pleurs dans ce gentil bocage. »
N’est-ce pas tendre et délicieux ? Aimablement dit ? Suavement tourné ?
A quoi pense CHARLES BAUDELAIRE quand il écrit :
« Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine (...) ? »
Faut-il faire un dessin ? Une explication de texte ? Je m’en voudrais. C’est pourtant, dans Les Fleurs du Mal, un poème (« Parfum exotique ») figurant fort souvent à l’oral du bac. Je signale qu’une seule lettre distingue « exotique » et « érotique ».
Je ne suis pas sûr, si cela peut rassurer les parents, que le professeur aille, dans son cours, jusqu’à l’explicite. Eh bien, je dis que c’est tout à fait regrettable, car il n’est pas mauvais de dépuceler ainsi l’imaginaire pubère – qui ne demande pas autre chose –, et bien des contes des 17ème et 18ème siècles gagneraient à être lus pour ce qu’ils sont : des métaphores.
« Voyez fille qui dans un songe
Se fait un mari d’un amant ;
En dormant, la main qu’elle allonge
Cherche du doigt le sacrement ;
Mais faute de mieux, la pauvrette
Glisse le sien dans le joyau. »
Ce petit sizain est du sieur BÉRANGER, et rappelle une anecdote que je tire de RABELAIS, vous savez, celle qui raconte Grandgousier et Gargamelle, qui faisaient souvent la « bête à deux dos », bien que je ne sache pas si c’est maître FRANÇOIS qui a inventé la formule.
En tout cas, il raconte l’histoire de l’anneau de Hans Carvel, jeune marié qui, forcément, s’inquiète de se voir pousser du « cerf sur la tête », selon la formule de GEORGES BRASSENS, dans « Le cocu », car sa jeune épouse est jolie et ardente. Dans son rêve, une bonne fée lui passe au doigt un anneau magique qui fera de sa femme la plus chaste des femmes. Evidemment, quand il se réveille, il se rend compte qu’il a le doigt dans le « joyau ». Belle métaphore, n’est-il pas ?
Ne pas nommer, « suggérer au lieu de dire. Faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots » (ALFRED JARRY). Voilà le secret. Notre époque semble impropre aux secrets de cette sorte. Il lui faut la chose sous le nez, l’obscène, le réel. A ce titre, l’époque tend davantage au porno qu’à l’érotique. Notre époque est impropre aux subtilités du langage, au déplacement, à la métaphore. Elle ne sait pas de quels plaisirs de haute lisse elle se prive ainsi.
Signe des temps : vous ouvrez L’Equipe un lendemain de grand match : des métaphores comme s’il en pleuvait. Des métaphores très souvent guerrière du genre « exploser la défense », « tirs de barrage », etc. La déchéance, je vous dis. La métaphore qui survit grâce au sport-spectacle, c’est un comble.
Voilà ce que je dis, moi.
08:58 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : érotisme, littérature érotique, rhétorique, monsieur jourdain, prose poésie, métaphore, métonymie, histoire d'o, voltaire, baudelaire, les fleurs du mal, béranger, rabelais, georges brassens, alfred jarry, obscène, l'équipe

