dimanche, 04 avril 2021
LA LIBÉRATION DE LA PAROLE ...
... CHEZ LES PEUPLES OPPRIMÉS.
Morris a inventé le personnage de Lucky Luke en 1946. Goscinny a apporté sa patte inimitable aux scénarios à partir de 1957 (Des Rails sur la prairie). En 1958, dans Lucky Luke contre Joss Jamon, apparaît le personnage des peuples opprimés sous les traits de Joe le Peau-Rouge. Les seules interventions de ce personnage aux allures de Grand Sachem énigmatique dans les dialogues se limitent à proférer invariablement le sobre monosyllabe « Ugh ! » à toutes les sollicitations extérieures.
Mais soudain, à la page 41, face au chef des "méchants" qui menace de mort les méchants de la bande qui se laisseraient lâchement effleurer par le désir de se rendre aux représentants de la loi légale, voilà-t-il pas que les vannes s'ouvrent, et font découvrir au lecteur, derrière le mutisme obstiné du "sauvage", tous les raffinements rhétoriques d'un redoutable orateur. C'est très moral, tout ça : le "sauvage" n'est pas celui qu'on croyait. Goscinny et Morris avaient le sens du contraste.



Les initiés feront évidemment le lien avec un autre personnage — littéraire celui-là —, inventé par Alfred Jarry pour servir de valet, de serpillière, de victime-à-tout-faire et de double ignoble à l'excellentissime Docteur Faustroll : le « Grand singe Papion Bosse-de-Nage, lequel ne savait de parole humaine que "Ha Ha" » ("monosyllabe tautologique") dans son entreprise de navigation "de Paris à Paris par mer". Mais contrairement à Joe le Peau-Rouge, Bosse-de-Nage n'accèdera jamais à la libération de sa parole, irrémédiablement compendieuse.
09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, bande dessinée, lucky luke, morris lucky luke, goscinny, lucky luke contre joss jamon, peuples opprimés, la parole libérée, des rails sur la prairie, joss jamon, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, grand singe papion bosse-de-nage, monosyllabe tautologique, singe papion cynocéphale
lundi, 30 avril 2018
EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 1
22 juin 2015
Le pape François a raison !
1/3
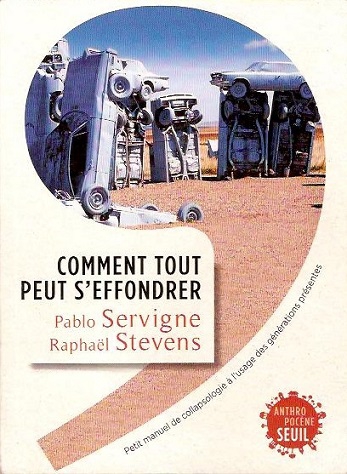 Le monde est en mauvais état, ça commence à se voir et même à se savoir. Le pape François en personne s’en est aperçu, c'est dire (cf. son "encyclique" Laudato si). Mais l’Eglise catholique est dans un tel délabrement que je n’ai plus envie d’appuyer sur la détente. On nous fait un ramdam pas possible au sujet du ramadan. On s’est bien gardé, le 25 mars, de signaler aux chrétiens le jour de l’Annonciation, que je sache. Plus la France se musulmanise dans les médias et dans la rue (sur le refrain : « Il faut être tolérant, voyons ! »), plus j’ai envie de revendiquer les racines chrétiennes de ma culture, même sans avoir la foi. Mes racines les plus profondes sont là, et nulle part ailleurs. Puisque d'autres revendiquent avec force (et même parfois avec violence) leur identité, je ne vois pas pourquoi je n'affirmerais pas la mienne. Ce serait bien mon tour. Passons.
Le monde est en mauvais état, ça commence à se voir et même à se savoir. Le pape François en personne s’en est aperçu, c'est dire (cf. son "encyclique" Laudato si). Mais l’Eglise catholique est dans un tel délabrement que je n’ai plus envie d’appuyer sur la détente. On nous fait un ramdam pas possible au sujet du ramadan. On s’est bien gardé, le 25 mars, de signaler aux chrétiens le jour de l’Annonciation, que je sache. Plus la France se musulmanise dans les médias et dans la rue (sur le refrain : « Il faut être tolérant, voyons ! »), plus j’ai envie de revendiquer les racines chrétiennes de ma culture, même sans avoir la foi. Mes racines les plus profondes sont là, et nulle part ailleurs. Puisque d'autres revendiquent avec force (et même parfois avec violence) leur identité, je ne vois pas pourquoi je n'affirmerais pas la mienne. Ce serait bien mon tour. Passons.
Le pape a donc raison avec son encyclique dédiée à l’état de notre environnement naturel. Qu’on examine la santé de la planète, qu’on mesure les ressources en eau ou en alimentation (leur qualité, les substances diverses qu'on nous fait avaler), actuelles et futures, que l’on comptabilise les kilomètres carrés de forêts qui disparaissent, qu’on assiste, effaré et impuissant, à la cancérisation du Moyen Orient et de quelques régions d’Afrique par des mafias impitoyables armées de leur islam guerrier, chassant sur les routes de l’exil des troupeaux de réfugiés, qu’on écoute la litanie interminable des déboires économiques qui attendent encore la France, – quoi qu’on fasse, on ne peut que constater les dégâts.
Quand on aborde les problèmes un par un, on pourrait presque se prendre à espérer en des solutions, et se dire que le pire n’est pas toujours sûr. C’est quand on les met bout à bout que le tableau d’ensemble commence à apparaître et à devenir effrayant. C'est la somme des maux qui touchent la planète et l'humanité, c'est aussi la diversité de leurs causes et de leur origine qui finissent par paraître menaçantes et monstrueuses. Les lieux du monde où sévit le Mal sous toutes ses formes tendent à se multiplier, et les multiples façons dont le Mal s’exprime tendent à envahir le paysage. Même pas besoin d’être pessimiste : il suffit de se tenir informé et de garder ouverts les yeux et les oreilles.
C'est la raison pour laquelle on a bien du mal à comprendre l’optimisme, fanatique autant que ravageur, qui habite certains commentateurs et observateurs soi-disant « avertis », genre Laurent Mouchard-alias-Joffrin, de Libération (pas le seul, hélas), qui persistent dans une stupéfiante confiance dans le « Progrès » indéfini de l’humanité et dans les solutions techniques aux problèmes que la technique a engendrés (l'innovation au secours des dégâts des innovations précédentes : le pompier venant éteindre à coups de pétrole l'incendie qu'il a allumé).
Je n’ose croire qu’ils se vautrent sciemment dans le mensonge, sauf à imaginer qu’ils en tirent un bénéfice personnel, à la façon de ces « think tanks » à l’américaine qui, largement subventionnés par les intérêts de ceux qui y ont intérêt, vous déversent à la demande du climato-scepticisme comme s’il en pleuvait ou de la croyance absolue dans les bienfaits des OGM ou des néo-nicotinoïdes dans l’agriculture.
Je viens d’apprendre l’existence d’un livre (Osons rester humains. Les impasses de la toute-puissance) de Geneviève Azam au sujet de la si fragile toute-puissance de l'humanité actuelle. Je le lirai peut-être [ce n'est toujours pas fait trois ans après : effet de saturation ?]. La dame, à la radio, parle en tout cas de façon pertinente et mesurée. Et le vieux poids lourd Edgar Morin lui apporte son soutien en écrivant "Lu et approuvé" dans Libération du samedi 20 juin (même jour que le Terre à terre de Ruth Stégassy, qui avait invité Geneviève Azam dans son excellente émission, sur France Culture).

Mais aujourd’hui, je veux évoquer le petit volume de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer (Seuil, collection « Anthropocène », avril 2015). Car l’ambition de ce bouquin est précisément de mettre bout à bout les problèmes qui menacent l’humanité. Le sous-titre est éclairant : « Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes ». Je le classerai parmi les « mauvais bons livres ». Je dirai pourquoi.
« Collapsologie », donc. Pourquoi pas ? Le terme existe sans doute déjà, dans cette Amérique qui a tendance à nous envoyer, avec quelque retard, toutes ses trouvailles, jusqu’aux plus débiles, saugrenues et malfaisantes. Mais « générations présentes » est aussi à relever : pour les auteurs, les menaces qui pèsent sur la planète ne doivent pas être pensées dans un lointain futur, mais sont à prendre en compte dès aujourd’hui.
Va donc pour cette nouvelle discipline scientifique : la science des effondrements. Drôle d’idée quand même de faire de l’effondrement un objet d’étude scientifique. D’ériger l’effondrement en concept, en objet d’observation en soi. Je ne comprends pas bien cette tournure d’esprit, qui pose un objet largement conceptuel sur la paillasse pour voir s’il obéit à des lois qui lui sont propres.
Ça me fait un peu penser à une des définitions qu’Alfred Jarry donne de la « ’Pataphysique » : « … la ’pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions … » (c'est dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien). J'adore quant à moi les lois qui régissent les exceptions. Sans exception.
De là à voir dans « l’effondrement » un objet pataphysique, il y a un pas que je me garderai de franchir, tout en esquissant le geste. Je veux dire que j’ai un peu de mal à envisager un concept qui s’appellerait « effondrement » : il faudrait disposer d’une belle série historique d’effondrements passés pour difficilement en tirer des enseignements de quelque validité. L’Empire romain, les Mayas (qui sont cités), je veux bien, mais scientifiquement, ça paraît bien léger. Y a-t-il des "lois" qui président aux effondrements ? Ou, plus probablement, chacun est-il un exception ? Un cas unique ?
On n'est finalement pas très loin de la 'Pataphysique, il me semble. Que les auteurs n'aient aucun souci, ils ne risquent rien : « La 'Pataphysique est la science ... » (dernière phrase du Faustroll).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : comment tout peut s'effondrer, pablo servigne, raphaël stevens, éditions du seuil, anthropocène, environnement, réchauffement climatique, écologie, pollution, église catholique, pape françois, vatican, encyclique, fête annonciation, ramadan, islam, musulmans, france, société, laurent joffrin, geneviève azam, osons rester humains, edgar morin, journal libération, collapsologie, pataphysique, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, ruth stégassy, france culture, émission terre à terre
vendredi, 06 janvier 2017
LA NIAISERIE VÉGÉTALOPHILE
J'entends régulièrement des énormités, y compris (et pourquoi pas ?) sur France Culture. Hier matin, ce fut le tour d'une madame Pelluchon, qui se présente comme philosophe (et pourquoi pas ?), d'entonner le refrain des droits des animaux, et de déplorer les traitements que les hommes leur font subir. Qu'ils soient animaux de laboratoire ou d'élevage, ils souffrent, ce dont plus personne de raisonnable ne doute. Mais bon, est-ce une raison pour déraisonner ?
Là où je vois la niaiserie bêtassonne nimber le cerveau et les paroles de madame Pelluchon de l'auréole de la douce béatitude, c'est quand elle dit qu'il faudrait (ah, qu'ils sont délicieux, ces vœux pieux, ces doux rêves !) que les éleveurs reviennent à l'élevage extensif, plus traditionnel et plus humain (ben voyons, il suffit sans doute de leur demander gentiment pour qu'ils obtempèrent !), et qu'on fasse disparaître ces odieux camps de concentration et d'extermination de plus en plus démesurés que l'industrie de la viande construit dans toutes les campagnes, où porcs, bovins ou volailles, réduits à l'état de "minerai" (sic), s'entassent les uns sur les autres sans savoir ce qu'est un brin d'herbe, et sans jamais voir la lumière du jour, jusqu'à l'instant fatal où ils monteront à l'échafaud.
Protester contre ça est assez juste, mais franchement, autant expulser ses urates dans un violon (c'est Faustroll qui se permet de faire ça, mais ce n'est pas dans un violon, c'est parce que le fond de son as est un crible, cf. I,6 : « Du bateau du docteur, qui est un crible »). Car c'est ignorer (ou le feindre) le principe de réalité, c'est ignorer qu'un système, surtout aussi solidement organisé et durablement implanté que la "filière viande", ne se change pas à coups de "il faudrait". C'est une simple déclaration de bonnes intentions, qui a l'avantage de donner de ceux qui la font l'image pieuse et valorisante des âmes immaculées, celles face auxquelles les gens ordinaires se sentent spontanément coupables.
Si les caméras cachées introduites dans plusieurs abattoirs par l'association végane L214 ont fait scandale, c'est bien parce cette réalité apparaît scandaleuse à une partie importante de la population. Là où les végétariens (madame Pelluchon l'est depuis 15 ans, s'est-elle vantée), végétaliens et autres véganes se mettent le doigt dans l’œil jusqu'à l'anus, c'est quand ils placent le problème sur le terrain moral et tirent de leur constat la seule conclusion qui vaille à leurs yeux : convertissez-vous au végétal, cessez de manger de la viande. Je dis pourquoi pas, mais pourquoi cette soudaine exclusivité ? A-t-on demandé l'avis des végétaux ? Qui se portera au secours de cette autre grande cause ? Qui dira la souffrance de la feuille de laitue réduite à l'impuissance, écrasée sous le marteau-pilon de molaires converties à l'abstinence carnée ? Plus crucial et plus général : que mangeront les hommes ?
Je réponds à ces gens sûrement très moraux, déontologiques, éthiques et tout et tout qu'une entrecôte bien saignante, avec ou sans sauce poivre vert, me fait un effet bœuf ; qu'un steak tartare (attention : non haché mais coupé au couteau) me paraît tout le contraire d'un coup vache ; qu'un morceau de veau pris dans le bas de carré, longuement mijoté avec un bout de gras, deux ou trois tomates pelées et une pincée de fleur de sel, me tire des soupirs de contentement ; qu'un poulet soigneusement rôti éveille chez mes papilles une concupiscence irrésistible, à laquelle précisément je ne vois pas de motif sérieux de résister. J'ajoute que je ne convie pas n'importe quelles viandes dans mon assiette, et que je ne me les procure pas n'importe où.
Quoi qu'il en soit, ces végétalophiles, madame Pelluchon en tête, ont tout faux. Tout simplement parce qu'ils s'en prennent au seul effet, en se gardant bien de remonter à la cause. La conclusion qu'ils en tirent est forcément erronée, puisqu'ils font d'une solution et d'un choix purement individuels une loi générale. Leur réaction, en plus d'être stupidement policière et morale, s'en prend par erreur à une cible qui n'est pas la bonne : s'ils la bombardaient, on parlerait de "dommages collatéraux". Il n'en serait pas de même s'ils consentaient, dans leur dénonciation de l'élevage industriel, à porter leur attention plutôt sur "industriel" que sur "élevage". Ils verraient que le fléau n'est pas dans la viande, mais dans la viande de masse.
Et ça leur permettrait d'englober dans leur refus tout un système fondé sur le productivisme effréné et l'industrialisation à outrance de toute la filière agricole, culture et élevage confondus, à commencer par l'usage déraisonnable qui y est fait des pesticides, des OGM (eh, Pelluchon, ton tofu, il est au soja biologique, tu es sûre ?) et autres antibiotiques, autant de substances que nous absorbons les yeux grands fermés. Cela leur permettrait de s'en prendre à tout un système, et non, bien en vain, à un seul de ses aspects.
Peut-être, après tout, le système productiviste leur convient-il dans son organisation et ses orientations cardinales. Peut-être aussi n'ont-ils pas aperçu le monstre Léviathan derrière le chiffon rouge de la "souffrance animale", ce rideau de fumée choquant et douloureux, mais avant tout affectif et sentimental. Il y a de la bêtise pusillanime dans leur façon de présenter les choses, car ils n'ont pas compris que le scandale qu'ils dénoncent à juste titre est un corollaire on ne peut plus logique et nécessaire du système qui l'a produit.
Un gars de la Confédération paysanne déclarait, toujours hier matin sur France Cu, à propos de l'épidémie de grippe aviaire dans le Gers (qui va voir plus d'un million de canards abattus), que les industriels du secteur se frottent les mains en se disant qu'une fois disparu le dernier élevage fermier dans la région, ils détiendront le monopole sur la filière, et pourront remplir à leurs conditions les rayons des grandes surfaces de leur daube de bas étage.
L'industrialisation de l'agriculture (l'industrie agro-alimentaire est une réalité, en même temps qu'elle est un système complet, qui conditionne et organise l'existence des éléments qui le composent) est mauvaise en soi. C'est le système industriel de production de nourriture qui est à changer en totalité, et non telle ou telle de ses modalités. La cause animale est une noble cause, je suis d'accord, mais en fait de réforme, madame Pelluchon et ses coreligionnaires, en prêchant le végétarisme, en se contentant de s'exprimer dans l'espoir de "changer les mentalités" (la belle blague !), proposent un réformette, même pas cosmétique, d'un système qui est mortifère dans son entier.
Et en même temps que j'écoute le sermon de ces curés moralisateurs, j'entends le ricanement satisfait des industriels, qui ne sont pas près de se laisser convaincre de revenir à l'élevage extensif traditionnel, et qui sont en train de se payer leur fiole en murmurant : « Cause toujours ». Le perroquet Laverdure (Zazie) dirait approximativement la même chose :
« Tu causes, tu causes, c'est tout c'que tu sais faire ».
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france culture, corine pelluchon, végétarien, végétalien, végan, cause animale, animaux de laboratoire, animaux d'élevage, déclaration des droits de l'animal, doctaur faustroll, pataphysique, alfred jarry, l 214, l 214 abattoirs, ogm, monsanto, grippe aviaire, cause toujours, tu causes tu causes c'est tout c'que tu sais faire, perroquet laverdure, zazie dans le métro, raymond queneau, gestes et opinions du docteur faustroll, tewfik hakem paso doble
mercredi, 17 février 2016
GEORGES PEREC
 2/2
2/2
Le génie qui fait de Perec un cas absolument particulier, c’est qu’il réunit (parmi d’autres) deux capacités très différentes, opposées ou complémentaires : d’une part, une invraisemblable virtuosité combinatoire, qui en a fait un maître du palindrome, du lipogramme, des mots croisés, etc., mais aussi l’ingénieux artisan de divers jeux qu’il proposa pendant un temps à la revue Ça m’intéresse. Et puis, un merveilleux sens de l'approximation phonétique, capable de lui fournir le fameux « les gnocchis, c'est l'automne », à partir du célèbre et socratique "gnôthi séauton" du temple de Delphes.
D’autre part, une sensibilité hors du commun qui le met à l’affût de tout ce qui se présente à lui de la réalité. Sa curiosité est insatiable. On se dit parfois que son Graal à lui, c’est « l’aleph » de Jorge Luis Borges, le « Tout dans l’Un », cette sorte de pierre lumineuse dissimulée sous la marche d’une cave banale, mais qui, quand on l’examine de près, montre l’univers entier en train de défiler dans la totalité multiple de ses espaces et de ses temps (je m’étonne en passant que l’index, à la fin du Georges Perec de David Bellos, ne comporte que trois (+ 1) occurrences du nom de l’auteur de Buenos Aires ; mais bon).
Et par-dessus tout ça, Perec vous donne en étrenne la vulnérabilité à vif de son existence d’enfant juif qui a eu la chance, réfugié à Villard-de-Lans, d’échapper au nazisme. A noter, dans la biographie de Bellos, la différence qu’il note entre l’occupation du Vercors par les Italiens et le moment où les Allemands vont les remplacer, beaucoup plus organisés et déterminés.
Le génie de Georges Perec, donc, a pu prendre son envol grâce au carcan des contraintes formelles. Comme s’il avait eu besoin d’un cadre qui lui servît de bercail. Cela suffit-il à fabriquer du « poétique » ? Le biographe David Bellos semble le croire (voir p.689 de son Georges Perec). Personnellement, j’ai un peu de mal : Alphabets, La Clôture, qui rassemblent des « poèmes », appartiennent de façon trop évidente à de la littérature expérimentale.

Exemple d' « ulcérations ».
Si si ! C'est un poème, on vous dit !
Perec était, hélas, un adepte de la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg. J’expliquerais volontiers cet égarement du goût par sa tournure d’esprit particulière, qui met la combinatoire au cœur du processus de création. Or, la musique sérielle a été conçue dès le départ comme une machine combinatoire qui, en plaçant tous les sons de la gamme à égalité (abandon de la tonalité, ce principe qui les organise a priori), multiplie mathématiquement les possibilités d’arrangements des sons entre eux, ce qui ne pouvait que plaire à l’écrivain. Les arts en général, la littérature en particulier, envisagés sous l'angle de leur potentiel infini d'innovation formelle, promue au rang d'un idéal considéré en lui-même et pour lui-même. L'impasse, quoi.
Par-dessus le marché, Perec était sans doute séduit, dans le dodécaphonisme, par la notion de contrainte : le fait d’établir une succession de douze sons, puis de la triturer dans tous les sens (forme droite, rétrograde, miroir, miroir du rétrograde) fait obligatoirement penser aux « onzains hétérogrammatiques », structure à partir de laquelle il élaborait ses poèmes. Que le résultat musical ou poétique soit impénétrable à l’auditeur ou au lecteur lambda, peu importe : il reste toujours à l'artiste le contentement d’avoir réalisé une prouesse.
Tant pis pour moi, que cette priorité exagérée accordée à la forme aurait plutôt tendance à décourager. Je ne conteste pas, du reste, le fait que Perec ait eu besoin de contraintes structurelles pour y loger ses propres contenus (j’ai entendu de la bouche même d’Harry Mathews, son meilleur ami, que sans les contraintes oulipiennes, Perec n’aurait pas été Perec), mais je maintiens qu’on ne saurait lire, par exemple, La Disparition comme n’importe quel autre roman : qu’on le veuille ou non, l’effet de fascination provoqué par le procédé est un obstacle puissant.
David Bellos le dit d'ailleurs lui-même, à propos du grand palindrome de Perec : « Les facultés critiques y sont en effet paralysées par la connaissance de la contrainte formelle ; lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un palindrome géant, on a tendance à ne plus voir que cette structure palindromique » (p.451). Que vaut, en effet, un texte ainsi obtenu ? Qu'en reste-t-il littérairement si on lui ôte la contrainte ? Bonnes questions.
Mais attention, il serait stupide de prétendre que le travail de Perec est purement formel : W ou le souvenir d'enfance, Un Homme qui dort sont des livres qui touchent le lecteur. Hormis les machines à produire du texte (palindrome, "ulcérations", etc.), véritables hérissons d'obstacles à la lecture, Georges Perec est certainement un cas unique, par la façon qu'il a d'habiter, d'animer et de faire vivre des structures, en y insufflant de la substance vitale.
Mais il y a autre chose, au sujet de la forme et de la structure : que des gens savants et facétieux se rassemblent pour ouvrir un laboratoire (Oulipo) pour élaborer des machines littéraires, c’est typique d’un certain rapport à la modernité : le même rapport d’adhésion au principe d’innovation qu’on observe tout au long du 20ème siècle dans tous les arts. Il est vrai qu'introduire la machine dans la production de l'art avait été envisagé par Alfred Jarry : on trouve en effet dans Faustroll (XXXIV, Clinamen) : « ... Cependant, après qu'il n'y eut plus personne au monde, la Machine à Peindre, animée à l'intérieur d'un système de ressorts sans masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines ... etc. ». Allons, Jarry annonçait bien le 20ème siècle.
Ainsi, les peintres se sont libérés du carcan des techniques picturales de représentation pour mettre en évidence, au choix, la ligne, la surface, la toile, la couleur, la matière, et même la salle d’exposition ou le visiteur. Cela a donné « l’art contemporain ». De même, certains musiciens ont pratiqué le « sérialisme intégral » (touchant cette fois tous les paramètres musicaux : hauteurs, timbres, intensités, durées, …). En simplifiant, cela a donné la « musique contemporaine ». J’ai dit ce que j’en pense il y a déjà quelque temps (du 6 au 17 décembre 2015).
De même l’Oulipo, en prétendant en finir avec le subjectivisme de la littérature courante (l’ « inspiration », le « génie », stéréotypes bêtement entachés de romantisme et d'affectivité), en plaçant sur le devant de la scène les diverses logiques formelles (les "machines") mises au point par les écrivains, en faisant des rouages et tubulures du moteur un objet de recherche en soi, a donné l’illusion à tout un chacun qu’un créateur sommeillait peut-être en lui.
On peut aussi dire que l'Oulipo, en inventant le "délassement intelligent", met entre parenthèses la gravité sérieuse du savoir universitaire, le temps d'une récréation où puissent s'ébattre les intellectuels. N'ai-je pas entendu Jean Lescure (la méthode "S+7") glisser à son vieux compère Noël Arnaud (Alfred Jarry, Dragée haute, ...) : « Alors, on va oulipoter ? » ? Bon, la récréation, ce n'est tout de même pas le bac à sable, mais il y a quand même de l'enfance là-dedans.
On a vu ensuite les recherches de l'Oulipo croître et embellir, au point que l'invention de contraintes nouvelles semble être devenue, à part entière, un genre littéraire autonome (aux dernières nouvelles on en est au n°225 de la "Bibliothèque oulipienne"). Certains voient là une « démocratisation ». Je crois plutôt que l'aspect ludique des exercices oulipiens explique pour une large part leur popularité : à quoi servirait, dans la littérature, qu'un auteur produise un ouvrage fondé sur une contrainte inventée par un autre ? Il aurait bonne mine, oui. L'auteur de la contrainte serait en droit de l'accuser de plagiat : un comble !
Il y a de la frénésie égalitariste dans les fondements de l’Oulipo. J'y vois aussi, paradoxalement, un bel exemple de snobisme littéraire, même si les fondateurs et les premiers membres (les dix-huit de LA photo) furent exempts, je crois, de cette bassesse. Il reste que l'Oulipo a inventé cette bête étrange : l'égalitarisme snob. L'oxymore nouveau est arrivé.
J'ai tendance à voir là la simple exploitation d'un filon : après le cul de sac, il n'y a qu'à continuer à creuser pour continuer à faire tourner la machine. La contrainte pour la contrainte, en quelque sorte. Comme une belle machine qui tourne toute seule, à vide, pour le seul plaisir de tourner. A quand la contrainte permettant de produire des contraintes nouvelles (la contrainte au carré) ? Comme quoi, l'Oulipo est comme la plupart des organisations : il a du mal à envisager sa propre disparition. L'Internationale Situationniste de Guy Debord fait figure d'exception.

Et puis je n’y peux rien : la pullulation de ce qu’il est convenu d’appeler « ateliers d’écriture » a quelque chose de déprimant à mes yeux. Vous voulez écrire ? On va vous apprendre. Cette mode qui a été importée des Etats-Unis (où l'on apprend à pondre des romans aussi contondants que des pavés) tend à sacraliser l’idée de procédés littéraires : devenez écrivain en vingt leçons, vous voyez le genre. Au choix, la méthode Assimyl ou le livre de recettes de cuisine. Cela permet à des petits malins de se donner le beau rôle. Certains en ont tiré des sources de revenus, et il suffit d’écouter l’émission « Des papous dans la tête », sur France Culture, pour assister au spectacle ennuyeux de gens savants payés pour offrir un spectacle laborieux de divertissement fastidieux. Et pour tout dire pénible.
Georges Perec, soyons-en sûr, n’aurait pas participé aux « Papous dans la tête ». Quoique ...
Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, revue ça m'intéresse, gnôthi séauton, jorge luis borges l'aleph, david bellos georges perec, perec alphabets, perec ulcérations, perec la clôture, musique, arnold schönberg, onzains hétérogrammatiques, perec la disparition, harry mathews, palindrome, perec un homme qui dort, w ou le souvenir d'enfance, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, sérialisme intégral, jean lescure, noël arnaud, bibliothèque oulipienne, guy debord internationale situationniste, des papous dans la tête, france culture, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, clinamen
mercredi, 16 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 11/9

POST-SCRIPTUM
Combien de « Justes » à Sodome ?
2
Partant de là, dans le capharnaüm de la production des arts du 20ème siècle, j’ai décidé de me constituer un petit trésor personnel, un panthéon domestique et familier, une famille d’élection, une modeste caverne d’Ali Baba, où coule la source de mes plaisirs esthétiques. Je ne vais pas établir la liste complète de mes préférences ainsi définies. Ce n’est même pas le nom des peintres et des compositeurs qui pourrait figurer ici : il est clair que ce ne sont pas les œuvres complètes de ceux qui ont capté mon attention, mon regard, mon ouïe.
Il va en effet de soi que je ne suis pas fou de toutes les œuvres d’Olivier Messiaen (j’ai du mal avec les Poèmes pour Mi, et ce n’est pas ma seule réserve), de Bartok Bela (j’ai du mal avec Le Château de Barbe-bleue), de Dimitri Chostakovitch (j’ai du mal avec les symphonies), pour prendre les premiers qui me viennent. De même que je ne peux pas prendre tout Beethoven (j’ai du mal avec Christus am Ölberg, bien que j’aie chanté dans les chœurs qui le donnaient), je ne garde pas tout de chacun, forcément.
Je ne suis pas non plus asservi à un « genre » de musique : je reste effaré qu’on puisse sérieusement se déclarer « fou de rap », « fan de heavy metal » ou « idolâtre de Johnny Halliday » (tant pis, c’est tombé sur lui). Je n’ai pas encore compris comment on peut dans le même temps se déclarer adepte de la tolérance et de l’ouverture à tout et à tous, et river ses oreilles à un seul et unique « genre » musical : c'est être très intolérant. J’en arriverais presque à considérer l’éclectisme de mes goûts musicaux et picturaux comme une preuve d’ « ouverture aux autres et au monde » (pour parler la langue officielle).
De même que le Docteur Faustroll (Alfred Jarry) ne gardait de toute la littérature qu’une œuvre de vingt-sept écrivains, ces œuvres qu’il appelait « Livres Pairs » (à l’exception éminente de Rabelais, qui figure pour toute son œuvre, j’oublie les différences entre le manuscrit "Lormel" et le manuscrit "Fasquelle"), de même, s'il fallait ne garder de mes élus qu'une seule œuvre, de Messiaen, ce seraient les Vingt regards sur l’enfant Jésus (par Béroff, Muraro ou Aimard, mais en commençant par Yvonne Loriod (cliquez pour 2h00'11"), cette femme à nom d'oiseau qui attendit avec amour et patience que le compositeur et ornithologue reconnu se sente enfin autorisé à l'épouser) ; de Bartok, le Quatuor n°4 (par les Vegh) ; de Chostakovitch, le Quatuor n° 8 (par les Borodine ou Fitzwilliam).
fallait ne garder de mes élus qu'une seule œuvre, de Messiaen, ce seraient les Vingt regards sur l’enfant Jésus (par Béroff, Muraro ou Aimard, mais en commençant par Yvonne Loriod (cliquez pour 2h00'11"), cette femme à nom d'oiseau qui attendit avec amour et patience que le compositeur et ornithologue reconnu se sente enfin autorisé à l'épouser) ; de Bartok, le Quatuor n°4 (par les Vegh) ; de Chostakovitch, le Quatuor n° 8 (par les Borodine ou Fitzwilliam).
Et ma préférence va plus loin dans le détail. Des Vingt regards …, je garde, en plus des accords initiaux qui sont « le thème du Père » (de Dieu), qui jalonnent et structurent toute l’œuvre, le vingtième (« Regard de l’Eglise d’amour », oui, moi, un mécréant endurci !), à cause de la joie triomphante qui en ruisselle et vous prend dans ses bras pour vous accroître d’une force que vous receliez sans le savoir. Je ne me suis jamais repenti de vivre l'épreuve initiatique que représente l’écoute intégrale des Vingt Regards. J'en garantis l'effet confondant sur le moral.
 Du Quatuor n°4, je garde l’ « allegretto pizzicato », à cause de son
Du Quatuor n°4, je garde l’ « allegretto pizzicato », à cause de son espièglerie savante ; du Quatuor n°8, le « Largo » initial, à cause de son paysage de lande désolée, où je crois voir un corbeau s’envoler lourdement sur un ciel de sombres cumulo-nimbus (ci-contre à droite, la bobine de Chostakovitch, au diapason de ce Largo).
espièglerie savante ; du Quatuor n°8, le « Largo » initial, à cause de son paysage de lande désolée, où je crois voir un corbeau s’envoler lourdement sur un ciel de sombres cumulo-nimbus (ci-contre à droite, la bobine de Chostakovitch, au diapason de ce Largo).
Chez ces trois-là, je m’en suis maintes fois assuré, rien n’est gratuit ou sans signification (quoique le dernier ait parfois donné dans le divertissement).
Dans la préférence musicale, j’aperçois toujours, dans l’œuvre d’un compositeur, l’opus qui me retient et, dans cet opus, le moment qui me transporte (dans un tout autre genre de musique, j’ai souvenir du « Loveless love » de Fats Waller (3'09") au « pipe-organ », et spécialement de quelques secondes merveilleuses qui l’illuminent de leur éclat).
 Voilà : quand on se met à fouiner du côté des préférences, on devient impitoyable. Ainsi, ce n’est pas que le Persian surgery dervishes (91’30 ") de Terry Riley me rebute, mais la version qu’il a donnée de son In C à l’occasion du 25ème anniversaire de sa création (1995, 76’20") le surpasse de son charme renouvelé à chaque nouvelle audition. Il faut attendre quelques secondes, après la fin du morceau, la manifestation d'enthousiasme de la trentaine de musiciens embarqués dans l'événement : ils ovationnent l'auteur !
Voilà : quand on se met à fouiner du côté des préférences, on devient impitoyable. Ainsi, ce n’est pas que le Persian surgery dervishes (91’30 ") de Terry Riley me rebute, mais la version qu’il a donnée de son In C à l’occasion du 25ème anniversaire de sa création (1995, 76’20") le surpasse de son charme renouvelé à chaque nouvelle audition. Il faut attendre quelques secondes, après la fin du morceau, la manifestation d'enthousiasme de la trentaine de musiciens embarqués dans l'événement : ils ovationnent l'auteur !
C’est la même chose avec les Sequenze de Luciano Berio : je me demande ce qui lui a pris d’aller s’embêter avec ça, quand Sinfonia (la première version, celle avec les Swingle Singers (1968), qui m’avait emballé à l’époque) reste infiniment plus fort et d’inspiration plus vaste, à cause, entre autres, de la référence à la 2ème symphonie de Gustav Mahler (« Résurrection », dans la version Bruno Walter si possible).
lui a pris d’aller s’embêter avec ça, quand Sinfonia (la première version, celle avec les Swingle Singers (1968), qui m’avait emballé à l’époque) reste infiniment plus fort et d’inspiration plus vaste, à cause, entre autres, de la référence à la 2ème symphonie de Gustav Mahler (« Résurrection », dans la version Bruno Walter si possible).
 Ainsi en va-t-il de tous les sons musicaux qui surnagent après le naufrage de la frénésie vorace qui m’a longtemps jeté sur tout ce qui était nouveau. D’Olivier Greif, par exemple, je garde le Quatuor n°3, sans doute à cause du poème Todesfuge de Paul Celan, qui lui donne son titre, et le cri poignant de la référence au Cantique des cantiques : « tes cheveux d’or Margarete / tes cheveux de cendre Sulamith ». La musique d’Olivier Greif est savante, mais va droit au cœur : toujours la simplicité des manières. Une forme aristocratique d’humilité.
Ainsi en va-t-il de tous les sons musicaux qui surnagent après le naufrage de la frénésie vorace qui m’a longtemps jeté sur tout ce qui était nouveau. D’Olivier Greif, par exemple, je garde le Quatuor n°3, sans doute à cause du poème Todesfuge de Paul Celan, qui lui donne son titre, et le cri poignant de la référence au Cantique des cantiques : « tes cheveux d’or Margarete / tes cheveux de cendre Sulamith ». La musique d’Olivier Greif est savante, mais va droit au cœur : toujours la simplicité des manières. Une forme aristocratique d’humilité.
L’auditeur devrait toujours se poser la question : « Est-ce qu’on me parle, à moi, personnellement ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : combien de justes à sodome, musique contemporaine, olivier messiaen, poèmes pour mi, bela bartok, le château de barbe-bleue, dimitri chostakovitch, beethoven, christus am ölberg, johnny halliday, docteur faustroll, alfred jarry, pataphysique, gestes et opinions du docteur faustroll, rabelais, heavy metal, vingt regards sur l'enfant jésus, michel béroff, roger muraro, pierre-laurent aimard, yvonne loriod, quatuor vegh, quatuor borodine, quatuor fitzwilliam, fats waller, loveless love, terry riley, persian surgery dervishes, terry riley in c, luciano berio sequenze, luciano berio sinfonia, olivier greif, greif todesfuge, paul celan todesfuge, cantique des cantiques, art contemporain
mercredi, 03 octobre 2012
ANIMAUX DES MONUMENTS AUX MORTS
Résumé : j’ai commencé à évoquer, en même temps que le passage de la guerre artisanale, éventuellement chevaleresque, à la guerre industrielle, la disparition programmée des animaux des paysages de champs de bataille, comme le montre la quasi-absence des bêtes dans les monuments aux morts.
Cette guerre-là, donc, est encore artisanale. A propos des hommes, certains parleront volontiers des derniers « chevaliers du ciel », même si le seul point commun (et encore) avec la chevalerie est le duel que se livrent deux hommes. Je ne tomberai pas dans le ton épique et parfois grandiloquent et suranné qui est celui de René Chambe, quand il évoque dans ses livres tel ou tel épisode guerrier dont il fut témoin ou auquel il a lui-même participé. Notre époque fatiguée, où l’esprit baigne dans un bouillon où se diluent inexorablement les nations européennes, est totalement impropre et imperméable à l’idée de grandeur.
Ajoutons toutefois, pour rendre les honneurs militaires à ses mânes éminemment respectables, que ces duels étaient teintés d’élégance morale, de loyauté et de courtoisie. Je retiens aussi, pour mon compte, l’artisanat instinctif du chasseur qui guette sa proie, espérant que son œil et son doigt feront la différence.
Car la carabine, disons-le, est très tôt renvoyée à ses chères études par plus fort qu’elle : la mitrailleuse. Roland Garros a l’idée du premier bricolage (des plaques de métal sur les pales de l’hélice). L’Allemand Fokker l’améliore en concevant tout un mécanisme pour synchroniser l’hélice et la mitrailleuse. Bref, on n’arrête pas ce progrès-là, même si ce qui se passe au sol a quelque chose à voir avec un insondable « régrès ».
Si Georges Brassens, sur le mode léger (en apparence), peut chanter : « Moi mon colon, celle que j’ préfère, c’est la guerre de 14-18 », c’est qu’elle est, d’une certaine manière, entièrement nouvelle. Pour la première fois, la population masculine dans son ensemble est considérée par les chefs politiques et militaires comme un énorme réservoir de matière vivante dans lequel il suffit de puiser. L’historien britannique Eric Hobsbawm ne fait pas démarrer par hasard son histoire du « court XX° siècle » en 1914, année qui marque le début de la course à l’arme atomique. Cette guerre a amené la technique et l'industrie au pouvoir.
Le rouleau compresseur de la folie guerrière et fratricide lamine les hommes : il y a environ 40.000.000 de Français en 1914, dont la moitié approximative de sexe masculin, à laquelle il faut ôter au moins 1.712.000 morts (8,5 % des mâles), sans compter 4.000.000 de blessés (20 % des mâles) et invalides. On peut presque dire qu’un tiers de tous les hommes de ce pays ont été soit éliminés, soit marqués à vie dans leur tête et dans leur chair.
J’en arrive aux animaux : la première guerre mondiale constitue le point final (ou peu s’en faut) de leur présence sur les champs de bataille, de leur utilisation comme auxiliaires de guerre. A cet égard, il est frappant de constater leur absence pour ainsi dire complète du champ des monuments aux morts : j’en ai à ce jour recensé 14 (il y a 36.000 « monumorts » en France). Autant dire RIEN : ils ont été purement et simplement évincés du paysage.
Les quelques exceptions que je présente comportent d’ailleurs une bizarrerie : sur les 14 monuments, 6 portent des lions (si !). J’en tire quant à moi une conclusion qui ne vaut que ce qu’elle vaut : l’animal est devenu inutile, comme il le deviendra quelque temps après dans les travaux des champs, dans les transports,… La guerre de 1914-1918 est une guerre mécanique, comme le montre la naissance du char d’assaut, qui apparaît pour la première fois le 15 septembre 1916. Face au Monstre mécanique (François Jarrige, éditions imho, 2009), l’homme n’est plus rien.
Hommage soit donc ici rendu aux quelques rares bêtes parvenues jusqu’à nous dans les monuments aux morts. J’éviterai de mentionner le coq, trop tarte à la crème patriotique, surtout quand il est présenté en train de terrasser l’aigle impériale. J’ai montré dans mon billet précédent (et ci-dessus) deux monuments impressionnants, comportant des chevaux. On trouve aussi le chien.
Dommage que l'animal soit le grand oublié des monuments aux morts. Mais certainement révélateur. Et sans doute prémonitoire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, littérature, faustroll, gestes et opinions du docteur faustroll, pataphysique, monuments aux morts, guerre 14-18, rené chambe, roland garros, fokker, france, nation, patrie, georges brassens, éric hobsbawm, françois jarrige, face qu monstre mécanique

