mercredi, 17 juin 2015
KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE
 Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,
Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.
Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.
C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.
Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.
Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.
Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.
L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).
Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.
Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.
Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.
Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.
Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.
C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.
L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.
D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».
Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.
Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.
Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.
Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe
dimanche, 14 juin 2015
HONORÉ SOIT DEBUSSY 3
Eh oui, il y a un supplément.
C'est que j'ai eu la surprise de trouver dans Le Monde daté "dimanche 14-lundi 15 juin 2015" le compte rendu qu'a fait Marie-Aude Roux, la chroniqueuse musicale du journal, du spectacle donné en ce moment à l'opéra de Lyon : Pelléas et Mélisande, de Maeterlinck et Debussy.

Je n’irai donc pas voir cette version de Pelléas et Mélisande. On l’avait compris, je pense : j’ai décidé de ne plus être utilisé comme cobaye par des expérimentateurs foutraques qui s’acharnent à produire de l’OGM culturel sur les scènes d’opéra, qui n'attend que son José Bové pour être fauché. Le boycott est peut-être moralement condamnable, mais il arrive qu'il soit une nécessité. Le Pelléas et Mélisande de Christophe Honoré est dans ce cas.
Le rapport entre ce que voit et ce qu'entend le spectateur d'opéra, autrement dit le plaisir qu'il en tirera, relève de la même alchimie qui fait qu'une chanson s'inscrira comme par magie dans les mémoires (Douce France, de Trénet, Les copains d'abord, de Brassens, ...), ou au contraire n'arrivera pas à y planter le plus petit bout de racine.
Pareil à l'opéra : pour atteindre le point d'équilibre entre la mise en musique et la mise en image, aucune recette. Cela tient du miracle. Il va de soi que la mise en scène peut vous gâcher la fête (il m'est arrivé plusieurs fois de partir avant la fin). Mais aussi qu'une mauvaise exécution musicale ne rattrapera jamais les qualités d'une mise en scène réussie. Prima la musica : qu'on le veuille ou non, le metteur en scène devrait se préoccuper avant tout de ne pas nuire.
La chroniqueuse du Monde, qui a assisté au spectacle, se tire de ce guêpier d’une façon on ne peut plus ambiguë. Sans oser l’ironie franche, elle laisse entendre qu’elle a pris quelque plaisir à ce flingage en règle de la machine théatro-musicale mise au point par les auteurs (Debussy-Maeterlinck, prononcer Mâter). J'ai l'impression que ce plaisir est à chercher dans l'exécution musicale. Car le commentaire de la mise en scène est, pour le moins, mi-pique-mi-lame.
Disons-le : Marie-Aude Roux, même si elle y voit « une beauté singulière », ne goûte guère les fumisteries dont Christophe Honoré a pensé que le chef d’œuvre avait d’urgence besoin pour prendre un sens tout à fait « actuel ». C’est étrange, si l’on y réfléchit, cette frénésie de replacer dans notre actualité faisandée les œuvres du passé, même le plus lointain, même le plus improbable (comme est Pelléas). J’attends monsieur Christophe Honoré dans une adaptation post-industrielle, voire post-atomique, des Perses d’Eschyle. Je suis curieux de voir ce que ça donnerait.
Golaud est devenu un « patron mafieux ». Mélisande ne mourra pas dans son lit, d’un mal mystérieux, mais « noyée pierres dans les poches dans une mer létale ». Marie-Aude Roux parle d’une « partie de jambes en l’air » (voir photo avant-hier), en lieu et place de la scène de la tour (vous savez, « mes longs cheveux descendent jusqu’au seuil de la tour … »). Le vieil Arkel devient « un grelottant Arkel parkinsonien » à tendance pédophile. L’enfant Yniold devient un adolescent « encapuchonné » qui se coiffe d’une des perruques (!) de Mélisande et qui aguiche le grand-père Arkel, mais « esquive » ses « caresses incestueuses ». Je dis : très fort, Christophe Honoré, pour voir tout ça en filigrane dans le livret de Maeterlinck.
Pour résumer le travail de Christophe Honoré, M.-A. Roux écrit : « Christophe Honoré a balayé le monde symboliste de Maeterlinck pour un no man’s land peuplé de fantasmes. La voûte des étoiles ne tombera pas sur les amants extasiés au moment suprême du baiser, mais dans la mort ouverte par le fer de Golaud au flanc sacrificiel de Pelléas ». Je laisse à la rédactrice la responsabilité de sa prose fleurie et chantournée. Mais je note qu'elle évite de formuler un jugement explicite.
Il reste, à la fin des fins, que, de ce drame perdu dans un espace et un temps aussi vagues que ceux des contes de fées, un metteur en scène capricieux a cru bon de faire un drame « d’enfants terribles et pervers au fin fond de ce qui pourrait être l’ex-Yougoslavie … ». Pourquoi pas ? Ça ou autre chose, de toute façon …
N’importe quoi pourvu que ça fasse de la mousse.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : puisqu'on en est à causer musique, je signale, quoique dans un tout autre genre, toujours dans Le Monde, mais daté du 13 juin, le somptueux hommage, plein d'humanité, rendu sur une page entière par Francis Marmande à Ornette Coleman, mort le 11 juin.

Je n'oublierai jamais, pour mon compte personnel, l'effet qu'avait produit à mes oreilles, il y a bien longtemps, l'écoute du premier morceau de Change of the century, Ramblin' (cliquez pour 6'38"), pour l'étourdissant duo de son saxophone avec la trompette de poche de Don Cherry.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, opéra de lyon, debussy, pelléas et mélisande, maurice maeterlinck, claude debussy, journal le monde, christophe honoré, metteur en scène, mise en scène opéra, ogm, josé bové, charles trenet, douce france, georges brassens, les copains d'abord, prima la musica, marie-aude roux, eschyle les perses, pellés, mélisande, golaud, arkel, yniold, ornette coleman, francis marmande, don cherry, change of the century, ramblin
samedi, 13 juin 2015
HONORÉ SOIT DEBUSSY 2
Résumé : je disais que le metteur en scène d'opéra semble n'avoir rien de plus pressé que de manquer de respect aux œuvres. Plus l'agression est « transgressive » ; plus le public est violé avec aplomb ; plus les connaisseurs s'interrogent sur la signification, et plus le metteur en scène jouit de la plénitude de son pouvoir. Je ne sais plus quel chef d'orchestre, trouvant la mise en scène par trop injurieuse pour le bon sens, avait abandonné les organisateurs à leur triste sort : voilà une attitude digne. Il faudrait apprendre à ces messieurs les metteurs en scène un minimum de modestie. Mais l'humilité n'est la qualité que de trop rares exceptions.
2/2
Le monsieur qui "met en scène" fait le plus souvent le docte, le cuistre, le pédant. Son métier est de sinistrer les lieux où il passe, comme Attila. Plus il « dérange », plus il « surprend » le spectateur dans son « confort », plus il est content. Il se plaît à « briser les tabous ». La mode est à provoquer, à jeter le trouble, à inquiéter, à faire « bouger les lignes ». Ce qui a déjà été fait est à jeter à la poubelle. Le mot d'ordre général prend au pied de la lettre l'injonction de Baudelaire au dernier vers des Fleurs du Mal : « Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! ». Traduction en novlangue béotienne : n'importe quoi, pourvu que ça n'ait jamais été fait.
Il y a bien de l’arrogance dans cette façon pour le metteur en scène d’entrer par effraction dans l’univers d’une œuvre pour, a-t-il le front d'oser soutenir, en révéler les contenus potentiels, inaperçus jusqu'à son arrivée, et d’interposer entre cette oeuvre et le spectateur l’écran de la révélation (?) qu’elle a constituée, prétend-il, pour lui.
Il ne se rend pas compte que quand ça devient systématique, (la nudité sur scène, ou toute autre « transgression », jusqu'à l'ithyphallique, à l'urinaire et au fécal), cela devient un académisme, un conformisme d’un nouveau genre. A quelle audace transgressive faudra-t-il hisser la prochaine mise en scène pour briser le stéréotype nouvellement inventé ?
Ces propos acrimonieux m’ont été suggérés par le triste sort qui attend le Pelléas et Mélisande de Debussy, à l’opéra de Lyon du 8 au 22 juin, si j’en crois les propos de Christophe Honoré, metteur en scène. Je m’attends au pire, quand j’observe la photo retenue pour illustrer l’article paru dans la presse locale (Le Progrès, dimanche 7 juin).

Message du metteur en scène : "Faisons descendre les chefs d'œuvre de leur Olympe pour les réduire à notre dimension".
Honoré est très net : « Je fais le choix de l’expressivité, d’une certaine brutalité, dans une esthétique contemporaine. (…) J’installe l’action dans une sorte de friche industrielle, avec des ateliers désertés par les ouvriers, la misère qui rode [sic]. Au milieu, une grande famille bourgeoise ruinée, comme ces dynasties du textile ou de l’acier qui vivent dans le souvenir de leur âge d’or ». Ma foi, ça ou autre chose, après tout … Je me demande quand même, dans ce paysage industriel sinistré, ce qu’il a prévu de faire faire à Golaud, au tout début, qui est censé s'être perdu dans l’immense forêt, à la poursuite d’une bête qu’il a blessée, puis qui rencontre Mélisande. Y aura-t-il une fontaine obscure et profonde au fond de laquelle brille l’or ?
Ces questions n’effleurent pas, apparemment, le metteur en scène : « Je veux éclairer leurs désirs, non les sous-entendus de leurs sentiments ». Je cherche à comprendre la nuance. Christophe Honoré veut, voilà tout. L’idée ne l’effleure pas de mettre son savoir-faire, peut-être son talent, au service de l’œuvre de Debussy. C’est tout simple : il applique le slogan en vigueur de nos jours : « Je fais ce que je veux, na ! ».
Dans la même veine, quoique dans un autre domaine, j’entendais l’autre soir deux éminents niaiseux du Masque et la plume (Patricia Martin, Arnaud Viviant) tresser des couronnes de laurier à la dernière parution d’un certain Jean Teulé, Héloïse, ouïlle !, qui rebâtit à sa façon, si possible pornographique, la fameuse histoire d’Héloïse et Abélard (on comprend bien sûr le « ouille » du titre, quelle marrade, les poteaux !). L'injure est du même ordre.
Jean-Louis Ezine était le seul à partir en guerre contre cette réécriture obscène. Il vit encore dans l'ancien monde, où il arrivait que les hommes résistassent à la veulerie invasive. Voilà donc tout ce qu’un auteur à succès (il paraît qu’il en a, faut-il que les lecteurs soient devenus « des esprits errants et sans patrie ») est capable de tirer d’un chef d’œuvre de notre littérature : une turlupinade. Ezine n’a rien compris à l’époque : il faut briser les tabous, transgresser, se fendre la pipe. Ora pro nobis, euh non : priez porno.
Retour à Pelléas. Olivier Messiaen s’est vu offrir, par Jean de Gibon, quand il avait dix ans (en 1918, donc), une partition chant-piano de l’œuvre de Debussy. Quelque temps après, il était capable de la réciter par cœur dans les moindres détails. Pelléas et Mélisande a toujours constitué pour Messiaen une œuvre fondatrice.
Ce n'étaient pas ses débuts : « On venait de m'acheter des extraits de l' "Orphée" de Gluck, et je regardais le thème en fa majeur du grand air d'Orphée au premier acte, qui est probablement la plus belle phrase que Gluck ait écrite, quand je me suis aperçu que je "l'entendais". Donc j'avais l'audition intérieure - et je ne faisais de la musique que depuis quelques mois » (cité dans l'impeccable biographie de Peter Hill et Nigel Simeone, Fayard, 2008, p. 25). Il raconte aussi qu'étant enfant, il jouait pour son frère (par cœur) les pièces de Shakespeare en tenant tous les rôles.
Je me demande ce qu’il penserait des propos et des intentions de monsieur Christophe Honoré, metteur-hélas-en-scène de ce qui fut à ses yeux le chef d'œuvre absolu.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, opéra, lyon, opéra de lyon, christophe honoré, pelléas et mélisande, metteur en scène, philippe beaussant, la malscène, claude debussy, golaud, le masque et la plume, patricia martin, arnaud viviant, jean teulé, héloïse ouïlle, héloïse et abélard, jean-louis ézine, olivier messiaen, peter hill, éditions fayard, journal le progrès, baudelaire, les fleurs du mal, baudelaire le voyage
vendredi, 12 juin 2015
HONORÉ SOIT DEBUSSY 1
1/2
Parmi les risques que la « société moderne » fait courir aux hommes, il en est un, non négligeable, encouru spécialement par l’amateur de musique en général, d’opéra en particulier. Il faut accepter de vivre dangereusement. Ce risque s'appelle « le metteur en scène ».
Bien que le si distingué Renaud Machart, dans un article de 2008 (mercredi 27 août) pour Le Monde, montre son dédain pour l’idée (« …on ne compte plus les articles ayant dénoncé la "dictature" présumée du metteur en scène. »), il faut bien dire que les exemples ne manquent pas de spectacles bousillés, massacrés, assassinés par le décret d’un homme à qui on a donné le pouvoir de tenir sur l’œuvre représentée un discours où il peut enfin lâcher la bride à ses lubies les plus invraisemblables.
Banalité de dire que l'opéra est un spectacle total, et que la jouissance du spectateur découle (ou non) du rapport entre ce qu'il voit et de qu'il entend. Qu'en advient-il quand, par exemple, dans Carmen, il voit, au lieu de la fabrique de cigare et de la caserne des dragons (d'Alcala) attendues, d'un côté un bordel, de l'autre un commissariat de police ? Eh bien c'est simple, il se demande si le concepteur n'a pas « le couvercle de la lessiveuse complètement fêlé ». Il voudrait suggérer que Carmen est moins une femme éprise de liberté qu'une simple pute qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Avis aux féministes.

Maurice Tillieux, Libellule s'évade.
De gauche à droite : Libellule, Gil Jourdan, Inspecteur Crouton.
Renaud Machart, dans son article, envoie bouler d'une pichenette condescendante le livre de Philippe Beaussant (qualifié de "pamphlet", ce qu'il est à moitié), La Malscène (2005), qui s'en prend à la toute-puissance capricieuse du M.E.S. dans les maisons d'opéra. C'est vrai que le bouquin n'est pas très bon, et n'évite pas balourdises et truismes. Certes, l'auteur dit sa colère, mais il ne va pas au bout de son ire : « Je ne citerai aucun nom : ni de metteurs en scène, ni d'interprètes, ni de chefs d'orchestre » (p. 20). Pusillanimité tout à fait regrettable, derrière le paravent d'un prétexte fallacieux (l'ennui). Il n'empêche que c'est un vrai sujet (de mécontentement).
Je veux bien que monsieur M.E.S. se soit fait sa petite idée sur la signification profonde du Chevalier à la rose, mais pourquoi met-il une mitraillette dans les mains d’un des chanteurs au troisième acte ? Et dans Cosi fan tutte, est-il bien nécessaire, au lever de rideau, cet immense bar américain, avec ses tabourets surélevés ? Et Dorabella et Fiordiligi en mini-bikinis, sur une plage, accrochées à leur téléphone portable ? Et l’Austin-Healey poussée sur la scène à je ne sais plus quel moment ?
Le si prudent Philippe Beaussant évoque quelques cas particulièrement gratinés : « Hercule en treillis », Jules César « entouré de SS en casaque noire », Orphée (de Gluck) « costumé en clown, avec sa balle rouge sur le nez et les sourcils circonflexes », Siegfried « en salopette sur un terrain vague, devant sa caravane crasseuse, son fauteuil au bras cassé et sa bassine sale », Don Giovanni sautant Donna Anna à en faire péter les ressorts du sommier (contresens, puisque, selon la dame elle-même, le violeur potentiel n'a pas "consommé", au très grand soulagement de Don Ottavio : « Ohimé, respiro »). Beaussant est peut-être en colère, mais qu'est-ce qu'il est gentil ! Ou alors il a mis du bromure dans sa testostérone ! J'ai envie de crier : vas-y ! ose ! des noms ! des noms !
Il parle pourtant très juste : « On me dépouille de ce que j'aime. On me le casse. Non seulement on me le vole (Orfeo, c'est à moi, Les Noces, c'est à moi, c'est à moi, Pelléas, c'est à moi ; exactement comme c'est à chacun de vous), mais sous mes yeux on le disloque, exprès ; on l'abîme, pour me faire mal ». Il se laisse pourtant déposséder sans se venger : quelle grandeur d'âme ! Vrai seigneur ou bien, plus simplement, gros matou qui s'est châtré les griffes (comme un Don Ottavio de la critique) ?
Vous dites ? C’est de l’ « actualisation » ? De la « modernisation » ? Il faut « dépoussiérer » ? Ah bon. S’il faut actualiser … Moi j’appellerais plutôt ça la prétention de quelqu’un qui « tient un discours », voire qui prêche son prône du haut de sa chaire, sur une œuvre si possible célébrissime, sur laquelle il a tout loisir de poser enfin sa patte et pouvoir dire ce que cette œuvre lui suggère, sans se demander, d’une part, ce qu’elle porte en elle-même et, d’autre part, si son imaginaire ne va pas à l’encontre du mien. Qu'il me l'impose, cela devient du sadisme.
Mais voilà : je ne suis pas masochiste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe honoré, mise en scène opéra, metteur en scène, renaud machart, journal le monde, opéra, pelléas et mélisande, debussy, carmen bizet, dragons d'alcala, bande dessinée, gil jourdan, maurice tillieux, inspecteur crouton, philippe beaussant, la malscène, le chevalier à la rose, cosi fan tutte, richard strauss, mozart, dorabella fiordiligi, jules césar, orphée gluck, don giovanni, donna anna, opéra de lyon, musique
mercredi, 03 juin 2015
UN COUP DE CHAPEAU
Aujourd’hui, cessons un moment de « faire suer le burn-out ». Offrons-nous un moment de détente, avec Aristide Bruant. (cliquez pour entendre). Je trouve cette chanson délicieusement cynique.
1.
Hier, c'était l'enterrement
De ma pauvre belle-maman.
Un' femm' qu'avait tout's les vertus;
Hélas, nous ne la reverrons plus !
Comm' ell' avait plus d'soixant' ans,
On attendait ça d'puis longtemps;
L'matin, on est v'nu la chercher
Et puis en rout', fouette cocher !…
Le vent soufflait je ne sais d'où,
Trou la la itou (bis);
Le soleil dorait l'horizon
Et zon, zon, zon.
Nous marchions d'un air décidé,
Gai, gai, gai la rira don dé
Et nous marchions tous comm' ça.
Larifla, fla, fla.
2.
 Près de moi dans les premiers rangs
Près de moi dans les premiers rangs
S'avançaient les proches parents;
Sous la douleur se laissant choir
Et pleurant tous dans leurs mouchoirs.
Soudain, l'un d'eux s'approche de moi
Et me dit d'un ton plein d'émoi :
« Vraiment, du ciel nous sommes maudits ! »
Tout en pleurant, j'lui répondis :
« Oui, monsieur, je suis comme un fou.
Trou la la itou (bis);
Ça fait un vide à la maison
Et zon, zon, zon.
De pleurs je suis tout inondé,
Gai, gai, gai la rira don dé. »
Et nous pleurions tous comm' ça.
Larifla, fla, fla.
3.
Il commençait à se faire tard
Quand t'nous arrivâmes à Clamart
Nous entrions quéque temps après
Dans un jardin planté de cyprès.
Les hommes pleuraient en sanglotant,
Les femmes sanglotaient en pleurant.
Gendres, neveux, cousins, p'tits-fils
Entonnaient le De Profondis.
Comme on la descendait dans le
Trou la la itou (bis);
Chacun disait une oraison
Et zon, zon, zon.
En criant comme un possédé,
Gai, gai, gai la rira don dé;
Et nous chantions tous comm' ça.
Larifla, fla, fla.
 4.
4.
A la sortie, v'là qu'les parents
Prennent d'assaut les restaurants,
Pour se consoler un p'tit brin,
On fit v'nir cinquant' litr's de vin.
Quand t'les cinquant'litres fur'nt bus,
On en fit rev'nir encore plus.
Si bien qu'au moment d'se quitter,
I y avait pus moyen d's'acquitter.
Tout le monde avait bu comme un
Trou la la itou (bis);
On avait son petit pompon
Et zon, zon, zon.
Quand t'votr' crampon s'ra décédé,
Gai, gai, gai la rira don dé;
Faudra l'enterrer comm' ça,
Larifla, fla, fla.
Note : Tous les zoziaux appartiennent évidemment à la famille, plus nombreuse qu'on ne croit, des « bruants » : « jaune », « fou », « zizi » et « des roseaux ». Et en prime, le sapeur Camember est heureux de vous chanter sa romance : « Petits voiseaux ».

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, aristide bruant, bruant jaune, bruant zizi, bruant fou, bruant des roseaux, bande dessinée, humour, christopohe, georges colomb, sapeur camember, ornithologie
jeudi, 28 mai 2015
POUR TEDI PAPAVRAMI 1
1/2
 Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.
Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.
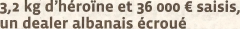
Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).
Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).
Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.
Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.
Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.
J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.
Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.
L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.
Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.
Des privilégiés, somme toute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella
samedi, 25 avril 2015
LA FÉMINISATION DANS LA MUSIQUE
Je ne connais pas Eric Zemmour. Le peu de fois que je l’ai entendu parler, il m’a plutôt agacé. Je l’ai écouté, entre autres, dans un « Répliques » d’Alain Finkielkraut, faire un historique assez acrobatique, celui qui l’amène à intituler son bouquin, en bout de course, Le Suicide français (que je n'ai ni lu ni l'intention de lire). Je n’ai pas été trop convaincu par l'acrobatie, même si je tire une conclusion assez proche de la formule du titre.
Il aborde aussi dans son livre, paraît-il, la question du processus de féminisation en cours qu’on peut observer en France depuis la sortie de la guerre, et plus généralement dans les pays occidentaux. Alors là j’approuve. J’abonde même avec force. J'applaudis d'une main contre l'autre.
Déjà qu’on savait que les poissons mâles du Potomac (E.-U.) changent de sexe sous l’effet de quelques merveilles chimiques qui agissent sur le système endocrinien ; que la fertilité des hommes (concentration de spermatozoïdes dans le sperme) a notablement diminué au cours des trente dernières années (dévirilisation probablement due aux phtalates ou autres « perturbateurs endocriniens », mais les « marchands de doute » (Oreskes & Conway, voir ici même, 26-27 février) proclament l’absence de preuves scientifiques formelles).
Parallèlement à cette évolution biologique, dans la « sphère culturelle » cette fois, on a commencé à vanter les « papas-poules », en même temps que les femmes se convertissaient massivement au pantalon, au « droit au travail » et au « partage des tâches ». C’est devenu le modèle dominant, sous la pression des exigences d’ « égalité », de « parité » et de « non-discrimination ». Ce n’est pas mon sujet, même s’il y aurait des choses à dire (de quoi n’y a-t-il pas « quelque chose à dire » ?).
Mon sujet ? La féminisation dans la musique. Je laisse à Eric Zemmour l'attaque contre les voix de crevards de certains chanteurs de variétés (Michel Berger, il paraît). Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène qui touche la musique dite « classique » depuis la sortie de la guerre, et en particulier les voix masculines. La voie a été ouverte principalement par le regain d’intérêt pour la musique "baroque", étiquette commode sous laquelle on classe toutes sortes de musiques de cour, d’église et de salon d’avant 1750. Après la redécouverte du clavecin, avec Wanda Landowska, on a redécouvert la tessiture de contreténor.
On peut croire que ce regain d'intérêt n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu Alfred Deller. Car le registre de contreténor s’est subitement et superbement incarné dans la voix de ce chanteur qui a marqué toute son époque. Il est vrai que le succès d’Alfred Deller ne se comprendrait pas si sa voix n’avait pas répondu à une attente, jusqu’alors virtuelle et en filigrane dans l’époque. Il fut le grand inaugurateur, longtemps un cas unique. La renommée qui est encore la sienne signifie simplement, en quelque sorte, que l'époque était mûre.
Aujourd’hui, le contreténor a proliféré comme le lapin avant la myxomatose. Qu’il faille dire « voix de fausset », « haute-contre », « sopraniste », « contreténor », je m’en contre-fiche (pardon). Peter Eötvös a écrit tout un opéra à partir de la pièce de Tchekov Les Trois sœurs, où ce sont autant de mecs qui chantent les frangines en question. J'ai vu ça, dans le temps. Oui, bon.
La diva (insupportable comme toutes les divas) qui règne actuellement en la matière s’appelle Philippe Jaroussky : c’est simple, on le voit partout, il va même jusqu'à pousser la chansonnette. Si j’ose dire et sans vouloir froisser personne, le contreténor aujourd’hui a le vent en poupe : je veux dire que la tessiture la plus féminine de la voix masculine est devenue une composante "normale" du paysage sonore. Elle a un succès fou, et l'on entend quotidiennement des hommes chanter avec des voix de femme. Je vais vous dire : ça en devient lassant. Question de génération, peut-être.
Quand ils étaient peu nombreux, j’arrivais à mémoriser les noms et à reconnaître les voix, j’allais même jusqu’à apprécier : Henri Ledroit, René Jacobs (vu en pythonisse dans David et Jonathas de Charpentier), Gérard Lesnes, Paul Esswood, Dominique Visse (fondateur - dont il faut supporter la voix perçante - de l'ensemble Clément Janequin), James Bowman, Michael Chance. C’était encore vivable. Le problème, c'est que, désormais, des contreténors, il en tombe comme à Gravelotte. Comme s'il en pleuvait. C’est devenu envahissant, comme si un nouveau stéréotype s’était durablement installé : le contreténor, c'est beau. Trop, c’est trop. A chaque coin des avenues musicales, on se heurte à un contreténor (la musique rock s'y est mise il y a déjà un moment).
Cela tient peut-être aussi à la mode du baroque, à la marotte presque maniaque des « instruments anciens », à la recherche de « l'authenticité d'époque », aux résurrections fourmillantes de vieilles partitions de compositeurs dont le nom finisse si possible en « i », enfouies dans des bibliothèques poussiéreuses.
C'est à qui déterrera le plus beau cadavre. Musicologues et musiciens s’acharnent à « redécouvrir » des compositeurs jusque-là totalement sortis des mémoires et des répertoires. J'observe que la manie de la reconstitution ne pousse pas les contreténors actuels à faire le sacrifice des attributs qu'on enlevait aux futurs castrats avant que leur voix ne muât.
C'est peut-être que les musiciens et musicologues sont avides de se faire un nom et une place sur ce créneau maintenant fort encombré. Il faut que tout le monde trouve du boulot, c’est vrai. Je n’ai rien contre la musique baroque. Bien au contraire, j'en écoute toujours autant. Mais je ne crois pas qu'il faille absolument « sortir de l’oubli » à tout prix l'intégralité du catalogue des œuvres écrites avant 1750 : beaucoup ont amplement mérité qu’on les oublie. L'exhumation devrait être encadrée par des lois sévères.
C’est pareil à toutes les époques. On ne m’ôtera pas de l’idée que Félicien David est un compositeur estimable, mais qu'il ne mérite pas le même nombre de pages dans les dictionnaires des musiciens que Hector Berlioz, même si Le Désert (du premier, avec une incroyable performance du ténor, dans le rôle du muezzin appelant à la prière) est plus intéressant que le Chant du chemin de fer (du second). Pourtant, qui a retenu le nom de Félicien David, dont Berlioz en personne vantait pourtant le génie, en 1844, après la première du Désert ?
Pour l’âge baroque, c’est la même chose, avec cette circonstance aggravante que c’est de la musique d’Ancien Régime, je veux dire séparée de nous par un abîme sans fond (la Révolution et quelques autres menues circonstances historiques) : c’est sûrement agréable à l’oreille, mais c’est définitivement hors de notre portée. Inatteignable autrement qu'après un énorme travail de rat de bibliothèque, un énorme effort de reconstitution historique. Tout ça est laborieux, et finalement factice. Comment peut-on sans pouffer entendre prononcer le français « à l’ancienne » ?
Nous n’avons plus les codes sociaux dans lesquels s’inscrivait cette musique : elle nous échappe, quoi que nous fassions. Je crois intensément qu’en matière d’art, le temps ne laisse surnager que la crème de la crème. Combien de sommets bas, avant d'arriver au Mont Blanc ? Combien de « Petits Maîtres », avant d'apercevoir un Génie ?Faut-il coûte que coûte amener au jour la partie immergée de l'iceberg ? Je ne suis pas du tout amateur de reconstitution du passé. La recherche patrimoniale a des limites.
Ceux qui aiment refaire Austerlitz en costume à date fixe me font marrer, et les habitants d'Autun, les figurants et acteurs du Puy-du-Fou (et autres lieux) me font pitié quand je vois les photos de leurs fêtes du moyen âge ou de la chouannerie. Je déteste les romans historiques. J’avais détesté le film Pelle le conquérant, de je ne sais plus quel cinéaste nordique.
On va dire que je « stigmatise », mais cette vogue d’hommes chantant comme des femmes, et peut-être d'hommes qui se prennent pour des femmes, n'est pas bon signe. Ça me fait penser à une autre banalisation : celle de l’homosexualité, dont on peut dire qu’elle aussi a envahi le paysage, avec toutes sortes de propagandistes de la « cause ».
L'homosexualité est désormais un marché florissant, parfois célébrée comme une norme à part entière, en concurrence avec celle qui définit les gens normaux. Gloire désormais à l’ambiguïté, à l’effacement des frontières entre les sexes, à la liquéfaction de la notion de norme. Ce n’est pas pour rien, j’imagine, qu’on fait tout un ramdam en ce moment autour de la peinture du Caravage, l'artiste au pinceau gras (ne pas confondre avec Rubens ou Jordaens, peintres du gras), parfois visqueux.
On me dit qu’il faut être « moderne ». Pour une fois, je dirai comme ce prince des modernes parmi les modernes, hélas "sémiologue" à ses heures, Roland Barthes : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne » (épigraphe d’un chapitre d’Extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq).
Pour une fois, je ne lui donne pas tort : que nous importe la modernité ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, éric zemmour, alain finkielkraut, émission répliques, le suicide français, france, société, féminisation, nomi oreskes et erik conway, états-unis, poissons potomac, les marchands de doute, wanda landowska, contreténor, alfred deller, voix de fausset, haute-contre, sopraniste, peter eötvös, opéra les trois soeurs, philippe jaroussky, david et jonathas, marc-antoine charpentier, gérard lesnes, paul esswood, dominique visse, ensemble clément janequin, james bowman, michael chance, musique baroque, musique classique, félicien david le désert, hector berlioz, michel houellebecq, extension du domaine de la lutte
mercredi, 04 mars 2015
MORT DE LA MÉLODIE
5
Car disons-le : c’est la musique qui est faite pour l’oreille, et pas l’inverse. L'oreille, elle est faite pour saisir les bruits du monde, les voix des hommes, le chant du merle au printemps juste avant le lever du jour. Quand quelqu'un juge assez satisfaisante pour autrui la suite de sons qu'il vient d'inventer, alors oui, il les fait entendre à bon droit à ses semblables. C'est en vue de leur procurer un plaisir.
De quel droit les compositeurs de musiques d'avant-garde maltraitent-ils l'oreille des gens ordinaires ? Car la mélodie, selon moi, a une affinité particulière avec l’oreille. Et il ne me semble pas être, parmi les amateurs de musique, un cas exceptionnel. Et s’il faut lâcher des gros mots, en voici un : cette affinité de la mélodie avec l’oreille est naturelle. Je veux dire : fondée sur des lois de la nature (consonance, intervalles, harmonie, ...).
Je sais, cette affirmation ne va pas précisément dans la même direction que l’air du temps, vous savez, cet air qui vous serine la rengaine : « Tout ce qui est humain est culturel. Rien de ce qui est humain n’est naturel ». Ben si ! Désolé ! Peut-être que c'est ça, après tout, qu'ils ont derrière la tête, les "transhumanistes" de la Silicon Valley, qui sont en train de préparer l'avènement de "l'homme augmenté" ?
Jusqu'à plus ample informé, je reçois tout ce qui me vient de l'univers sonore de mes organes de perception sensorielle. A chacun d'en perfectionner l'usage s'il le peut. J'aime que la musique, aussi poussée que soit sa complexité technique, ne devienne pas un pur concept : on observe à suffisance les dégâts du purement conceptuel dans les arts plastiques. J'aime que la musique n'oublie jamais qu'à l'origine, elle ne sort pas d'un pur esprit, mais du plaisir physique d'une expérience sensorielle.
Non, tout n'est pas, dans l'homme, façonné par la culture : il y a dans l'homme un noyau de nature irréfragable. J’en veux percevoir un indice probant dans le fait que, si les révolutions dans le langage musical opérées par le 20ème siècle étaient exclusivement des faits de culture, l’oreille de monsieur tout le monde s’y serait habituée au fil du temps, tout comme elle s’est habituée aux "dissonances" du quatuor du même nom de Mozart, aux plus abstruses des Variations Diabelli, aux longueurs de Lohengrin et Parsifal, etc.
Or on est obligé de constater qu’un siècle après les innovations radicales de Schönberg, Berg et Webern, l’oreille de monsieur tout le monde est à peine moins rétive à supporter le résultat de leurs cogitations révolutionnaires. J'ai l'impression qu'il reste assez de nature dans l'humanité pour penser que celle-ci « résiste encore et toujours à l'envahisseur ».
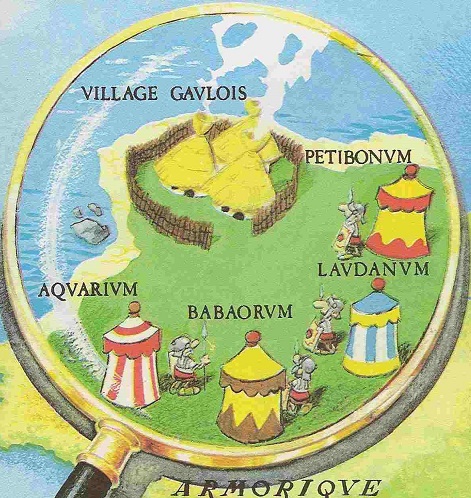
Si les musiques d’avant-garde du 20ème siècle étaient de même nature que celles, dans le passé, qui se sont fondues dans l’ensemble des styles précédents pour constituer ce qu’on désigne communément sous l’appellation extensive « Musique Classique », Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, chanterait avec sa joie et son exubérance coutumières les aberrations dodécaphoniques de Schönberg et les autres ou, pire, de l’école de Darmstadt (Boulez, Stockhausen et toute la bande).
Darmstadt, vous savez, ce sont ces commissaires du peuple et autres staliniens qui n’avaient rien de plus pressé que d’ « organiser la totalité de l’espace sonore en dehors de toute subjectivité » (autrement dit d’éliminer de la musique jusqu’au souvenir de l’humain). Quelle terrible chose, quand on y réfléchit ! Une musique scientifique, quoi ! "Surtout ne me parlez pas de plaisir", nous dit toute la chimie sonore sortie du laboratoire de Pierre Boulez ! Pierre Boulez traîne le boulet de sa haine de la subjectivité - hormis de la sienne, c'est entendu.
Dans un monde de plus en plus déshumanisé, pas d'autre solution qu'une musique déshumanisée ! Les sciences cognitivo-comportementales dissèquent bien le cerveau pour y traquer les sièges des sentiments, des émotions ! Pourquoi le physico-chimisto-mathématicien Pierre Boulez ne pourrait-il prétendre plonger l'auditeur moderne dans les éprouvettes de la paillasse où il officie ? Eh bien non.
Que Renato, le ténor napolitain, se refuse encore « avec entêtement » (tonton Georges, « Le Cocu », mais c'est à propos du « port de la feuille de vigne ») à mémoriser et vocaliser l'aberration dodécaphonique, que l’oreille d’une telle masse de gens ordinaires, résolument non-scientifiques, freine des quatre fers et s’interdise obstinément de calquer le rythme de ses pas sur celui des grands innovateurs de la musique moderne, cela devrait au moins poser question aux plus lucides et aux moins doctrinaires d’entre eux. Je ne suis pas sûr que la question soit parvenue à leur conscience.
Et ce n'est pas faute d' « éducation », si une majorité de la population reste aujourd'hui imperméable aux théories modernes de la musique : qu'est-ce que les responsables de France Musique, de festivals "Présence" (Paris), de salles de concerts lui en ont fait bouffer, de la contemporaine, à la population ! En tranches, en pâtés, en sauce, en ragoût, à la broche ! La tactique est bien connue : pour que l'oreille du vulgum pecus s'habitue, il suffit de glisser une tranche de John Cage entre deux symphonies de Mozart ! Eh bien non, le gavage forcé, l'endoctrinement, le bourrage de crâne, ça ne suffit pas : on ne change pas comme ça les lois de la nature (tonalité, consonance, intervalles, harmonie ...).
Et ce n'est pas davantage en essayant d'instiller un sentiment de culpabilité dans cette population arrogamment qualifiée de retardataire qu'on y arrivera : quand un humain ordinaire, normalement constitué, écoute son sentiment profond à l'écoute des élucubrations de John Cage ou de Pierre Boulez, il se dit que non, là, impossible de s'y retrouver.
Peut-être s'est-il passé dans la musique la même chose qu'en politique ? Vous savez bien, tous ces poissons rouges, dans leur bocal. Le public qui déserte les salles de concerts où l'on joue Luciano Berio, Takemitsu Toru, John Cage, André Boucourechliev, Pascal Dusapin, Elliott Carter, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Jean Barraqué, Claude Ballif, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Philippe Manoury, Klaus Huber, György Kurtag, (je fais courte la liste des nuisances) ..., ce public n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le public qui, les jours d'élections, vote avec les pieds en allant à la pêche, refusant de s'entendre chanter plus longtemps les vieilles rengaines, par des hommes politiques aux discours usés jusqu'à la corde ? N'y a-t-il pas là un autre exemple (inattendu) de fracture séparant le peuple des élites qui le gouvernent ?
Peut-être aussi ces compositeurs et la légion de leurs affidés sont-ils trop savants. Je leur dis simplement : rendez-nous la mélodie. Faites simple, soyez sympas : pensez à l'auditeur futur. Nous ne demandons pas grand-chose, finalement. Ne laissez pas une science musicale purement théorique, abstraite, voire déshumanisée, aussi avancée soit-elle, régner en despote totalitaire sur votre musique : réhumanisez vos sources d'inspiration. Destinez vos compositions à des auditeurs concrets, aux gens qui existent, qui ont des sens affûtés, qui ont envie d'éprouver du plaisir quand ils vont au concert. Rendez-nous le plaisir simple de la perception sensorielle des sons musicaux.
Donnez-nous envie de chanter votre musique. Est-ce demander l'impossible ?
Voilà ce que je dis, moi.
Fin (pour le moment)
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, avant-garde, transhumanisme, silicon valley, mozart quatuor dissonances, beethoven variations diabelli, wagner, parsifal, lohengrin, schönberg, alban berg, anton webern, astérix, musique classique, école de vienne, école darmstadt, boulez, stockhausen, dodécaphonisme, musique sérielle, georges brassens le cocu, france musique, festival présence, paris, john cage
mardi, 03 mars 2015
MORT DE LA MÉLODIE
Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.
Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.
Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.
4
J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.
Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.
Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".
Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.
Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.
On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.
J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.
Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.
Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.
Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.
C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.
J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.
Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?
C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.
Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.
Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek
lundi, 02 mars 2015
MORT DE LA MÉLODIE
3
Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?
Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.
Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.
Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !
L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.
Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.
Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.
L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.
Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.
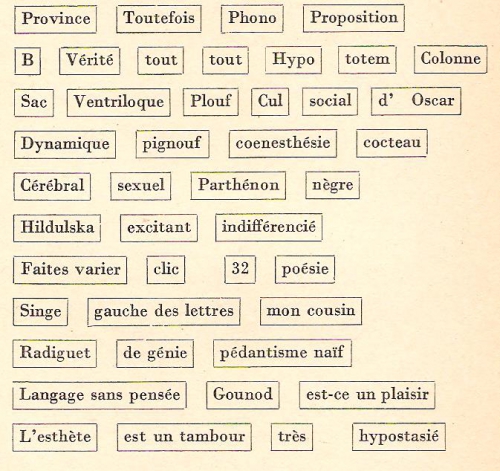
Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".
Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.
Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.
On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.
Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.
Leur arrogance est grande.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : désolé, il y aura un supplément.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux
dimanche, 01 mars 2015
MORT DE LA MÉLODIE
2/3
Une exception notable : la chanson (à texte, chansonnette, variété, rengaine, pop, ce que vous voulez, mais obéissant à la loi « paroles-et-musique »). A cela une raison : il est impératif de plaire si l’on veut vendre, seule condition de survie. Or ce qui plaît, selon toute apparence, c'est précisément la mélodie. Vous me direz que ce qui plaît au grand nombre, c'est sûrement du bas de gamme. Indigne des esprits de qualité. C'est du vulgaire commerce, n'est-ce pas. La mélodie, c'est bon pour le peuple, n'est-ce pas.
Pour le reste, de la musique savante aux musiques « festives » (pour dance floors) ou « de banlieue » (rap, slam), question mélodie, c’est nada, nib de nib, peau de balle et balai de crin. Ou alors il faut 10 ans de Conservatoire pour être capable d’en reconnaître le souvenir qui traîne ici ou là, savamment dissimulé.
Finis, les airs capables de s’incruster dans la mémoire de ceux qui les entendent, heureux ensuite de les chanter sous la douche, au volant, en marchant dans la rue ou en s'efforçant de repérer les boîtes de sardines à l’ancienne « Connétable » sur les rayons du supermarché. Et je m’interroge : comment se fait-ce ? Que diable signifié-ce ? Est-ce être complètement momifié, carrément fossilisé ou culturellement moisi que de déplorer amèrement cette disparition de la mélodie ? Qui a kidnappé la mélodie ?
Même si la musique, depuis le début de l’histoire humaine, n’en a pas toujours comporté, ou de très rudimentaires, celle qui s’est déposée dans ma mémoire, celle qui me constitue et qui n’est pas pour rien dans la formation de mon esprit tel qu'il existe présentement, repose principalement sur la mélodie.
Et du vaste fatras mélodique qui encombre mon cerveau, ne cessent de surgir à l'improviste, par réminiscence ou association, les airs les plus divers, les plus imprévus, et ça va du grégorien à la dernière chanson à la mode entendue à la radio. Je n’en démords pas : c'en est au point qu'une musique sans mélodie me semble aujourd'hui, au minimum, une incongruité.
Dans sa chronique du 1er septembre 1964, dont je citais le début il y a peu (« Ça faisait longtemps »), Alexandre Vialatte écrit ceci au sujet des romans que son métier de critique l’amène à lire au fur et à mesure des parutions : « Ce qu’il y a de curieux, c’est que ces romans reflètent encore un univers civilisé à une époque où la planète n’obéit plus à aucune règle, où elle ne fait plus que céder partout à des pressions purement cosmiques, zoologiques, au séisme, au volcan, à la bestialité, et n’est plus gouvernée, sauf en de rares endroits, que par la famine et le massacre, le raz de marée, l’imposture, la haine, le racisme et l’anthropophagie, présentés sous des mots savants, comme des systèmes cohérents et logiques.
Jamais siècle ne fut livré à une plus noire barbarie ». Il constatait (il y a cinquante ans) l’effarant divorce que le 20ème siècle avait consommé entre le livre et le journal. Entre la littérature et les événements de la réalité. Entre l'art et la vie quotidienne.
J’ai l’air de sauter du coq à l’âne ? Peut-être. Mais voilà : je suis tenté de faire un parallèle entre cette barbarie dont se désole le grand écrivain, cet homme à la haute culture (s’il voyait où on en est aujourd’hui !) et le séisme qui a ébranlé l’Europe jusqu’à ses fondations culturelles et artistiques. La figure a à peu près disparu de la peinture. La règle métrique a disparu de la poésie. La mélodie a disparu de la musique. C’est particulièrement flagrant aujourd’hui, et dans toutes sortes de musiques.
Le 20ème siècle est un siècle de cataclysmes politiques, je n’insiste pas. Mais il a aussi connu des cataclysmes esthétiques. Je ne m'attarderai pas trop sur ce qui s’est passé dans la peinture et dans la poésie, pour voir ce qu'il en est dans la musique. Juste le temps d’observer que ce qui caractérise les changements, c’est selon moi, disons la mise à distance du destinataire. Il faut le reconnaître : depuis le début du siècle dernier, le destinataire des œuvres a disparu du paysage de leurs créateurs. Ceux-ci ont coupé les ponts avec les gens auxquels leur travail s'adresse.
Les peintres, les compositeurs et les poètes ont inversé la charge de l’effort, en empêchant les récepteurs d’accéder directement à leurs œuvres, d’adhérer spontanément à ce qu’ils voient, entendent, lisent. Les créateurs se sont enfermés dans des laboratoires. Moderne alchimiste, chacun d’eux a inventé sa recette pour fabriquer son or. A charge pour le public de comprendre au bout de quel circuit alambiqué tombaient les gouttes de l’alcool ainsi produit.
Cette mise à distance du spectateur, de l’auditeur, de l’amateur, consiste en un refus de la perception directe, de la sensation immédiate. Le message envoyé par l’artiste au destinataire est assez clair : « A toi de te mettre à ma portée ». Et tant pis pour celui qui ne « comprend » pas. Je trouve ahurissant le discours hautain et arrogant, suintant le mépris, de tous ceux qui, se piquant de modernité, regardent de très haut les commentaires laissés par des gens simples sur les pages du « livre d'or » de certaines expositions, du genre "mon chien" ou "un gamin de cinq ans en ferait autant". Aucune remise en question, chez ces artistes, mais une certitude : aux autres de gravir la pente qui mène à leur œuvre.
On pourrait aussi voir dans cette façon de faire un moyen pour les milieux de l’art de compenser l’énorme mouvement de démocratisation culturelle qui a traversé tout le siècle. De sélectionner sa propre élite. Un moyen de conserver la distinction entre l’élite des amateurs et le vulgum pecus des béotiens, ceux qui ne « comprennent » pas.
Avec la vague bien connue de snobisme de tous ceux qui font semblant d’être dans le coup. J’ignore si c’est toujours le cas, mais j’étais frappé par un fait, à l’époque où je fréquentais beaucoup les expositions d’avant-garde : les visiteurs qui n’étaient pas entièrement vêtus de noir faisaient figure d’exotiques. J’étais un exotique.
Et je me demande si ce mouvement de mise à distance des publics par rapport aux œuvres n’est pas conforme à ce qui se passe dans tous les domaines où se conditionne l’existence du plus grand nombre : d’un côté les masses manœuvrables, de l’autre les connaisseurs, les experts, les spécialistes. Vous comprenez, le monde est devenu tellement complexe, mon bon monsieur. Vous n’avez plus qu’à vous en remettre à ceux qui savent pour la gestion des choses qui vous concernent : vous n’avez plus de prise sur elles.
Artiste, homme politique, c’est devenu des circuits à part entière. Si vous n’avez pas le diplôme pour être admis dans le réseau, vous fermez votre gueule.
Je n’ai pas le diplôme, j’ouvre ma gueule : j’ai tout faux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rap, slam, conservatoire de musique, alexandre vialatte, chroniques de la montagne
samedi, 28 février 2015
MORT DE LA MÉLODIE
1/3
Je suis, depuis « ma plus tendre enfance », un gros consommateur de musique. La voracité de mon appétit en la matière, en même temps qu'elle saturait jusqu'à l'exaspération l'espace sonore des gens qui m'entouraient, m’a fait parfois effleurer, parfois côtoyer l’univers des musiciens, parfois même y poser un pied (j’ai chanté pendant plusieurs années dans un ensemble de solide réputation). Certains disent que j’ai écouté la radio ou collectionné les disques de façon déraisonnable. J’avoue : je suis, depuis toujours, fou de musique. Littéralement.
J’ai aussi beaucoup fréquenté les lieux où la musique se faisait, et j’ai pratiqué quelques instruments (bugle [j'essayais de copier le sublime solo de Bubber Miley au cornet, dans je ne sais plus quel Duke Ellington précoce, au grand dam du médecin qui avait sa consultation juste au-dessus de ma chambre], guitare, piano, clarinette, … ), jusqu’à ce que je prenne conscience, dans un éclair de lucidité résignée, que, dans la pratique instrumentale, je manifestais une envie et un goût notablement supérieurs au talent effectif que je déploierais jamais dans leur maniement.
J’ai donc été forcé de me réfugier, dans un mouvement de retraite déçue et tardive (on ne renonce pas aisément), derrière le rempart d’une névrose aussi mélomaniaque qu’obsessionnelle. Pour dire, c’en est au point que si, en pleine discussion passionnée sur la marche de la planète avec quelques convives, parviennent à mon oreille des échos de l’adagio de la sonate opus 106 ou de l’aria de basse « Mein teurer Heiland » dans la Saint-Jean, mon esprit déserte aussitôt la table, pour s’isoler en compagnie de Ludwig Van ou de Jean-Sébastien.
Obsessionnel, c’est bien ce que je me dis, mais que voulez-vous y faire ? C’est sûrement un symptôme, n’est-ce pas ? Je me pose parfois la question de savoir, si l’on me demandait quel est le fil conducteur qui sous-tend mon existence, si ce ne serait pas l’ensemble des sons musicaux qui se sont introduits depuis les origines, en passant par l’oreille, jusqu’aux couches les plus profondes. Inatteignables, même par fracturation hydraulique.
Tout ça pour dire que, sans la musique, je serais comme un poisson hors de l’eau. Et que, après d’invraisemblables vagabondages, motivés par une curiosité que j’ai renoncé à comprendre, dans les musiques les plus diverses, les plus exotiques, les plus modernes, les plus hétéroclites et même les plus improbables, j’ai fini par déblayer le terrain de mes choix racinaires. J’ai fini par choisir. Or choisir, c’est éliminer.
Du magma sonore où mes oreilles ont depuis toujours traîné leurs guêtres, j’ai donc retiré un petit nombre de formes restées à même de combler mes besoins d’émotion musicale. Et cette décantation opérée par le temps qui passe en a éloigné d’autres désormais inaptes à satisfaire mon attente. Tout m'est resté dans l'oreille, mais filtré. Parmi les filtres qui motivent ce jugement, celui qui vient en premier, loin devant les autres, s’appelle la mélodie. Or c’est là que « ça fait problème » aujourd’hui. Oui, la mélodie.
Si l’on excepte la chanson et la pop music (en gros, les « variétés »), j’ai parfois l’impression que la notion même de mélodie a disparu des musiques que toute l’époque actuelle produit. Ecoutez « Les lundis de la contemporaine », d’Arnaud Merlin, le lundi soir ou les « Alla breve » d’Anne Montaron cinq minutes tous les jours, bref, ce qu’on appelle couramment la « musique contemporaine » (Dieu sait que j'en ai bouffé !).
Ecoutez une bonne partie de la musique que font les musiciens de jazz aujourd’hui. Ecoutez toutes les musiques qu’on a regroupées sous l’étiquette « Electro » ou « Techno ». Ecoutez du « Rap » ou du « Slam » : à peine si on peut y dénicher, de loin en loin, quelques souvenirs de traces d’une mélodie quelconque. Pour trouver une ligne de notes qui montent et qui descendent, qui soit assez structurée pour procurer une forme musicale à l’oreille. Car toute vraie mélodie est structurée : tout Berlioz en est une preuve éclatante (« Premiers transports que nul n'oublie ! Premiers aveux, premiers serments de deux amants, Sous les étoiles d'Italie ... », l'air de contralto est un modèle).
Conséquence de cette disparition : on ne peut plus chanter la musique qui se crée jour après jour. Or j’estime que pouvoir chanter ce que j’ai entendu est une façon de prolonger l’émotion ressentie à l’écoute. Comme si les compositeurs et improvisateurs actuels (depuis les « révolutions » du tout début du 20ème siècle) voulaient priver leurs auditeurs de ce plaisir. Les empêcher de jouir intérieurement du fruit de leur travail et de leur inspiration. Comme s’ils considéraient comme une démagogie méprisable d’imaginer une musique faite tout simplement pour plaire aux gens ordinaires. Comme s’ils n’aimaient pas les gens à qui ils destinent leurs créations.
Ils ont cessé de s’appuyer sur des suites de notes chantables par tout le monde. A part dans la chanson et la variété (et encore, pas toujours). Ceux qui se risquent à en écrire malgré tout (Karol Beffa, Olivier Greif, Philippe Boesmans, …), tout en utilisant les moyens modernes du langage musical, font presque figure d’exceptions, de survivants vaguement moisis ou momifiés d’une ère dinosaurienne (quoique de multiples dignitaires se soient inclinés devant le cadavre d'Olivier Greif).
Les plus « modernes » et autres « avant-gardistes », considérés comme le fin du fin de la musique, surtout dans la « musique contemporaine », étant ceux qui ne hiérarchisent plus les sons en « musicaux » et « non-musicaux », dans des œuvres où les sons produits par les instruments hérités de l’histoire ne sont plus qu’un cas particulier parmi l’ensemble des sons utilisables, où sont inclus toutes sortes de bruits, même les plus triviaux (le compositeur (!) Brice Pauset aime bien le bruit de l'aspirateur).
C’est pourtant la mélodie qui fait l’âme de la musique, je veux dire de la musique humaine, celle qui se partage, le socle puissant de ce qu’on appelait autrefois la « musique populaire ». Charles Trenet le dit bien : « Longtemps après que les poètes ont disparu, Leurs chansons courent encore dans les rues ». Et ça dépassait le petit univers de la chanson : c’était vrai pour l’opéra, la symphonie, le concerto, etc.
Ce qu’on appelait le « thème », ce qui faisait en quelque sorte sa carte d’identité, ce qui permettait de le fredonner à quelqu’un pour le lui faire reconnaître, c’était ça : la mélodie. Eh bien c’est fini : un cataclysme consensuel et silencieux s’est produit au 20ème siècle qui a englouti la mélodie.
De l'invention majeure de la musique occidentale, en plus d'être une musique écrite, je veux parler de la gamme par tons, je veux parler de la tonalité, un système établi, dit-on, par Guido d'Arezzo (« Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum ...» = do, ré, mi fa ...), le système qui a produit toute la musique tonale, toute la polyphonie et toute la musique symphonique, bref, tout le patrimoine de la musique européenne, le 20ème siècle a voulu faire table rase.
Pour être moderne, il faudrait dire « a remis les compteurs à zéro ». Il se trouve que l'humanité, depuis ses origines, n'a jamais « remis les compteurs à zéro ». On ne recommence jamais la même chose.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, mélodie, bubber miley, duke ellington, jazz, passion selon saint jean, jean-sébastien bach, sonate hammerklavier, ludwig van beethoven, france musique, musique contemporaine, les lundis de la contemporaine, alla breve anne montaron, arnaud merlin, karol beffa, olivier greif, philippe boesmans, charles trenet, l'âme des poètes, longtemps longtemps longtemps, guido d'arezzo
samedi, 17 janvier 2015
TARAF DE HAÏDOUKS
Ils m'ont tué Cabu. Ils n'avaient pas le droit.
Pour ne pas trop penser à sa mort, à celle de Wolinski et des autres, en ce moment, je me shoote à la musique. Une musique de joie et d’énergie, si possible. Le hasard faisant bien les choses cette fois, je suis retombé en triant quelques disques sur un album que je n’avais plus écouté depuis une éternité.
A l’époque, le groupe s’appelait « Les lăutari de Clejani ». Clejani est une commune située à proximité de Bucarest, au sud-ouest. En remettant le CD sur la platine, je me suis demandé pourquoi j’avais enterré si longtemps cette musique éclatante de vie. D’un autre côté, je me dis que c’est merveilleux de redécouvrir. Parce que vous avez de nouveau cette incroyable impression de « première fois » qui vous saisit. Cette musique, vous ne l’aviez jamais entendue auparavant. Vous êtes disponible. Tout neuf.
Surtout qu’entretemps, (de 1988 à 1991) ils ont changé de nom. Moi, je les connaissais sous le nom de « Taraf de Haïdouks ». En français : orchestre de bandits d’honneur, « haïdouk » désignant un Robin des Bois à la roumaine. Relire à cette occasion Présentation des haïdouks, petit livre mémorable de Panaït Istrati. Ils ont eu leur heure de gloire. Pas d'erreur possible. Et c’est sûr, ce sont les mêmes. Le vieux Nicolae Neacşu, Ion Manole, Ion Fălcaru, d’autres, on les retrouve d’un CD à l’autre. Environ une douzaine, en formations variables suivant les morceaux.
J’ai passé grâce à eux des instants magiques, me replongeant dans des ambiances exotiques datant d’avant la chute de Ceaucescu. Du coup, j’ai révisé les trois volumes que je m’étais procurés du temps de la célébrité de ces « haïdouks ». Dans celui de 1994 (« Bandits d’honneur,chevaux magiques et mauvais œil »), j’était littéralement tombé en extase en écoutant la plage 7 (« Cintec de Dragoste şi joc »). C’est une chanson d’amour, paraît-il. Mais quelle envolée, ma parole !
C’est étourdissant. Vous les entendrez, les deux compères, ils se relancent l’un l’autre, ils se répondent. Que disent-ils ? Je n'en sais rien, et je m'en fiche. Une « jam session » endiablée, rien d’autre. Ils se laissent aller à l’idée du moment, à la réplique qui fuse. Dans le jazz, on appelle ça l’improvisation. Et attention, ils sont déchaînés. La preuve que c’est excellent, c’est que les producteurs ont laissé les éclats de rire quand le morceau s’arrête. Ils sont tout étonnés d'avoir fait ça, de s'être donnés comme ça, ensemble. Des ambiances comme ça, ça ne se rencontre pas tous les jours, surtout en studio.
Le fin du fin, je l’ai trouvé sur Youtube. Un film de 1998 qui dure 44'16". C’est une chance unique, je vous assure. C’est enregistré par des Suisses qui s’y connaissent en sons musicaux et en technique d’enregistrement (c'est quand même en Suisse que Kudelski a inventé le Nagra et que Studer a fondé la marque Revox) : le son est parfait. Je veux dire que chaque instrument est individualisé au moment où il le faut.
Le plus formidable dans l’histoire, c’est qu’on les voit de près, chacun à son tour. Le vieux Neacşu qui n’a plus de dents et qui joue et chante « Balada conducatorului » (le Conducator en question s'appelait Ceaucescu) en tirant artistement un crin de cheval sur les cordes de son violon. Le cymbaliste barbu et le bassiste, les deux virtuoses de la « section rythmique ». Les deux accordéonistes qui, à deux minutes de la fin, réussissent à jouer strictement la même ligne mélodique effrénée. Les acrobaties ahurissantes de deux des violonistes, le grassouillet tout placide et l’enthousiaste tout nerf. Les interventions du flûtiste, Fălcaru je crois, avec son air un peu égaré de vagabond des limbes (aucun rapport avec la BD de Ribera et Godard).
Un des airs qui me touchent particulièrement est intitulé « Pe deasupra casei mele » (plage 4) : situé tout au centre du concert, il étonne et détonne. Son rythme balancé, ses modulations plus complexes entre couplets et refrain, ses quatre solistes successifs, contrastés et homogènes, ont un grand charme.
Je ne me lasse pas de visionner ces images qui me remplissent de joie. Ces musiciens se regardent, s’écoutent, se donnent. On les voit exulter, sérieux ou exubérants. La « Cintec de Dragoste » n’a pas autant d’éclat que la version mentionnée, mais ça déménage quand même.
Je suis sûr que Cabu aurait adoré.
Voilà ce que je dis, moi.
Les plages : 1 – Turcească ; 2 – Balada conducatorului (à 8’58") ; 3 – Rustem şi suite (à 16’46") ; 4 – Pe deasupra casei mele (à 21’07") ; 5 – Doina, hora şi briu (à 25’16") ; 6 – Cintec de dragoste ca la Roata (à 31’12") ; 7 – Tot Taraful (à 36’38").
09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, wolinski, charlie hebdo, musique, lautari de clejani, taraf de haïdouks, roumanie, bucarest, panaït istrati, présentation des haïdoucs, ceaucescu, jazz, jam session, conducator, le vagabond des limbes, godard et ribera, bande dessinée
mardi, 15 juillet 2014
ERROLL GARNER, BIENFAITEUR
Bien des « critiques » (je pouffe) de jazz font la fine bouche en entendant le nom d’Erroll Garner : « C’est du jazz, ça ? » (je brais). Boris Vian, qui n’est pas connu pour être un grand trompettiste (malgré une réputation flatteuse, avec sa « trompinette » dans les caves germanopratines), mais enfin qui était un vrai connaisseur du jazz, l’appréciait beaucoup. Il avait raison. C’est d’ailleurs un des disques d’Erroll Garner (Concert by the sea, avec Eddie Calhoun (b) et Denzil Best (dm)) qui, de toute l’histoire du jazz, s'est le mieux vendu dans le monde.
C’est sûr qu’Erroll Garner, c’est assez spécial pour qu’on l’identifie au bout de la deuxième seconde d’écoute. Et d’abord cette main gauche incroyable, qui plaque ses accords (on appelle ça « block chords ») sur les quatre temps, avec de curieuses notes intermédiaires et certains accords singulièrement martelés, donnant l’impression de sautiller (on voit bien faire le pianiste sur son tabouret). Et puis cet incroyable léger décalage de la main droite, qui donne envie de bondir.
La musique d’Erroll Garner donne une idée exacte de ce qu’est le bonheur d’être vivant à faire de la musique : sur les photos, on le voit jubiler d’être là. Et ça s’entend à ses grognements de satisfaction. Voilà : c’est une musique de la jubilation. Il adorait jouer en public et détestait répéter avant les concerts. Ou alors il ne tenait aucun compte de ce qu’il avait fait en répétition. Il était dans l’improvisation permanente.
C’est sûr que c’était difficile pour le bassiste et le batteur (respectivement Eddie Calhoun et Denzil Best sur Concert by the sea), jamais capables de prévoir, à l’écoute, dans son introduction du morceau suivant, dans quelle tonalité et sur quel titre ses pieds allaient retomber. Tiens, par exemple, écoutez l'introduction de « I’ll remember april » (Concert by the sea), pour voir : même que le public met plusieurs secondes à identifier le titre et à applaudir quand il en attaque le thème ! Le moins qu’on puisse dire, c’est que les « sidemen » devaient faire preuve de vigilance et de réactivité. Paresseux et fonctionnaires s’abstenir !
Si on me demandait quel titre en particulier il faut écouter, je serais bien embarrassé. Si on me poussait dans mes retranchements, j’avouerais avoir un faible pour « Sweet and lovely » (One world concert). Et je conseillerais à ceux qui se demandent encore ce que c’est que le « swing » d’être particulièrement attentifs à ce que les trois comparses font dans la séquence qui commence aux alentours de la quatrième minute. Moi, chaque fois que je l'écoute, ça me laisse sur le cul : rien de spectaculaire, mais de l'énorme à l'arrivée. Cela s'appelle l'art du swing.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musique, jazz, erroll garner, one world concert, concert by the sea, sweet and lovely, i'll remember april, boris vian
mercredi, 02 juillet 2014
L'OMBRE D'UN DOUTE
Je vais à la musique les yeux fermés, et je la laisse en moi agir et me toucher ; je ne connais pas la musique, c'est elle qui me connaît mieux que moi-même.
FRANÇOIS MAURIAC
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, musique, françois mauriac
mardi, 24 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 3/3
Résumé : pourquoi Chopin ? Parce que Chopin, quand il invente sa musique, cherche sa propre vie. Et cette vie est âpre. Comme celle des personnage du livre.
 Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».
Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».
Malheureusement pour lui, Konstantin a la rage. Il est en guerre contre le communisme et les communistes. C'est un bloc de refus. Plus grave, il est en guerre avec le monde : il déteste ses parents, qui ont eu le tort de s’adapter au moule du système. Et ses parents ne l'aiment guère. Pour le coup, à peu près asocial, aimé par personne et n'aimant personne (croit-il), c’est un authentique révolté, qui ne supporte pas le règne de la bêtise la plus abjecte, surtout jointe à la médiocrité la plus criante, qui exercent un pouvoir sans partage sur les êtres et les choses. Son seul exutoire est dans le piano de Frédéric Chopin. Une condition de survie.
Il le dit : « S’il y avait une raison de rester en vie, de supporter le torrent diurne de la bêtise, de la détresse, de l’insulte et de la bassesse, c’était bien ces moments de ravissement où je respirais au même rythme que Chopin, où le code secret du divin s’inscrivait dans les airs. Il me suffisait de promener les doigts sur le clavier pour y accéder, pour que les portes s’ouvrent toutes grandes ». Sa relation à la musique a quelque chose de névrotique, de pathologique même. Je le sais : je souffre d'un syndrome clinique voisin, sauf que je ne suis pas pianiste, à plus forte raison virtuose. Je suis obligé de me contenter de.
Mais pour lui, c’était ça ou mourir. Le système en effet est tel que si l’on veut espérer survivre, il faut être cinglé. Les seuls personnages vivants, dans Wunderkind, ont tous un grain. Un gros grain. La belle Irina, dont Konstantin se rend compte trop tard qu’il est amoureux, finira d’ailleurs à l’asile, à dix-sept ans, ayant déjà avorté deux fois, capable de déclarer, prémonitoire : « J’ai peur de ne pas atteindre mon vingtième anniversaire. J’ai tout expérimenté, j’ai goûté à tout. Je suis vieille et fatiguée. […]
Ici, le temps ne passe pas à la même vitesse, une année paraît une décennie, voire plus. Mon enfance a pris fin le jour de mes neuf ans. A quatorze ans, j’en avais terminé avec la puberté. Je me suis mariée, j’ai eu des enfants, j’ai voyagé … en quelque sorte. J’ai déjà perdu chacun de ceux qui m’étaient chers. Et tout cela pendant que je jouais de ce foutu violon. Je ne m’en suis même pas rendu compte ». Elle se suicidera. Et le grand Vadim devient militaire, après avoir été chassé de ce « paradis ». Et le superbe Igor le Cygne, un personnage flamboyant, est destitué de son poste.
Tous ces adolescents baisent sans amour, se saoulent à n’importe quoi, fument dès qu’ils le peuvent. La vie les a brutalisés, ils sont vieux avant l’heure. Seule la musique. La musique seule. Comme Irina, Vadim, pianiste prodigieux que Konstantin juge tellement supérieur à lui, est fou à sa façon. L’un des personnages les plus incroyables de tout le livre est professeur de violon. C'est lui qu'on appelle Igor le Cygne. Foutraquement poète, on se demande comment il a fait pour échapper aux camps de travail communistes.
Quand il fait répéter quelque sonate de Bach à Irina son élève et à Konstantin (BWV 1014, 1017 et 1018), les envolées lyriques échevelées dans lesquelles il se lance à deux ou trois reprises sont de vrais morceaux de bravoure : « Les démons de la joie ! Le concierge se fait sucer au moment où je vous parle, c’est de la folie. Je n’en peux plus. Voilà longtemps que j’aurais dû m’inscrire dans une chorale d’eunuques. Peut-être que vous devriez tout bonnement vous mettre nus sous le piano à queue pour baiser, Irina et toi, presto, un menuet, peut-être même une sarabande, et je regarderai de loin … Discrètement ! Je ne dirai pas un mot. C’est une proposition à prendre ou à laisser, je vous mettrai à tous les deux un Très Bien. Une affaire à saisir ! Vous ne savez même pas jouer d’un instrument, de toute façon … Petits merdeux ! De mon temps, on répétait dix heures, quatorze heures par jour, on jouait jusqu’à l’aube, on jouait pour rester en vie ». Comme ça sur des pages.
Seuls quelques-uns sont en vie, tous les autres sont morts ou ressemblent au « Père de la Nation », à la momie duquel la classe entière est allée rendre visite et hommage : « Tu trouves ça drôle Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. – Qu’on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l’empêcher de puer ». Ce serait hilarant si ce n'était pas terrible. Le surnom de Peppy est « le Voleur ». Et il ne se fait jamais prendre, même quand il vole des kalachnikovs dans les sous-sols du Conservatoire. Lui aussi fait partie des vivants : il connaît par cœur le manuel de survie en milieu hostile.
Et ils sont peu nombreux, les vivants : Igor le Cygne, Irina, Vadim, Peppy, Konstantin, Alexander à la rigueur, bien qu’il sache qu’il peut se permettre d’être insolent, puisque son père est quelqu’un dans le Parti. Il y a aussi « la Coccinelle », le professeur de piano qui considère Konstantin comme le plus doué de ses élèves, et qui finira par émigrer, ayant épousé un Américain.
N’oublions pas de nommer le dédicataire du livre : Ilya. Cet oncle du narrateur a passé quasiment toute sa vie à Lovech puis dans l’île de Parsin à casser des cailloux comme « espion des impérialistes ». Apparition d'une ombre fantomatique surgie du fond des âges totalitaires, qui raconte à son neveu l’horreur du camp de travail, où le kapo Gazdov décide, selon son humeur, de la mort de tel prisonnier, dont le cadavre ira engraisser les cochons, dans l'enclos réservé.
Le prononcé de la sentence se fait par l’entremise du petit miroir où l’officier invite le condamné à se regarder une dernière fois. C’est ainsi, crânement, que finit l’admirable violoniste appelé « le Maestro » : d’un seul coup de club de golf à l’arrière du crâne, après avoir roulé les pointes de sa moustache, en souriant.
Voilà pour le noyau dur des vivants. Tout ce qui les entoure donne l'impression minérale, pétrifiée de la haine (la Hyène, la Chouette, ...). Et la seule « preuve de vie » que les vivants peuvent se donner est la musique qu’ils font, non pas pour « réussir dans la vie », mais parce qu’elle est leur seule manière de donner et de recevoir de l’amour dans ce monde totalement déshumanisé : « Notre corps est la première chose qui disparaît lorsque nous faisons de la musique ». Comme dit Igor, ils font de la musique pour rester en vie. La musique seule.
L’urgence, l’absence, l’impossibilité de l’amour, dans cette existence concentrationnaire, est au centre du livre. Toutes les machines humaines qui gravitent autour du noyau des vivants sont des robots, qui se sont résignés à ne pas exister par eux-mêmes, se contentant de fonctionner docilement. Et de se montrer assez cruels avec ceux qu'ils ont sous leurs ordres pour les contraindre à faire de même. Deux issues pour ceux qui veulent rester vivants : le suicide ou la musique.
Quel tableau terrible, mes amis !
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je ne sais pas si Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un grand (voire même un bon) livre de littérature. Ce qui me reste de sa lecture, c'est le choc reçu au spectacle de l'affrontement meurtrier de deux mondes : d'un côté celui de la musique des grands (Bach, Beethoven, Chopin) et des rares qui se mettent au service de cette expression sublime de la vie à l'état pur (appelons ça l'amour de l'art) ; de l'autre celui d'un système où la musique n'est qu'une brique de prestige parmi d'autres, dans la muraille à l'abri de laquelle s'édifie l'avenir radieux du paradis socialiste, et qui à ce titre constitue la négation même de la vie.
Le pays totalitaire, ici, est pris dans une contradiction, un double impératif contradictoire : produire des musiciens qui permettent à la Bulgarie de rayonner dans le monde, mais tout faire, dans le même mouvement, pour qu'aucune tête ne dépasse.
Rien que pour l'exactitude radicale dans la peinture de cette bataille de fin du monde, merci monsieur Nikolai Grozni !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, frédéric chopin, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, bulgarie, communisme, sofia, virtuose, artiste, jean sébastien bach
lundi, 23 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 2/3
Résumé : je me demandais juste pourquoi Wunderkind, le livre de Nikolai Grozni, m’a secoué. C’est à cause de Chopin.
 « J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »
« J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »
Bien sûr, Grozni exagère. Il sait forcément que c’est injuste et faux, et que le mouvement lent de la sonate opus 106 de Beethoven ou l’adagio de son quatuor opus 132 (« Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart ») sont pour l’âme humaine d’autres Everest de sincérité absolue. Je note en passant qu’il n'ose pas citer Jean-Sébastien Bach dans sa liste des compositeurs qu’il juge impersonnels. Faudrait quand même pas abuser.
Quoi qu’il en soit, la musique de Chopin constitue le socle sur lequel est construit le livre, dont les chapitres, en même temps que les dates précises, s’ouvrent sur les morceaux de musique que travaille Konstantin, le jeune musicien qui raconte son existence au « Conservatoire pour Enfants Prodiges » de la capitale bulgare et communiste. Rachmaninov fait une apparition, Beethoven, Brahms et Moussorgski deux, Bach trois (eh oui), mais Chopin occupe royalement la première place, très loin devant : quinze chapitre sur vingt-cinq lui sont dédiés.
A ce sujet je me serais presque attendu à ce que les chapitres soient au nombre de vingt-quatre, comme il y a vingt-quatre tonalités dans la musique européenne, célébrées par Bach dans Le Clavier bien tempéré, nombre auquel Chopin lui-même a déféré en composant vingt-quatre Etudes (deux fois douze, opus 10 et 25) et autant de Préludes opus 28.
Je me fais une raison en me souvenant du motif pour lequel Georges Perec a fait exprès de composer La Vie mode d’emploi en quatre-vingt-dix-neuf chapitres et non pas cent, en souvenir de la petite fille de la publicité Lu qui a croqué juste un angle du petit-beurre. Grozni a fait en plus ce que Perec a fait en moins, en quelque sorte. S’est-il seulement préoccupé du nombre ? Pas sûr.
Ce qui m’a secoué, c’est ce que dit Grozni : la musique de Chopin, c’est une personne vivante, avec un épiderme d’écorché vif (si l'on peut dire) connaissant et portant la condition misérable de l’humanité tout entière. A propos de l’opus 20 : « Vadim se redressa, prit une profonde inspiration et déplaça les mains vers le haut du clavier, prêt à frapper le premier accord. Le Scherzo n°1 s’ouvre sur un cri de désespoir absolu : on s’éveille d’un cauchemar pour découvrir que tout ce qu’on a rêvé est vrai ». On trouve ça p. 41. Le Chopin de Grozni, il faut le chercher du côté du tragique.
Et puis : « Le second accord semble à la fois plus résigné et plus agressif : enfermés dans le sablier, on est condamnés à attendre. Prisonniers du temps, hors du temps, conscients de notre finitude. Puis vient la folie qui brise toutes les fenêtres, abat tous les murs, tourbillon de conscience cherchant la sortie. Se peut-il qu’il n’y ait aucun passage secret ? Aucune porte dérobée ? ». La vie, quoi. En plus intense.
Moi qui suis incapable de « voir » des circonstances, des situations ou des personnages (une « narration ») dans la musique (il faut dire que je n’essaie pas : pour moi, à tort ou à raison, les sons musicaux sont des abstractions, ensuite seulement viennent (ou non) les effets parfaitement concrets et physiques), voilà qu’un pianiste doué qui, en plus, sait écrire, met des mots jaillis de sa propre expérience, qui me font « voir » ce que cette œuvre raconte. Des propos que je trouve assez justes et pertinents pour en être intimement touché.
Attention, le Chopin que raconte Grozni n’a rien à voir avec l’éphèbe alangui, légèrement efféminé, que certains pianistes ont longtemps voulu voir, produisant des dégoulinades de sons mélodramatiques et narcissiques : essayez de jouer le Scherzo n°1, tiens, si vous n'avez pas des bras, des poignets, des mains et des doigts en acier !
Ce n'est pas non plus (au risque de paraître paradoxal) le Chopin qui a fait de Vincenzo Bellini son dieu, et qui demande à son piano de porter l'expression la plus accomplie de son profond amour pour le « bel canto » du maître italien de l'opéra (mort à trente-quatre ans, Chopin, mort à trente-neuf a un peu mieux résisté).
Le Chopin de Grozni est âpre, dur comme le granit. Un Chopin confronté à un monde qui, situé à une altitude très inférieure à celle où il a placé ses idéaux. Un Chopin qui affronte des épreuves morales d'une dureté qui met à mal son âme, voire la dévaste.
Mettons que ce Chopin-là s'appelle Nikolai Grozni et soit né en Bulgarie à l'époque de la décrépitude communiste, où plus personne dans le système ne sait où il en est. Où tout le monde s'accroche désespérément aux lézardes du mur. Qui ne tardera pas à tomber.
Avec Wunderkind, le lecteur est face à la figure d’un destin implacable : le Chopin de Grozni est en acier, blindé contre les forces de mort qui l'assaillent. Si c’était une embarcation, ce ne serait en aucun cas une gondole, mais un cuirassé puissant. Une fois le livre refermé, vous ne l'entendrez plus comme avant.
Le Chopin de Grozni est un navire de guerre lancé contre la mort.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, musique, chopin, beethoven, mozart, liszt, schumann, ravel, debussy, jean-sébastien bach, sonate opus 106, quatuor opus 132, brahms, rachmaninov, moussorgski, le clavier bien tempéré, georges perec, la vie mode d'emploi
dimanche, 22 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 1/3
Nikolai Grozni, Wunderkind, Plon, « Feux croisés », 2013

Je ne comprends vraiment pas l'expression de Patti Smith, "prose miroitante", posée bien en évidence sur le guéridon de l'entrée du volume.
Je le dis sans ambages : Wunderkind, du Bulgare Nikolai Grozni, n’est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Peut-être même n’est-il que pour quelques-uns (comme La Chartreuse de Parme, dont le point final s'écrit « to the happy few »). Ce que je ne souhaite pas à l’auteur. Car c’est un livre admirable. Mais Grozni n’a pas choisi la facilité, c’est le moins qu’on puisse dire.
Moi, il m’est rentré dans le chou direct et frontal. Je dirais comme Lino Ventura : « C’est du brutal ». Sauf que là, de la première à la dernière page, personne ne rit, ni les personnages, ni le lecteur. C’est un livre qui vous fait prendre un bain de granit : « Le ciel de Sofia est en granit ». C’est la première phrase. Or nager dans le granit, ce n’est pas évident. Un bain dans un passé sinistre pas si lointain : l’action commence à Sofia, Bulgarie, le 3 novembre 1987 et finit deux ans plus tard, au moment de la chute du mur de Berlin.
On passe trois cents pages enfermé dans l’étroite cellule qu’était un pays communiste où, quand on n’a pas à faire à un mouchard, c’est que c’est un bureaucrate ou un « agent en civil ». Parfois un militaire chargé d'enseigner l'éducation physique, armé de son Makarov 9 mm. En tout cas un médiocre qui peut à tout moment vous menacer de son pouvoir. L’effet est poignant. Comme le narrateur, le lecteur se sent à l'étroit, en permanence traqué par les yeux malveillants au service du « Parti ». Et les yeux sont partout, et ils cognent à l’occasion.
Car ce livre met le lecteur à l’épreuve. Comment fait l’auteur pour lui donner l’impression de passer par les épreuves où lui-même est passé ? Mystère. Ce qui est sûr c’est que c’est violent. Et d’autant plus violent qu’il raconte une guerre impitoyable. Cette guerre de destruction voit s’affronter deux ennemis : Frédéric Chopin et le Communisme (avec tout le système soviétique en prime). Et je peux vous dire qui a gagné : c’est Chopin. Mais à quel épouvantable prix !
Je dois dire, pour être honnête, que, comme lecteur, je suis dans une position singulière, qui ne fait pas de moi un élément statistique décisif. Car moi, Chopin, j’avais huit ans. J'étais vacant, donc disponible, il m’est tombé dessus. Pendant des jours et des jours, j’ai passé et repassé sur le Teppaz du 39 Cours de la Liberté la face du 78 tours où je n’ai jamais su quel pianiste (Braïlovski ?) avait gravé l’étude opus 25 n°11.
Combien de fois l’ai-je fait tourner, pour que le chant implacable et volontaire de la main gauche et les cataractes étincelantes de la droite soient définitivement imprimés, fondus ensemble dans les battements d’un cœur gros comme l’univers, au plus profond de mes profondeurs ? Quarante ? Cinquante ? Cent ? En tout cas, Grand-mère n’en pouvait plus et demandait grâce. J’étais impitoyable. J'avais une excuse : Chopin m’avait révélé la vraie vie.
Le plus étonnant : j’ignorais le nom du compositeur, seule la musique, pendant de longues années, est remontée régulièrement de tout au fond vers la surface, inoubliée et pour ainsi dire originaire, comme un événement fondateur, mais aussi comme un point aveugle. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché : quel enchanteur pouvait avoir écrit cette musique prodigieuse ? Je n’ai plus entendu ce morceau par la suite. Il vivait quelque part, comme un point d’interrogation obstiné.
C’est le hasard d’une programmation de France-Musique entendue sur un mauvais transistor, quelque part au fin fond de la Haute-Loire, qui m’a valu, beaucoup plus tard, de pouvoir enfin nommer l’œuvre et attribuer sa paternité au grand Polonais de France. Je le dis sans fioritures : une commotion ! Un ébranlement vertébral ! A l’instant même, je retrouvais le paradis perdu, pas moins. Je n’y peux rien : c’est comme ça que ça s’est passé.
Ensuite, mon carquois s'est garni d'autres flèches. Le Nocturne opus 48 n°1, par exemple, avec cet extraordinaire changement de tonalité qui suit l'exposé du thème, pour annoncer la brutale mutation de l'humeur, avant le retour à une sorte de paix, mais crépusculaire. Ou bien le Scherzo n°3 (op. 39), avec ses contrastes complexes qui déboulent (« presto con fuoco ») dans une sorte de folie furieuse. Mais l'Etude opus 25 n°11 gardera toujours pour moi le même ineffaçable aspect inaugural que « la première fille qu'on a tenue dans ses bras » (comme dit Tonton Georges).
Devenu le profond sillon dans lequel cette œuvre s’est déposée, je m’autorise à voir dans l’auteur de Wunderkind une sorte de frère éloigné dans l’espace et dans le temps, qui m’apporte soudain sur un plateau les mots et les phrases qui collent exactement à l’idée, jamais formulée, que je me faisais de la musique de Frédéric Chopin.
Là où il est très fort, c’est qu’il m’a fait découvrir des choses que je savais déjà.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nicolai grozni, bulgarie, roman, wunderkind, éditions plon, collection feux croisés, communisme, urss, guerre froide, parti communiste, sofia, musique, frédéric chopin, études opus 10, études opus 25, france musique
mardi, 17 juin 2014
GABRIEL TYR, PEINTRE

Ce tableau de Gabriel Tyr (1863) n'est pas au musée Crozatier du Puy-en-Velay, où sont rassemblées ses œuvres. Peut-être y sera-t-il un jour. Ci-dessous, un autre portrait (1857) : elle est pas mimi, la dadame au bonnet, avec ses anglaises amidonnées ? Et visez un peu le camée !
Je connais d'autres Gabriel. Peut-être celui auquel je pense avec prédilection parviendra-t-il à échapper, en prenant de l'âge, comme Tyr a su le faire, au fardeau qu'une vaine célébrité fait toujours peser sur ceux qu'elle a choisi d'écraser, et qui, trop souvent, n'ont pas mérité ça. Il ne faudrait jamais que la gloire (de même que le pouvoir) aille à ceux qui l'ont le plus ardemment désirée.

Gabriel Tyr (1817-1868) : né à Saint-Pal-de-Mons, mort à cinquante et un ans.
Entré à seize ans à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Travaillé avec Victor Orsel à la décoration de l'église parisienne de Notre-Dame de Lorette. Avec Alphonse Périn et Hippolyte Flandrin (qui a sa rue à Lyon, ce qui n'est pas une preuve de ... - de quoi, au fait ?).
On parle volontiers de son talent à réaliser pour la religion des œuvres « délicates, pures et lumineuses », mais il a aussi peint de très beaux portraits, dans lesquels il délaisse toute « anecdote » et toute fioriture pour que l'attention se concentre sur l'essentiel.
Saint-Pal-de-Mons est la riante bourgade natale du peintre, située dans l'arrondissement d'Yssingeaux, qui appartient au canton de Sainte-Sigolène, et rattachée à la perception de Saint-Didier-en-Velay.
Au recensement de 1990, mille cinq cent quarante-deux individus peuplaient neuf cent soixante-quinze logements (dont trois cent cinquante-huit résidences secondaires), répartis sur deux mille sept cent onze hectares, ce qui faisait alors une densité de cinquante-six virgule neuf habitants au kilomètre-carré. Il semblerait que la population dépasse aujourd'hui les deux mille âmes.
Les vingt kilomètres qui, en 1990, séparaient la commune de l'accès à l'autoroute n'ont pas dû varier significativement.
Impossible, en l'état actuel des choses, d'en savoir plus. Mais nous promettons au lecteur de le mettre au courant, dès que nous en aurons appris davantage.
*******
Dernière minute : nous avons de la chance. Nous apprenons qu'il se passe bien des choses à Saint-Pal-de-Mons. Ainsi l'installation sonore de l'église, connue pour ses pénibles effets de réverbération, a été entièrement rénovée. Le système de sonorisation choisi est composé de deux enceintes Rayon 100V Active Audio pour la nef de dix-huit mètres, de deux enceintes SM400i-WH pour le chœur, d'un ampli CXV 225 de Cloud, d'un lecteur CD CDT1U, d'un Furman PLPRODMCE pour la protection des éléments, d'un processeur numérique NUT ainsi que de microphones Clock Audio, dont la nouvelle application "Speech conformer" permet de régler automatiquement la hauteur en fonction de l'orateur. L'ambon a été doté d'un col de cygne C33ERF avec une embase XLR SM10, l'autel d'un col de cygne C34 ERF avec une embase S210. Les célébrations seront animées grâce à deux microphones HF main CW9000C. Ci-dessous un aperçu.

*******
Dernier arrivage : nous apprenons que Saint-Pal-de-Mons est une commune d'avant-garde. Impatiente d'essayer les merveilleux moyens techniques dont on a doté son église, elle a décidé d'organiser sa "Fête de la Musique" le 14 juin, avec l'excellente fanfare Zigomaclique.
Il était bon que cela fût su. Il est donc nécessaire que cela soit dit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, gabriel tyr, saint-étienne, lyon, saint-pal-de-mons, musique, sonorisation, église
jeudi, 12 décembre 2013
UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

FRAGMENT DE SEQUENZA III
J’en étais resté à conspuer la littérature et la musique « de laboratoire », dont sont férus tant d’adeptes de la « Modernité ».
Je me demande même si ce n’est pas la « Modernité » en soi qui a fini par me rebuter : j’ai déjà dit ici le mal que je pensais des Sequenze (pour écouter Sequenza III, cliquez ici : 8 minutes de rigolade garanties) de Luciano Berio. Même chose pour ce que les artistes, depuis une quarantaine d’années, se complaisent à appeler – précisément – des « performances » (je sais, je sais, ça vient de l’anglais, ça ne veut pas dire la même chose).
A propos de performance, je me souviens d’un spectacle inénarrable, superbement gratiné dans le genre, vu au Centre d’Art Plastique de Saint Fons, alors dirigé par un véritable apôtre en la matière (J.-C. G), homme terriblement sympathique au demeurant.
Imaginez une baignoire solidement fixée au plafond avec un individu dedans, poussant à intervalles irréguliers de petits glapissements, pendant qu’un liquide jaunâtre goutte par la bonde mal fermée, qu’une comparse va lentement déposer de petits tas de sable aux coins d’un quadrilatère, et qu’un autre, en uniforme de varappeur, fait le tour de la salle sans mettre un pied au sol. Les murs avaient été préparés en vue de l’acrobatie. Si quelqu'un peut m'expliquer ...
La « Modernité », en démocratisant à tout va la création, en autorisant ainsi tous les charlatans à vendre en salade leurs potions vendues comme des panacées, qu’il s’agisse de musique, de peinture ou de littérature, la « Modernité » a inauguré l’ère de l’esbroufe, de l’épate et du n’importe quoi.
Impossible pour un public non initié de faire le départ entre les gens « sérieux » (au nombre desquels, malgré les apparences, je compte Luciano Berio) et ces batteurs d’estrade et autres cabotins. Et je ne parle pas du snobisme qui fournit à la « Modernité » des adeptes qui se piquent de figurer dans toutes les avant-gardes, et qui promeuvent par bêtise ou par calcul les derniers gadgets à la mode qui font fureur dans les salons des « branchés ».
Ce qui fait, résultat des courses, que, d’une part, les compositeurs sérieux et savants se sont retirés bien à l’abri des murs de leurs laboratoires, et d'autre part ont oublié, tout simplement, l’auditeur. Ils ont élaboré, dans leurs cornues et leurs athanors de plus en plus compliqués et tarabiscotés, des univers sonores qui n’étaient plus faits pour provoquer émotions et plaisir chez l’auditeur, mais pour répondre à des programmes quasiment scientifiques.
Que leur musique plaise à quelqu’un semble être devenu le cadet des leurs soucis. Pourvu que leurs œuvres ainsi conçues recueillent l’estime et l’admiration du petit cercle de leurs confrères, ainsi que de quelques privilégiés, voilà leur bonheur « samsufi ». Ce qui compte avant tout, c'est d'être reconnus par leurs pairs.
J’imagine que des auditeurs soucieux de paraître « au courant » n’ont rien de plus pressé que de se sentir flattés qu’on leur propose des œuvres d’accès difficile : peut-être s’enorgueillissent-ils de paraître comprendre ce qui se passe. Après tout, depuis Balzac et même avant, on sait que la vanité aime à se nicher parfois de façon surprenante.
Mais je me dis aussi que lorsque les sons entendus offusquent l’oreille qui les reçoit, lorsqu’ils sont ressentis par elle comme une langue inconnue, voire comme une forme d’agression, il y a peut-être une raison objective à cela. Que se passe-t-il donc dans ces œuvres musicales où l’auditeur se sent intimement tenu au collet et menacé par plus imposant que lui ? Qu’est-ce qui les différencie d’œuvres plus « classiques » (certains diront plus « conventionnelles ») au niveau de la réception ? Cette question m’intrigue et me turlupine (de cheval) depuis longtemps.
La réponse n’est pas évidente. Les adeptes de la Modernité pointeront son aspect éminemment « culturel » (c'est comme entre sexe et genre, la plaisanterie bien connue). Je veux dire qu’ils traiteront de préjugés et de stéréotypes les « attachements excessifs » aux musiques (aux « codes ») héritées du passé. Ils accuseront peut-être les industries de diffusion et de reproduction musicale (radio, disque, …) de distribuer dans les oreilles ces codes d’un conformisme épouvantable.
Mais je finis par me demander s’il n’y a pas dans beaucoup de « musiques contemporaines » (disons expérimentales, dissonantes, violentes, …) une attitude d’INTIMIDATION chez des artistes qui ne cherchent plus principalement à plaire à quelqu’un, mais qui se considèrent davantage comme des spécialistes, maîtres d’une technique qui échappe à celui qui écoute.
Des musiques qui se situent plus haut que leurs auditeurs. Devant lesquelles ils sont contraints de se montrer humbles, pour ne pas dire humiliés, l’artiste se présentant comme CELUI QUI SAIT. Celui qui sait domine celui qui ne sait pas. Il y a dans ce fonctionnement une « histoire de pouvoir » (rien à voir avec les fariboles racontées autrefois par le « sorcier » Carlos Castaneda). Juste une histoire de pouvoir. Quasiment politique.
Non que les musiques plus classiques ne fussent parfois diaboliquement savantes (je pense à certaines des Variations Diabelli de Beethoven). Et techniquement, elles étaient largement hors de portée du vulgum pecus. Mais les compositeurs se souciaient de la réception de leurs œuvres. Ils écrivaient leur musique pour quelqu’un. Ils pensaient à quelqu’un quand ils écrivaient leur musique. Ils étaient déçus, voire mortifiés, quand l’accueil du public, lors du concert inaugural, ne consacrait pas une réussite. Témoin Bizet, quand il vit siffler sa Carmen. Il est mort peu de temps après, sans avoir le temps d'assister au triomphe, aujourd'hui planétaire, de son opéra.
Le dodécaphoniste, ce révolutionnaire de laboratoire, se fout éperdument de la façon dont son œuvre sera reçue. Son idée, c’est de composer une œuvre satisfaisante pour son esprit. Il ressemble en cela au mathématicien devant son tableau noir, qui se réjouit d’avoir trouvé une belle formule bien géniale.
Mais à la différence du mathématicien, qui se contente de proposer sa trouvaille aux autres mathématiciens, à travers des revues très spécialisées, voire confidentielles, le dodécaphoniste met son œuvre sur la place publique et somme brutalement les foules de manifester de l'enthousiasme, c'est-à-dire d’apprécier et de comprendre la grandeur et la complexité de son travail.
L'insondable bêtise prétentieuse de cette attitude saute aux yeux : il n'a jamais été prévu par Einstein que sa théorie de la relativité (restreinte ou générale) fût comprise par d'autres que le petit nombre de ses pairs. Il y a une espèce de terrorisme culturel à envisager pour la musique dodécaphonique une diffusion aussi large que pour la quarantième de Mozart. On ne peut faire entrer des foules dans un laboratoire. C'est une musique faite par des spécialistes pour des spécialistes, n'en déplaise à Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : musique, musique sérielle, musique dodécaphonique, arnold schönberg, luciano berio, sequenza iii, modernité, art performance, jean-pierre derrien, france musique, karlheinz stockhausen, florent boffard
mercredi, 11 décembre 2013
UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

MUSIQUE POUR LABORATOIRE
Malgré un siècle de diffusion, la musique sérielle rebute toujours le public ordinaire. Comment se fait-ce ? Que se proposent Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard sur l’antenne de France Musique le vendredi matin ? Ni plus ni moins que d’éduquer le peuple jusqu’à ce qu’il n'en puisse plus de résister à tant d'insistance et de sollicitude, et qu'enfin, il consente à aimer le système dodécaphonique inventé au début du 20ème siècle par Arnold Schönberg.
Mais je me dis que, si en un siècle on n’y est pas arrivé, c’est qu’il y a quelque chose de plus que la surdité ou le conservatisme du public qui est en cause. Peut-être y a-t-il quelque chose de rédhibitoire dans la musique inventée elle-même. Une limite infranchissable aux oreilles ordinaires et normales. Un noyau dur inassimilable. J'y reviendrai un de ces jours.
« Musique contemporaine » donc ? Je me demande si cette étiquette ne sert pas à marquer une frontière : celle du rapport entretenu par chacun à la modernité. A la droite de Jean-Pierre Derrien (voir plus haut) siégeront tous les justes, tous les promis au salut accordé aux héros qui « vivent avec leur temps ». A l’oreille de ceux-là, je me permettrai juste de susurrer ce mot de Cromwell : « Ceux qui épousent leur époque prennent le risque d’être souvent veufs ».
A la gauche de Florent Boffard, tous les racornis cramponnés à de vieilles lunes comme sont la mélodie, la consonance ou la sensation de plaisir et d’émotion auditifs, promis aux poubelles de l’Histoire qu’il a adroitement placées sous leurs pas. Ceux-là, je me promets de les encourager à rester sourds aux sirènes de la « modernité », et de ne pas sectionner les quelques racines que le 20ème siècle n’a pas réussi à couper avec les temps anciens.
Ces attardés de la préhistoire égarés dans la modernité ressemblent à l’antique caricature des cancres, ceux qui se blottissent au fond de la classe, tout contre le radiateur. Comme le disait un comique des années 1950 – Jacques Bodoin (on peut le voir sur Youtube) – : « C’est là qu’ils s’épanouissent ».
Ceux-là ont garni leurs oreilles du même épais bouchon de cire que les marins d’Ulysse avaient mis à l’approche du rocher des Sirènes. Ceux-là, je le dis aux dévoués Derrien et Boffard, sont définitivement perdus pour la science, hermétiques à toute musique expérimentale, à toute innovation en art. Soyons net, voire péremptoire : hostiles à tout progrès.
Bon, peut-être. Mais pas complètement sûr. Peut-être douteux. Pour vous dire combien je me suis endurci dans mon épaisseur de bouseux béotien resté les pieds enfoncés dans sa glèbe natale, il m’arrive même d’imaginer que l’hypothèse est complètement fausse, même si ça doit contrarier Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard.
Et si, après tout, c’étaient les réticents qui avaient raison ? Et si, au contraire des décrets de la « doxa », il était complètement stupide de parler de « Progrès » en musique ? Et s'il y avait quelque imposture à vouer un culte à la déesse « Innovation », quand il s'agit des arts, et de faire d'elle l'arbitre départageant l' « obsolète » et le « vivant » ? Qu’est-ce qui pousse Jean-Pierre Derrien à se prosterner aux pieds de la statue « révolutionnaire » d’Arnold Schönberg ? Je demande qu’au moins on examine ces questions.
Je me demande en effet s’il ne s’est pas passé dans la musique la même chose que dans la peinture et la littérature. Finalement, qu’est-ce que c’est, l’abstraction en peinture ? J’y vois pour ma part deux aspects. D’abord – j’en ai parlé –, c’est la disparition du visage de l’homme et du monde des représentations picturales, l’effacement de la figure humaine, et son remplacement par l’exploitation de toutes les possibilités expressives des moyens techniques à la disposition des peintres.
Ensuite, c’est l’irruption dans le domaine des arts de l’esprit de système, des grandes théories et doctrines. N’est-il pas révélateur qu’un livre considéré comme l’un des trois chefs d’œuvres littéraires du 20ème siècle soit Ulysse, cet ouvrage improbable où le romancier s’est lancé le défi de placer, outre une foule de contraintes langagières, successivement TOUTES les figures de style. Les spécialistes en ont dénombré une petite centaine. L'Ou.Li.Po. de Queneau et Le Lionnais n'est pas loin.
J’ai lu Ulysse en 2009, moi qui ne suis pas spécialiste, et non seulement je n’ai pas cherché à faire cet inventaire, mais je n’ai pas honte d’avouer que ce livre m’a intéressé, sans toutefois me subjuguer. Le côté « performance sportive » attaché aux œuvres proclamées « chefs d’œuvre de la Modernité » me laisse froid. Mais peut-être l'ai-je lu trop tard. J'aurais dû le faire quand la Modernité me laissait encore pantois d'enthousiasme, et ne m'avait pas encore laissé voir son cœur desséché et momifié.
L’expérience de laboratoire, en littérature comme en musique, c’est d'abord fatigant.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art, musique, musique contemporaine, dodécaphonisme, musique sérielle, jean-pierre derrien, florent boffard, france musique, arnold schönberg, oulipo, raymond queneau, le lionnais, james joyce, ulysse, modernité
dimanche, 01 décembre 2013
SANS TITRE
C'EST COMME POUR LES CHANTEUSES DE JAZZ : J'ADMIRE EVIDEMMENT ELLA FITZGERALD ET SARAH VAUGHAN, QUI FONT CE QU'ELLES VEULENT DE LEUR VOIX, DE LEUR BOUCHE, DE LEUR LANGUE ET DES MELODIES, MAIS JE PREFERE PAR-DESSUS TOUT BESSIE SMITH ET BILLIE HOLIDAY, DONT LA VOIX LAISSE ENTREVOIR EN TRANSPARENCE LES BLESSURES DE LEUR HISTOIRE.
ELLES NE REGNENT PAS, ELLES EXISTENT. LEUR PERSONNE EST PRESENTE DANS LEUR VOIX. ELLES NE SE CONTENTENT PAS D'ÊTRE DE PARFAITS INSTRUMENTS DE MUSIQUE.
POUR LES MURS, C'EST PAREIL : UN MUR TOUT NEUF, BIEN LISSE OU FRAÎCHEMENT REPEINT N'A RIEN A DIRE. UN MUR CABOSSÉ ET TRAVAILLÉ PAR LE TEMPS INVITE A SE FAIRE ARCHEOLOGUE.
08:50 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, jazz, musique, ella fitzgerald, sarah vaugghan, bessie smith, billie holiday
samedi, 23 novembre 2013
LA MELODIE COMME UN VISAGE

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1932
Les musiciens savants modernes, si l’on excepte quelques artistes héroïques, ont beaucoup œuvré à la disparition du visage mélodique dans la musique, au profit de constructions théoriques et d’emprunts parfois alambiqués au monde des bruits. Au profit, en fin de compte, d’un monde sonore indifférencié, où tout ce qui s’entend est d’autorité placé au même rang que tout le reste.

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1936
Cette disparition du visage dans la musique contemporaine, avec la haine des compositeurs pour la mélodie, a touché les autres arts. Ce qui me frappe, c’est qu’en peinture, il s’est passé exactement la même chose. Les artistes (je parle en général, cubistes, suprématistes et autres –istes) se sont ingéniés à exterminer tout ce qui pouvait rappeler la réalité telle qu’on la voit en général, et en particulier la figure humaine, pour faire de la matière même, du support, de l’espace autour, que sais-je, des conditions de réalisation, l’objet même de l’art.
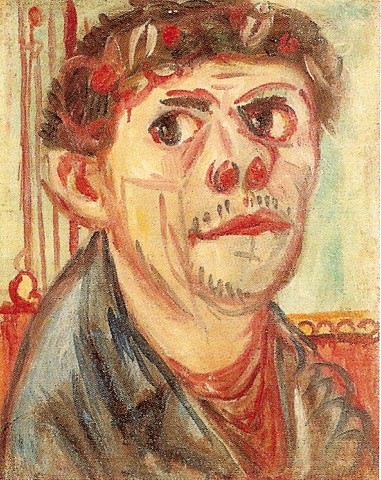
PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1945
Il fallait, dans la peinture aussi, détruire la représentation, d’où une haine féroce pour le trop bien nommé « figuratif ». Les Autoportraits de Pierre Tal-Coat sont à cet égard révélateurs de vérité : la figure humaine devient la grande absente. C’est lui, on sait que c'est lui, mais il n’est pas là, voilà tout. Il refuse de paraître. Que s'est-il passé ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984
Je ne veux pas m’appesantir trop longuement, une fois de plus, sur ce qui s’est passé en poésie, et qui ressemble de très près à l’effacement de la mélodie en musique et de la figure en peinture. Depuis les symbolistes, parmi lesquels Mallarmé, le discours poétique s’est chargé de mystères et de significations obscures qui ont radicalement fait fuir le public pour lequel l’expression « sens commun » a encore un sens. Qui lit René Char ? Qui lit Philippe Jaccottet ?
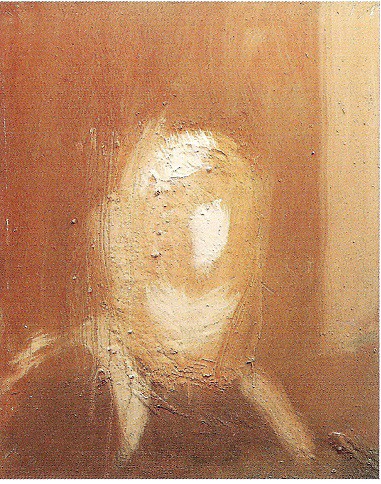
PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985
Je ne veux pas non plus donner à mon propos l’enflure de généralité brassée avec le vent qu’Edgar Morin sait si bien mettre dans son discours pour lui donner un aspect de profondeur mûrement réfléchie. J’observe juste que la musique, la peinture et la poésie font, à peu près au même moment, disparaître de leurs préoccupations le visage de l’individu, et que le 20ème siècle a appelé ça la « Modernité ». Ou encore le « Progrès ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985
Et j’observe que tout ça coïncide avec les énormes progrès accomplis par l’industrie lourde dans les moyens mis en œuvre pour détruire le plus possible de vies humaines dans le minimum de temps (pas loin de 300.000 morts et disparus dans les rangs français pour le seul mois d’août 1914). On me dira que ça n’a rien à voir. Moi je dis : « Pas si sûr ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1985
Parce que finalement, de quoi s’agit-il ? Dans les arts (musique, peinture, poésie), c’est la mise en avant des « moyens techniques » qui devient l’objet, le but de l’activité. Pour le musicien sérialiste (école de Vienne, pour faire court), c’est le son, égal à tous les autres sons. Pour le poète, c’est le mot, voire la syllabe, quand ce n’est pas la lettre toute seule. Pour le peintre, c’est la couleur, la ligne et même la toile. Ce qui compte, ce n’est plus le monde que cherche à traduire l’artiste à destination de ses semblables, ce sont les moyens mêmes de la traduction qui deviennent le sujet principal.
Voilà peut-être ce que je ne supporte plus, finalement, que ce soit en peinture, en musique ou en poésie : que les moyens soient devenus la fin. Car en même temps que la technique est promue au rang de finalité ultime, le monde en général et l’homme en particulier disparaissent. L’homme est réduit à l’état d’instrument et de moyen, comme le montre le déchiquetage méticuleux de la chair humaine par une artillerie lourde de plus en plus performante.
Le 20ème siècle a assuré le triomphe de la technique. Et je ne suis pas loin de penser, à la suite de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, Hans Jonas et quelques autres, que ce triomphe est une défaite pour l’humanité, comme le montre la disparition du visage humain dans la musique et dans la peinture. Il y a dans tout cela un amoralisme radical.
Voilà ce que je dis, moi.
NB : Il va de soi que les propos ci-dessus manquent tant soit peu de nuances. Il conviendrait, en de tels sujets, de trancher autrement qu’à la hache. J’en suis d’accord. Il y a chez tout le monde, musiciens compris, des fondamentalistes, des modérés et des résistants.
Francis Poulenc, par exemple, eut connaissance de la musique dodécaphonique, mais resta avec une belle constance à l’écart. Je crois savoir que c’est le côté doctrinaire de la chose qui le rebuta. Boulez est un idéologue, un dogmatique. A son propos, j’ai même entendu « stalinien », c’est dire. Heureusement, certains adeptes de la « modernité » n’oublient pas, lorsqu’ils composent, que la musique est faite pour procurer un plaisir ou une émotion à celui qui écoute.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts plastiques, peinture, pierre tal-coat, cubisme, futurisme, constructivisme, musique, mélodie, poésie, jacques ellul, bernard charbonneau, günther anders, hans jonas
vendredi, 15 novembre 2013
QUELQUES NOTES SUR UNE SUITE DE NOTES

LA SAÔNE EN CRUE
****
Préambule : Christiane Taubira retranchée de l'espèce humaine ? Il ne faut rien exagérer. Je remarque que l'offensive antiraciste du gouvernement Hollande-Ayrault au grand complet dressé sur ses ergots intervient dans une période de basses-eaux comme jamais vu pour un président à la chair duquel chaque petit événement arrache un petit lambeau. Si ça continue, on aura à faire dans pas longtemps à un squelette de Hollande.
Et je me dis que la "une" de Minute tombe à pic pour lui reconstituer un peu d'épiderme sans trou. L'affaire Taubira : une véritable aubaine pour un président en détresse. Hissez bien haut l'étendard des « valeurs » de « gauche ». Aussi longtemps qu'on verra un bonnet rouge à l'horizon. Diversion, vous avez dit ? Ben oui, pour écarter le danger de ma personne présidentielle, rien de tel qu'une bonne affaire lacrymogène.
****
Résumé : les compositeurs du 20ème siècle, pour s’arracher aux pesanteurs insupportables de la tradition et pour imposer leur idée d’un « Progrès » en musique, ont fait feu sur tous les éléments qui entraient dans la composition de la dite tradition. Schönberg avait déjà bien déblayé en éliminant la tonalité (do majeur, sol septième) pour ne plus voir qu’une seule tête dans la file de douze sons égalitarisés à la tronçonneuse.
Dans le même sac poubelle, ses suiveurs ont jeté les rythmes, les harmonies. Même l’instrument de musique y est passé. Mais ce qui se remarque par-dessus tout, c’est la disparition de la mélodie, c’est-à-dire ce qui permettait à l’amateur de participer à la musique entendue, à sa façon : « La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l’auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur » (Charles Trenet). La mélodie, parfaitement, qui est la marque de la politesse bienveillante du compositeur à l’égard de celui à qui il s’adresse.
Dans son livre Les Balesta, que j’ai en ce moment un peu de mal à terminer, Henri Bosco imagine le personnage de Melchior. Il est célibataire, il a soixante ans. Quand il avait 20 ans, il fut amoureux fou d’une fille de « La Haute » qui le lui rendait bien, mais membre d’une noble famille habitant sur le Mourreplat, dans les hauts de Pierrelousse. La dite famille, horrifiée par la mésalliance, mit brutalement fin à ce sentiment réciproque en enfermant la fille au couvent.
Melchior ne l’a jamais oubliée. Elle s’appelait Elodie. Très habile de ses doigts, il a sculpté une statue à la taille réelle de l’objet de son amour, une statue comme vivante, et d’une ressemblance hallucinante. Mais il a également construit une harpe magnifique, dont il joue souvent, et dans le bois de laquelle il a gravé ceci : « Elodie Mélodie ». C’est à ce point que je voulais en venir. J’ajoute juste que statue et harpe (et même fantôme de Melchior) jouent un rôle dans L’Epervier, dernier volet de la saga de Pierrelousse.
Parmi les plus graves reproches qu’on peut faire à beaucoup de compositeurs du 20ème siècle, c’est d’avoir abandonné lâchement le pilier immémorial de la musique, d’avoir réduit en miettes le socle sur lequel sa statue vivante s’élevait depuis qu’un homo sapiens à peine sorti de l’animalité, avait eu l’idée de se servir des deux cordes blotties au fond de son gosier pour produire autre chose que les syllabes dont il usait dans la conversation courante.
En faisant durer le son, en en faisant varier la hauteur et l’intensité, il s’en était servi pour faire quelque chose de totalement incongru : chanter. On a appelé ça « mélodie ». La voix est le premier instrument de musique, bien avant tout autre. Ce n’est qu’après coup (je n’y étais pas, mais …) que l’homme s’est dit que ce serait bien de s’accompagner en tapant sur des objets sonores, en frottant, pinçant ou frappant des cordes tendues, en soufflant dans des objets creux percés de trous.
Jusqu’au 20ème siècle, donc, pas d’autre issue pour le musicien que d’aligner sur une portée des notes enchaînées les unes aux autres par la seule logique du chant humain. D’ailleurs, bien des compositeurs ont persisté dans l’écriture mélodique : aucune rupture ne se fait dans l’histoire de quoi que ce soit de façon aussi tranchée et brutale, même la Révolution a pris quatre ans pour s’occuper de la tête de Louis XVI.
Il reste que, jusqu’au 20ème siècle, TOUTES les musiques sont faites pour être éventuellement chantées, même celles écrites pour être sonnées (opposition sonate / cantate). Cela ne veut pas dire que la mélodie est la composante exclusive de la musique, c’est bien clair, juste la composante horizontale. Comme nos phrases syllabe après syllabe, les notes se suivent sur une ligne, pour la raison que le gosier ne peut émettre qu’un son à la fois (et qu’on ne me sorte pas ici l’exception des chants diphoniques du Tibet ou d’ailleurs).
Mais au fond, qu’est-ce que c’est, une mélodie ? Qu’est-ce qu’elle a de spécial, cette suite de notes ? Cela dit sans vouloir faire de la théorie musicale : j’ai assez sué et bavé sur la Théorie de la musique de Danhauser pour envisager de l’infliger à qui n’aurait pas mérité un châtiment exemplaire pour ses entorses, incartades et autres infractions.
Tout ce que je peux faire, en tant qu’auditeur, c’est me référer à quelques-unes des innombrables mélodies qui se sont à jamais gravées dans mon disque dur interne (et qui, publicité ou lied, mouvement d’orchestre ou solo d’alto, ressurgissent parfois selon l’ordre des préférences hiérarchisées qui se sont mises en place avec le temps, parfois selon le désordre du chaos indifférencié qui s’impose tout à coup à ma mémoire).
Je pense par exemple à cet air de Purcell (est-ce dans King Arthur ou dans The Indian queen ?) : « How blessed are shepherds, How happy their lasses … ». Ou bien au solo de l’alto dans Roméo et Juliette (accompagnement de harpe, s’il vous plaît) : « Premiers transports que nul n’oublie, Premiers aveux, premiers serments de deux amants, Sous les étoiles d’Italie ; … ». Les paroles sont de Berlioz lui-même, on peut y trouver à boire et à manger. Mais je me récite aussi parfois la sublime mélodie du ländler viennois que forme l’« andante moderato » (2ème mouvement) de la symphonie « Résurrection » de Gustav Mahler.
Je ne sais pas comment je pourrais faire partager le plaisir ressenti à chanter de ces mélodies. J’ai d’ailleurs du mal à imaginer qu’il n’en soit pas de même pour tout un chacun, même si je sais qu’il n’en est rien. Je le regrette pour ceux qui, comme mon ami R., chantent épouvantablement faux. Heureusement, il est lucide. Non, ce que je persiste à ne pas comprendre, c’est la haine de beaucoup de compositeurs de la modernité pour tout ce qui pourrait ressembler à une ligne de chant.
Comme dans beaucoup des visages qu'a montrés le XX siècle, je vois quelque chose d'inhumain dans les œuvres musicales qu'il a produites. Peut-être est-ce juste un refus de l'humain. Cela reste très peu engageant.
Voilà ce que je dis, moi.
vendredi, 30 août 2013
FREDERIC DARD ECRIVAIN

"LE SECRET DU NAVIRE : J'AI VU CLOUER SUR LA TABLE LA MAIN GRAISSEUSE DU MEXICAIN"
JOURNAL DES VOYAGES
***
J’ai donc lu récemment La Mort de Virgile, de Hermann Broch : les Grandes Jorasses par la face nord, sans assurance, en hivernale, en maillot de bain et en apnée. Ensuite j’ai lu Tante Martine, de Henri Bosco. Déjà, ça fait un choc, le passage de l’un à l’autre. Je devrais dire le basculement de l’un dans l’autre : du haut de la très haute montagne inhospitalière à l'oxygène raréfié, on descend dans les vallées parfumées de la Provence. Encore que, du moins me semble-t-il, l’esprit de Bosco et celui de Broch ne soient pas si étrangers l’un à l’autre qu’on pourrait le croire, en matière de quête spirituelle et de plongée dans l’insu.
Tout de même, à lire Bosco, on se sent presque en vacances par rapport à la contention radicale et verticale qu’exige Broch de son lecteur, tout au moins dans La Mort de Virgile. Tante Martine fait donc un peu figure de délassement, quand sa lecture intervient après. Mais Paul Valéry l’avait bien dit : « Ô récompense après une pensée / Qu’un long regard sur le calme des dieux ». C’est là qu’on se sent en vacances : Henri Bosco, c’est les vacances après Hermann Broch.
Les doigts de pied se mettent d’eux-mêmes en éventail, on est sur l’herbe douce, on commence à regarder les feuilles par en dessous et, de fil en anguille, après avoir apporté sa modeste contribution à l’augmentation de capital du contentement de la copine étendue à côté, sans se demander si l’appel d’offre était réglementaire, légal, ou même moralement défendable, on sombre dans cette délicieuse somnolence de l’être procurée par le farniente. La Cérigoule murmure pas loin, gardant au frais le reste de rosé de Provence. Même les oiseaux piquent un roupillon. On était venus pour ça.
Alors maintenant, essayez d’imaginer, à l’intérieur même de ces vacances, somme toute encore un peu studieuses, des sortes de vacances au carré. Car qui passe authentiquement ses vacances à ne rien faire ? Et ça se comprend. Ne faire strictement rien, rester étendu au soleil comme la limace sur la feuille de laitue, c’est s’exposer au pire risque qui menace l’humanité souffrante : se mettre soudain à penser. Qui aurait la témérité d’affronter le monstre ?
C’est là, au milieu des après-midi torrides, dans la touffeur des étés où déjà pointe à l’horizon l’horreur de la rentrée, que vous vous accrochez à la planche de salut : un livre ! Vous avez bien lu. Mais pas n’importe lequel. Les vacances au carré ne peuvent décemment se passer ailleurs que dans un volume édité par les éditions Fleuve Noir, dans la collection « Spécial Police », et plus précisément dans la série passée à la postérité sous l’appellation générique de SAN ANTONIO. Voilà, c’est dit.

Maintenant, ce n’est pas parce que le nom magique est lâché qu’il faut se précipiter à l’aveuglette. Dans les cent soixante quinze titres parus, on dira ce qu’on voudra, mais il y a du bon et du moins bon, il y a à boire et à manger, il y a de la chèvre et du chou, du haut et du bas, de la poire et du fromage, du ziste et du zeste, du chien et du loup. Entre nous et le pont de l’Alma, ma petite sœur n’irait pas plus y mettre la main que dans la culotte du zouave. Il y faut un minimum de prudence, de circonspection et de discernement.
Il faut bien dire que le bon Frédéric Dard ne l’était pas tout le temps, et il lui est arrivé plus d’une fois d’avoir des coups de mou dans le porte-plume. C’est forcé, c’est humain, c'est normal et c'est comme ça : le meilleur chroniqueur de presse, qui sue sang et eau pour fournir avant le bouclage les 1500 signes quotidiens qui font bouillir sa marmite, il y a forcément du déchet dans sa production. On ne peut pas toujours être au top, c’est l’évidence. Même chez Alexandre Vialatte, on trouve parfois que l'auteur ne s'est pas donné trop de mal. Un frustration, certes légère, mais indéniable, s'ensuit fatalement. On dira que c'est la vie.

Les deux numéros de « San Antonio » que je viens de lire en sont l’illustration éclatante. Prenez Du Mouron à se faire, je vais vous dire, c’est laborieux, ça se traîne, on n’y croit qu’à moitié, et surtout, pas une seule page de bravoure. Quelques petites crottes de formules sont tombées sur le macadam pour faire plaisir, mais on sent bien que le cœur n’y est pas.
On dira, pourquoi le commissaire est-il allé se planquer à Liège, je vous demande un peu ? D’abord c’est la Belgique, et rien que pour ça, l’auteur aurait dû y réfléchir à deux fois. Ensuite, c’est la ville natale d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), passé à la postérité pour un seul air de bravoure et de baryton, c’est dans Richard Cœur-de-Lion : « Ô Richard, ô mon roi, L’univers t’abandonne … » (pour les amateurs, cliquez ci-contre). Un baryton plus un richard : deux raisons d’éviter, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, polar, san antonio, bérurier, frédéric dard, hermann broch, henri bosco, la mort de virgile, tante martine, roman policier, fleuve noir, grétry, richard coeur de lion, belgique, musique, alexandre vialatte


