jeudi, 30 août 2012
CHOURMO, SUITETFIN
Pensée du jour : « Il prend la plume, il va écrire à un ami ; il se rappelle soudain que cet ami est mort ; c'est pourtant avec lui qu'il partage les trois quarts des choses. A tel autre ; il est mort aussi. Et tel, et tel. Ils sont rangés sous terre, comme les livres, une fois lus, sur des rayons. L'humanité est une bibliothèque dont presque tous les livres sont lus. L'humanité est aux archives ».
ALEXANDRE VIALATTE
Nous parlions donc de Chourmo, de JEAN-CLAUDE IZZO. Ce qu’on savait, c’est que le père de Guitou, Gino, est mort (de mort violente), et que Gélou (son vrai prénom n’est jamais donné, et je déteste les diminutifs, les "bibiche", les "mon cœur", et autres niaiseries suspectes ; à la rigueur, votre sœur Gisèle, appelez-la Sophie, et n’en parlons plus, ça reste intéressant et affectueux) s’est maquée avec Alex, et que Guitou ne peut pas encadrer Alex, et qu’Alex le brutalise à l’occasion.
Mais comment le lecteur (Fabio Montale dit "je", c’est pratique : chaque rebondissement, c’est d’abord lui qui l’encaisse) aurait-il pu deviner qu’Alex, son nom complet, c’est Alexandre Narni, et que ce type est (avec Antoine Balducci) le porte-flingue de Sartanario, un parrain de la Camorra napolitaine (la même que dénonce ROBERTO SAVIANO dans Gomorra), et que c’est lui qui a dézingué, au tout début du bouquin, Hocine Draoui et, dans la foulée, Guitou ?
Même Gélou, sa propre compagne depuis 10 ans, croit qu’il est dans le marketing économique. En fait de marketing économique, c'est de l'arnaque à tous les étages. Sartanario le camorriste, vous savez quoi ? Il prête de l’argent (à blanchir) à qui veut monter une entreprise, mais à 25 %, et Alex est chargé de faire rentrer l’argent bonifié et de punir les mauvais payeurs. Mais le truc, à un taux pareil, c'est qu'il ne peut y avoir que des mauvais payeurs (voir le restaurant de Gino). La différence avec le Gobseck de BALZAC, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette : il y a le flingue d'Alex. On apprend d'ailleurs que c'est lui qui avait tué Gino, le légitime de Gélou.
Le pire, c’est que Guitou n’était même pas le fils de Gino, mais bien du truand Alex (andre Narni), dont on apprend qu’il a donc tué son propre rejeton, mais qu'il l’ignorait parce que Gélou ne lui avait jamais dit que c’était lui, le père (c’est vrai que seule la mère sait qui est le père, et encore, pas toujours).
Vous voyez le nœud ? Quasiment gordien, le nœud, non ? "Gordien", ça fait très bien, dans un paysage. Personne ne sait ce que c’est, donc tout le monde respecte. Et ignore généralement comment Alexandre l'a réglé (Le Grand, c'est d'un coup d'épée, Narni, d'un coup de pistolet). N’empêche, qu’est-ce qu’elle prend sur la calebasse en rien de temps, la frangine à Fabio Montale ! Son fils a été tué par son mec, qui est un tueur à gages. De quoi disjoncter bien net ? Eh bien non.
Eh ben oui que eh bien non, parce que tout le monde se retrouve dans le zen d’un temple bouddhiste, où Cûc, la femme d’Adrien Fabre, le père du Mathias qui a prêté la chambre à Guitou (j'espère que vous suivez), la même Cûc qui a pris le temps de faire une pipe à Montale, où Cûc, disais-je, a caché Mathias et Naïma.
C’est vrai que c’est sûr que c’est garanti, que là, ils étaient en sécurité : comment le camorriste napolitain aurait l'idée de fouiner chez les bouddhistes ? J’ai oublié de préciser qu’Adrien Fabre a assisté à l’exécution du début, et qu’il a été lui-même exécuté (il devenait de plus en plus tiède) : il devait sa brillante carrière d’architecte à l’argent sale et à l'influence secrète de la Camorra sur les marchés publics.
C'est le genre de livre optimiste, qui rétablit l’ordre du monde à la fin. Oui, parce que les méchants sont punis. Parce que Fabio Montale, quand il est au volant de la Saab, faut pas le chercher. Ou alors, il faut le suivre sur la route du col de la Gineste, en Safrane noire, par la D 559, avec la ferme intention de faire un tir au pigeon. A fond les manettes. La poursuite finale est assez bien écrite, où Montale se demande s'il préfèrera les spaghettis à la matricciana, une soupe de haricots et une daube bien marinée. Tout en taquinant à mort le frein et le changement de vitesses.
Au moment fatidique, la Safrane des méchants « me doubla et poursuivit sa route. Contre la rambarde en béton. Culbuta. Et partit dans les airs. Les quatre roues face au ciel. Cinq cents mètres plus bas, les rochers, et la mer ». L’ordre est donc rétabli, et d’autant mieux que les deux flics qui suivaient tant bien que mal dans leur R 21 minable et antique, rappliquent aussitôt pour lui dire que le commissaire Loubet avait bien fait les choses et que, de toute façon, les truands étaient cuits.
Quoi, j’ai raconté la fin ? Et alors ? Ceux qui l’ont lu, de toute façon, ils savent (à condition de s'en souvenir). Et ceux qui n’ont pas encore lu la trilogie marseillaise de JEAN-CLAUDE IZZO, c'est sans doute qu'ils n’en ont rien à battre, sinon, ce serait fait depuis longtemps.

UNE TÊTE DE PERE TRANQUILLE, NON ?
MOI, JE LE VERRAIS BIEN PROF D'ALLEMAND
Et puis en plus, ça montre qu’un livre dont la seule chose à faire est de ne surtout pas raconter la fin, c’est un livre dont le seul intérêt est dans le dénouement. Or, quand on raconte le dénouement et que ça dégoûte la personne, c'est qu'on est dans la littérature de consommation. S'il connaît la fin avant, le lecteur n'a plus besoin d'ouvrir le livre. C’est ça, la littérature policière. Et ça vaut, évidemment, pour le cinéma.
SIMENON écrivait neuf livres par an, assis à sa table tous les matins. Avec sa pile de crayons taillés la veille au soir. CELINE a mis quatre ans pour terminer Voyage au bout de la nuit. En tout il a écrit SEPT romans. En mettant, comme il dit, sa « peau sur la table ». SIMENON, il en a écrit 368. Et il s'est bien conservé. Vous la voyez, la différence ?
Le polar, c’est un mécanisme avant d’être de la littérature. THOMAS NARCEJAC (de BOILEAU & NARCEJAC, donc un connaisseur) le reconnaît : l’auteur de polar ne doit pas péter plus haut que son cul. Parce que son bouquin, c’est comme une rivière qui remonterait vers sa source : il est élaboré et construit à partir de la fin. Tout le reste de l’effort d'écriture, c’est de faire le plus d’effet possible sur le lecteur. Il fait des livres qui s'auto-détruisent.
Un grand livre, c'est le contraire : ça se développe dans le sens que la nature impose à l’eau : de la source à la mer. CELINE lui-même est saisi d’étonnement devant les rigoles, rus, ruisseaux, rivières et fleuves qui se mettent à couler et qui s’imposent à lui quand il écrit Féerie pour une autre fois, et qui font gonfler le volume des volumes. Il part dans les directions qui se présentent. Et surtout, il ne sait pas où il va aboutir.
L’intrigue de Le Rouge et le noir, c’est quoi ? Un jeune ambitieux séduit une aristocrate, puis une aristocrate, avant de tenter de tuer la première. Franchement, pas de quoi fouetter un chat. Juste un fait divers. Qu'est-ce que c'est, Madame Bovary ? Quelques adultères et un suicide à la campagne. Ça veut simplement dire que STENDHAL et FLAUBERT ont mis du gras, du muscle et du nerf autour des os du squelette, et que ça donne des êtres vivants. Mais attention, ça ne veut pas dire qu’il faut mépriser le polar. « Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. » Appelons ça « hiérarchie des valeurs », si vous n’y voyez pas d’inconvénient. J’ai dit un gros mot ?
Reste un truc, dans Chourmo, qui me chiffonne (pas trop) : le "je" de Fabio Montale sert à l’auteur pour des retours sur le passé amoureux de l’ancien flic qui a raté pas mal de choses. Bon, on a compris, il s’agit de « donner de l’épaisseur au personnage ». Moi je veux bien. Mais ça me fait un peu l’effet de l’usage du Front National dans le bouquin : ça n’apporte pas grand-chose, et même, ça fait perdre du temps. Bon, peut-être que le gars était payé à la page ?
C'est comme Honorine et Fonfon, je veux dire les personnages secondaires, dans le polar (tous les polars) : IZZO n'a pas tort de donner un peu de profondeur de champ à la photo. Mais s'il leur accordait plus d'importance, le centre de gravité du bouquin se déplacerait en direction de la grande littérature. Dans le polar, pour que l'intrigue avance (puisque c'est elle l'essentiel), il ne faut pas que les personnages en aient trop, de l'épaisseur. Côté psychologie, il faut en rester au dessin esquissé. Bon, finalement, admettons que l'auteur s'en sort bien. Le contrat est rempli.
Il reste aussi le tableau de Marseille, qu’on regarde de l’intérieur, en caméra subjective : « Je pris la rue Sainte-Barbe, sans mettre mon clignotant, mais sans accélérer non plus. Rue Colbert ensuite, puis rue Méry et rue Caisserie, vers les Vieux Quartiers, le territoire de mon enfance ». On suit bien. On passe par la rue de Lorette, dans le Panier. Place des Treize-Coins, juste derrière l’hôtel de police.
Le problème du polar, c’est que les ficelles, presque forcément, comme elles sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus visibles. Et que c’est pour ça qu'il appartient à ma catégorie des amours, disons, intermittentes. De la petite littérature. Même si ça donne de gros pavés, genre MICHAEL CONNALLY (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, ...) ou JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ (Le Concile de pierre, Le Vol des cigognes, ...). Je ne méprise pas du tout, mais « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, roman policier, polar, jean-claude izzo, chourmo, trilogie marseillaise, camorra napolitaine, marseille, fabio montale, roberto saviano, gomorra, balzac, safrane, georges simenon, louis-ferdinand céline, boielau narcejac, michael connally, jean-christophe grangé
dimanche, 26 août 2012
LA METHODE VIALATTE 5/5
Pensée du jour : « Il y a un style de l'almanach Vermot. Et sans doute, ça ressemble à la nouille ; mais en plus fort ; ça la transcende ; ça la défie ; ce n'est même plus la nouille sans sel, c'est réellement la nouille sans nouille au beurre sans beurre. Du vide de nouille dans l'absence de beurre. Bref, c'est du trou de macaroni. Essayez de parler de Landru sans dire qu'il a brûlé ses femmes, ou de Ruskin sans un mot de la religion du beau ! Ils y arrivent ! Et ils s'y ébrouent. Ils donnent le rien de toutes choses dans le détail. C'est peu de dire qu'ils le donnent, ils le modulent, ils le festonnent, ils l'ouvragent. C'est étonnant. Le lecteur bien doué arrive ainsi à ne rien savoir d'à peu près tout avec des précisions affreuses ».
Alexandre Vialatte
Résumé : Alexandre Vialatte porte sur le monde et sur l’époque un regard désolé, avec un sourire fraternel et amusé qui en corrige le fatalisme d’un semblant de tendresse. Pour écrire, conseille-t-il, « commencez par n’importe quoi » et « concluez sur n’importe quoi ».
Si je voulais faire le savant (je m'en garderai bien), je dirais que Vialatte est un écrivain du paradigmatique. Or, il faut le savoir, le paradigmatique est l’ennemi juré du syntagmatique. Je traduis : le détail plutôt que le global. Je l'ai dit il y a peu. Au paradigme l'unité de base. Au syntagme la vue d'ensemble, la phrase.
Pour faire simple, Vialatte, c'est la préférence donnée au substituable sur l'enchaînable. A la liberté improvisée de la trouvaille sur la discipline rectiligne de la logique rationnelle. Axe vertical contre axe horizontal. Bref, le mot et ses semblables, plutôt que la phrase et sa logique. La perception par les sens plutôt que les généralités abstraites. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'uniforme de la syntaxe dans un état impeccable, et de prendre plaisir à tourner des phrases compliquées. Ne serait-ce que pour embêter les gens.
Je préfère moi aussi le paradigme du livreur de lait, avec ses bidons accrochés à son vélo (on a peine à imaginer, mais je jure que c'est vrai, parce que je l'ai vu, c'était la laiterie de la rue du Garet), aux syntagmes de la Critique de la raison pure. L'image plutôt que le concept. Le particulier plutôt que le général. Pourquoi ? C’est très simple : l’humain est l’hôte naturel du particulier. Et la victime du général. L'ami précis du spécifique et la cible globale du générique.
C'est exactement pour cette raison que la 'pataphysique, science du particulier qui se propose de mettre au jour les lois qui gouvernent les exceptions (essayez d'imaginer), est une véritable urgence humaine, et que Vialatte fut un lecteur attentif d'Alfred Jarry qui, à travers Ubu et Faustroll, en fut l'inventeur.
L’individu plutôt que la statistique. Dès que se pointe le général (mettons le sociologue), l’humain disparaît, réduit à sa quantité. A son nombre. Plus précisément : l'unique est éliminé. L'individu écrasé. Voyez la catastrophe des sondages. Les mensondages, qui me découpent en morceaux (avec des décimales) pour me faire dire leur vérité : 37,8 % (ou 17,2 %) de moi-même sont d'accord (ou pas d'accord).
Où voulez-vous que je les trouve, mes 37,8 % (ou 17,2 %) ? Dans le bras ? Dans la fesse ? Non, ce n'est pas possible. C'est comme la natalité en France : 2,1 enfant par femme, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est, 0,1 enfant ? Il faut une mentalité de sous-chef comptable pour raisonner ainsi, pour être obsédé par la moyenne à calculer. Sans parler de la fiabilité des chiffres qu'on lui a donné à passer dans sa moulinette, au sous-chef comptable. Et dire que les populations du globe sont gérées de cette façon, par des chefs comptables qui se fient aveuglément aux chiffres qu'on leur fait mouliner.
Voilà pourquoi la chronique de Vialatte dont je parle commence par la citation tirée d’un San Antonio : « J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur », que j’ai donnée ici il y a quelque temps. Il fait de cette phrase anodine (pas tant que ça) l’emblème d’une méthode d’écriture : « Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là [c'est une de ses formules préférées] que tout est dans tout ». Il a bien raison. Remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. C'est tellement bien dit. Tout est dans tout, peut-être, mais pas n'importe comment.
Substituer au hasard un mot à un autre, c'est exactement ce qui se passe dans le cadavre exquis, cette invention des surréalistes (le jeu des "petits papiers", vous savez, qu'on se passe autour de la table, et qui produisit l'inaugural « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » : sujet-adjectif-verbe-COD-adjectif). Vialatte excelle à tirer du procédé (substitution sur l'axe paradimatique, excusez-moi) des effets d'une grande drôlerie. L'exercice lui ouvre la porte à la surprise et à l'inattendu (« des vérités nouvelles »).
Jean-Sébastien Bach répète à l'envi (c'était un humble) que quelqu’un qui ferait l'effort de s’appliquer autant que lui arriverait au même résultat que lui. Sa méthode pour bien jouer du clavier ? Rien de plus simple : « Il faut poser le bon doigt sur la bonne touche au bon moment ». Le propre du génie, c’est de paraître évident à celui qui le possède. Ben oui, il a toujours vécu avec. C'est une excuse. Pas une explication.
« Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou toute autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (…) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses (…) : le soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le soleil date de la plus haute antiquité". »
Et c’est là qu’on arrive au cœur de la méthode Vialatte : « Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela ».
La clé de voûte de la méthode Vialatte est là, dans l'effort constant et puissant de « rétablissement » de l'esprit. Un vigoureux rétablissement de gymnaste qui soit à même de le surprendre lui-même. Il faut le savoir, c'est un vrai sportif. Qui improvise pour s'enrichir. Le « rétablissement » sert à retomber sur ses pieds, et à éviter le n'importe quoi, maladie typiquement surréaliste (vous savez, le truc piqué par André Breton au poète Reverdy : la poésie naît du rapprochement incongru de deux réalités éloignées). La preuve que c'est une maladie, c'est que la publicité en a fait son carburant principal.
Voilà, vous savez tout : si Alexandre Vialatte est un grand écrivain, c’est qu’il attend d’être surpris par ce qu'il va poser sur le papier. Parce que la réalité présente ne le satisfait pas. Parce qu’il attend de découvrir au fil de la plume ce dont lui-même est capable, et qu'il ignorait posséder. En commençant par n'importe quoi, il se met à l'épreuve.
Imaginez un auteur de polars qui met son héros dans une situation inextricable, et qui se demande comment il va faire pour l'en sortir dans le prochain épisode du feuilleton (il faut qu'il reste vivant). Lui aussi procède par un rétablissement de l'esprit. Vialatte, c'est pareil, il lui faut de l'inédit. Parce que la route sur laquelle il marche, il la trace et la goudronne au fur et à mesure. En se demandant où elle le fera aboutir. Le monde qui est le sien sort de sa plume au moment où il écrit. Il ne sait pas, en avançant le premier pied, quel sera son point d’arrivée. Et c’est ça qui compte, évidemment.
Et ça explique qu’il n’ait jamais été un ethnologue à la façon de Lévi-Strauss, mais le meilleur anthropologue autodidacte qui soit. Et même un amoureux de la littérature. Qui décoche, de sa patte aux griffes rentrées, un mot feutré sur les fausses gloires médiatiques du moment (qui se souvient de Minou Drouet (qu'il faisait semblant, quelque part, de confondre avec Françoise Sagan, en inversant les prénoms) ce feu de paille littéraire à sensation de 1955 ?), mais qui consacre de longues pages à célébrer Chardonne, Gadenne, Hellens, Frédérique (que des discrets !), et une palanquée d'autres qu’il estime dignes d’hommage.
Le n’importe quoi de la conclusion « aura été fixé d’avance », naturellement. Les orateurs du grand siècle finissaient tous leurs sermons sur un « Ave Maria » : l’admiration allait à ceux dont l’art et la technique amenaient la prière à Marie avec le plus de souplesse et d’évidence. Et Vialatte ajoute : « Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel ». CQFD. Qui arriverait aussi "naturellement" à cet oxymore ?
Je regrette de n’avoir jamais vu Alexandre Vialatte faire le saut de l’ange, qu’il exécutait, selon les témoins, à la perfection, à la piscine Deligny, oui, celle qui a bizarrement coulé au fond de la Seine en 1993, et que j’ai fréquentée avec mon ami Hans-Joachim Bühler dans l’ancien temps, un 15 août, dans un Paris totalement silencieux et désert.
Nous étions venus en stop depuis Neustadt-an-der-Weinstrasse, dans le Rheinland Pfalz. En fait, la maison était à Mussbach, juste à côté. Neustadt, c’était le chef Queyrel. Les parents de HA-JO habitaient Richard-Wagner Strasse 11 (ne cherchez pas, la rue a été débaptisée, je suis tombé sur un bec). Un jardin. Un barbecue.
Et puis : « Ich bin kein mädchen dass man einmal kusst », m'avait-elle lancé, l’idiote invitée, révoltée par mes manières. L'uppercut m’est resté. Abattu, je n’avais pas tardé à me rabattre. La loi de l'offre et de la demande, il faut la mettre en oeuvre. Cela aussi exige un « rétablissement de l'esprit ». Pas seulement. C’était en quelle année, bon dieu ?
Voilà ce que je me demande encore, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, almanach vermot, pataphysique, alfred jarry, ubu, faustroll, jean-sébastien bach, surréalisme, andré breton, reverdy, imagination, publicité, statistiques, san antonio, claude lévi-strauss, jacques chardonne, paul gadenne, piscine deligny
samedi, 25 août 2012
LA METHODE VIALATTE 4/5
Pensée du jour : « Voilà un homme [à propos du Prince de Ligne]. Le reste est plèbe et fibre épaisse, imbécile, et nous vivons dans cet affreux malaise d'une affreuse civilisation qui sécrète elle-même les poisons dont elle mourra, par voie de suicide évidemment, sans trop tarder. Par auto-intoxication. Comme le scorpion qui se pique la nuque avec sa queue ».
Alexandre Vialatte
***
Résumé : je disais donc que la vie n’est qu’une digression. Mais j’en viens à mon sujet initial.
Oui, il s’agit bien d’en venir, enfin, à Alexandre Vialatte. Au sourire désolé qu’il pose sur l’époque dans laquelle il est obligé de vivre, à l’angle des rues Léon-Maurice Nordman et de la Santé (l’hôpital Cochin n’est pas loin à droite, la prison est en face). Quand il n'est pas dans son Auvergne. C’est à Paris. Il parle plus de la prison (qu’il a sous ses fenêtres) que de l’hôpital (un peu à l’écart de son champ de vision). On est dans le 13ème, au seuil du 14ème.
« Les pigeons de Paris, au vol lourd, tournent autour des toits de la Santé et se posent sur le rebord des fenêtres des cellules ; peint en blanc. Et numéroté : 128, 129, 130, ... Seraient-ce les colombes de la Paix ? Sur l'un des rebords il y a un petit pot bleu. En bas tournent les C.R.S., les sergents de ville, ou la garde mobile, la mitraillette braquée. En haut rêvent les détenus.
Ils rêvent, ils font des songes. »
Oh, l’époque où il vit, il la voit, il l’entend, il la renifle, il l'ausculte, il en a examiné les moindres coutures, et à son gré, le tissu se découd un peu trop vite. Il voudrait ralentir la chute. La culture, la civilisation (« La civilisation ne cesse de s'effondrer sous l'énergique poussée des hommes »). La langue (« Il ne faut pas de h à Nathalie »). La grammaire, ah, la grammaire (« Pas de subjonctif après après que ») ! La création littéraire. Son éloge incessant du labeur de moine pieux du bon écrivain. L'exaltation de l’artiste peintre maître de son art. La profondeur de son regard sur l’homme qui, par son travail, fait aux hommes le don d'une oeuvre.
Et l'acuité du regard qu'il porte sur la défaite humaine face à l’avènement du règne intraitable des recettes, des concepts et des coups de pub. Devant la victoire de l’idée sur l’œuvre, et du coup de pub sur le talent. L’idée, on la doit à Marcel Duchamp. L’art confondu à la publicité, à Andy Warhol. Les deux meurtriers en chef de tout ce qui, en d’autres temps, s’est appelé « art ». C'est grâce à tout ça qu'on lui doit cette célèbre phrase :
« ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRES : IL S'ARRÊTE TOUT SEUL ».
La défaite devant le merchandising et le packaging. Le parking et le pressing. Le profiting et le n’importequ’ing. La cotation en bourse. La veuve écossaise. Les valeurs sonnantes. La Rolex à cinquante ans, le bling-bling. Accessoirement la tyrannie exercée par le succès des fausses gloires. L’inconsistance de la « surface médiatique », une surface sans profondeur, ça va de soi. La vanité des sunlights et le toc des plateaux de télévision. Ce qu'il appelle quelque part le « règne du faux ». A son époque, ce n’étaient déjà plus seulement des vues de l’esprit ou des anticipations, mais les stigmates incontestables d'une avancée irrésistible.
Vialatte a observé tout ça. Et nommé. Et envoyé à la poubelle. Avec la souveraine élégance de l’esprit dont il ne s’est jamais départi. C’est de là que lui vient le sourire désolé qui ne quitte jamais sa prose. Il sait que Rome assiégé ne pourra rien contre les barbares qui se pressent sous ses murs. Mais qu'on ne compte pas sur lui pour les laisser entrer : tout ce qu'il écrit a de la tenue.
Aucune brèche dans la muraille du style. Cette colonne vertébrale sert à se tenir bien droit. Mais en même temps une bonhomie dépourvue de prétention. Les fureurs injuriantes d’un CÉLINE ne sont pas de sa planète à lui, mais son pessimisme n'a rien à lui envier. Rien que lorsqu'il définit l'homme : « Animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la Glacière ».
Je vais vous dire un truc définitif : Vialatte est un sourire désolé posé sur le monde sinistré qui l’entoure.
L’Amérique domine ? Il s’en attriste, certes, mais il refuse obstinément de le laisser paraître. Si, bien sûr, les bulles de colère éclatent à la surface, mais c'est difficile à repérer, car c’est toujours une colère courtoise, civilisée, exprimée dans les formes. Littéraires, évidemment. Et surtout qui n’a jamais l’air d’une colère.
Il se sait impuissant contre le « mouvement de l’histoire » et contre la régression tant redoutée vers la barbarie. De ce point de vue, il me fait penser à Claude Lévi-Strauss, celui de Regarder, écouter, lire (en 1993, il a 85 ans, et il meurt centenaire en 2009, il a eu le temps d'en voir).
Comme Vialatte, Lévi-Strauss voit. Sur la fin, il sait toute la saloperie qui est en train d’arriver et qui réduit à néant tout l’effort d’élévation qui fut celui de l’homme depuis ses origines. Il ne joue pas les prophètes. Il voit agoniser un monde qui fut beau. Pas que beau (excusez-moi, mais là, c’est justifié), mais non sans grandeurs diverses. Et voyant cela, il se tourne vers l’essentiel de ce qui constitue SA culture (la mienne aussi), à lui qui a tant œuvré pour les cultures des autres, des « primitifs », comme on disait.
Dans Regarder écouter lire, Lévi-Strauss se tourne vers Poussin, Rameau, Diderot. Il ne se désole pas de l’état du monde tel qu’il est ou sera. Simplement, lui, l’anthropologue et l’ethnologue de peuplades en voie de disparition (et souvent déjà disparues) choisit de s’incliner devant trois statues en or massif, dont chacune figure à elle seule la majesté, la puissance, le génie de l'art français classique, dans la peinture, la musique et la littérature : Poussin, Rameau, Diderot.
Oh, nulle contrition dans son propos. Il assume toujours (hélas !) Roman Jakobson, l'aridité, la sécheresse universitaires de la linguistique et de l’anthropologie structurales. Mais je veux être convaincu que, en écrivant ce livre, Lévi-Strauss s’est rendu compte du destin tragique de SA culture (la mienne aussi), et qu’il y a, dans Regarder écouter lire, au moins en négatif, la manifestation d’un regret.
Sa façon de célébrer, pour finir, trois génies français d'un lointain passé désigne, au moyen même de tout le reste qu'il ne dit pas, le délabrement qu'il ressent de la culture de son époque. La célébration de cet art français vaut condamnation de ce qui se répand au présent sous le nom de culture.
Le problème, c'est qu'il a participé à la démolition structuraliste. Rien que le fait de décider que, grâce aux structures des contes, de la parenté ou de je ne sais quoi, on va pouvoir mettre l'humanité entière dans un grand sac unique, ce n'est finalement qu'une idéologie. Et je veux me dire que Lévi-Strauss s'est rendu compte de ce à quoi à servi le structuralisme : le nivellement de tout. La destruction de tous les critères (parce qu'un critère permet un jugement). Il ne faut plus juger. Cela veut dire qu'il ne faut plus différencier. L'autre est devenu le même. Le Mal, c'est le critère de jugement. Il faudra bien que j'y revienne, à cette folie.
Alexandre Vialatte lui, n’a jamais été structuraliste : il a donc eu moins à se faire pardonner. Il n'a jamais été un homme de la théorie englobante. Disons que, s’il a souri désolément, c’est d’une autre manière, plus directe et franche peut-être. La "pensée du jour" qui ouvre cette note espère en être une vive illustration. Il lui arrive même, à Vialatte, d'être terrible de noirceur.
On ne peut pas lui donner tort, tant le vingtième siècle a détruit : la première guerre de destruction des hommes (14-18), la première guerre de destruction des femmes et des enfants (39-45), mais aussi, tout au long du siècle, et de plus en plus arrogante, la première guerre de destruction américaine, pacifique et commerciale des racines des peuples, et le rouleau compresseur n'a pas fini d'avancer.
Pas de théorie donc chez Vialatte, certes, mais une méthode. Et sa méthode, il en fait cadeau : « Je ne vends pas la recette, je la donne ». Ecrivain, il a prouvé aux éclairés qu’il sait écrire des romans (Battling le ténébreux, et surtout Les Fruits du Congo, si vous ne connaissez pas, jetez-vous). Peu connu, mais estimé de confrères qui comptent, il livre donc sa recette à tous ceux – et ils sont nombreux – qui se proposent d’écrire : « Commencez par n’importe quoi », dit-il martialement.
Et plus loin : « Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi ». Ainsi, vous avez votre première page et la dernière. Quant au reste : « Mais que doit-on mettre entre la préface et l’épilogue ? Qu’on ne me le demande jamais, car je ne l’ai jamais su ». Voilà qui a le mérite de la netteté, même si ça n’arrange pas le débutant. Et l’on peut être sûr qu’il est sincère.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, fantaisie, digression, prison de la santé, paris, auvergne, grammaire, style, écrivain, marcel duchamp, andy warhol, art, publicité, télévision, louis-ferdinand céline, claude lévi-strauss, regarder écouter lire, nicolas poussin, diderot, jean-philippe rameau
vendredi, 24 août 2012
LA METHODE VIALATTE 3/5
Pensée du jour : « Tout y est dans le ton, dans le timbre, dans l'accent. C'est une immense leçon de style. Il n'est que style. Mais cherchez-y le style et vous ne l'y trouverez pas. C'est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, ordonné les fleurs dans les vases. Il est parti, ne nous laissant que la fête. Elle tient toute dans un éclairage. Le style est une fête donnée par un absent ».
Alexandre Vialatte, parlant de Jacques Chardonne (la formule magique est soulignée par moi).
***
Résumé : les livres, c’est comme les voyages. Certains écrivent des sommes écrasantes comme des systèmes solaires. D’autres se contentent de musarder au gré des chemins creux. Le véritable dilettante (c'est celui qui aime avant tout se délecter, comme son nom l'indique) est capable de bouleverser son programme à cause du son lumineux de la cloche qu’il vient d’entendre au loin, alors que la nuit va tomber.
Je dirai, pour introduire mon introduction (je ne veux pas fixer de date pour la conclusion, parce que, finalement, tant qu’on est en vie, on ne se croit jamais arrivé à la conclusion), que la digression est la vie, parce que la vie, à tout prendre, est une plus ou moins longue digression entre deux points d’une histoire qui la dépasse par tous les bouts.
Finalement, combien de gens arrivés à l’article de la mort ont l’impression de n’avoir pas vraiment achevé l'introduction, encore moins ébauché le développement ? Tout au moins de ne pas les avoir écrits comme ils auraient voulu, rétrospectivement ? Et qui voudraient tout réécrire ? Combien de paragraphes de leur vie voudraient-ils corriger ? Combien de phrases à supprimer ? Combien de vocables à mieux choisir ?
Dans le fond, chacun de nous n’est-il pas, en soi, une digression ? Une digression qui se déroule à son insu et qui ne se voit dans son entier (et encore, par temps clair : il faut au moins qu’on puisse voir le Mont Blanc depuis le Gros-Caillou, 154 km exactement en ligne droite, j'ai mesuré, moi-même en personne) qu’au moment où elle s’achève ?
C’est pourquoi, en attendant que se referme sur moi-même la parenthèse ouverte depuis lurette par l’homme et la femme qui m’ont occasionné, je ballotte aujourd’hui avec une sérénité somme toute appréciable au gré de mon petit cours d'eau, en me cramponnant à ma coquille de noix : « La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots ». Ceci pour dire que s’il y a errance, c'est le bateau qui est ivre. Je me sens accompagné par quelque autorité en la matière. Cette compagnie me tient.
Je ne sais pas si mon rafiot avance dans le courant principal, ou si, rejeté sur le côté du fleuve, paralysé par divers courants et tourbillons, je ne finirai pas comme les conquistadors montés sur l’un des radeaux d’Aguirre (Klaus Kinski), dans le sublime film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu (1972).
La digression, c’est la vie : « Va petit mousse, Où le vent te pousse, Où te portent les flots. Sur ton navire, Vogue ou chavire, Vogue ou chavire jusqu’au fond des flots » (Planquette, Les Cloches de Corneville). Louis-Ferdinand Céline aimait cette opérette.
Vous voulez en trouver une preuve en vous-même ? Par vous-même ? Souvenez-vous juste du moindre de vos repas entre copains ou en famille : à table, on cause, non ? Au bout d’une demi-heure, quelqu’un s’avise de se demander d’où on est parti.
Vous vous rappelez forcément ces moments : vous êtes partis du président Fallières (supposons), et vous en êtes arrivés au tigre du Bengale (ou à la pomme de Newton), après être passés par vos dernières vacances au camping de Sisteron, la folie de Khadafi, les « allées couvertes » du Cap Sizun, le prix du carburant, l’irruption de loups des Abruzzes dans le parc du Mercantour et l’invention de Lucy par Yves Coppens en 1974, au son d'une chanson des Beatles. Peut-être même l'entrée de René Caillé à Tombouctou le 20 avril 1828, qui vaut celle d'Alexandra David-Néel à Lhassa, le 28 janvier 1924. Presque cent ans plus tard. C'est normal, c'est une femme, et on est au 20 ème siècle.
Vous vous dites que vous tenez, dans ces errances conviviales, un compendium de l’histoire humaine, que je résumerai par une seule question : « Comment en est-on arrivé là ? ». C’est sûr, une conversation de table résume à chaque fois, à sa manière, l’histoire de l’humanité. Pour peu qu’on insiste un peu. Qu’on sache remonter au point de départ (pour Vialatte, le point de départ, c'est forcément « la plus haute antiquité »). Qu'on ait le souci de retourner dans les détails de la chose.
Que voulez-vous ? L’homme, dans sa caverne comme devant son poste, en a une vive conscience. Il aime à se demander comment il en est arrivé là. Et il tente laborieusement de reconstituer la trajectoire sinueuse, le cheminement biscornu observable depuis qu’il est parti. Parfois. Pas toujours. Parions que cette tentative de reconstitution est à l’origine de la littérature. Mais ne nous laissons pas impressionner par les plus lourds que l’air.
J’entends à l'instant dans mon casque une interpellation vibrante : « Bon alors, blogueur à rallonge, ta "méthode Vialatte", elle va finir par arriver, ou il faut aller la chercher ? », (je cite textuellement, bien sûr, je ne me permettrais pas, pensez). Sache, lecteur pressé d’arriver au bout (au bout de quoi, je le demande ?), que le fleuve, dans ses méandres les plus acrobatiques et ses détours les plus sophistiqués, ne perd jamais de vue la mer dans laquelle il jettera tôt ou tard son être tout entier.
Mon propos étant intitulé La Méthode Vialatte, j’ose affirmer que ce n’est pas pour rien, et que je n’ai garde de l’oublier. C’est pour demain, la révélation. Je le jure. A moins que … une digression se présente. De toute façon, Alfred de Musset l’a dit : Il ne faut jurer de rien (1836). J'obtempère : je jure donc de ne jurer de rien.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, jacques chardonne, dilettante, digression, méandre, mont blanc, gros caillou, arthur rimbaud, le bateau ivre, aguirre la colère de dieu, klaus kinski, werner herzog, planquette, les cloches de corneville, opérette, louis-ferdinand céline, tigre du bengale, yves coppens, alfred de musset
jeudi, 23 août 2012
LA METHODE VIALATTE 2/5
2
Pensée du jour : « Janisson [personnage d'un roman de Jean-Claude Sordelli] mène une petite vie, plus seul qu'un croûton de pain tombé derrière une malle dans un grenier de chef-lieu de canton ».
Alexandre Vialatte
***
Résumé : pour faire l'éloge de la digression, je parlais d’un cactus mexicain et de son principal alcaloïde : peyotl, objet d’un rituel chez les Tarahumaras, et la mescaline, devenue, comme tous les psychotropes chez les occidentaux, une drogue, avec accoutumance et dépendance. Car la civilisation occidentale, en même temps qu'elle constitue pour le monde le poison violent qu'elle lui a inoculé de force, a inventé quelques moyens chimiques de lui échapper tout en en exprimant la vérité foncière.
La drogue dure est la vérité ultime de la civilisation occidentale.
On voit les effets de ce cactus sur l’esprit faible (mais malin) d’un petit escroc occidental des années 1970, nommé Carlos Castaneda, passé avec armes et bagages sous l'emprise du supposé sorcier Yaqui Don Juan Matus, comme il le raconte dans un livre qui m’a, au moins un temps, fasciné : L’Herbe du diable et la petite fumée (éditions Soleil Noir, la suite (interminable) se trouve chez Gallimard, l’herbe du diable étant, je crois me souvenir, le redoutable datura). J'en suis redescendu.
Car l’auteur a très bien su récupérer armes et bagages pour transformer ses expériences initiatiques et hallucinatoires (« Don Juan, ai-je vraiment volé ? », demande-t-il après avoir atterri) en retombées sonnantes et trébuchantes, aussi longtemps qu’il fut à la mode. S’il est mort, au moins est-il mort riche.
Revenons au peyotl, ce petit cactus. C’est après avoir absorbé un peu de son principal alcaloïde que Jean-Paul Sartre écrivit Les Séquestrés d’Altona (1959), pièce dans laquelle un des personnages apparaît récurremment sur scène en vociférant : « Des crabes ! Des crabes ! ». Ceci pour traduire l’hallucination qui ne le quitta plus guère après cette ingestion de mescaline (car c’était elle). Il voyait, dit-on, des homards autour de lui quand il marchait aux Champs Elysée. Moralité : sans crabe, pas d'existentialisme. Quel dommage que Sartre ait rencontré la mescaline !
On a compris pourquoi il a cette gueule hallucinée de crapaud désordonné et fiévreux. Et on comprend pourquoi tout Sartre est ennuyeux. C’est péremptoire, je sais. Mais j'ai été membre fondateur d'un "club des péremptoires". Cela tombe bien. La même drogue produisit de tout autres effets, et combien plus admirables, chez Henri Michaux.
Pour revenir à mon sujet, j’ajouterai donc, et c’est de la pure logique, que la digression fleurit où elle est semée, et que, jusqu’à plus ample informé, le pommier ne pond aucun œuf avant d’y avoir été obligé. Peut-être même encore après. La chose reste à confirmer. L’association d’idées, dans ce qu’elle a de plus arbitraire, personnel, soudain et momentané, est la règle souveraine de la digression.
C’est vrai, vous avez des gens uniquement préoccupés de l’unité, de la cohérence, de l’homogénéité de ce qui sort de leur plume. Des obsédés de la ligne droite, de la vue d'ensemble et du but à atteindre. La ligne droite qui explique le monde, la vue qui le synthétise, et le but qui le résout. Même qu'après, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Des aveuglés de la totalisation.
Eux, ils écrivent de gros traités ou bien de grands romans. Ils sont guidés par les principes de tiers-exclu et de non-contradiction. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, dont aucune adventicité parasite ne saurait les distraire ou les détourner. Ils sont en mission. Ils veulent tout dire. "Epuiser le sujet", l'expression est révélatrice.
A eux les grandes constructions. Je ne crache pas dessus, loin de là, car ça peut produire des chefs d’œuvre inoubliables : Guerre et paix (Tolstoï), Traité de l’argumentation (livre génial et profondément humaniste de Chaïm Perelman, dommage qu’il décourage les non-spécialistes, car il se lit comme on boit du petit lait (dont je parle en connaisseur), pour moi, c'est de la littérature), L’Homme sans qualités (Musil), La Recherche du temps perdu, et autres monuments monumentaux, que le notaire du Poitou stocke sur ses rayons, au lieu de les ouvrir.
C’est comme quand vous voyagez. Il y a ceux qui ne tolèrent de voir le monde que derrière les vitres d'une bétaillère de 80 têtes, et il y a ceux qui ne voudraient pour rien au monde se confier à autre chose que leur caprice. Je suis de ces derniers.
Les Japonais ne sauraient, pour venir voir la Joconde, se déplacer qu’en masses compactes et métronomisées, selon un agenda millimétré au quart de poil, où même les moments de « liberté » octroyés sont dûment inscrits par le tour-opérateur. Et il ne s’agit pas de sortir du cadre et de l’itinéraire. Ça ne plaisante pas.
Je préfère quant à moi annoncer à ma petite famille, un jour de 1989, sur l'herbe du camping Amsterdamsebos (ci-dessus), que l'année prochaine, on ira en Roumanie. Comment ? Par où ? Combien de temps ? Avec quels points de chute ? On aura bien le temps de voir, que diable, quand on sera sur place. C'est vrai que cette manière de faire comporte quelques inconnues, quelques imprévus, quelques incidents. Ah ça, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on préfère.
Car il faut bien dire que les voyages qui vous font « faire » la Turquie ou la Grèce en 10 jours, l'oeil sur la montre et le doigt sur le déclencheur photographique, tout comme les grands plans d'ensemble, les grandes constructions, les grandes explications définitives du monde (façon Kant), les grandes idées pour le transformer (façon Marx), et pour tout dire, les systèmes qui vous livrent le monde clé en main, tout le monde n'est pas fait pour. Je connais des allergiques.
Et que, face au voyage entièrement packagé et acheté prêt à l'emploi, comme face à l’énormité des ambitions encyclopédiques et totalisantes, appauvrissantes et accumulatrices, mesquines et simplificatrices, face à ces laboratoires où l’homme expérimente son absence ou sa destruction, il y a place pour le fragment, l'anecdote, le détail concret, la musarderie, le nez au vent, le chatoiement de la lumière dans le sous-bois. La vie.
Bref, il y a place pour Alexandre Vialatte (le voilà !), ses frères, ses cousins, sa parentèle. J'ai tendance à me sentir de cette famille. Il y a place pour la flânerie : sans but et curieuse de tout. Flânerie n'est pas vide ou désoeuvrement. Oui, appelons ça la vie. Quoi, au ras des pâquerettes ? Bien sûr. A quelle altitude croyez-vous vivre ? Relisez la dernière phrase des Essais de Montaigne : « Si avons-nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde si ne sommes assis que sus nostre cul ». Parfaitement, c'est la dernière phrase.
Ce n'est pas du haut d'un char d'assaut à touristes que vous aurez pu, un jour, comme ça, poser votre vélo sur le talus d’un chemin des « marais », et vous asseoir à penser à rien. La Bourbre est juste là. Et puis vous regardez quelques feuilles mortes, à deux mètres. Ça bouge, ma parole. Bizarre. Quelque chose grabote en dessous. Ça crisse. Vous ne rêvez pas. Et puis elle apparaît, la taupe, elle est sortie de ses souterrains pour varier le menu, elle en a assez, du sempiternel ver de terre.
Vous vous souviendrez même longtemps, dans la chair de vos doigts, de la défense acharnée qu'elle vous a opposée, quand l'idée saugrenue vous a pris de la capturer. Un conseil : méfiez-vous des dents. Même les griffes ne sont pas à négliger.
Alors je demande quelle théorie scientifique, quel système philosophique, quelle conclusion sur le sens de la vie ou l'existence de Dieu voulez-vous tirer de ça. Pas lerche ! Contentez-vous de saisir l'instant, voilà. Ce n'est pas Imanuel Kant qui peut se vanter d'avoir observé une taupe in vivo. En tout cas, il n’en fait pas état dans Critique de la raison pure. Selon moi, il a tort.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, alcaloïde, peyotl, tarahumaras, psychotrope, drogues dures, carlos castaneda, l'herbe du diable et la petite fumée, yaqui, don juan, jean paul sartre, théâtre, les séquestrés d'altona, mescaline, hallucination, henri michaux, association d'idées, léon tolstoï, guerre et paix, chaïm perelman, traité de l'argumentation, robert musil, l'homme sans qualités, la recherche du temps perdu, roumanie, kant, marx
mercredi, 22 août 2012
LA METHODE VIALATTE 1/5
Pensée du jour : « Aussi les pères de famille avisés attachent-ils par une corde courte au piquet central de la tente les grand-mères et les enfançons. Une barrière de barbelés isole du monde ces radeaux de la Méduse. Un haillon vert y sèche à côté d'une loque rose. La vache vient, contemple et s'étonne, le prisonnier se souvient et passe, le promeneur regarde et fuit épouvanté. C'est ce qu'on appelle un camping de vacances ».
Alexandre Vialatte
***
Je m’adresse aujourd’hui – j’aime autant annoncer la couleur –, à ceux de mes lecteurs que je déboussole, que je décontenance, que je dépayse, que sais-je, que je dérange, déroute, voire désarçonne ou désoriente (j’en ai d’autres dans la musette, au cas où …, par exemple « agace ») par la tentation à laquelle je cède un peu trop volontiers, de me laisser, faute de rigueur intellectuelle, embarquer dans des « arabesques », comme les appelle Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-Tombe, c'est-à-dire des « digressions » (« parabases », pour les amateurs).
La digression, parfaitement, voilà l’ennemi, paraît-il. Je me propose de traiter le sujet en tant que tel, dignement, et de le traiter d’une manière formellement idoine à la matière. « Il ne faut pas confondre la forme et le fond », proclamait pourtant, affolé, Monsieur René Bady, dans un des cours les plus mouvementés (il n'avait jamais eu autant d'auditeurs) de sa tranquille histoire de professeur d’université. Il reste l’auteur d’une thèse de doctorat qui est restée dans les mémoires : tout le monde se souvient de De Montaigne à Bérulle. La modernité lui a répliqué : « La forme doit épouser le fond ».
Le pauvre homme, qui était admirablement humble et catholique, ne s’y est pas retrouvé. Le garnement infernal que je fus se souvient des cours sur l’ode au 16ème siècle (aussi, a-t-on idée !) : le cours durait quelques minutes, avant d’être sommairement exécuté par les ballons bondissant de mains en mains. Malheureux René Bady ! Tout perclus de savoirs précieux, mais sortis de l’usage et du respect, il rangeait tristement ses notes sérieuses et quittait l’amphithéâtre, accompagné de nos aboiements féroces et déracinés.
Cette série de notes se propose rien de moins que de faire l'éloge du contournement, de la trajectoire déviée, de l'embardée poétique et du désir de musarder en route au lieu d'aller bêtement d'un point à un autre en TGV. Car ces lecteurs bienveillants, mais exigeants, me reprochent de faire comme les parents du Petit Poucet, je veux dire de vouloir les perdre dans la forêt. L'enjeu est de taille, on en conviendra.
Je réponds d’urgence à ce reproche, dans un premier temps, que les cailloux blancs ne manquent jamais chez moi pour retrouver le râtelier parental, même quand il n’y a rien à y ruminer. Je veux dire que ma flèche ne perd jamais de vue le centre de la cible, ni le terme final de sa trajectoire ondulante et sinusoïdale. Que le Nord est toujours inscrit au fronton de ma boussole capricieuse.
Dans un deuxième temps, je dirai que la tentation est une chose trop sérieuse pour ne pas appeler une réponse vigoureuse et adéquate. Il faut y réagir vivement pour en prévenir les effets néfastes. La tentation ? Quelle horreur ! Le mieux est donc d'y céder aussitôt qu’elle se présente. Et de réserver les éventuelles velléités de résistance pour des combats plus formidables et plus essentiels.
Cette solution lumineuse, simplissime et fructueuse me fut dévoilée un beau jour, en dehors des adventicités naturelles du quotidien, dans un petit livre que je recommande vivement : La Papesse Jeanne, d’Emmanuel Rhoïdès (ou Roïdis, éditions Actes-Sud). Je ne l’aurais sans doute jamais lu s’il n’avait pas été traduit en français par Alfred Jarry en 1900 et des poussières.
Revigorant, et même coruscant. Je le confesse : il prêche une morale que les normes admises, certes, désavoueraient, mais qui le fait de façon si aimable, et sur un ton si espiègle que les normes elles-mêmes se disent qu'au fond, pourquoi pas ?
Les esprits perspicaces ont déjà perçu la digression qui me tend les bras : c’est quoi, cette histoire de « Papesse Jeanne » ? Pour vous montrer que le pire n’est pas toujours sûr, sachez que, pour une fois, je ne céderai pas à la tentation. Même si vous aimeriez bien en savoir plus. Le devoir avant tout. Plus tard peut-être. En attendant, voici une photo prise à l'époque des faits relatés (et qui illustre le scandale).
Dans un troisième temps, qu’on se le dise, si la notion de « digression » (ou d’« excursus ») existe, ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Or, il faut savoir que tout ce qui a été inventé par l’homme depuis la nuit des temps, l’homme s’en est servi, de la fourchette à la bombe atomique, en passant par le pédalo, la pince à épiler, le ticket de métro, l’assiette anglaise et le soc de charrue. Mais sait-on encore ce qu’est une « assiette anglaise » ?
J’ajoute que, si c’est à ma disposition, je serais bien bête de ne pas en profiter : après tout, la digression n’est pas faite pour les chiens. C’est vrai, ça : un chien, même mal éduqué, ne digresse jamais. La digression est hors de portée du règne animal. Le règne animal se déroule en ligne droite. Enfin je crois.
Et comme la digression est gratuite, elle est dans mes moyens. Dans le jardin où l’on cultive toutes les fleurs de rhétorique de la création, « chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite » (Georges Brassens, pour retrouver le titre, je vous laisse faire).
De toute façon, dit Antonin Artaud (c’était avant les électrochocs aimablement et doctrinalement administrés par le docteur Ferdière, dans son service psychiatrique de Rodez) : « Il n’y a pas d’art au Mexique, et les choses servent ». Il était en villégiature chez les Indiens Tarahumaras, dont il appréciait le plat principal, le cactus nain appelé « peyotl », chargé de forces mystérieuses. Après tout, c’est peut-être au peyotl qu’il la doit, Artaud, son « exaltation » ?
Pour la suite de la digression, merci d'attendre à demain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, chroniques de la montagne, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, digression, parabase, méandre, montaigne, déviation, petit poucet, la papesse jeanne, emmanuel rhoïdès, alfred jarry, morale, brassens, antonin artaud, rhétorique, docteur ferdière, peyotl, cahiers de rodez, tarahumaras, drogue
samedi, 11 août 2012
METEO DES JEUX
Pensée du jour : « Les Sioux ont l'accent chinois, leur manière de vivre est celle des Tartares.» (ABBE FLEXIER DE REVAL, 1735-1802).
Résumé : nous disions donc : « La chaussure, voilà l’ennemi ».
C’est ce que se disait DENIS DUFOUR, compositeur attachant que j’ai rencontré du temps où je ne manquais rien de ce qui se faisait en musique contemporaine. Lui, son truc, c’était la musique électro-acoustique. Ne pas confondre avec HUGUES DUFOURT, adepte d’une musique moins contemporaine, puisqu’elle se joue avec de vrais instruments fabriqués par des ébénistes. 
DENIS DUFOUR marche pieds nus, qu'on se le dise (Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, extraordinaire texte de KNUT HAMSUN, Dix portraits, …). Parce que, m’a-t-il dit – et ce n’est sans doute pas dénué de vérité –, ne pas avoir de semelle permet de ressentir des vibrations physiques que ne perçoit pas l’oreille. L’avantage, c’est que, vu la couleur de ses pieds le soir, il ne risque pas qu’un quelconque lèche-bottes vienne lui faire des compliments sur sa musique, puisqu’il n’en a pas, de bottes. Le pied nu constitue, en quelque sorte, le fin du fin du retour à la nature.
Ce qui prouve par a + b que l’homme, en inventant la chaussure, s’est séparé de la nature il y a 4000 ans, quand il interposa entre lui et le sol une lamelle de cuir plus ou moins épaisse. De plus en plus perfectionnée. Pour s’épargner les injures faites à son pied par les cailloux du chemin. Nous sommes devenus trop sensibles, voire hypersensibles.
Un rien (qu’est-ce que 15 cm de neige ?) nous pousse à l'émeute contre nos dirigeants. Plus nous avons perfectionné et accru notre confort, plus nous sommes devenus vulnérables, craintifs et vindicatifs. Peut-être voudrions-nous reconstituer les conditions de la maternation originaire. Attendons-nous, dans ce cas, à quelques déconvenues funestes.
Ce qui prouve accessoirement que les travaux d’Hercule (qui vainquit Antée, en le privant de tout contact avec la Terre, qui n'était autre que sa mère Gaïa, et on considère encore aujourd'hui que ce fut un progrès)  ont accéléré le mouvement de rejet de la Nature. A mon avis, Hercule avait des chaussures aux pieds. Ah, qui dira le joli temps des écuries d’Augias (« les deux pieds les deux mains dans la merde ») ? Hydre de Lerne, reviens parmi nous !
ont accéléré le mouvement de rejet de la Nature. A mon avis, Hercule avait des chaussures aux pieds. Ah, qui dira le joli temps des écuries d’Augias (« les deux pieds les deux mains dans la merde ») ? Hydre de Lerne, reviens parmi nous !
Cela nous en dit long, soit dit en passant, sur les chances que l’homme industriel a de se réconcilier avec sa planète. C’est vrai que j’ai perdu pas mal de mes capacités à lover mes côtes et mes vertèbres entre les cailloux et les racines des terrains de camping. J’ai noté, en particulier, que les racines de pin sont résolument invincibles.
C’en est même un brin paradoxal, vous ne trouvez pas ? Ben oui, quoi, plus nous nous fleurbleuisons, plus nous nous écologisons, plus nous nous renaturisons sous l'égide de MAMÈRE NOËL (je ne peux pas croire que les parents ne lui ont pas joué un tour en lui donnant ce prénom) et CECILE DUFLOT (qui ne s’est pas risquée à accepter un poste de ministre de la Nature), plus nous avons peur que la Nature nous fasse du mal (tsunami, éruption, cyclone …).
Mais allez marcher pieds nus sur les trottoirs de nos villes, aujourd’hui ! Nos trottoirs rendraient indispensables et obligatoires, d’une part, le pédiluve (dans le temps, on disait « bain de pieds »), du fait de la caniphilie urbaine généralisée, et d’autre part la boîte à pharmacie, pour réparer les dégâts commis par les débris de bouteilles de bière. Il faut savoir que la merde de chien et la bouteille cassée sont le principal apport de la modernité au trottoir urbain macadamisé. Vivre sans chaussures en milieu aussi hostile, c’est accepter de vivre dangereusement. La Nature s'éloigne de l'homme inexorablement. A moins que ce ne soit l'inverse.
N’empêche que, quoi qu’on dise, courir sans semelle entraîne une flexion accrue : l’amorti en devient articulaire ! Je n'invente rien. Courir pieds nus permet d’éviter les ampoules et de limiter les risques de tendinites. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est scientifique. Les mêmes scientifiques affirment que si la fantaisie vous prend de vous mettre au « freedom running », mieux vaut y aller doucement.

Progressivement. Fiez-vous aux marques : elles ont d’ores et déjà inventé la chaussure minimaliste, semelles fines comme des crêpes et « five fingers » pour ganter les doigts de pieds.

MAIS POUR CE PIED, QU'EST-CE QU'ON FAIT, DOCTEUR ?
ON APPELLE CELA POLYDACTYLIE : IL Y A ENCORE PLUS FORT

SEIZE ORTEILS A LA NAISSANCE : QUI DIT MIEUX ?
En six ou douze mois, quand vous aurez usé huit paires de semelles fines et de « five fingers », vous pourrez passer au « barefoot » et au « freedom running ». Les marques ont même inventé les « barefoot shoes ». Comme disait ALEXANDRE VIALATTE, « le progrès fait rage ».
Vous pourrez même, suprême raffinement, vous passer de toute chaussure. Après avoir, nous l’espérons, contribué de vos deniers au redressement productif des entreprises spécialisées dans la semelle fine et dans la « barefoot shoe ». Pendant six à douze mois. Mais restez prudent. Oui, à ce moment, il est alors possible d’effectuer quelques sorties pieds nus. Et rendez-vous compte, vous verrez de la corne, carapace naturelle de la peau, se développer autour du pied afin de le protéger. Comme disait ALEXANDRE VIALATTE : « On n’arrête pas le progrès : il s’arrête tout seul ». C’est fort bien dit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chaussure, société, france, jeux olympiques, musique contemporaine, denis dufour, acousmatique, knut hamsun, hercule et antée, gaïa, écologie, nature, noël mamère, cécile duflot, alexandre vialatte, le progrès fait rage, godasse, progrès, culture, five fingers, barefoot runners, freedom running, polydactylie
mardi, 07 août 2012
TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ?
Météo des Jeux : bonne nouvelle, USAIN BOLT et quelques autres sont enfin parvenus à parcourir 100 mètres. Certains en doutaient. Les voilà rassurés. Ils s'en félicitent. Moi je dis : peut mieux faire. J'espère qu'ils pourront aller un peu plus loin, parce que, franchement, quand tu as fait 100 mètres, tu n'as rien fait, ou si peu que rien. Ils n'ont plus qu'à persévérer s'il veulent arriver au bout.
Prêts pour une Grande Digression Symphonique, en forme d’entrée en matière ?
« Tintinophile », qu’est-ce que ça veut dire ? D’abord et déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu’est un « colombophile ». Si vous pensez que c’est un fan de l’acteur PETER FALK (lieutenant Columbo),  un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.
un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.
Le colombophile fait travailler les pigeons pour lui, pour son compte, pour son seul plaisir, gratuitement. C'est une sorte de maquereau, quoi. Sauf que ses putes lui rapportent nib de nib. Disons qu'il s'est fait souteneur pour soutenir la cause. C'est du dévouement, je me tue à vous le dire. La preuve ? Il offre gratuitement le gîte et le couvert à ses gagneuses et à ses gagneurs. C'est bien le moins, vous avouerez.
Pour ce qui est du gîte, certains colombophiles fanatiques, voire enragés, n’hésitent devant aucune folie dispendieuse, comme en témoigne cette photo d’un authentique pigeonnier, digne d'être homologué hôtel cinq étoiles (quoique sans ascenseur ni salle de bains), quelque part dans le nord-est de la France. On peut dire que R. n’a reculé devant aucun sacrifice pour offrir à ses oiseaux le luxe le plus tapageur et le plus extrême.
DANS UN PAREIL 5 ETOILES, TRES PEU DE PIGEONS SE PLAIGNENT DE LEUR SORT
(ET LES ROUCOULEMENTS DE MASSE, IL PARAÎT QU'ON S'Y HABITUE)
Mais en contrepartie, disons carrément que R. exploite honteusement la capacité innée que ces volatiles ont de retrouver leur nid après en avoir été honteusement éloignés à dessein. Au top départ, toutes les cases du camion collecteur s’ouvrent brusquement, dans la région de Narbonne, libérant les pauvres bêtes, dès lors obligées de se creuser la cervelle (sans carte et sans boussole, s’il vous plaît !) et de se rapatrier par leurs propres moyens vers les brumes du nord-est. Le taux de réussite est généralement bon, mais l'aventure connaît parfois quelques ratés, on est obligé de le reconnaître.
Il m’est en effet arrivé de convoyer jusqu’à son point d’origine (enfin, disons pas loin) un de ces malheureux oiseaux qui s’était égaré pas trop loin de chez moi (à 600 km de chez lui, quand même !), pour le restituer (gratuitement, s’il vous plaît, mais combien volontiers !) à son propriétaire. Il lui manquait beaucoup, paraît-il. Pourtant, les 399 autres qu’il possède (authentique, évidemment) devaient l’occuper largement. Que voulez-vous, aurait dit LAMARTINE, « un seul pigeon vous manque, et tout est dépeuplé », n’est-ce pas, R. ?

LUI, C'EST "RED CHAMPION"
(c'est un vrai de vrai, bien sûr)
Le colombophile, c’est donc celui qui aime les volatiles de course (y compris à table, farcis, à condition qu’ils soient jeunes, et là, à table, je me suis aperçu que moi aussi, j'avais des tendances colombophiles), qui gagne des trophées à la sueur de leur front (qu’ils ont fort étroit, par bonheur), qui les laisse régulièrement se dégourdir les ailes pour s’entraîner, en priant cependant le dieu des pigeons qu’aucun autour des palombes, qu’aucun faucon pèlerin ou autre nuisible ne rôde par là ou ne s’est mis à l’affût dans le coin. En un mot, c’est quelqu’un qui ne compte ni son temps, ni son argent, ni son énergie pour perpétuer une espèce qui, par bonheur et pour cette raison, n’est pas en voie de disparition.
EN PLUS, ILS SONT BEAUX, NON, LES CHAMPIONS ?
CE N'EST PAS DU PIGEON DE VULGUM PECUS !
Bon, pour un préambule, ça commence à faire très long. Je me suis encore laissé entraîner, ma parole. Aucune rigueur, tout dans les « arabesques ». Vous pourriez me le signaler, quand ça se produit ! M'arrêter ! Pourtant, je vous jure, j’essaie de me refréner. Mais à chaque fois, ça y est, le démon me reprend, la digression me tend les bras, et je m’y jette avec emportement. Il ne faudrait pas, avec ça, que l’envie me prenne, un de ces jours prochains, d’enseigner ou de devenir professeur. Vous voyez d’ici la catastrophe ?
Imaginez-moi en professeur qui commencerait sur « Mignonne allons voir … » et qui déboucherait sur le burnous trop vaste de RENÉ CAILLÉ, premier blanc arrivé à Tombouctou. C’était le 20 avril 1828. Il profitait de ses larges manches pour griffonner des notes au crayon sur son petit carnet. Là-dessus, vous avez bien compris que je pourrais embrayer sur les djihadistes actuels d'AQMI qui détruisent des mausolées musulmans. Décidément, l'Islam est de plus en plus énigmatique. Mais ici, comme vous le constatez, je résiste à la digression.

Vous voyez ? Une digression, c’est si vite fait. Presque pas le temps de s’en apercevoir. Je tâcherai donc de m’orienter, pour gagner mon pain, dans une autre branche professionnelle que l’Education Nationale. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Si Dieu et le Conseiller d’Orientation n'en décident pas autrement.
Cela donnerait aux rabat-joie de l’anti-France (quand reviendras-tu, Super Dupont ?) une occasion nouvelle de crier au déclin des valeurs, des brosses à dents et du confit de canard. J’éviterai par conséquent de prêter le flanc. De toute façon, je ne suis guère prêteur. Surtout du flanc. Ah si, pourtant : je ne sais plus à quel ami j’ai prêté mon coffret Catalogue d’oiseaux d’OLIVIER MESSIAEN, auquel je tiens tant. Si vous l’apercevez, merci de me tenir au courant.

En revanche, j’ai retrouvé (par hasard) la personne à laquelle j’avais prêté Antiquité du grand chosier d’ALEXANDRE VIALATTE. Et si à ce jour je n’ai pas recouvré mon livre, j’ai du moins retrouvé le sommeil. Conclusion ? J’admire les gens qui, contre vents et marées, savent résister à la digression. Quelle fermeté d’âme est la leur ! Vous avez ci-dessus un compendium de ce qu'il ne faut pas faire, quand on prétend avoir de la fermeté dans l'âme.
Remarquez, je me rappelle les cours du vendredi à 14 heures, avec Monsieur DELMAS, alias Le Baron. C’était, au moins sur le papier, de l’histoire-géographie. Mais c’était une matière qui pouvait aller du montant d’un salaire à consacrer au loyer par un jeune ménage aux souvenirs bretons de vacances de rêve remontant à l’été dernier, en passant par l’immense intérêt qu’il y a pour la jeunesse à apprendre les langues étrangères. Le vendredi à 14 heures, Monsieur DELMAS était le roi de l’ « arabesque » ainsi entendue.
Car, contrairement aux cours qui avaient lieu tôt le matin, la figure de Monsieur DELMAS, à ce moment de la journée, arborait une teinte qui variait, suivant les semaines, et selon les menus et les quantités absorbés au restaurant voisin en compagnie de quelques collègues, du rubescent à peine marqué, au cramoisi le mieux venu, en passant par toutes sortes d’enluminures cuivrées, de pourpres congestifs et de flammes incarnates. Il n’y a pas à en douter, le gras double, le tablier de sapeur et le Chiroubles du patron de « La Meunière », rue Neuve, à deux pas du lycée Ampère, avaient le don d’inciter Monsieur DELMAS à l’arabesque.

LES SALLES D'HISTEGEO ETAIENT AU DERNIER ETAGE, DROIT DEVANT
Promis, après cette « mise en bouche », dès demain, j’en arrive à Tintin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, les aventures de tintin et milou, jeux olympiques, usain bolt, digression, colombophilie, pigeons, christophe colomb, peter falk, columbo, lamartine, rené caillé, tombouctou, mignonne allons voir si la rose, éducation nationale, super dupont, olivier messiaen, catalogue d'oiseaux, alexandre vialatte, antiquité du grand chosier, monsieur delmas, lycée ampère
vendredi, 13 juillet 2012
JE SUIS RESTE BRASSENS
Les Amis de Georges, c’est une chanson de MOUSTAKI GEORGES, mais en l’honneur de BRASSENS GEORGES. Mon histoire avec GEORGES BRASSENS est très ancienne, je crois l’avoir déjà dit. Avec MOUSTAKI, l’intérêt est forcément plus récent, mais c’est aussi situé dans des couches plus superficielles. Certains explicateurs professionnels l’expliqueront certainement par des raisons professionnelles qui, par des raisons générationnelles que.
Je m’en fiche : c’est comme ça. C’est comme le copain qui tentait l’autre jour de me convaincre que tout le monde, des années 1950 à 1972 écrivait comme ALEXANDRE VIALATTE. Excuse-moi, R., mais quelle ânerie ! Ou qu’ALLAIN LEPREST fait partie d’une « génération » de chanteurs « à texte ».
Faire disparaître, au nom de je ne sais quelle « conscience historique » dépravée, l'original du spécifique et le singulier de l’individuel dans la soupe du collectif et l’indifférencié du « générationnel » me semble relever d’une Chambre Correctionnelle, voire d’une Cour d’Assises. Il faudra que je pense à lui dire, tiens.
Je suis resté BRASSENS. Qu'on n'attende pas de moi d'autre déclaration.
Chez mes grands-parents, ceux de « la campagne », pas ceux de « la ville », il y avait un « tourne-disque » (le mot est paléontologique), et dans le placard de la chambre à trois lits (pour les enfants), il y avait deux disques 25 cm, 33 tours : le premier de YVES MONTAND, avec, entre autres, « Les Grands boulevards », chanson que je sais encore presque par cœur, et « Battling Joe », le second de GEORGES BRASSENS, avec, entre autres, « Les Amoureux des bancs publics ». J’avais huit ans.
Cette chanson m’est spécialement restée à cause de mon oreille : vous ne savez sans doute pas ce qu’est un « toizard des rues ». Rassurez-vous : moi non plus. Mais j’ai mis longtemps avant de comprendre. J’entendais : « ces « toizards » des rues, sur un de ces fameux bancs ».
J’ai mis du temps à comprendre qu’il fallait entendre : « Que c’es-t au hasard-des rues, sur un de ces fameux bancs, qu’ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour ». L’histoire du soldat Séféro est plus connue : « Entendez-vous, dans les campagnes, mugir Séféro, ce soldat ? ». On ne se méfie pas des cerveaux d’enfants disponibles aux pires malentendus. Au sens propre de « malentendu ».
Franchement, je suis moins sûr de l'histoire du soldat Séféro. Parce que les "toisards", c'est pris dans le ciment des fondations du bâtiment, comme le cadavre de celui qui commence sa longue nuit dans le pilier nord du tout nouvel hôtel qu'on a construit Via Vittorio Emanuele. C'est à Palerme. On est en Sicile. Alors que "Séféro", ça fait une trouvaille, disons, plus collective.
Mine de rien, le sens propre de « malentendu », ça peut faire de gros dégâts. La preuve, c’est que c’est ainsi que j’ai perdu la foi chrétienne. J’exagère à peine : du fond du chœur de l’église Saint-Polycarpe (j'étais encore dans mon uniforme de scout de la 44ème GUY DE LARIGAUDIE, réunions tous les jeudis dans le local paroissial donnant sur la cour, au 16 rue Pouteau, tout en haut de l'escalier), après avoir compté les tuyaux de façade de l’orgue magnifique (au nombre de 91), je tentais de saisir les mots de l’homélie que prononçait le Père BEAL (le même que celui des putains de Saint Nizier, d’ULLA et de ses collègues de travail, quelques années plus tard).
Je suis cependant resté BRASSENS. Qu'on n'attende pas de moi d'autre déclaration.
Mais la réverbération des sons jouait des tours à la clarté du saint message. Elle faisait parvenir à mon oreille – depuis longtemps encline à la musique – une espèce de magma sonore qui me plaisait beaucoup et qui, rétrospectivement et par analogie, me fait penser à ces images conçues par ordinateur, donnant à percevoir une forme précise, mais seulement après juste accommodation. Mon oreille adorait rester dans le flou de la perception approximative, comme l'oeil normal devant l'assemblage énigmatique de l'image avant l'accommodation.
Comment expliquer ce que j’entendais ? Me parvenait une sorte de pâte onctueuse et profondément spatiale, où le sens exact des mots se perdait tant soit peu dans les ricochets des sons sur les voûtes, comme le goût du champignon dans la sauce forestière : tu ne le sens pas, mais tu sais que, s’il n’était pas là, il manquerait.
Je suis resté BRASSENS. Qu'on n'attende pas de moi d'autre déclaration.
Dans mes derniers temps de fréquentation des confessionnaux et des églises (j’allais sur mes dix-sept ans), l’unique raison de ma présence dans le lieu sacré était mon espoir de perdre le sens des mots du prêtre dans une sorte de jus auditif, dont l’espace architecturé de Saint-Polycarpe se chargeait de fournir à mon oreille la mixture musicale. J’étais mûr pour accueillir les Cinq Rechants d’OLIVIER MESSIAEN. J’étais mûr pour des expériences musicales d’avant-garde. Je n’y ai pas manqué.
A moi, les Quatre études chorégraphiques de MAURICE OHANA. A moi, les Huit inventions de KABELAC, par Les Percussions de Strasbourg. A moi, d’IVO MALEC, Sigma, Cantate pour elle, Dahovi, Miniatures pour Lewis Carroll. A moi, Epervier de ta faiblesse, de STIBILJ, sur un poème d’HENRI MICHAUX, Alternances, de SHINOARA, Signalement, de SCHAT. Les trois disques (Philips, collection "Prospective 21ème siècle") ont reçu le Grand Prix International du Disque de l'Académie Charles Cros). J'indiquerai les numéros à qui les demandera, promis.
Malgré tout ça, je suis resté BRASSENS. On n'obtiendra pas de moi d'autre déclaration.
JE ME SUIS FAIT TOUT PETIT
(même les sous-titres espagnols sont à croquer,
d'ailleurs, PACO IBANEZ chante BRASSENS à la perfection,
écoutez donc sa "Mala Reputacion")
Tout ça, n’est-ce pas, ça vous forme une oreille. Ou bien ça vous la déforme. C’est aussi une possibilité à envisager. C’est vrai que, quand tu es jeune, tu as surtout envie de « vivre avec ton temps ». Mais « vivre avec son temps », c’est un stéréotype qui devrait à ce titre être banni des esprits, et passible d’amendes extraordinaires devant un tribunal. Ben oui, quoi, c'est de l'ordre du « générationnel ».
C’est ainsi que j’ai été diverti, converti, reconverti : je suis passé directement de la foi catholique au free jazz. Et à tout ce qui se faisait de mieux (= de plus inaudible), en matière de musique contemporaine.
Mais ça ne m’a pas empêché de rester BRASSENS. Je n'ai rien d'autre à déclarer, monsieur le délicieux Commissaire du Peuple.
TRES BELLE VERSION DES COPAINS D'ABORD
DANS LA SALLE, ON APERCOIT FUGITIVEMENT
RAYMOND DEVOS, RENE FALLET...
Hélas, je n'étais pas dans la salle de Bobino, en ce jour de 1972. Je conseille aux vrais amateurs d'écouter AUSSI les trois dernières minutes, pour bien se mettre dans l'ambiance incroyable de la salle. TONTON GEORGES est là, avec un visage qui change d'expression à chaque seconde : il est fatigué, il a envie de s'en aller, mais il n'ose pas. Par politesse, peut-être ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : georges brassens, georges moustaki, les amis de georges, alexandre vialatte, allain leprest, yves montand, les grands boulevards, battling joe, les amoureux des bancs publics, église, chrétien, catholique, messe, orgue, saint polycarpe, saint nizier, olivier messiaen, cinq rechants, maurice ohana, ivo malec, henri michaux, poésie, free jazz
mardi, 10 juillet 2012
DES GOGUES ET DES GAGS
Pensée du jour : « Le vrai est trop beau ou trop triste pour qu’il ne faille pas lui donner l’air d’une plaisanterie. » ALEXANDRE VIALATTE
Résumé de l’épisode précédent : une société de masse est une énorme usine à produire de la fiente, de la crotte, de la déjection, de la fèce, de la selle, voire de la scybale ou du fécalome, pour ne rien dire du colombin, du pruneau, du rondin ou de la tartissure.
Et en même temps, la solution de l’évacuation industrielle de toute cette matière humaine fait disparaître celle-ci aux yeux de tous, au point que, excepté les chiens sur les trottoirs bien aimés de nos villes, nul n’est prêt à offrir en spectacle public son derrière en pleine action expulsatoire, et que chacun prend soin, au contraire, de verrouiller la porte.
C’est d’ailleurs cette espèce de tabou qui ouvre la voie à quelques joyeux transgresseurs, professionnels ou non. La scatologie, tout le monde sait ce que c’est, et tout le monde a tendance à mépriser. Il n’en a pas toujours été ainsi, et il suffit de se tourner vers RABELAIS ou BEROALDE DE VERVILLE pour se rendre compte que le caca faisait partie du quotidien. La merde faisait partie intégrante de la vie de tous les jours. Le tuyau d'évacuation, l'égout, le collecteur et la station d'épuration ont expédié ce moyen âge dans les poubelles de l'histoire.
Tout le monde, de nos jours, sait que le Versailles de Louis XIV était dépourvu de toilettes et que toute la cour qui y déambulait baignait dans des arômes qui nous feraient fuir. Je n’ose imaginer ce que cela pouvait être les jours de grande chaleur. Mais au moins, c’était une odeur familière, à laquelle on était bien obligé de s’habituer. Nous sommes devenus hypersensibles. C’est le Tarzan de GOTLIB, dans le n° 1 de L’Echo des savanes (1972), qui le dit : « Hommes civilisés bien délicats ».
C’est certain : on a fait un chemin prodigieux, depuis Versailles, où les mieux équipés possédaient une « chaise d’affaires », encore appelée « chaise percée » ou « cabinet d’aisance ». Le meuble, qui pouvait être luxueux, couvert de laque du Japon, était rangé dans la « garde-robe », d’où, par métonymie, cette curieuse appellation (« Monsieur est à sa garde-robe »). Au moins, on savait manier les images et les figures de rhétorique.

CHAISE D'AFFAIRE, OBSERVEZ LE STYLE LOUIS XVI
Et je ne suis pas remonté aux Romains, qui ne se formalisaient guère de quelque atteinte à la bienséance, et allaient sans façon dans des lieux collectifs, où chacun pouvait, en quelque sorte « faire son trou ».

LE DERNIER SALON OÙ L'ON CAUSE
Aujourd’hui, nous sommes devenus à cet égard d’une pusillanimité presque drôle, et le moindre remugle de toilettes sales nous chatouille les narines désagréablement et nous fait déserter un établissement dont l’installation laisse à désirer pour ce qui est de l’hygiène et de la propreté. J’ai connu une personne qui, quand elle entrait dans un restaurant, n’avait rien de plus pressé que de vérifier l’état des lieux et, en cas de répugnance, de partir en courant. Je l’ai dit : il y a comme du tabou dans la chose. Et ce ne sont pas les directives de la Commission (la grosse ?) Européenne qui vont arranger les choses.
C’est ce tabou qui permet, par exemple, à COLUCHE de faire hurler de rire son public qui se lâche (« Respirez par le nez, madame ! »), en racontant, dans La Publicité, à sa façon, la « campagne jumelée » des dragées Fuca et d’Ajax WC. Je n’y reviens pas, tout le monde connaît ça par cœur. J’ajoute seulement que le vraiment scato n’arrive qu’à la 6ème minute dans la vidéo Youtube (8’25).
Moins connue peut-être, une scène du Fantôme de la liberté, de LUIS BUÑUEL. Le cinéaste ne se bouscule pas l’intellect : en bon surréaliste, il se contente d’inverser les perspectives et le code des convenances, un peu comme des ethnologues africains ou amazoniens (formés dans des universités européennes ou européennes, je le note en passant) viennent aujourd’hui étudier les peuplades européennes et leurs coutumes – forcément exotiques en diable, puisqu’elles se sont étendues à toute la planète.
Voici la scène en question (pas trop longue) qui, à la reniflée à plusieurs dizaines d’années de distance (1974), sent terriblement son mai 68. J’y vois quant à moi l’extraordinaire et veule facilité du procédé hérité de l’Oulipo, qui consiste à poser comme hypothèse : « Et si on inversait tout ? ». Oui, on peut tout inverser, sauf dans la réalité.
Avant d’en finir avec ces modestes considérations sur les « matières » et sur les « lieux », je propose un petit détour par le Japon. Ce pays, en effet, est célèbre pour sa vénération profonde des questions d’hygiène, ainsi que pour les recherches poussées qu’il a menées s’agissant des questions d’évacuation.
Commençons par ce petit film d’animation merveilleusement conçu, destiné à habituer l’enfant à déposer son obole quotidienne dans un lieu réservé à cet effet, mais aussi à consentir à s’en séparer chaque fois à jamais (les psychologues sont passés par là). C'est pédagogique et moderne en diable.
Poursuivons avec un aperçu, certes non exhaustif, mais néanmoins pittoresque des toilettes justement renommées qu’on trouve aujourd’hui sur l’archipel, du rustique moderne …

ET IL FAUT SE TOURNER VERS LE CÔTE INCURVE

ET AVEC LE MODE D'EMPLOI, S'IL VOUS PLAÎT
(y compris la mise en garde contre les pertes d'équilibre)
Jusqu’au dernier cri du « high tech ».

JUSTE APRES, C'EST LE TABLEAU DE BORD DU CONCORDE
Et pour finir, quelques gags amoureusement concoctés par quelques facétieux nippons,
Qui, comme on le voit, n’hésitent pas, dans certaines occasions, à déployer des moyens logistiques considérables.
Certains pensent que le Mal n’est pas dans la technique, mais dans l’usage qu’on en fait. Ils oublient que le drôle peut faire partie des acquis de la technique. Bon, c'est vrai que ça va un moment, pas trop plus. On n'est pas obligé d'y passer autant d'heures que les types qui ont imaginé et réalisé tout ça. Au fond, la technique n’a pas que des mauvais côtés et offre parfois quelque menue compensation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, pensée, littérature, wc, chiottes, vie quotidienne, société, humour, plaisanterie, crotte, excréments, trottoirs, rabelais, béroalde de verville, cabinets, coluche, japon, hygiène, blague
lundi, 09 juillet 2012
DES GOGUES ET DE LA CIVILISATION
Pensée du jour : « Non loin de là il y a le lac de cratère : des ténèbres au fond d'un trou. Le résineux obscur alterne sur la rive avec le sombre conifère. Ils se mirent dans l'eau comme la houille dans l'anthracite ». C'est ALEXANDRE VIALATTE qui a écrit ça. Quoi, ce n'est pas vraiment une pensée ? Et alors ? Je m'en fiche, c'est du VIALATTE. Et c'est beau. Comment voulez-vous qu'on résiste à : ils se mirent dans l'eau comme la houille dans l'anthracite ?
Avant de reprendre le fil de mon thème "goguenard", un mot sur la grande CONFERENCE SOCIALE qui se tient à Paris. Juste pour signaler que SARKOZY avait fait, paraît-il, un GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, montagne qui a accouché même pas d'une souris, à peine d'une musaraigne pygmée (5 cm, sans la queue).
Disons que, pendant les quelques premières centaines de milliers d’années de son existence, l’humanité a eu recours au plus rustique des moyens : s’accroupir, déféquer et puis se nettoyer comme elle pouvait, d’une pierre, polie dans la mesure du possible, d’un bouquet d’orties fraîches ou d’un « oison bien dumeté, pourveu qu’on luy tienne la teste entre les jambes » (Gargantua, chapitre 13).
Et disons-le nettement : il n’y eut aucun problème particulier pendant deux ou trois cent mille ans. Tout le monde savait, dans les bourgs et dans les villes du néolithique (quoi, j'exagère ?), qu’il fallait faire, quand on marchait dans la rue, attention à ce qui tombait des fenêtres le matin, comme l’apprit un jour à ses dépens le bon LOUIS IX, alias Saint Louis, et, plus tard, je ne sais plus quelle grande dame qui déambulait étourdiment juste sous les fenêtres de Versailles, dans une robe du dernier chic qui avait coûté les yeux de la tête à ses fermiers et métayers.
Les difficultés surgissent avec la concentration urbaine des hommes et la croissance verticale des villes. Les solutions artisanales s’avèrent très vite totalement dépassées, comme le montrent quelques ébauches théâtrales d’ALFRED JARRY jeune, qui vécut à une époque de transition, où l'on est passé (lentement) de la "collecte" à l'ancienne à une "évacuation" moderne. Je ne m'attarderai pas sur les péripéties. Cela s'appelle Les Antliaclastes (traduction : les briseurs de pompe à merde).
Il y met en scène les membres du Club-Antliator, autrement dit les « vidangeurs au tonneau », qui ne sont autres que les adeptes de la (« parlant par respect », dirait NIZIER DU PUITSPELU) pompe à merde, c’est-à-dire, en quelque sorte, les fervents de la tradition et de la vieille école, avec ses savoir-faire inimitables et ses tours de main amoureusement préservés et transmis. Les tenants de l'amour du métier et du travail bien fait, quoi.
Ces « militants de la pompe » sont en guerre contre les « Antliaclastes », partisans quant à eux de l’ « herpétologie ahénéenne » (= les « serpents d’airain » = les tuyaux métalliques), de la chasse d'eau, des tuyaux de descente et de l'égout, en somme, de l’évacuation industrielle, technique, anonyme et déshumanisée, qui coupe l’homme de tout contact avec sa propre activité et, disons-le, avec la « vraie vie », et qui, du jour au lendemain, a fait disparaître aux yeux de tous l’œuvre la plus constante que, jour après jour, l’homme confectionnait (qu'il y consentît ou qu'il y regimbât), qu’il neigeât, qu’il ventât ou qu’il grêlât (notez la rafale de subjonctifs imparfaits), depuis la nuit des temps.
Dans ce combat proprement homérique, c’est évidemment l’anonymat industriel et déshumanisé qui a triomphé. Il faut dire que la lutte était foncièrement inégale. Rendez-vous compte de tout ce qu’une tour haute de 400 mètres (on pense évidemment à celles du World Trade Center de Manhattan) peut produire d’ « eaux noires » (c’est le terme spécialisé, par opposition aux « eaux grises », qui viennent de l’évier, du lavabo et de la douche). La rationalisation a triomphé sans trop de mal : nécessité fait loi.
Qui pourrait imaginer la grande ville d'aujourd'hui, couverte de buildings, avec des "vidangeurs au tonneau" qui passeraient dans les rues pour vider les fosses ? La société de masse commande des solutions de masse, des solutions industrielles de masse. Regardez ce qui se passe à Marseille, à Lyon ou à Naples, dès que les éboueurs décident de cesser le travail, et imaginez la même chose, pas avec les poubelles, mais avec les « matières ». On pourrait vraiment dire, au sens « propre » (!!!), qu'on est dans la merde.
Dans les célèbres tours du WTC, désormais abolies par un décret d’Allah en personne (c'est ce que dit la rumeur) comme symboles du Mal, travaillaient 50.000 personnes. Non mais, vous vous rendez compte ? Chaque jour débaroulaient jusqu’aux égouts soixante-quinze tonnes d’excréments (il faut compter 3 livres en moyenne par personne).
Quand vous saurez qu’à la fin du 19ème siècle, des gens excessivement sérieux, en Angleterre, ont calculé, avec la plus grande exactitude, que pour évacuer la seule matière solide, il fallait 9 litres d’eau, vous saurez ipso facto que le World Trade Center de Manhattan dépensait 675.000 litres d’eau par jour. BEN LADEN se voulait peut-être un bienfaiteur de la planète ?
Petite pause anecdotique : on raconte que les Américains, quand ils ont attaqué l'archipel d'Okinawa, ont largement surestimé le nombre des Japonais embusqués, en se fiant aux tas de fiente que ceux-ci laissaient, et qu'ils ont en conséquence acheminé des effectifs beaucoup plus copieux. Comme disent les Italiens : se non è vero, è ben trovato. Fin de l'anecdote.
Le plus dur à supporter dans cette affaire, c’est que ce qui évacue l’ « engrais humain » vers les océans, c’est, ni plus ni moins, de l’EAU POTABLE. Parfaitement : DE L'EAU POTABLE. Ben évidemment, vous imaginez ce que ça coûterait, de doubler les canalisations d’eau, l’une pour acheminer ce qui se boit, l’autre pour acheminer l'eau non-potable, vouée à l'évacuation de l’indigeste et du non-digéré ? Explosé, le budget d’investissement ! Quel financier désintéressé et philanthrope scierait ainsi sa propre branche ?
Pensez juste un instant que toute l’eau que vous jetez dans la cuvette en appuyant sur le bouton, c’est de l’EAU POTABLE. Dites-vous, oh, juste un instant, que vous pourriez mettre votre verre quand vous tirez la chasse, et que l’eau, oui, vous pourriez la BOIRE ! Franchement, est-ce qu’il n’y a pas de quoi se dire qu’avec un tel gaspillage, démocratiquement étendu à 6 milliards et demi d’humains, c’est exactement, concrètement et très efficacement annoncer l’impossibilité totale de la civilisation qui a promu ce gaspillage ?
Soyons clair : un tel gaspillage n’est possible et envisageable que s’il est réservé à un tout petit nombre. Soyons même tranchant : une vraie démocratie, une démocratie avérée, authentique est le régime de la médiocrité pour tous. Le gaspillage est un luxe, et de ce fait reste définitivement hors de portée du vulgum pecus.
A cet égard, on peut accuser la planète Terre de vivre comme les grands seigneurs de la cour à Versailles. Sauf que tous les manants, tous les vilains et tous les roturiers de la planète ont pour seul désir et objectif de pouvoir se comporter en grands seigneurs. Il paraît que c'est ça, la démocratie. Jadis, je n'aurais demandé qu'à le croire. Maintenant, j'avoue que j'ai du mal. Aujourd'hui, manants, vilains, roturiers et sans-culotte ont pour ambition suprême d'imiter les ci-devant aristocrates. Tout au moins d'en imiter certains gestes. Les plus coûteux.
La planète Terre est folle, elle ne se rend pas compte : elle a totalement perdu de vue les excréments qu’elle produit (ne parlons pas des autres déchets). Parce qu’elle a le regard fixé (par la publicité, la propagande, la télévision) sur la portion de Terre vierge, pure et momentanément préservée où elle va pouvoir se ressourcer, avant les onze mois de galère que va lui coûter le pavillon qu’elle s’est offert dans la banlieue de Saint-Brévin-les-pins.
C’est sans conteste cette raison (50.000 personnes obligées chaque jour de pisser et de chier du haut de leurs 400 mètres de béton, de verre et d’acier de toutes les tours du World Trade Center) qui a décidé OUSSAMA BEN LADEN, un écologiste de pointe et un démocrate interminable et péremptoire, à faire raser par quelques personnes fatiguées de vivre ce monument du non-sens de l’orgueil consumériste qu’étaient les tours du World Trade Center. On ne peut nier qu’il a visé juste. Le tout serait d’en tirer les bonnes leçons, ce qui semble loin d’être fait.
Le World Trade Center était exactement ce qu'on appelle le défaut de l'armure. La faille dans le système. La paille dans l'acier. Ce que les Grecs anciens appelaient l'ubris (la démesure, le défi aux dieux), et ce que les chrétiens ont traduit par la Tour de Babel.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, chroniques de la montagne, conférence sociale, nicolas sarkozy, françois hollande, parti socialiste, ps, grenelle de l'environnement, hygiène, wc, cabinets, toilettes, alfred jarry, nizier du puitspelu, world trade center, manhattan, excrément, ben laden
samedi, 07 juillet 2012
UN PARFUM DE TROISIEME REICH (2)
LISTE DES INTERDITS : cette formule me fait penser à un texte d’ALAIN (Propos sur le bonheur). Le philosophe oppose la famille où règne la joie dans l’absence de contraintes imposées à ses membres à celle où la vie en commun se réduit à la stricte observance des phobies de chacun : il ne faut heurter personne. Résultat, « tous se regardent d’un œil morne et disent des pauvretés ».
Poussons les choses à l’extrême : imaginez, dans notre petite société française de 65.000.000 d’habitants, que CHACUN ait le droit d’interdire à TOUS ce qui ne lui plaît pas, que devient la vie sociale ? Et que devient la vie ? Qu’avons-nous fait de la liberté ? Sur le papier, nous n’avons jamais été aussi libres.
Dans la réalité, nous n’avons jamais autant fait, au même moment que les autres, la même chose que tout le monde : nous déplacer, nous alimenter, nous distraire, nous reposer, etc. Dans les espaces divers que nous occupons successivement dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l’année, c’est soit le désert, le vide angoissant, soit l’engorgement, la saturation, la thrombose (mot savant affectionné des journalistes).
Donc, d’un côté, une liste de PROSCRIPTIONS oppose à nos désirs d’expression libre le mur des conventions morales, voire légales (judiciarisation de la vie en société). De l’autre, une liste de PRESCRIPTIONS lexicales vite adoptées, véhiculées et imposées par les médias et les complaisants, inattentifs ou négligents journalistes. Je suis parti de l’exemple « Françaises, Français ».
Mais les exemples de ces formules ne manquent pas. Je pense à « cellule de crise », qui montre que le responsable politique est bien à son poste, l’œil vigilant, la main prête à passer à l’action. Je pense à « commencer son travail de deuil », qui, lors du procès d’un meurtrier, sous prétexte de valoriser la victime, occulte la nécessité d’une justice juste pour que le citoyen normal puisse recommencer à dormir paisiblement.
Je pense à « cellule psychologique », qui voit des autorités proches des gens, des « vrais gens », et prêtes à les entourer de leurs soins et de leur prévenance suite au traumatisme subi. Je pense à « devoir de mémoire », qui appelle la prise en compte du passé historique, particulièrement de ses moments tragiques. Rappelez-vous, sous SARKOZY, la lettre de Guy Môquet et le parrainage d’enfants morts à Auschwitz par des écoliers.
Je pense à l’expression horrible « la foule des anonymes », dont le journaliste ordinaire et catastrophique (père, pardonnez-lui, parce qu’il ne sait pas ce qu’il dit) se repaît, dès que lui incombe la tâche de narrer par le menu et dans le détail tout le pittoresque d’une cérémonie funèbre. Après la liste des interdits, donc, la liste des commandements.
S’inspirant de VICTOR KLEMPERER, ERIC HAZAN a écrit en 2006 LQR – La Propagande au quotidien (Editions Raisons d’agir). LQR signifie « langue de la cinquième République ». Ce petit livre (122 pages) n’a pas l’ampleur, la portée et l’ambition de LTI – Notizbuch eines Philologen de son ancêtre KLEMPERER.
VICTOR KLEMPERER était juif, et son livre est l’aboutissement d’un travail de longue haleine, qui couvre toute la durée de l’hitlérisme au pouvoir (13 ans). ERIC HAZAN fait néanmoins œuvre utile et réjouissante, en étalant au grand jour la prétention et la cuistrerie des Trissotin qui nous gouvernent, dont le vocabulaire apparemment sensé n’est finalement qu’un nouveau masque du mensonge politique.
Il montre en particulier que la foule, en intériorisant le langage des puissants, intègre de ce fait l’attitude de soumission qu’ils attendent. Il cite, p. 21, cette histoire, racontée par KLEMPERER, du docteur P., juif, qui « faisait siens tous les propos antisémites des nazis, spécialement ceux de Hitler (…). Il ne pouvait probablement plus juger lui-même dans quelle mesure il se raillait du Führer, dans quelle mesure il se raillait de lui-même et dans quelle mesure ce langage d’humiliation volontaire était devenu sa seconde nature ».
« La vérité c’est qu’on n’a jamais vu pareille docilité des masses. Parce qu’il n’y eut jamais tant de moyens de les conditionner à son gré », écrit ALEXANDRE VIALATTE. On peut à bon droit s’inquiéter du degré d’intériorisation de la soumission des esprits auquel nous a conduits le règne actuel de la télévision, qui assure le règne hégémonique voire totalitaire de la PROPAGANDE.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 05 juillet 2012
MA DOSE DE VIALATTE (ET AUTRES FETUS)
On connaît ma prédilection pour la haute littérature qu’on trouve dans les Chroniques de La Montagne, d’Alexandre Vialatte, qui ont la taille de courtes nouvelles et qui, de ce fait, constituent des petites merveilles de « livres pour les cabinets », pour qui a le désir ou l’habitude d’agrémenter ces moments quotidiens passés derrière la porte verrouillée, mais où d'autres verrous, corporels cette fois, se relâchent, pour qui, cependant, tient à maintenir dans son esprit un niveau honorable de maintien intellectuel et de contention morale.
Dans ces « lieux » destinés à accueillir des « nécessités » bien triviales, posséder, sur quelque honnête rayon de bibliothèque, des ouvrages capables d’offrir ainsi quelque satisfaction quintessenciée aux aspirations les plus nobles de l’individu en train de se soulager de sa matière la plus ignoble, tout en s’aérant les parties basses, je n’hésite pas à le dire, constitue l’indéniable marque de la haute considération dans laquelle doit être tenu, non seulement le logement où on le trouve, mais encore la personne qui l’habite.
Parenthèse : « Des gogues et démagogues ».
Cela dit, il est conseillé aux personnes « pressées » de s’enquérir auprès de leur hôte, avant d’accepter son invitation à dîner, de l’existence d’un deuxième « lieu », au cas où la situation l’exigerait. Rien n’est en effet plus disconvenable que de déposer dans un pot de fleurs son « engrais humain » sans demander à la maîtresse de maison si elle a auparavant fait le nécessaire.
J’ai parlé d’un « engrais humain » : il faut savoir qu’ainsi parle Victor Hugo dans Les Misérables : « Tout l’engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d’être jeté à l’eau, suffirait à nourrir le monde » (partie 5, livre 2, chapitre 1, pour ceux qui douteraient).
La suite est toute empreinte de parfums, je dirai même de fragrances délicates et raffinées. Jugez plutôt : « Ces tas d’ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c’est ? C’est de la prairie en fleur, c’est de l’herbe verte, c’est du serpolet et du thym et de la sauge, c’est du gibier, c’est du bétail, c’est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c’est du foin parfumé, c’est du blé doré, c’est du pain sur votre table, c’est du sang chaud dans vos veines, c’est de la santé, c’est de la joie, c’est de la vie ». Victor Hugo est bien le grand prêtre de l’antithèse (dont Chateaubriand lui a montré le chemin). Le Livre II s’intitule « L’intestin de Léviathan » : ça dit bien ce que ça veut dire.
Autrement dit, plus l’humanité produit de caca, plus l’humanité peut se nourrir. Comme quoi on a raison de dire que chez VH, il y a « à boire et à manger ». Est-ce à tort que nous n’éprouvons qu’aversion et répugnance pour ces matières vilipendées par la coutume, et qu’Alfred Jarry appelle les « immondices du corps » ?
Puisqu’on en cause, me revient à l’esprit le « lieu » du 7 quai Lassagne, où le « suivant » devait s’armer d’une très longue patience, ou se résoudre à traverser tout l’appartement à toute vitesse pour trouver refuge et salut dans l’autre « lieu ». La faute à la pile des Tintin hebdomadaires qui offrait son interminable tentation à la personne en train d’ « opérer ».
Me reviennent aussi, en même temps que les plumes de paon que nous ramassions par terre, les « lieux » du château d’Azolette, dans le haut Beaujolais, propriété de la famille Manivet : situés dans un pavillon faisant face à l’imposant bâtiment, de l’autre côté de la grande terrasse, leur lunette était recouverte d’un merveilleux velours, peut-être rouge, mais je ne peux pas le jurer.
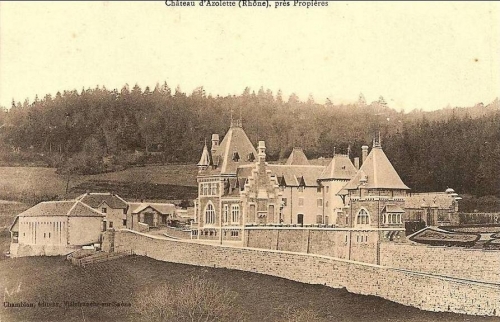
MIEUX QU'UNE PAILLOTE SUR UNE PLAGE CORSE, NON ?
(on distingue bien le pavillon en question, au premier plan)
Et pendant qu’on en est aux « mondanités », parlons du château de Joux, en Haute-Loire, dont les gogues ruraux et rustiques (auxquels on accédait en passant dans le petit bois, séparé de la haute et belle terrasse par un haut mur), étaient à deux places, ce qui m’a toujours laissé perplexe, et où l’on pouvait par là observer en direct, six ou sept mètres plus bas, le résultat des activités développées en cet endroit. Je précise que, si je parle de châteaux, ce n’est jamais moi qui y ai habité. « Simple visite », comme on dit au Monopoly.
Fermez la parenthèse.
Promis, je cesse de digresser, et je reviens à mon Vialatte. On le considère le plus souvent (quand on n’ignore pas scandaleusement son existence), comme un humoriste. Or, il faut bien se mettre dans la tête qu’Alexandre Vialatte est tout, sauf un humoriste. Avoir de l’humour ne suffit à personne pour devenir un professionnel de la chose. Alexandre le grand plaçait tout son humour dans la sphère infiniment plus vaste du regard très particulier qu’il portait sur le monde.
L'humour était un élément parmi d’autres dans la vision toute personnelle qu’il avait des choses. Si l’on veut, l’humour faisait partie intégrante de sa « philosophie » de l’existence. Une « philosophie » éminemment pessimiste. Sans espoir dans une hypothétique amélioration de l’espèce humaine. D’où la formule « Le progrès fait rage », disait-il, avant que Philippe Meyer ne popularisât la formule.
Disons que l’humour était, en quelque sorte, l’huile qui permettait au pessimisme de son moteur existentiel de ne pas « casser ». Vous trouverez ci-dessous une jolie petite illustration du pessimisme et de l’humour. Laissez Alexandre Vialatte agiter les ingrédients dans son shaker personnel, et voyez ce que ça donne.
La vérité, c’est qu’on n’a jamais vu pareille docilité des masses. Parce qu’il n’y eut jamais tant de moyens de les conditionner à son gré. L’instruction elle-même y concourt, qui permet à tous les hommes de lire le même journal. L’analphabète était bien obligé d’avoir ses idées personnelles, « de disputer, de juger, de décider par lui-même ». Aujourd’hui, il en croit le prospectus général.
Le prospectus général l’assure qu’il ne cesse de devenir plus libre, plus intelligent et plus fort. Que les siècles se superposent et qu’il y voit, par conséquent, de plus en plus loin. Mais il en va de ce socle hautain comme de celui de ce procureur auquel un avocat disait : « Monsieur l’avocat général, votre position supérieure est une erreur du menuisier ».
On trouve ça dans Les Champignons du détroit de Behring. Le pessimisme, c’est la lucidité sur l’époque qui le produit. L’humour, quant à lui, c’est un choix de vie, une attitude. Pour tout dire, c’est une morale. En plus, Alexandre Vialatte montre qu’il avait ce qu’on appelait au 18ème siècle « de l’esprit ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, wc, gogues, goguenots, chiottes, victor hugo, les misérables, alfred jarry, tintin, beaujolais, philippe meyer, les champignons du détroit de behring, château d'aazolette, château du cros
mardi, 26 juin 2012
BICYCLETTE, DOPAGE ET LITTERATURE
Résumé : ce n’est pas la peine de chercher l’exception : dans le peloton du Tour de France, celui qui ne se dope pas, c’est l’aiguille (si j’ose dire !) dans la botte de foin : on ne peut pas le trouver.
Le cyclisme (professionnel, mais aussi amateur, et très tôt) est donc le monde de la triche organisée et systématique, où les sportifs, s’ils veulent « percer », sont obligés de se procurer hors de leur organisme des « ressources » impossibles à trouver au-dedans. JACQUES ANQUETIL ne disait pas autre chose : « Il faut être un imbécile ou un faux jeton pour s’imaginer qu’on peut courir 265 jours par an sans stimulants ». Il comparait lui-même ses cuisses et ses fesses à « des écumoires ».
Je signale que LANCE ARMSTRONG, avec ses sept victoires dans le Tour de France, risque dans peu de temps de s’en voir privé, si les poursuites engagées par les instances sportives américaines aboutissent (le coureur est un gros lobby à lui tout seul).
Il semble qu’elles aient assez de « biscuits » pour conclure, si j’en crois L’Equipe (eh oui, ça m’arrive aussi !), qui sous-titrait récemment un article : « L’Agence américaine antidopage détient les preuves absolues que Lance Armstrong fut un terrifiant tricheur ». Pourquoi « terrifiant » ? Parce tout le milieu a été lâche et complice, et qu’il a si longtemps fermé les yeux ?
Le déjà nommé ANTOINE VAYER s’étonnait (?), en 1998, que l’équipe Festina au grand complet arrivât groupée, quasiment « en ligne », et « bouche fermée » au sommet de je ne sais plus quel col impossible. Il dit d’ailleurs de ce genre de coureurs : « Plus ils roulent, plus ils récupèrent ».
C’était le rêve d’André Marcueil, le personnage créé par ALFRED JARRY pour Le Surmâle, où cinq cyclistes, sur une quintuplette, font la course (de 10.000 milles) avec une locomotive, aidés par la « perpuetual motion food » (l'aliment du mouvement perpétuel) du bon Dr Elson. ALFRED JARRY fut un précurseur en matière de dopage. Il faudra que j’en parle un de ces quatre.
Il faut savoir que le taux d’hématocrite dans le sang (proportion des globules rouges) diminue dans les efforts longs et intenses, ce qui rend un sportif impropre à toute performance s’il ne se repose pas pour le reconstituer (eh oui, j’ai essayé de me documenter, mais je ne vais pas vous bassiner avec les données).
Au cours de toutes les affaires de dopage qui jalonnent la compétition cycliste depuis bientôt quinze ans, j’ai vu passer de temps en temps un article de PAUL FOURNEL, qui regrettait profondément les saloperies qu’on faisait au cyclisme et qui ternissaient son image, mais qui n’a jamais, pour son compte, renoncé à l’amour du vélo. Et on le comprend bien volontiers. Mais son bouquin Les Athlètes dans leur tête date (1988) d'avant l'arrivée de l'EPO, qui donne au pire canasson des ailes de crack.
Il fait dire à son ANQUETIL (des propos rapportés comme répétés à ses plus proches), dans son dernier livre : « Je crois bien que je n’aime pas, que je n’ai jamais aimé, que je n’aimerai jamais le vélo ». Dans la nouvelle qu’il lui consacre, il fait dire à son narrateur, parlant du vrai crack : « … un trait de caractère que je n’ai jamais eu et que je n’aurai jamais : un certain dégoût pour la bicyclette et une tendance à la laisser au garage plutôt que de s’entraîner ». Mais ce qui est sûr, c’est que FOURNEL, qui aime le vélo, est carrément baba devant le champion qui porte le nom de JACQUES ANQUETIL.
C’est qu’avec FOURNEL, on a vraiment l’impression d’être dans le bonhomme qui agite les jambes sur sa bicyclette, d’être au fin milieu du peloton, avec les amabilités diverses qui se déversent pendant une course : on ne voit pas pourquoi les mecs seraient muets, mais le spectateur se demande toujours : « Qu’est-ce qu’ils peuvent bien se dire ? ».
Dans Les Athlètes dans leur tête, je passe sur « La Course en tête », où le Portugais dont il est question fait le vide autour de lui, à cause d’une trajectoire erratique, et dangereuse pour ses voisins, surtout dans les sprints finaux. Une nouvelle qui commence par : « Il en va souvent ainsi des cyclistes : les plus malicieux manquent de cuisses et les plus cuissus manquent de malice. Ce Portugais était très cuissu ». A cause de l’ellipse, on dirait du VIALATTE.
La nouvelle finit par : « … il avait eu la sensation fugitive que le Portugais n’était pas vraiment mécontent de voir arriver cette bordure de trottoir en plein dans sa figure, à la vitesse d’une dernière gifle de béton ». Là, je ne peux pas dire qu’on dirait du VIALATTE, mais je me demande si VIALATTE n’aurait pas aimé écrire une phrase comme ça.
J’aime bien la nouvelle « Gregario » (le troupeau de l’équipe, au service exclusif de la vedette). A cause de quelques phrases, peut-être. Le gregario parle d’Yvon, le sprinter : « C’est lui qui fait rentrer l’argent dans l’équipe, c’est lui qui lève les bras sur la ligne pour qu’on puisse lire « Salami-Store » sur son maillot, à la télé, dans les journaux. Dans notre équipe, on roule pour du saucisson ». Il n’y a pas à dire : PAUL FOURNEL prend le monde tel qu’il est. Il n’en cache rien, il ne se fait aucune illusion, mais il « y va », comme on dit. C’est un choix. Ce n’est pas le mien, mais là, je respecte, parce qu’il sait écrire.
Je passe très rapidement sur « Méticuleux », canular montrant le gars qui se la joue, mais qui n’a plus envie que d’une chose : se taper la cloche dans une bonne auberge, après avoir fait semblant de partir pour l’Izoard. Je passe aussi sur « La forme », qui raconte la bonne journée (il arrive 30ème de l’étape) d’un basique qui s’étonne d’être encore dans la course. Aujourd’hui, « il était monté comme dans une chanson (…). Le revêtement rendait bien, les boyaux sifflaient juste, il passait en danseuse sans à-coups… ».
PAUL FOURNEL, on ne dira pas le contraire, aime et connaît le vélo.
Voilà ce que je dis, moi.
Le meilleur reste à venir.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cyclisme, tour de france, dopage, paul fournel, les athlètes dans leur tête, jacques anquetil, uci, lance armstrong, l'équipe, antoine vayer, alfred jarry, le surmâle, hématocrite, alexandre vialatte
lundi, 18 juin 2012
ALEXANDRE VIALATTE LE GRAND
Dans son Almanach des quatre saisons, ALEXANDRE VIALATTE rappelle qu’au mois de février, « la grosse erreur est de semer les crosnes du Japon trop serrés, et qu’il faut les mettre à trente centimètres d’intervalle (en dehors de heures de bureau) ». Et il ne manque pas de préciser que « les hommes qui naissent en février aimeront les étoffes chinées. Ce sont des enfants du Poisson. Mystiques et rêveurs, ils seront attirés par la musique, l’abnégation, l’occultisme, les voyages et les liquides ; à la limite, ils feront donc d’excellents marins ou des placiers en spiritueux ».
Il donne aussi de précieuses indications au sujet de quelques prénoms du mois. Ainsi, « les Blaise (le 3) sont aimés de l’aristocratie slave ; très forts en métaphysique, ils naissent dans les rues commerçantes ». Si, à partir de là, vous avez reconnu BLAISE PASCAL (mais aussi BLAISE CENDRARS), c’est que vous êtes fort, ou que vous avez compris un des aspects intéressants de la tournure d’esprit de l’auteur, ainsi que de son style (la généralisation abusive).
Toujours à propos de prénoms, mais comportant un autre aspect (l’approximation phonétique) : « Les Armand (le 6) sont heureux, souvent jaloux, volages quelquefois. Selon La Fontaine, ils ont intérêt à ne voyager qu’aux rives prochaines ». Vous avez reconnu une citation d’une des plus belles Fables, Les Deux pigeons :
« Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ?
Que ce soit aux rives prochaines ».
Si je dis « une des plus belles », c’est à cause des derniers vers, qui constituent un rarissime et très touchant exemple où LA FONTAINE se laisse aller à la tentation de se livrer à quelques confidences :
« J’ai quelquefois aimé, je n’aurais pas alors
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable et jeune bergère
Pour qui, sous le fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas ! Quand reviendront de semblables moments ?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ?
Ah ! Si mon cœur osait encor se renflammer !
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête ?
Ai-je passé le temps d’aimer ? »
On est loin de La Cigale et la fourmi ou du Loup et le chien, vous ne trouvez pas ? Mais revenons aux prénoms selon VIALATTE, pour qui les « Apolline (le 9) se lèvent avec le jour. Yeux verts et foie fragile. Elles naissent à Limoges ». Et il conclut : « Si vous tenez à économiser, par avarice ou par manque de moyens, appelez votre filleul Montan ou Dosithée (fête le 29). Vous ne le fêterez que les années bissextiles ».
Je signale que le village de Saint-Montan (ou Saint-Montant), dans l’Ardèche (entre Viviers, Bourg-Saint-Andéol et Vallon-Pont-d’Arc), produit du vin rouge. Ce vin peut, à excellent droit, être surnommé le roi des « rouges-qui-tachent ». Pour parler franchement, si vous avez rêvé de la « tache absolue », je vous conseille un détour par le rouge de Saint-Montan. Je n’ai jamais vu l’équivalent.
Pour finir sur le 29 février, il est bon de rappeler que Saint GREGOIRE DE NAREK fut fils de Kosroès, évêque d’Antsévatsik (il paraît qu’il y avait des chrétiens en Turquie, au 11ème siècle) et que, décevant les attentes de tous les jaloux, mauvais et méchants qui lui cherchaient noise, non content de refuser de manger du pâté de pigeonneaux apporté par de vils tentateurs, au motif qu’on était vendredi, il frappa dans ses mains et dit au pâté froid : « Allez jouer, mes petits amis, c’est du poisson qu’on mange aujourd’hui ». Les pigeons s’envolèrent aussitôt dans les arbres. Farpaitement ! C’est comme ça que ça s’est passé !
Moi je dis que je comprends qu’il ait été invité à naître un 29 février. Parce que vous ne me ferez pas sortir de l’esprit que tout ça, c’est louche. Bon, c’est vrai qu’on ne le fête (encore faut-il ne pas avoir oublié l’aide-mémoire entre la liste des courses de la semaine à Auchan et celle des bonnes résolutions du 1er janvier, qu’on a omis d’ôter du portefeuille) que tous les quatre ans. Mais quand même, ça reste louche, cette histoire de pigeons.
Bon, j'ai encore fait des « arabesques » (au sens de CHATEAUBRIAND), mais que voulez-vous, s'il fallait se priver de tous les à-côtés, la vie serait bien triste, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
A la prochaine.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, almanach des quatre saisons, littérature, humour, blaise pascal, la fontaine, les deux pigeons
vendredi, 15 juin 2012
UN PEU DE VIALATTE CHAQUE JOUR
J’ai déjà dit tout le bien qu’il est conseillé de penser de Monsieur ALEXANDRE VIALATTE, l’auteur immarcescible des Chroniques de La Montagne (898 textes publiés chaque lundi, à quelques très rares exceptions près, de 1952 à 1971, dans le journal de Clermont-Ferrand, disponibles en Laffont « Bouquins »). Je dis « conseillé », parce que – et on peut le regretter – il n’existe ni sanction, ni mesure de rétorsion contre les écervelés qui, endurcis dans une attitude confinant à un lamentable obscurantisme, se refuseraient à rendre un culte à l’ « Auvergnat absolu ».
Mais la vénération a d’autres raisons de s’exercer que les seules Chroniques de la Montagne, dont FERNY BESSON, la fidèle entre les fidèles, a publié une bonne partie dans une douzaine de volumes (Julliard) délicieux, dotés de titres parfaitement homothétiques avec le contenu et l’esprit des dites chroniques. Citons L’Eléphant est irréfutable, Profitons de l’ornithorynque et Eloge du homard et autres insectes utiles, pour rester dans la référence animale.
A ce propos, je précise que l’ornithorynque est un mammifère « monotrème » mot forgé à partir du grec, signifiant « un seul trou », car le même conduit sert à excréter les liquides, les matières et les œufs portant la descendance, mais aussi permet à la femelle d’accueillir le mâle ; pourquoi se compliquer l’anatomie quand on peut faire simple, n’est-ce pas ? N’est-ce pas aussi que c’est rafraîchissant de savoir de telles choses ?
Parmi d’autres originalités cultivées par ALEXANDRE VIALATTE, il eut celle d’habiter, au dernier numéro pair (158) de la rue Léon-Maurice Nordmann (Paris, 13ème), un immeuble donnant juste sur la prison de la Santé (Paris, 12ème), dont il n’était séparé que par la bien nommée rue de la Santé (l’hôpital Cochin est tout à fait voisin, mais j’ignore qui, de l’hôpital, de la prison ou de la rue, eut la préséance dans la dénomination).
Parmi les autres raisons d’admirer ALEXANDRE VIALATTE, il y a ses romans, dont le formidable Les Fruits du Congo. J’en parlerai une autre fois, si vous le permettez. Je m’arrêterai aujourd’hui, certes sur des chroniques, mais d’un autre genre : celles qui furent publiées dans Marie-Claire (eh oui !) dans les années 1960, sous le titre « L’Almanach d’Alexandre Vialatte », et que l’impeccable FERNY BESSON a publiées (Julliard) sous le titre rigolo Almanach des quatre saisons (12 chapitres correspondant aux mois de l’année), et dans lesquelles il démontre combien il sait parler aux femmes : « Ail : mangez-en beaucoup. Il rajeunit l’organisme et éloigne les importuns ».
« Janvier est le premier mois de l’année depuis une décision de Charles IX ». Voilà comment ça commence. Car il faut le savoir, avant l’ « Edit de Roussillon » (promulgué le 9 août 1564 au château de Roussillon, et entré en vigueur le 1er janvier 1567), c’était l’anarchie dans le royaume de France, et en plus, sans tenir compte des guerres de religion. Pensez, dans le diocèse de Lyon, l’année commençait à Noël, dans celui de Vienne, le 25 mars, ailleurs c’était le 1er mars, ailleurs c’était à Pâques. Impossible de s’y retrouver. Remarquez, maintenant, comment expliquer les « sept-, oct-, nov-, déc- des quatre derniers mois de l’année ? Réponse : on ne saurait satisfaire tout le monde.
« C’est en janvier, sous le Roi-Soleil, que l’homme inventa la machine à écrire, et que Landru, qui reste dans l’histoire comme le type du faux affectueux, brûla sa dernière victime dans un poêle à trois trous sans valeur commerciale : le vent soufflait et l’ombre de sa barbe dansait sur le mur de la cuisine. » Le fantastique, comme on le voit, n’est jamais loin. Un art éminemment visuel.
Ses recommandations aux dames pour le mois de janvier sont très simples : ne pas croire qu’à la Saint-Charlemagne, les censeurs de lycée ont pour coutume de manger un mauvais élève ; ne pas s’adresser à son percepteur dans la langue chaldéenne ; éviter les loups qui rôdent dans la forêt en hiver ; après une journée fatigante, faire un bœuf mode à la cocotte-minute, et gagner ainsi trois heures qu’elles pourront consacrer à un repos réparateur : « Une bonne lessive, au même moment, peut vous faire gagner deux grandes heures ; en achetant un prêt-à-porter vous gagnerez quarante-cinq minutes. Vous finirez pas avoir trop de temps ».
Voilà : une dose de VIALATTE tous les jours, c’est d’abord et avant tout une question d’HYGIENE. Et la forme littéraire qu’il a adoptée s’y prête à merveille. Comme le disait, lors des Assises Internationales du Roman, un écrivain (ROBERTO ALAJMO), le fragment est, idéalement, « de la littérature de cabinet ». Profitez de votre halte quotidienne dans « les lieux » pour soignez vos neurones et vos zygomatiques intérieurs.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, pataphysique, chroniques de la montagne, bouquins laffont, ferny besson, profitons de l'ornithorynque, éloge du homard, l'éléphant est irréfutable, mammifères, monotrème, les fruits du congo, almanach des quatre saisons, éditions julliard
vendredi, 24 février 2012
SAINT FIACRE HOLLANDE
LA VERITABLE ENFANCE DE NOS SAINTS POLITIQUES
INTRODUCTION
En cette période d’élections prochaines, il est bon de revenir sur la véritable carrière de quelques candidats qui briguent quelque poste exposé mais avantageux, et se présentent pour cela, courageusement, devant le tribunal du suffrage universel. Notons que, sans s’être donné le mot, tous ces candidats gardent sur une partie méconnue de leur carrière un silence de tous les instants.
Disons même qu’ils se gardent bien de s’en vanter. Allons-y carrément : de même que des héros célèbres (Tristan, Hercule, Gargantua, …) ont vécu ce qu’on appelle des « enfances », la plupart de nos saints politiciens, avant de tenir le haut du pavé médiatique, ont eu, eh oui, une sainte enfance.

L'ENFANCE D'UN CHEF (nouvelle d'un certain J.-P. S.)
Mais à la différence de ces saints héros (preuve qu’ils n’en sont sûrement pas), ils semblent l’avoir reniée, comme s’ils la considéraient comme une existence antérieure, sur laquelle la plus extrême prudence de parole doit être observée. A croire que cette existence première les couvrirait de honte si son déroulement effectif venait à être connu.
S’ils savaient, pourtant, toute la sympathie, toute l’empathie, toute la compassion, et disons-le toute la pitié qu’ils pourraient s’attirer de la part des foules, si celles-ci étaient mises au courant de la toute première partie édifiante de leur éminente carrière, ils ne tarderaient pas à commanditer de célèbres agences de communication publicitaire pour établir à leur juste valeur les « galops d’essai » qui préfigurent à jamais, à n’en pas douter, l’excellence future de leur parcours.

SAINT FIACRE AVEC SA PELLE ET SON LIVRE
(à Saint Germain d'Auxerre)
Ayant déjà évoqué ces « galops », quoique trop allusivement, brièvement et fragmentairement, nous nous sentons le devoir de revenir, en les approfondissant, sur des trajectoires exceptionnelles, marquantes pour le genre humain tout entier, et pour tout dire, définitives. Des trajectoires aujourd’hui couronnées de la sainte appellation catholique de SAINT, même si les impétrants (mot désormais à la mode) se désistent de l’orgueil d’en réclamer le titre (toute fausse modestie mise à part, je trouve que cette phrase est assez bien tournée).
AUJOURD'HUI : SAINTE ENFANCE DE FRANÇOIS HOLLANDE
Nous commencerons la revue de ces célébrités trop modestes, par un coup d’œil jeté du côté du petit FRANÇOIS HOLLANDE, devenu sur le tard le désormais irremplaçable SAINT FIACRE HOLLANDE, que certains calomniateurs ont (heureusement en vain) tenté de faire passer pour un « fromage de Hollande ».

L'AIR (FROID) DE LA CALOMNIE
Le petit HOLLANDE naquit sans doute au début du 7ème siècle, quelque part en Irlande. Il est mort en Seine-et-Marne, en un lieu qui lui était prédestiné, puisqu’il s’agit de la commune bien connue de Saint-Fiacre-en-Brie. Cet événement funeste serait intervenu autour de 670 de notre ère (on sait qu’on ne peut être promu au grade de « SAINT » patenté avant l’ère qu’on appelle « chrétienne »).
Grâce à Saint Faron, lui-même fils d’une biche, d’où, évidemment, vient l’expression « faon Faron », dont la célébrité a atteint la Côte d’Azur puisqu’on a donné son nom à une montagne qui domine la ville de Toulon, SAINT FIACRE HOLLANDE fut autorisé à devenir ermite en forêt de Brie.
On ne sait comment grandit sa renommée. Toujours est-il qu’il reçut des visiteurs qu’il récompensait, en quelque sorte, en priant sur eux, et en distribuant consolations et bons conseils (je n’invente rien). Il lui arrivait de les guérir.

NON , LE SUPPLICE DU PAL, C'EST PLUS GRAVE
Il les guérissait principalement des hémorroïdes, l’usage étant que le pèlerin qui souffrait précisément de ce « mal de SAINT FIACRE HOLLANDE » (parfois appelé « fic », on se demande pourquoi) s’asseyait sur la pierre où le saint s’était lui-même assis. On ne sait pas vraiment à quel épisode de sa vie se rattache cette tradition. Les archives ne disent pas tout. Mais en tout cas elles disent : « Loué soit Dieu, SAINT FIACRE HOLLANDE guérit les hémorroïdes. Après l’annus horribilis, l’anus hollandibilis ».
Il nourrissait en cas de besoin les pèlerins des légumes de son jardin, souvent des haricots. Ces jours-là étaient jours de fête. C’est vraisemblablement la raison pour laquelle les jardiniers ont, le 30 août 1237, élu pour leur saint patron SAINT FIACRE HOLLANDE en personne. A l’unanimité. Toute parenté avec quelque hémorroïde que ce soit serait purement fortuite.
Principalement, il savait sur quel ton il fallait parler aux gens : toujours suave, toujours caressant, presque tendre, il atteignait ses auditeurs au fond de leur cœur, imperméable aux propos de quelques vilains jaloux qui ne se privaient pas de le brocarder de diverses expressions qui se seraient voulues blessantes.

LE VERT BAVEUR
Heureusement, FIACRE HOLLANDE (qui n’était pas encore décrété saint), était au-dessus de cette bave crapaudesque, et allait son chemin vaillamment. Si certains lui auraient vu les manches de lustrine et le « rond de cuir » dont Courteline et Maupassant ont fait le symbole de la bureaucratie fin-de-siècle, il se voyait quant à lui sur la plus haute marche du podium électoral.

Malheureusement, un journal d’opposition déterra une malheureuse affaire où un de ses ancêtres, QUINTIANUS HOLLANDUS, avec lequel il offre d'ailleurs une ressemblance de visage tout à fait spectaculaire, avait fait torturer celle qui devint plus tard SAINTE RITA ROYAL. Cette affaire lui coûta le poste de premier consul en 1798. Ce qui n’empêcha pas Anne d’Autruche, bien connue pour avaler n’importe quoi, d'avoir recours à ses miracles pour accoucher (enfin !) de LOUIS XIV.

LE CENTURION (ADJUDANT) QUINTIANUS HOLLANDUS
C’est d’ailleurs de cette curieuse circonstance que s’autorisa un certain Monsieur SAUVAGE qui, en 1640, investit dans une compagnie de taxis (ça ne s’appelait pas ainsi, mais c’est pour donner l’idée), qu’il baptisa « voitures de Saint-Fiacre », tout ça parce qu’elles étaient attachées à l’hôtel de Saint-Fiacre. Les sceptiques, s’ils prennent la précaution de vérifier l’information, en seront pour leurs frais. Bien fait ! « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Ce n’est pas moi qui le dis.
Un auteur, savoureux autant que méconnu, ajoute même, sur un ton qui fait penser à ALEXANDRE VIALATTE, que « les fiacres étaient tirés par un vieux cheval désabusé, que conduisait un cocher haut-perché, armé d’un fouet, surmonté d’un gibus ».
Il va de soi que la plupart des données figurant dans cette note ont été puisées aux meilleures sources, même s'il est possible que se soient glissées, ici ou là, quelques approximations susceptibles de gauchir la stricte vérité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saints chrétiens, fleur des saints, politique, société, politiciens, françois hollande, parti socialiste, saint fiacre, hémorroïdes, ségolène royal, alexandre vialatte
vendredi, 28 octobre 2011
L'ENFANT ÜBER ALLES (1)
EPISODE 1 : la caisse du supermarché
Cette chronique n’abordant que les sujets les plus graves et les plus vastes, nous parlerons aujourd’hui de l’enfant (cette phrase se veut un petit hommage au grand ALEXANDRE VIALATTE). Et s’agissant de l’enfant, chacun conviendra qu’il n’y a rien de mieux que la caisse de supermarché pour l’observer « en action », dans la mission que lui a confiée le commerce industriel : vaincre la résistance de la ménagère, en général sa propre mère, ce qui en fait d'emblée un traître en puissance.
Car si l’espace du supermarché, en soi, dévoile l’intention stratégique de son organisation (« coco, tu te débrouilles comme tu veux, mais à l’arrivée à la caisse, je veux que la longueur de la liste rédigée chez elle, sur un bout de papier et un coin de table, ait au moins triplé ! »), la caisse en est le couronnement. Cette cerise est bien vissée sur ce gâteau.
Vous savez sûrement que tout « bon musulman » doit impérativement accomplir au moins une fois dans sa vie le « hadj » (pèlerinage à La Mecque, dont le coût actuel, dans le bas de la fourchette haute, se monte à environ 5.000 euros par personne, je le sais de première main, c'est KHALED qui me l'a dit).
Le « hadj » du consommateur, c’est moins cher, mais c’est toutes les semaines, si possible le même jour de la semaine, pour garder les points de fidélité, de repère et de comparaison, et si possible le samedi matin, pour bien se souvenir que les autres ont une existence concrète, principalement au moment de faire la queue à la caisse. Ce voyage dans la Mecque de la consommation permet de révéler, à travers une petite scène du quotidien, le plus élaboré de tous les protocoles du commerce industriel, le plus prévisible, mais aux péripéties concrètes indéfiniment renouvelées : l’arrivée de la petite famille à la caisse.
Car la caisse est le piège, le cul-de-sac, la nasse, l’impasse, comme sont tous les péages. Arrêt obligatoire et patience vivement conseillée. Il faut l’avoir vue se dérouler, la scène : la maman (en général, c’est elle, mais on voit parfois un papa) pousse le chariot, qu’elle vide sur le tapis de caisse, après l’avoir rempli et avant de le remplir à nouveau pour le vider dans le coffre de la voiture (on ne s’en lasse pas, que ça devrait être considéré comme un loisir), et ce n’est pas fini. On ne le dit pas assez : le consommateur-en-supermarché est un manutentionnaire qui, non seulement travaille pour les beaux yeux de la princesse, mais en plus qui achète le droit de travailler.
Maintenant, mettez un gamin dans le siège du chariot (tout est prévu). Le gamin, son métier, c’est de regarder autour de lui. Et qu’est-ce qu’il voit, posé devant ses yeux, à portée de sa charmante et innocente menotte potelée quand le chariot arrive à la caisse ? Evidemment bien sûr : LE TEST. Grandeur nature. Juste à la bonne hauteur. Bien en évidence dans des présentoirs avenants.
Donc des boîtes d’épinards ou de fayots, ça ne risque pas. Rien que des saloperies délicieuses, ou bien des cochonneries sucrées, ou alors des pacotilles suaves, et même des camelotes exquises, bref, des merdailles au goût délectable. Rien que des trucs défendus par le coran (euh non, aux dernières nouvelles, je me trompe ; sûrement un oubli du prophète, ce qui prouve d’ailleurs l'amateurisme de ceux qui se fient à lui). Rien que des trucs défendus par le docteur – mais celui-là je l’aime pas parce qu’il fait les piqûres.
Rien que des trucs défendus par papa et maman quand on les a pas encore trop épuisés, mais on va les avoir à l’usure, on n’est qu’au début de l’échauffement, ils vont voir à qui ils ont à faire. « Rien que des trucs défendus », on a compris que ça veut dire : « Rien que des trucs éminemment désirables ». Dans « désirables », comprenez : « A saisir coûte que coûte ».
Poussant son chariot, la femme sait. Depuis l’entrée du magasin, elle tremble, car elle sait ce qui l’attend. Elle sait que le magasin « l’attend à la sortie », comme on dit. Autant dire qu’elle s’approche à regret de ce moment inéluctable de la corvée, de cette épreuve terrible et décisive pour les nerfs et l’autorité. Elle se prépare à résister : aujourd’hui je ne céderai pas, je ne céderai pas, je ne céderai pas.
Elle doit donc s’armer de fermeté pour résister à la coalition conclue entre son angelot et le magasin. Mais certains loupiots, même tout seuls, ils ont un pouvoir terrifiant. Il y en a qui ont un coffre, on ne se douterait pas à les voir. Le chérubin, quand il vient au supermarché, il vient armé. Et son arme, presque imparable, quand la mère affiche fermement sa décision de fermeté, c’est le DECIBEL.
Ça n’a l’air de rien, un décibel, comme ça, quand il est tout seul. « Quand il y en a un, ça va. C’est quand il y en a beaucoup que ça ne va plus. » Je cite monsieur BRICE HORTEFEUX, un homme très bien, malgré qu’il ait le teint rouge. Le décibel isolé, il a tellement peu de poids, autant dire qu’il n’existe pas. Mais attention, quand il vole en escadrille, c’est l’arme fatale. Et certains mioches ont un pont d’envol particulièrement large, et ils arrivent à faire décoller cent ou cent dix décibels en même temps. Pas le seuil de douleur, mais pas loin.
J’en ai vu un, une fois, on l’aurait mesuré, je suis sûr qu’il était à cent douze ou cent seize. Virgule cinq. Essayez, pour voir : insoutenable. Le truc imparable du bourreau qui a derrière lui deux siècles d’expérience. Le blondinet qui découvre la puissance dévastatrice de son missile sonore embarqué, cette arme de destruction massive, il peut tout demander, ou presque. Il met la machine en route et, après un galop d’échauffement, envoie le projectile. Si le parent tient bon, c’est soit qu’il est héroïque, soit qu’il est un robot, soit qu’il est sourd. Disons-le, la plupart du temps, c’est la victoire en rase campagne, avant même qu’il ait envoyé ses mégatonnes.
Mais il faut le comprendre, le lardon. Il sait que le magasin est de son côté. Il le lui a assez répété à la télévision : « Je suis ton ami, mon petit. Je fais tout pour te rendre heureux. Pas comme ces égoïstes de parents qui n’ont qu’une idée en tête : te restreindre, t’imposer des limites. Regarde toutes ces bonnes choses. Vas-y à fond, tu verras, c’est nous, toi et moi, qui sommes les plus forts ». Le merdeux, il n’aime pas ça, les limites. Pourquoi ça, des limites ? Ce qu’il déteste dans ses parents, ce sont les limites qu'ils lui imposent.
Alors, se dit le mouflet, toutes ces petites boîtes colorées, ces petits sachets amicaux, « toutes ces délicieuses petites choses en vente dans cette salle » (c’est ce qu’on entendait à l’entracte au cinéma, à l’époque des « bonbons, glaçons, chocolats » vendus par les accortes ouvreuses), toutes ces promesses de délices, tout ça, c’est exclusivement pour lui que c’est fabriqué.
On a compris que la bataille qui se présente est foncièrement inégale. La mère part battue d’avance. C’est vrai que le moutard n’a pas toujours le dessus, pour finir. Mais en général, c’est le chiard qui gagne, que dis-je, qui triomphe, et il n’a jamais le triomphe modeste. La preuve, c’est que les présentoirs sont toujours là.
Maintenant que j’ai vu la scène (dans les manuels de polémologie, on appelle ça une « guerre-éclair »), je peux ranger le carnet, replier l’observatoire, remballer les cannes à pêche, placer la sangle de ma musette sur l’épaule avec les poissons dedans. Je me lève pesamment, je m’ébroue et m’achemine vers la sortie. Je suis content. Je suis venu. J’ai vu. J’ai vu qui a vaincu. Pas César, mais presque.
Moralité de l’histoire : pour venir à bout de la ménagère aventurée sur le terrain hostile de la grande consommation, il n’y a pas d’arme plus efficace que le sale gosse envoyé en mission. Un suspense comme dans Les Infiltrés.
A suivre ...
22:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, chronique, société, littérature, moeurs, enfant, parents, papa, maman, éducation, grande consommation, supermarché, hypermarché, consommateur, brice hortefaux
jeudi, 26 mai 2011
L'IMPOSTURE ECONOMISTE
Dans le zoo fou qu’est devenue la planète, l’économiste occupe une pace de choix. Que dis-je : l'animal tient le haut du pavé du centre de l'échiquier. Comme ils disent eux-mêmes, ils sont « incontournables ». Ce sont, disent-ils, des « spécialistes ». Leur spécialité, c’est l’économie. Une « science », paraît-il. Drôle de science quand même. La science, on sait ce que c’est, le Grand Robert le dit : « connaissance exacte et approfondie ». « Exacte » ? Alors l’économie N’EST PAS UNE SCIENCE. Qu’il y ait des invariants, c’est certain : plus on fabrique de la monnaie, plus les prix augmentent ; quand on détient un monopole, on s’enrichit plus que quand la vraie concurrence fait rage ; etc. J'ai quelques notions quand même, faut pas croire. Mais un des caractères infaillibles qui définit une science, c’est qu’elle est capable de PREDIRE les phénomènes (si tu es à 0 mètre, et si tu mets de l'eau sur du feu, elle bouillira à cent degrés Celsius, par exemple).
Ça crève donc les yeux : l’économie n’est considérée comme une science que par un abus de langage, un mensonge soigneusement entretenu par la corporation des économistes. Drôle de corporation, à vrai dire. Il se trouve que j’écoute de temps en temps l’émission du samedi matin à 8 heures sur France Culture, intitulée « L’Economie en questions ». Ils sont quatre ou cinq, ils sont appelés des « experts », ils discutent de deux sujets principaux. Et s’il y a un invariant, il est ici. Pendant une quarantaine de minutes, ces « experts », tous très savants, c’est certain, débattent. Oui, parfaitement : il DEBATTENT. C'est précisément là qu'est l'os. ILS DEBATTENT. Suivant les sujets, il leur arrive même de s’engueuler. Voilà l’abus de langage : ces « experts » dans la « science économique », ils sont rarement d’accord, d’une part sur l’analyse à faire d’un phénomène, d’autre part sur les solutions à apporter aux problèmes et les perspectives. Si c'était une science, il n'y aurait pas de débats aussi vifs (et ce ne sont pas les vitupérations du bibendum plein de suffisance arrogante CLAUDE ALLEGRE qui peuvent me convaincre du contraire). Ecoutez un peu, un jour où vous n'avez rien de mieux à faire, ça devient toujours assez drôle, quand ce n’est pas franchement burlesque, quand ces grands spécialistes attaquent la partie « IL FAUT » du débat.
NOURIEL ROUBINI, cet économiste américain d’origine iranienne, s’est terriblement singularisé, début 2008, en prédisant la catastrophe des prêts hypothécaires aux Etats-Unis (« subprimes »). Tous ses collègues l'appelaient Cassandre : à présent, c'est plus un Cassandre, c'est un grand savant. Combien sont-ils dans le monde ? En France, on connaît maintenant PAUL JORION (l’homme au blog), qui avait aussi prévu la crise de 2008. Il prédisait hier la désintégration de l’Europe. Faut-il espérer qu’il se trompe ? De tels économistes, il doit y en avoir quelques autres dans le monde. Mais ils sont l’exception : dans l’ensemble, la profession se trompe régulièrement, incapable de seulement anticiper les événements. Or la profession, ce sont les « experts », et les « experts », ils sont où ? Ils enseignent l’économie, pardi. Ils forment de futurs économistes. Certains deviendront profs à leur tour, et la boucle est bouclée. C’est comme le poisson rouge dans son bocal : il tourne en rond. On serait dans les biotechnologies, on appellerait ça le « clonage ». On n’est pas près d’en sortir.
Je ne m’attarderai pas sur la folie furieuse de l’économie financière, sur la dictature des marchés et des « agences de notation », sur la récente et la peut-être future catastrophe. Je ne suis pas « expert », moi. Je me contente de regarder (et de subir, comme tout un chacun) la voracité de ce tout petit monde qui fait la loi au reste du monde. Je m’intéresse quand même à son fonctionnement, après tout, je suis concerné. J’ai donc mon mot à dire. Des gens plus qualifiés s’y intéressent aussi. ALBERT JACQUARD : J’Accuse l’économie triomphante ; VIVIANE FORRESTER : L’Horreur économique ; EMMANUEL TODD : Illusion économique ; et j’ajoute, pour faire bonne mesure, l’économiste JOHN KENNETH GALBRAITH : Les Mensonges de l’économie. Il n’a pas été Prix Nobel d’économie, celui-là ? Sauf qu’en fait de Prix Nobel (c’est-à-dire ceux fondés par ALFRED NOBEL en personne), il y en a CINQ et pas un de plus : médecine, chimie, physique, paix, littérature. Prix Nobel d’économie : inconnu au bataillon ! Oui, il existe un Prix d’économie, décerné (depuis 1968 ?), par la Banque de Suède, que les journalistes traduisent (faut-il qu’ils soient paresseux !) Prix Nobel. Là encore, donc, un simple ABUS DE LANGAGE. L'économie est bourrée d'abus de langage.
Bref, les quatre auteurs ci-dessus (dont un Prix « Nobel » donc) s’en prennent à l’économie en tant que telle. Todd, par exemple, parle en 1998 du « projet d’une impossible monnaie européenne » (c’est moi qui souligne). Lui aussi, il croit que l'Europe va se désintégrer ? Peut-on parler d’économie quand on n’est pas un « expert » ? La réponse est définitivement OUI ! C’est comme en psychanalyse, où vous avez JACQUES LACAN d’un côté, et de l’autre des gens comme DIDIER ANZIEU. L’un jargonne à qui mieux-mieux, et ça intimide, et ça impressionne les gogos. L’autre explique des choses complexes dans une langue claire qui cherche avant tout à être comprise. La plupart des économistes jargonnent, avec l’intention bien arrêtée de maintenir le profane hors du cercle des initiés. Mais tous ces gens, finalement, n’ont aucune certitude, mais aussi aucun compte à rendre (mais quel responsable, aujourd’hui a des comptes à rendre ?). Ils peuvent, crise après crise, continuer à SE TROMPER (soyons indulgents : en CHANGEANT D'ERREUR à chaque fois, en adoptant une erreur différente, parce que nous, on a oublié la précédente, et c'est bien, parce que, comme ça, tout le monde croit ce qu'ils disent A PRESENT) dans les mêmes médias : voyez le petit ALAIN MINC qui, en tant que « consultant » (ça veut dire « expert » je suppose) grassement rétribué, continue à « conseiller » les puissants.
Moi, ce que je comprends, dans les diverses (et opposées) théories économiques, c’est que le fait même qu’il y ait des théories économiques est en soi une IMPOSTURE. (Je ne reviens pas sur celle que constitue le mot « science ».) Parlons de DOCTRINE, ce sera plus honnête. Le mot « théorie » est fait pour impressionner, rien de plus. En fait, ce que ne disent pas les « experts », c’est que dans leurs « théories », il y a moins d’ ECONOMIE que de POLITIQUE. Les fantoches « politiques » (vous direz que j’abuse des guillemets, mais il les faut) qui défilent sur les écrans et dans les journaux sont précisément cela : des FANTOCHES. Ils nous font croire qu’ils font de la politique, alors que la politique, elle se fait aux derniers étages des GOLDMAN SACHS et autres multinationales, elle se fait dans ces merveilleux endroits répartis sur toute la planète, monde sur lequel l’argent ne se couche jamais (bien content de ma formule). On appelle ça les « bourses » (c’est cruel pour les mâles, mais il est vrai qu’une bourse, ça se remplit et ça se vide : pardon. Il y a bien dans ma belle ville une rue Vide-bourse !).
Sarkozy et ses complices du G 8 font semblant d’être des acteurs, d’avoir du pouvoir, pire : ils nous font croire qu’ils savent ce qu’il font, et qu’ils feront ce qu’ils disent. En réalité, ils courent derrière, en essayant de nous convaincre que « la politique a repris le dessus », et qu’ils sont les meneurs de cet Amoco Cadiz. C’est à cette tâche constante (marteler, bourrer le crâne) que se consacre l’industrie télévisuelle et une bonne part de la presse papier (presse-papier ?). Quand, le soir même de son élection, NICOLAS SARKOZY va passer la soirée au désormais célèbre Fouquet’s, ce n’est pas parce qu’il est ami de quelques milliardaires. Il n’est pas le chef, ce soir-là : il est le LARBIN. Les gars autour de la table, disent : « C’est bien que tu sois élu. Maintenant, tu vas pouvoir faire NOTRE POLITIQUE ». Dites-moi si je me trompe : est-ce que ce n’est pas comme ça que ça s’est passé effectivement ?
Allez : la vie est belle et c’est tant mieux (il faudra que je trouve une formule plus personnelle. « Et c’est ainsi qu’Allah est grand », par exemple. Ah mais je m’aperçois qu’ALEXANDRE VIALATTE me l’a ôtée de la bouche, il y a déjà quelques décennies).
10:57 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, économie, société, politique, nicolas sarkozy, science, débat, claude allègre, nouriel roubini, paul jorion, alexandre vialatte, et c'est ainsi qu'allah est grand



