jeudi, 23 août 2012
LA METHODE VIALATTE 2/5
2
Pensée du jour : « Janisson [personnage d'un roman de Jean-Claude Sordelli] mène une petite vie, plus seul qu'un croûton de pain tombé derrière une malle dans un grenier de chef-lieu de canton ».
Alexandre Vialatte
***
Résumé : pour faire l'éloge de la digression, je parlais d’un cactus mexicain et de son principal alcaloïde : peyotl, objet d’un rituel chez les Tarahumaras, et la mescaline, devenue, comme tous les psychotropes chez les occidentaux, une drogue, avec accoutumance et dépendance. Car la civilisation occidentale, en même temps qu'elle constitue pour le monde le poison violent qu'elle lui a inoculé de force, a inventé quelques moyens chimiques de lui échapper tout en en exprimant la vérité foncière.
La drogue dure est la vérité ultime de la civilisation occidentale.
On voit les effets de ce cactus sur l’esprit faible (mais malin) d’un petit escroc occidental des années 1970, nommé Carlos Castaneda, passé avec armes et bagages sous l'emprise du supposé sorcier Yaqui Don Juan Matus, comme il le raconte dans un livre qui m’a, au moins un temps, fasciné : L’Herbe du diable et la petite fumée (éditions Soleil Noir, la suite (interminable) se trouve chez Gallimard, l’herbe du diable étant, je crois me souvenir, le redoutable datura). J'en suis redescendu.
Car l’auteur a très bien su récupérer armes et bagages pour transformer ses expériences initiatiques et hallucinatoires (« Don Juan, ai-je vraiment volé ? », demande-t-il après avoir atterri) en retombées sonnantes et trébuchantes, aussi longtemps qu’il fut à la mode. S’il est mort, au moins est-il mort riche.
Revenons au peyotl, ce petit cactus. C’est après avoir absorbé un peu de son principal alcaloïde que Jean-Paul Sartre écrivit Les Séquestrés d’Altona (1959), pièce dans laquelle un des personnages apparaît récurremment sur scène en vociférant : « Des crabes ! Des crabes ! ». Ceci pour traduire l’hallucination qui ne le quitta plus guère après cette ingestion de mescaline (car c’était elle). Il voyait, dit-on, des homards autour de lui quand il marchait aux Champs Elysée. Moralité : sans crabe, pas d'existentialisme. Quel dommage que Sartre ait rencontré la mescaline !
On a compris pourquoi il a cette gueule hallucinée de crapaud désordonné et fiévreux. Et on comprend pourquoi tout Sartre est ennuyeux. C’est péremptoire, je sais. Mais j'ai été membre fondateur d'un "club des péremptoires". Cela tombe bien. La même drogue produisit de tout autres effets, et combien plus admirables, chez Henri Michaux.
Pour revenir à mon sujet, j’ajouterai donc, et c’est de la pure logique, que la digression fleurit où elle est semée, et que, jusqu’à plus ample informé, le pommier ne pond aucun œuf avant d’y avoir été obligé. Peut-être même encore après. La chose reste à confirmer. L’association d’idées, dans ce qu’elle a de plus arbitraire, personnel, soudain et momentané, est la règle souveraine de la digression.
C’est vrai, vous avez des gens uniquement préoccupés de l’unité, de la cohérence, de l’homogénéité de ce qui sort de leur plume. Des obsédés de la ligne droite, de la vue d'ensemble et du but à atteindre. La ligne droite qui explique le monde, la vue qui le synthétise, et le but qui le résout. Même qu'après, vous avez l'impression d'avoir tout compris. Des aveuglés de la totalisation.
Eux, ils écrivent de gros traités ou bien de grands romans. Ils sont guidés par les principes de tiers-exclu et de non-contradiction. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, dont aucune adventicité parasite ne saurait les distraire ou les détourner. Ils sont en mission. Ils veulent tout dire. "Epuiser le sujet", l'expression est révélatrice.
A eux les grandes constructions. Je ne crache pas dessus, loin de là, car ça peut produire des chefs d’œuvre inoubliables : Guerre et paix (Tolstoï), Traité de l’argumentation (livre génial et profondément humaniste de Chaïm Perelman, dommage qu’il décourage les non-spécialistes, car il se lit comme on boit du petit lait (dont je parle en connaisseur), pour moi, c'est de la littérature), L’Homme sans qualités (Musil), La Recherche du temps perdu, et autres monuments monumentaux, que le notaire du Poitou stocke sur ses rayons, au lieu de les ouvrir.
C’est comme quand vous voyagez. Il y a ceux qui ne tolèrent de voir le monde que derrière les vitres d'une bétaillère de 80 têtes, et il y a ceux qui ne voudraient pour rien au monde se confier à autre chose que leur caprice. Je suis de ces derniers.
Les Japonais ne sauraient, pour venir voir la Joconde, se déplacer qu’en masses compactes et métronomisées, selon un agenda millimétré au quart de poil, où même les moments de « liberté » octroyés sont dûment inscrits par le tour-opérateur. Et il ne s’agit pas de sortir du cadre et de l’itinéraire. Ça ne plaisante pas.
Je préfère quant à moi annoncer à ma petite famille, un jour de 1989, sur l'herbe du camping Amsterdamsebos (ci-dessus), que l'année prochaine, on ira en Roumanie. Comment ? Par où ? Combien de temps ? Avec quels points de chute ? On aura bien le temps de voir, que diable, quand on sera sur place. C'est vrai que cette manière de faire comporte quelques inconnues, quelques imprévus, quelques incidents. Ah ça, c'est sûr qu'il faut savoir ce qu'on préfère.
Car il faut bien dire que les voyages qui vous font « faire » la Turquie ou la Grèce en 10 jours, l'oeil sur la montre et le doigt sur le déclencheur photographique, tout comme les grands plans d'ensemble, les grandes constructions, les grandes explications définitives du monde (façon Kant), les grandes idées pour le transformer (façon Marx), et pour tout dire, les systèmes qui vous livrent le monde clé en main, tout le monde n'est pas fait pour. Je connais des allergiques.
Et que, face au voyage entièrement packagé et acheté prêt à l'emploi, comme face à l’énormité des ambitions encyclopédiques et totalisantes, appauvrissantes et accumulatrices, mesquines et simplificatrices, face à ces laboratoires où l’homme expérimente son absence ou sa destruction, il y a place pour le fragment, l'anecdote, le détail concret, la musarderie, le nez au vent, le chatoiement de la lumière dans le sous-bois. La vie.
Bref, il y a place pour Alexandre Vialatte (le voilà !), ses frères, ses cousins, sa parentèle. J'ai tendance à me sentir de cette famille. Il y a place pour la flânerie : sans but et curieuse de tout. Flânerie n'est pas vide ou désoeuvrement. Oui, appelons ça la vie. Quoi, au ras des pâquerettes ? Bien sûr. A quelle altitude croyez-vous vivre ? Relisez la dernière phrase des Essais de Montaigne : « Si avons-nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde si ne sommes assis que sus nostre cul ». Parfaitement, c'est la dernière phrase.
Ce n'est pas du haut d'un char d'assaut à touristes que vous aurez pu, un jour, comme ça, poser votre vélo sur le talus d’un chemin des « marais », et vous asseoir à penser à rien. La Bourbre est juste là. Et puis vous regardez quelques feuilles mortes, à deux mètres. Ça bouge, ma parole. Bizarre. Quelque chose grabote en dessous. Ça crisse. Vous ne rêvez pas. Et puis elle apparaît, la taupe, elle est sortie de ses souterrains pour varier le menu, elle en a assez, du sempiternel ver de terre.
Vous vous souviendrez même longtemps, dans la chair de vos doigts, de la défense acharnée qu'elle vous a opposée, quand l'idée saugrenue vous a pris de la capturer. Un conseil : méfiez-vous des dents. Même les griffes ne sont pas à négliger.
Alors je demande quelle théorie scientifique, quel système philosophique, quelle conclusion sur le sens de la vie ou l'existence de Dieu voulez-vous tirer de ça. Pas lerche ! Contentez-vous de saisir l'instant, voilà. Ce n'est pas Imanuel Kant qui peut se vanter d'avoir observé une taupe in vivo. En tout cas, il n’en fait pas état dans Critique de la raison pure. Selon moi, il a tort.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, alcaloïde, peyotl, tarahumaras, psychotrope, drogues dures, carlos castaneda, l'herbe du diable et la petite fumée, yaqui, don juan, jean paul sartre, théâtre, les séquestrés d'altona, mescaline, hallucination, henri michaux, association d'idées, léon tolstoï, guerre et paix, chaïm perelman, traité de l'argumentation, robert musil, l'homme sans qualités, la recherche du temps perdu, roumanie, kant, marx
mercredi, 22 août 2012
LA METHODE VIALATTE 1/5
Pensée du jour : « Aussi les pères de famille avisés attachent-ils par une corde courte au piquet central de la tente les grand-mères et les enfançons. Une barrière de barbelés isole du monde ces radeaux de la Méduse. Un haillon vert y sèche à côté d'une loque rose. La vache vient, contemple et s'étonne, le prisonnier se souvient et passe, le promeneur regarde et fuit épouvanté. C'est ce qu'on appelle un camping de vacances ».
Alexandre Vialatte
***
Je m’adresse aujourd’hui – j’aime autant annoncer la couleur –, à ceux de mes lecteurs que je déboussole, que je décontenance, que je dépayse, que sais-je, que je dérange, déroute, voire désarçonne ou désoriente (j’en ai d’autres dans la musette, au cas où …, par exemple « agace ») par la tentation à laquelle je cède un peu trop volontiers, de me laisser, faute de rigueur intellectuelle, embarquer dans des « arabesques », comme les appelle Chateaubriand dans Mémoires d’Outre-Tombe, c'est-à-dire des « digressions » (« parabases », pour les amateurs).
La digression, parfaitement, voilà l’ennemi, paraît-il. Je me propose de traiter le sujet en tant que tel, dignement, et de le traiter d’une manière formellement idoine à la matière. « Il ne faut pas confondre la forme et le fond », proclamait pourtant, affolé, Monsieur René Bady, dans un des cours les plus mouvementés (il n'avait jamais eu autant d'auditeurs) de sa tranquille histoire de professeur d’université. Il reste l’auteur d’une thèse de doctorat qui est restée dans les mémoires : tout le monde se souvient de De Montaigne à Bérulle. La modernité lui a répliqué : « La forme doit épouser le fond ».
Le pauvre homme, qui était admirablement humble et catholique, ne s’y est pas retrouvé. Le garnement infernal que je fus se souvient des cours sur l’ode au 16ème siècle (aussi, a-t-on idée !) : le cours durait quelques minutes, avant d’être sommairement exécuté par les ballons bondissant de mains en mains. Malheureux René Bady ! Tout perclus de savoirs précieux, mais sortis de l’usage et du respect, il rangeait tristement ses notes sérieuses et quittait l’amphithéâtre, accompagné de nos aboiements féroces et déracinés.
Cette série de notes se propose rien de moins que de faire l'éloge du contournement, de la trajectoire déviée, de l'embardée poétique et du désir de musarder en route au lieu d'aller bêtement d'un point à un autre en TGV. Car ces lecteurs bienveillants, mais exigeants, me reprochent de faire comme les parents du Petit Poucet, je veux dire de vouloir les perdre dans la forêt. L'enjeu est de taille, on en conviendra.
Je réponds d’urgence à ce reproche, dans un premier temps, que les cailloux blancs ne manquent jamais chez moi pour retrouver le râtelier parental, même quand il n’y a rien à y ruminer. Je veux dire que ma flèche ne perd jamais de vue le centre de la cible, ni le terme final de sa trajectoire ondulante et sinusoïdale. Que le Nord est toujours inscrit au fronton de ma boussole capricieuse.
Dans un deuxième temps, je dirai que la tentation est une chose trop sérieuse pour ne pas appeler une réponse vigoureuse et adéquate. Il faut y réagir vivement pour en prévenir les effets néfastes. La tentation ? Quelle horreur ! Le mieux est donc d'y céder aussitôt qu’elle se présente. Et de réserver les éventuelles velléités de résistance pour des combats plus formidables et plus essentiels.
Cette solution lumineuse, simplissime et fructueuse me fut dévoilée un beau jour, en dehors des adventicités naturelles du quotidien, dans un petit livre que je recommande vivement : La Papesse Jeanne, d’Emmanuel Rhoïdès (ou Roïdis, éditions Actes-Sud). Je ne l’aurais sans doute jamais lu s’il n’avait pas été traduit en français par Alfred Jarry en 1900 et des poussières.
Revigorant, et même coruscant. Je le confesse : il prêche une morale que les normes admises, certes, désavoueraient, mais qui le fait de façon si aimable, et sur un ton si espiègle que les normes elles-mêmes se disent qu'au fond, pourquoi pas ?
Les esprits perspicaces ont déjà perçu la digression qui me tend les bras : c’est quoi, cette histoire de « Papesse Jeanne » ? Pour vous montrer que le pire n’est pas toujours sûr, sachez que, pour une fois, je ne céderai pas à la tentation. Même si vous aimeriez bien en savoir plus. Le devoir avant tout. Plus tard peut-être. En attendant, voici une photo prise à l'époque des faits relatés (et qui illustre le scandale).
Dans un troisième temps, qu’on se le dise, si la notion de « digression » (ou d’« excursus ») existe, ce n’est pas moi qui l’ai inventée. Or, il faut savoir que tout ce qui a été inventé par l’homme depuis la nuit des temps, l’homme s’en est servi, de la fourchette à la bombe atomique, en passant par le pédalo, la pince à épiler, le ticket de métro, l’assiette anglaise et le soc de charrue. Mais sait-on encore ce qu’est une « assiette anglaise » ?
J’ajoute que, si c’est à ma disposition, je serais bien bête de ne pas en profiter : après tout, la digression n’est pas faite pour les chiens. C’est vrai, ça : un chien, même mal éduqué, ne digresse jamais. La digression est hors de portée du règne animal. Le règne animal se déroule en ligne droite. Enfin je crois.
Et comme la digression est gratuite, elle est dans mes moyens. Dans le jardin où l’on cultive toutes les fleurs de rhétorique de la création, « chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite » (Georges Brassens, pour retrouver le titre, je vous laisse faire).
De toute façon, dit Antonin Artaud (c’était avant les électrochocs aimablement et doctrinalement administrés par le docteur Ferdière, dans son service psychiatrique de Rodez) : « Il n’y a pas d’art au Mexique, et les choses servent ». Il était en villégiature chez les Indiens Tarahumaras, dont il appréciait le plat principal, le cactus nain appelé « peyotl », chargé de forces mystérieuses. Après tout, c’est peut-être au peyotl qu’il la doit, Artaud, son « exaltation » ?
Pour la suite de la digression, merci d'attendre à demain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, chroniques de la montagne, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, digression, parabase, méandre, montaigne, déviation, petit poucet, la papesse jeanne, emmanuel rhoïdès, alfred jarry, morale, brassens, antonin artaud, rhétorique, docteur ferdière, peyotl, cahiers de rodez, tarahumaras, drogue
vendredi, 17 août 2012
A BAS LES HERETIQUES ! (4)
Pensée du jour : « Frappé d'une balle qui, pénétrant dans la poitrine, traversait le poumon et sortait par le dos, cet officier a survécu à cette mortelle blessure ». Général Trochu
On apprend qu’un certain VIGILANCE fut condamné parce qu’il condamnait le culte des saints, la vénération de leurs reliques et le célibat. Cet homme devait se tenir honorablement quand il était à table ou au lit. On apprend qu’il ne faut surtout pas confondre les « vaudois » et les « valésiens » : alors que les premiers, très banalement, exécutent à l’instant même où ils le prononcent leur vœu de pauvreté, les seconds n’admettent dans leurs rangs que des eunuques, sauf quelques hommes « entiers », à qui ils interdisaient l’usage de la viande jusqu’à ce qu’ils se fussent mutilés.
Je ne vais pas insister sur les appellations fleuries dont Notre Sainte Mère l’Eglise Apostolique et Romaine a affublé les innombrables croyants de la VRAIE FOI (ils se déclaraient tous catholiques) qui avaient le malheur, soit d’ajouter, soit de retrancher, soit encore de modifier si peu que ce fût le moindre cil, la virgule la plus modeste ou l’accent le moins grave au plus mince article de la dite foi.
Car ce sont, sachons-le, les théologiens officiels de l’Eglise qui ont baptisé chaque hérésie du nom qu'elle porte. Et leur imagination lexicale fut sans bornes, comme essaie de le montrer la présente série de notes, qui pourtant ne donnent de l’ensemble que la minuscule partie émergée de l’iceberg théologique et doctrinal. Ils ont fait montre, au cours de siècles, d'une véritable constance dans l'invention poétique.
Je me demande s’il n’y a pas un germe du petit père STALINE (JOSEPH VISSARIONOVITCH DJOUGACHVILI) dans le centralisme catholique. Ou alors du jacobinisme. A force de larguer à grands coups de conciles et de tatanes dans le derrière, hors de la communauté des croyants, les Coptes (ou Cophtes), les Syriaques, les Orthodoxes, et autres variantes locales de ce que les autorités appelaient la VRAIE FOI, le catholicisme romain ressemble à un arbre qui se serait élagué lui-même.
Jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un moignon de tronc, avec certes quelques racines, mais dépourvu de tout branchage et de tout feuillage. Jusqu’à devenir un arbre sec. Un arbre mort. Certes, cette vigilance dogmatique et doctrinale a donné à l’appareil clérical une puissance nonpareille à une certaine époque (entre autres, en faisant affluer les picaillons dans les coffres de la maison-mère). Mais elle a fini par assécher la source même de son esprit.
Reste qu’il est amusant de penser que des foultitudes de petites gens se sont ingéniées à faire chier la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (naguère présidée par Monsieur RATZINGER, alias BENOÎT XVI), à justifier la rémunération d’un innombrable et compact agrégat de fonctionnaires aussi pontificaux que sourcilleux, et à donner du boulot pendant des siècles aux dizaines de milliers de membres d’une corporation qu’on pourrait appeler des « contrôleurs de conformité » (autrement dit des flics de la pensée et de la conscience), ne serait-ce qu'en stimulant leur créativité poétique.
Car il y a indéniablement une force poétique dans les noms de baptême accordés par Rome à tout ce qui faisait mine de s'écarter de la ligne. Que pensez-vous de caucaubardite, nom qui fut donné à une branche des eutychiens ? Des manifestaires, ainsi nommés parce qu'ils croyaient criminel de dissimuler leur doctrine quand ils étaient interrogés ? Des tropites, pour qui le Verbe divin, du fait de son incarnation, cesse d'être une personne divine ? Des rebaptisants, qui renouvelaient le baptême de gens déjà baptisés, mais par des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ?
N'y a-t-il pas une authentique imagination poétique pour nommer psatyriens les égarés qui pensaient que Jésus Christ n'était pas Dieu, mais une créature ? Parherméneutes, ceux qui interprétaient à leur guise les Ecritures en faisant foin « des explications de l'Eglise et des docteurs orthodoxes » ? Aquatiques, ceux qui « regardaient l'eau comme un principe coéternel à Dieu » ? Et les pneumatiques ? Et les condormants ? Et les familistes ? Et les jovinianistes ? Et les ethnophrones ? Tout ça déborde d'une inventivité poétique proprement héliconienne, ne trouvez-vous pas ?
Passons sur les naturalistes, qui expliquent les miracles par des causes naturelles ; sur les mutilés de Russie, qui pratiquaient l'automutilation, et dont les lubies menaçaient les marins de la flotte impériale ; sur les métangismonites, qui soutenaient que « le Verbe est dans son Père comme un vaisseau dans un autre ». On reste confondu devant des extravagances, je devrais dire des vésanies aussi manifestes.
Le tort des hérétiques, donc ? Leur imagination. Car il en fallait, pour imaginer que la Sainte Trinité est formée de trois substances égales (trithéistes) ou que les sacrements sont inutiles, au motif que « des effets incorporels ne peuvent être communiqués par une cause matérielle et sensible » (ascodroupites). Les inquisiteurs ne furent que le paroxysme fanatisé de cette POLICE CATHOLIQUE chargée de faire le ménage dans le troupeau.
La réflexion que m’inspire la notion d’hérésie définie par les autorités catholiques, c’est qu’elle suppose un sentiment très aiguisé de la hiérarchie, quasi-militaire, parmi les croyants. Grosso modo, l’Eglise ne peut faire aucune confiance dans les fidèles de base (le vulgum pecus) pour ce qui est de la vérité de la foi : dès qu’on leur laisse la bride sur le cou, les croyants partent dans tous les sens et, surtout, ils se permettent d’improviser des articles de foi qui n’ont pas reçu le visa des autorités romaines. Il ne faut pas rigoler : il y a la brebis de base, qui n'a qu'à suivre, puis les brebis en chef, puis les chef-brebis, etc. ... jusqu'au pape.
Car si on laissait faire, ce serait l’anarchie. Il est donc nécessaire, pour guider tout le troupeau mondial dans la même direction, de fixer d’en haut le contenu de la foi. C’est d’ailleurs la question du « libre examen » qui (entre autres) va creuser le fossé le plus profond entre catholiques et protestants, en accordant à tout croyant le droit de décider lui-même de sa relation à Dieu.
Quand chacun peut décider pour son propre compte du contenu et des modalités de sa foi, on assiste à l’atomisation de la grande Eglise en petites chapelles éparpillées et autonomes. Exactement ce qui s’est passé avec la prolifération des sectes protestantes. C'est un certain JOSEPH SMITH qui a fondé la secte des mormons. Un certain CHARLES TAZE RUSSELL la secte des témoins de Jéhovah (vous savez, ceux qui vont toujours par deux, mais qui n'entrent jamais, tout comme les testicules). Un certain LAFAYETTE RONALD HUBBARD la scientologie, la secte mercantile qui voudrait passer pour une Eglise, et qui tente de se faire admettre comme religion.
En fait, je vais vous dire, c'est la multiplication des Papes qu’a reçu pour mission de prévenir et d’empêcher la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et la besogne n’a pas manqué. La multiplication des pains suffit aux catholiques.
Les aphthartodocètes furent-ils d’authentiques eutychiens ? L’hérésie colarbasienne eut-elle tort de considérer l’alphabet grec comme la perfection et la plénitude de la Vérité (à cause de : « Je suis l’α et l’ω » (l’alpha et l’oméga)) ? Les saccophores n’étaient-ils qu’une bande d’hypocrites ? En tout cas, personnellement, j’assure qu’aucun conflit de m’oppose aux corrupticoles, aux hétérousiens, aux gomaristes, et autres métangismonites, pas plus qu’aux hypsistariens, aux infralapsaires et autres mammillaires, chez qui le jeune homme qui voulait épouser une jeune fille n’avait pourtant qu’à lui « mettre la main sur le sein », une véritable incitation à peloter les jolies femmes dans la rue.
Voilà ce que je dis, moi.
Suitetfin demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérésie, religion, société, foi, secte, catholicisme, protestantisme, église romaine, luther, calvin, vaudois, théologie, staline, coptes, syriaques, orthodoxes, ratzingeer, benoît xvi, congrégation pour la doctrine de la foi, sainte trinité, mormons, témoins de jéhovah, scientologie, lafayette ronald hubbard, évangile, ancien testament, poésie, littérature
jeudi, 16 août 2012
A BAS LES HERETIQUES ! (3)
Pensée du jour : « L'estomac d'un Espagnol ne dure pas à notre forme de manger, ni le nôtre à boire à celle des Suisses ». Michel de Montaigne, Essais, III, 13

Résumé : les autorités catholiques de Rome ont passé beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre les formes incorrectes de la foi, pour empêcher les populations de croire en Dieu d'une manière hétérodoxe, voire incontrôlable. C'est ce que déclare en 1847 l'abbé GUYOT, auteur d'un Dictionnaire des hérésies.
Il va même jusqu’à énumérer les sectes qui selon lui ont d'ores et déjà démembré la doctrine luthérienne : synergistes (pour qui « l’impulsion de la grâce est accompagnée de la coopération de la volonté humaine »), substantiaires (pour qui « le péché originel est devenu la substance même de l’homme »), osiandrites, indifférents (emmenés par MELANCHTON), stancaristes, majoristes (qui « renouvelaient le semi-pélagianisme », ce sont des choses qui gagnent à être sues), antinomiens (qui « conclurent à la suppression de toute foi religieuse »), syncrétistes (dont les promoteurs furent persécutés, apprend-on non sans un certain effroi, par les protestants eux-mêmes), hubérianistes (selon qui « tous les hommes sont justes »), origénistes, millénaires, invisibles, ubiquistes (qui se sont opposés, il faut le savoir, aux sacramentaires), piétistes (vulgaires « dévots fanatiques »), anabaptistes, sociniens, ainsi qu’une « foule d’autres sectes, aussi peu constantes dans leur forme respective que l’astre des nuits ».
Comment voulez-vous, sous ce Niagara de sectes, que MARTIN LUTHER continue à respirer ? Certes, l’abbé GUYOT, charitablement, se livre à cette énumération avec une visible et onctueuse délectation sadique : visiblement, ce déluge qui semble emporter la grande hérésie vers les ténèbres n’est pas pour déplaire au saint abbé.
Il faut reconnaître, quand vous regardez le protestantisme, vous ne savez plus où donner de la tête. Cela grenouille (de bénitier) à qui mieux-mieux. C’est de l’enchevêtrement de vers de terre dans lequel une éléphante normale ne reconnaîtrait pas ses souriceaux, ni le pommier les cerises tombées à son pied.

Hélas, là où l’abbé GUYOT se met les deux gros orteils dans les deux yeux jusqu’à la pendule de grand-papa, c’est que MARTIN LUTHER, non content de ne pas être mort des dissidences qui ont fractionné sa nouvelle religion, en est sorti plus remuant et ressuscité que jamais. Les sectes protestantes sont, non pas des meurtres du père, mais autant de gouttes de sa semence.
Chacune des sectes énumérées ci-dessus pas loin porte le même ADN que MARTIN LUTHER. Pauvre abbé GUYOT, quand même. Il ne s’est même pas rendu compte que, loin de faire disparaître le protestantisme, la pullulation des sectes scissipares du luthéranisme en avait étendu la contagion partout sur la planète, à commencer par les tout nouveaux Etats-Unis.
Il reste qu’on trouve dans le livre du bon abbé des noms de sectes d’un ardent effet poétique. J’aime assez celles qu’il rassemble sous l’appellation de « Bulgares ». Ce ne sont que « patarins », « turlupins » « cathares », « bogomiles », « joviniens », « albigeois ». Et que pensez-vous des « pétrobrusiens » ? Ne sont-ils pas délicieux ? GUYOT fulmine contre toutes sortes de « manichéens », de « henriciens », de « novateurs », condamnés en 1176 « au concile de Lombez, dont les actes se lisent au long dans Roger de Hoveden ». Je signale par ailleurs aux amateurs d'anecdotes lexicales que, à partir du mot « bulgare », le français a formé « bougre » pour désigner tout homme qui se livrait à la sodomie.
Que reproche aux « bulgares » Notre Sainte Mère l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine ? De proclamer la vérité d’erreurs aussi manifestes que les suivantes : « Que les maris qui vivaient conjugalement avec leurs femmes ne pouvaient être sauvés ; que les prêtres qui menaient une mauvaise vie ne consacraient point ; qu’on ne devait obéir ni aux évêques, ni aux ecclésiastiques qui ne vivaient point selon les canons ; qu’il n’était point permis de jurer en aucun cas, et quelques autres articles qui n’étaient pas moins erronés ».
On croit rêver, n’est-ce pas ? Ainsi – si j’ai bien compris –, le mari ne doit pas remplir de « devoir conjugal », et le clergé doit marcher au son du canon. Et je ne parle pas des « frérots » ou « fraticelles », ni des « dulcinistes », et encore moins des « apostoliques » (franchement, on ne sait plus à qui se fier) : « Pour lors, ils avaient secoué toute honte : ils disaient qu’on n’est parvenu à l’état de liberté et de perfection que quand on peut voir sans émotion le corps nu d’une personne de sexe différent ». Le Ciel me préserve de secouer un jour toute honte !
Si l’on m’y pousse, je révélerai toutes les turpitudes commises par les « abécédaires » ou les « omphalophysiques » (nom par lequel on a probablement voulu désigner les « hésichastes », mais cela va sans même le dire). A la lettre « O » du dictionnaire, on trouve par ailleurs dénoncés les « ophites », les « opinionistes », les « orbibariens » et – accrochez-vous aux poignées et aux barres – les « optimistes ». Je vous jure que c’est vrai : c’est page 257. Je ne suis donc pas le seul à dénoncer les optimistes. Cela me fait chaud au coeur, et je me sens moins seul.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérésie, religion, croyance, foi, église, protestantisme, catholicisme, pape, schisme, montaigne, catholique romain, dieu, secte, dicitonnaire, martin luther, jean calvin
jeudi, 09 août 2012
TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ? (fin)
Météo des Jeux : l'aviron, avant même d'être une épreuve olympique, est un problème scientifique. Allonger la pelle de huit centimètres coûterait moins d'énergie, mais demanderait plus d'efforts. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est scientifique.
Résumé : les récalcitrants au culte tintinesque qui, à l’issue de leur scolarité, ne sauraient pas par cœur les 22 volumes de cette moderne « récitation » (ou « lecture » : je rappelle que « Coran » signifie l’un ou l’autre), seraient envoyés dans des lieux d’accueil  spécialisés destinés à leur apprendre à se concentrer sur l’essentiel, lieux appelés « camps favorisant la concentration ».
spécialisés destinés à leur apprendre à se concentrer sur l’essentiel, lieux appelés « camps favorisant la concentration ».
Un seul cri du cœur, un seul hymne : « Tintin, Tintin über alles », entonné à pleine voix au saut du lit. Et des questions à l’improviste, avec lumière en plein dans les yeux, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit : « Allez, avoue, qui est Foudre Bénie ? » ; « Tu vas cracher le morceau, je te jure, qu’est-ce que tu trafiques avec Rodrigo Tortilla ? Si tu refuses, c’est simple, on te renvoie chez les Arumbayas ! » ;

« Qui c’est, ce Viracocha dont tu parlais dans ton sommeil ? » ; « C’est où, sa planque, à ce Rascar Capac ? » ;  « Et ce 26 rue du Labrador, c’est le repaire de la bande ? » ; « C’est quoi, cette histoire entre Babaoroms et Matouvous ? » ; « Et ce Harrock’n roll, qu’est-ce qu’il est allé faire, sur le Ramona ? » ; « Et c’est quoi, comme message, "La marque que fume Boris", prononcé par un certain professeur Topolino ? » ;
« Et ce 26 rue du Labrador, c’est le repaire de la bande ? » ; « C’est quoi, cette histoire entre Babaoroms et Matouvous ? » ; « Et ce Harrock’n roll, qu’est-ce qu’il est allé faire, sur le Ramona ? » ; « Et c’est quoi, comme message, "La marque que fume Boris", prononcé par un certain professeur Topolino ? » ;
« Et tu me crois assez naïf pour croire que ce Rotule est docteur en ostéologie ? » ; « N 14 ? Qu’est-ce que c’est encore, ce code secret ? » ; « Et qui c'est, ce Ridgewell ? ».

On peut dire que le programme d’étude est copieux. Je dirais même nourrissant. Je vous garantis, les adjudants ont les moyens de faire parler les plus regimbeurs. Impitoyables, ils sont. Vous êtes prévenus.
Vous voilà dans le meilleur des mondes. Big Brother Tintin is watching you. Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas prévenus.
Avec élimination impitoyable des tièdes et des récalcitrants. Il serait donc formellement interdit de récalcitrer à Tintin sous peine d’une mort infamante, infligée après de longues tortures morales, comme dans Orange mécanique (ci-contre), sauf qu’au lieu du finale de la 9ème, on infligerait tout le cursus tintinique au son de : « Tintin, Tintin über alles ». Soyez sûrs qu'Alex Delarge, le personnage de STANLEY KUBRICK, mourrait ignominieusement.  N’ayons pas peur des mots : c’est même au-delà d’un enjeu culturel, c’est carrément un enjeu de civilisation.
N’ayons pas peur des mots : c’est même au-delà d’un enjeu culturel, c’est carrément un enjeu de civilisation.
Mais s'il faut tout dire, il existe une sorte de Docteur MENGELE, l'inventeur de ce programme de « redressement productif », et même moral, que dis-je, le HEINRICH HIMMLER de ce protocole éducatif. Cet homme porte un nom. Il s’appelle FRANÇOIS HÉBERT. Son idée remonte à 1983. Il fut secondé dans son énorme tâche par RENÉE-HELOISE (sic) GIROUX. L’œuvre s’intitule Êtes-vous tintinologue ? et a été publiée aux éditions du Royaume de la bande dessinée. Son idéologie est irréprochable.

C'EST UNE REEDITION
L'oeuvre consiste, à propos de chaque album de cette nouvelle Torah, à poser 50 questions. Le questionnaire est donc composé de 1100 demandes plus ou moins précises, portant sur les éléments importants de la Bible (+ Torah + Coran, ne mégotons pas), mais aussi les détails du dogme. Le dit questionnaire est globalement assez bien fait, et permet de faire le tour du corps de doctrine.
Mais pour parler franchement, leurs questions sont parfois oiseuses. C’est vrai, quand ils demandent de compléter « araignée du matin … », quand ils posent des questions comme : « Qu’est-ce qu’un piranha ? » ou « Qu’est la Grande Ourse ? », on sent qu’ils diluent leur sujet, qu’ils le noient dans les connaissances générales, dont le besoin ne se fait vraiment pas sentir. Pourquoi élargir l'horizon ? On sent chez eux une forme insidieuse de culturgénéralisme désuet, qui offre des relents vaguement hérétiques. On sent que le bûcher n'est pas loin. A tant faire que d'avoir la VRAIE FOI, que diable, autant être INTEGRISTE. Et impitoyable. Etroit.
Ils auraient dû s’inspirer du génie du khalife OMAR qui, autour de 642 après J.C., a ordonné à son général AMR IBN AL AS de brûler la bibliothèque d’Alexandrie, la plus énorme bibliothèque qui eût jamais existé, au motif que si les livres qu’elle contenait reprenaient ce qui est dans le Coran, ils étaient inutiles, donc à jeter au feu. Quant à ceux qui s’écartaient du Coran, ils étaient forcément impies, donc à jeter au feu.

Je propose donc de faire des 22 albums sacrés le socle de la civilisation à venir. Pour commencer, ils tiendront lieu de CONSTITUTION de la REPUBLIQUE. Pour continuer, ils serviront de base au prochain (et inébranlable, cette fois) TRAITE EUROPEEN. Et pour finir, on y trouve une matière suffisante pour en faire la CHARTE DEFINITIVE de l’Organisation des Nations Unies, en même temps que le texte incontestable de la Charia Mondiale. Je le déclare solennellement : j’en ai eu la révélation sur la montagne sacrée (c’est la Croix-Rousse, qu’on se le dise), Tintin sera le Coran de l’humanité tout entière. TINTIN SERA LE GENRE HUMAIN.
Comme dit le Professeur Itard de GOTLIB, à la fin de la rééducation de Victor, l'enfant sauvage (c'est dans La Rubrique-à-brac taume 3) :
« HALLELOUYA GLORIA ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeux olympiques, tintin, aventures tintin, tintinophile, tintinologue
mercredi, 08 août 2012
TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ?
Météo des Jeux : le centre de gravité des sauteurs en hauteur se situe au niveau de la barre, voire pour de rares athlètes juste en dessous. Je jure que je n'invente rien. Ne m'en demandez pas plus. C'est scientifique.
Hier, je le sais, je l’avoue, je suis parti de loin. De trop loin. Tintinophile, colombophile, c’est tout pareil par le suffixe « phile ». Le suffixe « phile » peut mener très loin. Je me garderai du « très loin » pour ne pas décourager le lecteur. J’éviterai donc « drosophile »,  qui est une mouche, donc assez dégoûtant, « scatophile », « coprophile » ou « nécrophile », que je ne veux même pas m'abaisser à traduire en français, et « germanophile », qui rappelle trop à nos « chères têtes blanches » les errements patriotiques de périodes troublées.
qui est une mouche, donc assez dégoûtant, « scatophile », « coprophile » ou « nécrophile », que je ne veux même pas m'abaisser à traduire en français, et « germanophile », qui rappelle trop à nos « chères têtes blanches » les errements patriotiques de périodes troublées.
Qu’on se le dise : on ne commente pas Tintin. Tintin se suffit à lui-même. Pourtant, bien des commentateurs s’y sont risqués.  Je pense à SERGE TISSERON, qui a fait ses débuts en psychanalyse en étudiant les tenants et les aboutissants de certains détails éminemment « signifiants » semés par l’imagination d’HERGÉ au long des pages d’aventures qu’il fait vivre à son héros.
Je pense à SERGE TISSERON, qui a fait ses débuts en psychanalyse en étudiant les tenants et les aboutissants de certains détails éminemment « signifiants » semés par l’imagination d’HERGÉ au long des pages d’aventures qu’il fait vivre à son héros.
Que signifie (en profondeur) la mention « verre sécurit » dans la grosse voiture noire de la Castafiore qui prend Tintin et Milou en stop dans L’Affaire Tournesol ? Dans Tintin en Amérique, que signifie le jaillissement de pétrole sous le cul de l’Indien assis sur un rocher, bientôt suivi par Tintin lui-même, porté au sommet de l’éjaculat par la force minérale de l’huile de pierre (étymologie certifiée exacte de « pétrole ») ? Vous serez sans doute d’accord pour dire avec moi que tout le monde s’en fout ? Cela va mieux en le disant. Il faut laisser les décortiqueurs de sens gagner de quoi survivre. Et à la rigueur de quoi se nourrir, pourquoi pas ?
Voilà le principal : Tintin se suffit à lui-même. Les décrypteurs, déchiffreurs, herméneutes, analystes passent, Tintin reste. Inoxydable. C’est comme le Coran : au lieu d’écoles où les gamins de France « ont la chance D’apprendre dès leur enfance Tout ce qui ne leur servira pas » (chanson bien connue et déprimante d'un certain JACQUES BREL), il faudrait de bonnes madrasas du genre pakistanais ou taliban, où ils apprendraient tout Tintin par cœur. Et si je peux me permettre, je peux vous assurer que dans ces conditions, entre les élèves, le Coran passe.

DE LA MADRASA, ON SORT "TALEB", QUI FAIT AU PLURIEL "TALIBAN"
Avec récitation complète et obligatoire, vignette par vignette, en fin d’année pour passage dans la classe supérieure. Avec examen sélectif pour entrer à l’université. Tiens, qui parmi vous peut me donner la marque des conserves qu’on aperçoit sur une vignette de la page 49 de Tintin en Amérique ? Vous voyez tout ce qui vous manque ? Tiens, comme je suis bon prince, je vous livre la réponse gratuitement.

Avec « formation continue tout au long de la vie ». Ce serait une remarquable utilisation du slogan de LIONEL JOSPIN quand il était aux manettes. Tiens, juste pour voir : quelle est la devise des rois de Syldavie ? Traduisez-la (à peu près) en français. Puisqu’on en est au Sceptre d’Ottokar, quelle est l’adresse exacte du professeur Halambique, à qui Tintin rapporte sa serviette oubliée sur un banc public ?

EIH BENNEK EIH BLAVEK
(QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE)
+
24, RUE DU VOL A VOILE
Et puisqu’on en est aux adresses, donnez un peu celle d’Ivan Ivanovitch Sakharine, le collectionneur de bateaux dans Le Secret de la Licorne. Et dans Le Crabe aux pinces d’or, sous quel faux nom apparaît le cargo Karaboudjan ? Dans le Lotus bleu, quel est le nom de professeur qui connaît l’antidote au « poison qui rend fou », le radjaïdjah ? Et pour faire bonne mesure, dans quelle rue est située sa maison ? Vous voyez ?

MONSIEUR SAKHARINE HABITE 21, RUE DE L'EUCALYPTUS
+
DJEBEL AMILA
+
FAN SE-YENG
+
RUE DU SAGE IMMENSE
Je vous l’avais bien dit, que vous aviez besoin d’un petit stage de remise à niveau dans un de nos charmants centres d’accueil tintinesque. Juste quelques baraquements alignés et sobrement meublés, quelques barbelés électrifiés, quelques miradors garnis de gardes armés,  un appel toutes les trois heures, de la soupe claire pour les repas, et le reste du temps consacré à l’étude des vingt-deux volumes de la Bible tintinesque, pour apprendre à vivre aux « stagiaires », jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé le droit chemin de la vraie foi. Comme c’est pour leur apprendre à rester concentrés en toute circonstance, on appelle ça des « camps favorisant la concentration ».
un appel toutes les trois heures, de la soupe claire pour les repas, et le reste du temps consacré à l’étude des vingt-deux volumes de la Bible tintinesque, pour apprendre à vivre aux « stagiaires », jusqu’à ce qu’ils aient retrouvé le droit chemin de la vraie foi. Comme c’est pour leur apprendre à rester concentrés en toute circonstance, on appelle ça des « camps favorisant la concentration ».
Voilà ce que je dis, moi.
Le bouquet final est à suivre demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, tintinophile, tintinologue, serge tisseron, psychanalyse, hergé, l'affaire tournesol, tintin en amérique, le coran, jacques brel, madrasa, taliban, sceptre d'ottokar, syldavie, professeur halambique, sakharine, lotus bleu
mardi, 07 août 2012
TINTINOPHILE OU TINTINOLOGUE ?
Météo des Jeux : bonne nouvelle, USAIN BOLT et quelques autres sont enfin parvenus à parcourir 100 mètres. Certains en doutaient. Les voilà rassurés. Ils s'en félicitent. Moi je dis : peut mieux faire. J'espère qu'ils pourront aller un peu plus loin, parce que, franchement, quand tu as fait 100 mètres, tu n'as rien fait, ou si peu que rien. Ils n'ont plus qu'à persévérer s'il veulent arriver au bout.
Prêts pour une Grande Digression Symphonique, en forme d’entrée en matière ?
« Tintinophile », qu’est-ce que ça veut dire ? D’abord et déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu’est un « colombophile ». Si vous pensez que c’est un fan de l’acteur PETER FALK (lieutenant Columbo),  un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.
un continuateur de la mémoire de CHRISTOPHE COLOMB, un habitant de Saint-Colomban (c’est en Loire-Atlantique) ou un amateur de voyages en Colombie, vous avez tout faux. C’est quelqu’un qui aime les pigeons, en particulier les pigeons voyageurs. N’en tirez aucun jugement péremptoire.
Le colombophile fait travailler les pigeons pour lui, pour son compte, pour son seul plaisir, gratuitement. C'est une sorte de maquereau, quoi. Sauf que ses putes lui rapportent nib de nib. Disons qu'il s'est fait souteneur pour soutenir la cause. C'est du dévouement, je me tue à vous le dire. La preuve ? Il offre gratuitement le gîte et le couvert à ses gagneuses et à ses gagneurs. C'est bien le moins, vous avouerez.
Pour ce qui est du gîte, certains colombophiles fanatiques, voire enragés, n’hésitent devant aucune folie dispendieuse, comme en témoigne cette photo d’un authentique pigeonnier, digne d'être homologué hôtel cinq étoiles (quoique sans ascenseur ni salle de bains), quelque part dans le nord-est de la France. On peut dire que R. n’a reculé devant aucun sacrifice pour offrir à ses oiseaux le luxe le plus tapageur et le plus extrême.
DANS UN PAREIL 5 ETOILES, TRES PEU DE PIGEONS SE PLAIGNENT DE LEUR SORT
(ET LES ROUCOULEMENTS DE MASSE, IL PARAÎT QU'ON S'Y HABITUE)
Mais en contrepartie, disons carrément que R. exploite honteusement la capacité innée que ces volatiles ont de retrouver leur nid après en avoir été honteusement éloignés à dessein. Au top départ, toutes les cases du camion collecteur s’ouvrent brusquement, dans la région de Narbonne, libérant les pauvres bêtes, dès lors obligées de se creuser la cervelle (sans carte et sans boussole, s’il vous plaît !) et de se rapatrier par leurs propres moyens vers les brumes du nord-est. Le taux de réussite est généralement bon, mais l'aventure connaît parfois quelques ratés, on est obligé de le reconnaître.
Il m’est en effet arrivé de convoyer jusqu’à son point d’origine (enfin, disons pas loin) un de ces malheureux oiseaux qui s’était égaré pas trop loin de chez moi (à 600 km de chez lui, quand même !), pour le restituer (gratuitement, s’il vous plaît, mais combien volontiers !) à son propriétaire. Il lui manquait beaucoup, paraît-il. Pourtant, les 399 autres qu’il possède (authentique, évidemment) devaient l’occuper largement. Que voulez-vous, aurait dit LAMARTINE, « un seul pigeon vous manque, et tout est dépeuplé », n’est-ce pas, R. ?

LUI, C'EST "RED CHAMPION"
(c'est un vrai de vrai, bien sûr)
Le colombophile, c’est donc celui qui aime les volatiles de course (y compris à table, farcis, à condition qu’ils soient jeunes, et là, à table, je me suis aperçu que moi aussi, j'avais des tendances colombophiles), qui gagne des trophées à la sueur de leur front (qu’ils ont fort étroit, par bonheur), qui les laisse régulièrement se dégourdir les ailes pour s’entraîner, en priant cependant le dieu des pigeons qu’aucun autour des palombes, qu’aucun faucon pèlerin ou autre nuisible ne rôde par là ou ne s’est mis à l’affût dans le coin. En un mot, c’est quelqu’un qui ne compte ni son temps, ni son argent, ni son énergie pour perpétuer une espèce qui, par bonheur et pour cette raison, n’est pas en voie de disparition.
EN PLUS, ILS SONT BEAUX, NON, LES CHAMPIONS ?
CE N'EST PAS DU PIGEON DE VULGUM PECUS !
Bon, pour un préambule, ça commence à faire très long. Je me suis encore laissé entraîner, ma parole. Aucune rigueur, tout dans les « arabesques ». Vous pourriez me le signaler, quand ça se produit ! M'arrêter ! Pourtant, je vous jure, j’essaie de me refréner. Mais à chaque fois, ça y est, le démon me reprend, la digression me tend les bras, et je m’y jette avec emportement. Il ne faudrait pas, avec ça, que l’envie me prenne, un de ces jours prochains, d’enseigner ou de devenir professeur. Vous voyez d’ici la catastrophe ?
Imaginez-moi en professeur qui commencerait sur « Mignonne allons voir … » et qui déboucherait sur le burnous trop vaste de RENÉ CAILLÉ, premier blanc arrivé à Tombouctou. C’était le 20 avril 1828. Il profitait de ses larges manches pour griffonner des notes au crayon sur son petit carnet. Là-dessus, vous avez bien compris que je pourrais embrayer sur les djihadistes actuels d'AQMI qui détruisent des mausolées musulmans. Décidément, l'Islam est de plus en plus énigmatique. Mais ici, comme vous le constatez, je résiste à la digression.

Vous voyez ? Une digression, c’est si vite fait. Presque pas le temps de s’en apercevoir. Je tâcherai donc de m’orienter, pour gagner mon pain, dans une autre branche professionnelle que l’Education Nationale. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Si Dieu et le Conseiller d’Orientation n'en décident pas autrement.
Cela donnerait aux rabat-joie de l’anti-France (quand reviendras-tu, Super Dupont ?) une occasion nouvelle de crier au déclin des valeurs, des brosses à dents et du confit de canard. J’éviterai par conséquent de prêter le flanc. De toute façon, je ne suis guère prêteur. Surtout du flanc. Ah si, pourtant : je ne sais plus à quel ami j’ai prêté mon coffret Catalogue d’oiseaux d’OLIVIER MESSIAEN, auquel je tiens tant. Si vous l’apercevez, merci de me tenir au courant.

En revanche, j’ai retrouvé (par hasard) la personne à laquelle j’avais prêté Antiquité du grand chosier d’ALEXANDRE VIALATTE. Et si à ce jour je n’ai pas recouvré mon livre, j’ai du moins retrouvé le sommeil. Conclusion ? J’admire les gens qui, contre vents et marées, savent résister à la digression. Quelle fermeté d’âme est la leur ! Vous avez ci-dessus un compendium de ce qu'il ne faut pas faire, quand on prétend avoir de la fermeté dans l'âme.
Remarquez, je me rappelle les cours du vendredi à 14 heures, avec Monsieur DELMAS, alias Le Baron. C’était, au moins sur le papier, de l’histoire-géographie. Mais c’était une matière qui pouvait aller du montant d’un salaire à consacrer au loyer par un jeune ménage aux souvenirs bretons de vacances de rêve remontant à l’été dernier, en passant par l’immense intérêt qu’il y a pour la jeunesse à apprendre les langues étrangères. Le vendredi à 14 heures, Monsieur DELMAS était le roi de l’ « arabesque » ainsi entendue.
Car, contrairement aux cours qui avaient lieu tôt le matin, la figure de Monsieur DELMAS, à ce moment de la journée, arborait une teinte qui variait, suivant les semaines, et selon les menus et les quantités absorbés au restaurant voisin en compagnie de quelques collègues, du rubescent à peine marqué, au cramoisi le mieux venu, en passant par toutes sortes d’enluminures cuivrées, de pourpres congestifs et de flammes incarnates. Il n’y a pas à en douter, le gras double, le tablier de sapeur et le Chiroubles du patron de « La Meunière », rue Neuve, à deux pas du lycée Ampère, avaient le don d’inciter Monsieur DELMAS à l’arabesque.

LES SALLES D'HISTEGEO ETAIENT AU DERNIER ETAGE, DROIT DEVANT
Promis, après cette « mise en bouche », dès demain, j’en arrive à Tintin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tintin, les aventures de tintin et milou, jeux olympiques, usain bolt, digression, colombophilie, pigeons, christophe colomb, peter falk, columbo, lamartine, rené caillé, tombouctou, mignonne allons voir si la rose, éducation nationale, super dupont, olivier messiaen, catalogue d'oiseaux, alexandre vialatte, antiquité du grand chosier, monsieur delmas, lycée ampère
samedi, 21 juillet 2012
MESSALINE ? POURQUOI PAS MESSALOPE ?
Résumé : le poète ALFRED JARRY décide de s’attaquer à MESSALINE, la femme prostituée de CLAUDE, l’empereur romain. Et le personnage pornographique, passé par des alchimies peu plausibles, devient un personnage tragique.
C’est bien tout l’intérêt du personnage. Et ce n’est pas pour rien qu’ALFRED JARRY, à Messaline, fait correspondre Le Surmâle : elle est, en quelque sorte, une « super-femelle ». Ce sont deux êtres d’exception, la preuve, c’est que les deux meurent à la fin. Messaline, elle, c’est, dans une sorte d’hallucination : elle s’introduit dans le corps le glaive de l’homme envoyé pour la tuer, glaive dans lequel elle voit le phallus tant aimé. Dans le corps, ça veut dire « dans le cœur ».
Quand le soldat commence à sortir la lame de son fourreau : « O comme tu as froid ! dit-elle. Ne touche pas tout de suite le cœur de Messaline, il y fait si doux que tu t’y brûlerais au sortir d’un tel froid ». Au grand dam de l’exécuteur.
« Nec dum satiata recessit » (elle se retira sans être rassasiée) est beaucoup plus simple, et perpétue cette vision masculine : le plaisir féminin est un puits sans fond, la jouissance féminine est potentiellement infinie, et la femme serait, quoi qu’il arrive, par nature, sexuellement insatisfaite, puisqu'il ne saurait y avoir de limite de temps et d'intensité à sa jouissance sexuelle.
C’est une tradition qui remonte au mythe de Tirésias, que tout le monde connaît, mais que je peux rappeler ici. Comme le dit Calamity Jane, dans l’album éponyme de MORRIS et GOSCINNY : « Je vais te raconter l’histoire de ma vie, Lucky Luke, c’est un passe-temps que j’affectionne » (p. 5).
Tirésias est un jeune homme. Un jour, se promenant, il assiste à l’accouplement de deux serpents, et paf, comme de juste en pareil cas, il est illico transformé en femme, et il passe sept ans sous cette forme avant, pour l’exacte même raison, de redevenir un homme.
Cette histoire a transpiré jusqu’à l’Olympe où, une fois de plus, Zeus et Héra se chamaillent sur un point crucial : de l’homme ou de la femme, lequel éprouve le plus de plaisir dans l’amour ? Tirésias, qui a joué sur les deux tableaux, et mangé aux deux râteliers (sur ce mot, voir ci-dessous) répond : si l’on divisait le plaisir amoureux en dix parties, la femme en aurait neuf et l’homme une seule.
Shazam ! Héra, en un éclair, rend le pauvre homme aveugle, elle est furieuse, faut la comprendre, un important secret qu’elle avait tant de mal à garder secret ! Zeus, pour le remercier, lui accorde en revanche le don de double vue : tu verras, non pas double, mais l’invisible. Alors, le féminin a-t-il un potentiel de jouissance à ce point supérieur au masculin qu'il faille empêcher coûte que coûte ce secret de transpirer ?
Aux dernières nouvelles, on n'en sait pas plus. N'est-ce pas SIGMUND FREUD qui, parlant de la femme, utilisait l'expression "continent noir" ?
Après cette « minute culturelle », revenons : nous n’en avons pas fini avec Messaline. Car ALFRED JARRY, quelques années avant le livre, a eu affaire à LA VIEILLE DAME, épisode célèbre parmi les jarrystes, relaté dans L’Amour en Visites (chapitre III).
BERTHE DE COURRIERE de son vrai nom, elle a « fait une fin » comme compagne (il fallait dire « cousine ») de REMY DE GOURMONT, après avoir été modèle du sculpteur CLESINGER et l’égérie du Général BOULANGER. Je vous passe les épisodes de l’histoire. Alfred la rencontre dans des circonstances croquignolettes : cette vieille dame s’est mis dans l’idée de se farcir ce jeune homme de 22 ans, et lui envoie un drôle de texte intitulé « Tua res agitur » (les latinistes comprendront : tua res, c’est, mot à mot « ta chose », on devine à quoi elle pense). Après un rentre-dedans pas possible, il se rend chez la Vieille Dame, où elle s’efforce de le provoquer à l’acte.
Allez, quelques bribes de ce dialogue, dont aucune raison ne permet de penser qu’il n’est pas rigoureusement authentique : « Ah ! si les jeunes gens ne connaissaient que moi, ils s’épargneraient bien des occasions de dépenses et des risques de maladies honteuses ! Je calmerai vos excitations sans ces dangers abominables. – Je ne suis pas excité du tout. Vieux dromadaire ! »
Et puis : « Ah çà ! Me prenez-vous pour Madame Putiphar ? Si j’avais vraiment envie de ces choses, je pourrais descendre dans la rue, vers le boucher du coin. Mais je ne suis pas une Messaline. » Nous y voilà. « J’ai eu l’univers à mes pieds, en la personne du Général MITRON. Si j’avais voulu, il aurait été dictateur et moi reine de France ». Elle se fait entreprenante : « Elle frotte son menton hérissé sur les genoux de Lucien ».
Oui, le héros du livre s’appelle Lucien. Et puis le bouquet, j’espère que ça ne vous coupera pas l’appétit : « Voulez-vous que je dépose dans un verre d’eau mon râtelier, pour prolonger dans tout mon palais la douceur de mes lèvres ? ». Retenez bien cette formule extraordinaire. Le chapitre finit sur cette notation : « … la Vieille Dame range divers ustensiles qu’on ne peut pas dire et qui n’ont pas servi ».
Après avoir rompu avec BERTHE DE COURRIERE, et en corollaire, avec REMY DE GOURMONT, ce qui est plus embêtant quand on a des livres à publier, ALFRED JARRY écrit un petit poème vengeur, où revient, à la fin de chaque strophe LA phrase : « Mais je ne suis pas une Messaline », et qui finit ainsi : « Envoi respectueux à Berthe de Courrière. – Vieux dromadaire, afin d’encourager / La Jeunesse à t’offrir sa javeline, / Sache allonger la phynance adjugée / A l’overrier, qui vient pour vidanger. / L’overrier n’est pas une Messaline ».
L’overrier, qu’on se le dise, a sa fierté. Si on l’embête, aujourd’hui, il fait appel au syndicat. Autres temps, autres mœurs.
Voilà ce que je dis, moi.
Là, chères lectrices, chers lecteurs (voilà que je me mets à parler comme un homme politique ordinaire, attention les yeux), je pars me mettre au vert, dans un endroit qui ressemble à ça. Je retourne à la (bonne, évidemment) mine à mon retour. Disons que ça va faire des vacances à quelques personnes.

REGARDEZ BIEN, JE SUIS JUSTE SOUS LE GROS BOURDON
(EH OUI, J'AIME BIEN LES GROSSES CLOCHES)
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 20 juillet 2012
LA FEMME EST-ELLE UNE MESSALINE ?
En 1902, ALFRED JARRY publie, comme je le disais il y a quelques jours, Le Surmâle (sous-titre « roman moderne »). L’année précédente, il a publié un autre roman « alimentaire » (lui qui est fauché comme les blés depuis qu’il a dilapidé l’héritage familial dans des « gestes artistiques » aussi splendides (la revue Perhindérion) que dispendieux). Ce « roman alimentaire », c’est Messaline.
Comme « alimentaire », nous pouvons assurer qu’il y a mieux. D’abord parce que l’époque (oui, déjà) est à la facilité, et que Messaline est, en termes éditoriaux, un « créneau porteur », à condition que l’écrivain « se mette à la portée de son public ». ALFRED JARRY n’est pas de cette engeance. On a son orgueil, que diable. Il va faire de l’alimentaire d’élite. Et l’alimentaire d’élite, ça ne nourrit pas tous les jours son homme.
Car JARRY passe beaucoup de temps à la bibliothèque (« Sainte Geneviève », si je me souviens bien). JARRY est un savant. Mais il se veut aussi poète, ce qui complique les choses. MESSALINE, la personne historique, est passée dans les manuels pour une débauchée, pour une salope et, disons-le carrément, une pute. Comment en faire un livre « qui se tienne », littérairement ?
La question se pose, car le thème est en général traité sur le mode pornographique, enfin, disons … « grand public ». ALFRED JARRY, il faut le savoir, et c’est un euphémisme de le dire, chie sur le « grand public ». C’est aussi net que ça. Personne n’a jusqu’à présent été en mesure de demander à sa mère de le refaire. Aussi injuste que soit cette vérité. Je devrais dire « ce fait ».
Il a donc composé une histoire sale sur le fond, éminemment esthétique dans la forme. C’est peut-être ce que les disciples de SIGMUND FREUD appellent « sublimation ». C’est comme le coq de basse-cour. Oui, vous savez, celui qui lance au lever du jour, les ergots dans le fumier, un « cocorico » triomphant (je signale qu’en allemand, le coq fait « kikeriki », en japonais, suivant les sources, « kukeleku », « kokekoko », « cicerici », et on pourrait continuer longtemps, les onomatopées, c’est encore de la convention linguistique, qu’on se le dise). Je reviens à Messaline.
La Messaline de l’histoire, il faut se la figurer très jeune : elle a vingt-trois ans (23) quand l’empereur Claude, son époux (celui des « Tables Claudiennes » des pentes de la Croix-Rousse, la « colline qui travaille », elles sont aujourd’hui au Musée Gallo-Romain, sur la « colline qui prie »), la fait assassiner.
L’existence de l’impératrice, enfin : de la femme de l’empereur, d’après la carte postale léguée par la tradition, est consacrée au sexe, au vice, aux perversions. Messaline ne sait plus où donner de la débauche, elle s’y perd, au point qu’elle a oublié un détail : si elle a le droit (oui, enfin, … quand je dis le droit …) d’avoir toute sorte d’amants, l’idée d’en épouser un, Caius Silius, est très mauvaise, elle est même si mauvaise que c’est un crime.
ALFRED JARRY, avant d’arriver à sa mort, part de quelques vers pas piqués des hannetons, des vers tirés, non pas du nez, mais des Satires du poète latin JUVENAL. Attention, c’est parti :
« Tamen ultima cellam Clausit,
adhuc ardens rigidae tentigine vulvae,
Et lassata viris nec dum satiata recessit. »
T’en fais pas, la traduction arrive, c’est du gratiné : « Cependant, elle clôt sa cellule la dernière, brûlant encore de la tension de sa vulve rigide, et fatiguée du mâle, mais non pas rassasiée ». Tu te dis qu’elle a passé toute la nuit à baiser, et c’est la vérité, mais de quelle « cellule » peut-elle bien sortir ?
Eh bien, la femme de l’empereur, comme n’importe quelle putain de base, est allée, la veille au soir, « faire le métier », soyons clair : faire la pute, et la cellule est celle d’un bordel du quartier de Suburre, mauvais quartier de la Rome antique. Toute la nuit, elle a reçu des hommes.
« C’était un soldat vêtu de cuir, et Messaline eut l’impression que s’épanchait en elle une outre en peau de bouc vivant. » « Et s’ils se fermèrent dans le plaisir, quand ses cuisses dures firent une ceinture au lutteur accroupi sur elle, plus éternels que les vrais yeux de la courtisane, les bouts dorés des seins veillèrent à leur tour de leur feu infatigable. » « Et il vint des hommes, des hommes et des hommes. »
Jarry écrit : « La dernière, après même sa suivante, elle ferma sa cellule, mais le désir la consumait encore » (voir la citation latine). La « suivante » en question est une prostituée professionnelle. Messaline aime la compétition, mais la professionnelle, dans la joute sexuelle, a été la plus forte : en vingt-quatre heures, elle a accueilli vingt-cinq mâles, un de plus que l’impératrice.
Le gris commentateur de bibliothèque est perplexe : « la tension de sa vulve rigide », mais ça ne veut rien dire, voyons ! Il ne sait plus : une vulve, enfin, d’après ce qu’on lui a raconté, c’est différent d’une verge. En gros, ça ne bande pas, quoi ! Seule la verge (enfin, c’est du ouï-dire) se dresse bien droite quand une femme appétissante passe dans le paysage. Même si, aujourd’hui, il y a des adjuvants pour les cas de laisser-aller (la citrine contenue dans la peau de la pastèque, qu’alliez-vous imaginer ?).
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 17 juillet 2012
SUPERMASCULIN, VOUS DITES ?
Préambule d'actualité : je suis d'accord : BACHAR EL ASSAD est une épouvantable brute, un dictateur sanguinaire, et je vote à l'unanimité, comme tout le monde, pour ces gens qui sacrifient leur vie pour le déstabiliser et, si possible, le renverser. Ce qui m'embête un peu dans l'affaire, c'est toute la main d'oeuvre djihadiste et les petites mains d'Al Qaïda qui rappliquent en ce moment de partout et qui profitent de l'occasion pour faire le coup de feu, noyauter cette opposition et s'installer dans le paysage syrien. De véritables « brigades islamistes internationales » se sont mises en place. Quand on voit le sort réservé aux touaregs indépendantistes par les islamistes radicaux d'AQMI au Mali, qui les ont virés comme des malpropres, et manu militari, du fauteuil de chef, on ne peut que s'inquiéter de la couleur du prochain pouvoir qui s'exercera à Damas. Fin du préambule.
Résumé : ALFRED JARRY est un auteur maudit. Il a interposé entre lui et le monde la marionnette monstrueuse d’Ubu. Ce qui a mis définitivement à l’abri de l’attention générale une pléiade d’ouvrages qui méritent un détour, voire valent le voyage. Le pauvre, quand il se met à la littérature « alimentaire », cela donne Le Surmâle, qui est loin d’avoir tenu ses promesses, mais qui bénéficie encore d’efforts éditoriaux notables.

Dans le fond, l’homme « moderne » est une machine à ce qu’on voudra, ici André Marcueil, le « héros », est une machine à baiser. C’est publié en 1902, je le signale. C’est même un homme qui en remontre à la machine, puisque, au cours de l’invraisemblable « Course des 10.000 milles », l’homme ordinaire rattrape chaque jour, sur son vélo qui grince, le train lancé à toute allure, qui transporte sa « fiancée » Ellen Elson, pour déposer sur son wagon un bouquet de roses fraîchement coupées.
Car Ellen Elson, cette pure vierge (pas pour longtemps), qui dit à André Marcueil : « Je crois à L’indien », est à bord de ce train lancé à des vitesses « qu’on n’a jamais osé rêver », contre laquelle lutte la quintuplette emmenée par Bill Corporal Gilbey.
Un petit mot sur cette course : vous avez cinq bonshommes sur un vélo à cinq places et, en plein milieu de la course avec le train, Jewey Jacobs meurt, et le chef, pour ne pas perdre la course, décrète : « Ah ! il est mort ? Je m’en f…, dit Corporal Gilbey. Attention : ENTRAÎNEZ JACOBS ! ».

Les quatre autres forcent donc la rigidité cadavérique, et la suite : « En effet, non seulement il régularisa, mais il emballa, et le sprint de Jacobs mort fut un sprint dont n’ont point idée les vivants ». Et les quatre de s’exclamer : « Hip, hip, hip, hurrah pour Jewey Jacobs ». Un mort qui se met à pédaler plus vite que les vivants, et que ceux-ci ovationnent. Ce genre d’idée, il fallait oser, non ? La quintuplette fait même mine, à plusieurs reprises, à force de vitesse, de se prendre pour un aéroplane, mais ce n’est que du « vol de vautour ».
N’attendez, dans le livre, aucune description graveleuse. Ce n’est pas, à cet égard un de ces « livres qu’on ne lit que d’une main ». Exceptons cependant quelques – oh ! très modestes – allusions lorsque les prostituées invitées pour subir la performance seront enfermées à clefs dans un local où, s’ennuyant ferme, elles trouveront quelques moyens de se … désennuyer entre elles.
C’est Ellen Elson, fille unique et préférée du célèbre chimiste américain William Elson, père de la mythique Perpetual Motion Food : l’aliment du mouvement perpétuel, en français : la potion magique, – c’est Ellen Elson, disais-je, qui a enfermé les hétaïres, car cette très jeune femme n’a froid nulle part, encore moins là où vous pensez, bande d’obsédés, et elle veut subir à elle toute seule les assauts de « l’Indien tant célébré par Théophraste ».
Le professeur Bathybius est témoin de la scène et, au bout des vingt-quatre heures imparties, cet observateur objectif, rigoureux et parfaitement scientifique, peut inscrire le chiffre faramineux de quatre-vingt-deux "actes" (82) dans les 24 haures imparties : le public n’en revient pas : « La dépopulation n’est plus qu’un mot ! », dit un sénateur idiot, qui ne se rend pas compte que le nombre des naissances dans une population ne dépend pas du nombre d'hommes mais de femmes.
En tout cas, quatre-vingt-deux « assauts », voilà qui pulvérise la vantardise d’un grand séducteur, dragueur et baiseur devant l’Eternel, j’ai nommé VICTOR HUGO. Il dira, longtemps après la nuit de noces qui suivit son mariage avec ADÈLE FOUCHER, qu’il l’a honorée quatorze fois. Elle s’était trouvée déjà comblée des huit « postes courues » par VICTOR lors de cette nuit, et s’en était trouvée longtemps tout éblouie.
Pour revenir à ALFRED JARRY, l’apothéose finale, je devrais dire la « Passion » d’André Marcueil, se déroule de la façon suivante : l’ingénieur Arthur Gough fabrique la « Machine-à-inspirer-l’amour ». « Si André Marcueil était une machine ou un organisme de fer se jouant des machines, eh bien, la coalition de l’ingénieur, du chimiste et du docteur opposerait machine à machine, pour la plus grande sauvegarde de la science, de la médecine et de l’humanité bourgeoises. Si cet homme devenait une mécanique, il fallait bien, par un retour nécessaire à l’équilibre du monde, qu’une autre mécanique fabriquât … de l’âme. » La préoccupation de JARRY, on le voit, est physicienne : équilibrer les forces. Pour lui, la vie est une équation à résoudre par la déduction logique.
André Marcueil est donc ficelé sur un fauteuil, revêtu de diverses électrodes, finissant par ressembler à je ne sais quel Christ. Mais, au grand dam des trois savants qui suivent les événements, « c’est la machine qui devint amoureuse de l’homme », car c’est la machine dont le potentiel est le plus élevé qui charge l’autre. Elémentaire, mon cher Watson !
Dans une explosion de métal chauffé à blanc, de verre fondu et de débauche électrique, le surmâle finit donc par mourir. Ellen Elson saura dès lors de contenter d’un mari aux performances ordinaires.
Il n'empêche que ce roman d'anticipation anticipe vraiment, d'une façon terrible et authentique, le monde actuel, où une économie tyrannique et totalitaire, appuyée sur l'hégémonie d'une technique triomphante, exige de chaque individu des performances de surhomme. Tout en condamnant de la bouche le dopage. Qui est inscrit dans le code génétique de la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde.
Et le public du roman, en extase devant les performances d'André Marcueil, ne fait-il pas penser aux milliards de gogos (pardon, de consommateurs) qui se gavent, émerveillés ou ennuyés, d'un tas de réalités virtuelles devant leur écran ? L’écran est le point d’aboutissement du programme actuel de l’existence humaine, n’est-il pas vrai ? L'un des livres les plus vendus dans le monde n'est-il pas le "Guinness" des records ? Et ça ne vous fait pas peur, à vous ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, littérature, le surmâle, pataphysique, ubu, science fiction, performance, dopage, course cycliste, sexe, acte sexuel, victor hugo, guinness des records
lundi, 16 juillet 2012
DE LA VIRILITE EN LITTERATURE
ALFRED JARRY a occupé dans ma vie une place importante. Peut-être est-ce le folklore foutraque et infantile auquel son invention de la ’pataphysique a donné lieu dans les années 1950, avec la création du Collège de ’Pataphysique, et sa collection de grands enfants très savants et, au fond, très « philosophes ».

Peut-être est-ce l’intime saisissement poétique ressenti à la lecture de L’Amour absolu. Ou alors ce fut la perplexité foisonnante et vibrionnante ressentie à la lecture des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. A moins que ce ne soit la bizarrerie antimilitariste et adelphique ressentie à la lecture de Les Jours et les Nuits. Mais après tout, peut-être fut-ce à cause de l’irréductible bigarrure des onze épisodes de l’ « éducation sentimentale » que raconte L’Amour en Visites.
Quoi, pas un mot d’Ubu roi ? Evidemment ! C’est le moins intéressant. On dirait même qu’ALFRED JARRY, en produisant son Ubu roi, a dressé un mur de protection entre lui et ses lecteurs potentiels en imposant, au milieu du paysage littéraire du début du 20ème siècle (la « première » de la pièce a été donnée le soir mémorable du 10 décembre 1896). Les œuvres citées ci-dessus ont donc été publiées bien à l’abri de cet énorme succès de scandale, qui leur a assuré un incognito à peu près parfait jusqu’aujourd’hui.

LE CRÂNE PIRIFORME, LE BÂTON-A-PHYSIQUE, ET LA GIDOUILLE
(XYLOGRAVURE D'ALFRED JARRY)
Il faut dire que le bonhomme JARRY est en soi un peu « spécial ». Il se faisait appeler Monsieur Ubu, dont il avait adopté, en société, l’articulation excessivement artificielle et segmentée. Un jour où, dans le « phalanstère » de Corbeil, il tire au pistolet, une voisine fait irruption pour protester en arguant de la présence de ses enfants derrière le buisson de séparation, à quoi, seigneurial, il répond : « Qu’importe, Madame, nous vous en ferons d’autres ».
A une visiteuse de son « entresol-et-demi » qui, avisant un phallus de dimension considérable sur la cheminée, demande si c’est un moulage, il réplique : « Non, Madame, c’est une réduction ». Il hébergeait chez lui quelques chouettes hulottes qu’il observa longuement pour en tirer quelques images et réflexions, notant par exemple que la chouette ferme les yeux quand elle lève les paupières. L'inconvénient était l'odeur qui accueillait le visiteur, les animaux étant nourris avec de la viande crue, qu'ils dispersaient et oubliaient dans la pièce. Certains ont parlé d'une « chambre encharognée ».

VOUS AVEZ NOTE LA SOURIS ?
PEUT-ÊTRE EST-CE UN MULOT ?
Ces anecdotes font partie d’une collection définitive et dûment inventoriée, répertoriée et certifiée, que les amateurs se transmettent pieusement de père en fils. Elles sont plus ou moins véridiques, plus ou moins controuvées, plus ou moins apocryphes, mais sans elles, la biographie d’ALFRED JARRY serait tellement moins savoureuse qu’on persiste à se les raconter. D’autant qu’il eut une courte vie (il est mort à 34 ans, sans doute d’une méningite tuberculeuse, peut-être en réclamant un cure-dent), qu’une absorption consciencieuse et constante de divers alcools, notamment l’absinthe, ne contribua guère à prolonger.
Quand JARRY a hérité de sa famille, il a tout claqué assez rapidement dans une revue illustrée, de luxe (Perhinderion, mot qui veut dire un « pardon » en breton), pour l’impression de laquelle il a fait fondre des caractères spéciaux, enfin bref : une folie, un geste artistique, ou ce qu’on voudra.
Pour le reste (de son existence), il a vécu sans un, raide comme un passe-lacet, comme on disait dans les anciens temps. Faut dire que ce n’étaient pas ses livres qui pouvaient lui rapporter beaucoup, vu le nombre des acheteurs potentiels auxquels ils étaient destinés : ça devait tourner autour de 37 ou de 42 exemplaires vendus.
Alors il a l’idée d’écrire deux romans « populaires » qui vont lui rapporter le magot. Ce seront Messaline et Le Surmâle. Bon, inutile de vous dire que le magot, il l’attend encore. Enfin, là où il est, n’est-ce pas, mon bon monsieur, ça ne lui tire plus sur l’estomac. Mais, comme dirait Gontran, tout ça ne nous dit pas l’heure. Et au fait : quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?

ILLUSTRATION DU PEINTRE PIERRE BONNARD,
COPAIN DE JARRY, POUR LE SURMÂLE
Or donc, Le Surmâle (roman moderne) raconte l’histoire des performances d’abord physiques, puis sexuelles d’André Marcueil, « homme ordinaire », d’apparence chétive, dont une mystérieuse transformation va faire un surhomme. Au début, scène mondaine et discussion mondaine autour de l’amour. Marcueil assène cette vérité : l’amour est un acte, et l’on peut le faire indéfiniment (sans aucun « dopage », cela va de soi, mais pas si sûr) : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment ». Dans le fond, on ne peut pas dire que ce soit complètement faux.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, le surmâle, alfred jarry, docteur faustroll, ubu roi, collège de pataphysique, perhinderion, messaline, performances sexuelles
jeudi, 05 juillet 2012
MA DOSE DE VIALATTE (ET AUTRES FETUS)
On connaît ma prédilection pour la haute littérature qu’on trouve dans les Chroniques de La Montagne, d’Alexandre Vialatte, qui ont la taille de courtes nouvelles et qui, de ce fait, constituent des petites merveilles de « livres pour les cabinets », pour qui a le désir ou l’habitude d’agrémenter ces moments quotidiens passés derrière la porte verrouillée, mais où d'autres verrous, corporels cette fois, se relâchent, pour qui, cependant, tient à maintenir dans son esprit un niveau honorable de maintien intellectuel et de contention morale.
Dans ces « lieux » destinés à accueillir des « nécessités » bien triviales, posséder, sur quelque honnête rayon de bibliothèque, des ouvrages capables d’offrir ainsi quelque satisfaction quintessenciée aux aspirations les plus nobles de l’individu en train de se soulager de sa matière la plus ignoble, tout en s’aérant les parties basses, je n’hésite pas à le dire, constitue l’indéniable marque de la haute considération dans laquelle doit être tenu, non seulement le logement où on le trouve, mais encore la personne qui l’habite.
Parenthèse : « Des gogues et démagogues ».
Cela dit, il est conseillé aux personnes « pressées » de s’enquérir auprès de leur hôte, avant d’accepter son invitation à dîner, de l’existence d’un deuxième « lieu », au cas où la situation l’exigerait. Rien n’est en effet plus disconvenable que de déposer dans un pot de fleurs son « engrais humain » sans demander à la maîtresse de maison si elle a auparavant fait le nécessaire.
J’ai parlé d’un « engrais humain » : il faut savoir qu’ainsi parle Victor Hugo dans Les Misérables : « Tout l’engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d’être jeté à l’eau, suffirait à nourrir le monde » (partie 5, livre 2, chapitre 1, pour ceux qui douteraient).
La suite est toute empreinte de parfums, je dirai même de fragrances délicates et raffinées. Jugez plutôt : « Ces tas d’ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c’est ? C’est de la prairie en fleur, c’est de l’herbe verte, c’est du serpolet et du thym et de la sauge, c’est du gibier, c’est du bétail, c’est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c’est du foin parfumé, c’est du blé doré, c’est du pain sur votre table, c’est du sang chaud dans vos veines, c’est de la santé, c’est de la joie, c’est de la vie ». Victor Hugo est bien le grand prêtre de l’antithèse (dont Chateaubriand lui a montré le chemin). Le Livre II s’intitule « L’intestin de Léviathan » : ça dit bien ce que ça veut dire.
Autrement dit, plus l’humanité produit de caca, plus l’humanité peut se nourrir. Comme quoi on a raison de dire que chez VH, il y a « à boire et à manger ». Est-ce à tort que nous n’éprouvons qu’aversion et répugnance pour ces matières vilipendées par la coutume, et qu’Alfred Jarry appelle les « immondices du corps » ?
Puisqu’on en cause, me revient à l’esprit le « lieu » du 7 quai Lassagne, où le « suivant » devait s’armer d’une très longue patience, ou se résoudre à traverser tout l’appartement à toute vitesse pour trouver refuge et salut dans l’autre « lieu ». La faute à la pile des Tintin hebdomadaires qui offrait son interminable tentation à la personne en train d’ « opérer ».
Me reviennent aussi, en même temps que les plumes de paon que nous ramassions par terre, les « lieux » du château d’Azolette, dans le haut Beaujolais, propriété de la famille Manivet : situés dans un pavillon faisant face à l’imposant bâtiment, de l’autre côté de la grande terrasse, leur lunette était recouverte d’un merveilleux velours, peut-être rouge, mais je ne peux pas le jurer.
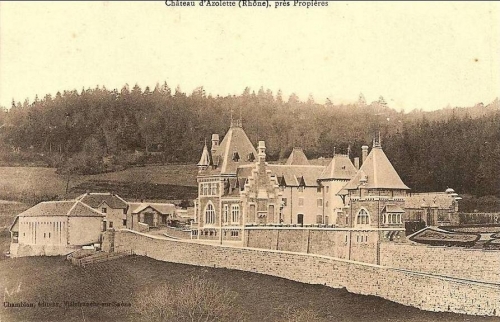
MIEUX QU'UNE PAILLOTE SUR UNE PLAGE CORSE, NON ?
(on distingue bien le pavillon en question, au premier plan)
Et pendant qu’on en est aux « mondanités », parlons du château de Joux, en Haute-Loire, dont les gogues ruraux et rustiques (auxquels on accédait en passant dans le petit bois, séparé de la haute et belle terrasse par un haut mur), étaient à deux places, ce qui m’a toujours laissé perplexe, et où l’on pouvait par là observer en direct, six ou sept mètres plus bas, le résultat des activités développées en cet endroit. Je précise que, si je parle de châteaux, ce n’est jamais moi qui y ai habité. « Simple visite », comme on dit au Monopoly.
Fermez la parenthèse.
Promis, je cesse de digresser, et je reviens à mon Vialatte. On le considère le plus souvent (quand on n’ignore pas scandaleusement son existence), comme un humoriste. Or, il faut bien se mettre dans la tête qu’Alexandre Vialatte est tout, sauf un humoriste. Avoir de l’humour ne suffit à personne pour devenir un professionnel de la chose. Alexandre le grand plaçait tout son humour dans la sphère infiniment plus vaste du regard très particulier qu’il portait sur le monde.
L'humour était un élément parmi d’autres dans la vision toute personnelle qu’il avait des choses. Si l’on veut, l’humour faisait partie intégrante de sa « philosophie » de l’existence. Une « philosophie » éminemment pessimiste. Sans espoir dans une hypothétique amélioration de l’espèce humaine. D’où la formule « Le progrès fait rage », disait-il, avant que Philippe Meyer ne popularisât la formule.
Disons que l’humour était, en quelque sorte, l’huile qui permettait au pessimisme de son moteur existentiel de ne pas « casser ». Vous trouverez ci-dessous une jolie petite illustration du pessimisme et de l’humour. Laissez Alexandre Vialatte agiter les ingrédients dans son shaker personnel, et voyez ce que ça donne.
La vérité, c’est qu’on n’a jamais vu pareille docilité des masses. Parce qu’il n’y eut jamais tant de moyens de les conditionner à son gré. L’instruction elle-même y concourt, qui permet à tous les hommes de lire le même journal. L’analphabète était bien obligé d’avoir ses idées personnelles, « de disputer, de juger, de décider par lui-même ». Aujourd’hui, il en croit le prospectus général.
Le prospectus général l’assure qu’il ne cesse de devenir plus libre, plus intelligent et plus fort. Que les siècles se superposent et qu’il y voit, par conséquent, de plus en plus loin. Mais il en va de ce socle hautain comme de celui de ce procureur auquel un avocat disait : « Monsieur l’avocat général, votre position supérieure est une erreur du menuisier ».
On trouve ça dans Les Champignons du détroit de Behring. Le pessimisme, c’est la lucidité sur l’époque qui le produit. L’humour, quant à lui, c’est un choix de vie, une attitude. Pour tout dire, c’est une morale. En plus, Alexandre Vialatte montre qu’il avait ce qu’on appelait au 18ème siècle « de l’esprit ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, wc, gogues, goguenots, chiottes, victor hugo, les misérables, alfred jarry, tintin, beaujolais, philippe meyer, les champignons du détroit de behring, château d'aazolette, château du cros
jeudi, 28 juin 2012
C'EST RESTE SUR PLACE
MILLE REGRETS. Ce qui suit devait s'intercaler entre les deux billets précédents. Ce serait dommage que ça passe à la trappe. Cela va demander un petit effort, mais l'histoire est trop sympa. Vous allez voir.
Résumé : il n’y a pas que le dopage, dans la vie. Il y a les histoires de vélo, et PAUL FOURNEL, ça, il sait faire. Voici les deux meilleures de son bouquin Les Athlètes dans leur tête.
J’arrive au « Sur-place », une petite merveille de moins de cinq pages, parce que ça sent son souvenir d’enfance. Cela ressemble furieusement à une anecdote véridique. En tout cas, je ne peux pas l’imaginer autrement. C’était au temps où il y avait un vélodrome à Saint-Etienne, mais on savait qu’il devait être détruit. Restent en lice JACQUES ANQUETIL, FAUSTO COPPI et ROGER RIVIERE, sortes de vedettes, qui vont s’affronter « deux par deux en poursuite et en vitesse ». Le public vote à fond pour le dernier, qui est enfant du pays.
Le gamin qui raconte (devinez si c’est PAUL FOURNEL) est dans la loge réservée par son père, où « une dame » était là, comme si elle était chez elle, juste au bord de la piste. Les athlètes s’échauffent. RIVIERE fait une pause juste devant la dame, « et agrippa le rebord de la balustrade, devant mon nez. Il portait des gants sans doigts avec le dessus tricoté. La dame posa sa main sur la main de Rivière, lui sourit, et dit à mon intention : – C’est mon garçon à moi. Je fus surpris par son très fort accent stéphanois ». On apprend que la portion bleue et plane en bas de la piste s’appelle la « Méditerranée ».
COPPI et RIVIERE se mesurent ensuite et cherchent la meilleure manière de surprendre l’adversaire pour « emballer » l’épreuve dans la partie finale. Je passe sur les détails. RIVIERE décide d’infliger un « sur-place » à COPPI, et s’immobilise juste devant la loge : « J’aurais presque pu ne pas le reconnaître tant son visage s’était transformé depuis le début du match. Il me paraissait beaucoup plus vieux que mon père maintenant.
Sa mère avança alors les fesses jusqu’au bord extrême de sa chaise et elle posa très doucement la main sur le cuissard de son fils. Elle tremblait.
– Ça ne fait rien si tu ne gagnes pas, murmura-t-elle avec une voix de maman triste, mais va pas te tomber …
Coppi n’en profita même pas pour plonger ». On n’en saura pas plus : c’est le dernier mot de l’histoire. Qui a gagné ? Qu’est-ce que ça peut faire ? L’histoire a été racontée, et la course n’était pas l’essentiel. Bref, j’espère que vous comprenez pourquoi je vois là de la littérature.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 27 juin 2012
JACQUES ANQUETIL, LE CRACK
L’autre nouvelle (enfin, n’exagérons pas : à peine huit pages) à savourer longuement s’intitule « Le crack ». Je pèse mes mots : c’est un petit chef d’œuvre que PAUL FOURNEL a ciselé. Le crack en question, cela ne peut être que JACQUES ANQUETIL, l’histoire le transpire (c’est le cas de le dire). Et même si ce n’est pas vrai, il est nécessaire que ce soit lui. De toute façon, l’auteur l’appelle « le grand Jacques, le patron du peloton », alors basta ! Le crack, dans le cyclisme, c’est le seigneur du peloton, c’est l’aristocrate, c’est le dessus du panier.
L’histoire se passe à Yssingeaux (Haute-Loire), où est organisé un de ces nombreux et lucratifs critériums d’après Tour qui font aussi la joie des jeunes coureurs qu’on appelle les « locaux », ou les « régionaux », parce qu’ils peuvent se mesurer comme rarement à des « grands » de leur sport.
Mais tout le monde fait la gueule, ce matin-là. Vous savez pourquoi ? Le crack est malade : « Il était livide, les yeux bordés de noir, les lèvres blanches. On avait l’impression, aussi, qu’il avait perdu dix centimètres de tour de jambe. Il n’avait pas eu le courage de se raser non plus et le voyage en voiture avait été un calvaire ». Une catastrophe pour les organisateurs, pour les « locaux », mais aussi pour le coéquipier, qui est aussi le narrateur (est-ce un souvenir raconté à l’auteur par ANDRÉ LE DISSEZ, coureur pro de 1957 à 1965, à qui est dédié le récit ? Ce n’est pas invraisemblable).
Ah, il n’est pas beau à voir, le crack : « Estomac vide, jambes en coton, vertiges. Il se tenait appuyé sur le capot de la voiture pendant que Charles lui laçait ses chaussures, parce qu’il était incapable de baisser les yeux sans s’écrouler aussitôt ». Et ce n’est pas mieux quand la course a commencé : il « roulait comme une épave. Il fermait les yeux dans les lignes droites pour ne pas dégueuler. Qu’aurait-il bien pu dégueuler ? Et c’est moi qui devais lui dire de changer de braquet ».
C’en est au point que tout le peloton est ébahi, stupéfait : « En dix minutes, son maillot était collé de sueur et son menton gouttait sur la potence.Il s’était creusé autour de nous, dans le paquet, une sorte de vide respectueux et les coursiers se relayaient pour venir voir le spectacle du zombie ».
Le rôle du coéquipier, dans ce naufrage, c’est de limiter les dégâts. Il est donc décidé, avec les organisateurs et les « gros bras » du peloton, de faire le premier tour, d’amener en tête le crack, pour la première traversée de la ville (il faut bien satisfaire le public, qui a été mis en appétit par sa présence), et de le laisser disparaître par la première ruelle discrète pour qu’il regagne son hôtel à l’abri des regards : « On lui enfila un maillot jaune et il partit les poches vides, course finie avant d’avoir commencé ».
Tant bien que mal, le coéquipier se met en devoir de remplir son « contrat », luttant pour ne pas être semé par le peloton (« je parvins à le ramener sans à-coups »). Les spectateurs en restent muets de surprise (« C’était comme une rumeur de silence »). Arrivé à proximité de la ville, il s’agit maintenant de l’amener en tête (quand même).
Tout se passe sans trop d’encombres, jusqu’au dernier kilomètre avant la pancarte. C’est là que ça se passe, braves gens, et je laisse la parole : « A un kilomètre de mon but, j’étais en tête et j’avais dû batailler ferme pour rendre à la raison les régionaux qui allumaient des pétards pour faire plaisir à leur famille. A chaque accélération, je frémissais à l’idée de l’état dans lequel il devait être.
A cinq cents mètres, je sentis son souffle et il vint se placer à ma hauteur. Je n’oublierai jamais le regard qu’il me lança : un regard glacé, tranchant, plein. Et il me posa cette question ahurissante : – T’as pas deux sucres ?
Je les lui donnai. Il les engloutit et, comme il tendait la main à nouveau, je lui abandonnai une part de gâteau de riz et un fruit qu’il glissa dans la poche arrière de son maillot.
Bien entendu, je ne le revis qu’après l’arrivée. Il gagna le critérium après avoir offert un festival au peloton médusé. Il volait. Et dans la troisième ascension de la côte de Rosières [c’est près d’Yssingeaux], il mit trois minutes sans forcer au second.
Tout le monde apprit ce jour-là que le vrai crack, c’est aussi celui qui est capable de cuver en pédalant une cuite à coucher un bataillon. Je m’en doutais déjà ».
Ce petit récit me ravit. Voilà pourquoi j’avais commencé ces quelques billets sur JACQUES ANQUETIL. C’est sûr, PAUL FOURNEL aime le vélo, et il sait raconter les histoires. En plus, ANQUETIL, il en est baba, et ça se voit : « … qui était en machine l’homme le plus beau, le plus élégant qu’ait jamais compté un peloton … ». PAUL FOURNEL regarde avec tendresse grouiller un paquet de types qui s’arrachent les tripes on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être pour la beauté du geste, après tout ?
Et il adresse là une véritable déclaration d’amour et d’admiration à tous les cracks (dont le narrateur a eu la chance, dit-il, de rencontrer cinq exemplaires, « des vrais ») : « Il n’y a rien de plus beau qu’un crack, un qui donne des rendez-vous, qui se prépare, qui met tout le monde en confiance ; celui qui dicte la loi et l’ordre et qui, grippe, foulure, angine ou fatigue, voltige quand il faut voltiger, appuie ses relais comme personne, grimpe devant les grimpeurs, sprinte devant les sprinters, mène les bordures, tire deux dents de moins [du 52 x 12, je ne sais pas si vous vous rendez compte] que tout le monde dans les contre la montre, fixe les tarifs et sait se relever pour offrir une victoire ». Pour un peu, PAUL FOURNEL se laisserait aller au lyrisme. Il a raison de se retenir.
A la fin de tout ça, ça me redonne envie d’assister au critérium de Tence (Haute-Loire), où le chéri de ces dames s’appelait FAYARD, et où le type au micro répétait à satiété : « Et le bureau des primmmmes est ttttoujours ouvert ! ». Les primes, c’était la pâtisserie CHAMBOUVET ou l’Hôtel GOUIT qui les fournissaient. On était à la campagne. Profonde. C’était l’époque où il y avait encore à Tence (Haute-Loire) le marché aux veaux, le mardi, sur le Chatiague. Et où c’était le vieux père DIGONNET qui les pesait, les veaux, en faisant d’extraordinaires grimaces inutiles, quand il avait l’œil sur les chiffres, et qu’il n’aimait pas les photos, le père DIGONNET.
C'était histoire de dire que moi aussi, j'ai des souvenirs d'enfance.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 26 juin 2012
BICYCLETTE, DOPAGE ET LITTERATURE
Résumé : ce n’est pas la peine de chercher l’exception : dans le peloton du Tour de France, celui qui ne se dope pas, c’est l’aiguille (si j’ose dire !) dans la botte de foin : on ne peut pas le trouver.
Le cyclisme (professionnel, mais aussi amateur, et très tôt) est donc le monde de la triche organisée et systématique, où les sportifs, s’ils veulent « percer », sont obligés de se procurer hors de leur organisme des « ressources » impossibles à trouver au-dedans. JACQUES ANQUETIL ne disait pas autre chose : « Il faut être un imbécile ou un faux jeton pour s’imaginer qu’on peut courir 265 jours par an sans stimulants ». Il comparait lui-même ses cuisses et ses fesses à « des écumoires ».
Je signale que LANCE ARMSTRONG, avec ses sept victoires dans le Tour de France, risque dans peu de temps de s’en voir privé, si les poursuites engagées par les instances sportives américaines aboutissent (le coureur est un gros lobby à lui tout seul).
Il semble qu’elles aient assez de « biscuits » pour conclure, si j’en crois L’Equipe (eh oui, ça m’arrive aussi !), qui sous-titrait récemment un article : « L’Agence américaine antidopage détient les preuves absolues que Lance Armstrong fut un terrifiant tricheur ». Pourquoi « terrifiant » ? Parce tout le milieu a été lâche et complice, et qu’il a si longtemps fermé les yeux ?
Le déjà nommé ANTOINE VAYER s’étonnait (?), en 1998, que l’équipe Festina au grand complet arrivât groupée, quasiment « en ligne », et « bouche fermée » au sommet de je ne sais plus quel col impossible. Il dit d’ailleurs de ce genre de coureurs : « Plus ils roulent, plus ils récupèrent ».
C’était le rêve d’André Marcueil, le personnage créé par ALFRED JARRY pour Le Surmâle, où cinq cyclistes, sur une quintuplette, font la course (de 10.000 milles) avec une locomotive, aidés par la « perpuetual motion food » (l'aliment du mouvement perpétuel) du bon Dr Elson. ALFRED JARRY fut un précurseur en matière de dopage. Il faudra que j’en parle un de ces quatre.
Il faut savoir que le taux d’hématocrite dans le sang (proportion des globules rouges) diminue dans les efforts longs et intenses, ce qui rend un sportif impropre à toute performance s’il ne se repose pas pour le reconstituer (eh oui, j’ai essayé de me documenter, mais je ne vais pas vous bassiner avec les données).
Au cours de toutes les affaires de dopage qui jalonnent la compétition cycliste depuis bientôt quinze ans, j’ai vu passer de temps en temps un article de PAUL FOURNEL, qui regrettait profondément les saloperies qu’on faisait au cyclisme et qui ternissaient son image, mais qui n’a jamais, pour son compte, renoncé à l’amour du vélo. Et on le comprend bien volontiers. Mais son bouquin Les Athlètes dans leur tête date (1988) d'avant l'arrivée de l'EPO, qui donne au pire canasson des ailes de crack.
Il fait dire à son ANQUETIL (des propos rapportés comme répétés à ses plus proches), dans son dernier livre : « Je crois bien que je n’aime pas, que je n’ai jamais aimé, que je n’aimerai jamais le vélo ». Dans la nouvelle qu’il lui consacre, il fait dire à son narrateur, parlant du vrai crack : « … un trait de caractère que je n’ai jamais eu et que je n’aurai jamais : un certain dégoût pour la bicyclette et une tendance à la laisser au garage plutôt que de s’entraîner ». Mais ce qui est sûr, c’est que FOURNEL, qui aime le vélo, est carrément baba devant le champion qui porte le nom de JACQUES ANQUETIL.
C’est qu’avec FOURNEL, on a vraiment l’impression d’être dans le bonhomme qui agite les jambes sur sa bicyclette, d’être au fin milieu du peloton, avec les amabilités diverses qui se déversent pendant une course : on ne voit pas pourquoi les mecs seraient muets, mais le spectateur se demande toujours : « Qu’est-ce qu’ils peuvent bien se dire ? ».
Dans Les Athlètes dans leur tête, je passe sur « La Course en tête », où le Portugais dont il est question fait le vide autour de lui, à cause d’une trajectoire erratique, et dangereuse pour ses voisins, surtout dans les sprints finaux. Une nouvelle qui commence par : « Il en va souvent ainsi des cyclistes : les plus malicieux manquent de cuisses et les plus cuissus manquent de malice. Ce Portugais était très cuissu ». A cause de l’ellipse, on dirait du VIALATTE.
La nouvelle finit par : « … il avait eu la sensation fugitive que le Portugais n’était pas vraiment mécontent de voir arriver cette bordure de trottoir en plein dans sa figure, à la vitesse d’une dernière gifle de béton ». Là, je ne peux pas dire qu’on dirait du VIALATTE, mais je me demande si VIALATTE n’aurait pas aimé écrire une phrase comme ça.
J’aime bien la nouvelle « Gregario » (le troupeau de l’équipe, au service exclusif de la vedette). A cause de quelques phrases, peut-être. Le gregario parle d’Yvon, le sprinter : « C’est lui qui fait rentrer l’argent dans l’équipe, c’est lui qui lève les bras sur la ligne pour qu’on puisse lire « Salami-Store » sur son maillot, à la télé, dans les journaux. Dans notre équipe, on roule pour du saucisson ». Il n’y a pas à dire : PAUL FOURNEL prend le monde tel qu’il est. Il n’en cache rien, il ne se fait aucune illusion, mais il « y va », comme on dit. C’est un choix. Ce n’est pas le mien, mais là, je respecte, parce qu’il sait écrire.
Je passe très rapidement sur « Méticuleux », canular montrant le gars qui se la joue, mais qui n’a plus envie que d’une chose : se taper la cloche dans une bonne auberge, après avoir fait semblant de partir pour l’Izoard. Je passe aussi sur « La forme », qui raconte la bonne journée (il arrive 30ème de l’étape) d’un basique qui s’étonne d’être encore dans la course. Aujourd’hui, « il était monté comme dans une chanson (…). Le revêtement rendait bien, les boyaux sifflaient juste, il passait en danseuse sans à-coups… ».
PAUL FOURNEL, on ne dira pas le contraire, aime et connaît le vélo.
Voilà ce que je dis, moi.
Le meilleur reste à venir.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cyclisme, tour de france, dopage, paul fournel, les athlètes dans leur tête, jacques anquetil, uci, lance armstrong, l'équipe, antoine vayer, alfred jarry, le surmâle, hématocrite, alexandre vialatte
lundi, 25 juin 2012
JACQUES ANQUETIL ET LE DOPAGE
Voilà, PAUL FOURNEL a enfin concrétisé un vieux rêve : consacrer tout un livre à une des idoles de son âge enfantin, qui s’appelle JACQUES ANQUETIL. Le livre s’appelle Anquetil tout seul (Seuil, 16 €). Ce n’est pas un gros livre : 150 pages. Je ne l’ai pas encore lu. Je ne sais d’ailleurs pas si je le lirai, parce que, franchement, ANQUETIL, hein …
Pourquoi je dis que c’est un « vieux rêve » ? Parce que le bouquin sur le cycliste me fait irrésistiblement repenser à un autre livre du même PAUL FOURNEL : Les Athlètes dans leur tête, paru en 1988. C’est un recueil de nouvelles. L’ensemble est absolument délicieux. Vingt-deux histoires très courtes qui racontent toutes un moment particulier, peut-être décisif, dans la vie d’un sportif de haut niveau, cycliste, perchiste, haltérophile, skieur, enfin toute la panoplie.
On m’apprendrait que PAUL FOURNEL a une préférence marquée pour le vélo qu’on ne m’étonnerait pas : pas moins de six récits le mettent en scène. Des miettes pour les autres sports, mais des miettes à grignoter sans hésiter.
Car ce qui est bien, dans les sports racontés par l’auteur, c’est la manière, l’attitude, le style, si on veut : à la fois amusée, un peu distante et en même temps pleine d’affection (ne parlons pas d’amour) pour les activités sportives et pour ceux qui les pratiquent : « … car le sport était une des plus belles choses que l’homme ait inventée pour toucher les hommes ». Si ça, ce n’est pas une déclaration d’amour, moi je suis un Nambikwara converti au bouddhisme option mahayana.
Moi, le vélo, je n’ai rien contre, à condition de ne pas abuser. Depuis le scandale de 1998 sur le Tour de France (d’où vient le célèbre « à l’insu de mon plein gré » du regretté RICHARD VIRENQUE : est-ce de lui ou des Guignols de l’info ?), je lis dans les journaux les chroniques d’ANTOINE VAYER, un spécialiste qui prouve le dopage par la puissance mécanique développée (calculée en watts).
FREDERIC PORTOLEAU, son confrère, définit ainsi la puissance : « La notion de puissance est assez simple à comprendre. Pour un système mécanique en rotation comme un pédalier, la puissance est égale au produit du couple moteur, lié à la force appliquée sur les pédales, par la fréquence de rotation (vitesse). Un coureur en très grande forme qui dispose d’un fort potentiel physique va mettre un grand braquet et tourner vite les jambes: sa puissance sera élevée.»
ANTOINE VAYER donne les précisions suivantes : « Comment procède-t-on ? Comme vous, devant votre télévision : on enclenche le chronomètre au point de départ précis référencé pour les principales difficultés du Tour 2009 et on l’arrête au sommet. Nos mesures tiennent compte de paramètres abscons mais tout à fait scientifiques comme, entre autres, la surface frontale, le coefficient de roulement, le pourcentage de la pente, la densité moyenne de l’air ».
PORTOLEAU et VAYER, eux, ils se fichent donc pas mal de l’analyse d’urine, de la prise de sang et de tous les efforts dépensés (c’est le mot !) pour y trouver les traces de substances prohibées par la noble « charte déontologique » du sport : ils analysent les performances du coureur. Ils collectent toutes les données chiffrées possibles, enfin tout ce qui peut se chiffrer par l’observation des faits.
C’est quand la course est terminée que le travail commence : on applique alors sur toutes les données collectées une grille qui permet de déterminer la puissance développée par le coureur au cours de l’étape. PORTOLEAU et VAYER arrivent à la conclusion que le maximum auquel puisse arriver un athlète normalement constitué est une puissance développée de 410 watts, sachant que le coureur du dimanche correctement entraîné est capable de développer entre 200 et 250. A partir de 410, il y a objectivement dopage.
Pour le Tour 2011, voici ce que dit ANTOINE VAYER : « C’est 23 coureurs à 31 km/h de moyenne dans la pente finale de Super-Besse à 5,75 % de dénivelée, derrière Rui Costa, le vainqueur qui revient d’une suspension pour usage de Méthylhexanamine. C’est une foultitude d’Eddy Merckx côté potentiel athlétique qui mène la bande 2011 à 41,32 km/h de moyenne horaire après neuf étapes (quel cru !). ».
Dimanche 19 juillet 2009, lors de l'ascension vers Verbier, ALBERTO CONTADOR a établi un record de vitesse : il a parcouru les 8,5 km de montée (7,5 % de pente moyenne) en 20 min 55. Jamais un coureur du Tour n'avait grimpé aussi vite. Selon ANTOINE VAYER, dans Libération, le coureur espagnol aurait eu besoin d'une VO2 max (consommation maximale d'oxygène) de 99,5ml/mn/kg pour produire cet effort. C’est rigoureusement impossible pour quelqu’un qui a un peu étudié la physiologie humaine. Et ça fait une puissance développée de 506 watts !!!
Et il fait semblant de s’étonner que, dans le col de la Croix, ce ne soient pas moins de 80 coureurs qui grimpent à 393 watts ! HORNER, à Mûr-de-Bretagne, développe « 453 watts pendant 4’16’’ dans la côte finale », c’est-à-dire un VO2 max de 87,5. Mais HORNER « s’est cassé le nez derrière huit coureurs "anaérobies" plus puissants à 515 watts » (cinq cent quinze ! à comparer aux 150 de monsieur tout le monde) ; « ils auraient au-delà de 95 » de VO2 max.
Le vélo est une chose merveilleuse, à condition d'en sortir.
Voilà ce que je dis, moi.
Promis, demain, je reviens à la littérature, à ANQUETIL, à PAUL FOURNEL.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, paul fournel, jacques anquetil, anquetil tout seul, éditions du seuil, les athlètes dans leur tête, éditions ramsay, sport, cyclisme, dopage, richard virenque, à l'insu de mon plein gré, antoine vayer, le monde, libération, tour de france, alberto contador
dimanche, 24 juin 2012
LECONS POUR BIEN FOUTRE
Le genre littéraire qu’il faut bien, aujoud’hui, appeler « érotique mondain », s’est épanoui en France (et en Italie, on peut bien l'avouer) au 18ème siècle. Il semblera évident à bien des lecteurs, cet amer constat que je fais : le nom de ZORZI ALVISE BAFFO (1694-1768) ne dit rien à personne. L’une des raisons principales de l’ignorance profonde dans laquelle ce nom est plongé est peut-être le dialecte vénitien.

IL SIGNOR BAFFO
(avouez, vous lui donneriez pourtant le bon dieu sans confession,
mais c'est quand même lui qui écrit ce qui suit)
Traduit en français, le poème donne ceci :
« On foutra toujours :
« L’homme ayant un goupillon, et la femme un vase, il n’est pas étonnant que l’un le lui plonge jusqu’aux poils, et que l’autre le reçoive jusqu’où il peut aller, lorsqu’un même désir les anime tous deux.
Je ne suis étonné que d’une chose, c’est qu’il y ait encore des gens qui s’en étonnent ; car tant qu’existeront dans ce monde les instruments qui servent pour pisser, on s’en servira aussi pour foutre.
Ce jus délicieux qui jaillit d’un beau vit produit un excellent effet, et la matrice, dont il fait le bonheur, le nomme l’esprit consolateur.
C’est un baume, qui a toujours guéri les jeunes filles épuisées par les flueurs, blanches, jaunes, vertes, épaisses ou putrides ; et il guérirait les nonnes mieux que tout médecin, patriarche ou confesseur ». Y a-t-il besoin d'expliquer "flueurs" ?
Je ne sais pas dans quelle forme d’origine exacte sont écrits les textes. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des sonnets ou des madrigaux galants, parfois pornographiques. Derrière je ne sais plus quelle stèle exposée au Musée des Antiquités Gallo-Romaines de Lyon, est gravé un graffiti d’époque qu’on peut traduire : « Je ne baise pas, j’encule ».
Certaines grottes peintes du paléolithique supérieur comportent elles-mêmes des dessins « osés ». Le pornographique a donc, selon moi, la légitimité du temps écoulé, écroulé, qui s’écoule à la façon d’humeurs diverses hors du corps humain, au cours d’activités qui, dirait ALEXANDRE VIALATTE, si sa pudeur l’osait, « remontent à la plus haute antiquité ».
« J’ai essayé différentes manières pour bien jouir d’une femme : tantôt je l’ai fait monter sur mon ventre, tantôt je me suis mis sur le sien.
Je l’ai placée habillée sur un lit, ou debout et toute nue ; je le lui ai mis dans le con pendant qu’elle marchait à petits pas, et j’ai déchargé entre ses tétons.
De tous ces plaisirs, celui auquel j’ai trouvé le plus de charme, c’est de lui faire prendre mon vit dans la bouche ».
Je me rallie à la classique distinction entre l’érotisme, où le représenté voudrait éveiller au désir, et la pornographie, qui se contente de montrer l’acte, encore que le désir des uns puisse s’éveiller où commence l’acte des autres, et taratatsoin. Il y a du sexe depuis que l’homme a une conscience. L’animal oublie dans l’instant même de l’instinct sexuel l’intérêt que peut avoir la chose. L’homme ajoute à l’instinct la mémoire, ce qui le pousse à peindre et désirer encore, y compris et surtout dans l’absence de « chose » à désirer. L’écran rupestre du « sapiens » n’est guère différent du nôtre, le cinéma en moins (mais est-ce bien sûr ?).
« Plaisirs nocturnes d’une femme.
« Cette nuit, j’ai eu un plaisir fou, et je ne me suis jamais tant amusée, ce que vous comprendrez quand vous saurez que je l’ai passée entre un prélat et un bardache.
Figurez-vous que nous avons fait tant de folies, et que nous les avons recommencées si souvent que cela a duré jusqu’au jour.
J’étais entre eux, comme je vous l’ai dit, et pendant que le bardache m’enfilait par devant, le prélat me le mettait par derrière.
Ensuite le bardache se mettait à ma place et, pendant qu’il me foutait, le prélat l’enculait ;
Et ainsi de suite ; mais j’ai remarqué que le prélat ne me l’a jamais mis dans le con. »
Un bardache, c'est, comment dire, un frégaton, un uranien, une corvette, un cinède, quoi. Pour tout dire, c'est un schbeb, un marquis, un tonton, un endoffé. Bref, un bougre, un giton, un ganymède. En un mot, un sodomite. On a du vocabulaire, ou on n'en a pas, que diable. Pour les curieux, je peux envoyer sur demande le chapelet complet, avec tous les petits grains des "Je vous salue Marie" et tous les gros grains des "Notre Père".
Il y a beaucoup à regretter à ne pas connaître le dialecte vénitien : impression d’un aplatissement, forcément. J’ai envie de croire qu’en langue originale, c’est plus spirituel, plus joli, plus drôle, et va savoir, plus poétique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature érotique, érotisme, cul, fesse, porno
lundi, 18 juin 2012
ALEXANDRE VIALATTE LE GRAND
Dans son Almanach des quatre saisons, ALEXANDRE VIALATTE rappelle qu’au mois de février, « la grosse erreur est de semer les crosnes du Japon trop serrés, et qu’il faut les mettre à trente centimètres d’intervalle (en dehors de heures de bureau) ». Et il ne manque pas de préciser que « les hommes qui naissent en février aimeront les étoffes chinées. Ce sont des enfants du Poisson. Mystiques et rêveurs, ils seront attirés par la musique, l’abnégation, l’occultisme, les voyages et les liquides ; à la limite, ils feront donc d’excellents marins ou des placiers en spiritueux ».
Il donne aussi de précieuses indications au sujet de quelques prénoms du mois. Ainsi, « les Blaise (le 3) sont aimés de l’aristocratie slave ; très forts en métaphysique, ils naissent dans les rues commerçantes ». Si, à partir de là, vous avez reconnu BLAISE PASCAL (mais aussi BLAISE CENDRARS), c’est que vous êtes fort, ou que vous avez compris un des aspects intéressants de la tournure d’esprit de l’auteur, ainsi que de son style (la généralisation abusive).
Toujours à propos de prénoms, mais comportant un autre aspect (l’approximation phonétique) : « Les Armand (le 6) sont heureux, souvent jaloux, volages quelquefois. Selon La Fontaine, ils ont intérêt à ne voyager qu’aux rives prochaines ». Vous avez reconnu une citation d’une des plus belles Fables, Les Deux pigeons :
« Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ?
Que ce soit aux rives prochaines ».
Si je dis « une des plus belles », c’est à cause des derniers vers, qui constituent un rarissime et très touchant exemple où LA FONTAINE se laisse aller à la tentation de se livrer à quelques confidences :
« J’ai quelquefois aimé, je n’aurais pas alors
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable et jeune bergère
Pour qui, sous le fils de Cythère,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas ! Quand reviendront de semblables moments ?
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ?
Ah ! Si mon cœur osait encor se renflammer !
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête ?
Ai-je passé le temps d’aimer ? »
On est loin de La Cigale et la fourmi ou du Loup et le chien, vous ne trouvez pas ? Mais revenons aux prénoms selon VIALATTE, pour qui les « Apolline (le 9) se lèvent avec le jour. Yeux verts et foie fragile. Elles naissent à Limoges ». Et il conclut : « Si vous tenez à économiser, par avarice ou par manque de moyens, appelez votre filleul Montan ou Dosithée (fête le 29). Vous ne le fêterez que les années bissextiles ».
Je signale que le village de Saint-Montan (ou Saint-Montant), dans l’Ardèche (entre Viviers, Bourg-Saint-Andéol et Vallon-Pont-d’Arc), produit du vin rouge. Ce vin peut, à excellent droit, être surnommé le roi des « rouges-qui-tachent ». Pour parler franchement, si vous avez rêvé de la « tache absolue », je vous conseille un détour par le rouge de Saint-Montan. Je n’ai jamais vu l’équivalent.
Pour finir sur le 29 février, il est bon de rappeler que Saint GREGOIRE DE NAREK fut fils de Kosroès, évêque d’Antsévatsik (il paraît qu’il y avait des chrétiens en Turquie, au 11ème siècle) et que, décevant les attentes de tous les jaloux, mauvais et méchants qui lui cherchaient noise, non content de refuser de manger du pâté de pigeonneaux apporté par de vils tentateurs, au motif qu’on était vendredi, il frappa dans ses mains et dit au pâté froid : « Allez jouer, mes petits amis, c’est du poisson qu’on mange aujourd’hui ». Les pigeons s’envolèrent aussitôt dans les arbres. Farpaitement ! C’est comme ça que ça s’est passé !
Moi je dis que je comprends qu’il ait été invité à naître un 29 février. Parce que vous ne me ferez pas sortir de l’esprit que tout ça, c’est louche. Bon, c’est vrai qu’on ne le fête (encore faut-il ne pas avoir oublié l’aide-mémoire entre la liste des courses de la semaine à Auchan et celle des bonnes résolutions du 1er janvier, qu’on a omis d’ôter du portefeuille) que tous les quatre ans. Mais quand même, ça reste louche, cette histoire de pigeons.
Bon, j'ai encore fait des « arabesques » (au sens de CHATEAUBRIAND), mais que voulez-vous, s'il fallait se priver de tous les à-côtés, la vie serait bien triste, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
A la prochaine.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, almanach des quatre saisons, littérature, humour, blaise pascal, la fontaine, les deux pigeons
vendredi, 15 juin 2012
UN PEU DE VIALATTE CHAQUE JOUR
J’ai déjà dit tout le bien qu’il est conseillé de penser de Monsieur ALEXANDRE VIALATTE, l’auteur immarcescible des Chroniques de La Montagne (898 textes publiés chaque lundi, à quelques très rares exceptions près, de 1952 à 1971, dans le journal de Clermont-Ferrand, disponibles en Laffont « Bouquins »). Je dis « conseillé », parce que – et on peut le regretter – il n’existe ni sanction, ni mesure de rétorsion contre les écervelés qui, endurcis dans une attitude confinant à un lamentable obscurantisme, se refuseraient à rendre un culte à l’ « Auvergnat absolu ».
Mais la vénération a d’autres raisons de s’exercer que les seules Chroniques de la Montagne, dont FERNY BESSON, la fidèle entre les fidèles, a publié une bonne partie dans une douzaine de volumes (Julliard) délicieux, dotés de titres parfaitement homothétiques avec le contenu et l’esprit des dites chroniques. Citons L’Eléphant est irréfutable, Profitons de l’ornithorynque et Eloge du homard et autres insectes utiles, pour rester dans la référence animale.
A ce propos, je précise que l’ornithorynque est un mammifère « monotrème » mot forgé à partir du grec, signifiant « un seul trou », car le même conduit sert à excréter les liquides, les matières et les œufs portant la descendance, mais aussi permet à la femelle d’accueillir le mâle ; pourquoi se compliquer l’anatomie quand on peut faire simple, n’est-ce pas ? N’est-ce pas aussi que c’est rafraîchissant de savoir de telles choses ?
Parmi d’autres originalités cultivées par ALEXANDRE VIALATTE, il eut celle d’habiter, au dernier numéro pair (158) de la rue Léon-Maurice Nordmann (Paris, 13ème), un immeuble donnant juste sur la prison de la Santé (Paris, 12ème), dont il n’était séparé que par la bien nommée rue de la Santé (l’hôpital Cochin est tout à fait voisin, mais j’ignore qui, de l’hôpital, de la prison ou de la rue, eut la préséance dans la dénomination).
Parmi les autres raisons d’admirer ALEXANDRE VIALATTE, il y a ses romans, dont le formidable Les Fruits du Congo. J’en parlerai une autre fois, si vous le permettez. Je m’arrêterai aujourd’hui, certes sur des chroniques, mais d’un autre genre : celles qui furent publiées dans Marie-Claire (eh oui !) dans les années 1960, sous le titre « L’Almanach d’Alexandre Vialatte », et que l’impeccable FERNY BESSON a publiées (Julliard) sous le titre rigolo Almanach des quatre saisons (12 chapitres correspondant aux mois de l’année), et dans lesquelles il démontre combien il sait parler aux femmes : « Ail : mangez-en beaucoup. Il rajeunit l’organisme et éloigne les importuns ».
« Janvier est le premier mois de l’année depuis une décision de Charles IX ». Voilà comment ça commence. Car il faut le savoir, avant l’ « Edit de Roussillon » (promulgué le 9 août 1564 au château de Roussillon, et entré en vigueur le 1er janvier 1567), c’était l’anarchie dans le royaume de France, et en plus, sans tenir compte des guerres de religion. Pensez, dans le diocèse de Lyon, l’année commençait à Noël, dans celui de Vienne, le 25 mars, ailleurs c’était le 1er mars, ailleurs c’était à Pâques. Impossible de s’y retrouver. Remarquez, maintenant, comment expliquer les « sept-, oct-, nov-, déc- des quatre derniers mois de l’année ? Réponse : on ne saurait satisfaire tout le monde.
« C’est en janvier, sous le Roi-Soleil, que l’homme inventa la machine à écrire, et que Landru, qui reste dans l’histoire comme le type du faux affectueux, brûla sa dernière victime dans un poêle à trois trous sans valeur commerciale : le vent soufflait et l’ombre de sa barbe dansait sur le mur de la cuisine. » Le fantastique, comme on le voit, n’est jamais loin. Un art éminemment visuel.
Ses recommandations aux dames pour le mois de janvier sont très simples : ne pas croire qu’à la Saint-Charlemagne, les censeurs de lycée ont pour coutume de manger un mauvais élève ; ne pas s’adresser à son percepteur dans la langue chaldéenne ; éviter les loups qui rôdent dans la forêt en hiver ; après une journée fatigante, faire un bœuf mode à la cocotte-minute, et gagner ainsi trois heures qu’elles pourront consacrer à un repos réparateur : « Une bonne lessive, au même moment, peut vous faire gagner deux grandes heures ; en achetant un prêt-à-porter vous gagnerez quarante-cinq minutes. Vous finirez pas avoir trop de temps ».
Voilà : une dose de VIALATTE tous les jours, c’est d’abord et avant tout une question d’HYGIENE. Et la forme littéraire qu’il a adoptée s’y prête à merveille. Comme le disait, lors des Assises Internationales du Roman, un écrivain (ROBERTO ALAJMO), le fragment est, idéalement, « de la littérature de cabinet ». Profitez de votre halte quotidienne dans « les lieux » pour soignez vos neurones et vos zygomatiques intérieurs.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, pataphysique, chroniques de la montagne, bouquins laffont, ferny besson, profitons de l'ornithorynque, éloge du homard, l'éléphant est irréfutable, mammifères, monotrème, les fruits du congo, almanach des quatre saisons, éditions julliard
lundi, 04 juin 2012
MODESTE LEçON DE RHETORIQUE
La rhétorique, on ne le sait pas assez, tout le monde l’a à la bouche. On croit que c’est uniquement un truc réservé aux savants, mais de même que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, de même les gens les plus ignorants de ce qu’on trouve dans les traités de rhétorique les plus érudits passent leur temps la métaphore à la bouche. Prenez « l’air du temps », « boire un canon », « discuter le bout de gras », etc. Rien que des métaphores.
Mais il est un domaine où un minimum de connaissance rhétorique explicite est requis : la littérature érotique. Si l’on met sur la « chose » le mot cru, le mot brut qui la désigne, on est plutôt dans le porno (comme on le dit à l’église : « priez porno »). Pour passer du pornographique à l’érotique – je parle évidemment de littérature –, il est indispensable de maîtriser au moins la métaphore.
J’ai parlé récemment, à propos d’Histoire d’O, du « ventre » et des « reins » : ce sont des métonymies, pour désigner les deux orifices de la femme, dans ce roman célèbre, mais qu’on peut aujourd’hui considérer comme excessivement compassé. La métaphore, étant plus facile à « manier », est infiniment plus fréquente.
« D’un doigt, il entrouvrit les lèvres ; elle poussa alors un petit gémissement. Elle était inondée et son sexe lui donnait l’impression d’être un abricot gorgé de soleil. »
ANNE-MARIE DE VILLEFRANCHE
L’abricot dont il est question ressortit tant soit peu de la comparaison. Mais voici une métaphore véritable :
« Un soir, ma sœur me dit : si nous étions dans le même lit, tu pourrais faire entrer ta petite broquette qui est toujours raide dans la bouche de ma petite marmotte. »
RESTIF DE LA BRETONNE
Là, c’est même deux pour le prix d’une : pour une bonne compréhension de la première, une « broquette » est un clou de tapissier. Les énumérations sont fastidieuses, n’est-ce pas ? Aussi m’en garderai-je comme de la peste. Tenez, voici un petit poème du grand VOLTAIRE.
« Je cherche un petit bois touffu que vous portez, Aminthe,
Qui couvre, s’il n’est pas tondu, un gentil labyrinthe.
Tous les mois, on voit quelques fleurs couronner le rivage.
Laisse-moi verser quelques pleurs dans ce gentil bocage. »
N’est-ce pas tendre et délicieux ? Aimablement dit ? Suavement tourné ?
A quoi pense CHARLES BAUDELAIRE quand il écrit :
« Guidé par ton odeur vers de charmants climats,
Je vois un port rempli de voiles et de mâts
Encor tout fatigués par la vague marine (...) ? »
Faut-il faire un dessin ? Une explication de texte ? Je m’en voudrais. C’est pourtant, dans Les Fleurs du Mal, un poème (« Parfum exotique ») figurant fort souvent à l’oral du bac. Je signale qu’une seule lettre distingue « exotique » et « érotique ».
Je ne suis pas sûr, si cela peut rassurer les parents, que le professeur aille, dans son cours, jusqu’à l’explicite. Eh bien, je dis que c’est tout à fait regrettable, car il n’est pas mauvais de dépuceler ainsi l’imaginaire pubère – qui ne demande pas autre chose –, et bien des contes des 17ème et 18ème siècles gagneraient à être lus pour ce qu’ils sont : des métaphores.
« Voyez fille qui dans un songe
Se fait un mari d’un amant ;
En dormant, la main qu’elle allonge
Cherche du doigt le sacrement ;
Mais faute de mieux, la pauvrette
Glisse le sien dans le joyau. »
Ce petit sizain est du sieur BÉRANGER, et rappelle une anecdote que je tire de RABELAIS, vous savez, celle qui raconte Grandgousier et Gargamelle, qui faisaient souvent la « bête à deux dos », bien que je ne sache pas si c’est maître FRANÇOIS qui a inventé la formule.
En tout cas, il raconte l’histoire de l’anneau de Hans Carvel, jeune marié qui, forcément, s’inquiète de se voir pousser du « cerf sur la tête », selon la formule de GEORGES BRASSENS, dans « Le cocu », car sa jeune épouse est jolie et ardente. Dans son rêve, une bonne fée lui passe au doigt un anneau magique qui fera de sa femme la plus chaste des femmes. Evidemment, quand il se réveille, il se rend compte qu’il a le doigt dans le « joyau ». Belle métaphore, n’est-il pas ?
Ne pas nommer, « suggérer au lieu de dire. Faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots » (ALFRED JARRY). Voilà le secret. Notre époque semble impropre aux secrets de cette sorte. Il lui faut la chose sous le nez, l’obscène, le réel. A ce titre, l’époque tend davantage au porno qu’à l’érotique. Notre époque est impropre aux subtilités du langage, au déplacement, à la métaphore. Elle ne sait pas de quels plaisirs de haute lisse elle se prive ainsi.
Signe des temps : vous ouvrez L’Equipe un lendemain de grand match : des métaphores comme s’il en pleuvait. Des métaphores très souvent guerrière du genre « exploser la défense », « tirs de barrage », etc. La déchéance, je vous dis. La métaphore qui survit grâce au sport-spectacle, c’est un comble.
Voilà ce que je dis, moi.
08:58 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : érotisme, littérature érotique, rhétorique, monsieur jourdain, prose poésie, métaphore, métonymie, histoire d'o, voltaire, baudelaire, les fleurs du mal, béranger, rabelais, georges brassens, alfred jarry, obscène, l'équipe
dimanche, 03 juin 2012
CONTREPETERIE : LA FIN ?
Un peu d’histoire aujourd’hui, non pas du pet (JEAN FEIXAS et ROMI s’en sont occupés en 1991, avec Histoire anecdotique du pet Ramsay-Pauvert, ouvrage jovial et très documenté), mais du contrepet, cette perversion amicale et presque familiale du langage, et finalement de bonne compagnie. On pourrait prétendre, en poussant la logique de cette perversion gentille et sale jusqu’au bout, que les phrases « normales » que tout le monde prononce tout le temps, devraient être considérées comme des suites de « contre-contrepets », c’est-à-dire, au fond, de la perversion revêtue du masque de la normalité. J'espère que vous suivez.
J’ai cité quelques noms. Il faut donc maintenant absolument préciser quels ont été les héros et les hérauts qui ont présidé au fabuleux destin de la contrepèterie dans la deuxième moitié du 20ème siècle, dont beaucoup ont trouvé refuge au sein de l’Oulipo, le céleste OUvroir de LIttérature POtentielle, fondé en 1960 par RAYMOND QUENEAU et FRANÇOIS LE LIONNAIS. Mais je parlerai de l’Oulipo une autre fois, sans ça, on n’est pas arrivés. Restons-en à la contrepèterie.
Disons quand même que FRANÇOIS LE LIONNAIS traîne derrière lui une lourde et terrible casserole. Dans ses Souvenirs désordonnés, JOSÉ CORTI (oui, celui de la maison d'édition magnifique) raconte qu'il doit (!?!) la mort de sa femme et de son fils dans les déportations de la deuxième guerre mondiale, à l'ahurissante et révoltante inconscience de cet homme, qui, d'après lui, tenait, si l'on peut dire, "table de résistance ouverte" dans les locaux de sa librairie, jusqu'au jour où il vit la Gestapo embarquer sa famille. J'imagine que l'événement ne l'a pas prédisposé à admirer les oeuvres nées de l'Oulipo.
A tout seigneur tout honneur. YVAN AUDOUARD, qui a inauguré la rubrique du Canard enchaîné intitulée « Sur l’Album de la Comtesse » (d’abord intitulée « la Comtesse M. de la F. », qui ne renvoie pas à l’antistrophe de RABELAIS (« molle de la fesse », mais l’intention est quand même bien d’induire en erreur), mais à la comtesse MAXINE DE LA FALAISE). A vrai dire, ce n’était pour Y. A. qu’un passe-temps exercé dans les moments creux. Il a en effet écrit beaucoup d’autres choses, dont un délicieux polar rigolard, Antoine le vertueux.
Il a par ailleurs laissé des sentences et autres apophtegmes frappés au marteau de la bonne forge, comme : « Je n’attendais rien d’elle. J’ai été comblé », ou : « C’est faire honneur au soleil que de se lever après lui ». Dans la préface qu’il a donnée au Manuel de contrepet de JOËL MARTIN (Albin Michel, 1986), il raconte l’exquise et délectable anecdote suivante :
« Du temps où j’étais responsable de "L’album de la comtesse", je reçus un coup de téléphone suppliant et affolé d’un chef d’entreprise qui me dit : « Je dirige un petit atelier de dessin industriel. Vous m’avez déjà coûté deux cents heures de travail. Mes dix-huit employés n’ont plus l’esprit à ce qu’ils font. Ils n’arrivent pas à trouver la contrepèterie de la semaine. » Elle était pourtant classique.
C’était le fameux : « Aucun homme n’est jamais assez fort pour ce calcul ». « Je vous en conjure, poursuivit le brave homme, donnez-moi la solution, sinon je suis ruiné ». Je la lui ai donnée. » La bonté d’YVAN AUDOUARD le perdra. Ah, on me dit qu’il est mort en 2004 ? Alors, paix à ses cendres. C’est vrai, qu’étant né en 1914, il avait le droit. Avant d’avaler sa chique, il a quand même écrit La Pastorale des Santons de Provence, à l’enregistrement de laquelle il a même participé, en donnant sa voix à l’âne.
Son successeur à « L’Album de la Comtesse » s’appelait LUC ETIENNE (né, lui en 1908, et décédé en 1984), qui fut, sauf erreur, Régent de Contrepet (ou d’Astropétique) au Collège de ’Pataphysique, a donné à « l’art de décaler les sons » l’ampleur et la noblesse d’un mode d’expression littéraire à part entière. Il a établi dans la durée la rubrique hebdomadaire du Canard, et l’a rendue indispensable comme un vrai rite.
Rompu à toutes sortes d’exercices de jonglerie avec les mots, il était néanmoins un scientifique averti (professeur de mathématiques), ainsi qu’un vrai musicien, par-dessus le marché. J’eus en ma possession, il y a déjà quelque temps, un fascicule intitulé Palindromes bilingues (anglais/français, c’était édité par le Cymbalum Pataphysicum).
Le palindrome, je ne sais pas si vous vous rappelez, c’est ce tour de force qui consiste à élaborer un texte qui puisse se lire indifféremment à l’endroit ou à l’envers, tout en gardant le même sens, parce qu’exactement symétrique (en miroir) autour de son point central, en ce qui concerne la suite des lettres.
GUY DEBORD a rendu hommage à la technique dans le titre de son film In girum imus nocte et consumimur igni (c’est du latin : « nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu », vous pouvez essayer dans les deux sens, ça marche, et c’est assez fortiche).
Le recordman de la discipline est sans contestation possible (quoiqu’un record soit a priori fait pour être battu) GEORGES PEREC, avec son texte de 1247 mots. Bon, c’est vrai qu’il ne faut pas être trop chatouilleux sur le sens de l’ensemble, mais la prouesse est là.
De LUC ETIENNE, j’ai gardé précieusement la cassette audio éditée par le Collège de ’Pataphysique en … (vulg. 1990) en hommage au Régent, qui, le diable d’homme, y présente des « palindromes phonétiques » et des « inverses phonétiques », dont l’incroyable début de Zazie dans le métro, du Transcendant Satrape RAYMOND QUENEAU.
Le successeur, en 1984, pour la rubrique du Canard enchaîné, des grands ancêtres qu’étaient YVAN AUDOUARD et LUC ETIENNE s’appelle JOËL MARTIN. Dans le civil, ce n’est pas un comique : c’est un ingénieur en physique nucléaire, il travaillait au CEA. Quand il est en uniforme, c’est indéniablement le pape qui porte sur sa tête la tiare de l’Eglise Contrepétante, dans la discipline de laquelle il a apporté la rigueur et la méthode propres à l’esprit des ingénieurs.
Et ça donne, dans Manuel de contrepet (Albin Michel, 1986, p. 320-321, j’aime bien la précision), des graphique savantissimes, en trois dimensions, qui sont supposés donner au lecteur les clés de la maison. C’est sûr que JOËL MARTIN, on dirait une usine à contrepet, qui tourne 24 / 24. Je pense qu’il doit faire la pause de temps en temps. Son agilité, qui plus est, est telle, qu’on a du mal à suivre. Pour un peu, je dirais qu’il est le PAGANINI de la contrepèterie.
Avec JOËL MARTIN, la contrepèterie acquiert la dignité de la Science, et je ne suis pas sûr que l’Université Française n’ouvrira pas, dans un avenir plus ou moins proche, une chaire de Contrepet, avec Licence, Maîtrise et Doctorat. Au point que cela risque d’en devenir intimidant pour le vulgum pecus auquel j’appartiens. Au point qu’on pourrait dire que « trop de science tue l’amour ».
JOËL MARTIN a pondu un nombre effrayant d'ouvrages sur la contrepèterie, à commencer par le Manuel de contrepet, en 1986, où il expose la méthode qu'il a mise au point pour fonder en science le contrepet, dans un chapitre horriblement savant (« Précis de Pataphysique (sans l'apostrophe obligatoire) du solide »), finissant par deux pages intitulées "morphologie, physiologie et pathologie du contrecube", et couvertes de schémas déliremment pataphysiques.
L'un d'eux mesure la tension artiérielle du contrapétiste, pour vous dire : on est dans le sérieux et le scientifique, mais il ne faut pas exagérer. De toute façon, ALFRED JARRY lui-même a donné l'exemple, dans le dernier chapitre des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, intitulé « De la surface de Dieu ».
Le maître ouvrage de l'empereur de la contrepèterie, sorti en 2003 en collection "Bouquins", est sobrement intitulé Le Bible du contrepet (960 pages), et sous-intitulé "une bible qui compte pour décaler les sons" (deux permutations à faire).
JOËL MARTIN, en érigeant la contrepèterie en SYSTÈME, régi par des règles quasi-scientifiques (je dirai plutôt des règles quasi-mécaniques, puisque son système finirait presque par ressembler à une machine), risque de réduire le contrepet à un vulgaire tiroir des meubles de la cuisine oulipienne, dont il faudra bien un jour que je me décide, quoi qu’il m’en coûte (et quoiqu’il m’en coûte), à dire tout le mal que j’en pense, en tant qu’entreprise de destruction.
A mon avis, en effet, avec JOËL MARTIN, la contrepèterie a tout simplement perdu de vue Panurge, et ça, c’est plus que je ne peux supporter. Tout simplement parce que, dès qu’on fait de quelque chose d’humain, d’intimement lié au rire et à la joie, le support d’une THEORIE SCIENTIFIQUE, je fais comme le rat : je quitte le navire, même si je dois me noyer.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : contrepèterie, contrepet, joël martin, yvan audouard, luc étienne, alfred jarry, pataphysique, oulipo, raymond queneau, guy debord, in girum imus nocte et consumimur igni, l'album de la comtesse, histoire anecdotique du pet, le canard enchaîné, rabelais, pastorale des santons de provence, collège de pataphysique, georges perec, palindrome, zazie dans le métro, manuel de contrepet, josé corti, souvenirs désordonnés
samedi, 02 juin 2012
CONTREPETONS EN CHOEUR
Résumé : la contrepèterie heurte tout un tas de codes moraux, de religions et de pudeurs.
Car il faut que ce soit clairement affirmé : il n’est de bonne contrepèterie que portant sur les sujets les plus scabreux, les plus inconvenants, les plus poivrés, en un mot les plus « libres », je veux dire évidemment SEXUELS (« Sagesse n’est pas folie »). La contrepèterie, qu’on se le dise, est un jeu de l’intelligence qui sait prendre la vie du bon côté. Excellente formule pour définir la voie tracée par maître FRANÇOIS RABELAIS. Le jeu savant des bons vivants, quoi (non, désolé, pas de contrepèterie).
Pour apprécier la contrepèterie, il ne s’agit donc pas seulement d’avoir un peu d’astuce lexicale. Il s’agit de maîtriser un minimum de vocabulaire dans le domaine du « bite-couille-chatte-cul ».
Déclaration solennelle :
Je déclare solennellement que les quatre mots précédemment prononcés ne l’ont été – et à mon corps défendant, j’espère que le lecteur en est intimement convaincu – que pour indiquer vers quel « Nord » le curieux et l’amateur sont invités à orienter la boussole de leur attention, et qu’il ne saurait être question pour moi, dans un blog habitué à planer dans les azurs éthérés de l’Idée et de la Science, et à ne pas se vautrer dans l’immonde fange des appétits trop animaux d’une humanité livrée à ses appétits trop animaux, de me laisser aller dans la suite de ce billet à quelque étalage de grossièretés que ce soit, en citant l’un ou l’autre vocable susceptible de blesser l’honnêteté de la vertu, et même la vertu de l’honnêteté (relisez un peu cette phrase, pour voir : n’est-ce pas qu’elle est belle et pleine d’une vérité forte ?).
Cela implique, ipso facto, que le lecteur sera impitoyablement privé de la « solution », et qu’il ne devra la découverte de celle-ci qu’à ses propres compétences, à la qualité de son imaginaire libertin, à son ingéniosité lexicale et, pour tout dire, à la « maltournure » de son esprit. « Oh ! Votre pull mou ! » (la solution n’est pas « votre poule mue », beaucoup trop « sortable »).
Est-ce que JOËL MARTIN, qui a pris glorieusement la suite de l’immortel LUC ETIENNE – qui restera pour les siècles des siècles, après avoir pris la succession d’YVAN AUDOUARD, le fondateur de cette Restauration de la Légitimité de la Lettre, à travers la rubrique intitulée « Sur l’album de la Comtesse » –, aurait eu la faiblesse, pour ne pas dire la bassesse, de résoudre chaque semaine les énigmes qu’il propose dans Le Canard enchaîné (par exemple : « Cannes, raquettes et dures luttes des starlettes » (n° du 30 mai 2012) ?
Que non pas, que diable ! Fi ! Que nenni, vertuchou ! J’avoue humblement, pourtant, qu’il m’arrive de caler aux contrepèteries de JOËL MARTIN, le mercredi (« Labyrinthe et routes » (non, ça, c'est facile, Canard du 30 mai). J’ai parfois l’impression que même les plus retorses lui coulent de la plume aussi spontanément et naturellement que les diaboliques « onzains hétérogrammatiques » viennent par dizaines à GEORGES PEREC (Alphabets, Galilée, 1976), quand HARRY MATTHEWS lui-même avoue suer des heures pour en pondre seulement le fantôme d'un.
Que le digne lecteur ne compte donc pas sur moi pour donner la traduction de la contrepèterie bien connue : « Le boutre du sultan entra dans le confluent de la Garonne ». Pour ceux qui auraient du mal, par pure bonté d’âme, je me permettrai seulement de signaler qu’il s’agit de permuter trois consonnes. Lesquelles ? Alors là, je le déclare solennellement, la tête sur le billot et la main serrant le fer rougi, je n’irai pas plus loin.
Pareil pour la plus difficile, mais connue : « L’aspirant habite Javel » (parente de « l’accessoiriste peint les tuniques », mais là, il faut beaucoup permuter) ou la célébrissime (mais très facile) : « Le Général est arrivé à pied par la Chine », qui remonte à l’époque de DE GAULLE (mais on trouve aussi un fakir à la place du général, plus en accord avec la prouesse physique que la solution suppose, et qui vaut la naissance de Gargantua "par l'oreille senestre").
Dans les contrepèteries « mâles », on trouvera donc très souvent des gens qui habitent (« Monsieur le maire, il est difficile d'habiter votre Nîmes! »), qui vont en Chine (« La Chine se dresse devant les Nippons », « Mettre la Chine au pas, n'est-ce pas mettre le feu à l'Annam ? »), qui élèvent des jars (« recyclé dans l’élevage, l’ancien ministre dupé montre son jars »), qui participent à des jeux (« avant chaque examen, les séminaristes doivent montrer leurs jeux aux curés »), qui brouillent toutes sortes de choses (la très connue « ces parasites nous brouillent l’écoute »), qui conjuguent toutes sortes de verbes (« ah maître, que votre verbe est agile ! »).
Message : je t'assure, M., tout ça est réputé facile. Rappelle-toi : consonnes, ou voyelles à permuter (ici, c'est surtout des consonnes).
Il en existe même des authentiques, je veux dire « prononcées à la télé », comme celle-ci, de BERNARD TAPIE (enfin, qu’on lui prête), à l’époque de ses ennuis judiciaires, malheureusement (et salopement) terminés : « le procureur m’entend pour mieux m’acculer ». Allez, M., là, c'est les voyelles initiales. Un petit effort, que diable, vertuchou !
Pour les contrepèteries « femelles », on s’attend évidemment à tomber très souvent sur des mots en « -elle »(« les gamelles de morilles », « les gamelles de mousse », « il faut deux jumelles pour bien mater »), en « -atte » (« nous avons le choix dans la date » (qui répond, en toute logique à « Le Poids de la Chine »), « la geisha fait caresser sa natte pendant le show » ou « bois dans ma jatte, Sachem »), en « -ente » (« les ventes vont-elles souffrir ? »), en « -ousse » (« les guerrières de brousse sont rarement ludiques » permutation circulaire à 3), en « -ine » (« la zoologue cherche en vain des fouines grisées »).
Mais il convient de préciser qu'en général et évidemment, contrepèteries mâle et femelle sont faites pour se rencontrer.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : contrepèterie, poésie, oulipo, françois rabelais, jeux de mots, joël martin, luc étienne, yvan audouard, le canard enchaîné, sur l'album de la comtesse, georges perec, de gaulle, bernard tapie
vendredi, 01 juin 2012
VOULEZ-VOUS (CONTRE)PETER AVEC MOI ?
« Voulez-vous que je vous envoie dans la culture ? ». « Les nouilles cuisent au jus de cane » (x 2). « Le curé est devenu fou entre deux messes ». « Ma cousine joue au tennis en pension ». « Ce vieux marcheur veut courir sur le mont » (x 2, dont une dans un mot). « La magistrature assise ment debout ». « Le Suisse sortait sa pique au milieu des beatnicks ». « La pâtissière moule des quiches ». « Joseph a maculé Henri ». Bon, j’arrête là. Je sais que ceux qui ont compris ont compris. J'encourage les autres à lire ce qui suit.
Je chantais, il n’y a pas très longtemps, les beautés subtiles de la chanson que j’appelais « quasi-paillarde », où l’auteur se plaît à décevoir l’oreille de l’auditeur en substituant au terme « cru » (« le tout de mon cru », psalmodiait l’immortel LUC ETIENNE), au moment de la rime « sale » attendue, un terme innocent, que la rime suivante a pour mission de justifier.
Cela dit, non seulement le jeu de la « fausse rime » n’empêche nullement l’auditeur de comprendre, mais en plus, elle multiplie son plaisir par le taux d’intelligence qu’il se décerne (très objectivement, forcément) quand il estime qu’il a compris, sur le principe du « je ne prête qu’à moi, parce que je suis riche » (même si ce n’est pas vrai).
Je veux chanter aujourd’hui, dans le même esprit (c’est-à-dire avec les mêmes arrière-pensées, que je qualifierai pudiquement de « décolletées »), une des formes les plus anciennes de jeu sur les mots de notre belle langue. J’ai nommé la CONTREPÈTERIE. Certes, on peut prétendre que « cette menthe a le goût de fiel », mais il n’en est pas moins vrai que « Virginie prend les bols » (tout au moins chez BERNARDIN DE-SAINT-PIERRE, je dis ça pour aider).
L’inventeur de la contrepèterie est peut-être – ce n’est pas sûr – FRANÇOIS RABELAIS, que j’ai célébré ici même récemment. C’est vrai qu’on trouve dans Pantagruel deux exemples célébrissimes. Le premier est au chapitre 16, qui détaille les « mœurs et conditions de Panurge » : « car il disait qu’il n’y avait qu’un [sic] antistrophe entre "femme folle à la messe" et "femme molle à la fesse" ». Je laisse à Panurge la responsabilité de ce propos.
Le seul commentaire qui s’imposerait (éventuellement) concernerait la fréquentation, par les individus de sexe féminin, des lieux consacrés que les catholiques investissent chaque dimanche, et où ils se rassemblent « au nom du Christ », pour se faire une idée de la consistance de leur « partie charnue », à une époque où la déchristianisation est un fait accompli, mais ce commentaire-là, je m’en abstiendrai pour cette fois, parce que ça rallongerait inutilement (cela dit, tous les rallongements ne sont pas inutiles).
Notre vieil oncle GEORGES BRASSENS, puisqu’il faut aujourd’hui parler d’ « orientation textuelle », était plus VILLON que RABELAIS, a assez longtemps creusé le sillon de la rime qu’offrent ces deux mots (« messe » et « fesse », … pardon, il y a aussi (et même plutôt) « confesse ») pour que je me dispense d’ajouter mon grain de sel.
Le deuxième exemple se trouve un peu plus loin (chapitre 21) : « Madame, sachez que je suis tant amoureux de vous que je n’en peux ni pisser, ni fienter. Je ne sais comment vous l’entendez ; s’il m’en advenait quelque mal, qu’en serait-il ? – Allez, dit-elle, allez, je ne m’en soucie pas ! Laissez-moi ici prier Dieu. – Mais, dit-il, équivoquez sur "A Beaumont-le-Vicomte". – Je ne saurais, dit-elle. – C’est "A beau con le vit monte" ». Avouez : comment pourrait-on se lasser de Panurge ? Contrepèterie, « antistrophe », « équivoquer », tout ça, c’est du pareil au même. Vous pouvez aussi dire « métathèse » si voulez faire votre cuistre.
Contrepéter, c’est donc permuter (« j’ai glissé dans la piscine », c’est autorisé aux enfants en bas âge). On peut permuter des tas de choses : des consonnes, des voyelles, des syllabes. Le plus souvent, on permute les éléments par paire, mais on peut compliquer à plaisir. Deux grandes règles à respecter.
La première est de toujours se fier au son, à l’oreille, à la phonétique, jamais à l’orthographe ou à la séparation des mots écrits (quoique …). Comme le cite JOËL MARTIN, en couverture d’un de ses livres, le contrepet, c’est « l’art de décaler les sons » (deuxième exercice très facile).
La deuxième règle est, aussi cruel que ça puisse paraître, de ne jamais dévoiler la solution. C’est la règle du : tant pis pour ceux qui ne comprennent pas (ceux qui ont décrypté l’exemple ci-dessus l’admettront aisément, et décrypteront celle-ci de même : « on reconnaît les concierges à leur avidité »).
Elle s’apparente à celle de la fausse rime (déjà vue dans les « chansons quasi-paillardes ») : si l’on se donne la peine d’escamoter le mot qui heurte la morale, la religion, les bonnes mœurs, et qui taquine les bonnes sœurs en cornette et des bons pères en soutane jusque dans leurs parties intimes (la cornette et la soutane se sont diablement raréfiées), pour le remplacer par un « mot sage », qui cache le « message », ce n’est quand même pas pour des prunes.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, contrepèterie, jeux de mots, oulipo, luc étienne, collège de pataphysique, le tout de mon cru, rabelais, pantagruel, panurge, georges brassens, villon, joël martin, le canard enchaîné, yvan audouard, chanson paillarde, érotisme
jeudi, 31 mai 2012
COMMENT PROUST DEVIENT ECRIVAIN
Il faut attendre la fin du roman pour assister à l'événement nodal, pour arriver jusqu'au foyer central qui anime toute La Recherche du temps perdu, le centre de cette toile arachnéenne, vers lequel tendent tous les fils fabriqués par un auteur qui, jusque-là, cherchait sans le trouver ce qu'il pourrait bien faire de sa vie.
Le moment le plus bouleversant à mes yeux se situe en effet dans Le Temps retrouvé, c’est-à-dire le dernier « épisode » du roman. Bien des années ont donc passé, il y a eu la guerre de 14-18, et Marcel est invité à une grande soirée mondaine chez le prince de Guermantes (à ne pas confondre avec le duc du même nom, frère du baron de Charlus). Comme il ne veut pas écouter tout le concert, il ne se presse pas, et il arrive en retard. Mais commençons par la fête chez le prince, qui vient plus loin, dans le récit, et entrons dans le grand salon.
Quand il est invité à entrer par le maître d’hôtel, j’ai mis un peu de temps à comprendre qu’il ne s’était pas trompé d’adresse et qu’il n’avait pas débarqué dans un lieu inconnu de lui :
« Au premier moment, je ne compris pas pourquoi j’hésitais à reconnaître le maître de maison, les invités, et pourquoi chacun semblait s’être "fait une tête", généralement poudrée et qui les changeait complètement. (…) Le prince avait encore cet air bonhomme d’un roi de féerie que je lui avais trouvé la première fois mais cette fois (…) il s’était affublé d’une barbe blanche (…) A vrai dire je ne le reconnus qu’à l’aide d’un raisonnement" ».
Mais non, ce n’est pas un bal masqué et costumé pour lequel Marcel aurait oublié de se déguiser : c’est le temps qui a passé. Beaucoup de temps. « Le petit Fezensac (…) avait trouvé le moyen de couvrir sa figure de rides ». J’avoue que le tableau qu’il fait de la soirée chez le prince de Guermantes est d’une grande force. Parce qu’au passage, il a lui-même vieilli, au point qu’il s’étonne qu’on lui témoigne des égards qu’il considère comme dus aux gens âgés, alors que vu de l’intérieur, sa façon d’éprouver les choses lui ferait croire qu’il a gardé la fleur de sa jeunesse. Toute la scène forme un ensemble extraordinaire.
Et c’est d’autant plus saisissant que c’est précisément qu’il vient de se passer, quelques minutes avant, le quelque chose d’inoubliable, qui va décider de tout l’avenir du narrateur, enfin, des années qui lui restent à vivre. Le quelque chose dont il avait besoin, après lequel il avait passé sa vie à courir désespérément. Au moment d’entrer chez le prince, il manque de se faire écraser par une voiture, qu’il évite de justesse :
« et je reculai assez pour buter malgré moi contre les pavés assez mal équarris derrière lesquels était une remise. Mais au moment où, me remettant d’aplomb, je posai mon pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement s’évanouit devant la même félicité qu’à diverses époques de ma vie m’avaient donnée la vue d’arbres que j’avais cru reconnaître dans une promenade en voiture autour de Balbec, la vue des clochers de Martinville, la saveur d’une madeleine trempée dans une infusion, tant d’autres sensations dont j’ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m’avaient paru synthétiser ».
Ce pied qui boite sur un pavé, ce n'est rien d'autre qu'une description pure et simple du BONHEUR. Voilà, la boucle est bouclée : l’épisode célébrissime de la madeleine se situe au tout début de La Recherche (Du Côté de chez Swann, p. 45), et ce qui précède se passe environ 200 pages avant la fin.
J’avoue que cette façon de récupérer, dans un minuscule instant, de « synthétiser » (comme il le dit) toute la matière dont son existence s’est finalement tissée hors de sa volonté, m’impressionne : une façon pour l’architecte de poser en une fois le dôme qui va couronner l’édifice en même temps qu’il va faire tenir les murs. Peut-être que c’est ça qu’on appelle « donner un sens à sa vie » ?
L’auteur précise :
« Chaque fois que je refaisais rien que matériellement ce même pas, il me restait inutile ; mais si je réussissais, oubliant la matinée Guermantes, à retrouver ce que j’avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau la vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m’avait dit : "Saisis-moi au passage si tu en as la force, et tâche à résoudre l’énigme de bonheur que je te propose." Et presque tout de suite, je la reconnus, c’était Venise (…) ».
« Saisis-moi au passage si tu en as la force». Là est le secret de tout. Il faut s’abstraire des circonstances matérielles présentes, contingentes et accidentelles, pour accéder au sens de tout ça. PROUST ajoute : « Mais pourquoi les images de Combray et de Venise m’avaient-elles, à l’un et à l’autre moment, donné une joie pareille à une certitude, et suffisante, sans autres preuves, à me rendre la mort indifférente ? ». N’est-ce pas, que c’est beau : « A me rendre la mort indifférente » ? Quand j’y pense, qu’est-ce qui serait à même de me rendre « la mort indifférente » ?
Introduit dans le petit salon, il entend le bruit d’une cuiller heurtée contre une assiette, et aussitôt c’est toute la scène d’un train arrêté à la hauteur d’un petit bois qui lui est restituée dans son entier instantanément, train dont un employé frappe une roue avec un marteau.
Puis, buvant une orangeade, il s’essuie les lèvres avec une serviette qui « avait précisément le genre de raideur et d’empesé » que celle avec laquelle il avait eu tant de mal à se sécher le jour de son arrivée à l’hôtel donnant sur la plage de Balbec : « une nouvelle vision d’azur passa devant mes yeux ; mais il était pur et salin, il se gonfla en mamelles bleuâtres ; l’impression fut si forte que le moment que je vivais me sembla être le moment actuel ». Que pensez-vous de « mamelles bleuâtres » ?
Bref, c’est seulement juste avant d’entrer chez les Guermantes pour renouer avec des mondanités dont sa santé l’a longuement tenu éloigné, que Marcel est convaincu d’être écrivain : « ma présence même en ce moment chez le prince de Guermantes, où venait de me venir brusquement l’idée de mon œuvre ». « L'idée de mon oeuvre » !!!! Et ce moment n’est autre que la somme exhaustive de tous ceux où il a vécu l’essentiel des moments successifs de sa propre vie.
Il faut qu'il ait fini de vivre tous ces moments, pour se rendre compte que ce sont eux qui constituent la matière du livre qui se présente enfin à son esprit. Lui qui voulait faire carrière dans les lettres, il ne découvre l'essentiel qu'à la fin de son parcours. Quand on se rend compte qu'il a fallu attendre si longtemps dans la lecture pour apprendre que le sujet du livre est ce qui vient d'être lu et qu'à partir de maintenant l'auteur va enfin pouvoir se mettre à l'écrire, on se dit : chapeau l'artiste ! Et l'on s'incline devant le maestro, chapeau bas !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 30 mai 2012
PROUST ECRIVAIN
Proust, je vais vous dire, j’ai été intéressé par Du côté de chez Swann, intrigué par A l’ombre des jeunes filles en fleur, interloqué par Le Côté de Guermantes, éberlué par Sodome et Gomorrhe, horripilé par La Prisonnière, agacé par La Fugitive, enthousiasmé par Le Temps Retrouvé. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts.
Mais je me demande, à l’arrivée, s’il n’est pas nécessaire d’en être passé par tous ces états, d’avoir lu les six premiers épisodes, et d’éprouver les sentiments successifs, pour que le septième et dernier livre fasse son effet avec la plénitude dont l’auteur l’a chargé. Cependant, il faut dire que, tout au long du livre – et c’est même très curieux : y compris dans les passages de « basses eaux » de l’intérêt ou de l’attention, et malgré les agacements – le lecteur trouve constamment de quoi alimenter son envie de poursuivre.
Parce que l’action, si on veut la résumer, est très simple : c’est l’histoire d’un gamin maladif qui a au départ la très vague idée de se lancer dans la littérature, et qui met un certain nombre de dizaines d’années à s’y décider pour de bon, parce qu’un beau jour, il a la révélation que c’est le but de toute sa vie. Et l’on peut vraiment parler de révélation.
Bon, c’est sûr qu’il faut à Proust presque 3000 pages pour arriver au moment où tout se dénoue, et où sa vocation d’auteur devient brusquement d’une luminosité aveuglante, en même temps qu’elle synthétise et justifie les milliers de pages qui précèdent.
Tout est évidemment dans le « certain nombre de dizaines d’années », où Marcel, le narrateur, ne fait rien, où il s’en veut d’être un paresseux invétéré qui passe le plus clair de son temps à observer et analyser ses sentiments, la nature, les œuvres humaines, les choses et les êtres dans leurs manèges sociaux et sentimentaux.
Il aura fallu un certain nombre de dizaines d’années pour qu’il prenne conscience que c’étaient ces dizaines d’années qui constituaient l’objet même de sa vocation. Autrement dit, il a fallu que le narrateur vive sa vie pour qu’il se rende compte que c’était cette vie-là qu’il était fait pour raconter. C’est vrai qu’il se défend de tomber dans l’autobiographie, et il prend bien soin de rappeler qu’on est dans un roman, même s’il ne peut s’empêcher de laisser parfois tomber le masque.
Tiens, c’est dans La Prisonnière (derniers tiers de l’œuvre) :
« Et pourtant, cher Charles Swann, que j’ai si peu connu quand j’étais encore si jeune et vous près du tombeau, c’est déjà parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d’un de ses romans, qu’on recommence à parler de vous et que peut-être vous vivrez. Si dans le tableau de Tissot représentant le balcon du Cercle de la rue Royale, où vous êtes entre Galliffet, Edmond de Polignac et Saint-Maurice, on parle tant de vous, c’est parce qu’on voit qu’il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swann ».
Le balcon en question domine la place de la Concorde. Le tableau de James Tissot est peint en 1868 (Proust naît en 1871). Charles Haas, qui est sans doute le dernier à droite, a donc, parmi d’autres, servi de modèle à Proust pour le personnage de Swann.
Toujours dans La Prisonnière, Albertine fait porter un mot urgent par un cycliste : « "Mon chéri et cher Marcel, j’arrive moins vite que ce cycliste dont je voudrais bien prendre la bécane pour être plus tôt près de vous. (…) Quelles idées vous faites-vous donc ? Quel Marcel ! Quel Marcel ! Toute à vous, ton Albertine" ».
La « vocation » littéraire du petit Marcel est très tôt exprimée. Il compose son premier texte dans la voiture du docteur Percepied au spectacle des clochers de Martinville. Il est très jeune. Il montrera ce texte à Monsieur de Norpois qui, sans décourager Marcel, fait la fine bouche et doute sérieusement qu’il pourra faire, comme il l’espère, carrière dans les lettres. Mais déjà, dans Du Côté de chez Swann, l’idée est présente :
« Et ces rêves m’avertissaient que, puisque je voulais un jour être un écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un sujet où je pusse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit s’arrêtait de fonctionner, je ne voyais plus que le vide en face de mon attention, je sentais que je n’avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l’empêchait de naître. »
Le thème de la vocation littéraire jalonne tout l’ouvrage, mais comme sans conviction, comme une simple hypothèse. C’est vrai, à un moment, la mère de Marcel, l’air de rien, dépose sur sa table de nuit le numéro du Figaro où un article de lui vient d’être publié, mais c’est comme « en passant », elle fait semblant de n’y prêter aucune attention. C’est qu’il lui semblerait impudique d’exprimer ses sentiments. Mais la manière même dont ce sentiment d’impudeur est exprimé est tout simplement remarquable.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel proust, littérature, france, à la recherche du temps perdu, du côté de chez swann, guermantes, sodome et gomorrhe, cercle de la rue royale, peinture, james tissot



