samedi, 26 septembre 2015
NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe
vendredi, 25 septembre 2015
NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, bande dessinée, gaston lagaffe, andré franquin
jeudi, 24 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4
Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse
La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.
Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.
Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».
Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.
Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).
C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.
Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).
Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.
Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot
mercredi, 23 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3
Le Monde comme fantôme et comme matrice
Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.
Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).
Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.
Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).
Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».
On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.
L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.
Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.
Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.
Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.
Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.
L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.
Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer
mardi, 22 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
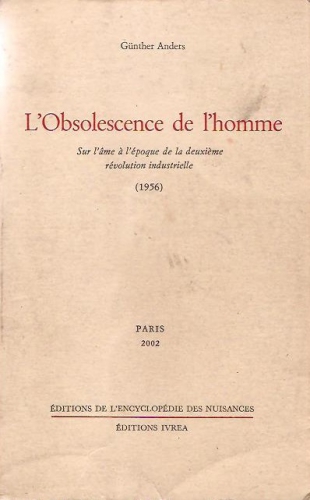 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.
Sur la honte prométhéenne
Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».
J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.
Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.
Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.
De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.
Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.
Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.
Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.
Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.
Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».
Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre
lundi, 21 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
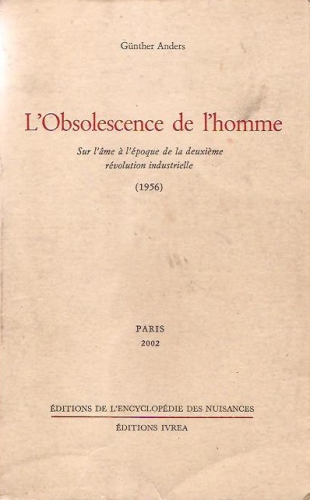 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
L’Obsolescence de l’homme, (éditions de l’Encyclopédie des Nuisances + éditions Ivréa, Paris, 2002) du philosophe Günther Anders, voilà un livre qui m’a donné du fil à retordre (comme le montre ci-contre l'état de la couverture). Mais un livre important.
L’idée surgit au 20ème siècle : l’homme est désormais « de trop ». La preuve, l'homme (pas le même) est capable de l’éliminer en masse de 1914 à 1918, puis de 1939 à 1945. La preuve, Staline a supprimé sans doute cinquante millions de « mauvais soviétiques ». La preuve, les nazis furent les premiers industriels de la mort de populations civiles. La preuve, les Américains ont effacé de la surface de la Terre deux villes « ennemies », avec leurs habitants. D’autres preuves ne manquent pas, inutile d’énumérer.
Cette idée que l’homme a été rendu « superflu », je l’avais découverte en lisant Les Origines du totalitarisme, le grand ouvrage de Hannah Arendt. Pierre Bouretz la souligne dès son introduction (Gallimard-Quarto, 2002) : « Son horizon est un système dans lequel "les hommes sont superflus" » (p.151). Arendt enfonce le clou dans sa deuxième partie (« L’impérialisme »), attribuant à la « monstrueuse accumulation du capital » la production d’une richesse superflue et d’une main d’œuvre superflue (p.405). A deux doigts d'expliquer ainsi la concurrence colonialiste entre puissances européennes.
Je viens de trouver la même idée (pas tout à fait : "superflu" n’est pas "obsolète", mais le résultat est le même, répondant à la même question : « A quoi sers-je ? ») exprimée dans le dernier livre paru de Paul Jorion (Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob, septembre 2015), qui cite le célèbre économiste britannique : « Mais l’effet des machines des générations les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l’homme plus efficaces, mais de les rendre "obsolètes" » (p.94). Il écrivait cela en 1928. Que dirait-il aujourd’hui, où la numérisation bat son plein et où la robotisation avance par vent arrière et a sorti le spinnaker ?
Le livre de Günther Anders, sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », publié en 1956, s’il n’invente pas la notion, la place en tant que telle au centre de la réflexion du philosophe. C’est du brutal. A noter que la notion d’ « obsolescence programmée » est inventée à la fin des années 1920, quand les fabricants d’ampoules lumineuses se rendent compte que si celles-ci sont éternelles ou presque (comme ils sont parfaitement capables de le faire), leurs entreprises ne survivront pas longtemps.
Je l’avoue : il m’arrive de lire des philosophes. J’exècre, je l’ai dit, les économistes qui jargonnent pour bien faire comprendre leur supériorité sur les gens ordinaires en usant de concepts sophistiqués et d’un vocabulaire amphigourique. C’est la même chose pour la psychanalyse : Lacan me fait rire, contrairement à quelqu’un comme Didier Anzieu, qui n’abrite pas son « autorité » derrière un sabir ou un volapük motivé selon lui par l’extrême précision technique que requiert sa discipline.
C’est encore la même chose avec les philosophes. Je ne suis pas familier de la discipline, mais il m’arrive d’en fréquenter, tout au moins parmi ceux qui me paraissent fréquentables, dans la mesure où ils écrivent pour être compris du commun des mortels, et non du seul petit cercle de leurs confrères spécialistes de la spécialité. Pour rendre intelligible leur pensée, en rédigeant en « langue vulgaire », c’est-à-dire – au sens latin – la langue « commune à tous ».
Ce qui est curieux (et qui rend la lecture tant soit peu ardue), avec le livre de Günther Anders, c’est qu’il cumule. Je m’explique. Il s’exprime dans une langue très accessible, sans toutefois s’interdire de recourir à l’occasion au dialecte propre à quelques philosophes (Hegel, Heidegger, …). Mais il accroît la difficulté : le contenu même des idées est fait pour rebuter le lecteur, dans la mesure où celui-ci se retrouve démuni et perdu, faute d’apercevoir quelques points de repère grâce auxquels il ait l’impression d’être en terrain connu. Indéniablement, on a à faire à un original authentique. L’éditeur le déclare d’entrée de jeu : si la traduction française paraît près d’un demi-siècle après l’édition allemande, « La difficulté du texte y est certainement pour quelque chose … ».
Anders (pseudo signifiant « autre », son vrai nom étant Stern) est un philosophe de toute évidence marginal, à cause de sa radicalité, et surtout à cause d’une « méthode » pour le moins idiosyncrasique. Il revendique en effet le droit à l’exagération comme méthode. Il justifie ce choix en comparant sa recherche à celles que mène un virologue, dont l’outil principal est le microscope : que serait une « virologie à l’œil nu » (encyclopédie en ligne) ?
L’argument semble d’autant plus valable qu’il soutient que ce n’est pas lui mais le monde dont il parle qui exagère : ce qu’il écrit « … n’est que l’exposé outrancier de ce qui a déjà été réalisé dans l’exagération » (p.35). Il le dit ailleurs : l’humanité a commencé à fabriquer « un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher ». La grande idée qui traverse tout l’ouvrage est que certes, par son génie, l’homme a élaboré un monde qui tend à se rapprocher des œuvres divines, mais que, par sa nature, il en reste à jamais « pas à la hauteur ».
« L’homme est plus petit que lui-même » est d’ailleurs le titre d’un des chapitres. Le pataphysicien pense bien sûr au chapitre IX du livre II de Faustroll : « Faustroll plus petit que Faustroll ». « Tout est dans Faustroll », s’écriait d’ailleurs le docteur Irénée-Louis Sandomir (fondateur du Collège de 'Pataphysique), pour bien signifier qu’Alfred Jarry reste un grand précurseur.
L’homme n’est pas à la hauteur du monde qu’il a fabriqué à partir du 20ème siècle. Il y faudrait, comme dit Jarry, un SURMÂLE, du type d'André Marcueil.

Dessin de Pierre Bonnard pour Le Surmâle, d'Alfred Jarry.
Mais il n'y a pas de surmâle, comme le montre la baudruche appelée indûment Superman. Comme par hasard américaine.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les rigines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique
dimanche, 20 septembre 2015
NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe
samedi, 19 septembre 2015
MARIO VARGAS LLOSA
 Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.
Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.
Il a beau inscrire son propos, dans le chapitre introductif, dans la lignée d’une ribambelle d'auteurs dénonçant le règne de la marchandise, la transformation du monde en spectacle et des gens en consommateurs (T.S. Eliot, George Steiner, Guy Debord, Gilles Lipovetsky, Frédéric Martel – il oublie Alain Finkielkraut et sa mémorable Défaite de la pensée), son livre au titre ambitieux ne tient pas debout. C'est au mieux le livre d'un vieux notable universellement respecté, à qui un adulateur a demandé, à la fin du banquet, d'émettre un jugement sur notre époque et notre monde tels qu'il les voit.
La thèse est facile à formuler : le monde actuel, en privilégiant le loisir, le divertissement et la consommation, a assassiné la culture. L’un des problèmes vient justement de ce dernier terme. L’auteur en tient visiblement pour la « haute culture » (sous-entendu : classique, traditionnelle, la culture par laquelle l’homme tend à s’élever au-dessus de lui-même). C’est précisément ce qui n’est pas à lui reprocher.
Il lui oppose la « culture-monde » : « La culture-monde, au lieu de promouvoir l’individu, le crétinise, en le privant de lucidité et de libre-arbitre, et l’amène à réagir devant la "culture" régnante de façon conditionnée et grégaire, comme les chiens de Pavlov à la clochette qui annonce le repas » (p.28). On est évidemment d’accord avec lui : la culture est structurée selon une échelle de valeurs. La marchandisation de tout tire tout vers le bas en mettant sur le même plan une paire de bottes et l'œuvre de Shakespeare (Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Gallimard, 1987, p.136).
Il existe, malgré tout ce que peut proclamer la culture « mainstream » (titre du livre du susnommé Frédéric Martel), une hiérarchie dans la culture, qui sait différencier la démarche qui prône un effort constant et une exigence de la part de celui qui se cultive, et la démarche qui se borne à des produits culturels de consommation courante véhiculés par la publicité, faits pour suivre les modes et disparaître sitôt absorbés.
Vargas Llosa raisonne en aristocrate : « La quantité aux dépens de la qualité. Ce critère, auquel tendent les pires démagogies dans le domaine politique, a eu ici des conséquences imprévues, comme la disparition de la haute culture, forcément minoritaire par la complexité et parfois l’hermétisme de ses clés et codes, et la massification de l’idée même de culture » (p.35). Jusque-là, je suis prêt à approuver l’auteur.
Qu’est-ce que je reproche à ce livre ? D’abord de brasser des idées tant soit peu rebattues. D’enfoncer des portes ouvertes. De nous donner à renifler des parfums flottant dans l’air du temps. D’énoncer trop souvent des banalités. De produire un ingrédient voulu original, mais constitué surtout du tout-venant intellectuel. Il arrive comme les carabiniers quand il dénonce – après tant d’autres – l’irruption de la « frivolité » dans les domaines les plus sérieux de l’existence des hommes et de la vie des sociétés.
Mais ce que je reproche surtout à ce livre, en dehors de la superficialité des analyses, c’est le joyeux mélange qu’il opère des notions et des perspectives. Autrement dit : son manque d’unité. Cela donne une impression d’hétérogène et de disparate. Autant j’abonde quand il s’en prend aux « déconstructionnistes » de la culture (Foucault, Derrida, …) qui, en critiquant la notion de pouvoir, ont sapé à la base le principe d’autorité, autant je trouve incongru le chapitre sur la « disparition de l’érotisme ». Je concède cependant que la dénonciation des « ateliers de masturbation » mis en place en 2009 dans les collèges d’Estrémadure a quelque chose de réjouissant.
Et encore plus étrange celui où, tout en s’affirmant athée, il prend contre toute raison la défense de la plus extrême liberté religieuse, en mettant strictement sur le même plan les sectes (Moon, scientologie, …) et toutes les croyances et religions reconnues et officielles : « Les sectes, à cet égard, sont utiles et devraient être non seulement respectées, mais encouragées » (p.197). Il se félicite que les sectes « procurent un équilibre et un ordre à ceux qui se sentent déconcertés, solitaires, inquiets dans le monde d’aujourd’hui ». Pour le moins surprenant, n’est-il pas ?
Ajoutons pour compléter le tableau que les six chapitres et la « Réflexion finale » sont entrelardés d’une petite dizaine de textes intitulés « Pierre de touche » (pourquoi ?) – en fait, des articles déjà publiés dans le journal El País, illustrant telle ou telle partie du raisonnement. Quant au chapitre conclusif, inclus dans la « Réflexion finale », il reproduit le discours que l’auteur à prononcé en 1996 après s’être vu décerner le « Prix de la Paix » par les éditeurs et libraires allemands. Le discours du patriarche à la fin du banquet organisé en son honneur.
L’image que je garde du livre dans sa totalité : banal, consensuel et mal foutu, où l'on trouve à la fois du très juste, mais qui court les rues, et du n'importe quoi.
Quant au titre, qu’on me pardonne, il est au mieux une promesse non tenue, au pire une imposture prétentieuse.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, mario vargas llosa, la civilisation du spectacle, guy debord, la société du spectacle, éditions gallimard, ts eliot, george steiner, alain finkielkraut, gilles lipovetsky, frédéric martel mainstream, la défaite de la pensée, secte moon, scientologie, l ron hubbard
vendredi, 18 septembre 2015
L'AMI D'ENFANCE DE MAIGRET
Georges Simenon : L’Ami d’Enfance de Maigret (tome XXVI, éditions Rencontre, 1973).
Léon Florentin, quand il était au lycée Banville de Moulins, était celui qui, dans la classe de Maigret, passait son temps à faire rire ses camarades. En d’autres occasions, il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans qu’un mensonge en sorte. Ils se sont perdus de vue, rencontrés par hasard des années après : tout avait l’air d’aller bien pour Florentin, le copain de classe de Maigret. Il revenait juste d’Istanbul.
Mais le Florentin qui se présente au bureau de Maigret ce jour-là a tout du décavé : il « était moins fringant que celui de la place de la Madeleine ». Son costume gris est du genre fatigué. Il vit bizarrement. Habitant avec Josée, il s’absente lorsque celle-ci reçoit des messieurs contre rémunération. On peut dire, sans trop exagérer, qu’il est le maquereau de la dame. Au petit pied, c’est entendu.
La dame en question reçoit au total quatre messieurs dans la semaine. Chacun a son jour. Et puis un jour, surprise, l’un des clients s’annonce hors du créneau prévu. Florentin se cache dans la penderie. Un quart d’heure après, il entend un coup de feu : Josée est morte, atteinte à la gorge. Premier suspect, évidemment : Florentin. Pourtant c’est lui qui vient raconter cette histoire à Maigret, qui n’a pas oublié la tendance de son ancien camarade de classe à arranger les faits à sa sauce.
Bref : Maigret mettra la main sur le coupable. Mais il n’innocentera pas Florentin de sa lâcheté et de sa veulerie. C’est vrai que le bonhomme est loin d’être reluisant. Un minable, finalement.
On a aussi le portrait croustillant d’une concierge magnifiquement laide, et le défilé habituel de quelques types humains plus ou moins esquissés ou dessinés.
Un Maigret tout en grisaille un peu gluante.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, l'ami d'enfance de maigret
jeudi, 17 septembre 2015
LA COLÈRE DE MAIGRET
Georges Simenon : La Colère de Maigret (tome XXIII, Editions Rencontre, 1969)
Emile Boulay a disparu mystérieusement, au cours d’une nuit. Il possède plusieurs boîtes et cabarets, à peu près tous regroupés dans le même quartier (Montmartre). Les proches s’inquiètent. On retrouve son cadavre deux jours plus tard, rue des Rondeaux dans le vingtième arrondissement, une rue en cul-de-sac sur le flanc nord-est du Père-Lachaise. Il est en état de décomposition avancée, ce qui laisse supposer ...
C’est l’occasion d’une plongée dans le milieu tant soit peu interlope et nocturne de la « vie parisienne ». Un « caïd » du « milieu », Mazotti, s’est fait descendre au cours d’une fusillade quelque temps auparavant. Mais Antonio Farano affirme catégoriquement que ce n’est pas Boulay qui a fait le coup, bien qu’il possède un automatique et l’autorisation de détention et de port d’arme qui va avec.
Antonio était le beau-frère de Boulay et gérait l’une de ses boîtes. Il soutient que son beau-frère était très « famille-famille », comme on peut l’être en Italie. D’autres personnages gravitent autour du mort : un portier, Mickey, un ancien de la Légion, un avocat, ancien héros qui la joue modeste, baroudeur pendant la guerre, qui y a laissé quatre doigts parce qu’il ne voulait pas que le type en face lui plante son poignard. Il s’est spécialisé dans l’établissement et la vérification des comptes des sociétés, et gagne apparemment beaucoup d’argent, parce que le travail qu’il rend est absolument impeccable, au point que l’inspecteur des impôts Jubelin en est estomaqué.
Le titre est motivé par le poing que Maigret abat avec force sur son bureau : « Alors Maigret frappa la table d’un coup de poing qui fit sursauter tous les objets. – Taisez-vous ! hurla-t-il. Je vous interdis, jusqu’à ce que je vous y invite, d’ouvrir la bouche … ». Les inspecteurs, dans le bureau à côté, se regardent, interloqués. Je ne sais pas vous, mais j’ai du mal à me représenter un objet en train de « sursauter » (synonyme de "tressaillir").
Bon, je ne dirai pas qui est le coupable, mais le mobile n’est quand même pas glorieux pour deux sous.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, la colère de maigret
mardi, 15 septembre 2015
NE PAS DERANGER
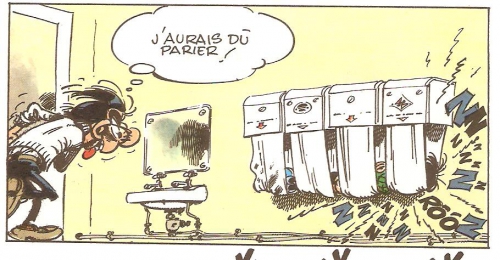
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, gaston lagaffe, andré franquin, humour, spirou
lundi, 14 septembre 2015
MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL 2
 MES LECTURES DE PLAGE 8
MES LECTURES DE PLAGE 8
2/2
Musique au château du ciel, de John Eliot Gardiner (Flammarion, 2014), est sous-titré "Un portrait de Jean-Sébastien Bach". Pour moi, Bach (Jean-Sébastien) et Beethoven (Ludwig van, comme on dit) sont les deux pères de la musique qui est la mienne. Bach atteint le sommet d'un "genre ancien". Beethoven fracasse les limites de celui-ci et ouvre de vastes horizons au "genre nouveau".
Bach surpasse tous ceux qui ont voulu, avant lui, marier la mélodie (horizontale) et l'harmonie (verticale) dans le contrepoint. Beethoven est le premier à avoir écrit de la musique de chambre jouable seulement par des professionnels aguerris (à Ignaz Schuppanzigh, qui se plaignait des difficultés d'exécution de je ne sais plus lequel des derniers quatuors : « Croyez-vous que je me soucie de vos boyaux de chat quand l'inspiration me visite ? »).
JSB s'efforce donc de proposer en musique l’exact équivalent du texte chanté par les fidèles. D'en rendre fidèlement la teneur spirituelle. En ce sens, Bach, s’il n’est pas un cas unique, est du moins de ceux qui maîtrisent à la perfection l’art de réaliser une osmose, de mettre au plus près en adéquation musique et texte : il fait en sorte que sa musique se mette humblement au service de la liturgie et de sa signification. Au même moment (titre du chapitre 4 : « la génération de 1685 »), Haendel, Domenico Scarlatti et Rameau sont engagés sur des voies beaucoup plus impliquées dans la vie sociale et mondaine de leur temps (opéra, musiques de salon, etc.).
Gardiner insiste particulièrement, dans les premiers chapitres, sur l'intense piété qui guide Jean-Sébastien Bach. On le savait, bien sûr, mais il explique en détail combien le musicien adhérait avec conviction à la doctrine de Luther, au point de posséder nombre de ses œuvres dans sa bibliothèque, dont une belle édition complète. Bach est né à Eisenach, ville dominée par la Wartburg, le château où Luther fut contraint de se réfugier après avoir fait son coup d’éclat.

Maison natale de Jean-Sébastien Bach à Eisenach (côté jardin, photo prise à l'été 2001).
Gardiner ne peut s’empêcher, avec malice, de faire état (en note de bas de page, soyons juste) de la constipation du fondateur du protestantisme : « Le Seigneur m’a frappé de graves douleurs en mon derrière ; mes excréments sont si durs que je pousse pour les expulser avec tant de force que j’en transpire ; et plus j’attends pour ce faire, plus ils durcissent. […] Mon cul est devenu mauvais ». C'est sûrement le petit Jésus qui l'a puni pour son forfait contre la religion catholique.
Mais revenons à Bach et à son immense piété. Il allait jusqu’à signer ses œuvres (y compris profanes) du sigle SDG (« Soli Deo Gloria ») : « A la gloire de Dieu seul ». Cette piété ne l’empêchait pas d’avoir son caractère. Le livre de Gardiner n’est pas une hagiographie, loin de là. On y voit un Bach parfois colérique : quand ses interprètes n'étaient pas à la hauteur, quand les responsables de la Thomasschule ou de la Thomaskirche lui cherchaient noise ou lui faisaient des embarras. Il est vrai que les responsabilités de sa charge à Leipzig pouvaient paraître effrayantes, puisqu’il devait à la fois faire le maître d’école (« Schule ») et écrire la musique pour les offices (« Kirche »). On découvre ces conditions de travail au chapitre « L’incorrigible cantor ». Il ne fallait certes pas lambiner.

Sur ce portrait de 1748 par Elias Haussmann, on voit Bach tenant une partition (à l'envers pour que le spectateur puisse lire) intitulée « Canon triplex à 6 voc. ». Gardiner en fait une analyse étourdissante (p. 655 et suiv.).
On le prend aussi, à l’occasion, en flagrant délit de mauvaise foi. Bref, Gardiner s’attache à présenter ce géant de la musique occidentale comme un homme comme les autres. Il était certes conscient de ses capacités, de son génie si l’on veut. Mais quand certains s’extasiaient devant la génialité d’une œuvre, il répondait : « Celui qui travaillera autant que moi arrivera au même résultat ». Ce qui est à la fois grande modestie et vacherie pour ses confrères.
Gardiner insiste aussi beaucoup sur un aspect de la musique de Bach trop souvent absent ou minimisé dans ses interprétations : son caractère éminemment dansant. Certes, il y a dans nombre d’œuvres de la sévérité et de l’austérité (je pense à certaines œuvres pour orgue), mais d’une part tout dépend de la façon dont elles sont comprises et jouées, et d’autre part il me semble que l’auteur, en soulignant ce caractère dansant, pense surtout aux œuvres chantées (cantates, Passions, …), où il perçoit ce que Bach y a mis d’allégresse physique.
Très normalement, les premiers chapitres du livre dessinent les cadres dans lesquels s’inscriront la naissance et la vie de Bach. L’auteur commence toutefois par exposer les circonstances toutes personnelles (famille, études, ...) qui l’ont amené à s’occuper en priorité de célébrer cette musique, qui l’ont mis en présence, les rencontres et les premiers pas dans la carrière de chef.
Puis il aborde le cadre historique : Bach naît en 1685, à la fin d’un siècle marqué par l’épouvantable guerre de Trente ans (1618-1648) ; le cadre géographique : la Thuringe, avec ses traits spécifiques (plus « provinciaux » que, par exemple, Hambourg ou Berlin) ; le cadre familial : la dynastie Bach, les grands aînés (Johann Christoph), mais aussi toute une tribu marquée par l’amour et l'omniprésence de la musique.
1
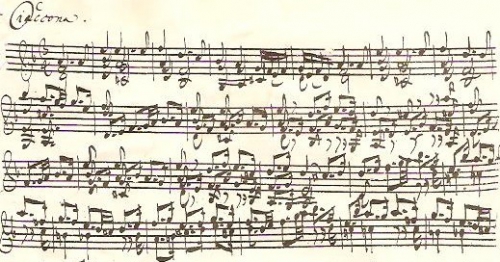
2

Ceci ne figure pas dans le livre de Gardiner : c'est juste pour le plaisir.
L'écriture de Bach (deux extraits, dont le début de la chaconne de la Partita n°2 pour violon seul) dans un fac-similé du manuscrit original. Par souci d'économiser le papier, il remplissait ses pages au maximum, après avoir tracé lui-même ses portées avec un porte-plume à cinq becs (que Gardiner appelle "rastrum" (p.271), de "raster" en latin : outil agricole à plusieurs dents pour briser les mottes).
On admire le graphisme, où l'on distingue (1) écriture harmonique (verticale, apparence éparpillée) et (2) écriture mélodique (horizontale, triples croches très "liées"). Quand Bach s'amuse à faire de la polyphonie (harmonie) sur un instrument a priori monodique (mélodie).
Gardiner, on le comprendra aisément du fait de sa position de chef d’orchestre (et de chœur), fait donc la part belle aux œuvres vocales du maître, laissant de côté des monuments du contrepoint tels que L’Art de la fugue, Le Clavier bien tempéré, L’Offrande musicale et autres merveilles de ce répertoire. C’est le résultat logique d’un choix. Gardiner s’est demandé essentiellement par quel puissant motif était poussé Jean-Sébastien Bach, aboutissant à la conclusion que la source vive où celui-ci puisait son inspiration était d’ordre spirituel, religieux.
Gardiner le dit bien, les documents concernant le quotidien, familial comme professionnel de Jean-Sébastien Bach sont en nombre insuffisant pour permettre à un biographe de retracer l’existence du compositeur autrement qu’à travers ses grandes étapes (dans l’ordre, Eisenach, Ohrdruf, Lunebourg, Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen, Leipzig).

Devant la Thomaskirche à Leipzig (photo prise à l'été 2001).
Son livre, Musique au château du ciel, est donc moins une biographie au sens strict que la tentative de rendre compte de l’effort accompli constamment au cours de toute une vie de musicien pour approcher et partager si possible une expérience grandiose.
John Eliot Gardiner peut être content du monument qu'il a élevé à la mémoire du "Cantor de Leipzig".
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une seule bêtise dans ce livre, sans doute (j'espère) une bourde du traducteur. On la trouve à la page 659 : « Bien des gens se souviennent que lorsque la navette spatiale Voyager fut lancée, en 1977, ... ». Si la sonde Voyager avait été une navette, la Terre aurait pu attendre son retour. La sonde, on l'attendra longtemps, longtemps, longtemps. La sonde Voyager, c'était bien sûr sans espoir de retour, les signes et symboles, et la musique (de Bach) gravés sur l'engin étant destinés à d'éventuels extra-terrestres.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, john eliot gardiner, english baroque soloists, orchestre révolutionnaire et romantique, musique baroque, buxtehude, membra jesu nostri, revue diapason, guide de la musique ancienne et baroque, rené jacobs, harmonia mundi, andré suarès, jean-sébastien bach, cantor de laipzig, elias haussmann peintre, gustav holst, benjamin britten, cantates de bach, musique au château du ciel, éditions flammarion, passion selon saint-jean, passion selon saint-mathieu, christ lag in todesbanden, karl richter, dietrich fischer-dieskau, cantate actus tragicus, noël arnaud, alfred jarry
dimanche, 13 septembre 2015
MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL 1
 MES LECTURES DE PLAGE 7
MES LECTURES DE PLAGE 7
1/2
Tous les amateurs de musique, en particulier ceux qui préfèrent « le baroque » (en gros 1600-1750), connaissent peu ou prou John Eliot Gardiner. Ce chef d’orchestre né en 1943, fondateur des English Baroque Soloists et de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (deux ensemble destinés à des répertoires différents, comme leur nom l’indique), a énormément travaillé et, bien sûr enregistré.
Je dois dire que ses interprétations ne sont pas toujours celles que je préfère. Je pense par exemple à ce chef d’œuvre de Buxtehude, Membra Jesu nostri. Sa version est terne, pieuse et monotone. J’écoute (et je recommande) celle de René Jacobs, beaucoup plus jouissive et sensuelle, quoique le rédacteur Diapason du Guide de la musique ancienne et baroque (qui encense la version Gardiner) la qualifie de « vraiment piétiste » (Bouquins-Laffont, 1993) : on devrait interdire aux ignorants d’utiliser les mots à tort et à travers (peut-être voulait-il dire « sulpicienne », « piétiste » désignant une secte protestante fondée au 17ème siècle, rassemblant des gens qu’André Suarès qualifiait d’ « ennemis secrets ou déclarés de la vie »). La version de Jacobs est simplement sublime. Passons.
John Eliot Gardiner a donc très longuement fréquenté Jean-Sébastien Bach. Il a même grandi « sous les yeux du cantor », comme il le dit lui-même : né dans un « vieux moulin du Dorset », il a pu, à peine sorti du ventre de sa mère, contempler le portrait à l’huile que le peintre Elias Haussmann avait fait de Bach en 1748, qui était « accroché en bonne place en haut de l’escalier, sur le palier du premier étage ».
Gardiner n'est pas né natif de nulle part : ses parents recevaient chez eux « Imogen Holst, fille du compositeur Gustav Holst et secrétaire de Benjamin Britten ». Il est né dans un milieu musical de haut vol. Pour introniser Bach en façon de « saint patron », il s’est lancé un défi au début de sa carrière : donner dans le temps prévu par le compositeur (un an) un cycle entier de ses cantates, comme cela se passait à son époque. Pari (une prouesse) tenu.
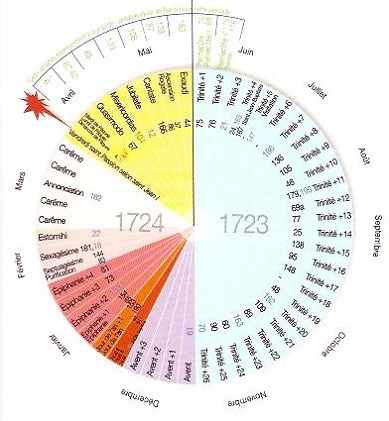
Un cycle annuel de cantates d'église débute au premier dimanche après la Trinité, et rythme l'année liturgique luthérienne. Ici, le premier cycle de cantates de Bach à Leipzig (il y est arrivé en 1723). Un défi que lui seul était en mesure de relever. Les couleurs renvoient aux différentes origines des cantates (inédites, matériau réutilisé, etc.).
De ce long compagnonnage avec le maître de Leipzig, de cette immersion prolongée dans son oeuvre, devait forcément découler le gros livre (le texte se clôt à la p.669) qu’il lui a consacré en 2013, Musique au château du ciel (Flammarion, 2014). Je le dis tout net : un bouquin formidable. Ce jugement péremptoire découle directement de l’impression que j'ai eue qu'il rendait compte de façon absolument authentique de la très longue et intime relation que le chef a entretenue avec la musique de Bach.
Gardiner a trouvé l’exacte distance au sujet dont il fait le portrait, pour tenir sur lui un propos d’une très grande justesse. Et j’ajouterai qu'il le fait avec une grande humilité, la même humilité que Bach qui, s'il pouvait montrer un caractère épouvantable, dès qu'il s'agissait de musique, se soumettait humblement et joyeusement à l’idéal (« Endzweck ») qu’il s’était fixé : célébrer la puissance et la gloire de Dieu par les œuvres qu’il composait.
Il ne faut pas se méprendre : le livre s’adresse, sinon à des spécialistes, du moins à des mélomanes. Ce n’est en effet pas une biographie au sens plein du terme (c'est un « portrait », comme l'indique le sous-titre : plus proche, plus intime, plus personnel, en même temps que plus vivant qu'un travail plus "universitaire").
L’analyse musicale tient une place non négligeable. Il est recommandé de connaître assez bien les deux Passions, la Messe en si, ainsi qu’un certain nombre de cantates, au premier rang desquelles les BWV 4 (« Christ lag in Todesbanden », version saisissante de ferveur de cette cantate magnifique par Karl Richter et Dietrich Fischer-Dieskau), 131 (« Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir ») et 106 (« Actus tragicus »).

Ces analyses sont indispensables pour prendre conscience de l’extraordinaire état de symbiose (Gardiner emploie le terme) auquel Bach parvient, entre l’écriture de la musique et le sens des paroles qui seront chantées. Pour donner un exemple, voici comment l’auteur évoque la façon dont Bach a conçu, dans la Passion selon Saint Jean, le poignant air « Ach, mein Sinn », chanté par Pierre (basse) au n°13.
Pierre vient de renier Jésus, comme celui-ci le lui avait prédit (y compris le chant du coq) : « Le plus inattendu pour cette expression du remords est le choix du style héroïque français – normalement associé à la pompe et aux cérémonies –, et la manière dont Bach l’imprègne de techniques structurelles italianisantes, chaque mesure sauf les trois de l’épilogue étant dérivée de la ritournelle initiale ».
Et encore n’ai-je pas cité un de ces passages plus techniques, où Gardiner dévoile le sens théologique (dans l’esprit de Bach) de la quinte descendante, de l’hémiole (« … tantôt renforçant le deuxième temps caractéristique de la chaconne, tantôt le concrétisant au moyen d’hémioles à cheval de la barre de mesure »), et autres joyeusetés. On pourrait dire comme Noël Arnaud parlant d’Alfred Jarry (dans A. J. D'Ubu roi au docteur Faustroll, je crois) : Jean-Sébastien Bach n’écrit pas pour les ignorants. Sa musique explique, commente, développe, signifie les paroles qu’elle prend pour matériau, ce qui passait très souvent largement au-dessus de la tête des responsables tracassiers, et sans doute bornés, auxquels il avait à faire (le conseil municipal de Leipzig).
Autre exemple, un peu plus « pointu », à propos de la cantate BWV 4 (« Christ gisait dans les liens de la mort ») (cliquer ci-contre pour vingt-deux minutes formidables avec Richter et Fischer-Dieskau) : « Sur cette scène désolée, la Mort fait maintenant son entrée furtive, saisissant les mortels dans ses mains décharnées. Par deux fois, Bach fige la musique, d’abord sur les mots "den Tod … den Tod", allant et venant quatre fois entre le soprano et l’alto, puis sur le mot "gefangen" ("prisonniers") sur lequel les voix s’immobilisent dans une dissonance mi / fa dièse – l’état de captivité qui précède immédiatement le début de la rigidité cadavérique ».
Plus loin : « Le pouvoir de la mort est brisé. La musique s’arrête complètement sur le mot "nichts" : "il ne reste plus rien" – les ténors reprennent lentement – "que la figure de la mort", la mort n’est plus désormais que l’ombre pâle d’elle-même. Bach inscrit ici de manière très délibérée le dessin de la croix en quatre notes, avant que les violons ne reprennent leur mouvement ». L’illustration ci-dessous permet de visualiser la chose.
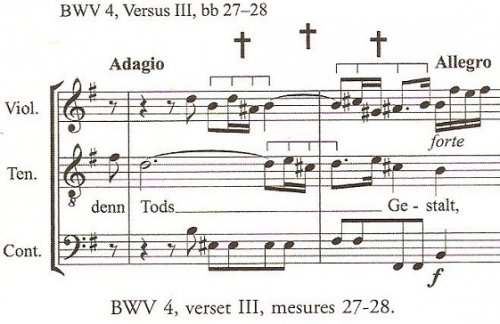
Gardiner est doué, ça ne l'empêche pas d'être pédagogue. La marque du grand monsieur.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : il vient de diriger magistralement la Fantastique de Berlioz au festival de La Côte-Saint-André.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, john eliot gardiner, english baroque soloists, orchestre révolutionnaire et romantique, musique baroque, buxtehude, membra jesu nostri, revue diapason, guide de la musique ancienne et baroque, rené jacobs, harmonia mundi, andré suarès, jean-sébastien bach, cantor de laipzig, elias haussmann peintre, gustav holst, benjamin britten, cantates de bach, musique au château du ciel, éditions flammarion, passion selon saint-jean, passion selon saint-mathieu, christ lag in todesbanden, karl richter, dietrich fischer-dieskau, cantate actus tragicus, noël arnaud, alfred jarry
samedi, 12 septembre 2015
NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 08 septembre 2015
MAIGRET HESITE
A l'occasion du nouvel an pataphysique (nous sommes présentement le 1 absolu de l'an 143 E.P., où le pataphysicien célèbre précisément la "Nativité d'Alfred Jarry"), qu'il me soit permis d'adresser au lecteur et à tous les Palotins tous mes vœux de prospérité morale et de santé mentale.

Autour de l' "herbe sainte", Alfred Jarry et le peintre Pierre Bonnard (mur peint au Grand-Lemps, 38690).
Sans entrer dans des considérations trop techniques, précisons que le calendrier pataphysique prend pour premier jour de l'année le premier (8 septembre 1873) jour d'existence d'Alfred Jarry. Il est réputé avoir formulé, juste avant de s'éclipser (un 2 novembre 1907 vulg., autrement dit "28 Haha E.P.", jour commémorant la "Fuite d'Ablou"), en guise de "dernière parole", cette immortelle demande : « Un cure-dents ».
*******************************************
Georges Simenon : Maigret hésite (tome XXVI, éditions Rencontre, 1973).
Cette fois, il s’agit d’un meurtre annoncé. Et ça interloque Maigret. Une lettre d’une grande courtoisie, presque neutre. Mais une lettre anonyme quand même, dans laquelle on lit : « Un meurtre sera commis prochainement ». Sa particularité est d’être écrite sur un papier très spécial, appelé « Vélin du Morvan » : « … un vélin épais et craquant … », dont l’en-tête a été soigneusement découpé. C’est précisément ce papier, qui n’est plus fabriqué que par un papetier, et acheté que par de rarissimes clients.
Maigret déboule donc chez Parendon comme un ours dans un jeu de quille, ce qui motive l’envoi de la deuxième lettre anonyme : il aurait dû respecter la marche à suivre indiquée et attendre d’être recontacté. Parendon est un juriste renommé, spécialisé dans le droit maritime, et qui s’occupe de grosses affaires. Des hommes importants viennent souvent le voir pour cela.
Pourtant l’homme ne paie pas de mine : il porte des lunettes « à verres très épais », Maigret serre « une petite main blanche qui semblait sans ossature », l’homme semble « petit et frêle, d’une curieuse légèreté ». Son épouse, qui s’est invitée sans prévenir au cours de l’entretien, déclare tout de go : « J’espère que vous n’êtes pas venu arrêter mon mari ?... Avec sa pauvre santé, vous seriez obligé de le mettre à l’infirmerie de la prison … ». Elle le considère comme une demi-portion, comme un gnome, comme une quantité négligeable. La charmante femme !
La secrétaire du monsieur est amoureuse de lui. Elle se nomme Mlle Vague. Elle ne lui refuse rien quand il a envie d’elle, au risque que Mme Parendon les surprenne en pleine action : la maison entière est garnie de tapis et moquettes à suffisance pour qu’elle puisse se déplacer sans être remarquée, et être ainsi au courant de tout ce qui s’y passe, à l’insu même des occupants. Le luxueux appartement de l’avenue de Marigny lui appartient, hérité de son père, M. Gassin de Beaulieu, lorsque celui-ci a pris sa retraite, se retirant dans son château de Vendée. L’époux n’a strictement rien changé aux meubles, aux objets, à la décoration. On dirait qu’il n’est pas chez lui.
M. Parendon a une manie, pardon : un « hobby ». Il est obsédé par l’article 64 du Code Pénal. Il s’est mis en tête de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le faire abroger. C’est l’article qui dit : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». Cela sous-entend peut-être dans son esprit que tout crime mérite châtiment, quel que soit l’état mental du criminel au moment des faits. Une sorte d’éthique fanatique de la responsabilité morale de l’homme dans tout ce qu’il fait. Pourquoi pas ?
En tout cas, Parendon n’a semble-t-il rien à cacher, puisqu’il fait savoir à tout le personnel que le commissaire pourra circuler à sa guise dans l’appartement et interroger chacun autant qu’il le jugera nécessaire. C’est ainsi qu’il s’entretient fort longuement avec la charmante Mlle Vague, qui répond sans fard à toutes ses questions, même les plus indiscrète. C’est évidemment cette femme qu’on retrouve égorgée.
Après lecture, les péripéties de l’enquête s’effacent assez vite. Simenon introduit dans son tube à essais un certain nombre de composés chimiques qui sont les personnages, pour observer comment tout ça réagit. Ici, la réaction est, selon moi, de basse intensité.
Une histoire somme toute anodine, peut-être à cause du choix des ingrédients : rien d’explosif.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alfred jarry, calendrier pataphysique, pierre bonnard, le grand-lemps, georges simenon, commissaire maigret, maigret hésite, roman policier, polar, code pénal, pataphysique
dimanche, 06 septembre 2015
MAIGRET A VICHY
MES LECTURES DE PLAGE 6
GEORGES SIMENON : MAIGRET A VICHY (vol. XXIV, Editions Rencontre, 1969)
Le commissaire, pour une fois, a quitté Paris. Le bon docteur Pardon, après lui avoir dit : « Je crois qu’une cure à Vichy vous ferait le plus grand bien … Un bon nettoyage de l’organisme … », lui a conseillé de prendre ses vacances dans la ville d’eau. Il s’astreint à la discipline qui va avec : le verre d’eau obligatoire et régulier, et pas d’excès de table. Au café, il va même jusqu’à renoncer à la bière, c’est dire s’il est obéissant. Et puis surtout, il passe une bonne partie du temps à marcher en compagnie de bobonne.
Mais voilà, un Maigret ne serait pas un Maigret s’il n’y avait pas un mort. Cette fois, c’est « la dame en mauve » qui s’y colle. Une femme que le policier – déformation professionnelle – avait prise dans son collimateur (comme par hasard). Il est vrai qu’elle n’était pas la seule : il y avait aussi un couple, lui petit et replet, elle grassouillette, peut-être une Belge (« teint clair », « cheveux presque jaunes », « yeux bleus à fleur de tête »).
A noter que, où qu’il soit, il y a toujours quelqu’un pour reconnaître en lui le « chef de la Sûreté ». Simenon imite ici Maurice Leblanc, qui faisait des relations spéciales entre Arsène Lupin et la presse un ressort à part entière de ses fictions : le gentleman-cambrioleur ne se sert-il pas des journaux pour narguer la police ou annoncer, hâbleur, son prochain méfait ?
Pourquoi l’auteur des Maigret ressent-il le même besoin, dans la fabrication du personnage, de lui dessiner une aura de célébrité, même s'il la subit davantage qu'il ne la cherche ? On lit ici : « Il rejeta le journal, sans colère, car il avait l’habitude de ce genre d’échos, … ». Il n'y a en effet guère d'épisodes de ses aventures où il ne soit question de journalistes ou de sa photo dans le journal. L'effet de mise en abyme fut-il recherché ? Ou accompagna-t-il plus simplement la renommée du commissaire et le chiffre des ventes des romans dont la couverture portait ce nom ? Passons.
Donc la « dame en lilas » a été étranglée. Il se trouve que le commissaire divisionnaire Lecœur, qui dirige la PJ à Clermont-Ferrand, a été inspecteur sous les ordres de Maigret. Le patron de l’hôtel interpelle ce dernier : « Alors, monsieur Maigret, on vous soigne à Vichy ! On va jusqu’à vous offrir un beau crime … ». Les retrouvailles avec l’ancien subordonné sont cordiales : Lecœur ne demande pas mieux que de mettre au travail son ancien patron.
L’étranglée s’appelait Mlle Lange. Qui était-elle ? C’est à la recherche de la vérité de la personne que le livre est consacré. Une vérité liée à un passé longtemps enfoui. Cela fait une histoire compliquée, embrouillée : Hélène Lange avait une sœur, prénommée Francine. Celle-ci déclare qu’elles ne s’aimaient guère, mais on s’apercevra que, loin de se haïr, elles formaient un tandem de complices remarquable d’efficacité.
En fait de dames respectables, les deux sœurs sont des créatures machiavéliques : elles ont été assez habiles pour faire croire à M. Pélardeau, digne industriel, marié à une femme à laquelle il demeure très attaché, qu’Hélène, qui était à son service et qui a entretenu une longue liaison avec lui, a eu un fils - qu'il lui fut impossible de reconnaître, pour des raisons de convenances sociales.
En fait, c’est Francine, femme aux amants innombrables et inconnue de l’industriel, qui est allée accoucher d’un garçon à Mesnil-le-Mont, secondée par sa sœur. Elles se sont mises d’accord pour faire croire à Pélardeau qu’il est le père. Ayant le sens des responsabilités, il a constamment et largement subvenu aux besoins de la soi-disant "fille-mère" (comme on ne dit plus) et de sa supposée progéniture.
C’est l’argent ainsi soutiré pendant les quinze années qui viennent de s’écouler qui a permis aux sœurs d’ouvrir un beau salon de coiffure à La Rochelle, puis à Hélène d’acheter la maison qu’elle occupait à Vichy. Le hasard d’une cure dans la ville d’eau a suffi pour que Pélardeau reconnaisse Hélène, la suive, et fasse tout pour lui faire dire où se trouvait leur fils supposé. La mort de la femme est quasiment accidentelle.
Le roman est remarquablement construit et conduit, dans la mesure où le dévoilement se fait longtemps laborieux, pour s’accélérer vers la fin. Une autre grande qualité de ce Maigret est l’intensité dramatique produite par les enjeux psychologiques : l’embarras et la pitié de Lecœur et Maigret pour cet homme, plus accablé, semble-t-il, du poids de ce long péché pour lequel il n’a cessé de payer en pure perte, que du crime qu’il vient de commettre. Et qui a tout ce temps vécu dans l’illusion (un mensonge) qu’il avait une descendance mâle, alors que l’union avec l’épouse légitime est demeurée stérile.
Je compte ce livre parmi les excellents Maigret.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : ces considérations ne m'empêchent pas de déplorer vivement l'énormité morphologique commise par Simenon dans le chapitre I (à la deuxième page du roman) : « La soirée était presque fraîche, après une journée lourde, et la brise faisait bruisser doucement le feuillage ... ». Comment diable a-t-il pu faire de "bruire" un verbe du premier groupe ?
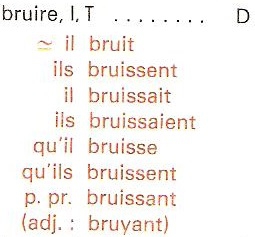
Bescherelle est catégorique ("D" pour "défectif").
Pauvre verbe "bruire" (ne pas confondre avec "bruir", du 2è groupe, qui veut dire "imbiber de vapeur, échauder") : on comprend que n'importe quel journaliste ignare prononce le plus naturellement du monde des phrases du genre : « La ville entière bruisse des rumeurs les plus folles », mais Simenon ! C'est impardonnable ! Honte sur vous, monsieur Simenon !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, commissaire lecoeur, maigret à vichy, docteur pardon, roman policier, polar, maurice leblanc, arsène lupin
samedi, 05 septembre 2015
LE VOLEUR DE MAIGRET
MES LECTURES DE PLAGE 5
GEORGES SIMENON : LE VOLEUR DE MAIGRET
Maigret, bêtement ennuyé par le cabas qu’une dame lui colle dans les tibias, se fait piquer son portefeuille. Il fumait sa pipe tranquillement sur la plate-forme d’un des derniers bus parisiens ainsi équipés. Le voleur s’est carapaté, puis perdu dans les petites rues du Marais. Aussi pourquoi le commissaire a-t-il la mauvaise habitude de mettre le portefeuille dans la poche revolver ? Il aurait dû écouter sa femme. C’est d’autant plus ennuyeux que celui-ci contient sa médaille officielle de commissaire, dont la perte est sanctionnée.
Surprise : le lendemain, il trouve sur son bureau une grosse enveloppe à son nom, contenant le portefeuille. Il n’y manque strictement rien. Puis c’est le voleur en personne qui lui téléphone et le convoque dans un café non loin de la rue Saint-Charles, dans le 15ème. François (parfois Francis) Ricain est un homme bizarre et compliqué, il fait des manières, il est affamé, il est inquiet, il n’a pas le sou. Il emmène le policier jusqu’à son logement (dans la rue citée), pour lui montrer le cadavre de son épouse, Sophie : il lui manque une partie du crâne. L’odeur est pénible.
François Ricain se croit promis à un bel avenir dans le cinéma : il écrit des scénarios de films. En attendant, il tape toutes ses connaissances pour payer son loyer, si bien qu’il doit de l’argent à un peu tout le monde. Il n’est pas le seul à croire en son talent : il y a un certain Dramin, lui aussi scénariste ; il y a Huguet, un photographe de presse ; il y a Maki, un sculpteur abstrait ; et puis il y a Carus, un producteur qui vit avec Nora, belle femme dont on apprendra que, sans ostentation, elle est une vraie femme d’affaires. Elle espère épouser Carus un jour. Tout ce petit monde se retrouve dans le restaurant tenu par Bob Mandille, un ancien cascadeur, et Rose Vatan, une ancienne chanteuse connue sous le nom de Rose Delval.
Petit roman offrant un coup d’œil sur le petit milieu vaguement artiste qu’on trouve associé au cinéma. On s’apercevra que les mœurs sont assez libres, que Sophie Ricain n’était pas précisément une oie blanche (elle aurait été vexée de ne pas se faire sauter par Huguet), que Ricain n’en pouvait plus de tirer la langue et de dépendre, pour sa subsistance de la bonne volonté de quelques-uns, qu’il pouvait haïr pour cela. Peut-être Sophie l’a-t-elle traité de maquereau ?
C’est un bon roman sans aspérités, dont l’intérêt repose sur l'inventaire méticuleux, façon "fouille en règle", un jour de grève du zèle, des caractéristiques du personnage principal, ce François Ricain, bourré d’incertitudes, d’orgueil et de contradictions.
Soit dit en passant, Maigret n'est jamais le personnage principal des aventures de Maigret : le commissaire n'est pas un "héros", mais une sorte d'éponge qui absorbe les ambiances, les petits faits, les types humains, puis qui les synthétise pour en extraire tout le suc de signification.
S'il fallait une métaphore pour définir Maigret, je dirais volontiers qu'il est un centre de gravité. Chaque Maigret est un effort, à chaque fois renouvelé, de donner du sens à un monde sans cesse incompréhensible. Et on aboutit chaque fois à la même conclusion : il n'y a rien à comprendre, il n'y a que les faits.
Au bout du compte, il reste une seule question : est-il vraisemblable qu'une petite balle de calibre 6,35 (entre 3,3 et 3,9 grammes), même tirée par un Browning de Herstal, ait emporté un morceau du crâne de la victime ? D’autant plus que quelqu’un parle à un moment (début) d’une arme de gros calibre.
Je n’en sais rien. Le doute m’habite.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maigret, littérature, littérature française, georges simenon, le voleur de maigret, roman policier, commissaire maigret, police judiciaire, quai des orfèvres, inspecteur janvier, inspecteur lucas
vendredi, 04 septembre 2015
PIKETTY ET LE CAPITALISME 2
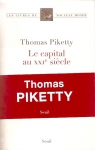 MES LECTURES DE PLAGE 4
MES LECTURES DE PLAGE 4
THOMAS PIKETTY : LE CAPITAL AU XXI° SIÈCLE
2/2
J’avais commencé à évoquer Le Capital au 21ème siècle, très gros ouvrage de Thomas Piketty, en terminant sur la courbe exponentielle que suit depuis quarante ans le montant des plus grosses fortunes actuelles, à commencer par le centile supérieur du décile supérieur (le 1 % supérieur des 10 % supérieurs).
Dans un système qui permet de telles aberrations, qui peut encore penser à la ridicule notion de « juste répartition des richesses » ? Piketty indique dans un joli tableau (p. 691) que le nombre de milliardaires dans le monde, entre 1987 et 2013, est passé de 140 à 1400 (10 fois plus). Dans le même temps, leur patrimoine total est passé de 300 milliards de dollars à 5400 (18 fois plus). Tout ça en à peine un quart de siècle. Vous avez dit « normal » ?
L’énorme masse de données (masse de chiffres qu'il a regroupés en « séries ») qui a servi de base au travail de Thomas Piketty lui a permis de reconstituer historiquement l’évolution des écarts de richesse depuis 1800. L’enseignement principal qu’il en tire est l’incroyable basculement qui s’est produit au 20ème siècle, à partir de 1914 et jusqu’en 1950. L’auteur ne cesse de revenir sur le fait qu’au temps de la Belle Epoque (qui clôt le 19ème siècle, grosso modo 1890-1913), les écarts de fortune étaient astronomiques, tels qu’ils ne s’étaient jamais vus. Et que les crises violentes de toutes sortes qui ont déchiré le monde de 1914 à 1945 les ont ratatinés.
Il explique qu’en période de croissance faible, ce sont les patrimoines qui bénéficient le plus. Tout le 19ème siècle a fonctionné ainsi, pour atteindre des sommets au tournant du 20ème. Les revenus du travail ne sauraient prétendre rivaliser. Il revient (de manière même un peu insistante) sur le discours par lequel Vautrin, dans Le Père Goriot, essaie de convaincre Rastignac d’épouser Victorine Taillefer : même en faisant de brillantes études de droit, sa situation n’arrivera jamais à la cheville de celle qu’il aurait alors, Victorine devant hériter de son père richissime (le salopard de L'Auberge rouge). Rien à faire : entre un gros héritage et une vie de travail, il n’y a pas photo. Mais Rastignac refuse.
Cette organisation se prolonge jusqu’à 1914. A partir de ce moment, le siècle va tomber dans d’incessantes et tragiques convulsions (je suis heureux de savoir que Piketty voit dans la Première Guerre le début du long « suicide » du continent européen) : entre les guerres, les crises économiques ou politiques et l’inflation, les patrimoines se font laminer : fini les héritiers, les rentiers.
Après la deuxième guerre mondiale, après cette colossale remise à niveau des conditions économiques, un système plus redistributif se met en place, principalement grâce à la progressivité de l’impôt sur le revenu, à peu près partout sur le continent. Les Trente Glorieuses constituent la période historique la moins inégalitaire que celui-ci ait connu. C’est aussi la (brève) période au cours de laquelle les revenus du travail ont dépassé ceux du capital dans le revenu national. La période où la méritocratie a donc fonctionné à plein et où l’individu pouvait, à force de travail, faire la preuve de ses compétences et de ses aptitudes, améliorer sa situation à proportion, voire arriver à s'enrichir.
Viennent les années 1970, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, la dérégulation des mouvements de capitaux, la fin de la convertibilité du dollar, enfin tout un tas de circonstances nouvelles (libérales, néolibérales, ultralibérales …), qui inversent la tendance et font repartir à la hausse les écarts de situation. Disons-le : qui accroissent de nouveau les inégalités. Et parfois démesurément, en particulier au profit du centile supérieur (0,1 %) de la population [2 ans après je corrige : il faut lire le "millile" supérieur]. Quatre décennies et demie plus tard, constatons les dégâts.
Piketty résume la cause principale de cette effarante montée des inégalités dans la formule r > g : « r » étant le rendement privé du capital, « g » figurant la croissance (production et salaires) : quand le rendement du capital (5%) est supérieur à la croissance (1%), « L’entrepreneur tend inévitablement à se transformer en rentier » (p. 942). C’est évident : si l’on a une croissance de 1 % par an, pendant que le capital rapporte 5 % à son propriétaire, le capital augmente dans la mesure exacte où ce dernier est en mesure de ne pas en dépenser tout le revenu, pour réinvestir le surplus. Et plus le capital initial est important, plus l'enrichissement est spectaculaire.
On a tout compris : pour être riche, il vaut mieux être gosse de riche. Piketty voit dans la formule r > g la contradiction principale du capitalisme aujourd’hui, cause du creusement de plus en plus abyssal du fossé séparant les plus riches des plus pauvres, une source de divergences qui produiront un jour ou l’autre, inévitablement, des convulsions sociales et politiques. La formule r > g conduit à la guerre civile ou à la révolution.
Je me rappelle – c’était il y a longtemps, quand je lisais encore Le Monde diplomatique – que ce journal avait intitulé un de ses grands articles « Les riches n’ont plus besoin des pauvres ». Ce que je vois, dans la tendance actuelle qui guide le monde, c’est la grande confiscation des conditions du bonheur de tous au profit du tout petit nombre d’une nouvelle race des seigneurs, gourmande jusqu’à la folie, insatiable jusqu'à la fureur, gloutonne jusqu'à l'extravagance.
Je me dis aussi que tout ce système fonctionne aux dépens de la planète : ne vient-on pas de nous informer au courant du mois d'août que l’humanité a épuisé les ressources renouvelables que la Terre peut fournir en un an, et qu'à partir de cette date, elle vit "à crédit", sachant que la date est plus précoce chaque année ? Bon je ne sais pas par quels calculs abscons on en arrive à fixer la date de l’année où l’humanité se met à « vivre à crédit ». Quoi qu’il en soit, une telle façon de fonctionner n’est évidemment pas viable à long terme. Il n'y a pas besoin d'être catastrophiste pour l'affirmer.
Il va de soi que je n’ai fait qu’à peine effleurer ici l’énorme livre de Thomas Piketty. Certes, ce n’est pas de la littérature, mais un livre d’histoire : la prose est du genre indigeste, et ce d’autant plus que l’auteur s’efforce davantage d’être clair et exact qu’élégant dans le style. La prose s’alourdit même parfois, comme à plaisir : abondance des incises, des parenthèses, des « nous y reviendrons » et des « ou tout du moins ». Par-dessus le marché, le lecteur doit affronter la Grande Armada des notes de bas de page. Mais bon, Piketty ne s’attend sans doute pas à obtenir le Goncourt avec son ouvrage.
Le poids du livre (1.126 gr.) s’explique par la nécessité où se trouvait l’auteur de le mettre à l’abri des réfutations et des attaques, au moyen d’une argumentation fournie, aussi inattaquable que possible, et d’une vérification méticuleuse de l’exactitude de la masse des données auxquelles il se réfère. Il y avait aussi la nécessité d’être irréprochable sur le plan méthodologique.
En plus, pour moi qui ne suis pas économiste, je remercie l'auteur de se refuser à jargonner, et de s'efforcer de mettre à la portée du lecteur lambda un ensemble de notions aussi complexe.
En plus, j'avoue que j'ai été bluffé par le nombre (et la clarté) des graphiques et tableaux : cela suppose en amont d'avoir brassé une quantité impressionnante de matière (données, documentation, archives, ...), pour établir les « séries » de chiffres que l'auteur en a tirées.
Thomas Piketty (comme sa maison d'édition) a sans doute été surpris par le succès de son bouquin. Vu l’emballement médiatique qu’il a suscité outre-Atlantique, il a dû pouvoir se dire : « Mission accomplie ».
Thomas Piketty peut à bon droit être fier de la besogne abattue.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas piketty, le capital au 21ème siècle, capitalisme, économie, inégalités, vautrin, le père goriot, rastignac, victorine taillefer, balzac l'auberge rouge, trente glorieuses, première guerre mondiale, ronald reagan, margaret thatcher, dérégulation, le monde diplomatique
jeudi, 03 septembre 2015
PIKETTY ET LE CAPITALISME 1
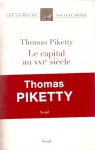 MES LECTURES DE PLAGE 3
MES LECTURES DE PLAGE 3
THOMAS PIKETTY : LE CAPITAL AU XXI° SIÈCLE
1/2
J’ai fini par en venir à bout, de ce pavé de 950 pages de texte. Le Capital au 21ème siècle, ça s’appelle. L’auteur se nomme Thomas Piketty. C’est un économiste. Il a une certaine célébrité. Son bouquin est un énorme succès de librairie, en particulier aux Etats-Unis, où il a fait un tabac et un débat. Il s’est permis de refuser la légion d’honneur (il a raison, quand tous les zéros virgule cinq peuvent l'obtenir). Il paraît qu’il est brillant.
Pour être franc, l’économie n’est pas ma tasse de thé. Comme disait Bernard Maris (assassiné le 7 janvier, en même temps que Cabu et les autres de Charlie Hebdo) dans Houellebecq économiste, c’est une discipline jargonnante et prétentieuse, dont les adeptes énoncent leurs sentences obscures sur un ton péremptoire. S’il y a une « science économique », ce qui n’est pas sûr, elle fait partie, comme toutes les « sciences humaines », des sciences molles, par opposition aux sciences dures. Un pataphysicien, même novice, l’opposera fort pertinemment aux « sciences exactes », en la rangeant parmi les « sciences inexactes ». Le Collège de 'Pataphysique a si bien défini la chose qu'il existe en son sein une « sous-commission des sciences inexactes ». L'économie pourrait à bon droit se prétendre l'archétype de toutes les sciences inexactes.
C’est d’autant plus juste que lorsqu’on met quatre économistes en présence pour parler d’un sujet quel qu’il soit touchant leur discipline, ils ne tardent pas à en venir aux mains. Pour une raison très simple : l’essence de l’économie est éminemment politique. Elaborer une théorie économique revient à proposer une vision du monde, une philosophie de la société, une conception de l’humanité, un modèle d'organisation des collectivités humaines. Autrement dit : à faire de la politique. Il ne saurait y avoir d'économie sans politique, sinon l'économie serait une pure et simple machine, ce qui n'est évidemment pas le cas.
A cet égard, il n'existe donc pas de théorie économique sans prise de position politique : grosso modo, il y a ceux qui veulent exclusivement que la "machine" économique fonctionne au mieux, et en face, il y a ceux qui voudraient que l'économie apporte un peu de bonheur aux hommes et produise un peu d'harmonie sociale. Disons : les mécaniciens et techniciens contre les humanistes et philosophes. Entre les deux, des tas de "moyens termes". Deux races d'économistes définitivement irréconciliables. Pour les premiers, l'économie est une fin en soi - disons le mot : une idole ; pour les seconds, l'économie est un moyen (parmi beaucoup d'autres) que se donne l'humanité pour améliorer son sort.
Ce à quoi s’efforce Thomas Piketty (qui fait plutôt partie des seconds) dans son très gros livre, c’est de retracer l’histoire des inégalités depuis le début de la révolution industrielle (mettons à partir de 1800 - 1700 sur certains points -) jusqu’à nos jours (le livre est paru en 2013). On ne résume pas un tel ouvrage, vous pensez bien. Je peux tout au plus retenir quelques idées saillantes.
Piketty pilote son navire en braquant son gouvernail sur la question des inégalités. Sa thèse principale est que, après avoir été radicalement corrigées après la deuxième guerre mondiale, les inégalités sont reparties à la hausse depuis quarante ans. Une hausse vertigineuse. Constat confirmé ces derniers jours par Joseph Stiglitz (prix soi-disant Nobel d'économie, parution de La Grande fracture le 2 septembre).
Mais d’abord ce qu’il faut savoir de la sacro-sainte « croissance économique ». Gavés des chiffres de la "croissance" depuis la révolution industrielle, nous avons fait semblant d'oublier que, depuis l’antiquité jusqu’à 1700, elle a été à peu près nulle (environ 0,1 % par an). Et que le monde ne s’en est pas plus mal porté, puisque la population n’a cessé de croître. J’ai du mal à comprendre pourquoi la croissance économique est liée à la croissance démographique. L’auteur y insiste lourdement au début. Après tout, plus il y a de bras, plus la production peut augmenter. C’est peut-être ça.
Piketty dit surtout qu’une croissance de 1 % par an est loin d’être négligeable, quand on la mesure sur le temps long. J’ai la flemme de chercher la page, mais le pourcentage au bout de trente ans paraît proprement incroyable. Il dit enfin qu’une croissance lente (1 %) est en gros la règle, et que des 10 % comme a montré la Chine dans les dernières années doivent être considérés comme un « rattrapage », un rééquilibrage par rapport aux pays plus anciennement favorisés. Curieux comme les gens s'affolent parce que le chiffre est tombé à 7%.
La première notion que l’auteur établit est le « rapport capital / revenu », c’est-à-dire le rapport entre le stock de la richesse possédée et le flux des richesses produites. Ce rapport est mesuré en « années de revenu national » (en général 5 ans dans les pays industrialisés). J’envisage sans problème la différence entre stock et flux. La notion de rapport me laisse plus perplexe : si j’ai bien compris, le « rapport capital / revenu » indique le degré de dynamisme économique qui anime une société. Ou alors sa productivité ? Remarque, c’est un peu la même chose, non ? Je n’insiste pas (et je laisse de côté l’équation « α = r x β »).
La deuxième notion que je retiens, c’est la façon dont l’auteur découpe la population en « quantiles », façon que je trouve particulièrement éclairante, dès lors qu’il s’agit d’examiner comment les différentes couches de population évoluent les unes par rapport aux autres au cours du temps, en matière de richesse.
Piketty distingue ainsi les 50% les moins favorisés, les 40% des « classes moyennes », et le « décile supérieur ». Il n’hésite d’ailleurs pas à découper ce dernier : il montre que l'enrichissement de ces 10 %-là, depuis les années 1970, profite aux 9%, mais encore davantage au 1% supérieur de ce décile, et de façon encore plus mirifique au 0,1% qui tient le haut du pavé dans ce décile des privilégiés de la fortune. Stiglitz confirme : 85 milliardaires détiennent aujourd'hui 50% (je crois que c'est le chiffre qu'il a prononcé) de la richesse mondiale.
Piketty montre en particulier que plus on est riche, plus on s’enrichit. Et c’est mécanique. Il donne l’exemple des trois plus grandes universités américaines (Harvard, Yale, Stanford, je crois), qui trouvent des ressources grâce aux dons d’anciens élèves, mais qui arrivent à un maximum de profit en plaçant les fonds qu’elles détiennent.
Or en cette matière, plus gros est votre gâteau, plus vous avez les moyens de vous offrir les services des spécialistes les plus pointus des marchés financiers : consacrer 1 million de dollars pour payer cette équipe de conseil qui va vous faire gagner 100 millions grâce à ses compétences, c’est virgule de guillemet (ah, Achille Talon !) et queue de cerise (ah, Gil Jourdan !), comparé au gâteau. Les universités plus modestes ont moins les moyens de faire de l’argent avec leur argent. Inversement, plus on en a, plus on peut en faire.
L’effet est donc mécanique : les plus riches parmi les riches creusent l’écart avec les suiveurs, y compris les déjà bien riches. Leurs patrimoines atteignent la stratosphère à vitesse accélérée (exemples de Bill Gates et Mme Bettencourt), gonflés qu’ils sont par les revenus qui leur tombent dessus, venus de leur capital ou de leur éventuel travail, et qu’ils ne sont pas en mesure de dépenser en totalité, même avec de la bonne volonté. Ne sachant plus comment claquer leur fric, ils sont obligés d’augmenter chaque année le montant de leur épargne, au risque d’augmenter leur fortune, vous vous rendez compte ? Une vraie guigne.
Au passage, ça explique peut-être les montants extravagants atteints par certaines œuvres d’art chez Sotheby’s ou Christies.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, thomas piketty, le capital au xxi siècle, bernard maris, houellebecq économiste, science économique, collège de 'pataphysique, politique, société, cabu, charlie hebdo
mercredi, 02 septembre 2015
KADARÉ : LE PALAIS DES RÊVES
 MES LECTURES DE PLAGE 2
MES LECTURES DE PLAGE 2
C’est l’histoire de Mark-Alem Kuprili qui, grâce à l’appui de son oncle le Vizir, devient un fonctionnaire de l’Etat dans cette vaste institution qui s’appelle le « Palais des Rêves ». Nous sommes dans l’empire ottoman. Il me semble que le palais est évoqué dans La Niche de la honte. Ce roman est formidable, y compris au sens étymologique du mot. A cause de son actualité : nous ne vivons pas dans un régime totalitaire, mais.
Les Kuprili sont une vieille et grande famille qui a donné à l’Etat cinq premiers ministres et une foule d’autres serviteurs à des rangs moins en vue : « … cette famille qui, aujourd’hui encore, malgré son relatif effacement, demeurait l’un des piliers de l’Empire, la première à avoir lancé l’idée de la reconstruction du grand Etat sous la forme des E.U.O. (Etats-Unis ottomans), la seule famille, avec la dynastie impériale, à figurer dans le Larousse, et cela à la lettre K, avec la notice suivante : "KÖPRÜLÜ : grande famille albanaise dont cinq membres furent, de 1666 à 1710, grands vizirs de l’empire ottoman", famille à la porte de laquelle, enfin, venaient frapper timidement les hauts fonctionnaires de l’Etat pour solliciter protection, avancement, intercession en vue d’une grâce … ». Mon Larousse 1903 confirme à peu près, sauf qu’il date le début de cette puissante famille de 1656. Et qu’il orthographie le nom « Kupruli ou Koproli ».
Mark-Alem pénètre donc un jour dans ce fameux et redouté Palais des Rêves comme un tout petit fonctionnaire. La première impression est qu’il entre dans un désert absolument immense, où il a d’abord le sentiment angoissant de se perdre, tant à cause des dimensions prodigieuses de l’édifice que de l’absence totale d’indications qui lui permettraient de s’orienter.
Il tombe presque par hasard sur un responsable, qui semble ne pas le voir puis qui, ayant pris la lettre de recommandation donnée par l’oncle, la brûle instantanément : « Au Tabir Sarrail, on n’accepte pas les recommandations, c’est foncièrement contraire à l’esprit de cette institution ». Inquiet, Mar-Alem écoute la suite : « Le fondement du Tabir Sarrail est non point l’ouverture, mais, au contraire, la fermeture aux influences extérieures, non point l’ouverture, mais l’isolement, et, partant, non pas la recommandation, mais précisément son opposé. Malgré tout, à compter d’aujourd’hui, tu es nommé à ce Palais ». Que peut bien être l’opposé de la recommandation ? Passons.
Mark-Alem est d’abord affecté au service de la Sélection (pas tout à fait en bas de l’échelle, puisqu’il est supérieur aux simples copistes). Il s’assied à la place qui lui est assignée, tout comme les innombrables employés du service déjà au travail. Il s’agit de faire le tri, dans l’épais dossier qui lui est confié, des récits de rêves qui sont parvenus au Palais des endroits les plus reculés de l’Empire. Car tous les sujets sont tenus, lorsqu’ils font un rêve qui leur semble particulièrement signifiant, de rejoindre l’office de collecte le plus proche de leur domicile et de le raconter au fonctionnaire préposé à cette tâche, qui le transcrit fidèlement, et cela quel que soit le temps ou la saison.
La date, le lieu, le nom du rêveur sont soigneusement précisés sur la feuille. Un service de voitures a pour tâche exclusive de réceptionner régulièrement les rêves produits et de les acheminer à la capitale, où un personnel ad hoc est là vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les rassembler en de volumineux dossiers. Certains rêves recèlent un contenu tellement épouvantable que le cheval refuse obstinément d'avancer : une procédure exceptionnelle permet de le retirer et de le détruire.
La tâche de Sélection des rêves consiste à jeter les insignifiants et à conserver les autres pour les envoyer au service de l’Interprétation, auquel Mark-Alem ne tardera d’ailleurs pas à être affecté. Cette promotion l’étonnera. Mais la responsabilité est aussi plus grande : il s’agit de ne commettre aucun impair et aucune erreur, car le cheminement du rêve est soigneusement enregistré, étape par étape et fonctionnaire par fonctionnaire. Les erreurs d'appréciation peuvent être durement sanctionnées.
Les rêveurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri de sanctions : Mark-Alem assiste à l’interrogatoire de l’un d’eux. Les policiers du rêve veulent en savoir plus. Après plusieurs dizaines de pages de procès-verbal et plusieurs jours d’interrogatoire, il voit sortir du bureau un cercueil porté par quatre hommes. On pense évidemment à la Loubianka et aux méthodes du KGB.
Les rêves se rangent ensuite dans quelques grandes catégories thématiques, qui vont du simple délire et du rêve fabriqué jusqu’au complot contre l’Etat. Régulièrement, parmi les dizaines ou centaines de milliers de rêves ainsi collectés, se voit élire le « Maître-Rêve », indispensable au Sultan dans la bonne administration de l’Empire, pour prévenir les problèmes ou pour déjouer les manœuvres qui pourraient viser à l’affaiblir ou à le renverser.
On l’a compris, Le Palais des Rêves raconte sur le mode fictionnel, comment se met en place une Police de la Pensée dans un régime totalitaire. Les décisions concernant les hommes tombent de tout en haut sans que quiconque puisse en comprendre le motif. L’arbitraire règne en maître. C’est ainsi que Mark-Alem, du rang de minuscule fonctionnaire qui était le sien au début, finira par être bombardé Directeur Général du Palais des Rêves, sans comprendre les raisons d’une telle faveur.
Mark-Alem a compris que sa puissance apparente est éminemment fragile. Il pense en effet à son oncle le Vizir qui, peut-être enivré de sa position dominante, s’est permis d’organiser dans son palais une fête grandiose au cours de laquelle il comptait faire chanter la grande ballade albanaise en l’honneur des Kuprili.
La sanction n’a pas tardé : alors que la fête bat son plein et que les musiciens s’apprêtent à se produire, une foule d’hommes en armes fait irruption. Les trois musiciens sont poignardés, le Vizir emmené. On apprendra plus tard qu’il a été proprement décapité. Comme quoi il n’y a pas qu’à Rome que « la roche tarpéïenne est proche du Capitole ».
Ismaïl Kadaré semble avoir pour obsession littéraire la description méticuleuse de la façon dont s’installe et perdure un système totalitaire, et des méthodes qui sont les siennes pour terroriser la population : les yeux se font inquiets quand on évoque le Palais des Rêves, qui semble enveloppé d’un mystérieux brouillard de crainte.
Beau livre, qui m’a fait penser (pour ce qui est du thème) à La Niche de la honte et à La Pyramide, du même auteur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, albanie, enver hodja, dictature, empire ottoman, totalitarisme, police de la pensée, la niche de la honte, le palais des rêves, urss, kgb, loubianka, kadaré la pyramide
mardi, 01 septembre 2015
NE PAS DERANGER
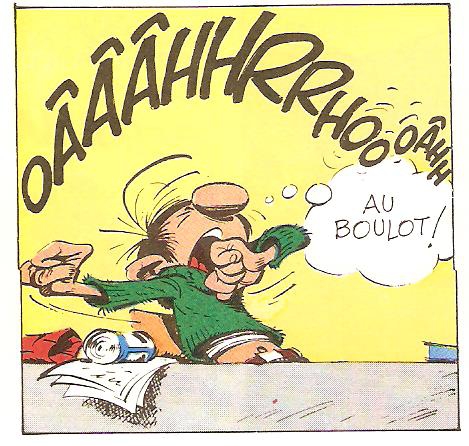
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gaston lagaffe, spirou, andré franquin, bande dessinée
lundi, 31 août 2015
KADARÉ : LE MONSTRE
 MES LECTURES DE PLAGE 1
MES LECTURES DE PLAGE 1
Je viens encore de lire un livre d’Ismaïl Kadaré, écrivain albanais qui a vécu sous la dictature communiste d’Enver Hoxha (Hodja), ce tyran qui a réussi à se brouiller avec ses copains Brejnev et Mao, sans doute pas assez méchants à ses yeux. Il est intitulé Le Monstre. Je n’ai rien compris à ce livre.
Présenté comme « le plus étrange et le plus original d’Ismaïl Kadaré », je l’ai personnellement perçu comme un livre compliqué. On nous dit, en quatrième de couverture, que « Le Monstre est un roman sur la terreur politique qui plonge un pays tout entier dans les affres ». Je veux bien, mais alors, il faut, de la part du lecteur, une grande prédisposition à la métaphore et à l’allégorie. Je suppose que je manque d'une prédisposition minimale.
L’action se situe de toute évidence à Tirana. Dans un vaste terrain vague, on voit un jour un vieux fourgon abandonné. Mais ce fourgon, n’est-ce pas plutôt un cheval ? Et plus précisément un énorme cheval de bois ? Dans le fourgon-cheval, en tout cas, logent une demi-douzaine de personnages : le Constructeur, Acamante (le seul apparemment qui ait le droit de sortir du cheval et d’aller dans le monde : il rapporte les journaux), Max, Milosh, Robert. Et puis, il y a Ulysse K. Au sol, dans le ventre du cheval, une vieille lance rouillée.
Et puis il y a l’histoire des amoureux, sur laquelle s’ouvre (presque, c’est le chapitre II) le livre : Gent Ruvina, promis à un brillant avenir, et à ce titre, qui est allé étudier à l’étranger, doit rentrer la queue basse en Albanie lorsque les relations avec Moscou se sont détériorées. De ce fait, il est auréolé d’un certain prestige. Il tombe amoureux de Léna, que tout le monde surnomme « Hélène de Troie », et avec qui il a échangé un vrai baiser lors d'une soirée. Mais si elle est plus belle que toutes les autres, elle n'est pas simple. Elle est promise à Max.
Quand elle se fiance officiellement à Max, Gent Ruvina décide de l’enlever (semble-t-il une coutume albanaise, mais on pense évidemment à Pâris, Hélène et Ménélas), le soir même, en l’emmenant dans un taxi, qui a stationné longuement sous les fenêtres, sans que personne ne se pose de questions. Max jure de se venger, et de planter la pointe de sa lance rouillée dans la poitrine de la promise et dans le dos du rival chanceux.
Gent Ruvina a commencé à travailler à une thèse sur les hypothèses qu’on doit pouvoir faire pour comprendre la signification du poème d’Homère, L’Iliade, en particulier la ruse du cheval en bois, que les Grecs ont manigancée pour affaiblir les défenses de la ville en endormant la méfiance des guerriers.
Ce livre entremêle le passé et le présent, le mythe et la réalité, l’ailleurs et l’ici, bref, il multiplie les doubles-fonds et les arrière-boutiques. Le lecteur que je suis a lu sans déplaisir ce curieux livre, tout en se demandant où l’auteur voulait en venir et ce qu’il avait derrière la tête.
Là-dessus, arrive un chapitre « rédigé » par Laocoon, ce Troyen qui ne croit pas à la sincérité des Achéens (« Timeo Danaos et dona ferentes », que reconnaîtront tous ceux qui ont sué sur L’Enéide), et qui finit par se mettre à dos le roi Priam en personne, précipitant la chute de la ville.
Laocoon, c’est ce personnage qui projette une lance qui va se ficher dans le ventre du cheval, faisant longuement résonner la structure, puis qui est puni de son audace, en mourant dans les anneaux du serpent envoyé par les dieux. Dans Le Monstre, on voit un petit Laocoon de la foule venue voir, se contenter de fracasser une bouteille de bière en la projetant sur la construction. On le retrouvera mort (ou peut-être pas).
Gent Ruvina épousera Léna. On les retrouve à la fin du livre, sur une route de campagne à l’écart de la ville, où l’on découvrira un couple qui a été assassiné : la femme, étendue sur le dos, porte dans la poitrine une horrible blessure provoquée par une arme étrange, sans doute de collection ou de musée. Une vieille lance rouillée ? Quant à l’homme, il porte sous l’omoplate une semblable blessure. Le meurtrier les a confondus avec nos « héros ». Au fait, j'oubliais de préciser que Léna est enceinte.
Bon, Tirana, c’est Troie, je veux bien. Max est Ménélas venu récupérer sa femme, je veux bien. Léna est Hélène de Troie, je veux bien. Mais pour le reste ? J'ai du mal à décalquer le mythe de Troie sur l'Albanie totalitaire. Je ne vois pas de cohérence dans la métaphore savante développée par l’auteur. Je me dis que les communistes d’Enver Hodja ont bien dû percevoir quelque chose d’une critique du régime, puisqu’ils ont interdit le livre à sa sortie en 1965. Mais bien des aspects du problème m’échappent. Je dois manquer de subtilité.
Il manque une notice explicative à ce livre décidément compliqué.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, le monstre, albanie, enver hodja
dimanche, 30 août 2015
GASTON

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 04 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
 « La parole date de la plus haute Antiquité. Qui ne se rappelle les tournois d’éloquence des Grecs et des Troyens devant les murs de Troie ? Les guerriers se sont lancé de magnifiques insultes. Les rois nègres, naguère, de colline à colline, s’entre-vitupéraient dans le style le plus grandiose. Les Peaux-Rouges. Les Apaches. Les automobilistes. Voire les marxistes-léninistes. Et même les époux en colère. Ils se traitaient, et se traitent même parfois encore, de chiens, de fils de chien, de fromage mou, de vipères lubriques, que sais-je ? D’affreux. De déviationnistes des droite. Les Arabes disent à leur ennemi : "Qu’Allah te change en vespasienne !". Les cochers de fiacres traitaient leurs clients de "veaux frisés", de "profil d’œuf", de "moules à confetti". Les paysans citaient de nombreuses maximes, les monarques avaient l’habitude de prononcer des paroles historiques, et les mourants des mots de la fin. »
« La parole date de la plus haute Antiquité. Qui ne se rappelle les tournois d’éloquence des Grecs et des Troyens devant les murs de Troie ? Les guerriers se sont lancé de magnifiques insultes. Les rois nègres, naguère, de colline à colline, s’entre-vitupéraient dans le style le plus grandiose. Les Peaux-Rouges. Les Apaches. Les automobilistes. Voire les marxistes-léninistes. Et même les époux en colère. Ils se traitaient, et se traitent même parfois encore, de chiens, de fils de chien, de fromage mou, de vipères lubriques, que sais-je ? D’affreux. De déviationnistes des droite. Les Arabes disent à leur ennemi : "Qu’Allah te change en vespasienne !". Les cochers de fiacres traitaient leurs clients de "veaux frisés", de "profil d’œuf", de "moules à confetti". Les paysans citaient de nombreuses maximes, les monarques avaient l’habitude de prononcer des paroles historiques, et les mourants des mots de la fin. »
Alexandre Vialatte, « Chronique de la parole et parfois de la pensée ». Dans La porte de Bath-Rabbim, textes choisis et préfacés par Ferny Besson, Julliard, 1986.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagnela porte de bath-rabbim, ferny besson, humour
lundi, 03 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
 « Qui ne disparaît ? Nous vivons par hasard.
« Qui ne disparaît ? Nous vivons par hasard.
J’avais dix-huit-mois quand ma mère vit mes deux pieds qui dépassaient d’une lessiveuse. On connaît la bonté des mères. Elle les saisit immédiatement, me sortit de l’eau, me fit sécher au four et me replaça debout sur la route de la vie. C’est à cette circonstance fortuite que je dois de pouvoir signer mes différents travaux. Sans elle on eût été forcé de les donner sous un pseudonyme, ou de les publier comme posthumes, ou sous le manteau de l’anonymat. »
Alexandre Vialatte, « La clef des songes », La Montagne, 23 août 1970.
Dans Profitons de l’ornithorynque, Julliard, 1991.
Note : je cite le tout début de la chronique en question.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, éditions julliard, humour

