mardi, 07 janvier 2014
7 BALZAC : LA PAIX DU MÉNAGE
Le troisième volume de l’édition complète de La Comédie humaine parue au Cercle du Bibliophile recueille une douzaine de nouvelles de dimensions variées. J’avais déjà évoqué la première, dont le titre espagnol – El Verdugo (« Le Bourreau ») – indique assez, sinon une volonté d’exotisme, du moins un souci de « couleur locale ».
Pour en rappeler brièvement la teneur, je dirai juste que cela se passe pendant la guerre de Napoléon en Espagne, dans le château du marquis de Léganès, « hidalgo » distingué en même temps que « grand d’Espagne ». Un détachement français est proprement massacré par les partisans, sauf un jeune officier qui parvient à s’enfuir (prévenu par la fille de la maison qui l'a trouvé mignon).
La vengeance du général « G…t…r » est terrible : la famille entière est condamnée à mort. Mais dans un sursaut de bonté sadique, il accorde au noble vieillard la survie de son nom à travers son fils, à condition que celui-ci se fasse le bourreau de tous les siens et leur coupe la tête. Court récit sec, net et violent, dramatique et spectaculaire. Un coup droit dans l'estomac.
Bien loin de cette ambiance intense de sang, de larmes et de frissons, La Paix du ménage nous introduit dans un grand salon parisien, au cours d’un bal prestigieux donné par un grand personnage de l’Empire (on est en 1809), le « citoyen Malin » devenu comte de Gondreville, sénateur et ami de Napoléon. C’était l’époque où, écrit Balzac, « l’engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie, et concorda trop bien aux vues de l’empereur pour qu’il y mît un frein ». La phrase sent son épigramme rétrospective. Peut-être aussi un regret pour un temps qu'il n'a pas connu.
Dans la foule formée par cette somptueuse et splendide société, et après avoir établi tout le cadre historique et social, Balzac braque le lorgnon du lecteur sur quelques individus choisis, entre lesquels l’intrigue est savamment circonscrite, et qui, s’observant mutuellement avec une attention qui a quelque chose de sauvage, sauront interpréter le moindre des regards des autres protagonistes pour en tirer des conclusions sur les intentions des uns et des autres et sur l’état de leurs relations. L'évocation de ces regards dans le récit est en soi un petite merveille de mise en scène romanesque.
Deux amis, le baron Martial de la Roche-Hugon et le général Montcornet font le pari d’être chacun le premier à mettre dans son lit une femme mystérieuse, très belle quoique très mélancolique, restée à l’écart près d’un candélabre, avec toutes les apparences de la tristesse, voire de la souffrance. Personne ne semble la connaître.
Le baron est l’amant en titre de Mme de Vaudremont, l’une des plus belles femmes de Paris, jeune et belle veuve d'un militaire mort bravement, dont le plus grand souci est de n’apparaître, pour faire contraste, qu’au moment du bal où les autres femmes ainsi que leurs toilettes apparaissent déjà un peu fatiguées.
Elle semble s’intéresser à un autre militaire, le général comte de Soulanges, soit par jalousie (elle surprend son amant Martial empressé auprès de la belle inconnue), soit par inclination (le monsieur a de la prestance). Mais sur le conseil avisé de la duchesse de Lansac, vieille renarde rusée (« volpa astuta », comme dit Leos Janacek) des salons parisiens, qui fut, dit-on, maîtresse de Louis XV, elle se laisse détourner de l’amant en titre, informations désobligeantes à l’appui (« Il a des dettes »), pour s’intéresser, si elle veut du « solide », à Montcornet.
Puis la vieille duchesse se débrouille pour se faire raccompagner chez elle par Soulanges, qui se révèle n’être autre que le mari de la belle inconnue, qui s’apprêtait à brûler spectaculairement la cervelle de La Roche-Hugon, qui, à son goût, serre son épouse d’un peu trop près pour être honnête. Mais il n’en aura pas le temps, et qui plus est, sa crainte est infondée, puisque sa femme n’est venue (incognito) à cette soirée que pour reconquérir son époux volage en suscitant sa jalousie.
Et quand elle rentre chez elle, après avoir repoussé les avances du piètre La Roche-Hugon, au moment où elle pénètre dans sa chambre, elle est très surprise et bien heureuse d’y trouver son mari installé qui, sans doute sermonné par la vieille Lansac, juge plus sage de se réconcilier avec sa femme. « Tout est bien qui finit bien », comme il est dit à la fin du Trésor de Rackham le Rouge (c'était juste pour ça, l'illustration du début).
Une magnifique nouvelle, toute en subtilité, du jeune Balzac. Un bel exercice d’observation du monde, et une intrigue assez ramassée pour que la construction, sans une once de gras, en paraisse aussi savante qu’économe en moyens. Suprême habileté du futur grand romancier. Délectable d'intelligence.
Moralité : il faut lire Balzac.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la comédie humaine, la paix du ménage
mardi, 24 décembre 2013
6 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
Balzac a truffé sa Physiologie du mariage de choses succulentes. Tenez : « Avoir de la jalousie pour une femme dont on est aimé constitue de singuliers vices de raisonnement. Nous sommes aimés ou nous ne le sommes pas : placée à ces deux extrêmes, la jalousie est un sentiment inutile en l’homme ; elle ne s’explique peut-être pas plus que la peur, et peut-être la jalousie est-elle la peur en amour. Mais ce n’est pas douter de sa femme, c’est douter de soi-même.
Être jaloux, c’est tout à la fois le comble de l’égoïsme, l’amour-propre en défaut, et l’irritation d’une fausse vanité. Les femmes entretiennent avec un soin merveilleux ce sentiment ridicule, parce qu’elles lui doivent des cachemires, l’argent de leur toilette, des diamants, et que, pour elles, c’est le thermomètre de leur puissance ». Les psychologues, psychiatres et autres psychanalystes ne pourront pas dire qu’on ne leur a pas mâché la besogne : ils n’ont eu qu’à lire Balzac.
Alors l’amour, parlons-en. Il semble que pour lui, l’expression « amour conjugal » soit un oxymore, tout comme « soleil noir » (Nerval, dans El Desdichado) ou « feu glacé » (Shakespeare, dans Roméo et Juliette). C’est en tout cas ce qu’il veut montrer dans la nouvelle intitulée La Maison du chat qui pelote (j’en parlerai plus tard). Pour lui, si l’on épouse sous l’empire exclusif de la passion amoureuse, il faut s’attendre à de sévères déconvenues. Augustine, l’héroïne de ce récit, aura vécu au total dix-huit mois de bonheur consommé. Après ...
Dans la Physiologie, il accorde au couple une rallonge d’autant, ce qui nous mène à trois ans de parfait amour. L’époque moderne, avec les trois ans qu’elle prête en durée aux plus belles passions, croyait avoir inventé quelque chose de nouveau : c’est raté. Comme la plupart du temps, elle ne fait que recycler quelques déchets du passé dont, en les rhabillant aux couleurs de la mode du jour, elle s’enorgueillit à tort d’être la génitrice géniale et généreuse.
Cela me fait penser à ce mien proche qui voulait à toute force me convaincre du génie d’Antoni Gaudi (Barcelone), que j’admirais depuis belle lurette. J’ai beau le savoir, je m’étonne toujours que certains s’ingénient à croire que le monde est né avec eux. Pour dire que l’époque moderne a un vrai problème avec le passé. Ce n’est pas pour rien que l’épidémie symbolique du futur qui nous guette s’appelle la maladie d’Alzheimer. Bref.
Une fois écoulées les trois années de « Lune de Miel » (titre de la Méditation VII), aucun mari ne doit s’étonner de voir apparaître les « premiers symptômes » (titre de la Méditation VIII) du mal qui guette le moment propice de contaminer l’épouse et qui risque prochainement de le « minotauriser » (selon le Robert historique, le terme a été créé par Balzac), c’est-à-dire de transformer son front lisse en trophée de chasse au cervidé pour tous les célibataires passant à proximité de sa femme.
C’est même écrit noir sur blanc : « Deux personnes se marient-elles, les sbires du Minotaure, jeunes et vieux, ont tous ordinairement la politesse de laisser entièrement les époux à eux-mêmes. Ils regardent un mari comme un ouvrier chargé de dégrossir, polir, tailler à facettes et monter le diamant qui passera de main en main, pour être un jour admiré à la ronde ». Il faudrait citer tout le paragraphe. Et dire que certains (suivez mon regard jusqu’à avant-hier) prétendent que « Balzac ne sait pas écrire » ! Elle peut toujours s’aligner, tiens !
On pourrait se scandaliser du regard que Balzac jette, d’une part sur les femmes (un simple objet, fût-il précieux, passant de main en main), d’autre part sur les hommes cocufiés (qui sont la risée de tous), et critiquer sa misogynie autant que le pessimisme de sa philosophie. Mais n’évoque-t-il pas quelque part le cas de ce jeune homme qui, à vingt ans, a « jugé le monde » et qui, en décidant d’en tirer le meilleur parti possible pour lui-même, a opté pour la voie décidément la plus raisonnable ? Comme il écrit (dans la Méditation XXVIII) : « Hélas ! mes frères, nous n’avons pas fait la nature ! ».
Partant de ce principe, le célibataire attend sagement « le moment où les époux commencent à se lasser du septième ciel ». Un signe qui ne trompe pas, à ses yeux, après le temps suffisant où le couple se sera retiré du monde pour jouir pleinement de sa félicité et se gaver du corps de l’autre et du plaisir qu'il en tire, c’est lorsque il émerge enfin de sa Thébaïde enchanteresse : « Du moment où vous reparaissez, ensemble ou séparément, au sein de la société, que l’on vous voir assidus l’un et l’autre aux bals, aux fêtes, à tous ces vains amusement créés pour fuir le vide du cœur, les célibataires devinent que votre femme y vient chercher des distractions ; donc, son ménage, son mari l’ennuient ».
S’ensuivent tous les signes montrant l’évolution de la situation : « Jamais vous ne l’aurez vue plus soigneuse à vous plaire. Elle cherchera à vous dédommager de la secrète lésion qu’elle médite de faire à votre bonheur conjugal, par de petites félicités qui vous font croire à la perpétuité de son amour ; de là vient le proverbe : Heureux comme un sot ». Si ceci n’est pas savoir écrire, alors je me fais moine trappiste. Sachez qu’il m’en coûterait, pour deux ou trois raisons qui ne regardent que moi, et que je n’ai donc pas à exposer ici.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 23 décembre 2013
5 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
Physiologie du mariage se présente sous la forme de trente « Méditations de philosophie éclectique », réparties en trois blocs à peu près égaux : « Considérations générales », « Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieur » et, pour couronner le tout, « De la guerre civile » (!). L’ensemble fait trois bonnes centaines de pages, dont la lecture est rendue réjouissante, du fait de la variété de la composition, où ruptures de ton, de registre ou de mode de narration alternent savamment les images et les leçons.
L’ensemble est parsemé d’ « aphorismes », souvent loufoques, parfois étranges, tel le cinquième : « Une femme qui fait la cuisine dans son ménage n’est pas une femme honnête ». Certains sont frappés au coin du bon sens : « Physiquement, un homme est plus longtemps homme que la femme n’est femme », même si ça ne plaira pas à toutes les ménopausées qui s’efforcent de rester fraîches, minces et lisses à coups de cosmétiques, de lifting, de jogging, de magazines féminins, de club de remise en forme (step, rameur, vélo d'appartement ...) et de surveillance du contenu de l’assiette. Remarquez, soit dit à leur décharge (si j’ose dire), les journaux font régulièrement des « sujets » sur ce qui se passe en matière de sexe dans les maisons de retraite, alors ...
Il faut préciser que Balzac différencie la femme « honnête » de la « vertueuse », et là j’avoue que, pour moi du moins, l’auteur se complaît à entretenir, sinon le paradoxe, du moins un certain flou. Il consacre pourtant un chapitre à chacune, et fait semblant de poser la question de savoir « si une femme honnête peut rester vertueuse ».
Son livre ne s’adresse pas à n’importe qui. Il faut se retenir de rire ou de se mettre le doigt sur la tempe à la lecture des « statistiques » que Balzac bricole en prétendant « cerner » son sujet. « Plaisanterie », ai-je d’abord envie de dire. Il aurait pu en effet s’épargner la peine de fabriquer des chiffres hypothétiques, et déclarer simplement que son propos était circonscrit à ce qui se passe dans la haute société, c’est-à-dire celle qui s’offre à ses yeux d’observateur redoutable. Les femmes du peuple, ce n'est pas sa tasse de thé. S'agissant de thé, il ne trempe ses lèvres que dans les porcelaines de l'élite. C'est une image.
Pour entrer dans son « échantillon représentatif », il faut en effet, sinon posséder un hôtel particulier, du moins avoir assez de moyens pour vivre dans le luxe, avec domesticité nombreuse, ameublement raffiné, équipage splendide et relations au ministère et à la Chambre. C’est en effet dans ce milieu que le regard des autres, impitoyable, est capable de percer en un clin d’œil les moindres secrets d’alcôve, et la germination éventuelle de ces excroissances cervidoïdes, à quoi se reconnaît l’inconduite des épouses.
Pour obéir en quelque sorte à la scientificité (réelle ou fictive) affichée par le titre (l’ouvrage se présente comme un traité de médecine : « Physiologie »), les titres des chapitres s’affublent souvent de déguisements scientifiques : « Statistiques conjugales », « Théorie du lit », où le caractère facétieux de l’auteur s’expose ouvertement.
Soit dit en passant, ce n’est pas pour me vanter, mais on trouve dans la Méditation XXII le mot qui donne son titre à ce blog : « Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque [c’est moi qui souligne, évidemment] dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes ». Je rappelle que ce terme, formé de racines grecques, est le synonyme exact d’ « antidote », « contrepoison », « alexi- » voulant dire « qui protège » (dans Alexandre, par exemple), et « pharmaque » signifiant « poison » (comme dans « pharmacie »).
Parmi tous les hommes qui risquent de faire franchir aux épouses la barrière de leur vertu, l’ennemi public du mari, celui qui selon Balzac, a des chances de brandir l'épouse comme un trophée, c’est, en tout et pour tout, le « Célibataire ». Mais pas n’importe quel célibataire : en termes de statut social et d’aisance matérielle, rien ne le différencie de l’époux (comme on le voit dans l’illustration ci-dessus). La seule différence, c’est qu’il n’est pas marié, lui.
L’amusant dans l’affaire, c’est que Balzac ne s’est jamais marié, sauf à la fin de sa trop courte vie, après avoir pendant des années fait le siège de l’élue de son cœur, Madame Hanska. Même si son aspect n’avait rien à voir avec le portrait de la gravure, ça en dit long sur la façon dont il considérait les femmes des autres. Sa première conquête d’importance (au grand dam de sa propre mère) fut d’ailleurs une femme mariée, même si le mari avait eu la bonne idée de mourir avant, ce qui caractérise en général la situation des veuves.
En se permettant de devenir le « conseiller conjugal » des maris inquiets, et tout en montrant qu’il connaissait son sujet, Balzac se payait donc le luxe de se moquer d’eux en se donnant l’air de venir à leur secours. Ce n’est pas sans raison que le livre, à parution, suscita quelque émotion.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, balzac, physiologie du mariage, adultère
dimanche, 22 décembre 2013
4 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
Disons-le d’entrée de jeu : Physiologie du mariage n’est pas un roman. Le sous-titre éclaire déjà davantage la question : « Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal ». J'admire la triple ironie contenue dans "méditations", dans "éclectique" et dans "philosophie". Ce n’est donc pas un roman, mais ça n’empêche pas le livre d’être un merveilleux bijou de vachardise (voire de férocité à l’occasion).
L’auteur, célibataire endurci de tout juste trente ans quand paraît son « Traité », propose aux maris tous les moyens imaginables de se prémunir contre le risque inhérent, voire consubstantiel à l’institution maritale et à la vie dans l’état conjugal : le cocuage. Il fait semblant de leur donner tous les conseils pour ne pas avoir un jour « du cerf sur la tête » (Brassens, Le Cocu). Ce n’est pas pour rien que Balzac ne s’est marié qu’à la toute fin de son existence, et l’on peut admirer ici un formidable catalogue d’observations, par lequel il prétend faire le tour de la question en même temps qu’épuiser le sujet.
Il est certain que l’ouvrage a acquis un intérêt plus historique que pertinent dans le contexte actuel : le mariage, le régime matrimonial, la famille étant devenus ce qu’ils sont, une grande partie des remarques de l’auteur tombe à plat, si on les regarde avec l’œil des générations actuelles, habituées à obéir à leur moindre désir avant même d’en savoir davantage sur son origine, sa destination, ses conséquences et diverses considérations auxquelles seuls les plus anciens sont désormais accessibles.
Je veux dire que l’institution du mariage est devenue un supermarché où chacun trouve un produit à sa convenance, un produit dont une enquête marketing fine a permis de dessiner le « profil » adapté à sa « cible »; on pourrait dire aussi qu’elle est devenue un restaurant dont la carte proposerait tous les menus et tous les plats qu’il est possible de manger sur notre planète. Je veux dire évidemment que la notion même d’institution a pris du plomb dans l’aile, et que ce qui reste de son corps décharné agonise dans la liesse générale.
Pendant ce temps, une ribambelle de doctes intitulés « penseurs » et de cuistres autoproclamés « intellectuels », s’interrogeant sur le délitement du lien social et les moyens de le retisser, pondent des thèses sur le Progrès indéniable que constitue l’évolution dans les mœurs, tout en accompagnant, si ce n’est en précédant ou provoquant, par le contenu de leur « pensée », le dit délitement.
Michel Foucault et Pierre Bourdieu, entre beaucoup d’autres, ont fondé leur renommée sur leur talent à structurer et théoriser leur haine de l’ordre social, et en le « déconstruisant » patiemment et méthodiquement, pour en dégager et extirper l’insupportable odeur d’arbitraire. Jusqu’à faire découvrir au bon peuple ébahi, comme si c’était une nouveauté révolutionnaire, que la « culture » se différencie radicalement de la « nature », vieux cours de philo pour classes terminales d’après-guerre.
A cet égard, Physiologie du mariage apparaîtra, aux yeux des thuriféraires de cette « société en mouvement » (on se demande autant ce qu’est une société en mouvement : une société statique, ça n’existe pas, du moins aussi longtemps que les membres en sont en vie), comme un livre abominablement suranné, tout juste capable de motiver et d’intéresser je ne sais quel boutonneux soucieux d’accéder pas trop tard à une chaire en Sorbonne. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j’ai refermé le livre, c’était comme si je m’étais abreuvé à la source Hippocrène. C’est sur le mont Hélicon, près de Thespies. Ah, le sabot de Pégase ! Je veux dire que je m’y suis « ressourcé ».
D’abord parce qu’on y retrouve une société où un partisan des institutions n’était pas encore considéré comme un ennemi public à anéantir. Ensuite parce qu’on sait, après ça, ce que c’est que la littérature. Et dire qu’il y a des gens d’un goût apparemment très sûr prêts à soutenir que « Balzac ne sait pas écrire » (citation d’un propos récemment entendu dans la bouche de quelqu’un d’éminemment sensé). N’en veuillons pas trop à la personne : de même que quelqu’un a dit : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc, XXIII, 34, traduction du chanoine A. Crampon), certains ne savent pas ce qu’ils disent, et il ne serait pas charitable de leur en tenir rigueur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, physiologie du mariage, comédie humaine
vendredi, 20 décembre 2013
UN FOU REMARQUABLE

Il n’y a pas que Balzac, dans la vie. Voici pour le prouver de quoi alimenter l’insatiable curiosité des curieux (curiosité dont le métier est généralement de faire de l’auto-allumage : comme chacun sait, la curiosité, cette invention, mère de la créativité et moteur de l’action, ne se décrète pas : elle se sécrète). C'est parti.
« LE PÉCHÉ ORIGINEL
« Pécer ou pesser = pisser. Pé ce t’ai, pesse t’ai, pester. La petite beste pestait. En pesse t’ai, empestait. Ai ce, p’ai ce ; ai ce pesse, l’esse pesse, l’espèce. Toute esse pesse de toute espèce ; le pécé ou le péché empestait, c’est l’origine du pessimisme : pesse i m’ai, isse-me. Pécer ou pesser se retrouve dans la bouche des enfants pour pécher.
« Péch’ai, péche ai, pécher, péché. Péche ai heure, pêcheur ; péche ai raie-ce, pécheresse. Le péché offrait son eau au bec pissant ou péchant contre les règles de l’art. On pisse ou pèche contre. Il a péché queue on treu moi ; celui qui avait fait cela était violemment repoussé et chassé. Tu eau fais en ce dieu ou lieu, tu offenses Dieu.
« Les premiers êtres se promenaient avec leur aspergès et lançaient leur eau de tous côtés ; cela alla encore chez les prêtres ; mais les dieux, nés d’une mère, s’en indignèrent, et le péché à la figure des gens fut honni. Celui qui pisse en face de nous, nous offense, car le péché offense Dieu et d’yeu, ton œil. Le nom de péché fut donné plus tard à tout ce qui était répréhensible, mais le premier et le vrai péché vient du bénitier, lançant son eau que c’était une bénédiction. (…)
« Eau r’ai, aure ai, aurer, orer. Eau d’aure ai, odorer. L’eau d’aure odorait. A l’aure ai ore, à l’aurore, les anges offraient leur eau du matin, en présentant leur auréole, ore ai eau le, aure ai haut le. L’auréole était formée par la peau du prépuce découvrant le gland. L’homme étant un ancien membre, le diable met une auréole sur le sommet de la tête de ses saints pour désobéir au grand Dieu tout-puissant qui défend les idoles ».
Ce ne sont que quelques-unes des délicieuses "fariboles sidérales" (l'expression est le titre d'une excellente et méconnue BD de Lacroix, alias Alias) et sidérantes qu’on trouve dans un livre en général connu des seuls spécialistes, et je me permets de trouver ça regrettable : Les Origines humaines. L’auteur, dont le nom ne devrait lui aussi être connu que de rares initiés, est néanmoins plus répandu, car André Breton a jugé bon de le faire figurer dans un livre célèbre quant à lui : L’Anthologie de l’humour noir, et cela, bien qu’il s’agisse d’André Breton le pontifiant pontificateur, n’est pas injuste.
Brisset est encore l’auteur de La Grammaire logique, plus fastidieux à la lecture : il faut imaginer par le texte ci-dessus les mauvais traitements qu’il fait subir à l’objet qu’il se propose d’y traiter. Il occupe une place éminente dans une confrérie, une tribu injustement obscure : les bien nommés « Fous Littéraires », confrérie à laquelle le très savant André Blavier a consacré un très savant et très copieux (in-quarto de 1147 pages) ouvrage, très pertinemment intitulé Les Fous littéraires (Editions des cendres, 2001).
Pour se faire une idée du genre de folie dont il s'agit, le lecteur peut se replonger dans le trente-huitième chapitre du Tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel, « composé par M. Fran. Rabelais, Docteur en médicine », qui expose « Comment par Pantagruel et Panurge est Triboullet blasonné ».
A ce propos, je ne résisterai jamais au plaisir de rappeler l'histoire narrée au chapitre précédent, où Rabelais expose l'histoire jubilatoire de Seigny Joan, fou appelé pour arbitrer le différend entre le rôtisseur et le faquin qui mangeait son pain en le parfumant « à la fumée du roust », et qui déclare, en véritable nouveau Salomon, après avoir fait sonner deux pièces d'argent : « La Court vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roust civilement a payé le roustisseur au son de son argent ».
Parmi ce déluge de façons pour l'esprit humain de battre la campagne (plus de 200 sortes de fous), qui place le lecteur dans le plus grand embarras quant au choix, ma préférence, très variable selon les jours et les circonstances, ira pour cette fois au « Fol bien mentulé » et au « Fol de haulte fustaie », avec une mention spéciale pour le dernier de la liste : « Fol a espreuve de hacquebutte ».
L’éditeur de Blavier prend soin de préciser que le motif de couverture est inspiré de « bois gravés d’après les dessins de Dürer illustrant ʺLa Nef des folz du mondeʺ de Sébastien Brandt (1497) ». Dans l’édition que je détiens de la dite Nef des fous, la gravure d’Albrecht Dürer, complète cette fois, et 29ème d’une richissime série, figure à la page 73 (Editions de la nuée-bleue, 1977, traduction de Madeleine Horst).
On a appelé « fous littéraires » toutes sortes d’écrivains. André Blavier s’efforce de classer les membres de cette famille inclassable selon leur mode et leur domaine d’inspiration. Le Sommaire indique quelques-unes des catégories retenues : « prophètes, visionnaires et messies », « astronomes et météorologistes », « philanthropes, sociologues et casse-pieds », « persécutés, persécuteurs et faiseurs d’histoires(s) », etc. L’auteur en dénombre ainsi une treizaine au total.
Pour donner un exemple, voici ce que déclare un certain André Dodet, dont l’auteur place une citation en épigraphe de son chapitre hautement moral « Médecins et Hygiénistes » : « La crasse forme un revêtement protecteur ». Le nommé Cornay n’a rien à lui envier, qui déclare : « La formation des rides repose sur les impulsions cérébrales. (…) Les rides demi-circulaires indiquent la franchise … les rides horizontales indiquent l’ambition, etc. », non plus qu’Augustine de Baralle : « La nature a mis dans chaque femme un utérus plus ou moins perfectionné ». Le réservoir est à peu près inépuisable.
Mais dans ce parterre de fleurs où chaque individu forme en soi une espèce unique, Jean-Pierre Brisset détient sans conteste la palme qui revient au vainqueur : « Jeu m’ai ou yeu, je mets ouille, je mouille. B’ai ou yeu, b’ai ouille, bouille. Bouille ai on, Boue y ai on, bouillon. Bouille ai, one ai ente ; bouillonnante. L’eau des mares bourbeuses fut le premier bouillon. Les ancêtres bouillants, bout y ai en, s’y tenaient dans les eaux bouillonnantes. Queue où yeu, coup yeu, couille = coule. Couille ai on, le couillon ne pouvait entrer et restait à la porte. C’est là qu’ai un nœud ouille ; c’est la queune ou yeu, c’est la quenouille. Chéant t’ai, peux ou yeu ; chanter pouille. On ce d’ai, pouille ai ; on se dépouillait. D’ai pouille au pime, dépouilles opimes. C’étaient les parties sexuelles des vaincus. C’est avec de telles dépouilles que David obtint Mical, fille de Saül (1 Sam. 18, 27). On ce, à jeune ai où yeu ; on s’agenouille ».
Ce n’est pas pour rien qu’un certain nombre de gens sérieux et gais, par exemple à La Ferté Macé, dans l’Orne, où il a fini ses jours, continuent à rendre hommage à celui qui fut surnommé « Prince des penseurs ». Par exemple en posant une plaque en l'honneur du « Pas sage Jean-Pierre Brisset ».
De quoi se réjouir en toute innocence en ces temps de disette morale et politique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les fous littéraires, andré blavier, jean-pierre brisset, la ferté macé, les origines humaines, la grammaire logique, littérature, péché originel, andré breton, anthologie de l'humour noir, pape du surréalisme, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, la nef des fous, sébastien brant, albrecht dürer
mardi, 17 décembre 2013
3 BALZAC : LES CHOUANS
Dès le début des Chouans, on est dans une ambiance de guerre : la colonne de Hulot marche vers le sommet de La Pèlerine, emmenant la troupe des conscrits que Fougères devait fournir à la République, et qu’on a eu les pires difficultés à recruter. On est en 1799.
Sur le plan romanesque, je comprends mal le surgissement de Marche-à-Terre sur la route : Balzac aurait voulu mettre la puce à l’oreille de Hulot, il ne s’y serait pas pris autrement. Or, qu’est-ce qu’une embuscade, je vous le demande ? Car c’est sa présence qui incite le chef à la méfiance et à la prudence, et qui permettra aux soldats de ne pas être anéantis. D’accord, ça permet à Balzac de planter ce personnage central, mais bon.
Une scène assez marrante se déroule ensuite : les Chouans attendent plus loin sur la route une voiture (une « turgotine ») pour la piller. Il paraît qu’elle recèle une coquette somme en or. Cette idée de pillage, qui fait horreur au « Gars », gentilhomme chevaleresque, est défendue par Madame du Gua, l’autre figure royaliste du roman : « Mais d’où venez-vous donc, pour croire que vous vous servirez des Chouans sans leur laisser piller par-ci par-là quelques Bleus ? Ne savez-vous pas le proverbe : ʺVoleur comme une chouetteʺ ? Or, qu’est-ce qu’un Chouan ? ». C’est vrai, on dit que « Chouan » est fait sur « chat-huant », mais est-ce bien sûr ?
Or le drôle de l’affaire, c’est que l’or trouvé dans la voiture appartenait à la dite Madame du Gua, et il est trop tard pour elle pour courir après les pillards, qui se sont égaillés dans la nature. On retrouvera beaucoup plus tard un autre personnage pittoresque, qui se cachait comme un vil pleutre tout au fond de la turgotine : monsieur d’Orgemont, de Fougères, dont la maison recèle une particularité tout à fait romanesque, prouvant que la Révolution a honteusement engraissé un certain nombre de gens malins. Il est vrai qu’il manquera alors de se faire griller les pieds par quelques Chouans qui veulent lui faire avouer où il cache sa caverne d’Ali Baba.
Je laisse de côté tout ce qui se passe dans l’auberge où ce petit monde se retrouve (Bleus, divers voyageurs et, dans l’ombre, les Chouans), en notant juste l’art avec lequel Balzac met le lecteur dans l’ambiance de vigilance méfiante et prudente qui habite et guide tous les personnages dans leurs propos : personne ne sait à qui il a à faire, et nul ne peut se fier à quiconque. Je recommande aussi le dialogue de joute amoureuse que l’auteur met dans la bouche du Gars et de Marie.
Je m’attarde juste sur le personnage de Francine, une Bretonne, la dame de compagnie de Marie de Verneuil, l’envoyée de la République en général et de Fouché en particulier. Il se trouve que Francine est la fiancée de Marche-à-Terre, qui se prénomme Pierre. Elle surprend la fin des consignes que Madame du Guâ donne à ce dernier, dont Francine obtient la promesse qu’il épargnera la vie de sa maîtresse, à qui elle doit tout.
Les circonstances feront qu’il tiendra sa promesse mais, si je puis dire, sans l’avoir voulu. Hulot a donc envoyé sa démission au Directoire, pour cause de commandement féminin. Ses deux amis, Gérard et Merle, qui commandent la troupe en son absence, se laissent attirer au domaine de La Vivetière, château de Madame du Gua. Le guet-apens est si évident que le lecteur se demande pourquoi les Bleus se laissent ainsi manger sans réfléchir. Excès d’une confiance curieusement placée.
Car c’est au château que se trouve réunie toute la conspiration royaliste et, pendant que les soldats s’endorment en toute quiétude, les taillis alentour se peuplent d’une faune chouanne armée jusqu’aux dents, et qui n’attend qu’un signal pour passer à l’action. Je passe sur les péripéties. Les deux officiers sont assassinés, comme la soixantaine d’hommes qui ont cru en la parole de gentilhomme du marquis de Montauran, le « Gars ».
Balzac à cette époque est loin d’être légitimiste : excepté Montauran, les royalistes de la rébellion chouanne n’ont aucune dignité, et sont présentés comme de petits comploteurs de bas étage, comme on le verra plus tard lors du bal organisé à Saint-James, où leurs âmes basses s’inquiètent auprès du Gars de ce qu’ils recevront du Roi en retour de leur « dévouement ».
Marie de Verneuil échappe presque par miracle au carnage, et parvient à s’enfuir avec Francine dans une voiture conduite par un postillon terrorisé. On la retrouvera retranchée à Fougères, où Corentin lui a trouvé une maison à louer, et où la garnison a retrouvé son Commandant en la personne de Hulot, dont la démission a été refusée.
J’ai omis de parler de Corentin. Ce n’est pas très grave, parce que le personnage, s’il apparaît très régulièrement, ne joue qu’un petit rôle dans la mécanique du roman. C’est l’espion chargé par Fouché de superviser toute l’opération dont Marie est l’instrument, et de veiller à la mener à bonne fin.
En dehors de sa manigance pour tendre un piège au Gars (une fausse lettre de lui à Marie), le seul intérêt qu’il présente est l’aversion totale à son égard manifestée par Hulot. Le fait que Balzac lui prête l’ambition et l’espoir de convoler un jour avec Marie ne parvient guère à lui donner de la consistance.
Le militaire, à l’esprit direct et droit, et le policier, armé de ruses et de calculs, ne sauraient se comprendre, tant ils voient l’action différemment. Ils se sépareront à la fin sur cette parole de Hulot : « Puisque ta besogne est finie par ici, fiche-moi le camp, et regarde bien la figure du commandant Hulot, pour ne jamais te trouver sur son passage, si tu ne veux pas qu’il fasse de ton ventre le fourreau de son bancal ». Rien de mieux qu’une bonne haine (un bancal est un sabre ; mon Larousse 1903 donne cet exemple, aujourd'hui exotique : "Les gendarmes sont armés de BANCALS").
Car Hulot, en militaire aguerri, n’éprouve point de haine envers l’ennemi qu’il est chargé de combattre. Lorsque le Gars, après son mariage intime avec Marie, échoue à fuir Fougères et gît sur un brancard à côté de Marie qui agonise (elle avait revêtu les habits de son récent mari pour détourner de lui l’attention des soldats, en vain), Hulot lui promet de transmettre son message à son jeune frère, réfugié en Angleterre : « Le marquis put encore remercier par un signe de tête son adversaire, en lui témoignant cette estime que les soldats ont pour de loyaux ennemis ». Ah, la chevalerie !
On comprend, une fois le livre refermé, pourquoi Balzac, concevant l’immense cycle de La Comédie Humaine, a inclus Les Chouans a posteriori dans les « Scènes de la vie militaire », dont il est au demeurant le seul épisode. Certains y voient son premier chef d’œuvre. On peut le dire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 16 décembre 2013
2 BALZAC : LES CHOUANS
Balzac n’aime pas la Bretagne : « La place que la Bretagne occupe au centre [sic] de l’Europe la rend beaucoup plus curieuse à observer que ne l’est le Canada. Entouré de lumières dont la bienfaisante chaleur ne l’atteint pas, ce pays ressemble à un charbon glacé qui resterait obscur et noir au sein d’un brillant foyer. Les efforts tentés par quelques grand esprits pour conquérir à la vie sociale et à la prospérité cette belle partie de la France, si riche de trésors ignorés, tout, même les tentatives du gouvernement, meurt au sein de l’immobilité d’une population vouée aux pratiques d’une immémoriale routine ». On trouve ça dans Les Chouans. On n’est pas plus amène, n’est-ce pas. A méditer à la lueur de l’actualité (bonnets rouges, etc.).
Pourtant, son mépris ne peut s'empêcher de se teinter d'admiration : « Une incroyable férocité, un entêtement brutal, mais aussi la foi du serment ; l’absence complète de nos lois, de nos mœurs, de notre habillement, de nos monnaies nouvelles, de notre langage, mais aussi la simplicité patriarcale et d’héroïques vertus s’accordent à rendre les habitants de ces campagnes plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l’Amérique septentrionale, mais aussi grands, aussi rusés, aussi durs qu’eux ». On peut comprendre l’ancienne double consigne qui figurait autrefois à l’entrée des écoles bretonnes : « Défense de parler breton et de cracher par terre ».
Ce qui peut surprendre, dans Les Chouans, c’est le mépris que l’auteur manifeste pour ces paysans, de vraies brutes au plafond bas, mal dégrossies. Car dans l’Avant-Propos à la Comédie Humaine, voici ce qu’il déclare : « J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays ». Il est vrai que c’est écrit en 1842, alors que le livre date de 1829.
Le plus étonnant, c’est que le roman, déjà à ce moment-là, ne ridiculise pas la religion, bien au contraire : il suffit que l’abbé Gudin paraisse pour que les Chouans se taisent et s’agenouillent, même si Balzac assaisonne le curé de remarques peu aimables à l’égard des curés fanatiques qui se mêlent de politique. A l’opposé, il tresse des louanges à l’humble abbé qui, à la fin, est introduit dans la maison de Marie de Verneuil pour la marier au marquis de Montauran. Lui au moins, sans ostentation, se contente de servir humblement et obscurément Dieu et la religion.
Toujours dans l’Avant-Propos, il ajoute cet argument qui devrait nous pousser à réfléchir, nous qui, aujourd’hui, nous contentons d’exister politiquement les jours d’ouverture des bureaux de vote, et d'être contraints au silence le reste du temps : « Sans être l’ennemi de l’Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l’Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu’elle l’est aujourd’hui, car elle ne représente pas d’imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique ». Je suis bien d’accord avec lui : la peste soit de la dictature majoritaire, qui laisse les mains libres au parti vainqueur d’imposer leurs caprices à des masses qui auront tout oublié des avanies ainsi subies quand on leur demandera de voter à nouveau.
Marche-à-Terre est un très beau personnage, décrit comme aussi redoutable qu’insaisissable. Au début, dans le premier affrontement, il ne lui faut qu’un instant pour se soustraire à la vue des soldats, dont il vient de fracasser le crâne des deux qui le surveillent, avec le manche de son fouet. C’est le personnage qui sert de fil rouge à la partie chouanne du récit, toujours aux aguets, toujours aux premières loges pour casser du républicain. C’est même sur lui que se referme le roman : « … et personne ne lui disait rien quoiqu’il eût tué plus de cent personnes ».
Chez les Bleus, la figure qui domine est celle de Hulot, chef de demi-brigade, vieux militaire respecté par ses hommes, féru de discipline et de manœuvres savantes comme on le verra à la fin. Un homme fier aussi, qui brise son épée quand Marie de Verneuil sort de son corset le papier donnant l’ordre de Fouché à tous les républicains de se mettre aux ordres de sa personne : « Je ne sais pas servir où les belles filles commandent ».
Le féminisme n’était pas encore passé par là.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans
dimanche, 15 décembre 2013
1 BALZAC : LES CHOUANS
Il y a des chances que Balzac n’ait éprouvé pour la Bretagne et les Bretons que du mépris. Mais un mépris curieusement teinté d’admiration. Dans Les Chouans, le mépris s’exprime dans la description des mœurs, des habitations et de la pauvreté misérable de la région et de ses habitants, qu’il juge à peine civilisés. Il faut lire la description de la cabane de la Barbette, la femme de Galope-Chopine.
Il écrit ceci : « … et les Chouans sont restés comme un mémorable exemple du danger de remuer les masses peu civilisées d’un pays », et je ne cite pas le pire. Il se moque de leur manie de placer leur fumier au haut bout de leur cour, ce qui a selon lui de fâcheuses conséquences. L’admiration transparaît dans ce que l’auteur dit de l’attitude des chouans dans la bataille.
Mais là encore, il ne peut s’empêcher de voir en ceux-ci des sortes de brigands, dont les motivations sont bassement matérielles, tant ils sont avides de s’emparer de l’or qui passe à portée de leurs mains. Tout ça manque singulièrement de grandeur, et Balzac montre à plaisir, en même temps que leur indéniable courage, la cupidité (et la stupidité de bûche) de ces va-nu-pieds féroces.
En 1829, Balzac n’a pas encore eu l’idée de la future Comédie humaine. C’est après coup qu’il inclut Les Chouans dans son énorme cycle. Pour dire le vrai, ce roman porte un titre tant soit peu trompeur. Je ne l’avais jamais lu. Et pourtant le livre se lit tout seul : pour le coup, c’est un roman d’action, seulement ponctué par quelques instants de contemplation de la nature, et par un fort long, subtil et passionnant duel verbal entre les deux héros.
Le titre est trompeur : il aurait pu tout aussi bien s’intituler Les Blancs et les Bleus, ou encore Une tragédie amoureuse. Les Chouans sont une des composantes principales du roman, mais à peu près à égalité avec les soldats républicains (uniforme bleu) envoyés pour les combattre. L’autre composante essentielle est constituée des deux personnages principaux : Mademoiselle de Verneuil et le marquis de Montauran, surnommé par tout le monde « Le Gars ».
La première est envoyée par Fouché pour faire tomber le second en le prenant dans ses filets au moyen de son talent insurpassable de séduction amoureuse. Le second est envoyé par le roi pour soulever la Bretagne, pendant qu’un autre gentilhomme soulève la Vendée. Les deux sont donc en mission politique, quasiment nationale, sauf que ce n’est pas pour le même pouvoir. Tous deux tendent leurs filets, sauf qu’ils ne sont pas du même genre. Et que tous deux vont être pris dans le filet de l’ennemi, à leur corps défendant, et en perdre la vie.
Car Les Chouans raconte d’abord une histoire d’amour dans une région en guerre civile. C'est l’histoire tragique de deux ennemis amoureux l’un de l’autre, l’histoire de deux dons de la vie de soi à la vie de l’autre, l’histoire de deux sacrifices voulus, désirés, consentis d’un jeune homme et d’une jeune fille prêts à tout donner dès lors qu’ils ont la certitude absolue d’avoir trouvé l’élu de leur cœur, l’unique objet qu’ils attendaient pour se dire qu’à défaut, leur vie ne valait pas la peine, et qu’à ce moment-là, autant la gaspiller.
Les Chouans, c’est une sorte de « remake » étendu à la nation française d’alors de l’immortelle discorde véronaise entre Capulet et Montagu, à la différence que, dans ce combat politique impitoyable, Marie et Le Gars, s’ils ont le coup de foudre chacun de son côté, sont retenus par la méfiance : la Bretagne d’alors est un terrain dangereux, où tout le monde ignore d’où le coup de fusil mortel peut partir.
A cet égard, les moments où Balzac nous fait ressentir les heures d’affres du doute et de la défiance éprouvés par les amoureux sont des chefs d’œuvre où s’expose et se surmonte peu à peu leur résistance à leur désir spontané, immédiat et total de confiance de l’un à l’autre.
Chez les Chouans, les figures les plus travaillées sont au premier chef celle de Marche-à-Terre, et juste derrière lui, celles de Pille-Miche et de Galope-Chopine. Ce dernier se verra la tête coupée par les deux autres au motif que sa femme Barbette a renseigné Mademoiselle de Verneuil, ce qu’ils considèrent comme une trahison. Du coup, d’ailleurs, la Barbette se vengera en trahissant carrément la cause auprès des Bleus.
C’est bien fait pour les Chouans.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans, bretagne, bretons
mardi, 03 décembre 2013
LEONARD ET VICTOR
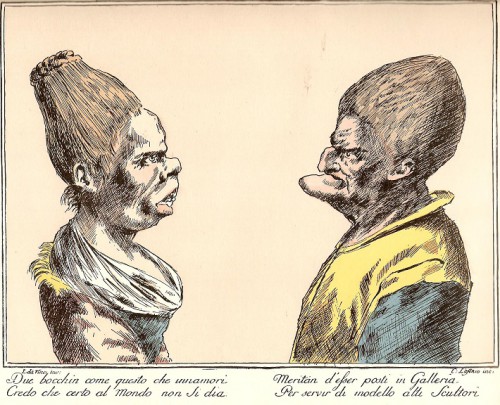



BON, D'ACCORD, LES DESSINS DE LEONARD DE VINCI, QUI N'ETAIENT QUE DE SIMPLES GRIFFONNAGES, ONT ETE RETRAVAILLÉS PAR DES GRAVEURS QUI N'ONT RIEN FAIT POUR NE PAS LES EMBELLIR. LES AUTRES GRIFFONNAGES SONT DE VICTOR HUGO.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonard de vinci, victor hugo, littérature, art, artiste
lundi, 02 décembre 2013
LA CROIX-ROUSSE ET SES TROIS OUILLES
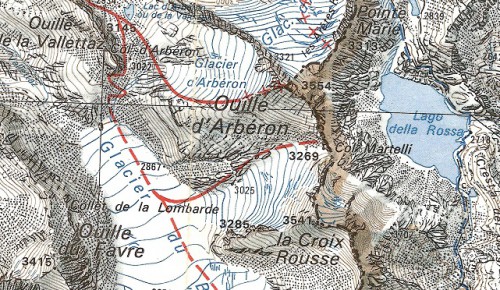
UNE VUE PANORAMIQUE DE LA CROIX-ROUSSE (3541 mètres au-dessus du niveau de la mer), SOUS UN ANGLE INATTENDU.
A NOTER QU'A PROPOS DE OUILLES, ON NE S'Y CONTENTE PAS D'UNE PAIRE.
C'EST D'AILLEURS COMME ÇA DANS LES ONZE MILLE VERGES DU POETE APOLLINAIRE.
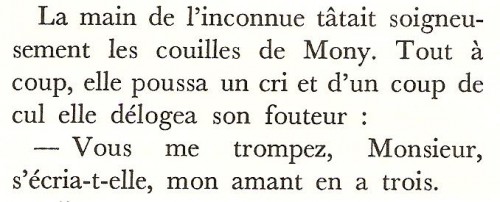
ON TROUVE CE PETIT POEME D'UNE DELICATESSE QUASI-MYSTIQUE A LA PAGE 120
****
MAIS JE GALÈJE, JE DIS QUE DES GANDOISES ET DES GOGNANDISES. LA SEULE, LA VRAIE CROIX-ROUSSE, JE VEUX DIRE LA PLACE DE LA CROIX-ROUSSE, LA VOICI, TELLE QU'EN SOI-MÊME ENFIN L'ETERNITÉ LA CHANGE.
(VUE DU "SAINT-BERNARD")

AVEC L'INEVITABLE ET TERRIBLEMENT BIEN PLACEE TERRASSE DE LA BRASSERIE DES ECOLES, OÙ J'EUS L'INSIGNE PRIVILEGE D'ASSISTER A LA CONCEPTION ET PRESQUE LA NAISSANCE DE L'IMMORTEL CHEF D'OEUVRE DE L'ENIGMATIQUE ET INGENIEUX R. D. PARPIN, LA MAIN VENGERESSE (EDITIONS LE MANUSCRIT, 2005).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, apollinaire, les onze mille verges, la main vengeresse, érotisme
jeudi, 28 novembre 2013
POUR REFERMER HENRI BOSCO
****
Est-ce que la lecture de la presque totalité des livres de Henri Bosco m’a donné une idée de la raison pour laquelle il reste un auteur peu lu ? Enfin, je dis « peu lu », mais au fond je n’en sais rien. Je peux dire que lorsque je pose la question autour de moi, on me cite presque obligatoirement L’Enfant et la rivière, parfois Le Mas Théotime ou Le Renard dans l’île, plus rarement Malicroix, et jamais Un Rameau de la nuit. Je ne parle même pas de Barboche et Le Sanglier.
C’est cette relative ignorance qui me fait penser que, si on ne peut pas dire que Bosco est un écrivain oublié (en comparaison, pourriez-vous citer un titre, par exemple, d’Eugène Dabit ? Et ceux qui ont vu le film Hôtel du Nord savent-ils que le titre est de lui ?), son œuvre est tombée dans une relative obscurité. A mon avis, cela s’explique.
D’abord parce qu’aucun de ses livres ne m’a fait l’effet produit par certains romans de cet autre écrivain « provençal » : Jean Giono. Je ne sais pas vous, mais moi, L’Iris de Suse ou Un Roi sans divertissement, chaque fois que je les lis, j’ai l’impression d’être mis en présence de chefs d’œuvre incontestables. Le souffle et le flux de l’inspiration m’emportent, et me laissent après coup dans une sorte d’hébétude. Rien de tout ça chez Bosco.
Je me demande si ce n’est pas le côté « obsessionnel » de l’œuvre de Bosco qui en est responsable. L’obsession de l’ombre, de la nuit, de la lumière de la lampe, si faible qu’on croit toujours qu’elle va s’éteindre. L’obsession du songe, qui tend à empiéter sur la réalité, jusqu’à parfois s’y substituer. L’obsession maladive présente dans le narrateur, très souvent forcé de garder la chambre et d’attendre que soit finie sa longue convalescence.
L’obsession encore de son attente vigilante mais passive, jusqu’à ce que l’action s’impose à lui. L’obsession aussi de l’interrogation sur soi-même : quand je dis « je », qui parle ? Avec un corollaire inattendu : la compartimentation intérieure de la personne, qui prend toujours soin de distinguer entre ses songes et sa pensée, sa pensée et son esprit, son esprit et son âme.
Et cet autre corollaire : le thème du double. Je sais, je sais, savons-nous qui et combien nous sommes, etc. ? Mais ça finit par tourner en rond. C’est sûr que je connais peu d’écrivains qui soient allés aussi loin dans l’exploration de l’intériorité, qui se soient à ce point demandé quel est cet autre que soi qui habite en nous, cette présence mystérieuse et insaisissable qui fait que notre être nous échappe quand nous croyons le tenir. Il reste que, au moins pour moi, les choses tournent souvent au coupage de cheveux.
Il n’est pas difficile de faire l’inventaire des thèmes chers à Henri Bosco, tant il se contente d’un petit nombre, et qui finissent par constituer son univers à lui. Je trouve d’ailleurs ça très fort : élaborer un univers unique, identifiable, qui lui appartient en propre, tous les écrivains n’en sont pas capables.
Et le caractère « obsessionnel » de ses thèmes favoris montre qu’il s’y est fidèlement tenu, si l’on excepte quelques brillants péchés de jeunesse (Pierre Lampédouze, Irénée) : s’il avait gardé leur côté virtuose, il y a fort à parier que l’œuvre aurait très vite cessé de rayonner. C’est comme le carburant : plus tu roules vite, plus vite le réservoir se vide.
Le monde élaboré par Bosco est, je trouve, remarquablement homogène. Explorer l’intériorité de l’homme explique et justifie l’omniprésence du caractère parfois excessivement nocturne de ses livres. L’obscurité infinie de l’intérieur va de pair avec l’infini de la nuit, du ciel étoilé, de l’infini des constellations.
Combien de fois suis-je tombé sur des passages où l’auteur note l’heure du lever de la lune, de l’apparition de telle constellation à l’horizon ? Ce ciel nocturne, quand il n’est pas bouché sous un couvercle de nuages, Bosco prend soin de préciser qu’il se déplace : comme le soleil et la lune, les étoiles se lèvent et se couchent.
Un monde littéraire d’une grande richesse, d'une grande profondeur humaine, mais il faut bien avouer, d’une âpre austérité. Cette œuvre d’accès difficile, il faut vraiment vouloir y entrer. Et je dis ça après en avoir fait le tour.
C'est peut-être là la raison de sa relative relégation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 26 novembre 2013
POUR REFERMER HENRI BOSCO
Parmi les œuvres mettant en scène le milieu familial et topographique dans lequel a baigné Bosco enfant, j’extrais avant tous les autres Barboche (qui apparaît une deuxième fois dans la liste « Du même auteur », sous le titre Le Chien Barboche, alors que, curieusement, les autres livres parus en collection « jeunesse » ne sont crédités qu’une fois), à cause de la véritable émotion qui émane du personnage de Tante Martine, partie sur le chemin de sa jeunesse, pour en revoir une dernière fois le paysage chéri.
Elle le retrouvera en effet, mais totalement en ruine. Ce n’est pas pour rien que Martine Gloriot se présentera, à la fin, sous le nom d’Agathe Franchon au paysan qui a reconnu la vieille dame. Ce dédoublement du personnage s’était déjà produit dans le village de Pierrouré, où la petite Pinceminou rencontrée par Pascalet n’est autre que Tante Martine enfant. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Beaucoup d’art dans ce petit livre pour se mettre au service de l’émotion et, pourquoi pas, d’une réflexion sur le vieil âge et le temps qui passe.
Ce que j’aime encore chez Bosco, ce ne sont pas à proprement parler des livres particuliers, mais quelques personnages bien campés, comme Bargabot le braconnier, Béranger le berger natif de Sivergues, Gatzo le jeune bohémien en rupture de ban, l’ami de Pascalet, qui apparaissent dans plusieurs aventures, au gré des circonstances. Citons évidemment L’Enfant et la rivière et Le Renard dans l’île, mais aussi Antonin.
Quant au personnage d’Hyacinthe, cette fille enlevée à sa famille (les Gloriot de La Saturnine à Pierrouré) par un vieux sorcier qui effraie et domine une tribu de Caraques, tribu toujours mystérieuse, dont on parle, à mots couverts, comme d’une menace permanente, j’ai du mal.
Cette histoire d’âme dont Hyacinthe a été vidée, et que le vieux a enfermée dans un arbre, je trouve ça intéressant, mais je n’arrive pas à y entrer. Et pourquoi cette insistance à l’évoquer de livre en livre ? J’avoue que je ne saisis pas bien, parce que tout ça ressemble à du mystère extrêmement fabriqué, et pour tout dire artificiel. Trop étrange pour entrer naturellement dans la narration de faits, et pas assez pour faire du fantastique le moteur du livre. Ce serait, si l’on veut, du fantastique non assumé.
C’est d’ailleurs le problème que j’ai avec des livres comme L’Antiquaire ou Le Récif, deux romans accordant au fantastique une part non négligeable. J’entre bien plus facilement dans le fantastique à la E.T.A. Hoffmann (Princesse Brambilla) ou à la Gustav Meyrink (Le Golem, La Nuit de Walpurgis) où, je ne sais pas comment, la frontière entre le réel et l’imaginaire apparaît beaucoup plus poreuse. Autant après avoir refermé leurs livres, j’ai eu besoin d’un moment de « décompression » pour reprendre pied dans mon décor habituel, autant Le Récif et L’Antiquaire m’ont épargné cet effort, du fait que je n’y suis pas entré.
Chez Bosco en effet, j’ai l’impression que le réel reste le réel, de même pour l’imaginaire, comme si les deux substances, comme l’eau et l’huile, avaient du mal à se mélanger. Pour réussir du fantastique, il faut que le romancier travaille à le rendre vraisemblable. Je peux me tromper, mais il me semble que chez Bosco, le résultat est moins efficace, et par conséquent, assez raté. Je le dis comme je le pense. Le seul livre où j’ai trouvé réussi le mariage entre la dimension fantastique et la réalité prosaïque est le très beau Un Rameau de la nuit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 25 novembre 2013
POUR REFERMER HENRI BOSCO
****
Bon, alors voilà, je n’ai pas lu tous les livres de Henri Bosco, mais il s’en faut à peine de quelques-uns (Saint Jean Bosco, Sites et mirages, …). Si je compte bien, j’en ai lu presque vingt-huit. Je dis « presque », parce que je ne finirai pas Les Balesta. J’ai fini par le poser refermé définitivement avant d’avoir fini. Au motif qu’on n’est pas obligé de toujours se forcer. Je m’étais fixé le but des œuvres complètes. J’ai échoué. Mais pour ma défense, je dirai que j’étais quasiment arrivé.
Il faut comprendre : Les Balesta, c’est une histoire racontée sous un titre menteur. On s’attend à s’entendre raconter une saga familiale (qu’annonce l’article défini pluriel : Les Thibaut, Les Pasquier, …), Bosco raconte le piège dans lequel le brave, doux, naïf et rêveur Melchior se laisse enfermer, et dont, comme bien on se doute, il ne sortira pas vivant. La toile est tendue par une araignée nommée Ameline Amelande, certes simple dame de compagnie d’une baronne ombrageuse et fière, mais dotée d’une ambition qui occupe son esprit sans une minute à perdre.
Elle veut « arriver », et comme elle ne pense qu’à ça, mais qu’elle est d’une prudence de renard inquiet, elle dissimule à merveille. Ceux qui la côtoient (la baronne, la Chichanque) voient en elle une créature de l’enfer. Oh, le livre est d’une belle habileté romanesque. Diabolique même ! Le livre raconte en définitive une sorte de « festin de l’araignée », de sa plus lointaine préparation à sa réalisation implacable. Et Bosco montre ici qu’il est passé maître dans la mise en œuvre d’une stratégie romanesque terriblement subtile.
Mais je dirai que c’est le projet même du livre qui me semble peu intéressant. Et ce n’est pas en impliquant Trigot, en faisant de lui le témoin lucide, affolé et impuissant de la manœuvre d’Ameline Amelande, qu’il donne à son récit autre chose qu’une sorte de piquant ironique, de distance avec l’action principale, en même temps que son commentaire synchrone.
Au total, l’exposition se languit et le lecteur s’égare dans les détails. Paradoxalement, une belle réussite de romancier aguerri, mais une réussite bien vaine, faute d’avoir soutenu l’intérêt de la lecture, par exemple par des ruptures de rythme ou de point de vue.. La figure diabolique d’Ameline Amelande projette cependant une belle lumière bien noire.
Voilà ce qui me retient de considérer Henri Bosco comme un très grand romancier : maintenant que j’en ai fait le tour presque complet, je trouve que son œuvre tire un peu à hue et un peu à dia. La veine la plus riche est sans conteste l’autobiographique, tout ce qui tourne autour du « Mas du Gage », de Tante Martine (Clarisse dans la vraie vie) et de Pascalet. Le cycle des Balesta, ou de Pierrelousse si l’on veut (dans l’ordre Les Balesta, Sabinus, L’Epervier), je le trouve inégal.
Des trois (ou quatre, si l’on ajoute Mon Compagnon de songes) volumes présentés explicitement comme des souvenirs, je garde Un Oubli moins profond, à cause des belles figures que l’auteur y dessine. Les deux autres (Le Chemin de Monclar et Le Jardin des Trinitaires), comme je l’ai dit ici, me semblent faire du remplissage avec du pas grand-chose, et Bosco y « tire à la ligne » (comme on disait à l’époque où les feuilletonistes étaient payés à la ligne) de façon trop visible.
De l’œuvre de Henri Bosco, finalement, quels sont les titres qui resteront gravés et lumineux dans ma mémoire ? J’en garde principalement quatre, que je considère comme des œuvres majeures de la littérature du 20ème siècle : les deux plus connus et répandus, Le Mas Théotime et Malicroix. Mais aussi deux autres, beaucoup moins renommés : Le Sanglier et Un Rameau de la nuit, soit deux œuvres situées au début et à la fin de la carrière de l’écrivain. Ce qui est commun à ces quatre titres, c’est leur puissance d’évocation, la force de l’imaginaire sur lequel ils reposent.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 07 novembre 2013
HENRI BOSCO : LE SANGLIER
MONUMENT AUX MORTS DE MERIAL, AUDE
****
HENRI BOSCO : LE SANGLIER
Ah le beau livre ! Je le dis sans ambages, bille en tête et sans détour : Le Sanglier est un des deux livres les plus puissants que j’ai lus qui soit sorti de la plume de Henri Bosco. Pour un peu, et si l’appellation n’était pas galvaudée aujourd’hui, je parlerais volontiers de chef d’œuvre. Et je tiens à l’adjectif « puissant ». J’avais gardé d’une première et ancienne lecture deux images. Celle de l’étreinte sauvage qu’une femme faisait subir dans le noir au narrateur. Celle d’un incendie démesuré. A la relecture, je les ai effectivement retrouvées, intactes et brûlantes.

Le narrateur, pour cette fois, on l’appellera « Monsieur René ». Il vient passer tous les ans deux mois de vacances au Mas des Ramades, situé au sortir du « Vallon des Cavaliers », dans le Luberon (on lit ce nom tour à tour avec et sans accent au cours du récit, et je refuse de me battre pour la cause de l’accent ou non sur Luberon.). Il aime ce « quartier » précisément pour son isolement.

LA MAISON DES CAVALIERS, AU DÉBOUCHÉ DU VALLON DU MÊME NOM
(PHOTO J.-P. BARÉA, POUR L'AMITIÉ HENRI BOSCO)
Pourtant cette année-là, dès son arrivée dans la carriole de Firmin, il sent quelque chose de changé. Quelque chose dans l’attitude de Firmin ? Dans le comportement de la Titoune, brave femme qui approvisionne « Monsieur René » ? Pourquoi Firmin s’attarde-t-il après l’arrivée, lui qui disparaît d’habitude sans demander son reste ? On dirait qu’il veut empêcher par sa présence la Titoune de dire des choses importantes à « Monsieur René ».
Et puis surtout, le premier soir, quand les deux se sont retirés et que « Monsieur René » se retrouve seul, il est soudain pris de panique, à cause d’une « présence » menaçante qui s’est introduite dans la maison, un être sans visage et sans forme dont il discerne vaguement le contour dans l’obscurité. Heureusement, cette menace, il sent bientôt qu’elle a disparu.
Chose curieuse, au même moment, la Titoune, sur le chemin du retour (qu’elle connaît comme sa poche) a tellement la frayeur de sa vie qu’elle en tombe sur le derrière, qu’il faudra que le Titou s’inquiète et aille la chercher, et que dorénavant, pour rien au monde, on ne la ferait revenir aux Ramades. Il faudra que Firmin demande à sa nièce Marie-Claire, jeune fille de seize ans, de s’occuper du ménage et de la cuisine de « Monsieur René ».
Ce qui se passe dans la tête de Marie-Claire n’est jamais expliqué, seulement montré et raconté, et encore, pas en entier. Le personnage tient un peu du caractère de Tante Martine : un cœur aimant et généreux, mais un refus farouche de le laisser paraître, qui donne aux réactions et gestes le rugueux nécessaire à la dissimulation de la tendresse. Ici, le carnet des comptes : quand un sentiment se met à affleurer, elle réclame la somme que son patron lui doit pour l’achat de quelques légumes. Passez muscade.
Mais au fil du récit, le masque se fendille. C’est une irruption surprenante aux Ramades en pleine nuit, pour demander à « Monsieur René » de ne pas retourner « là-bas ». C’est, au cours d’un affût à l’observatoire ménagé par Firmin au-dessus de la clairière nommée le « Repos-de-la-Bête », une tache claire que le narrateur aperçoit au loin sur une grande table de pierre au-dessus d’une falaise. Tout se passe comme si Marie-Claire tenait à son maître et veillait sur lui pour écarter le danger.
Car il y a du danger, comme on le comprendra progressivement. Le lecteur croit d’abord que c’est ce colosse accompagné d’un énorme et redoutable sanglier, aperçu lors du premier affût en compagnie de Firmin dans l’observatoire aménagé quelque part au cœur de la montagne du Luberon. L’animal qui donne son titre au livre est plus libre, en quelque sorte, que l’hercule qui hante la montagne, car il en franchit la limite, comme « Monsieur René » le constate un jour juste devant chez lui. Le colosse, lui, ne le fera jamais.
Mais attention quand Firmin lui tire dessus et le rate : la course effrénée dans laquelle les deux hommes se lancent pour échapper à la poursuite du géant et de la bête ne leur permet qu’in extremis de se trouver en sécurité. Dans l’affolement, René en a laissé sur place tout son matériel de peinture. Firmin prétendait tirer sur l’animal, mais bizarrement la ligne de mire du mousqueton Mauser que lui a prêté son compagnon d’aventure s’est déporté en direction de l’homme : résultat la balle est passée entre les deux.
Un degré supplémentaire dans l’intensité est franchi lorsqu’intervient une étrange femme aux cheveux noirs, aux yeux flamboyants, au corps sauvage. « Monsieur René » l’observe dans le vallon désormais familier : elle aussi semble craindre le colosse et le sanglier. Une nuit où, étendu sur son lit, tout habillé et dans l’obscurité, elle s’introduit dans la maison et se jette sur lui pour l’étreindre avec une incroyable sauvagerie. Puis elle s’échappe.
La suite est haletante : Marie-Claire était là, elle s’enfuit, poursuivie par la gitane furieuse, puis, à une certaine distance, par le narrateur. Celui-ci arrivera dans le vallon trop tard pour sauver l’adolescente : l’autre aura eu le temps de la saisir pour la précipiter dans un « trou de charbonnier » où elle se brise les reins. Puis il entend Firmin tirer sur la Caraque.
On extrait Marie-Claire de son trou, on la porte jusqu’à un abri de berger : elle est morte. Mais ce n’est pas fini, car les Caraques sont toute une tribu. Ils campent dans un château abandonné. C’est la femme sauvage qui les domine et sans doute les commande. Ils veulent, on ne sait pourquoi, récupérer le corps de l’adolescente. Une bataille sévère s’ensuit, où le narrateur se découvre dans le colosse un allié imprévu, qui taille très vite des coupes claires dans les rangs des Caraques.
Et puis un incendie se déclare après une série d’explosions. Le narrateur aperçoit la femme sauvage sur la terrasse de pierre dominant une falaise. Elle semble terrifiée. Il y a de quoi : le sanglier débouche de l’obscurité. Elle recule, et finit par tomber dans le vide. Justice est faite.
Au total, un livre où s’affrontent des forces primitives. Un livre violent, mais où la brutalité est graduée avec une science incroyable du début à la fin. Et un livre dont le programme est quasiment annoncé dès les premières pages, animalité, violence et incendie compris.
Un roman magistral.
Voilà ce que je dis, moi.
09:15 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, littérature, littérature française, henri bosco, le sanglier, gallimard, collection blanche, l'amitié henri bosco
mardi, 05 novembre 2013
HENRI BOSCO : HYACINTHE (suite et fin)
Hyacinthe, de Henri Bosco.
« Maintenant l’hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. La moindre branche s’y dessinait, grêle et précis ; et j’avais un plan de candeur où placer les figures de l’âme. Sur cette surface à peu près irréelle, j’imaginais à mon usage, une géométrie sentimentale, où les courbes du souvenir, du regret, de l’espoir, semblaient formulées par une intelligence tendre. Nul obstacle. J’avais fourni aux opérations de mon âme une surface issue de l’âme même. Les constructions les plus hardies tout à coup devenaient possibles. Dans un monde où plus rien n’arrêtait le développement de mes desseins, l’agilité de mon esprit acquit alors une aisance inattendue. J’errais autant et plus vite que jamais. Je m’étais délesté de ces voluptés qui vous traînent ou vous ralentissent. Rien ne me tentait plus. En moi ne survivait qu’une passion plus légère que moi. Je ne vivais plus dans les formes colorées ; les odeurs m’atteignaient à peine ; et je me tenais, par miracle, au cœur d’une lucidité éclatante et fragile. Mon esprit pénétrait partout, et je me voyais. »
Je tenais à citer ce passage un peu long (qui incitera peut-être, allez savoir, mon lecteur à ouvrir Hyacinthe) pour donner une idée de la chose. Henri Bosco, dans plusieurs de ses livres, met ainsi en scène des personnages qui se demandent combien ils sont à l’intérieur d’eux-mêmes, et si ce n’est pas un autre, un étranger qui, au-dedans, est le vrai maître des lieux. On lit même ceci : « Mes souvenirs ne me reconnaissaient pas » (p. 168). Bien sûr l’auteur veut signifier par là qu’il est devenu un autre, mais j’y vois aussi l’afféterie de quelqu’un qui « fait des manières » et des préciosités.
J’avoue être moi-même assez étranger à ce genre de questionnement et aux problématiques qui en découlent. Il me semble qu’il y a, dans une telle interrogation, quelque chose qui ressemble à une « angoisse de nanti ». Je ne méprise certes pas, à cause des dimensions éventuellement métaphysiques auxquelles elles conduisent, mais pour mon propre compte j’y vois des questions oiseuses.
Et puis il y a Hyacinthe, évadée du mystérieux et immense domaine de Silvacane, alias « Le Jardin », dont le maître est un vieillard (tiens tiens). Elle fait irruption à « La Commanderie » le soir du 25 décembre. Quand on a lu les évocations d’Hyacinthe dans les autres ouvrages, il faut comme qui dirait un « temps d’accommodation », car la dernière fois que je l’ai croisée, c’était une fillette d’une dizaine d’années, petit animal vidé de son âme, qui ne faisait que si on lui disait de faire. Ici, le narrateur a à faire avec une femme jeune et belle (et ardente).
Ailleurs, je me souviens d’une fillette joueuse et impérieuse. Bref, c’est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu’en raboutant tous les morceaux épars de l’histoire d’Hyacinthe comme les pièces d’un puzzle, on arriverait à une image homogène. J’avoue que le personnage m’intrigue beaucoup, même si j’ai un doute quant à la cohérence (et à une autonomie possible) de l’ensemble des données fournies par l’auteur au fil des livres. Mais que cela puisse intriguer (à force de récurrence du thème) est déjà le signe d’une réussite romanesque.
Hyacinthe est publié en 1940. Le narrateur n’est jamais nommé. Celui du Jardin d’Hyacinthe (1946), en revanche, s’appelle Méjan de Mégremut. Et, après avoir fait figurer le passage de L’Âne Culotte où M. Cyprien, le vieillard magicien, kidnappe la fillette de « La Saturnine » après s’être rendu maître de son esprit, le narrateur prend ses distances avec son « concurrent » du premier livre : « Car cette histoire a déjà été racontée, mais d’une manière bizarre. (…) Cette fille n’y apparaît que comme un fantôme impalpable. D’où vient-il, où va-t-il ? on ne sait. Il semble ne surgir du milieu de ces brumes que pour donner un corps, fût-il fugitif et décevant, aux rêveries effrénées de cet homme – d’ailleurs anonyme – qui prétend en dire l’histoire ». Bosco s’amuserait à brouiller les pistes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.
Mais je l’ai dit, dans Hyacinthe, il n’y a pas qu’Hyacinthe. Il y a aussi et surtout le narrateur envahissant, avec le poids, la surface et l’opacité de ses états d’âme. J’imagine qu’il s’écrit des tas de thèses universitaires épaisses comme des encyclopédies qui s’écrivent sur Henri Bosco. Dans le tas, ce serait bien le diable si l’une au moins n’avait pas pris pour sujet central un thème presque central de l’imaginaire de l’auteur : la convalescence.
Que de convalescences, en effet, chez les narrateurs de Bosco ! Souvent elle suit un moment d’exacerbation nerveuse qui va jusqu’à produire un délire, aboutissant à un évanouissement. Mais à chaque fois, une mystérieuse main secourable intervient pour retirer la personne de la zone de danger, la mettre à l’abri et en prendre soin jusqu’au rétablissement.
Je comprends bien pourquoi la convalescence (plus ou moins prolongée) attire le romancier : c’est un état intermédiaire de la conscience, où celle-ci, rendue poreuse à l’extrême par la maladie proche, hésite entre le délire et le discours de la raison. Toutes les ambiguïtés sont alors permises, y compris les hallucinations présentées comme vérités et les observations présentées comme illusions. Durant la convalescence, la conscience est essentiellement réversible entre ces deux états. Et je ne doute pas que l’expérience personnelle de l’auteur en la matière soit la source directe des récits de convalescence qu’on trouve (un peu trop) souvent chez lui.
Les narrateurs de Henri Bosco sont, à n’en pas douter, une espèce fragile des nerfs. Obnubilé par son désir de voir au-delà des apparences, le narrateur « boscien » perd facilement celles-ci de vue, pour se laisser conduire par des forces qui en font la victime désignée de celles qui s’affrontent hors de lui, au-dessus de lui. Il en réchappe de justesse (L’Antiquaire, Un Rameau de la nuit, …), et puis sa conscience se recompose.
La convalescence du narrateur, dans Hyacinthe, montre celui-ci très faible, après avoir échappé à la mort dans des circonstances à la limite du crédible (une glissade dans la neige le projette dans la cave d’une maison où se réunissent les Caraques qui lui veulent du mal). Mais je ne suis pas contrariant. La convalescence dure, dure, dure. On comprend qu’il n’est plus à « La Commanderie », mais à « La Geneste », entre les mains fidèles et discrètes du couple de vieux serviteurs de l’ « autre ».
Le dernier épisode met en scène la rencontre entre le narrateur et le mystérieux maître du mystérieux domaine de Silvacane (j’espère qu’on excusera et comprendra l’obsédante apparition du mot « mystérieux »), appelé tantôt le « Jardin », tantôt le « Paradis ». Cyprien est très vieux : « … si vieux que j’ai fatigué la vieillesse » (encore une coquetterie de formule). Il livre à l’anonyme qui l’écoute quelques explications.
Tout ce qu’il a fait, il l’a fait par amour. Il comptait sur Hyacinthe (qu’il a volée) pour récupérer Constantin Gloriot. Il a échoué. Il espère qu’Hyacinthe et Constantin seront assez malheureux dans leur vie terrestre pour décider de se retrouver au « Jardin » et y refonder le « Paradis ». Et c’est alors qu’il aura leurs âmes. Il précise aussitôt que ce n’est pas pour son propre compte (mais alors pour le compte de qui ?).
Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas sûr), la leçon de tout ça est que tous ceux qui manifestent le projet de refonder le paradis sur terre sont des gens dangereux. Si quelqu’un a une autre explication, merci d’avance. Je suis personnellement bien convaincu que vouloir sauver l'humanité c'est préméditer de commettre une crime contre ladite humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule institution humaine qui m'inspire toute confiance (puisqu'il n'y a rien à en attendre, que ce soit en positif ou en négatif) est celle qui est nommée ci-dessous.
J'ajoute que la littérature non plus n'a pas pour vocation de sauver le monde. Parce que le monde, je vais vous dire, il est rigoureusement impossible de le sauver. Il ira ce qu'il ira. Avec nous dessus.
Voilà ce que je dis, moi.
lundi, 04 novembre 2013
HENRI BOSCO : HYACINTHE
HYACINTHE, de Henri Bosco.
En ouvrant ce livre, je me disais : « Enfin, m'y voilà arrivé ! Je vais enfin découvrir le fin mot de l'énigme !». Eh bien non. Que nenni ! Je dirais même que le mystère s'est épaissi, une fois le livre refermé.
Ce livre, je l’avais enfoui sous des piles. C’est en entreprenant des fouilles quasi-archéologiques que je suis tombé dessus. Manque de chance, c’était après en avoir acheté un autre exemplaire chez un bouquiniste. Remarquez que je ne me plains pas, parce que j’y apprends quelque chose. En effet, comme c’est non pas la 22ème, mais la 10ème édition, la liste des « Œuvres de Henri Bosco NRF » a la bonté de signaler, non seulement les œuvres que Gallimard n’édite pas, mais fait figurer pour chaque titre, entre parenthèses, l’année où il fut publié.
C’est ainsi que je découvre que Pierre Lampédouze, dont j’ai parlé très récemment, apparaît dès 1924, et donc qu’il précède Irénée (1928) que, excepté pour ce qui est du thème, je plaçais dans le même registre, mais avant. L’ordre est rétabli, ma conscience, désormais appuyée sur une certitude, en est tranquillisée. Et la chronologie présentée dans la notice wikipédia serait bien inspirée de mettre le nez en page 4 du bouquin.
Alors le livre, à présent. Et d’abord le personnage même d’Hyacinthe. Cette fille qu’on rencontre bien souvent dans les livres de Henri Bosco, soit qu’elle existe en chair et en os (si l’on peut dire) dans le récit, soit qu’elle soit, juste en passant, à peine évoquée comme un fantôme, ou comme une âme, cette fille donc est certainement le personnage le plus étrange qu’ait élaboré l’auteur. Je dirai même le plus fascinant.
Tante Martine, par lequel j’ai commencé mon parcours dans l’œuvre de Bosco (mais le dernier ouvrage publié de son vivant), montre, devant le « Mas de la Sirène », une bande de vingt Caraques, dominés par un vieillard, invoquer l’âme d’une femme qui serait prisonnière d’un arbre. On apprend dans Barboche qu’Hyacinthe a été enlevée à l’âge de huit ou dix ans, dans sa maison de La Saturnine.
Dans la maison mystérieuse dans la montagne où Pascalet est emmené, on croise encore une tribu de Caraques qui, cette fois, veulent brûler l’arbre dans lequel l’âme d’une femme est enfermée, au risque de provoquer un gigantesque incendie. On trouve ça dans Mon Compagnon de songe. Bon, je ne vais pas faire la liste. Disons que le thème de la gamine enlevée par un vieillard qui l'a vidée de son âme, désormais insérée dans un arbre, pour lui insuffler une nouvelle mémoire entièrement élaborée par ses soins, est récurrent dans les livres de Bosco, pour ne pas dire obsessionnel.
J’ignore tout des sources où l’auteur a puisé ce puissant fantasme, mais de toute évidence il y tient. Apparemment plus qu’à une simple clause de style. Faute d’éléments pour guider une éventuelle recherche, il est vain de s’interroger sur la signification de ce retour obstiné d’une image à ce point étrangère à nos habitudes rationnelles, pour ne pas dire totalement invraisemblable. Remarquez qu'à tout prendre on pourrait y voir une expérience de lavage de cerveau par l'hypnose (avec une dose de sorcellerie). Pourquoi pas ?
Et ce n’est pas le contenu du livre qui porte le nom de l’héroïne qui risque de nous éclairer. D’autant plus que le sujet principal semble fort éloigné : le narrateur (toujours un « je », cette fois anonyme, c’est là que Henri Bosco est le plus à l’aise et le plus fort) est parti pour une expérience intérieure, que le lecteur est invité à ressentir à son tour.
J’avoue que j’ai du mal à suivre Bosco dans ces voyages d’une âme à travers des états successifs, qui sont la manière dont son personnage prend conscience du monde qui l’entoure, de la présence des autres, de la matière dont est fait l’univers, mais aussi des couches d'être qu'il porte au fond de lui, et qu'il s'efforce d'amener au jour, strate par strate.
Le narrateur est venu habiter une vaste maison, « La Commanderie », dans un pays perdu : le plateau de Saint Gabriel. Ce qu’il vient chercher : une expérience profonde de la solitude, sans doute parce qu’il est à la recherche de lui-même. Ce livre est le récit d’une quête intérieure, et sans doute d’une quête de la transcendance. La seule personne avec qui il soit en contact (et encore !) est Mélanie Duterroy, qui vient trois fois par semaine, avec son chien Ragui (un indomptable), s’occuper du ménage et de la cuisine. A part ça, il est rigoureusement seul.
Enfin, pas assez rigoureusement, car non loin de chez lui, on aperçoit le mas de « La Geneste ». Il sait qu’il est occupé par un homme (on apprendra qu’il s’appelle Constantin Gloriot) et un vieux couple de domestiques, mais qu’il n’a jamais vus. La seule chose à voir est la lampe allumée chaque soir à une certaine fenêtre, et qui brille toute la nuit. Beaucoup d’interrogations s’ensuivent.
Le narrateur va même jusqu’à se demander si ce n’est pas le voisin qui occupe « La Commanderie » et lui-même qui occupe « La Geneste ». On dira qu’il a des troubles de l’identité. Je suis toujours assez réfractaire, hélas, à ces doutes qui, ici, ont tendance à se dédoubler, se démultiplier et s’ouvrir sur de nouvelles angoisses embrayées les unes dans les autres.
Cela ne s’arrange pas quand le narrateur découvre la zone des étangs, où il passe des heures étendu sur le dos à contempler, à écouter et à flairer. A se perdre dans des considérations abstraites dont le rôle est apparemment d’introduire au monde sinon mystique, du moins mystérieux dans lequel il se complaît. Un vieillard énigmatique va même jusqu’à le déposer un jour dans sa barque pour le redéposer sur une berge plus près de chez lui après lui avoir fait « faire un tour » sur les canaux. Pourquoi pas ? Le lecteur reste perplexe.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, hyacinthe, le jardin d'hyacinthe, tante martine, pierre lampédouze, barboche, lourmarin, mon compagnon de songe
vendredi, 01 novembre 2013
BOSCO : M. CARRE-BENOÎT
Aujourd'hui 1 Novembre. L'onzième mois de l'année, mais le neuvième quand elle commençait en mars, comme le montrent les noms des quatre derniers mois de l'année civile (sept-, oct-, nov-, déc-). C'est la Toussaint. Mais notre époque a renié les saints, même si elle en a gardé sur l' « Almanach du Facteur », autrefois appelé « Calendrier des Postes». Mais même là, ce ne sont plus des Saints, ce sont juste des prénoms.
PETITE AQUARELLE SIGNEE I. OU L. CHEVALLIER
En l'honneur des morts en général, et de ceux de 14-18 en particulier, j'ouvre aujourd'hui un nouvel album que je leur ai consacré pour les honorer. C'est dans la colonne de droite. Il y en a 100. Il pourrait y en avoir 36000. On est obligé de se restreindre. Ici, j'ai mis des photos des monuments aux morts qu'on voit dans les communes dont le nom commence par la lettre B. Chacun porte, gravé dans la pierre ou le métal, un nombre variable de noms d'hommes. J'inscris ces photos sous la bienveillante aile protectrice d'une belle phrase trouvée dans un livre de Henri Bosco : « UN NOM RESSUSCITE LES MORTS ». Le titre en est Le Jardin des Trinitaires. Merci aux lecteurs de feuilleter.
*
***
*
MONSIEUR CARRE-BENOÎT A LA CAMPAGNE (fin)
L’industrie, s’installe aux Aversols, à l’initiative de M. Bourmadier, mais l’animation ainsi créée sera éphémère.
D’abord parce que des résistances commencent à se faire sentir. L’opposition de Me Ratou le notaire était connue de longue date : il n’aimait pas le maire Troupignan, ni la commerçante Mme Ancelin. Ratou est un homme de l’ombre qui dissimule sa puissance sous des dehors ternes. Renseigné sur tout ce qui est important par Jabard, son métayer, et Piqueborne, un vagabond qui lui sert d’homme de main, il sait tout. On a même l’impression qu’il peut tout, à commencer par les cours de Bourse, qu’un mot de lui est à même d’enflammer ou de couler.
Et puis il y a l’instituteur Tavelot, un original, un républicain, un athée, d’aspect chétif, mais intraitable en tout ce qui touche la Liberté. Bénévole et à la retraite, il a lui-même retapé l’école pour que les enfants des Aversols cessent de courir des kilomètres. Comme il fait froid l’hiver, il demande du bois de chauffage, que Troupignan se refuse à lui fournir, mais que Carre-Benoît, une fois élu maire, se fait fort de lui obtenir.
Comment ? Tout simplement en faisant abattre Timoléon, l’énorme et vénérable peuplier planté sous la Révolution. Le sang de Tavelot ne fait qu’un tour, et quand le charroi se présente devant l’école, il refuse le bois et envoie tout le monde au diable. Abattre ainsi un « Arbre de la Liberté », cela ne se fait pas, Monsieur, tout Maire que vous êtes !
Mais il n’y a pas que l’écharde Tavelot dans l’épiderme de la ville : il y a Léontine Chicouras, avec son feu qui la dévore. Ici ce feu s’appelle « curiosité ». Il faut savoir que la maison léguée à Hermeline Carre-Benoît par sa tante, déjà totalement hypothéquée à Me Ratou (sans que Fulgence le sache), subit en plus une clause spéciale : si les scellés apposés, par volonté de la testatrice, à une pièce du grenier venaient à être brisés, le testament serait immédiatement caduc, et le ménage Carre-Benoît perdrait aussitôt tous ses droits.
C’est précisément cet interdit absolu que Léontine ne supporte pas. Elle dérobe la clé, ouvre, mais n’est pas encore entrée qu’elle voit au fond de la pièce non seulement un cercueil ouvert, mais aussi un long corps maigre qui se déplie et qui en sort. C’en est trop pour la curieuse, qui tombe foudroyée, comme morte. Elle ne restera que paralysée, ce qui est peut-être pire. Le corps était celui de Piqueborne.
Mais la grande catastrophe est encore à venir. Au moment où l’on apprend que l’industriel Bourmadier a disparu de la circulation, ses sociétés font faillite ou sont mises en difficulté. Aux Aversols, les rats quittent le navire. Carre-Benoît est ruiné. On apprend accessoirement que la plupart des maisons de la ville sont hypothéquées au bénéfice de Ratou, et que comme les habitants ont, dans l’enthousiasme, vidé leur bas de laine pour acheter les actions de Bourmadier, ils sont eux aussi ruinés. Ratou rafle tout.
A sa mort, c’est le bon, terrible et mystérieux Jabard, chef de toute une redoutable famille, qui hérite, devenant le maître d’un domaine énorme et immense.
Au total, un livre qui se voudrait plus féroce qu’il n’est finalement. Le personnage qui lui donne son titre est (volontairement) trop caricatural pour exister complètement. A force de simplifier un caractère, le romancier sait qu’il le vide de substance. Carre-Benoît reste amusant. J’ai l’impression que Bosco, en le créant, a relevé une sorte de défi, pariant qu’il était capable de conduire un tel récit. Et je le dis : il est capable.
C’est surtout, en définitive, un livre moral (le Bien contre le Mal, l'Esprit contre la Matière, la Vie contre la Bureaucratie), où l’auteur réussit à insérer des personnages selon son cœur, qui portent ici la part d’univers habituel auquel, même dans cette fable caustique, il ne saurait renoncer tout à fait. Il y a la douce Hermeline, cette épouse effacée vite captée par les forces bénéfiques incarnées par la servante Zéphirine et l’anodin, terrible et avisé notaire.
Il y a le clan des métayers Jabard, intraitablement fidèle à Me Ratou. Il y a l’évasif et efficace Piqueborne, vagabond à tout faire. Et il y a, au cœur de la toile d’araignée, ce personnage de notaire, ce Maître Ratou qui fait pendant au Maître Dromiols de Malicroix. Tout aussi diabolique que lui, il est cependant présenté comme faisant partie de l’Axe du Bien.
Mais à la fin Ratou rafle tout.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, monsieur carre-benoît à la campagne, monuments aux morts, guerre 14-18, toussaint, guerre des tranchées
jeudi, 31 octobre 2013
BOSCO : M. CARRE-BENOÎT
MONSIEUR CARRE-BENOÎT A LA CAMPAGNE
Monsieur Carre-Benoît à la campagne, livre de Henri Bosco, raconte l’histoire d’une vengeance. Et c’est un livre ironique. M. Carre-Benoît est une caricature de gratte-papier, qui ne considère l’existence qu’à travers sa gestion administrative et l’infinité des formulaires à remplir pour en venir à bout. Il ne pense que par registres, classements et formules protocolaires. Sous-Chef retraité d’une administration jamais précisée, il n’a d’ailleurs rien de plus pressé que d’ouvrir un bureau dans la petite ville des Aversols, située à l’écart des voies de circulation et, comme telle, vivant repliée sur elle-même.

LA RELIURE EST EVIDEMMENT DE BONET
Un bureau pour quoi faire, demanderont les curieux ? Eh bien M. Carre-Benoît tient à ouvrir un « Bureau » pour le principe. M. Carre-Benoît porte en lui la quintessence même du bureau : le bureau en soi. Il ne conçoit pas la vie sans le vaste quadrilatère en bois devant lequel il convient de s’asseoir le matin, sans le volumineux et alphabétique classeur à tiroirs (tous vides, comme le constatera M. Bourmadier), et surtout sans l’inscription peinte à l’envers sur la vitrine, pour que le bon peuple qui passe tous les jours devant celle-ci sache bien que, derrière, ne se déroulent que des activités indispensables, surtout si on ne sait pas à quoi le bureau sert.
Fulgence Carre-Benoît avait épousé Hermeline, petite nièce d’Hortense, veuve Chobinet, qui avait survécu cinquante ans à son époux, mort noyé. Avant de mourir, il avait tout de même eu le temps de flamber l’intégralité de la petite fortune possédé par sa femme, et même de la faire passer intégralement entre les mains du notaire, Me Ratou, par hypothèques successives.
Ça tombe bien, Me Ratou est, depuis toujours, amoureux d’Hortense. Certes, quand Hortense est devenue Madame Chobinet, il a fini par se faire une raison, mais quand Chobinet est mort, il a repris espoir. En vain. Alors tous deux se sont contentés d’une amitié tendre, quotidiennement cultivée au pied de l’énorme peuplier Timoléon.
Hermeline a donc hérité de sa tante une maison dans la ville des Aversols, et M. Carre-Benoît vient logiquement en prendre possession. Le couple sera servi par Zéphyrine, la propre servante d’Hortense, dévouée corps et âme à sa vieille maîtresse. Son antipathie (quasiment sa haine) pour M. Carre-Benoît est aussi immédiate et entière que sa sympathie pour Hermeline.
Troupignan est le maire, surtout peu soucieux de faire quoi que ce soit, ce dont les habitants lui sont tellement reconnaissants qu’ils le réélisent constamment depuis vingt ans. La Mairie n’est d’ailleurs ouverte qu’à l’occasion des élections. Le commerce de Mme Ancelin est le seul endroit trépidant de la ville, puisque c’est là que s’échangent la plupart des informations, autant dire des cancans, ragots, commérages et autres rumeurs, qui sont le sang circulant dans les veines de la ville et le sel qu’on met dans le civet de tous les jours pour en relever le goût.
Parlons encore de la Poste, mollement tenue par le flegmatique et nonchalant Séraphin Chicouras, qui vit entouré de ses parents, mais surtout de son ardente et ambitieuse sœur Léontine, qui ne tarde pas à jeter les yeux sur Fulgence Carre-Benoît et à escompter tout le profit qu’il y aurait à tirer en favorisant son ascension sociale. Elle est oblligée, pour conduire ses intrigues, de réprimer le feu intérieur dont elle brûle en permanence, et qui d’ailleurs la perdra.
Toute la première partie du livre est consacrée à l’établissement progressif de la majesté de M. Carre-Benoît : il impressionne quelques habitants, qui en parlent dans le magasin de Mme Ancelin, qui se charge de répandre dans la population un sentiment d’admiration pour le personnage, dont le prestige imaginaire, gagnant en ampleur, finit par faire de l’ombre au maire en place, qui ne s’en remettra pas.
La deuxième partie raconte la séquence classique qu’on peut intituler « grandeur et décadence ». Depuis le passage aux Aversols de Bourmadier, fondateur de « La Récupératrice », industriel et brasseur d’affaires, la ville explose d’activité. Il a inventé et fait breveter une liqueur, à moins que ce ne soit un élixir ou un apéritif : le « Cuq ». Il voit grand, et fait construire séance tenante une usine de fabrication. La ville se met aussitôt à bruire de mille mouvements.
Mais ce n’est pas pour longtemps.
Voilà ce que je dis, moi.
A noter que l'auteur prend soin de préciser dans une "note phonétique" précédant le récit qu'il faut prononcer « Carre-Benoît », et non « Carré-Benoît », tout comme on prononce un « bécarre ». A noter aussi que le nom apparaît (fugitivement en passager de diligence, et l'apparition est loin d'y être flatteuse) dans Barboche.
10:13 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 30 octobre 2013
HENRI BOSCO : SYLVIUS
Ce beau livre de Henri Bosco n’est pas un roman, c’est une nouvelle : une toute petite centaine de pages. Et quand je dis « beau livre », ce n’est pas seulement à cause du contenu, c’est aussi à cause de l’objet, orné de belles vignettes gravées sur bois par Démétrios Galanis (les signes du Zodiaque). L’artiste a même réalisé un superbe frontispice, également en xylogravure, où il saisit à merveille l’esprit du livre (j’ai failli dire « l’âme »). Enfin, il paraît qu’il existe en Folio (n° 1010).
Qui dit nouvelle dit donc histoire courte, mais aussi histoire simple. Le narrateur (ou plus exactement le narrateur qui présente la narration d’un autre, ça se pratiquait beaucoup au 18ème siècle), on le connaît déjà : il s’appelle Méjean de Mégremut. On l’a rencontré dans Le Jardin d’Hyacinthe. On trouve un Martial de Mégremut dans Malicroix. Sans doute un cousin.
La famille Mégremut, je devrais dire la tribu, c’est le terme de l’auteur, habite, je devrais dire peuple Pontillargues, petite ville de 1600 habitants, population dont elle constitue sans mal le bon dixième, bien que le nombre de la tribu fluctue au cours du récit, un détail. L’auteur nous présente longuement cette famille, dont les particularités sont assez voisines des Mégremut de Malicroix.
Ah, les Mégremut : « Chez les Mégremut on s’aime en tribu ; on s’émeut collectivement. Malheur ou bonheur, quand ils frappent un Mégremut, consternent ou épanouissent cent visages ». Et plus loin : « On ne les confond pas avec d’autres cousins, d’autres grand-mères, d’autres oncles. Pas plus qu’on ne confond le groupe Mégremut, si distinct, si original, avec la famille, pourtant nombreuse et florissante des Maloches-Bordes, ou celle, plus compacte, des Bregaloux, qui ont tous le nez épaté ». Je n’en cite pas plus long : l’auteur s’attarde longuement pour commencer sur la description de l’esprit spécifique d’une famille particulière.
Le trait de caractère qu’il fait ressortir en vue du récit qui s’annonce est la sédentarité. Si les Mégremut voyagent, c’est par la pensée, ou plutôt par le rêve. On est bien où l’on est, on s’y est aménagé une sorte de nid douillet et confortable, et il ne viendrait à l’idée d’aucun membre de la « race » (le mot revient) de partir à l’aventure sur les routes. L’histoire de Sylvius sera racontée au narrateur par Barnabé de Mégremut-Landolle, surnommé « le Sage », le plus Mégremut de tous, et le seul Mégremut à ne pas avoir décroché le portrait de l’aïeul des murs de sa maison.
Car, heureusement pour la littérature, il y a une exception familiale : Sylvius, surnommé « le Sage ». Son bien est modeste, mais suffisant pour des besoins eux-mêmes modestes. Tout irait bien pour lui s’il n’avait pas une angoisse et une démesure : manquer. Non pas manquer en général, car il est content, au sens de l’expression « avoir son content », non, mais manquer de réserves de nourriture. Pourtant : « Il mangeait peu et buvait sobrement ».
Sa maison regorge de toutes sortes de victuailles : « Là s’alignaient jambons salés, saucissons drus, guirlandes d’oignons mordorés, claies rayonnantes de tomates, melons d’hiver suspendus au plafond, légumes secs, cornichons, piments, bocaux de gelées brunes ou roses, poissons fumés, coulis, conserves… ». Face à ces débordements : « Mais leur surabondance, bien loin de calmer ses inquiétudes, excitait sa fureur alimentaire, fureur qui, avec l’âge, tourna les préoccupations de Sylvius vers le ravitaillement en légumes secs ». Et c’est cette « ὓβρις » dont Sylvius est possédé qui va l’emporter dans son aventure. Il a soixante ans passés.
Avec sa carriole et le cheval qu’il a achetés spécialement, il se met à parcourir, par tous les temps, toute la campagne proche, écumant toutes les métairies possibles et imaginables pour s’approvisionner, et devient pour tous les Mégremut « Sylvius le Navigateur » (ici, permettez que je pense au voyage pataphysique qu’accomplit le docteur Faustroll « de Paris à Paris par mer »). La famille s’habitue donc à le voir partir, puisqu’elle le voit revenir à chaque fois.
Et tous ces voyages par monts et par vaux (pas trop loin de chez lui quand même) auraient continué à se dérouler sans heurts si Sylvius n’avait pas eu, une veille de Chandeleur, la drôle d’idée de « mettre à la cape » en direction de la vaste lande des Hèves, « désertique étendue, où jamais il n’avait aventuré sa carriole, car on n’y trouve, et loin encore, qu’un petit bourg perdu, Lobiers, entre deus étangs et des bois de saules ». Et Sylvius affronte bravement l’espace inconnu et enneigé.
Soudain l’attelage tombe en arrêt : c’est un cheval mort, dans lequel tout est mort, même l’os frontal (si si, c’est précisé). Sylvius, tout à fait perdu dans la nuit froide, se laisse conduire par Melchior le cheval jusqu’à une maison basse où il peut se restaurer. Mais quand son hôte parle d’une roulotte qui vient de passer tirée par un pauvre cheval et qu’il dit avoir vu le cheval mort, Misé (c’est son nom, presque claudélien) décide de l’accompagner jusqu’à Lobiers. Les voilà partis.
Arrivés à destination, ils croient le village déserté par ses habitants, jusqu’à ce qu’ils avisent une lumière à l’intérieur de l’écurie appuyée à l’église. Tout le village est assemblé là : un petit théâtre a été monté. Tiens, ça me rappelle L’Enfant et la rivière. La représentation va son cours. Une fois achevée, on voit apparaître un vieillard et une jeune femme.
C’est alors que tout pivote. Misé prend la parole : « Comme ça, vous avez perdu votre cheval ? ». Stupeur générale. Sylvius en rajoute : « Il y a Melchior ; c’est une bonne bête ». C’est bientôt dit : « Je suis à vous. Et je conduirai le cheval ». Voilà, la vie de Sylvius a basculé, il a trouvé sa vérité. Et son ancienne vie disparaît corps et biens, comme si elle n’avait pas eu lieu. On croit assister à la seconde naissance de Sylvius. Oubliés les Mégremut de Pontillargues, oubliée la maison bourrée de victuailles jusqu’à la gueule.
Mais la famille ne l’entend pas ainsi. Pour aller vite, réunie sous la houlette de tante Philomène (« C’était la tête forte de la famille »), elle lance messages et messagers vers tous les points cardinaux. Mais c’est en vain : « Sylvius resta introuvable ». Et la disparition s’éternise. Jusqu’à ce que, six mois après, sur un billet stupéfiant arrivé de la campagne, on lise : « Vous le trouverez samedi, aux Amélières, une lieue au-delà de la lande des Hèves. Il n’est pas seul ».
Un cortège de carrioles se met aussitôt en route, emmenant une forte délégation, Philomène en tête. On arrive aux Amélières. Ils trouvent Sylvius en pleine représentation. Il joue de la clarinette. La tribu Mégremut sanglote. Il faut ramener Sylvius chez lui. La population accepte de le laisser partir, mais à condition qu’il soit de retour à la Noël. Promesse en est faite.
Et c’est là que l’histoire devient belle et tragique. Sylvius a repris son existence douce et confortable, comme si rien ne s’était produit, gardant une indéfectible équanimité. Il semble avoir tiré un trait sur le théâtre et les Amélières. Mais pour Philomène, une promesse est une promesse. Quand Noël est arrivé, elle organise le voyage. Mais quoi, Sylvius a décidé de rester chez lui !
Qu’importe, on ira quand même : « Mélancolique et étrange voyage ». Mais quand on arrive aux Amélières, personne là où était le théâtre, seulement l’aubergiste, M. Léon, seul à les attendre. Pas de messe dans l’église. Plus de théâtre : la famille est partie et ne donne plus de nouvelles. Le retour, dans un très mauvais temps, est morose. A Pontillargues, on apprend que Sylvius est mort. Il est mort tranquille, sans être vraiment malade, en souriant comme à son habitude. On l’enterre dans l’enclos Sainte-Delphine. Pendant dix ans, un mystérieux bouquet est déposé sur la tombe.
Je n’ai pas très envie de conduire une analyse du récit. Juste une formule me vient pour en tirer une sorte de moralité : la tendresse Mégremut est comparable à une terrible chaîne scellée à la cheville des membres de la famille. Un boulet invisible enfonce l’individu dans le sol où il est né, comme s’il était un poteau. Une épouvantable douceur, une étouffante bonté, un amour insupportable à force d’être généreux. Un terrorisme sentimental. La famille la plus affectueuse peut être une horrible chose.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 02 septembre 2013
MEANDRES AVEC HENRI BOSCO
L’intéressant, quand on lit en rafale les livres d’un auteur, c’est qu’on perçoit rapidement, en quelques clics de regards successifs, ses tics et formalismes d’écriture, ses obsessions thématiques et ses petites manies. J’avais fait ça – plonger en immersion de longue durée –, il n’y a pas si longtemps, avec les Rougon-Macquart de Zola. Cela m’avait d’ailleurs éloigné de lui. Cette lecture m'avait fait osciller de la gourmandise la plus primaire à l'horripilation la plus stridente.
Zola a écrit, dans sa série soi-disant « scientifique », un certain nombre d’ouvrages insupportables (Le Docteur Pascal, La Faute de l’abbé Mouret, …), quelques-uns convenables (Son Excellence Eugène Rougon, …), et quelques autres rigolos (Nana, Pot-Bouille, …). J'en oublie sûrement. Pour moi, le Zola absolument rédhibitoire et pestilentiel réside presque tout entier dans l’infernal effort de démonstration. Tant qu'il se comporte en artiste-peintre, tout va bien. Je marche, parce que ça, vraiment, il connaît, il sait faire, il est très bon.
Mais chaque fois qu’il a quelque chose à prouver, il se comporte en bourreau : il ligote le lecteur au poteau de tortures, et lui assène, article par article, tous les commandements de la vraie foi, un nouveau Décalogue, en les détaillant, qui plus est, jusqu’à la plus infime virgule. Souvent caricatural à cause de ça. En un mot, Zola m'emmerde plus souvent qu'il ne m'intéresse. Je crois que le problème de Zola, c'est qu'il veut assener des vérités.
Son addition est lourde, consistant à alterner des énumérations dignes de la généalogie de Pantagruel et des raisonnements de commissaire du peuple à Moscou en 1937 : Emile Zola est alors digne du kouign-amann breton, pourtant encore à peu près digeste, même s’il est déjà relativement étouffe-chrétien, et, mieux encore, de l’authentique Christmas-pudding, dont les Britanniques eux-mêmes ne viennent à bout qu’après un usage énergique du burin. C’est d’ailleurs probablement d’une confrontation immémoriale avec le Christmas-pudding que les marins de Sa Majesté tiennent leur visage buriné. Pardon.
Sans en subir quelque séquelle que ce fût, j’avais auparavant pratiqué l’immersion de longue durée dans diverses étendues littéraires diversement profondes qui avaient nom Rabelais (immersion permanente), Montaigne (immersion récente) ou Balzac (immersion ancienne). J’avais aussi effectué des plongées de reconnaissance dans certains grands lacs américains nommés Steinbeck, Faulkner, Caldwell et quelques autres. Et ailleurs. Le retour à la surface s’était toujours déroulé sans dommage particulier. J’en avais conclu que Zola est un cas, mais alors un cas vraiment à part, un cas d’école peut-être. En clair : tout ce qu'il ne faut pas faire. En tout état de cause, on ne m’y reprendra plus.
L'immersion dans les eaux provençales des livres de Henri Bosco, pour parler franchement, je n’avais pas prévu. J’avais laissé au placard le masque, les bouteilles et les palmes. J’y suis donc allé d’abord en apnée, à faible profondeur. Et puis, je ne sais pas, peut-être que même là on risque l’ivresse ? Allez savoir. Ce qui est sûr, c’est que l’immersion s’est imposée d’elle-même. Il m’en est peut-être venu des branchies, après tout, à force de respirer sous l’eau. Allez savoir. Je garde en mémoire les vrais instants d'une vraie jubilation littéraire.
Ce n’est pas le coup de foudre, attention, on n’en est pas là. D’abord, on a passé l’âge. L’emballement de l’homme mûr, j’ai tendance à considérer ça comme un argument marketing développé par des cabinets d’avocats spécialisés dans le divorce, la garde des enfants, la récupération de grosses pensions alimentaires et autres prestations compensatoires, capturées au vol sur les cadavres consentants des maris infidèles et autres quinquagénaires en mal de peau lisse d’adolescentes attardées, celles qui sont à la recherche, tout à la fois, d’une épaule mâle et paternelle, d’un bel intérieur et d’un avenir matériel assuré.
Je n’ai aucune envie d'apparaître aux yeux du monde et de ses commérages comme le grand-père de mes enfants, ceux que pourrait soutirer de mes restes de fertilité séminale quelqu’une de ces femelles récentes, avides de sécurité de l’emploi, habiles dans le maniement du filet de pêche et passées expertes dans l'exhibition de diverses surfaces de peau soyeuse et de rondeurs savamment mises en valeur comme autant d'hameçons pour appâter le mâle impatient d'échapper enfin au spectacle du même nez au milieu de la même figure qu'il contemple depuis trop longtemps (cf. Auprès de mon arbre, de Georges Brassens). Moyennant les habituelles contreparties sonnantes.
Mais je me calme, je reprends mon souffle, et je reviens aux phrases courtes et à Henri Bosco. Je disais donc que ce n’est pas le grand amour. J’ai dit un mot du pourquoi de la chose mais, au-delà des sujets d’agacement, mes séances de plongée dans les eaux « bosciennes » m’ont permis d’apprécier une littérature française comme plus personne n’est en mesure d’en écrire. Même que c'en est un crève-cœur.
Si j’avais à caractériser l’univers de Henri Bosco en quelques mots, j’insisterais en tout premier lieu sur son amour incommensurable de la langue française, sur la très haute idée qu'il s'en faisait, sur la très haute exigence avec laquelle il la cultivait. Un amour de la langue française qui l'a amené, fidèlement au fil des ans, à la féconder et à lui faire des enfants magnifiques, écrits dans une prose riche et pleine, en même temps qu'exacte et précise. Qui sait encore écrire ainsi ?
J'insisterais ensuite sur l'aspect double de son univers : étranger et familier, proche et lointain, profond et épidermique, inquiet et serein, lisse et épineux : « Cela m’effraye. Cela aussi me charme ». De même, et de façon plus visible, l’état du narrateur est très souvent un « entre-deux », une hésitation entre la veille et le sommeil, entre le songe (Bosco parle rarement de "rêve") et la réalité, entre l’ombre et la lumière, entre la nuit et le jour. Une littérature du "peut-être", en somme. Une littérature de l'interrogation, voilà.
Les quelques livres que j’ai lus ces temps-ci regorgent de ces formules où le narrateur, quand il fait mine d’avancer, se débrouille pour préparer un éventuel recul : « J’entendis ce soupir, je pressentis cette aise, mon cœur s’apaisa.
Je ne savais que trop ce qu’il contenait de détresse et d’amertume ». Et encore : « Seul, ce cri insistant et d’une sauvagerie si mélancolique … ». Et encore : « … l’extrême lucidité de ma conscience en exaltation … ». Ces quelques formules sont picorées dans L’Antiquaire. Les délices ne sont jamais très loin de la terreur, à croire qu'elles sont réversibles les unes dans l'autre et inversement. Ou qu'on a affaire à deux polarités qui n'existent que se nourrissant l'une de l'autre, indissociables.
Il n’est pas jusqu’au narrateur lui-même qui ne se dédouble à l’occasion, et même plus souvent qu’à son tour. Toujours dans L’Antiquaire : « Car, seriez-vous entré (…) si vous n’eussiez porté à votre insu, en vous, un personnage différent de celui que vous êtes d’ordinaire, et qui s’est révélé soudain, grâce à cette rencontre ? » ; « Je perdis le pouvoir de me distinguer de moi-même …». J'avais noté le même dédoublement chez le narrateur d'Un Rameau de la nuit. Je pourrais continuer sur le thème.
Sans tomber dans l’étude systématique qui ferait fuir tout le monde, moi le premier, je dirais que Henri Bosco écrit avant tout pour creuser. Le Bosco est un animal fouisseur. Je vois en lui l’écrivain de la profondeur : celle de la nuit, celle de l’être, dont on ne sait combien d’êtres cohabitent au fond de lui, celle du mystère qui rattache l’être au monde, à commencer par la terre agricole, mais aussi le mystère qui lie les êtres entre eux, à commencer par l’homme en face de la femme qu'il aime. Jamais sans réticence. Pas facile de se donner, quand on est un personnage de Bosco.
Il y a chez Bosco (c'est une impression) autant de besoin de don de soi que de réticence à se donner. Un obstacle sépare bien souvent le narrateur de la statue resplendissante de la plénitude et de l'accomplissement. On pressent l'idéal, il n'est pas loin, mais on dirait que le réel oppose sans cesse l'opacité de sa matière à l'effort fait pour l'atteindre.
Les personnages successifs de narrateur sont des microcosmes qui tendent sans cesse à reconstituer l'univers au-dedans d'eux-mêmes, qui aiment laisser se mouvoir en eux le pressentiment du divin et de l'infini, mais qu'un objet bêtement concret, ou bien une innommable peur empêche d'inscrire ce désir immense dans la réalité. Car le désir est immense, mais il reste intérieur. Henri Bosco nous fait percevoir la limite, qui produit la frustration et la déception, mais aussi l'espoir.
Une autre obsession de l'auteur est l'omniprésence du songe. Pas du rêve, mais du songe. Le plus souvent vaste, nocturne, éventuellement dangereux. Le songe, jamais raconté dans son contenu et son déroulement (pourtant raconté en détail dans Le Récif), ouvre à l'esprit du narrateur l'espace infini de tous les possibles, qui vient compléter toutes les insuffisances de la raison et de la réalité concrète.
Il me semble que le songe, chez Bosco, est à la base d'une familiarité avec les êtres de même nature (ainsi la tante Martine), mais aussi avec les choses, que l'esprit du narrateur dote d'une existence propre, d'une sensibilité. D'une âme, pour ainsi dire. Le monde de Bosco est profondément animiste.
Et puis le grand mystère de l’existence. Il ne fait guère de doute que Henri Bosco est catholique. Ah non, il ne prêche pas, c’est certain. Simplement, c’est bien rare si une messe n’est pas dite à un moment ou à un autre, par un prêtre en tenue sacerdotale, devant un auditoire de fidèles plus ou moins fourni (parfois aucun, comme dans L'Epervier). C'est aussi bien rare si le narrateur n'est pas poussé à la prière, à un moment ou à un autre.
Même Baroudiel le mécréant, à la fin de L’Antiquaire, assiste en compagnie de son ami François Méjean à une messe : « Tous les gestes étaient de louange et d’extase ». On ne saurait être plus clair. Je le dis nettement : la présence de cette foi dans les livres de Bosco ne me rebute en rien. Et pourtant Dieu lui-même sait que je suis un incrédule endurci ! Païen irrévocable. Remarquez que Bosco lui-même ne serait pas exempt de toute accusation de paganisme, du fait du culte de la Nature qu'il professe. Disons, au moins, préchrétien.
Païen irrévocable donc. Et pourtant, ça ne m’empêche pas d’écouter religieusement Vingt regards sur l’enfant Jésus, le chef d’œuvre d’Olivier Messiaen, ou la Passion selon Saint Jean, de JSB. L’absence de foi ne saurait s’offusquer de la foi, cette force qui pousse l'homme à s'élever au-dessus de sa condition, quand l'expression de celle-ci crée des formes (poésie, musique, ...) où le sens supra-terrestre n'est jamais tout à fait explicite.
Même un païen peut tomber en arrêt, médusé, devant la merveille du chevet de Saint Austremoine d'Issoire. La traduction concrète de la foi n’est, à tout prendre, que la fumée du brasier de l’angoisse existentielle où se consume le bois sec et craintif de l’esprit humain (depuis l’aube des temps, comme on dit). Le fond du message prime-t-il sur la forme dans laquelle il a été formulé ? Ou l'inverse ?
Ce respect radical et immédiat que j'éprouve envers tous les monuments nés de la foi des hommes n'est peut-être, sait-on jamais, qu'une manifestation occulte de je ne sais quelle nostalgie du temps lointain où rien, en moi, ne contestait sa lumière, alors irréfutable ? Qui pourrait dire quel travail s'est fait ensuite ?
Pour dire combien ce temps est lointain, je me dois de confesser aujourd’hui avoir, quand j’avais sept ans, jeté la noire panique du néant satanique dans l’âme pure et pieuse de la pauvre « Sœur de Marie Auxiliatrice » qui me faisait le catéchisme, en lui affirmant qu’il était rigoureusement impossible, impensable, inimaginable, bref : déraisonnable d'admettre qu’un homme puisse revivre trois jours après sa mort. Affolée, elle avait repris toute l’affaire de A à Z. Je veux dire qu'elle avait récité fidèlement ce qu'on lui avait appris.
Conciliant et bon prince, j’avais écrasé le coup : on n’allait pas y passer le réveillon ! J’avais ma partie de billes en perspective. Guy B. me devait une revanche. Ça motive. Mais je garde encore en mémoire la terreur abyssale qui s'est peinte sur le visage de la nonne quand j'ai posé ma question. Mea culpa, ma sœur.
C'est sûr, de ce point de vue, Henri Bosco et moi, nous ne sommes pas de la même famille d'esprit. Mais ça n'empêche pas l'estime, et même l'admiration envers l'art d'écrire manifesté dans ses œuvres, art dont il possède la maîtrise accomplie, et qui a à peu près disparu aujourd'hui du paysage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, henri bosco, émile zola, le docteur pascal, la faute de l'abbé mouret, sonexcellence eugène rougon, nana, pot-bouille, christmas pudding, rabelais, balzac, auprès de mon arbre, georges brassens, l'antiquaire, un rameau de la nuit, le récif, tante martine, l'épervier, accipiter, olivier messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, jean sébastien bach, passion selon saint jean, saint austremoine d'issoire, catholique, chrétien
dimanche, 01 septembre 2013
SAN ANTONIO ÜBER ALLES
***
Mais revenons à nos san-antoniaiseries. Je le répète : dans un bon San Antonio, la langue jubile. Et le lecteur avec. C’est vrai que, tout bien pesé, ça ne pisse pas loin, c'est bas de plafond, c'est souvent ringard, mais au moins, d'abord ça fait plaisir, ensuite ça repose, enfin l'avantage, c'est que ça ne se hausse pas du col à toiser la populace du haut de son œil pincé comme un anus de gallinacé. Vous avez remarqué ? San Antonio, sodomiser des bestioles de la famille des syrphidés (ordre des diptères) n’est pas son fort. Ci-dessous, « parasyrphus lineola» (non, ce n'est pas une guêpe, c'est un syrphidé, je veux dire une mouche).
Ceux qui se haussent du col font juste croire qu'ils font partie de ces seigneurs en mie de pain qui se font passer pour des statues en marbre de Carrare ou de Paros et, pour arriver à leurs fins, ils arborent, entre leurs deux mâchoires en béton armé, le sourire californien, vous savez, celui qui est tout niaiseux de contentement, façon Beach Boys, celui qui a fait tant de tort aux moniteurs de ski entre Courchevel et Megève.
Eux, je prétends donc que ce n’est pas leur bouche, mais leur œil qui est en cul de poule. Pas mal trouvé quand même, non ? "Avoir l'œil en cul de poule" ? Je vais déposer la marque à l'INPI. Mais l'œil en cul de poule, m'est avis que ça doit leur faire mal quand ils l'ouvrent. Je ne leur ai jamais examiné le rectum, pour m’assurer s’il s’apparentait de préférence à l’un ou à l’autre orifice, mais si leur œil se mettait à déféquer en vous regardant, je n'en serais pas autrement étonné. Est-il, Dieu, possible de donner au spectateur une telle impression de chier, juste en soulevant la paupière pour vous envisager ? Je m'égare.
Remarquez pas tant que ça, si je me souviens d'un poème vaguement scatologique qui avait cours dans la famille à l'époque où il y avait des pots de chambre, au fond desquels était parfois peint un gros œil, façon : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Le poème familial finissait, pour sa part, ainsi : « L'œil était dans le fond et regardait mon père ». Bon, c'est sûr que ce n'est pas pour de pareils vers qu'on entre à l'Acadéfraise.
Pour revenir à La Vérité en salade, dès le nom de la personne qui demande le secours du fils de Félicie, sa « brave femme de mère », ça commence à carburer : Mme Bisemont (bise mon quoi ?). Un nom qui me fait penser à Votez Bérurier et à son immortel « Bellecombais, Bellecombaises », qui introduit sa harangue de candidat à la mairie de Bellecombe. Je ne m'en lasse pas.
Mme Bisemont est une vioque chargée comme un arbre de Noël de breloques en or massif, qui s’envoie en l’air avec un petit jeune, qui a lui-même une jolie copine, avec laquelle il imagine un stratagème pour soutirer un peu de compensation financière à son dévouement sexuel. Seulement, tout ça vire mal, et ça fait toute une histoire.
Vous avez remarqué que l’intrigue est présente, évidemment, chez San Antonio, sans ça il n’y aurait pas de roman, mais qu’elle devient parfois le cadet des soucis de l’auteur, en particulier quand il s’agit de résoudre l’énigme. Frédéric Dard se fiche souvent du dénouement comme de sa première étrangleuse à rayures (mettez "limace à carreaux lilas" si vous préférez). Comment ça finit, c’est le cadet de ses soucis, et il a, pour conclure, des manières parfois tout à fait cavalières.
Mais quand il est en forme, la langue frétille comme un gardon qu’un hameçon cruel vient de tirer des eaux trop claires de la Cérigoule. Voyez page 33 de La Vérité en salade. Je ne vais pas recopier la tirade, juste la fin : « Grandes premières en habit ! Petites dernières ! Balzac zéro zéro zéro un ! ». Soudain, l’esprit des amateurs de cinéma fait tilt ! Ils viennent de reconnaître un classique. Bon sang mais c’est bien sûr : « Jean Mineur publicité, 79 Champs Elysées », le petit mineur qui lance sa rivelaine à la fin de la séquence publicitaire, à l’entracte ! Dard, on peut dire que tout lui est bon. Peut-être parce que c'est un cochon ?
Pas la peine de faire l’éloge de San Antonio : il s’en occupe tout seul. Mais avant de terminer mon laïus, une révérence du côté de l’illustrateur favori de la série pendant les vingt premières années de son existence : Michel Gourdon (voir Viva Bertaga plus haut, et la grosse demi-douzaine montrée hier). Les illustrations de couverture ont acquis grâce à lui une homogénéité de ton, une cohérence qui vous fait repérer aussitôt les premiers tirages dans les boîtes des bouquinistes (bien vérifier cependant que la date de dépôt légal coïncide avec le copyright).
Personne n’est éternel, heureusement, et l’éditeur a été obligé de se tourner vers d’autres illustrateurs, avec plus ou moins de bonheur, il faut bien le dire. C’est sûr que le style Gourdon ne donne pas une idée juste du « ton » San Antonio, parce que ses images semblent prendre la chose au sérieux, et annoncer un polar comme tous les polars, bien carré. Or San Antonio n'est pas carré, il est tordu, il le sait et il le dit. Tenez, c'est dans lequel que le commissaire croise la route d'une belle nana qui a ceci de particulier qu'elle enlève sa culotte sans y mettre les mains ? Essayez pour voir. Je crois me souvenir que c'est une Israélienne, qui se paie un entre-deux avec Béru et San A.
Mais il ne faut pas oublier que les aventures du commissaire sont publiées dans la série « Spécial Police », et que la présentation obéit donc à certaines règles éditoriales. L’humour et les allusions salaces n’apparaîtront que plus tard en façade. Celles que j’apprécie sont celles qui rappellent les dessins que Pierre Etaix (oui, le cinéaste, le clown, le ...) avait faits pour Les Petits mots inconvenants (Balland), un livre rigolo de Jean-Claude Carrière : salaces, mais subtils et humoristiques.
Certes, le commissaire San Antonio est un vieux réac, un misogyne, un homophobe de première bourre (et je ne sais pas ce qu'il pense des Arabes), et c’est sûr qu’aujourd’hui, il ne pourrait plus déblatérer ses horreurs sur les gonzesses ou sur les fiottes (et fières de l'être) sans se prendre dans le buffet autant de procès que le malfrat récalcitrant encaisse de valdas défouraillées par le soufflant d’un argousin de littérature devenu un personnage quasiment historique. Mais c’est peut-être ce qui me le rend sympathique, justement. Je prends le risque des valdas. Il faut bien mourir de quelque chose, n'est-ce pas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, san antonio, frédéric dard, humour, langue française, polar, roman policier, bérurier, viva bertaga, michel gourdon, les petits mots inconvenants, jean-claude carrière, pierre étaix
samedi, 31 août 2013
BRAVO SAN ANTONIO !

"LES ESCLAVES AU BRESIL : IL SE FIT ECRASER LA TÊTE ENTRE DEUX TAMPONS".
LE COMMISSAIRE BOUGRET VERRAIT ÇA, IL CONCLURAIT QUE LE GARS N'EST PEUT- ÊTRE PAS VENU LÀ DE SON PLEIN GRÉ, ET QUE CE N'EST PEUT-ÊTRE PAS UN SUICIDE.
ÊTRE PAS VENU LÀ DE SON PLEIN GRÉ, ET QUE CE N'EST PEUT-ÊTRE PAS UN SUICIDE.
"AH PATRON, C'QUE VOUS ÊTES FORT !", S'ECRIERAIT ALORS L'INSPECTEUR CHAROLLES.
***
 Car c’est sûr, les meilleurs San Antonio sont ceux où Frédéric Dard y va joyeusement du calembour minable, de la niaiserie délicieuse, de la blague de bistrot, de la brève de comptoir à deux balles, bref, quand il lâche les chevaux-vapeur à l’inspiration, à l’imagination. Dans le registre minable ou dérisoire si possible. Quand il débride le moteur de Ferrari qu’il a sous le capot de son bolide verbal. Quand il lâche la bonde au fleuve puissant de l’invention lexicale. C’est là, je le dis, qu’il est le meilleur.
Car c’est sûr, les meilleurs San Antonio sont ceux où Frédéric Dard y va joyeusement du calembour minable, de la niaiserie délicieuse, de la blague de bistrot, de la brève de comptoir à deux balles, bref, quand il lâche les chevaux-vapeur à l’inspiration, à l’imagination. Dans le registre minable ou dérisoire si possible. Quand il débride le moteur de Ferrari qu’il a sous le capot de son bolide verbal. Quand il lâche la bonde au fleuve puissant de l’invention lexicale. C’est là, je le dis, qu’il est le meilleur.
Un bon San Antonio, c’est celui où la langue jubile. Que dis-je, effervesce, érupte, éructe, turgesce, éjacule et surrectionne. Certes, on est dans le registre populo, familier, argotique, mais je n'y peux rien : l'argot entre dans le corpus des langues, vivantes ou mortes, que je pratique avec délectation, chaque fois que l'occasion m'en est fournie. Sans l'argot, la langue française ne se mâcherait pas avec autant de gourmandise.
Et il me faut bien reconnaître que, dans Du Mouron à se faire, elle est obligée de se faire reluire elle-même, la langue, parce que personne ne lui fait rien, à la pauvrette, qu’elle fait tapisserie (comme on ne dit plus) et que, réduite à se palucher elle-même, la « joie » qui en résulte n’a rien à voir avec les étoiles, les planètes et les galaxies qui l’illuminent quand quelqu’un d’assez doué la chatouille et l’entreprend comme il faut, là où il faut et en profondeur. Dans ce volume, la langue doit se contenter de l’orgasme du pauvre. Si on peut appeler ça un orgasme.
obligée de se faire reluire elle-même, la langue, parce que personne ne lui fait rien, à la pauvrette, qu’elle fait tapisserie (comme on ne dit plus) et que, réduite à se palucher elle-même, la « joie » qui en résulte n’a rien à voir avec les étoiles, les planètes et les galaxies qui l’illuminent quand quelqu’un d’assez doué la chatouille et l’entreprend comme il faut, là où il faut et en profondeur. Dans ce volume, la langue doit se contenter de l’orgasme du pauvre. Si on peut appeler ça un orgasme.
Certes Karl Marx disait : « A chacun selon ses besoins. De chacun selon ses moyens », mais on n'est pas obligé de le croire. Cela veut dire qu'on ne peut pas toujours être au top. Enfin, je crois : on ne m'a jamais demandé de faire le traducteur, ce qui fait que je n'ai jamais essayé de transcrire de langue charabiesque en langue galimatiesque.
C'est vrai aussi qu'à l'opposé, il arrive à Dard d'en faire trop. Quand il est trop Dard, en quelque sorte. Pardon. Dans J'ai essayé : on peut ! (le titre est excellent et, pour une fois, justifié et expliqué, mais il ne faut rien exagérer), il en fait des tonnes, il en rajoute dans la sanantoniaiserie, dans la digression parasite, dans le méandre sinueux (« Pléonasme, sortez des rangs ! », braillait l'adjudant de Fernand Raynaud), dans le détour filandreux, dans le festonnement ornemental, dans le plissement associatif des idées, que le lecteur en perd totalement de vue l'argument, l'intrigue et la dramaturgie. C'est dommage. Comme si San Antonio virait à la littérature expérimentale.
Non, Frédéric Dard n'est pas James Joyce : un seul suffit amplement (moi qui ai lu Ulysse, parfaitement, oui monsieur, je ne sais pas trop, d'ailleurs, ce que les thuriféraires de l'Irlandais lui trouvent de si génial. Ah si, c'est vrai, il paraît qu'il a cassé les (attention les yeux !) « codes narratifs »). Je salue bien bas, mais je n'en pense pas moins : qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, des codes narratifs ? Frédéric Dard brille de tous ses feux quand il a trouvé l'équilibre de son déséquilibre. Je ne sais pas si vous suivez.

 Et cet équilibre, il peut le trouver. La preuve, si vous ouvrez La Vérité en salade, vous vous rendez tout de suite compte que vous avez tiré un bon numéro. D’abord à cause des « témoignages » affichés à la porte d’entrée, tous plus « san antoniesques » les uns que les autres, comme celui de Monsieur Vermot, profession Almanach : « Vos San-Antoniaiseries nous font beaucoup de tort ». Ou celui-ci : « Les bras m’en tombent », signé La Vénus de Milo. C’est idiot, mais c’est sympa. Ça met en confiance. Ça se met à la hauteur du lecteur. Je veux dire que ça accepte de descendre jusqu’au lecteur. Ça con-descend, même, on pourrait dire.
Et cet équilibre, il peut le trouver. La preuve, si vous ouvrez La Vérité en salade, vous vous rendez tout de suite compte que vous avez tiré un bon numéro. D’abord à cause des « témoignages » affichés à la porte d’entrée, tous plus « san antoniesques » les uns que les autres, comme celui de Monsieur Vermot, profession Almanach : « Vos San-Antoniaiseries nous font beaucoup de tort ». Ou celui-ci : « Les bras m’en tombent », signé La Vénus de Milo. C’est idiot, mais c’est sympa. Ça met en confiance. Ça se met à la hauteur du lecteur. Je veux dire que ça accepte de descendre jusqu’au lecteur. Ça con-descend, même, on pourrait dire.
Je n’y peux rien, quand je lis ça à l’entrée de la boutique, j’ai envie d’aller voir de plus près ce qu’il y a en magasin. Ça me coupe les vacances agréablement, parce que ça me fait oublier un moment l’ennui qui accompagne presque toujours ces parenthèses de vacuité existentielle, aussi vides que les dimanches après-midi des enfances mornes et familiales. Autrefois. C’en est curieux : comment se fait-il que les vacances soient devenues synonymes de bain de jouvence, de compensations bénéfiques et de réparations salutaires de tout le mal que représente la vie normale pour une foule invraisemblable de gens ?
boutique, j’ai envie d’aller voir de plus près ce qu’il y a en magasin. Ça me coupe les vacances agréablement, parce que ça me fait oublier un moment l’ennui qui accompagne presque toujours ces parenthèses de vacuité existentielle, aussi vides que les dimanches après-midi des enfances mornes et familiales. Autrefois. C’en est curieux : comment se fait-il que les vacances soient devenues synonymes de bain de jouvence, de compensations bénéfiques et de réparations salutaires de tout le mal que représente la vie normale pour une foule invraisemblable de gens ?
 Moi qui demeure, quoi qu’il arrive, d’une courtoisie de qualité nippone (ni mauvaise), j’imagine bien ce que dirait San Antonio en pareille circonstance : « Mais bande de loquedus, si la vie normale vous stresse, pourquoi acceptez-vous sans barguigner de la mener, fidèlement et obstinément, jour après jour ? Alors ça, ça me les coupe, ça me les brise, ça me les menu ! Je ne sais pas, moi, ma vie normale me semble normale. Je veux dire qu’elle me contente à peu près. Individuellement, je veux dire. Et je dis bien « à peu près ». Mais enfin, vous rêvez à quoi, vous ? C’est quoi, cette caricature d’existence : onze mois de labeur chiant, un mois d’éclate ? Ça rime à quoi, ce cinéma ? ».
Moi qui demeure, quoi qu’il arrive, d’une courtoisie de qualité nippone (ni mauvaise), j’imagine bien ce que dirait San Antonio en pareille circonstance : « Mais bande de loquedus, si la vie normale vous stresse, pourquoi acceptez-vous sans barguigner de la mener, fidèlement et obstinément, jour après jour ? Alors ça, ça me les coupe, ça me les brise, ça me les menu ! Je ne sais pas, moi, ma vie normale me semble normale. Je veux dire qu’elle me contente à peu près. Individuellement, je veux dire. Et je dis bien « à peu près ». Mais enfin, vous rêvez à quoi, vous ? C’est quoi, cette caricature d’existence : onze mois de labeur chiant, un mois d’éclate ? Ça rime à quoi, ce cinéma ? ».
Bon, au lieu de s’exciter bêtement, on va fermer le clapoir du commissaire, bien qu’on ne puisse pas dire qu’il ait entièrement tort. C’est vrai que l’obsession vacancière, qui consiste en réalité à fuir sa propre maison en espérant se fuir soi-même, pour aller à grands frais s’entasser dans des boîtes de conserve de masse, pourvu que la conserverie soit en bord de mer, tout ça me semble assez épileptique, sudoripare et pestilentiel.
commissaire, bien qu’on ne puisse pas dire qu’il ait entièrement tort. C’est vrai que l’obsession vacancière, qui consiste en réalité à fuir sa propre maison en espérant se fuir soi-même, pour aller à grands frais s’entasser dans des boîtes de conserve de masse, pourvu que la conserverie soit en bord de mer, tout ça me semble assez épileptique, sudoripare et pestilentiel.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, frédéric dard, san antonio, bérurier, gotlilb, rubrique-à-brac, bougret charolles
vendredi, 30 août 2013
FREDERIC DARD ECRIVAIN

"LE SECRET DU NAVIRE : J'AI VU CLOUER SUR LA TABLE LA MAIN GRAISSEUSE DU MEXICAIN"
JOURNAL DES VOYAGES
***
J’ai donc lu récemment La Mort de Virgile, de Hermann Broch : les Grandes Jorasses par la face nord, sans assurance, en hivernale, en maillot de bain et en apnée. Ensuite j’ai lu Tante Martine, de Henri Bosco. Déjà, ça fait un choc, le passage de l’un à l’autre. Je devrais dire le basculement de l’un dans l’autre : du haut de la très haute montagne inhospitalière à l'oxygène raréfié, on descend dans les vallées parfumées de la Provence. Encore que, du moins me semble-t-il, l’esprit de Bosco et celui de Broch ne soient pas si étrangers l’un à l’autre qu’on pourrait le croire, en matière de quête spirituelle et de plongée dans l’insu.
Tout de même, à lire Bosco, on se sent presque en vacances par rapport à la contention radicale et verticale qu’exige Broch de son lecteur, tout au moins dans La Mort de Virgile. Tante Martine fait donc un peu figure de délassement, quand sa lecture intervient après. Mais Paul Valéry l’avait bien dit : « Ô récompense après une pensée / Qu’un long regard sur le calme des dieux ». C’est là qu’on se sent en vacances : Henri Bosco, c’est les vacances après Hermann Broch.
Les doigts de pied se mettent d’eux-mêmes en éventail, on est sur l’herbe douce, on commence à regarder les feuilles par en dessous et, de fil en anguille, après avoir apporté sa modeste contribution à l’augmentation de capital du contentement de la copine étendue à côté, sans se demander si l’appel d’offre était réglementaire, légal, ou même moralement défendable, on sombre dans cette délicieuse somnolence de l’être procurée par le farniente. La Cérigoule murmure pas loin, gardant au frais le reste de rosé de Provence. Même les oiseaux piquent un roupillon. On était venus pour ça.
Alors maintenant, essayez d’imaginer, à l’intérieur même de ces vacances, somme toute encore un peu studieuses, des sortes de vacances au carré. Car qui passe authentiquement ses vacances à ne rien faire ? Et ça se comprend. Ne faire strictement rien, rester étendu au soleil comme la limace sur la feuille de laitue, c’est s’exposer au pire risque qui menace l’humanité souffrante : se mettre soudain à penser. Qui aurait la témérité d’affronter le monstre ?
C’est là, au milieu des après-midi torrides, dans la touffeur des étés où déjà pointe à l’horizon l’horreur de la rentrée, que vous vous accrochez à la planche de salut : un livre ! Vous avez bien lu. Mais pas n’importe lequel. Les vacances au carré ne peuvent décemment se passer ailleurs que dans un volume édité par les éditions Fleuve Noir, dans la collection « Spécial Police », et plus précisément dans la série passée à la postérité sous l’appellation générique de SAN ANTONIO. Voilà, c’est dit.

Maintenant, ce n’est pas parce que le nom magique est lâché qu’il faut se précipiter à l’aveuglette. Dans les cent soixante quinze titres parus, on dira ce qu’on voudra, mais il y a du bon et du moins bon, il y a à boire et à manger, il y a de la chèvre et du chou, du haut et du bas, de la poire et du fromage, du ziste et du zeste, du chien et du loup. Entre nous et le pont de l’Alma, ma petite sœur n’irait pas plus y mettre la main que dans la culotte du zouave. Il y faut un minimum de prudence, de circonspection et de discernement.
Il faut bien dire que le bon Frédéric Dard ne l’était pas tout le temps, et il lui est arrivé plus d’une fois d’avoir des coups de mou dans le porte-plume. C’est forcé, c’est humain, c'est normal et c'est comme ça : le meilleur chroniqueur de presse, qui sue sang et eau pour fournir avant le bouclage les 1500 signes quotidiens qui font bouillir sa marmite, il y a forcément du déchet dans sa production. On ne peut pas toujours être au top, c’est l’évidence. Même chez Alexandre Vialatte, on trouve parfois que l'auteur ne s'est pas donné trop de mal. Un frustration, certes légère, mais indéniable, s'ensuit fatalement. On dira que c'est la vie.

Les deux numéros de « San Antonio » que je viens de lire en sont l’illustration éclatante. Prenez Du Mouron à se faire, je vais vous dire, c’est laborieux, ça se traîne, on n’y croit qu’à moitié, et surtout, pas une seule page de bravoure. Quelques petites crottes de formules sont tombées sur le macadam pour faire plaisir, mais on sent bien que le cœur n’y est pas.
On dira, pourquoi le commissaire est-il allé se planquer à Liège, je vous demande un peu ? D’abord c’est la Belgique, et rien que pour ça, l’auteur aurait dû y réfléchir à deux fois. Ensuite, c’est la ville natale d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), passé à la postérité pour un seul air de bravoure et de baryton, c’est dans Richard Cœur-de-Lion : « Ô Richard, ô mon roi, L’univers t’abandonne … » (pour les amateurs, cliquez ci-contre). Un baryton plus un richard : deux raisons d’éviter, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, polar, san antonio, bérurier, frédéric dard, hermann broch, henri bosco, la mort de virgile, tante martine, roman policier, fleuve noir, grétry, richard coeur de lion, belgique, musique, alexandre vialatte
jeudi, 29 août 2013
HERMANN BROCH ECRIVAIN
LA MORT DE VIRGILE 3
Qu’est-ce qui fait céder Virgile à la colère de son empereur ? Je crois que le poète se rend compte que, lui comme son illustre souverain, ils sont chacun engagés dans une impasse, et qu’Auguste, en se mettant en colère, laisse entrevoir un défaut dans sa cuirasse (puisque sa raison souveraine n’a pas su venir à bout de celle de Virgile), agit comme jadis Alexandre le Grand quand il fut mis, face au « nœud gordien », de dénouer celui-ci, qu’il trancha simplement de son épée.
Un aveu de faiblesse, mais en même temps, l'affirmation d'une certitude et d'un pouvoir. Si la volonté de détruire l'Enéide est inaccessible aux arguments de la raison, autant en finir au plus vite avec les arguments, et autant le décréter du haut de la souveraine autorité du Maître.
Toujours est-il que Virgile consent à abandonner son précieux manuscrit aux mains d’Auguste, et que ce consentement le plonge dans un bain de félicité qui illumine toute la dernière partie. Il n’est ni dieu ni animal, et comme il est homme, il est à mi-chemin, comme tout le monde. Or le mi-chemin est somme toute l’espace impur, l’espace des dissonances entre les aspirations, les désirs et la réalité.
L’absolu n’est pas de ce monde, il faut que l’homme se résolve à l’idée d’être dans la dissonance, d’être lui-même une dissonance : « Il n’y a de dissonance, ni dans l’acte du dieu, ni dans celui de l’animal », écrit Hermann Broch. A croire qu’il a lu Sur le Théâtre de marionnettes, de Kleist : « De même aussi retrouve-t-on la grâce, après que la connaissance ait semblablement passé par, et à travers un infini. C’est ainsi qu’elle apparaît le plus pure dans la forme de l’homme, ou bien qui n’a aucune conscience, ou bien qui possède une conscience infinie : c’est-à-dire, et tout aussi bien, chez la marionnette et chez le Dieu ».
Dès lors, Virgile peut être en paix avec le monde et avec lui-même, ayant atteint le point de l’existence depuis lequel il n’est plus possible de percevoir des contradictions, le point à partir duquel l’individu saisit l’Unité de tout. C’est, au fond, ce que recherche le narrateur de L’Aleph, de Jorge Luis Borges, et qu’il découvre, stupéfait, dans l’escalier d’une simple cave, « à la partie inférieure de la marche, vers la droite ».
C’est aussi ce que recherche André Breton, quand il proclame : « Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçu contradictoirement » (Second manifeste du Surréalisme). Pour Virgile, cet instant de l’Unité retrouvée, on comprend que c’est l’instant qui précède la restitution de son âme à l’univers.
Il faut aussi parler du message ultime que Virgile adresse à son empereur (p. 351) : « La profondeur de ton œuvre est souvent énigmatique Virgile, mais maintenant tu parles également par énigmes.
– Pour l’amour des hommes, pour l’amour de l’humanité, le Dispensateur du salut s’offrira lui-même en sacrifice ; par sa mort, il fera de sa personne un acte de connaissance, un acte qu’il lancera à l’univers, pour qu’à partir de cette suprême réalité symbolique du secours charitable, la création commence à se développer ».
Je crois qu’il n’y a pas besoin d’expliciter l’identité du « Dispensateur du salut ». C’est une prophétie, si l’on se souvient qu’on est, au moment de cet échange, jour de la mort du poète romain, 19 ans avant l’ère chrétienne. Virgile prophète, maintenant ! Remarquez, Dante Alighieri (« Nel mezzo del camin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita ») l’a bien désigné et choisi pour le guider à travers l’enfer, le purgatoire et le paradis, pour le conduire jusqu’à Béatrice. D’ailleurs, Broch, à la suite de Dante, embauche à son tour le personnage de Virgile : « Il n’y a jamais eu qu’un seul guide, c’était toi ; toujours tu seras destiné à nous guider » (p. 243). On n’est pas plus clair.
Hermann Broch aime sans doute, dans la symétrie, la force symbolique : de même que, dans Le Tentateur, les douze chapitres (tiens, le même nombre que dans Au-dessous du Volcan de Malcolm Lowry), comme des chiffres sur le cadran d’une horloge, accompagnent et signifient l’écoulement du temps et l’accomplissement de l’action, de même, dans La Mort de Virgile, il borne les deux lourds chapitres où se concentre le sens au moyen de deux autres beaucoup plus brefs, où la respiration est plus facile.
Dans le premier chapitre (« l’eau – l’arrivée »), on suit les vacillements, hésitations et difficultés du cortège de la litière où gît le poète, depuis le navire jusqu’au palais, avec un détour par les bas-fonds abjects de la ville. Le deuxième chapitre (« le feu – la descente ») développe dans un long monologue intérieur les ruminations qui l’amènent à sa décision de brûler l’œuvre.
Le troisième (« la terre – l’attente ») voit le poète se confronter à des amis, qui sont aussi des admirateurs, qui sont incapables de comprendre à la suite de quel cheminement intérieur, il en est arrivé à cette décision. Le dernier chapitre (« l’éther – le retour ») se situe entre le moment du consentement (la soumission à la volonté d’Auguste) et celui de l’adieu. C’est le plus léger, le plus aérien. C’est le chapitre de la réconciliation de Virgile avec le monde et avec les limites humaines.
Je l’ai dit, l’intrigue (un roman, c’est une intrigue) est plus que mince et tient à pas grand-chose : un poète décide de brûler son œuvre, puis y renonce. Pour entrer dans ce livre absolument sans équivalent, il faut accepter de suivre le même itinéraire, il faut se faire un peu Virgile soi-même, il faut accepter de se laisser guider par l’âme du poète dans les méandres de son itinéraire complexe et subtil. Il faut renoncer au récit linéaire, et se laisser porter par le souffle d’une écriture ample comme l’espace. Je dirai qu’il faut accepter de se laisser perdre dans cette forêt profonde, ténébreuse et inspirée.
C’est le manuscrit de La Mort de Virgile que Hermann Broch emportait, quand il a quitté l’Allemagne nazie. En 1938, je crois. Il a bien fait, nom de Zeus !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, hermann broch, la mort de virgile, empereur auguste, alexandre le grand, énéide, kleist, sur le théâtre de marionnettes, jorge luis borges, l'aleph, andré breton, surréalisme, manifeste du surréalisme, dante alighieri, divine comédie, le tentateur, au-dessous du volcan, malcolm lowry, allemagne nazie
mercredi, 28 août 2013
HERMANN BROCH ECRIVAIN
LA MORT DE VIRGILE 2
Virgile se demande, au cours d’un très long monologue intérieur, ce qui est le plus nécessaire et vital à l’homme. Or, depuis le port jusqu’au palais impérial, sa litière, miraculeusement guidée par un jeune garçon inconnu (Lysanias ?), a traversé les bas quartiers de la ville, où croupit la lie de la population, dans des taudis puants, où des mégères vaguement prostituées lui font un cortège des pires insultes possibles.
Cette traversée de la fange humaine, jointe au curieux spectacle auquel il assiste au milieu de la nuit de trois épaves humaines, obèses ou squelettiques, qui vont on ne sait où en se disputant, dans des agressions verbales et physiques et en se chamaillant à propos d’argent, tout cela suscite en lui une sorte de dégoût de ses prétentions littéraires et poétiques : qui est-il en vérité pour s’être cru au-dessus du lot et d’avoir été célébré comme le plus grand poète romain vivant ?
Qu’est-ce qui prouve, en dernier ressort, « la non-vanité de l’effort humain » ? Si le langage sert à quelque chose, Virgile est saisi par l’impression, presque la certitude, de s’être parjuré, d’avoir souillé le serment qu’il avait fait en embrassant le métier de poète. Qu’est-ce que le langage, s’il est incapable de restaurer la communion essentielle entre les hommes ? A quoi bon, dès lors, écrire des chefs d’œuvre esthétique ?
Le poète devient un simple « porteur d’ivresse mais non un porteur de salut de l’humanité ». On le voit, l’ambition qui se fait jour dans Virgile mourant, c’est de sauver l’humanité. Or que peut son Enéide ? Rien, ou si peu. Une exigence morale absolue mène inéluctablement toute œuvre d’art à l’échec. Et Broch ne se fait pas faute de brocarder la figure de « l’homme de lettres », esthète dérisoire en regard de l’immensité de l’enjeu lié à l’acte créateur, esthète tout juste occupé à « idolâtrer son moi avide d’hommages » (cité en substance).
Si l’artiste s’avère incapable d’opérer la « mise à nu du divin par la connaissance introspective de l’âme », il n’est utile à personne. Car l’œuvre d’art, aussi ambitieuse soit-elle, est incapable de créer de la réalité. Elle crée du joli, du beau si l’on veut, c’est-à-dire les éléments à même d’orner le cadre de vie des hommes, mais définitivement incapable de modifier les conditions mêmes de cette vie : « Incapable de retrouver la communion de l’amour, il est forcé de se réfugier dans la beauté ».
Et qu’a-t-il peint, Virgile, dans son Enéide ? Des guerriers, des héros, des êtres d’exception, passant leur temps à combattre. Mais il le sait bien : « Il n’avait jamais réussi à figurer véritablement des hommes, des hommes qui mangent et qui boivent, qui aiment et peuvent être aimés, et encore moins ceux qui passent par les rues en boitant et jurant (…) et, à plus forte raison, [à] figurer le miracle d’humanité dont cette bestialité elle-même a reçu la grâce ». Il s’est borné à magnifier des êtres qui n’existent pas. Il est passé à des années-lumière de l’humanité réelle.
Il est saisi par cette illumination qu’il y a en lui « quelque chose de plus grand que lui », qu’il a échoué à traduire en langue humaine. Une seule issue à cet échec fatal et tragique : détruire L’Enéide. Hermann Broch place dans Virgile, le poète qui va mourir, l’aspiration à quelque chose qui le dépasse, et fait de lui davantage un « voyant » qu’un « annonciateur » (= prophète).
A la suite de la nuit épouvantable qu’il vient de passer, à peser le poids de sa propre vie par rapport à la masse de ce qu’il se rend compte qu’il n’a pas fait, longue épreuve métaphysique dont il sort transformé, Virgile estime que plus personne n’est capable de comprendre le point de vue où il se situe. Ses amis, Plotius et Lucius, sont immergés dans la socialité. Charondas, le médecin de cour qui l’examine, est plein de certitudes.
Le seul qui s’approche au plus près des scrupules de Virgile, c’est Auguste en personne, qui ne veut pas que le chef d’œuvre de la littérature romaine parte en cendres. Le dialogue entre les deux hommes occupe l’essentiel de la troisième partie (« la terre – l’attente »). Dans ce dialogue, aucun des deux (l’empereur et le poète) ne fait de concession sur ses convictions : l’un comme l’autre passe en revue ses arguments, et chacun va au bout de sa logique.
On arrive à la fin et, constatant que leurs deux logiques sont résolument incompatibles, César se met en colère. Et en vérité, c’est la colère d’Auguste face à l’intention désespérée de Virgile qui fait changer celui-ci d’avis. Cette colère a quelque chose de magnifique, car elle marque, d’une certaine manière, la victoire du poète sur l’homme le plus puissant du monde. Quoi, cet homme redouté de tous et devant lequel tous se prosternent, s’abaisser à se mettre en colère devant le caprice d’un histrion ! Tout ça parce que monsieur Virgile a des états d’âme !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, hergé, tintin et milou, tintin en amérique, hermann broch, la mort de virgile, poésie, virgile, l'énéide, empereur auguste



