vendredi, 28 février 2014
EN PENSANT A CEUX DE 14
MON MONUMENT À QUELQUES MORTS
Un journaliste se posait sérieusement la question, récemment, dans les colonnes de son journal, de savoir si la guerre de 1914-1918 avait été une « Grande Guerre » ou, plus probablement, une « Grande Boucherie ». Je trouve que poser la question cent ans après le début de ces sinistres festivités a quelque chose d'obscène, tant la réponse à la question est depuis longtemps évidente.

CARTE ENVOYEE A MAURICE PALIARD LE 27 OCTOBRE 1914, ET SIGNEE "ONCLE LEON"
Eh, crâne de piaf, ose un peu regarder en face une bonne fois pour toutes ce qui fut le premier suicide des peuples européens, la première Shoah, la première extermination de masse de tout ce que la civilisation européenne contenait de jeunes hommes pleins d'énergie et d'avenir.

PALIARD EST LE DEUXIEME EN PARTANT DE LA GAUCHE
Les champs de bataille du nord et de l'est de la France ne furent en effet rien d'autre qu'un gigantesque camp d'extermination, chambres à gaz comprises (je pense au gaz moutarde), sauf que tout se passait à ciel ouvert, et avec une sorte de consentement unanime de la « communauté internationale ». Oui, je sais que c'est ce cinglé de Guillaume II qui a commencé, et que c'est la folie du haut commandement allemand qui porte l'écrasante responsabilité de départ.

J'ai suffisamment évoqué par le passé l'horreur absolue que fut cette guerre de plus de quatre années (août 14 à novembre 18) et le serrement de cœur qui me prend chaque fois que je passe devant un monument aux morts érigé jusque dans les plus petits villages pour ne pas repartir dans un discours d'imprécations totalement inutile. Il ne faudrait pas, en passant, oublier les massacres de civils.

Le lecteur de ce blog peut aller feuilleter les deux albums ci-contre pour se convaincre que la plaie collective n'est pas, et n'a guère de chance d'être un jour pleinement cicatrisée. Et dire cela n'est pas veiller comme une Vestale sur la flamme du souvenir, c'est garder présente à l'esprit la conscience que le déclin de l'Europe, s'il est devenu évident aujourd'hui, date de cette époque.

La guerre de 1914-1918 n'est pas une catastrophe appartenant à un passé lointain : elle agit encore à sa manière dans les fondations si fragile de la nouvelle Europe que des margoulins et des crânes d'œuf œuvrant dans des bureaux climatisés s'efforcent de nous vendre et de nous imposer.

Je veux simplement penser une nouvelle fois à eux. Il se trouve que, parmi les cartes postales qui me sont parvenues par des biais familiaux, quelques-unes sont une évocation très directe de cette population masculine des campagnes de France qui ont été envoyées à l'abattoir.

PRESENTATION DU DRAPEAU AMERICAIN OFFERT A L'ECOLE MILITAIRE DE SAINT-CYR PAR L'ATTACHÉ MILITAIRE DES ETATS-UNIS EN DECEMBRE 1918
(légende écrite à la main au dos de la carte)
J'en publie donc ici, aujourd'hui, sans tomber dans la commémoration grandiloquente, quelques visages. J'ignore l'identité de presque tous : mon monument est anonyme, à une exception près. J'ignore à quelle date (sauf dans deux cas) les clichés ont été réalisés. Il y a un de mes ancêtres parmi eux (voir plus haut). Je ne sais pas combien sont arrivés jusqu'à l'armistice et dans quel état. Ce ne sont pas des héros. C'étaient des hommes.

PRISE D'ARMES, PEUT-ÊTRE APRES LE 11 NOVEMBRE 1918. LIEU INCONNU.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : les cartes postales non légendées sont muettes. Il est bien entendu que tout renseignement sur les dates, les lieux, les noms auxquels se réfèrent ces quelques images sera le bienvenu et l'objet de ma gratitude. Il n'est jamais vain d'espérer. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : guerre 1914-1918, monuments aux morts, poilus, grande guerre, histoire, france, centenaire, commémoration, shoah, chambres à gaz
jeudi, 27 février 2014
CHANTONS SUR LES CHARNIERS
BIGUINE A BANGUI, BIGUINE A BANGKOK
Aujourd’hui on se détend un peu. C’est l’actualité des événements qui se produisent dans le monde qui m’a fait penser à Charles Trenet et à sa chanson « Biguine à Bango ! » (cliquer pour visionner). Oh, la chanson est peu connue, certes, mais elle me fait irrésistiblement penser à ce qui se passe dans les capitales de deux pays : la Thaïlande et la Centrafrique.
En Thaïlande, une partie de la population en a assez d’être gouvernée par des gens appartenant à une élite corrompue jusqu’au trognon, et pour le faire savoir, elle est descendue dans la rue, au risque de se faire tirer dessus par les militaires de Yingluck Shinawatra, la sœur du nommé Thaksin, réfugié à l’étranger pour ne pas être coffré comme un vulgaire malfaiteur, pour corruption éhontée.

Tiens, au fait, est-ce que ce n’est pas le motif qui a poussé une bonne partie de la population ukrainienne à occuper depuis trois mois la place Maïdan ? Remarquez que, pas très loin de là, j’ai lu quelque part que certains Russes reprochent (en parlant assez bas pour ne pas être entendus de l’intéressé) à Vladimir Poutine d’avoir amassé depuis qu’il est au pouvoir une fortune aux dimensions inimaginables. Il posséderait ainsi plus de quarante résidences luxueuses. Il m'arrive de me demander ce que je ferais de quarante résidences, si j'étais dictateur. Passons.
Remarquez que les Tunisiens n’ont pas foutu dehors Ben Ali pour une raison différente, et que la première visite qu’ils ont faite dans le palais du dictateur leur a autant coupé le souffle qu’aux Ukrainiens celle que ceux-ci ont organisée dans l’invraisemblable propriété qu’occupait Ianoukovitch jusqu’à son départ. Et j’imagine que si les Egyptiens avaient pu visiter la propriété de Moubarak, ç’aurait été pareil : du marbre et de l'or. Il paraît même que chez Ben Ali, il y avait dans certaines pièces des murs de liasses de billets (je le tiens d'une bonne source, mais allez savoir).
Et peut-être un jour prochain ne sera-t-il plus permis aux Africains, les potentats Obiang, Sassou-Nguesso et autres Bongo de réinvestir dans la pierre et le foncier français (l'affaire des « biens mal acquis ») les sommes colossales qu’ils ont piquées dans les caisses de leurs Etats, sans parler des subventions accordées par la « communauté internationale » au titre de « l’aide au développement » (laissez-moi pouffer) qu’ils ont détournées à leur profit et planquées en Suisse, à Singapour ou aux Îles Vierges britanniques.
Vous en voulez encore ? Eh bien voyons du côté d'Ankara et d'Istamboul, et des islamistes de l'AKP dirigés par l'islamiste « conservateur modéré » (!) Redjep Tayip Erdowan (en phonétique). Un bon musulman, c'est certain, qui se garde de l'esprit de lucre comme de la peste. Tout faux ! Pris les doigts dans le cambouis de l'argent sale, le bon musulman !
Mais peut-être – espérons-le – qu’il n’est pas obligatoire dans tous les pays du monde que ce soient les bandits, gangsters et autres mafias qui arrivent au pouvoir.
Cela reste une question malgré tout, par exemple après lecture du copieux dossier paru dans Le Monde récemment au sujet des fortunes faramineuses accumulées par ce que le journal appelle les « princes rouges » et leurs héritiers. Je parle de la Chine, évidemment. N’est-ce pas le fils de l’un d’eux dont on a retrouvé les restes dans les débris fumants d’une Ferrari dernier cri ?
Il ne faut donc pas généraliser. On ne peut imaginer – je parle au hasard – que de tels abus puissent arriver dans notre beau pays de France. Jamais de la vie, voyons. Nous avons les capitaines de pédalo les plus intègres de la planète, tout le monde le sait et personne n’oserait contester cette vérité. Et dire que j’annonçais un moment de détente en commençant. Moralité, si l’on va où l’on a décidé d’aller, ce n’est pas toujours sans sinuosités et méandres. Bon, revenons à nos roustons.

Après la Thaïlande, si nous portons nos regards sur la Centrafrique, que voyons-nous, devant nos yeux ébaubis ? Après le pillage et le meurtre généralisés commis par les milices de la coalition nommée « Séléka », juste retour des choses, c’est maintenant aux milices nommées « anti-balaka » de se dire qu’il est temps de faire couler le sang. Ce n’est qu’une habitude à prendre, comme on peut lire dans l’impressionnante trilogie écrite par Jean Hatzfeld sur la tragédie rwandaise (commencer par l’absolument indispensable Une Saison de machettes).
C’est au détour d’amusements aussi simples que ceux fournis par ces informations que la loupiote d’une chanson de Charles Trénet se met à clignoter dans ma tête. Cette chanson, peu connue, je l’ai dit, s’intitule « Biguine à Bango ». Elle dit : « Connaissez-vous la Martinique ? Connais-tu là-bas le Bango ?… ». Voilà, c’est tout. Quoi, ça ne vous suffit pas ? He bien si. Remplacez « Bango » par « Bangui ».
Vous pouvez aussi remplacer « Bango » par « Bangkok ». Et vous comprenez pourquoi j’ai parlé de l’actualité en Thaïlande et en Centrafrique. Comment, je ne suis pas très sérieux ? Mais certainement, et non seulement je le reconnais, mais je le revendique haut et fort : il ne faut pas être sérieux sur les choses sérieuses, pas plus qu’il ne faut prendre à la légère les choses légères.
Que voulez-vous faire d’autre que du mauvais esprit, au spectacle des horreurs qui se commettent un peu partout dans le monde, et qui constituent le fonds de commerce de tous les médias d’information.
En me mettant à fredonner : « Woho ! Woho ! Biguine à Bangui ! » ou « Woho ! Woho ! Biguine à Bangkok ! », j’exorcise en quelque sorte un démon, celui qui, autrement, me laisserait tétanisé d’horreur. On me parlera de dérision, de manque de compassion, et ce ne sera pas complètement faux.
Mais je demande qu’on laisse ma compassion un peu tranquille de temps en temps. Ma compassion, si c’était une personne, elle serait classée parmi les grands brûlés, traitée en grand blessé, hospitalisée vite fait dans un service d’urgence, et le monde cesserait de la harceler pour lui laisser le temps de se remettre de tous ses traumatismes et de toutes ses blessures.
Ma compassion pour les misères du monde, elle n’en peut plus. Epuisée d’avoir été sollicitée sur tous les fronts des petites et des grandes tragédies qui ensanglantent les contrées émergées de la planète.
La compassion, ça suffit ! C'est juste pour ça que je fais semblant de rire ! Parce que, finalement, ça soulage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, corruption, france, politique, charles trénet, chanson française, biguine à bango, bangui, bangkok, centrafrique, thaïlande, thaksin shinawatra, yingluck shinawatra, place maïdan, russie, ukraine, vladimir poutine, tunisie, ben ali, égypte, moubarak, afrique, obiang, sassou-nguesso, omar bongo, argent sale, turquie, erdogan, islam, islamisme, musulman, coran, journal le monde, princes rouges, chine populaire, séléka, anti-balaka, jean hatzfeld, une saison de machettes, rwanda
mercredi, 26 février 2014
28 BALZAC : LE CHEF D’ŒUVRE INCONNU (1831)
J’avais vu en 1991, quand il était sorti en salle, le film que Jacques Rivette avait tiré, soi-disant, de la nouvelle de Balzac. Il l’avait intitulé La Belle noiseuse. Un film de quatre heures que j’avais cependant vu sans déplaisir, malgré la présence de Jeanne Birquain, pardon, Jane Birkin. Je ne sais pourquoi cette personne m’insupporte.
Ou plutôt je le sais, mais ça n’a aucune importance : quand elle a vu l’âge venir, elle s’est fait greffer un sourire en plâtre qui ne la quitte pas quand elle est en public. Passons. Le film est gratifié de quatre étoiles (le maximum) dans le dictionnaire de Jean Tulard, dans une notice signée Claude Bouniq-Mercier. Moi je veux bien.
Si je me souviens bien, c’est tout à fait exagéré : c’est un bon film, mais de là au chef d’œuvre, il y a un pas trop grand pour la longueur de mes jambes. C'est sûr que là, on entre dans l’irréfutable arbitraire des subjectivités et des goûts.
Emmanuelle Béart, le plus souvent complètement à poil, se laisse tordre bras et jambes par un artiste poursuivant un but mystérieux que le cinéaste voudrait bien nous faire pressentir. Les poses changent, la torture esthétique reste. Mais je simplifie sûrement. Je me souviens d’un très long panoramique à 360° sur la campagne qui entoure une superbe bâtisse provençale, sûrement très ancienne.
Quel rapport, du film au livre ? Le titre, et encore. Dans le livre, « La Belle Noiseuse » désigne l’ultime tableau peint par maître Frenhofer, celui qui doit couronner toute son œuvre, celui qui doit immortaliser son nom dans l’histoire des arts. Il y travaille depuis dix ans.
Dans le film, Michel Piccoli, artiste-peintre de son état, qui s’appelle Frenhofer, sûrement pour la filiation balzacienne, poursuit donc sa quête torturée de la perfection picturale en torturant le corps dénudé de l’alors encore belle Emmanuelle Béart, je dis « encore belle » parce qu’elle n’avait pas encore les deux pneus qui lui ont servi de lèvres par la suite, après le passage de la siliconeuse.
Mais pour dire le vrai, franchement, Rivette, Le Chef d’œuvre inconnu, l’œuvre écrite par Balzac, il s’en contrefiche allègrement, il s'en tape le fondement, il s'en brosse le nombril, au point qu’il n’en reste qu’un très lointain souvenir, si du moins le spectateur est de bonne volonté. Car il en faut, en même temps qu’un bel effort intellectuel pour faire le lien entre la nouvelle et le film.
Car le bouquin, qu’est-ce qu’il raconte ? Un grand maître de la peinture, supérieur à tous les peintres de son époque et reconnu comme tel par ses pairs, épuise son génie à faire en sorte qu’il se dépasse pour atteindre à une beauté qu’il espère surhumaine.
Soit dit en passant, Nicolas de Staël a sans doute succombé à l’échec d’une semblable ambition, quand il a choisi de se défenestrer, en 1955. Ceci pour dire qu’il y a du fanatisme religieux autocentré dans ce genre de tentative d’atteindre l’absolu. Je ne juge certes pas. Et il n'est pas le seul à avoir ainsi fini de croire qu'il pouvait.
Je me contente de plaindre (et d'admirer) l’artiste qui se trouve aux prises avec un démon venu du dedans, parce que je sais déjà, en même temps que je découvre son désespoir d’atteindre son idéal, qu’il ne l’atteindra jamais. Ce fut le drame de Giacometti, désespéré devant la tête de Michel Leiris, qu’il n’arrive pas, dit-il, à rendre comme il la voit dans sa tête à lui.
Mais saura-t-on jamais pour quelle exacte raison Nicolas de Staël s’est suicidé ? Peut-être même ne s’est-il pas suicidé, après tout ? Peut-être était-il simplement pris de boisson. Mais le Frenhofer de Balzac, il sait qu’il est un maître, car il lui suffit d’ajouter quelques coups de pinceau au magnifique tableau de son élève Porbus pour en faire un chef d’œuvre digne des collections de la reine de France auxquelles il est destiné.
Porbus existe, de même que son jeune ami le peintre Nicolas Poussin. L’histoire se passe en 1612. Le vieux maître Frenhofer, qui travaille donc depuis dix ans à parachever le chef d’œuvre de ses chefs d’œuvre cherche une jeune femme pour lui servir de modèle. Il se trouve que l’épouse de Poussin est remarquablement belle, mais le peintre, déjà un peu reconnu par ses pairs, rechigne à la laisser poser nue sous les regards de Frenhofer, car il en est encore très amoureux et très jaloux.
Mais l’histoire n’ira pas à son terme, car Frenhofer, fanatisé par l’espoir d’absolu placé dans son travail ultime de « La Belle Noiseuse », interdit à quiconque de s’approcher de sa toile. Et le jour où, après d’âpres négociations qui ont mis des aspérités pointues dans la parfaite entente (jusque là) entre Poussin et sa tendre épouse, Porbus et ce dernier sont autorisés à entrer enfin dans l’atelier, ils ne voient sur la toile sacrée qu’un amas de couleurs informes.
A l’exception de, « dans un coin de la toile, le bout d’un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant ! Ils restèrent pétrifiés d’admiration devant ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction ».
Car Porbus et Poussin constatent que la monomanie exaltée de ce génie de la peinture, comme est présenté Frenhofer, l’a conduit à barbouiller une infamie picturale sur la toile qui devait consacrer son éternel génie. On apprend que, dans la nuit suivante, la maison de Frenhofer a brûlé, avec Frenhofer et avec tous les tableaux : mis en face de ce chaos sorti de sa palette, l’artiste n’a pas supporté de voir cette réalité en face, d’avoir fait du n’importe quoi. Le débat vital où se débat l'artiste (doit-il privilégier le dessin ou la couleur ? le trait ou la surface ?) s'abolit à l'instant même, pour que le récit verse dans le tragique.
Dans le film de Rivette, disons-le, il ne reste rien de cette quête d’un absolu. Quand Piccoli enferme dans un mur la toile obtenue après les longues tortures qu’il a fait subir à la dénudée Béart Emmanuelle, il retourne s’asseoir dans son fauteuil à côté de celui de Jeanne Birquain, pardon Jane Birkin.
Un film de bourgeois futile plein de son angoisse existentielle, retrouvant à la fin le confort de sa continuité nantie et la chaleur de son coin du feu habituel, là où Balzac traçait le portrait tragique d’un grand artiste soudain mis en présence de son propre néant, et qui, dès lors, préfère s’anéantir.
Autrement dit la différence qu’il y a entre la comédie de boulevard et une tragédie de Racine.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cinéma, littérature française, balzac, le chef d'oeuvre inconnu, la belle noiseuse, jacques rivette, emmanuelle béart, michel piccoli, jane birkin, nicolas de staël, alberto giacometti, peinture, nicolas poussin
mardi, 25 février 2014
AUX CHIOTTES LES NORMES !
Préambule : voilà que l'Europe (laissez-moi pouffer !) autorise la culture des végétaux génétiquement modifiés. On nous dit que la dangerosité des OGM n'est pas prouvée. J'avais déjà parlé de ça il y a longtemps. J'y reviendrai peut-être.
En attendant, je dis et répète que le problème des OGM n'est pas d'ordre scientifique, mais d'ordre économique. Pour une raison très simple : la brevetabilité du vivant. Breveter une plante au simple motif qu'on a modifié un ou plusieurs de ses gènes en laboratoire, voilà la pure et simple saloperie qui pend au nez du monde futur.
Car mettre sur le marché des plantes dont la plus infime partie a été génétiquement modifiée n'empêche pas que le paysan, lui, c'est la plante entière qui l'intéresse. Résultat, il passe à la caisse pour payer.
C'est la confiscation pure et simple des semences par des entreprises multinationales privées (Monsanto, Syngenta, etc.), dont la seule raison d'être est d'engraisser leurs actionnaires. Avec une certitude, celle de finir leur vie dans la peau de richissimes rentiers.
Puisque chaque année, tous les paysans du monde seront forcés d'aller quémander les semences de l'année. Puisqu'ils n'auront pas le droit de réutiliser une part de celles obtenues dans la récolte passée, comme ils faisaient depuis les début de l'agriculture au néolithique.
Quant aux dégâts éventuels sur la santé des hommes, on verra bien dans trente ans. En attendant, l'histoire du « débat scientifique » est juste un rideau de fumée pour intoxiquer les médias et autres gogos.
*******
Le monde actuel, individualiste et marchand, ne veut plus de normes pour tout ce qui concerne les façons de vivre, d’où les « débats de société » autour du mariage homosexuel, de l’euthanasie, de l’identité française, … On se dit que, somme toute, tant que la norme reste un privilège réservé à la définition de la longueur des préservatifs ou de la courbure des concombres, elle est très utile parce qu’elle favorise le commerce des marchandises au sein de l’Union Européenne, et tout va bien.
Mais attention, pas touche la norme au commerce entre les personnes. Les désirs des individus sont des ordres. Mon désir est un ordre. Enfin, il faudrait plutôt dire un « désordre ». Car s’il est vrai que « mon désir est ma seule norme », on peut dire que, dans la formule, le sujet du verbe détruit l’attribut du sujet. La phrase « mon désir est ma seule norme » illustre à merveille le suicide de la notion même de norme. Son meurtre, si vous voulez.
Car si l’on impose des normes dans la fabrication des objets et marchandises dont les Européens font commerce, c’est précisément pour que tous les objets et marchandises fabriqués et vendus sous telle appellation obéissent à la même règle. La norme définit toutes les caractéristiques qu’un objet particulier a en commun avec tous les autres objets d’appellation identique. Tout ça paraît bête et bêtement évident.
Mais j’en déduis et conclus quant à moi qu’il faudrait réserver l’idée de « faire société » au seul monde des objets et marchandises. Car la norme dresse l’inventaire de ce que les éléments qu’elle définit ont en commun. C’est tout ce qu’ils partagent. A ce titre, on peut presque dire que seuls les objets « font société », puisqu’eux seuls sont soumis à des normes.
On va me rétorquer que j’exagère. Bien sûr, je grossis le trait, parce que c’est plus commode pour expliquer. On me dira qu’il y a la Loi, et que si ce n’est pas quelque chose que tous les citoyens ont en commun, je ne sais pas ce que je raconte. Certes, certes, mais je répondrai qu’au moment où chacun vit sa vie quotidienne, avec ses gestes, ses mouvements, ses va-et-vient, qui d’entre nous a le sentiment d’appliquer la loi ? Personne, j’espère. En temps normal et dans la vie normale, on ne pense pas au Code Civil, encore moins au Code Pénal.
La loi, c’est bien joli, mais si elle définit le cadre dans lequel s’organisent les relations dans la société, elle ne nourrit pas celles-ci, et heureusement. Non, ce qui nourrit les relations entre les gens, c’est quelque chose de plus immatériel et de moins codifié. Cela peut s’appeler le désir, l’intérêt, le mépris, la séduction, la haine, bref : l’homme. Dans ses contradictions et ses audaces, ses idéaux et ses lâchetés. L’humanité souffrante, quoi.
Et à ce niveau-là, les normes dont il est question, ça ne figure dans aucun Code. Disons que les gens, là où ils vivent, avec les gens qui les entourent, sont arrivés, à force, à une sorte de consensus. Pour faire les foins, il faut faire appel. Pour accroître la parcelle, il faut la complicité du voisin qui n’aime pas celui qui possède la surface convoitée. Pour accroître le bien, il faut signer un pacte avec le voisin pour convenir qu’après mariage des rejetons, tout ça formera un beau « tènement foncier ». Du classique depuis Balzac.
Tout ça pour dire que les consensus locaux s’obtiennent sur la base de circonstances particulières, de contextes et de situations spécifiques. Je veux dire que les consensus locaux ont défini les normes d’une communauté précise aussi longtemps que celle-ci est restée étanche et homogène. On peut dire « imperméable ». Je reconstruis le scénario comme je le vois, c’est vague et pas scientifique, mais ça reste assez vraisemblable.
Si l’on admet ce scénario flou mais crédible, on comprend ipso facto que ce qui vient perturber la norme admise dans la communauté A, c’est la confrontation avec la communauté B, aussi étanche et homogène. Le processus qui se met en place (appelons ça « remise en question », quoiqu’on puisse le qualifier aussi légitimement de « crise ») réajuste les positions de chacun en mettant en pratique la plastique des choses qui découle nécessairement de toute négociation, de toute confrontation, de tout accord.
C’est ce qui fait la différence entre les sociétés dites primitives et la civilisation née en Europe au moyen âge, où la circulation des hommes et des idées, les échanges de toute sorte et l’innovation sont devenus la base historique de ce qui caractérise la « civilisation occidentale ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 24 février 2014
QUELQUES OMBRES AU TABLEAU
LE MATIN
LE SOIR
L'ANSE
LE TEST DE ROHRSCHACH (VARIANTE)
10:56 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie
dimanche, 23 février 2014
AUX CHIOTTES LES NORMES !
Résumé : après avoir remarqué que la théorie du « genre », qui a envahi le champ social, les médias et qui est partie à l’assaut de l’école pour promouvoir dans le monde entier le point de vue (la « grille de lecture », les « lunettes », pour parler comme Bourdieu à propos des journalistes) de la communauté homosexuelle, je m’interrogeais sur les raisons de son succès actuel, du moins si l’on en croit ceux qui sont habilités (payés) à « causer dans le poste ». Je pointais la résistance légitime aux persécutions.
Mais parmi les raisons que j’entrevois, il en est une autre, qui me semble venir des eaux les plus profondes sur lesquelles avance l’esquif nommé « civilisation ». Et cette raison tient à l’évolution des rapports que nos sociétés entretiennent avec la question des interdits, des normes et des critères.
Grosso modo et pour simplifier, à mesure que les sociétés ont évolué vers la consommation de marchandises, la jouissance immédiate et l’individualisme, les populations se sont mises à rejeter ce qu’elles considéraient de plus en plus comme des contraintes.
Les normes n'ont plus été vues comme un bien commun, comme ce qui unit les citoyens d'un même pays, ce qu'on persiste à tort à appeler un « corps social », mais comme un ensemble insupportable de diktats, à faire disparaître d'urgence. Il faut choisir : s'il n'y a plus que des individus, il n'y a plus de société. De même et à l'inverse, s'il n'y a plus que de la société, l'individu s'abolit, dissout dans l'entité collective : c'est le totalitarisme nazi, stalinien, khmer rouge, le Petit Livre Rouge de la Révolution Culturelle chinoise .... Ah c'est sûr que l'équilibre est difficile à trouver !
Tout le monde admet, moi le premier, que toutes les coutumes et les cultures de toutes les peuplades de la Terre ont des particularités : les anthropologues et ethnologues ont noirci des milliers de kilomètres de parchemins savantissimes pour les décrire jusque dans leurs moindres détails, parfois abracadabrantesques à nos yeux.
Tout le monde admet par conséquent que toutes les coutumes et les cultures de la Terre, du fait de ce particularisme, comportent à leur base une part incompressible d’arbitraire. Nos coutumes et cultures d’Occidentaux endurcis comme celles de tous les autres peuples.
Et dans le maelström de la globalisation à outrance découlée de la généralisation de la société marchande, ces particularismes, en même temps que leur caractère arbitraire, sont devenus totalement insupportables. La liberté dans le choix des marques et des produits a détrôné la noble « Liberté guidant le Peuple ». Il est exigé de chacun des sept milliards d’individus qui grouillent sur la planète de participer au gigantesque effort qui consiste à la détruire pour entretenir la machine de la consommation.
L’accès de tous à tout est devenu le « credo », le « gloria » et le « confiteor » de la nouvelle Eglise vers laquelle se pressent (ou rêvent de se presser) les masses de la planète entière, j’ai nommé sa majesté l’Hypermarché, augmenté de sa dernière extension en date, dans les travées de laquelle se rend à chaque instant un culte au dieu nommé Illimité : l’empereur Internet.
Dans ce contexte, où les corps individuels se dilatent à l’infini aux dépens du corps social, comment voulez-vous que survive la vile et vieille notion de norme ? Quand les bornes du corps individuel sont franchies, il n’y a plus de limite au désir, il n’y a surtout plus de limite aux « droits ». Car le désir de l'individu est devenu générateur automatique de droit.
Qu’il s’agisse de l’enfant (à tout prix), de se marier avec quelqu’un du même sexe ou de suicider l’oncle à héritage au motif qu’il est en soins palliatifs, les désirs créent désormais des droits. Chaque individu est appelé à concevoir la norme particulière qui correspond à l'essence de son être.
A charge pour lui de la trouver et de la définir, bien sûr. Ce n'est pas le plus aisé, on le sait. Mais toutes sortes de coaches de vie, de consultants et de marchands de services à la personne et de biens matériels sont là pour l'aider à s'y retrouver dans le fouillis de ses contradictions et de ses changements d'humeur.
L’individu étant sa propre norme (« je fais ce que je veux parce que je suis libre », ou plutôt « je suis libre, donc je fais ce que je veux »), il n’y a plus de norme. Moyennant quoi on se rend bientôt compte que le social a disparu. Le social, je veux dire le bien commun. Je veux dire, comme disent les ânes bâtés (qui se prennent pour l'aristocratie moderne) qui nous gouvernent, le « vivre-ensemble ». Dit par eux, c’est devenu une abjection et une ordure.
Je ne vais pas jouer au gourou psychanalyste qui dirait à ces masses aveuglées que tout ça manque d’un père castrateur, parce que je n’ai pas les diplômes qui m’y autorisent, mais je me doute qu’il y a là-dedans quelque chose de cet ordre. Car finalement, accepter la norme, qu'est-ce d'autre qu'admettre une limite de soi ? On ne m’ôtera pas de l’idée que l’individu aux désirs tout-puissants est en réalité resté un enfant déguisé en adulte. Idée bien résumée dans le slogan publicitaire :
« Parce que je le vaux bien ! ».
Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de supporter la frustration d’un désir, étant donné que les marchands de marchandises se donnent un mal fou (= consacrent des sommes folles) pour connaître les motivations des gogos qui s’imaginent qu’ils combleront leur vide existentiel en achetant les merdes élaborées par des margoulins à partir de mille enquêtes de motivations fabriquées pour leur soutirer la formulation de quelque manque qu’ils attendent de combler, bouclant ainsi la boucle.
Faire croire aux gens que leurs désirs sont tout-puissants, ça confine à l’artistique. Sauf que c’est tout, sauf de l’art.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : normes, moeurs, société, civilisation, petit livre rouge, révolution culturelle, khmers rouges, france, liberté guidant le peuple, psychanalyse
samedi, 22 février 2014
"GENRE" ET BOURRE ET RATATAM
Résumé : la théorie du « genre » ne développe pas un concept scientifique, mais un slogan de propagande militante au service de la cause homosexuelle, que sont venues appuyer toutes les militantes de la cause féministe. Ce qui ne veut pas dire que toutes les féministes sont lesbiennes, ni que tous les "gays" sont féministes : ce serait trop beau, pain béni pour les homophobes. Simplement, ils appliquent le célèbre slogan du grand stratège chinois Sun Tzu : « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tant que mes objectifs ne sont pas atteints ».
Ainsi, la guerre idéologique est déclarée. D’un côté, le rouleau compresseur des « modernistes », des « progressistes », des « humanistes », les nouveaux porteurs de la flamme égalitariste métamorphosés en chevaliers blancs de la nouvelle croisade. De l’autre, les infâmes attardés des cohortes de vieux jetons réactionnaires, rétifs à toute évolution de l’ordre des choses.
Je fais naturellement partie des dites cohortes accrochées au passé. D’abord, j’ai l’instinct horriblement chatouilleux : dès qu’un quelconque publicitaire (politicien, curé, militant ou marchand) prétend me vendre sa soupe assaisonnée à la propagande et au bourrage de crâne, mes écoutilles se ferment automatiquement. Le système de sécurité embarqué est très au point. Et puis aussi, si j’assume très simplement cette position, c’est que quelque chose m’échappe. Il y a forcément quelque chose que je n’ai pas compris. Pourtant, j’aimerais comprendre.
J’aimerais comprendre en particulier pourquoi les tenants de la théorie du « genre » font si grand cas d’une notion qui n’apporte rigoureusement rien de nouveau à ce que l’humanité savait déjà depuis que l’homme est homme : la nature fait le sexe, ensuite l’éducation, la culture et la société font leur possible pour transmettre leurs codes, leurs normes et leurs références, mais laissent finalement à l’individu dûment socialisé la liberté de faire ce qu’il veut du sexe que la nature lui a donné.
En se mettant dans la mesure du possible à l’abri de tous les regards, si la loi réprime ses pulsions. Et ceci est une vérité aussi vieille que le monde. C’est ainsi qu’un vieux vieillard nommé Jean-Paul Sartre définissait d’ailleurs la liberté : « On n’est pas ce qu’on est : on est ce qu’on fait de ce qu’on est ». Tout juste Auguste, pour une fois qu'il ne dit pas de connerie.
J’aimerais donc comprendre comment et pourquoi les propagandistes de la cause homosexuelle ont réussi à imposer dans le champ du débat public ce mot de « genre », qui est venu se substituer en peu de temps (mettons quelques dizaines d’années) au terme immémorial de « sexe ». Parce que je ne sors pas de là : chacun a un sexe que lui ont conféré (imposé si l’on veut, et moyennant quelques aberrations génétiques dûment documentées) la nature et le hasard.
Ensuite chacun subit l’influence de ses parents, de son entourage, de ses maîtres, de ses rencontres, dont l’ensemble finit par le façonner comme une personne unique, une personne qui fera de son sexe naturel l’usage qu’il estime convenir le mieux à ses goûts (ses « préférences »). J’attends avec curiosité que quelqu’un me dise que ce n’est pas vrai. J’attends surtout ses arguments.
J'attends qu'on me montre que, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'avènement de la mirifique théorie du genre, l'humanité ignorait que la société était une « construction », élaborée arbitrairement, en fonction de contextes particuliers et pour répondre à des besoins localisés.
Et j’attends qu’il m’apprenne ce qu’apporte le mot « genre » à ce que le mot « sexe » apportait déjà à l’humanité depuis toujours. J’attends qu’on me prouve que la théorie du « genre » était nécessaire à l’accroissement du savoir humain, et qu’il était urgent d’augmenter grâce à lui la longueur des rayonnages de bibliothèque consacrés à la question sexuelle depuis que l’écriture existe.
Bien sûr, des raisons, j’en entrevois. Bien sûr il y a le désir de toutes les sexualités déviantes (appelons, s’il vous plaît, les choses par leur nom) d’en finir avec les persécutions. Là-dessus, je ne peux qu’approuver, à ceci près que je suis curieux de savoir à quelles persécutions les déviants sexuels, si l’on excepte les « pédophiles » (ceux que l’antiquité grecque appelait « pédérastes »), ont à faire face en France.

LA FRANCE COUPEE EN DEUX : ÇA DURE DEPUIS LA REVOLUTION FRANÇAISE.
Il ne faudrait pas confondre leur sort, somme toute éminemment enviable (non, je ne reviendrai pas sur le mariage homosexuel qui leur a été accordé sur la base des arguments fallacieux savamment détournés de « liberté » et d’ « égalité »), et celui de ceux qui subissent des lynchages en Afrique ou des condamnations à mort dans bien des pays musulmans. Les hurleurs et punisseurs des paroles « homophobes » de France, si prompts à dégainer le recours à la loi et à brandir la correctionnelle, devraient avoir la décence de se modérer et de relativiser.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 21 février 2014
"GENRE" ET BOURRE ET RATATAM
Je l'ai dit : participer à un "débat de société" est totalement vain et ne sert ni à rien ni à personne. Cela ne sert qu'à faire plaisir à ceux qui ont un grand besoin de s'exprimer. Tiens au fait, qu'est devenu le "débat de société" autour de Dieudonné et de sa quenelle ?

Moi je crois que, quand j'exprime des points de vue dans ce blog, ça a le même effet que quand je fais pipi : la petite musique d'une eau tombant dans une autre. Je veux dire : une grande leçon de modestie, voire d'humilité.
Mais tant pis, j'y vais de mon couplet et de mon refrain. J'y vais à reculons, mais je m'y colle quand même. Je ne dis pas avec enthousiasme. Je réagis, comme beaucoup de gens, j'imagine, en essayant de mettre la tête hors du déluge de crétinisme et de langue de bois qui s'abat sur la population au sujet du « genre ».
Ce n’est pas que la question m’obsède, mais je me sens, à tort ou à raison, obligé d’y revenir. Le « genre » est dans toutes les bouches. Le « genre » est devenu le nouveau dogme, le nouveau catéchisme, le « genre » est du dernier chic, le « genre » est la dernière religion à la mode. Et gare à tous les réactionnaires et à tous les fachos qui partent à l’assaut de cette nouvelle citadelle assiégée pour détruire la Vérité Nouvelle, vous savez, celle qui « vient de sortir ». Si possible de sortir toute nue du puits.
La fumée qui commence à me sortir par les naseaux, c’est celle de l’enfumage offensif de tous les tenants de la théorie du « genre » qui, à ce qu’ils disent, permet de renouveler de fond en comble, de la cave au grenier, tout le vieil attirail de la différenciation des sexes. C’est entendu, le mot « sexe » est devenu un mot ordurier, un gros mot, quasiment une insulte.
Il semble en effet devenu dangereux de traiter quelqu’un d’ « homme » ou quelqu’une de « femme ». Ce serait à présent « discriminatoire », ce pourrait être considéré comme « stigmatisant » et, à ce titre, passible des tribunaux correctionnels pour atteinte à la dignité de la personne.
Je le dis sans ambages, nous nageons en plein délire de la police de la pensée, en pleine fatrasie policière de la censure des mots (par leur interdiction ou leur torsion), en pleine panade de la confiture répressive des nouveaux commissaires du peuple d’un stalinisme soft, rénové et mis au goût du jour. Autant dire en pleine idéologie.
Il ne faut pas oublier que les « gender studies », au départ, ont été inventées dans un but militant. Il s’agissait pour son inventeur, du nom de Judith Butler, une lesbienne fière de l'être, une Américaine fière de l'être, sur la base des travaux du célèbre trio philosophique français (Deleuze-Derrida-Foucault) adepte de la « déconstruction », de faire sortir l’homosexualité de sa honteuse marginalité, où une intolérante et intolérable majorité de gens normaux cantonnait une minorité injustement persécutée. C'est le militantisme homosexuel, secondé par le militantisme féministe, qui a fini par imposer sa vision des choses.
Car il faut aussi citer, à l'origine de l'obsession du « genre » l'ahurissante fascination de toutes les féministes militantes pour cette ahurissante niaiserie proférée en son temps par Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient ». Oui, bien sûr, je sais qu'elle s'élevait à l'époque contre le cliché qui proclame qu'une femme est une femme parce que la nature est la nature.
Mais quand je relis cette phrase avec le recul, je me dis avec tout autant de conviction que « l'on ne naît pas homme, on le devient ». Ben oui, c'est tout aussi vrai au sujet de la virilité qu'au sujet de la féminité. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins difficile socialement de devenir un homme que de devenir une femme. Et dans le fond, ce sont des vérités fondées sur la réminiscence de ce que disait un certain Jean-Jacques Rousseau : « L'homme est né bon, la société l'a perverti ». Et d'encore plus loin : « La coutume [la culture] est une seconde nature » (Blaise Pascal).
Incroyable !!! Rendez-vous compte : l'humain naît de la nature, mais tout le reste (attention : TOUT LE RESTE) est le fait du façonnage culturel et social de la personne par l'éducation, par l'instruction et par la socialité. Et on le sait depuis toujours. Tout le reste est « construction ». Les débats modernes sur les parts respectives de l'inné et de l'acquis ne sont qu'une resucée de la vieille controverse. Et opposer le « genre » et le « sexe » ne devrait rien apprendre à personne. Il faudrait simplement préciser l'origine du succès décisif du mot dans la multiplication des travaux universitaires (d'abord américains) dans les « gender studies ».
Et sous la houlette de madame Judith Butler, la grande prêtresse de ce courant, une troupe de plus en plus nombreuse de « déconstructeurs » s’est mise à « déconstruire » à tout va les « stéréotypes » sexuels, qui ne sont à tout prendre que de viles normes, sur lesquelles la société ordonne arbitrairement aux individus de se conformer. La maladie a gagné tous les milieux où évoluent les gens, paraît-il, savants, l’université, les sciences humaines. Je n’ai pas approfondi la question de savoir si, comme certains le prétendent, le « concept » est « efficient ».
Moyennant quoi, les tenants actuels du « genre » soutiennent mordicus, contre toute raison, que ce n’est en aucun cas une théorie, suivis par la masse moutonnière des journalistes, pressés de parler de la « soi-disant théorie du genre ». Une théorie déguisée en vérité incontestable, qu’est-ce d’autre qu’une idéologie ? J’aimerais bien qu’on m’explique.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que c’est seulement l’action militante acharnée des milieux homosexuels (Judith Butler est lesbienne, et non seulement elle ne s’en est jamais cachée, mais elle l’a très tôt revendiqué haut et fort, au grand dam de sa propre mère) qui a fini par imposer cette représentation particulière du sexe qu’est la notion de « genre ».
J’en conclus que tout le monde (croient-ils) a fini par adopter la représentation homosexuelle des questions sexuelles. Bel exploit de propagandistes efficaces, qui ont réussi à substituer leur stéréotype maison au stéréotype dénoncé. Car qu'est-ce d'autre qu'un nouveau stéréotype que la notion de « genre » ? Encore bravo. Bienvenue donc au nouveau stéréotype, désormais en vigueur.
C’est sur cette toile de fond qu’il faut voir ce qui se passe depuis quelque temps en France, au sujet de la lutte contre les « stéréotypes » à l’école. Il n’est jamais trop tôt pour entreprendre de modeler l’esprit des enfants, si l’on veut façonner l’ « homme nouveau » tel que certaines officines le conçoivent.
Cette entreprise a des précédents, lorsque des gens sûrement très bien intentionnés avaient mis en œuvre de grandioses projets qui avaient pour but de faire advenir le « prolétaire nouveau » ou l’ « Allemand nouveau » : « du passé faisons table rase ». Ce qui m’impressionne, avec cette histoire du « genre », c’est la facilité avec laquelle elle a pénétré dans les esprits et commence à s’imposer effectivement dans les écoles.
Ils ont en effet perdu une occasion de s’instruire, ceux qui n’ont pas entendu cet instituteur (pardon, il faut dire « professeur des écoles », et pourtant qu'est-ce qu'il était beau, ce mot qui désignait le métier consistant à instituer un être humain !) exposer la petite expérience qu’il a faite avec ses cobayes, je veux dire ses élèves. Il s’agit de réunir les garçons dans une salle et les filles dans une autre, et de leur demander d’imaginer leur réaction si jamais, un matin, ils se réveillaient dans un corps de l’autre sexe. Quelle idée géniale !
Il faut que Peillon donne les Palmes académiques, pour le moins, à ce militant intrépide de la cause de l’ « égalité ». Il paraît qu’ensuite, après confrontation des résultats, la cour de récréation voit davantage filles et garçons jouer ensemble au lieu d’être odieusement séparés par l’odieuse barrière des sexes. Brandissons le drapeau de l’ « égalité » et partons à l’assaut de la forteresse des « stéréotypes ». Mais peut-être après tout ces gens s’imaginent-ils que le monde sera meilleur !
Car les stéréotypes, on me dira ce qu’on voudra, c’est essentiel dans la construction du psychisme de la personne, dans la première partie de son existence. On appelle ça des POINTS DE REPÈRE. On me dira ce qu'on voudra, mais il est vital que la personne, comme n'importe quel édifice, soit fondée sur une assise stable et construite avec des matériaux sûrs et bien identifiés, si l'on veut qu'elle soit capable d'affronter les épreuves de l'existence.
Alors halte au travail de sape !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sexe et genre, débat de société, quenelle dieudonné, théorie du genre, judith butler, discrimination, sexisme, stigmatisation, gender studies, deleuze, derrida, foucault, simone de beauvoir, féminisme, idéologie, homosexuels, lesbiennes, france, société, stéréotypes
jeudi, 20 février 2014
DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (4/4)
Dans son bouquin-autoportrait Délirium, ce que Druillet n’explique pas à son scribe David Alliot, c’est la raison pour laquelle, en grandissant, il n’a pas fait comme papa et maman, en gros pourquoi il n’est pas devenu fasciste. Certes, il évoque, à sept ans, l’enterrement de son père, où tous les dignitaires fascistes de Franco viennent tendre le bras bien haut autour du cercueil. Il dit bien qu’entre son père et sa mère il y a une belle osmose politique. Mais il ne parle pas du moment ou du processus qui l’amène sur le bord opposé.
Il répondrait sans doute qu’analyser la chose est le cadet de ses soucis. Sans doute. Et ce n’est pas moi qui lui conseillerai de s’étendre sur le divan du psychanalyste. Qui lui dirait sans doute, pour comprendre la haine totale et définitive qu’il voue à ses parents, d’aller voir du côté de quelque terreur enfantine assez tétanisante sur le moment pour maintenir en état de marche à travers les années le moteur de cette aversion native, qui se retrouve page après page dans toutes ses créations.
Il dit cependant cette chose étrange, que son frère rejoint les Forces Françaises Libres avec l’assentiment de son père ! Allez comprendre. Tout ça pour arriver à dire que le plus intéressant du livre se situe au début. Non que le récit des étapes de son parcours professionnel (la photo, etc.) ne soit pas instructif, mais disons qu’il est plus convenu et banal, puisque le lecteur que je suis est au courant depuis longtemps de l’immense célébrité de l’homme dans le milieu qui est le sien : j'ai acheté mon premier Lone Sloane (et tous les suivants) à parution, chez Adrienne, à la librairie Expérience, rue du Petit David. C'est vous dire.
Tiens, à propos, si Adrienne est encore de ce monde (et pas trop aigrie), passez-lui mon bonjour, c'est elle qui m'avait vendu l'édition sérigraphie de Capitaine Cormorant (Hugo Pratt, 150 francs à l'époque) acquisition dont je ne peux que me féliciter en même temps que la remercier. J'avais pris le même jour l'édition italienne grand format de La Ballade de la mer salée et la belle version reliée de Corto Maltese en Sibérie.
Mais à l'époque, il ne paraissait que 150 volumes de BD par an, je pouvais encore suivre. Aujourd'hui, les éditeurs ont ajouté un 0 à ce nombre déjà respectable. Le déluge, la cataracte de BD qui vous tombe sur la gueule. Et puis franchement, avec la prolifération est venue la compartimentation, la segmentation dans des "genres" bien définis, dans le temps même où la société tente de les abolir en les multipliant. Le mot d'ordre ? "A chacun sa secte".
Et ça, moi, je ne peux pas. Je crois que je mourrai de la maladie des universaux. Je n'y peux rien, j'ai hérité ça des Lumières : « Tous les hommes naissent libres et égaux », bon dieu ! Mais je retarde, car ça date de quand le mot "hommes" désignait le genre humain. Or aujourd'hui, les universaux sont devenus des mots creux, de grandes baudruches, des slogans pompeux auxquels plus personne ne croit. Quand on dit "hommes", il faut préciser si ce sont des femmes, des homosexuels, des juifs, des musulmans, des contribuables, et que sais-je encore !
L’époque décisive qui va décider du succès de Druillet est celle où Goscinny publie ses premières planches dans Pilote. L’afflux de lettres de lecteurs enthousiastes qui submerge la revue balaie les derniers doutes, s’il en avait, que le grand scénariste (et directeur) que fut Goscinny pouvait nourrir. Moi, ce qui m’intéresse d’abord, dans ce parcours, c’est l’incroyable fond de HAINE qui sert de terreau à l’inspiration de celui à qui je suis bien obligé de reconnaître une forme de génie. La force de la haine qui habite Philippe Druillet est impressionnante, et a quelque chose de dévastateur.

UNE BELLE IMAGE DE HAINE
La haine, ce mot qui revient périodiquement dans les bandes dessinées de Druillet, revient souvent au début de son autoportrait Délirium, et dès le prologue : « Ce qui grouille au fond de moi est immonde ». Mais il n’épargne pas sa mère : « Ma mère, je l’ai haïe depuis le début. Je ne l’aimais pas, je ne l’ai jamais aimée. Je ne sais pas pourquoi, c’était instinctif. Je ne pouvais pas la supporter. Même petit, quand nous marchions dans la rue, j’étais deux mètres devant elle. Je ne voulais pas qu’elle me touche ». C’est dit.
L’école n’est pas mieux lotie : « J’ai toujours détesté l’école. J’ai toujours détesté les enseignants. Je n’ai jamais supporté cet embrigadement ». Et il ajoute, finalement plus lucide que beaucoup d’éducateurs « modernes » : « Je n’ai jamais trouvé plus malin, plus pervers, plus mauvais que les enfants ». La haine vous dis-je. Et les bandes dessinées dont je me souviens sont bourrées à craquer de la violence de ce sentiment.
Je ne sais plus dans quel volume dessiné il évoque la mort de Nicole, la femme de sa vie, mais c’est encore la haine qui sort de lui quand il évoque dans son livre la façon dont les médecins s’y sont pris pour ne pas la sauver de son cancer. Le service du Professeur Schwartzenberg, à commencer par son chef bien connu, en prend plein la figure. Le pardon, Druillet apparemment ne connaît pas. Et je dirai que ça le regarde. Et que je le comprends.
Mais au total, je trouve tout à fait intéressant de découvrir grâce à Délirium que ce grand homme de la bande dessinée française a nourri son immense talent graphique, principalement, au carburant fourni par un sentiment négatif d’une force extraordinaire. Certes il n’y a pas que ça dans le livre, car Druillet mentionne à plusieurs reprises le fait qu’il a toujours travaillé comme un fou. Et c’est vrai que l’absence d’un acharnement résolu au travail est le plus sûr moyen de ne jamais devenir un génie. Balzac aussi fut un bourreau, que dis-je, un tyran de travail.

Mais non seulement je ne vois aucune contradiction entre les aventures stellaires de son héros principal, Lone Sloane, et le concentré haineux qui bout comme une lave en fusion au fond du volcan de son âme en attendant d’exploser, mais je vois même là une sorte de révélation, d’explication si l’on veut de ce qui me reste principalement de la lecture de la petite dizaine d’albums que j’eus jadis en ma possession, comme le montre crûment la planche ci-dessus.
Il y a en quelque sorte, dans l’œuvre de Philippe Druillet, une parfaite adéquation entre le contenu affectif extrêmement violent de sa production et les moyens d’expression qu’il a adoptés pour lui donner une forme esthétique parfaitement accomplie.
C’est cette adéquation, sans compter la folle dépense d’énergie, qui fait qu’un chef d’œuvre peut naître. Sans adhérer au fond, je dis : « Chapeau, maître Druillet ! Et merci pour tout ! ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 19 février 2014
DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (3/4)
Bon, alors, Délirium, l’autobiographie (le sous-titre dit exactement « autoportrait ») de Philippe Druillet, recueillie par David Alliot aux éditions Les Arènes ? Il va bien falloir finir par en parler, non ? D’accord. Et tout d’abord, un mot sur le titre, un titre qui met tout de suite dans le mille et dans l’ambiance. Car c’est d’une part une référence au Délirius des aventures de Lone Sloane, célèbre chez les amateurs. Dans la BD, Délirius, c'est la planète folle, une sorte de Macao perdu dans les étoiles, un enfer du jeu et du sexe, plein de putes et d'argent.
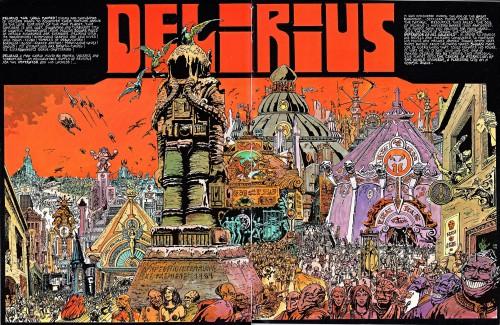
D’autre part, Délirium, c’est une sorte de simple expression de l’état mental dans lequel Druillet devrait normalement se trouver aujourd’hui, s’il n’y avait pas chez lui, selon toute vraisemblance, quelque chose de surhumain, du moins si l’on en croit les multiples aveux de dépassements, que dis-je, d’outrepassements de la dose prescrite, s’agissant de sa consommation d’alcools forts et de substances plus exotiques et, de ce fait, davantage surveillées aux frontières.
Il est vrai que les Rolling Stones montrent en action qu’on peut survivre à l’abus des drogues les plus variées (cf. la genèse démente d’Exile on Main Street dans une villa de la Côte d'Azur, que ça n'empêche pas d'être le meilleur disque du groupe, tout au moins le plus "pêchu", n'en déplaise à monsieur Mischka Assayas et à la fine bouche qu'il fait dans son Dictionnaire du Rock à ce sujet).

Qu’on se le dise, Philippe Druillet est un homme de l’excès. Mais un excès démesuré. Et le génie de cet homme est d’avoir créé la seule forme esthétique exacte dans laquelle il pouvait espérer concrétiser la démesure de ses rêves, et trouver un costume à leur taille.
On peut discuter la géométrie, l’architecture, les proportions ou la dimension de ses folies. On pourra ergoter sur l'invraisemblance qu'il y a à imaginer qu'il puisse exister un "Pont sur les Etoiles". On ne pourra pas le chicaner sur l’impressionnante adéquation qu’il a su établir entre les forces fantasmatiques venues de ses profondeurs et les figures visuelles chargées de les représenter sur le papier. Sur le papier, le "Pont sur les Etoiles" est plus vraisemblable que la vérité, un point c'est tout.
C’est tout au moins la conclusion que je tire de la lecture de son bouquin, tout à la fois terriblement mal écrit et pourtant formidable. Minable, je l’ai dit au tout début de cette série : ce livre n’est pas écrit. Aucune écriture, aucune mise en forme, sinon un très vague fil chronologique. Il n’est même pas composé (il y a des redites, etc.).
C'est sûr que j'exagère, car c'est un livre qui, malgré tout, se tient. Et qui touche. L'absence d'écriture se laisse volontiers oublier, éclipsée par la force motrice du propos. C’est un livre tout au plus craché. L’auteur le dit lui-même : c’est un règlement de compte, alors le style, on ne va pas l’embêter avec ça.
Mais il a de quoi en vouloir à ses parents. Pensez, rien que le choix de son prénom. Et ça tombe assez mal, parce que le 28 juin 1944, jour de sa naissance, le COMAC (Comité d’Action Militaire) abat l’orateur fasciste Philippe Henriot, qui tous les jours à « radio-Paris » s’en prenait très violemment à Pierre Dac (radio-Londres), aux juifs, aux gaullistes et autres suppôts des communistes, bref à l’anti-France. Je sais, Pétain aussi s’appelle Philippe, mais ça n’est pas du tout contradictoire.
S’il s’appelle Philippe, Druillet le doit donc à celui que son père voulait pour parrain de son deuxième fils, mais qui fut exécuté par la Résistance. Car son père est un fasciste convaincu, ami de Louis-Ferdinand Céline (« mon premier médecin »), et chef de la Milice dans le département du Gers. Les Druillet arrivent en Espagne après la Libération, après un petit détour par Sigmaringen. On apprend que « le gouvernement de Franco les accueillit à bras ouverts ».
L’enfant n’est pas très heureux à Figueras, mais il ne semble pas trop malheureux non plus. Il va de temps en temps au cinéma, au cirque, voit la Sagrada Familia, lit quelques illustrés pour enfants : « C’est à cette époque que je développe une mémoire visuelle ». En classe, il découvre qu’on peut représenter les produits de son imagination au moyen de crayons et de feuilles de papier. La planche de salut majuscule.
La suite au dernier numéro.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 18 février 2014
DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (2/4)
Bon, j’avais commencé à parler de Philippe Druillet, je crois. Qui avait commencé dans la Bande Dessinée, mais qui, après avoir fait « exploser les codes » (comme il est de bon ton de dire), a touché à divers domaines connexes, et même étrangers à l’univers des vignettes, des planches et des bulles (« phylactères », par abus de langage mais pour montrer qu’on est « initié », quoique les phylactères soient tout de même autre chose).

EN VOILÀ UN, DE PHYLACTERE, UN VRAI. ALBRECHT DÜRER Y A PEINT (EN 1508) : NE M'OUBLIE PAS ("UN PETIT FORGET ME NOT POUR MON ONCLE MARTIN, UN PETIT VERGISS MEIN NICHT POUR MON ONCLE GASTON, PAUVRE AMI DES TOMMIES, PAUVRE AMI DES TEUTONS", IL Y AVAIT LONGTEMPS QUE JE N'AVAIS PAS CITÉ GEORGES BRASSENS).
Par exemple, après avoir fait de la photo, il a travaillé un temps pour la cristallerie Daum, à concevoir des sculptures portant fièrement sa griffe. Avec succès, semble-t-il. Il se trouve que Daum ne m’est pas tout à fait étranger, puisqu’il m’est arrivé de « craquer » pour un objet produit par la maison, quand je voulais faire un joli cadeau. Il est vrai que pour certains objets, il est nécessaire de se mettre à plusieurs porte-monnaie, car la courbe des prix (comme celle du chômage) a vite tendance à se perdre du côté de l’infini.
ÇA, C'EST LE PAPILLON SCULPTÉ PAR UNE ARTISTE JAPONAISE POUR LA MAISON DAUM. ADMIRONS SA FAÇON D'ATTRAPER LA LUMIERE.
Druillet n’est pas le seul à avoir migré de la BD vers autre chose. Quoi qu’on dise, la BD reste fondamentalement un art mineur, et la très estimable ambition de gens comme Philippe Druillet ou Enki Bilal de lui donner des lettres de noblesse comparables aux œuvres picturales consacrées par leur suspension aux cimaises des musées, exige qu’ils quittent l’univers des histoires racontées en images pour des disciplines plus traditionnelles, plus dignes, plus reconnues. Ce n'est pas ma faute si la BD est confinée dans des "musées" spécialisés.

"GUERRIER", ÉDITÉ PAR LA MAISON DAUM.
LÀ C'EST SÛR, ON RECONNAÎT LA PATTE DE PHILIPPE DRUILLET.
La preuve aussi, c’est que leurs BD étaient de moins en moins des BD. J’ai admiré le travail de Bilal, après sa somptueuse et époustouflante « Trilogie Nikopol » (La Foire aux immortels, La Femme piège, Froid équateur), mais ensuite, avec Le Sommeil du monstre, j’ai eu du mal. Quant à 32 décembre, (et son double Trente-deux décembre) j’ai été largué, et du coup, j’ai laissé Rendez-vous à Paris dans les bacs des librairies spécialisées.

Mais il faut dire que Bilal, en compagnie du scénariste Pierre Christin (Valérian ...), avait commis auparavant ce radical chef d'œuvre absolu que constitue Partie de chasse qui, dès 1983, anticipe sur le délabrement prochain de l'Empire Soviétique. Partie de chasse ? Saisissant. Un monument historique de la Bande Dessinée moderne, qui ne me fait pas regretter d'avoir été longtemps un adepte de cet "art mineur". Philippe Druillet lui-même, dans son bouquin, s'insurge contre le fait que Pierre Christin, un génie pourtant du scénario de Bande Dessinée, n'ait jamais reçu le Grand Prix d'Angoulême. Entièrement d'accord.

AH ! LE VASSILI ALEXANDROVITCH TCHEVTCHENKO INVENTÉ PAR PIERRE CHRISTIN POUR PARTIE DE CHASSE ! VOUS M'EN DIREZ DES NOUVELLES !
Druillet, quant à lui, a créé un personnage désormais célébrissime (parmi les amateurs) : Lone Sloane. J’ai marché avec assez d'enthousiasme dans la combine, et j’ai continué à suivre avec Vuzz, Urm le fou et divers autres titres. Mais quand est sorti le premier volume de Salammbô, j’ai freiné des quatre fers.

C'EST SÛR, DRUILLET POSSEDE UN SENS AIGU DES PROPORTIONS ET DE L'ARCHITECTURE MONUMENTALE
Je n’y peux rien, pour moi, la BD résulte d’un compromis, d’un équilibre entre d’une part la narration d’une histoire (un « scénario ») et d’autre part son découpage en autant d’images que l’auteur (l’ « artiste je veux bien, à la rigueur) le juge approprié. Pour dire les choses autrement, il ne faut pas confondre "art" et "art appliqué". Dit encore autrement, il ne faut pas confondre "œuvre d'art" et "objet d'art". Sans parler de l' "objet dard" (Marcel Duchamp, ci-dessous).

Avec Salammbô, on dira ce qu’on voudra, je me retrouve face à des tableaux, certes magnifiques, mais en route, j’ai perdu la narration de l'histoire, et ce qui est plus grave, j’ai aussi perdu Flaubert. Une variante, en quelque sorte, de la double peine.
Mais un Flaubert qui, soit dit en passant, avec son respect maniaque de la langue, de la phrase, du rythme, du mot, n'envisageait pas une seconde qu'un illustrateur, quelque doué qu'il fût, osât poser dans les marges de ses récits les étrons de ses images (pardon pour le terme). Je ne nie pas l’énormité, l’originalité, peut-être la beauté du travail, mais je n’entre pas dans l’édifice. J'admets que ce puisse être une infirmité. Mais en peignant les images splendides que le livre de Flaubert lui inspire, je n'aime pas du tout que Druillet se permette de venir piétiner et violer mon propre imaginaire.

DRUILLET VOIT AINSI LA PREMIERE PAGE DE SALAMMBÔ. (VOUS SAVEZ : "C'ETAIT A MEGARA, FAUBOURG DE CARTHAGE, DANS LES JARDINS D'HAMILCAR..."). MOI JE DIS : POURQUOI PAS ? ET JE REPONDS : "MAIS BON !".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, philippe druillet, délirium, éditions les arènes, phylactères, cristallerie daum, enki bilal, la foire aux immortels, la femme piège, froid équateur, le sommeil du monstre, 32 décembre, festival de bd angoulême, pierre christin, valérian, partie de chasse, vuzz, urm le fou, flaubert, salammbô
lundi, 17 février 2014
DELIRIUM, DE PHILIPPE DRUILLET (1/4)
Il n’y a pas que Balzac dans la vie. Il y a encore une vie après La Comédie humaine. La preuve, c’est que, tombé par hasard, dans une librairie de quartier, sur un drôle de livre, je n’ai fait ni une ni deux, je l’ai acheté. C’est 17€, aux éditions Les Arènes. Et ça vient de sortir.

Entre parenthèses, une librairie de quartier, c’est formidable. Ce n’est pas comme l’ex-librairie Flammarion, rebaptisée Privat il y a quelques années, et qui vient de fermer ses portes (enfin, disons plutôt « rendre l’âme », et même de « passer l'arme à gauche ») sous le nom de Chapitre.com : un vrai crève-cœur. Le livre a déserté le centre-ville, si l'on excepte trois survivants et deux supermarchés.
C’est normal, me dira-t-on, un centre-ville conçu pour répondre à des critères de vraie modernité n’a pas besoin du livre, juste de parkings, de banques et de boutiques de sapes, avec des usines à mangeaille pour la pause entre deux magasins. Et suffisamment de points wifi pour que les passants n’aient pas à subir de déconnexion. Ce serait trop cruel de leur couper le cordon. Passons.
Philippe Druillet a donc écrit Délirium. Enfin, quand je dis « écrit », j’exagère. Si j’avais dit « craché », je serais plus près de la vérité. Qu’il l’ait fait dans l’oreille et devant le micro de David Alliot ne change rien à l’affaire : on ne peut pas dire que ce livre est « écrit ». Druillet semble avoir expulsé de lui tout ce qu’il raconte, un peu comme quand on vomit.

Mais qui c’est, Druillet, au fait ? J’ai découvert son travail dans l’hebdomadaire de BD Pilote, que j’achetais fidèlement depuis qu’on y voyait les planches de Cabu, Gébé et toute la bande. Pour vous dire si ça remonte. J’aimais beaucoup aussi l’ambiance des recherches graphiques auxquelles Goscinny ouvrait les pages. Par exemple, qu'est devenue l'histoire de Jean Cyriaque ?
Je me rappelle aussi avec plaisir l’aventure sans lendemain de La Saga de Délicielmiel, tombée dans d’insondables oubliettes. Qui s’en souvient ? Mais je crois me souvenir que l'auteur se souciait peu de raconter une histoire un peu construite, et se contentait de beaux dessins formels. Goscinny ne dédaignait pas, parfois, de laisser l'expérimental s'exprimer.
Druillet a donc commencé comme dessinateur de BD, et j’avoue que les histoires de Lone Sloane m’avaient beaucoup impressionné à l’époque, moi qui ne suis pas fan d’Héroïc fantasy ou de Space Opéra. J’ai lu quelques romans de Howard Phillips (HP pour les intimes, comme HG va avec Wells et EP avec Jacobs) Lovecraft, mais j’étais insensible à son univers de créatures monstrueuses ou de dieux terribles faisant irruption dans notre pauvre et si prosaïque réalité. J'avoue cependant que c'était une littérature de genre très honnête et très bien fabriquée.
Je considérais cette littérature comme régressive, car empreinte d’un grand infantilisme, où de grands enfants jouent à se faire peur en allant chercher leur inspiration dans leurs fantasmes les plus archaïques, et les ramènent au jour, peut-être pour mettre un peu de piment dans les plats de leur vie ordinaire, dans laquelle ils s'ennuient, en recréant à partir de réminiscences les cauchemars qui hantèrent leurs premières années.
De même, je suis hermétique à Elric le nécromancien, le « grand œuvre », paraît-il, de Michael Moorcock, que Druillet a mis en images avec Demuth. Ces diverses "écoles" ont produit autant de sectes que je me refuse à appeler littéraires, qui ne produisent la plupart du temps que des objets « à consommer de suite ».
Ce fantastique-là me semble très inférieur à celui qu’on trouve chez Gustav Meyrink (je garde juste La Nuit de Walpurgis et Le Golem) ou ETA Hoffmann, où c’est la vision subjective des choses par les yeux du personnage qui transforme la réalité au gré de ses fantasmes. Il me semble qu’être obligé de faire intervenir des principes extérieurs à l’homme pour susciter la terreur (ou autre chose) est un aveu de faiblesse technique du romancier. Cela fait un peu « deus ex machina », recette aussi vieille que le théâtre.
Créer un univers romanesque en partant d’un élément tiré du réel, élément que l’auteur développera ensuite selon une logique exclusivement interne, me semble infiniment supérieur à toutes les extravagances délirantes sorties du cerveau d’auteurs qui se prennent plus ou moins pour Dieu créateur de monde, et qui demandent donc à être diagnostiqués du syndrome de Peter Pan.
Le Cycle de Cyann, où François Bourgeon fait proliférer mille inventions autour du « Monde d'Ilô », est sûrement admirable de science du dessin et de la narration, mais vraiment, non : trop c'est trop. Plus la logique vient de l'intérieur de l'intrigue, plus le roman a des chances d'atteindre la puissance d'évocation qui fera sa force. De cela, je ne démords pas.
C’est la raison pour laquelle j’ai laissé tomber la science-fiction. Et pourtant j’en ai croqué, de la SF. J’ai beaucoup fréquenté, en particulier la collection « J’ai lu ». J’ai dévoré AE Van Vogt, et ses élucubrations sur le monde des Ā (non-aristotéliciens) et son héros, Gosseyn me semble-t-il, où j'ai appris le mot « parsec » qui me fait bien rire aujourd'hui ; Isaac Asimov et ses histoires de robots ; Philip K. Dick, Daniel Keyes, pour citer les premiers qui se présentent.
Comme dit Günter Anders quelque part dans L'Obsolescence de l'homme, la science-fiction est là pour convertir les naïfs, les rétifs et les sceptiques à la religion de l'innovation technique à perpétuité et de l'amélioration continuelle des performances, quelles qu'en soient l'utilité ou les nuisances.

Rares sont les écrivains de SF ou de fantastique qui savent nous parler du monde qui est le nôtre à travers les fables qu’ils inventent. Je me souviens à la rigueur de Norman Spinrad (Jack Barron et l’éternité), de John Brunner (Tous à Zanzibar, Le Troupeau aveugle), de quelques autres, mais bon. Disons que j’ai peut-être eu besoin de nourritures plus consistantes que celle que nous fournit le pur divertissement. Les adeptes de Lovecraft vont sans doute hurler. A commencer par Philippe Druillet lui-même.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe druillet, délirium, balzac, litérature, la comédie humaine, bande dessinée, éditions les arènes, librairie flammarion, chapitre.com, lone sloane, le trône du dieu noir, bd, revue pilote, rené goscinny, hp lovecraft, ep jacobs, hg wells, elric le nécromancien, michael moorcock, druillet demuth, eta hoffmann, gustav meyrink, la nuit de walpurgis, le golem, françois bourgeon, le cycle de cyann, science fiction, ae van vogt, isaac asimov, philip k dick, daniel keyes, günter anders, l'obsolscence de l'homme, john brunner, le troupeau aveugle, tous à zanzibar, norman spinrad, jack barron et l'éternité
dimanche, 16 février 2014
27 BALZAC : L’ELIXIR DE LONGUE VIE (1830)
Résumé : Don Juan Belvidéro ne tient pas à laisser son père ressusciter grâce à la liqueur que son immense savoir accumulé en Orient lui a permis d'élaborer. Quand il voit que ça marche, il décide de le garder pour lui.
Et il a raison. Quand il est mort, le fils, laissé seul avec le cadavre de son père, entend la voix d’un démon lui souffler : « Imbibe un œil ! ». L’ayant fait : « L’œil s’ouvrit ». Et ce n’est pas tout ça : « Il voyait un œil plein de vie, un œil d’enfant dans une tête de mort, la lumière y tremblait au milieu d’un jeune fluide ; et, protégée par de beaux cils noirs, elle scintillait pareille à ces lueurs uniques que le voyageur aperçoit dans une campagne déserte, par les soirs d’hiver ». Et Don Juan Belvidéro tue son père ressuscité en écrasant l’œil du mort qui aurait dû le rester. La scène est terrible. Peut-être excessive.
Le père magnifiquement et définitivement enterré, vient alors le récit de la vie du fils. Le portrait de ce nouveau Don Juan est magistral : « Son regard profondément scrutateur pénétra dans le principe de la vie sociale, et embrassa d’autant mieux le monde qu’il le voyait à travers un tombeau. Il analysa les hommes et les choses pour en finir d’une seule fois avec le Passé, représenté par l’Histoire ; avec le Présent, configuré par la Loi ; avec l’Avenir, dévoilé par les Religions. Il prit l’âme et la matière, les jeta dans un creuset, n’y trouva rien, et dès lors il devint don Juan ». J’arrête là, bien que ce soit dommage.
Dans certaines formules, Balzac semble se dépeindre lui-même : « Maître des illusions de la vie, il s’élança, jeune et beau, dans la vie, méprisant le monde, mais s’emparant du monde ». Tout ça pour dire que le portrait que l’auteur fait de ce Don Juan mis à sa sauce fait une très belle page de littérature, où se trouve synthétisée toute l’âme du cynique. De tous les cyniques. Je me dis aussi que ce cynisme-là répond trait pour trait à celui que le « Au lecteur » a distillé sur les relations d’intérêt entre enfants impatients et parents vieillissants. Balzac reparlera d’ailleurs des « espérances » des héritiers.
Les femmes ne sont pour lui qu’une part parmi d’autres de sa vision du monde : « Quand ses maîtresses se servaient d’un lit pour monter aux cieux où elles allaient se perdre au sein d’une extase enivrante, don Juan les y suivait, grave, expansif, sincère autant que sait l’être un étudiant allemand ». Les hommes, les religions, tout y passe, au premier rang de quoi figure son étonnante rencontre avec le pape Jules II en personne, qui vaut son pesant d’indulgences plénières en matière de clairvoyance réciproque et d'incroyance secrètement portée.
Passé en Espagne pour respecter la tradition du mythe, Don Juan adopte une conduite édifiante, décidant malgré tout, par calcul, de n’être « ni bon père ni bon époux », s’affirmant au dehors très à cheval sur les questions religieuses, exigeant de sa femme et de son fils une observance stricte de tous les principes et règles y afférant.
Moyennant quoi, parvenu à l’extrême vieillesse, juste avant de mourir, il demande à son fils ce que son propre père lui avait demandé en vain. Mais à son rebours, Philippe est pieux, et respectera donc la dernière volonté du défunt. Ayant enduit la tête et le bras du mort avec la liqueur secrète, il tombe évanoui quand il en constate l’effet : il comprend qu’il est en train de ressusciter son père, dont le bras pleinement revigoré l’empêche seul de s’effondrer sur le sol.
La foule accourt, crie au miracle. Appelé de toute urgence, l’abbé de San Lucar, un homme rusé qui ne cracherait pas sur un surcroît de revenus, prédit la prochaine canonisation du défunt, et organise dans son couvent une cérémonie grandiose, qui forme la scène finale de ce conte. La dite scène est-elle une réussite littéraire ? Franchement, j’hésite à me prononcer, car elle met le lecteur en présence d’une solennité tout à la fois fantastique, macabre et grotesque.
Je ne dirai rien de cette cérémonie, juste que la foule est venue de cinquante lieues à la ronde pour assister à la canonisation de « Saint Don Juan » et qu’elle pousse sa croyance fanatique jusqu’au plus absurde en persistant à crier au miracle jusque dans les manifestations les plus évidentes de diableries venues tout droit de l’enfer.
Bien fait pour le cupide abbé de San Lucar, qui n’emportera pas ses calculs en paradis. Mais au total une histoire bien faite aussi pour laisser le lecteur perplexe. Et trop étrange pour être inoubliable. Enfin je crois.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, balzac, la comédie humaine, l'élixir de longue vie, don juan
samedi, 15 février 2014
26 BALZAC : L'ÉLIXIR DE LONGUE VIE (1830)
L’Élixir de longue vie raconte une histoire tellement baroque, si outrée dans sa scène finale qu’il semble incroyable qu’elle sorte de la plume et de l’imagination de Balzac. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, car il avoue dans son avertissement « Au lecteur » la dette qu’il a envers « Hoffmann de Berlin » et continue fièrement : « La Comédie humaine est assez riche en inventions pour que l’auteur avoue un innocent emprunt … ».
J’ai sans doute encore quelques œuvres de ETA Hoffmann à découvrir, mais je ne vois pas, dans tout ce que j’en ai lu (c'est-à-dire les quatorze remarquables volumes édités jadis par Jean-Pierre Sicre aux éditions Phébus), un récit comparable, c’est-à-dire finissant dans un tel spectacle de grand-guignol. Le fantastique de Hoffmann, autant qu’il m’en souvienne, est moins dans un réel qui sortirait effectivement de ses gonds que dans le désir de l’imagination humaine de voir autre chose que ce qu’elle a devant les yeux.
Il s’agit d’un parricide, ou tout au moins d’une variante. C’est aussi une variation sur le thème de Don Juan, une variation « philosophique » si l’on veut (puisque l’auteur range l’histoire dans les « Etudes » ainsi qualifiées). Balzac se garde, dans son « Au lecteur », de « faire de l’atroce ». C’est ce qu’il dit, on n’est pas forcé de le croire.
Car de l’atroce, il y en a, fondé ici sur les rapports d’intérêt entre les humains en général et en particulier entre les enfants et leurs parents. Balzac le formule joliment : « La société humaine, qui marche, à entendre quelques philosophes, dans une voie de progrès, considère-t-elle comme un pas vers le bien, l’art d’attendre les trépas ? ». Il veut parler des « espérances » supposées que donne à tout héritier potentiel le prochain trépas d'un parent riche et mal portant.
Mais il faudrait citer tout l’avant-propos, véritable chef d’œuvre de cruauté (lucidité ?), s’agissant des vraies motivations qui font les « relations humaines », le plus souvent fondées sur les calculs les plus sordides. On sait que bien des figures paternelles de La Comédie humaine sont pathétiques, à commencer par le cercueil du Père Goriot, pour lequel ses propres filles (Restaud et Nucingen) se sont contentées d’envoyer leurs voitures, richement décorées à leurs armes mais vides de leur présence physique.
Ces basses motivations, notre époque, qui a inventé des « directeurs » spécialisés dans ces affaires, les a sans aucun doute jetées à la poubelle. Mais est-ce bien sûr ? Si c’était le cas, on ne citerait pas l’exemple amusant de ce pauvre notaire qui avait eu le malheur d’acheter une maison. Pas n’importe laquelle : il s’agissait d’un viager. La propriétaire s’appelait Jeanne Calment.
Don Juan Belvidéro attend donc fort impatiemment la mort de son bien-aimé et richissime géniteur. Et c’est en compagnie de fort accortes bougresses, disons des courtisanes, qu’il prend son mal en patience. Leur caractère est décrit d’un seul trait de pinceau : « C’était une innocente jeune fille accoutumée à jouer avec toutes les choses sacrées ». Dans un décor somptueux, on mange, on boit, on plaisante avec légèreté et insouciance.
Quand le vieux domestique lui annonce que son père vit ses derniers instants, il se lève et quitte l’assemblée : « … il s’efforça de prendre une contenance de théâtre ; car, en songeant à son rôle de fils, il avait jeté sa joie avec sa serviette ». Si ça ce n’est pas savoir écrire, je veux bien regarder passer les trains, les quatre sabots dans l’herbe verte des prairies.
Le vieux Bartholoméo Belvidéro a accumulé d’énormes richesses en commerçant avec l’Orient aux « talismaniques contrées », mais amassé en même temps « des connaissances plus précieuses, disait-il, que l’or et les diamants ». Son indulgence pour son fils unique, né tardivement, était sans bornes, et donc coupable, et trouvera dans l’ingratitude criminelle de celui-ci sa juste récompense.
Car le vieux, qui n’a aucune envie de mourir, révèle à son fils qu’il a trouvé le moyen de ressusciter, une fois sa mort dûment constatée. Ses immenses connaissances obtenues au cours de ses voyages lui ont en effet permis d’élaborer un mystérieux élixir au pouvoir surnaturel. Il est contenu dans un « petit flacon de cristal de roche ».
Mais quand Don Juan profère : « Il y en a bien peu », le père comprend qu’il s’est leurré du tout au tout sur le sentiment filial de son fils, et meurt dans l’affreuse souffrance morale du naïf qui découvre soudain l’hypocrisie de celui en qui il avait le plus confiance. Car il devine que Don Juan pense déjà à sa propre mort.
Il n’a même pas le temps de se repentir d’avoir été pour son rejeton un éducateur épouvantablement laxiste. Bien fait pour lui, tiens, ça lui apprendra.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 08 février 2014
25 BALZAC : ADIEU (1830)
Résumé de l’épisode précédent : la « Grande Armée » est en lambeaux, et les derniers lambeaux espèrent franchir la Bérésina.
Jusqu’à aujourd’hui, je ne savais pas bien pourquoi je mettais dans ce blog des comptes rendus de mes lectures. Je l’ai fait abondamment pour Henri Bosco récemment, je recommence avec Honoré de Balzac. Je crois avoir compris. Certains me diront : « C’est pas dommage ! ». Peut-être. En fait, j’essaie de mettre en forme les souvenirs de mes lectures. Pour l’instant, je n’ai pas trouvé plus juste : mettre en forme les souvenirs de mes lectures. Et accessoirement des impressions ainsi produites. Après tout, ce n’est déjà pas si mal.
Je ne veux pas résumer cet épisode du 29 novembre 1812 raconté par Balzac, qui tient en une vingtaine de pages, dont je conseille vivement la lecture aux amateurs de sensations fortes, où l’auteur donne libre cours à son génie de la peinture de genre. La description de ces débris d’une armée défaite, dont la dernière chance de survie est d’emprunter le dernier pont sur le fleuve, est d’une belle intensité tragique. La plupart des hommes se laissent aller, résignés et sans réactions. Ceux qui tiennent encore semblent retournés à la barbarie. Bref, le sentiment de la terrible catastrophe à laquelle la folie guerrière de Napoléon a mené sa « Grande Armée » est puissamment dépeint par l’auteur.
Le baron de Sucy, qui a demandé à un fidèle grenadier, Fleuriot, de sauver le comte de Vandières et sa femme (dont il est amoureux, et c’est réciproque), sera fait prisonnier par les Russes. Il n’est revenu (on est alors en 1819) que depuis à peine un an au moment du récit. La comtesse, au moment de franchir la Bérésina, a crié un seul mot à son amant : « Adieu ! ».
Rendue folle par les mauvais traitements, la solitude et la faim supportés pendant son très long périple de retour à travers l’Europe, elle n’a plus que ce mot à son vocabulaire. Après mille péripéties, elle est récupérée par son oncle médecin, le docteur Fanjat, qui entreprend de veiller sur elle et de la protéger. Elle se livre à mille excentricités arboricoles dans le parc des Bons-Hommes. Elle vivrait nue si le grenadier Fleuriot ne lui avait appris à mettre quelques vêtements.
Sachant cela, Philippe de Sucy décide alors d’entreprendre de la guérir à tout prix, et d’abord de s’en faire reconnaître. Peine perdue, elle reste absente, même si une fois, dans son sommeil, elle a prononcé « Philippe ». Il renonce à se suicider après l’avoir tuée (il avait apporté les pistolets pour cela), et se réfugie dans une de ses terres, n’ayant rien abandonné de son projet de guérison.
La folie grandiose du projet du baron est, chez lui, de reconstituer méticuleusement le décor entier dans lequel ils se sont vus avant leur séparation, le moment où elle traverse la Bérésina, ce dernier moment où elle a crié son « Adieu ! » pathétique, et où sa raison abdiquée s’est immobilisée.
Il rase ses bois, sculpte ses collines, creuse une nouvelle Bérésina sur laquelle il jette un pont. Il attend que l’hiver ait couvert tout ce paysage de neige, puis, aussi satisfait de son décor que dut l’être Victor Fleming de sa reconstitution d’Atlanta dans Autant en emporte le vent, il court aux Bons-Hommes pour y chercher Stéphanie de Vandières. Monsieur Fanjat accepte de participer au stratagème démesuré et généreux, et se débrouillera, grâce à un peu d'opium, pour que sa nièce se réveille au matin dans ce décor trompeur.
Le baron, qui a pris soin de revêtir plusieurs centaines de paysans d’ « uniformes délabrés » et de les dissimuler un peu partout parmi des cabanes en bois qu'il a fait incendier, a revêtu de drôles d’habits pour aller chercher sa belle : « Il portait les vêtements souillés et bizarres, les armes, la coiffure qu’il avait le 29 novembre 1812 ». On est alors en janvier 1820.
Au signal imitant un coup de canon, « mille paysans poussèrent une effroyable clameur … ». Stéphanie, terrorisée, saute de la voiture, voit ce paysage, voit un homme en train de jouer du sabre. C’est le baron Philippe. Elle regarde tout, longuement : « … puis elle passa la main sur son front, avec l’expression vive d’une personne qui médite ». Autour, tout le monde a fait silence. Balzac note que « le docteur pleurait ».
Alors se produit le miracle tant attendu : Stéphanie « tourna vivement la tête vers Philippe et le vit » (souligné par l’auteur). Elle est soudain de nouveau de plain pied dans le monde réel. Balzac a particulièrement soigné les effets produits pas ce retour de l’absente parmi les hommes, décrit comme une sorte de renaissance à l’humanité.
Revenue à la vie, elle se jette dans les bras du colonel, mais c’est pour y mourir aussitôt, en lui soufflant une dernière fois : « Adieu, Philippe. Je t’aime, adieu ! ». Ce qu’il gardera pendant encore dix ans, comme un fantôme qui le hante, c’est le dernier sourire qui errait sur le visage de sa belle maîtresse. Il tiendra dix ans, puis se brûlera un jour la cervelle.
On dira : veine « romantique » de l’inspiration balzacienne, où l’auteur ne craint pas d’user de grands effets de manche pour produire de l’émotion à coups de lyrique, de pathétique et tout ce qu’on voudra. J’en suis d’accord, mais je mettrai au défi de faire aussi bien ceux qui font la fine bouche, et d’essayer de peindre aussi parfaitement la scène du 29 novembre 1812 sur la Bérésina, ou alors le tableau de la comtesse folle sautant presque de branche en branche dans le parc des Bons-Hommes, ou encore le moment de sa résurrection et de sa mort dans les bras du baron.
Je peux attendre longtemps.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 février 2014
24 BALZAC : ADIEU (1830)
Il y a quelque temps (« quelque temps » est une expression très pratique, du fait du brouillard compact qu’elle répand sur le sentiment de l’écoulement du temps), j’ai fait l’erreur d’acheter, un volume de la collection « Bouquins » (Robert Laffont, 29 euros). Sous le nom de l’auteur, imprimé en très gros caractères, cette mention : « Œuvres ». Sont rassemblés dans ce volume quinze livres de Françoise Sagan. L’erreur, elle est là, dans le nom de l’auteur. Je n’aurais pas dû.
Studieusement, j’ai lu les cinq premiers titres (Bonjour tristesse, Un Certain sourire, Dans un mois dans un an, Château en Suède, Aimez-vous Brahms ...), à la file et dans la foulée. Au milieu du sixième (Les Merveilleux nuages), j’en ai eu tout d’un coup assez, j’ai refermé. Je ne l’ai plus jamais rouvert. Ce verre de tisane dans lequel trempe l’âme exténuée de quelques personnages blasés, je m’en suis débarrassé en le vidant moralement dans le pot du Ficus Benjamina. Apparemment, ça ne lui a fait ni chaud ni froid : il a continué comme avant à se déplumer de ses feuilles. C’est une image.
Tout ça pour dire que Sagan est restée pour moi une sorte de sirop fade, l’image d’un univers délavé où les protagonistes se regardent mutuellement vivre dans leurs désillusions, où tout le monde en a assez de la réalité de la vie. Un univers en bout de course, où l’individu est limité à lui-même, et où la personne qui lui fait face a pour mission de renouveler le reflet de lui-même où il se complaît, mission jamais accomplie, espoir toujours déçu.
Tout ça pour dire que ça ronronne et que ça tourne en rond. Tout ça pour dire que Françoise Sagan est l’écrivain d’un seul sujet. Tout ça pour dire que Sagan épluche dans les moindres détails l’existence de gens peu intéressants, de gens sans projets, le plus souvent désœuvrés, souvent débarrassés de tout souci matériel, et qui ne savent pas quoi faire de leur existence inutile.
Des gens que le simple fait de vivre semble en soi ennuyer prodigieusement. J’ai donc abandonné. J’ai peut-être eu tort, allez savoir. Je n’ai pas envie d’explorer plus avant. Dans la littérature française d'après-guerre, Sagan est un peu l'étalon-or de ce qui est devenu dans nos années plus récentes le fin du fin de l' « écriture du moi » : l'abominable et autosatisfaite « auto-fiction ».
Je ne sais pas pourquoi, en train de lire des œuvres de Balzac, je suis parti sur Françoise Sagan. Le plaisir du contraste, peut-être. Mais c’est vrai aussi que, après la douzaine de romans et nouvelles du grand homme que je viens de lire, essayant de situer le lieu où se produit l’intensité que j’ai trouvée à retourner à des livres qui, soit dit pour résumer, ont amplement contribué à structurer et façonner ma sensibilité, je viens de repenser à ces œuvrettes de celle qui fut l’auteur "prodige" de Bonjour tristesse (autour de 18 ans, ce qui est en soi un aveu).
Ce titre de Françoise Sagan, épèle mot à mot et lettre à lettre le programme de toute son œuvre, enfin pour la partie que je peux en connaître, c’est-à-dire l’initiale. C’est carrément idiot, je sais, de mettre en présence Sagan face à Balzac, elle aurait bien rigolé, je pense. Mais je prends mes idées comme elles se présentent, et là, c’est Sagan qui s’est présentée. Allez comprendre.
Par rapport au vaste monde qui respire profondément, qui avale gloutonnement la vie et qui jouit à chaque instant de ce qu'il a devant les yeux et dans l'oreille, les œuvres de Françoise Sagan me semblent aussi étroites que les parois de verre du bocal où agonise le poisson rouge.
Je viens donc de lire Adieu. Balzac a écrit ça en 1830. Très curieux, très surprenant. Par l’organisation du récit, par le thème. Le récit s’ouvre sur une scène de chasse, où les deux amis, messieurs de Sucy et d’Albon, reviennent bredouilles après avoir parcouru beaucoup trop de kilomètres, d’Albon suant et pestant du fait de son embonpoint nettement plus remarquable que son ami, qui semble au contraire efflanqué comme Rossinante, tout en montrant la vigueur de l’ancien militaire qu’il est. Mais son visage porte la marque d’un grave souci, qui semble le ravager de l’intérieur. Cette entame ne laisse rien augurer du reste.
Car les deux amis ont hâte de trouver avant la nuit le gîte et le couvert. Le hasard fait qu’ils passent devant les grilles d’un domaine qui semble à l’abandon. C’est l’ancien couvent des « Bons-Hommes », comprennent-ils en entendant les grognements plus ou moins articulés par une femme plus ou moins restée dans l’animalité, du nom de Geneviève.
Déjà surpris par la scène, ils aperçoivent au loin une autre femme, qui grimpe aux arbres, saute, fait mille cabrioles. Elle a visiblement perdu la raison. Appelée par « Geneviève », elle s’approche de la grille et, en voyant les deux hommes, elle prononce le mot qui ouvre sur le drame : « Adieu ! ». D’Albon, très étonné, se tourne alors vers de Sucy, mais c’est pour le voir évanoui sur le sol.
Appelant à l’aide, il voit s’approcher obligeamment la voiture de M. et Mme de Grandville, ses voisins, qui le laissent volontiers en disposer pour ramener son ami au château. On a appris que la femme s’appelle la comtesse de Vandières, que de Sucy a semble-t-il reconnue, pour être une certaine Stéphanie. Son âme s’est soudain violemment déchirée.
Quand de Sucy est rétabli, il prie son ami de courir aux Bons-Hommes pour s’enquérir de tout ce qui concerne la comtesse. Il est accueilli par l’oncle de la dame, médecin de son état, qui le fait entrer et, apprenant l’existence de Philippe de Sucy, lui raconte l’histoire terrible et lamentable que la comtesse et lui ont vécue sur la Bérésina (sic) au moment de la retraite de Russie.
La suite au prochain numéro.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeux olympiques, sotchi, vladimir poutine, littérature française, honoré de balzac, adieu, la comédie humaine, françoise sagan, bonjour tristesse, un certain sourire, dans un mois dans un an, château en suède, aimez-vous brahms, les merveilleux nuages
jeudi, 06 février 2014
23 BALZAC : ETUDE DE FEMME
Cette Etude de femme est une toute petite chose, quelque chose qui se situerait entre l’anecdote et la nouvelle courte. Pas tout à fait un fait divers, puisqu’elle se passe en circuit privé, mais qui fait le tour des salons à la mode, sur l’air de : « Tu ne connais pas la dernière ? ». Pas de quoi se relever la nuit, mais une dizaine de pages où Balzac parvient à peindre une société en mouvement, juste en appuyant à quelques reprises sur le déclencheur de son œil photographique.
Dans ce texte, je préviens, on assiste à un festival de formules, de trouvailles et de fusées verbales. En fait, Balzac raconte ici la gaffe monumentale d’Eugène de Rastignac, un Eugène débutant, naïf et emprunté, soupirant étourdi, commise aux heureux temps de ses débuts dans le monde parisien.
Occupé à séduire Mme de Nucingen, il lui écrit une lettre où brûle le foyer incandescent de son amour juvénile et inexpérimenté. Or l’histoire a débuté en portant la caméra sur Mme de Listomère, dont je conseille la lecture intégrale et réitérée d’un portrait littérairement éblouissant. Mariée à son marquis de mari, homme insignifiant mais à la situation enviable, elle possède assez de savoir-faire et de virtuosité pour ne présenter aucun défaut dans sa cuirasse d’épouse-modèle qui montre qu’on peut concilier sans problème piété irréprochable et urbanité mondaine.
La gaffe d’Eugène, encore jeune et inexpérimenté, consiste à écrire une lettre enflammée d’amour brûlant à Mme de Nucingen, oui, l’épouse du banquier richissime cité dans Le Père Goriot. Oui, mais malheureusement, sur l’enveloppe qu’il demande à son domestique d’aller porter à destination, il inscrit le nom de Mme de Listomère. Quand il s’en rend compte, il est trop tard, le mal est fait. Il est vrai que sa longue conversation de la veille avec la dame lui a laissé sans qu'il s'en doute une impression plus vive qu'il ne pensait.
Mme de Listomère lit donc la lettre et décide de « consigner à sa porte » l’insolent Rastignac. Par chance, quand il se présente chez Listomère, celui-ci l’introduit auprès de sa femme. Première erreur, il a attendu quatre jours pour tenter de dissiper le quiproquo, le temps que s’installent réflexions, idées et fantasmes.
Deuxième erreur, quand la marquise, qui a fini par croire au contenu de la lettre, l’interroge, il veut à toute force la détromper (au lieu, évidemment, de tenter sa chance, c’est tout au moins l’arrière-pensée de Balzac). Vexée par ce qu’elle prend pour des impertinences, par curiosité, elle voudrait bien savoir qui était la véritable destinataire.
A tout hasard, elle prononce le nom de « Nucingen », à quoi il répond « Pourquoi pas ? ». Résultat : « Cette confidence causa une commotion violente à madame de Listomère ; mais Eugène ne savait pas encore analyser un visage de femme en le regardant à la hâte ou de côté ». Il faut croire qu'elle n'a pas été totalement insensible au jeune homme et à la lettre qu'elle a reçue de lui. Peut-être aurait-elle aimé qu'il se mette à lui faire la cour. Qui sait ? Emue et flattée, elle se serait peut-être laissée aller. Or il la blesse par maladresse. Mais la marquise se venge du jeune étourdi en lui rappelant son « lapsus calami », car c’est bien le nom de Listomère qui figurait sur l’enveloppe, et c’est bien de sa plume qu'il est sorti.
Mais pour que Balzac parlât de l’inconscient et de ses manifestations dans les lapsus ou les actes manqués, il eût fallu qu’il lût dans je ne sais quelle boule de cristal la future venue au monde d’un certain Sigmund Freud.
Pour conclure, Etude de femme n’est certes pas un ouvrage de fond de La Comédie humaine, mais ce très court récit, brillamment mené, montre à quel point Balzac excelle à synthétiser en quelques pages diversité des points de vue et vivacité des images.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 05 février 2014
HOLLANDE PIRE QUE SARKOZY ?
François Hollande, impuissant face à ses ennemis (enfin, c'est ce qu’il disait à propos, par exemple, de la « finance internationale », ricanons un peu), se résigne à agir sur des réalités qui ne sont pas hors de son bon vouloir : les lois. Puisqu’on ne peut changer les choses, par exemple cette absurdité logique et mathématique de « l'inversion de la courbe du chômage », raisonne-t-il, on va s'en prendre au vocabulaire : changeons les mots, changeons le sens des mots, réécrivons le dictionnaire où se trouvaient rassemblées les définitions de la société et du sens de la vie en commun.
En s’attaquant à ça, il a mis le feu. Et ça l'étonne ! Enfin non : il fait semblant d'être choqué. Il est vrai qu’avec ses débats sur « l’identité française », Sarkozy avait mis en place quelques éléments du brasier. Cela a en effet donné le mariage des homosexuels et l’interdiction du spectacle de Dieudonné. Que la droite de la droite ait profité de l’aubaine pour s’engouffrer dans cette brèche, rien de plus explicable. Mais il ne faut pas oublier qu’ils ne sont pas les seuls. Et qu'il y a des gens normaux qui pensent depuis le début beaucoup de mal du mariage homo (sans être homophobes) et de la censure de Dieudonné (sans être antisémites).
Il est vrai que s’il fallait que je me situe politiquement, je serais très embarrassé. Que voulez-vous, dans notre « démocratie par procuration », où l’on demande aux populations d’abdiquer leur volonté entre les mains de « représentants », eux-mêmes pris dans les filets de systèmes ou d’entreprises de pouvoir (des « partis politiques », qui ne sont plus rien d'autre que des machines à arriver au pouvoir) qui détiennent les clés qui ouvrent ou ferment les portes donnant sur les instances de décision, j’ai beau regarder à droite et à gauche, je ne vois personne qui défende une idée plus haute que la somme des officines en présence.
Ils baragouinent au sujet « des Françaises et des Français », mais aucun pour parler un peu noblement de « La France ». Ce qu’on appelait autrefois « le Sens de l’Etat ». Je ne fais pas exprès de ne pouvoir me reconnaître dans aucun des guignols qui aspirent au pouvoir ou qui l'exercent présentement. Je reviens à mes trois moutons. Voici le troisième.
La troisième et dernière affaire en date que je retiens est celle de l’ « ABCD de l’égalité garçon-fille », lancée par le pauvre franc-maçon Vincent Peillon, accessoirement ministre de l’Education. C’est sûr que la droite (« forte », « dure » ou « extrême », je m’en fous) a dévié la trajectoire de son but initial, en dénonçant ici la théorie du genre. Cela veut dire qu’un certain nombre de connards calculateurs ont loupé une occasion de se montrer républicains. Vous voulez savoir ce que j’en pense ? Eh bien tant pis, je vous le dirai quand même.
« L’égalité garçon-fille », vous n’avez pas deviné à qui c’est destiné ? A mon avis, c’est l’évidence : aux populations d’immigrés et descendants d’immigrés qui vivent dans des « quartiers sensibles », essentiellement musulmans, où les filles, quand elles ne sont pas victimes de « tournantes » dans des caves lugubres, préfèrent s’habiller dans des survêtements amples, dans lesquels leurs formes sont suffisamment dissimulées pour qu’aucun petit caïd de onze ans n’ait le culot de les qualifier de salopes et l'envie de leur sauter dessus à plusieurs pour les violer.
Sans parler bien sûr de la mini-jupe. Heureuses et libres, dans ce contexte préfigurant la société terroriste que les talibans vont bientôt imposer de nouveau en Afghanistan, doivent se sentir les filles qui ont choisi, hélas, de s’habiller de noir de la tête aux pieds (sans oublier les gants, j'espère). Dans ce contexte, mais dans ce contexte seulement, l’ABCD de l’égalité garçon-fille se comprend et doit être considérée comme une excellente idée. Je vous étonne, hein !
Malheureusement pour le gouvernement, pour une fois bien intentionné, cela ne peut en aucun cas être dit officiellement, sous peine d’être aussitôt l’objet d’une QPC, recours auprès du Conseil Constitutionnel comme Question Prioritaire de Constitutionnalité. Les (paraît-il) « Sages » de la République auraient immanquablement censuré, au motif du sacro-saint principe d’égalité qui, considéré et régnant comme un impératif absolu, a déjà commencé à tuer notre pays.
Le Cons. Cons. est censé veiller au strict respect (paraît-il, ça reste à voir) de l’universalité des lois. A noter que le problème est strictement le même que lors de l'adoption de la loi sur le voile islamique, où le législateur a été obligé de se déguiser du masque de l'universalité en interdisant à tout le monde (et à toi, et à moi, et à l'autre, etc.) de dissimuler son visage sur la voie publique. On se rappelle les glapissements que cette loi avait suscités.
Je m’explique : de même que nul ne peut s'en prendre à des croyances, de même il est rigoureusement impossible de demander aux gouvernants en général et à Vincent Peillon en particulier de dire que ce programme éducatif n'est en réalité destiné qu'aux Arabes et aux Noirs installés en France depuis plus ou moins longtemps.
Vous imaginez le schproum gigantesque que ça ferait, la gauche de gouvernement accusée de discrimination raciale ? Les « associations », tout ce qui existe d'antiraciste ou d'antifasciste, toutes les bonnes âmes altruistes des droits de l'homme auraient glapi à la « stigmatisation », péché très à la mode.
Vincent Peillon, en instaurant l’ABCD, selon moi, a donc été obligé de prendre une mesure revêtue du sceau de l’universalité. Et c’est là que ça cloche, parce que si l’on sait dans certains territoires de France que les filles qui se maquillent se font traiter de putes, on sait aussi que ce n’est pas le cas partout ailleurs, et que l’égalité garçons-filles est la règle dans la plupart des lieux.
La stupidité paradoxale de ce programme éducatif saute ainsi aux yeux : établi pour une toute petite minorité de la population, bien ciblée sur des communautés imprégnées de la culture islamique traditionnelle, où le statut de la femme est assujetti à la loi masculine, il est obligé, pour éviter les foudres de la censure constitutionnelle, pour ne pas risquer d’être accusé de « stigmatiser » qui que ce soit, de prendre le masque de l’universalité et d'être mis en application absolument partout, au risque de prêcher (et de fatiguer à force de rabâchage) la grande masse des déjà convaincus. Au cas où je verrais juste, je ne m'en dirais pas moins qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des borgnes, où ce sont les aveugles qui font la loi.
Ensuite, que des escrocs jettent la panique chez des parents d’élèves en mettant sur le tapis la théorie du « genre », je considère ça comme un épiphénomène, qu’il faut être au moins journaliste pour traiter comme un événement majeur. Les journalistes – pas tous – me font penser à ces girouettes que les courants de l’air du temps font tourner sur leur axe, successivement dans toutes les directions.
Disons à leur décharge que c’est dû à la féroce guerre commerciale à laquelle se livrent les différents supports médiatiques dans la collecte de la manne publicitaire, guerre qui les oblige à faire le plus de mousse possible pour attirer le consommateur, en espérant affoler les compteurs chargés de mesurer leurs audiences respectives.
Pendant ce temps, le lecteur, l’auditeur, le téléspectateur – l’ordinaire et l’à peu près raisonnable, le citoyen normal, pour résumer – se lamente en vain et se ronge les ongles, s'il lui en reste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois hollande, politique, société, nicolas sarkozy, mariage homosexuel, mariage pour tous, dieudonné, inverser la courbe du chômage, censure, homophobie, antisémitisme, démocratie, abcd de l'égalité, vincent peillon, conseil constitutionnel, qpc, question prioritaire de constitutionnalité, république, arabes, noirs, parti socialiste, ps, ump, discrimination, antiraciste, antifascistes, droits de l'homme, journalistes, presse
mardi, 04 février 2014
HOLLANDE PIRE QUE SARKOZY ?
Quand on met le doigt dans les eaux turbulentes de l’actualité, on risque d’y mettre tout le reste et d’être emporté par le courant : eh oui, je ne suis ni sourd ni aveugle, j’écoute et je regarde. Je lis aussi quelques journaux, accessoirement. Mais je promets de tâcher de me consacrer rapidement à des sujets plus plaisants, plus gratifiants, qui n’ont rien à voir avec le puits sans fond de ce tonneau des Danaïdes qu’on appelle « l’actualité ».
On a dit pis que pendre de Nicolas Sarkozy. Je n’ai pas été le dernier. A cet égard, je n’ai ni regret, ni remords, et je suis effaré de voir constamment publiées dans la presse, depuis quelques mois, des photos où apparaît la sinistre trombine de ce triste individu, accompagnées de légendes explicites mentionnant son « retour en 2017 » et ses nouvelles « ambitions pour la France ». Ah bon ? Elles sont « nouvelles », ses ambitions ? Comme dit Georges Brassens, « si l’Eternel existe », qu’il le prouve en nous préservant de cette malédiction.
François Hollande, lui, a été élu au mépris du fait que je n’ai pas non plus voté pour lui en 2012. J’en tire la conclusion que le suffrage universel a quelque chose de profondément injuste, moi qui ai érigé en doctrine cette profonde maxime que nous devons aux Dupondt, de célèbre mémoire : « C’est mon opinion et je la partage ». On ne remerciera jamais assez Hergé, qui nous a offert cette trouvaille.
On se rappelle une accusation, parmi d’autres fort nombreuses, formulée à l’encontre de Nicolas Sarkozy. On lui reprochait en effet d’être « clivant ». Autrement dit de susciter la haine entre Français, entre autres avec son fumeux débat sur la désormais problématique « identité française ». Tout le monde semble l’avoir oublié, maintenant qu’Hollande (son H est-il muet ou aspiré ?) a pris sa place.
J’espère qu’on n’a pas oublié sur quels arguments François a remplacé Nicolas, arguments qu’on peut résumer dans la formule « rupture avec la rupture ». La « rupture », c’était le slogan de Sarko en 2007, et ça a marché du tonnerre, les gens y ont cru, pour mieux se retrouver « Gros Jean comme devant » un peu plus tard. « Rupture avec la rupture », si je comprends bien le français, devait renouer avec le « statu quo ante ».
Mais là, apparemment, ce n’est pas de compréhension du français qu’il s’agit. Il faut sans doute admettre que le contraire du contraire n’a rien à voir avec le retour à l’état initial. Parce qu’il y a eu de l’innovation entre-temps. « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », comme dit l’autre (ici, « l’autre » s’appelle Héraclite, il faut toujours se méfier de ce que dit « l’autre »). Mais peut-être que Hollande (ou « qu’Hollande » ?) est un lointain descendant d’Héraclite (ou « de Héraclite » ?).
Je reviens au « test comparatif » entre ces deux barils de lessive (ne prétendent-ils pas tous deux laver la vérité plus blanc que blanc ?) que sont François Hollande et Nicolas Sarkozy. On reprochait donc au second d’être beaucoup trop « clivant », d’opposer les Français entre eux et d’exciter la haine. A me souvenir du quinquennat du tout petit homme (je suis gentil, aujourd’hui), je suis amené à penser que c’est tout à fait vrai.
Maintenant, que voit-on depuis bientôt deux ans que François Hollande a accédé à la plus haute marche du podium présidentiel ? Franchement, ce n’est pas mieux. On pourrait même dire que c’est nettement pire. Ce type qui nous sert de président, avec sa tête de premier de la classe, bien lisse et arrondi aux angles, a réussi à prendre en vingt mois une belle brochette de mesures dont on fait semblant aujourd’hui de s’apercevoir qu’elles dressent les Français les uns contre les autres, bien plus efficacement que ne l’avait rêvé pour son compte le tout petit homme. J’en retiendrai trois.
Je ne reviendrai pas sur le mariage homosexuel (je me refuse à dire « pour tous », puisqu’il était déjà pour tous auparavant), qui continue à me heurter de front, tant il contredit des convictions profondément enracinées, dénuées de toute référence à une quelconque religion ou à je ne sais quelle morale. Je crois qu’on s’est ici servi de l’égalité comme d’un rideau de fumée, pour mieux distendre des liens anthropologiques que l’humanité entretient avec ce que je persiste à appeler la « Nature ». Ajoutons que la loi a été décidée dans l’arrogance de la force que donne une majorité parlementaire. L'adoption du mariage homosexuel me fait valdinguer hors du consensus national. J'en prends acte douloureusement. Mais passons.
Il y a ensuite l’ « affaire Dieudonné », dont j’ai déjà parlé ici. J’avoue personnellement que j’ai, depuis toujours, considéré le personnage comme un plaisantin tombé dans ce qu’on appelle aujourd’hui le comique, mais un comique qui ne m’a jamais fait rire. Je n’ai pas suivi sa trajectoire, sinon dans les grandes lignes, que les médias retracent à la hache aujourd’hui, pour simplifier l’explication du « phénomène Dieudonné » grâce au terme « antisémite ».
Le résultat est facile à deviner : de même que, pour la presse idéologique tout entière, il y a eu une énorme « libération de la parole homophobe » à l’occasion du mariage homosexuel, il y a eu, à l’occasion de « l’affaire Dieudonné », « libération de la parole antisémite ». Comme de bien entendu, ai-je envie d’ajouter. Tout le monde oublie que, sans l’appel de Valls à l’interdiction des spectacles du personnage, l’affaire aurait gardé sa dimension artisanale d’origine, juste faite pour faire couler le pognon dans la galaxie où évolue la planète erratique du soi-disant comique. Dieudonné peut remercier Manuel Valls.
Sur ces deux premiers sujets, donc, qu'est-ce qu'on constate ? Que ce soit à propos du mariage homosexuel ou à propos de l'antisémitisme (supposé ?) de Dieudonné, le gouvernement de monsieur François Hollande, celui qui se revendiquait le « Président Normal », en rupture avec la rupture provoquée par le tout petit homme, a systématiquement jeté du pétrole pour éteindre l'incendie allumé par son prédécesseur (on se rappelle que c'est lui qui a commencé, en instaurant les débats sur l'identité française).
Pour mieux dissimuler sa volonté de ne rien changer aux structures et au fonctionnement économiques et politiques du monde, ou pour ne pas avouer sa complète impuissance à le faire, François Hollande a choisi et décidé de reporter son action sur le terrain sociétal, et de brandir le drapeau du sens de la vie en commun pour rassembler sous son panache blanc sa clientèle électorale.
Accessoirement, il n'a pas hésité à ébranler des piliers anthropologiques de l'humanité, sous le prétexte fallacieux de la modernisation du corps social. Ce faisant, il a moins accompli la « rupture avec la rupture », qu'il n'a introduit une fracture dans la colonne vertébrale du squelette même du dit corps social.

LE MONDE DATÉ DIMANCHE 2 - LUNDI 3 FEVRIER 2014
Ah c'est sûr, maintenant, elles peuvent hurler au « réveil de la France réactionnaire », toutes les chorales anti-homophobes et anti-racistes, tous les incendiaires, la militante intégriste de la confusion des valeurs Caroline Fourest en tête ! Ah c'est sûr, François Hollande, avec son air de ne pas y toucher, est remarquable dans le rôle du provocateur à la haine et du pyromane en chef.
Eh bien, que le cul leur pèle ! Comme dit je ne sais plus quelle sorcière chez Alfred Jarry : « La paille en cul et le feu dedans ! ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journaux, presse, journalistes, le monde, france, société, françois hollande, parti socialiste, nicolas sarkozy, caroline fourest, georges bressens, mariage homosexuel, dieudonné, manuel valls, homophobie, antisémitisme, président normal
lundi, 03 février 2014
LAÏCITE : ISRAËL ET TUNISIE
C’est entendu, il faudrait que moi aussi je commente un peu l’actualité, que je fasse mon petit « Café du Commerce », que j’ajoute mon grain de sel sur la queue de la pie qui bavarde, qui jacasse, qui nous soûle d'informations, qui nous gave d'événements et qui tente de saturer notre imaginaire avec le spectacle du monde en nous faisant croire qu'il illustre la phrase de Rimbaud : « La vraie vie est ailleurs ». Ma vraie vie à moi, elle est ici. Mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j’ai le commentaire difficile, l’envie tiède, le goût mou, l’appétence renâclante, la fringale épuisée. Peut-être ai-je par surcroît le besoin satisfait et le désir comblé ? Allez savoir.
Il y a sans doute aussi la conscience ou la certitude que, à l’instar de chacune des quarante-trois millions de petites feuilles que les Français se préparent à glisser dans des petites enveloppes bleues puis à laisser tomber dans un cube transparent aux sons lugubres d'un timbre de compteur et d’une voix caverneuse proférant un « a voté » fatidique, ce que je peux dire ici ne sert à rien, noyé qu'il est dans le flot des avis, le déferlement des opinions, la cataracte des idées et l’avalanche des points de vue. Sans parler du foisonnement des jugements.
Et ce n’est pas qu’il n’y aurait rien à dire du spectacle du monde tel qu’il s’offre en divers lieux de notre encore belle planète. Tenez, prenez cette innocente confidence faite au premier ministre norvégien par le premier ministre israélien, comme quoi son fils Yair couchait avec la belle Sandra Leikanger.

YAÏR NETANYAHU AVEC SA NORVEGIENNE
Je me moque de savoir dans quelles positions variées ils ont accompli la chose. A les voir ici, on se dit qu'ils ne se sont pas trop ennuyés ensemble. Mais l’intéressant dans l’affaire est ailleurs : c’est la réaction des noyaux de fondamentalistes et autres intégristes juifs, souvent membres du parti Shass (que je situerais volontiers à l'extrême-droite de Jean-Marie Le Pen), que des journalistes peu scrupuleux qualifient d’ « orthodoxes ». Je ne vois pas bien ce qui les empêche de les appeler des « fascistes religieux ».
Bref, en apprenant les aventures de Yair Netanyahu avec Sandra Leikanger, ce minuscule monde qui fait un bruit énorme s’est dressé sur ses ergots, partant en guerre contre ce scandale innommable. Qu’est-ce qui les défrise à ce point, ces fanatiques ? Oh presque rien, c’est seulement que ça ne se fait pas, à leurs yeux. C’est seulement que Sandra la norvégienne n’est pas juive. Horreur ! Au fait, personne n’a pensé à l'occasion à demander à Anders Bering Breivik, fasciste déclaré, tueur de l’île d’Utoya en 2011 (77 victimes suivant une source), pensait du fait qu’une de ses compatriotes consente à se faire sauter, sans déplaisir apparent, par un juif ?

ANDERS BERING BREIVIK, FASCISTE ET FIER DE L'ÊTRE
Qu’on se le dise, il est interdit à un juif d’épouser une non-juive. Les juifs intégristes détestent ça. Et mêmes quelques autres, considérés je ne sais pourquoi comme plus tolérants (voir La Vérité si je mens). Le crime ? L'agression ? L'attentat ? Cela s’appelle « assimilation » (en passant, les médias français se gargarisent avec la tisane idéologique qui porte le nom d' « intégration »). Sans entrer dans les détails des prescriptions et proscriptions religieuses, je voudrais juste qu’on réfléchisse à une drôle de comparaison que l’actualité nous met sous les yeux.
Regardons un peu du côté de la Tunisie. Qu’est-ce qui se passe là-bas ? Pas grand-chose : après des mois de luttes politiques, de tractations tortueuses, parfois de crimes contre des représentants de la Tunisie démocratique, la Constituante vient d’adopter une nouvelle Constitution. Tiens donc, diable et stupéfaction, c’est le premier pays musulman à rayer de la liste des crimes inexpiables celui d’apostasie, puni de mort en Arabie Saoudite et dans d'autre contrées accueillantes.
Ça ne vous fait pas quelque chose, d’apprendre que dans un pays musulman, la religion, non seulement cesse d’être LA source du droit, mais qu’il soit en plus admis de la renier ? Pendant ce temps, tous les pays où le pouvoir est viscéralement uni à la religion font leur possible pour criminaliser sa contestation.
Or c’est très curieux, ce qu’on constate : c’est sûr que la Constitution tunisienne, la presse en a parlé. Mais finalement pas tant que ça. Et pas forcément avec la précision souhaitable. Et c’est sûr que le parti Ennahda, les islamistes majoritaires (dans les urnes, mais …), a accepté de laisser le gouvernement à des « technocrates », mais n’en garde pas moins un assez bon appétit de pouvoir.
Toujours est-il que la France entière (j’exagère beaucoup) célèbre l’extraordinaire avancée que représente cet article de la Constitution qui décriminalise le rapport des individus à la religion. Tout en ne protestant pas violemment contre les vociférations fascisantes des fanatiques du parti Shass, qui conditionne son adhésion au gouvernement Nétanyahu à son respect de l’intégrité absolue des prescriptions et proscriptions du Livre.
Je ne sais pas combien il y a, respectivement, de juifs et de musulmans en France. Il paraît qu’ils sont entre 30000 et 40000 à porter l’étoile de David en Rhône-Alpes. Sur la France entière, les musulmans sont (à ce qu’on m’a dit) plusieurs millions. Encore faudrait-il différencier croyants et pratiquants, mais bon.
Ce que je retiens, c’est la différence de traitement : pendant que tous nos démocrates saluent la nouvelle Constitution tunisienne, considérée comme un immense Progrès, parce qu'elle consacre un article à l'effacement des infractions à la religion de la liste des crimes, c'est à peine si l'on entend quelques vagues échos vite assourdis quand des fascistes religieux menacent le premier ministre israélien de lui retirer leur soutien politique s’il persiste à autoriser son fils à baiser avec une femme qui a sans doute, avant de croiser sa route, déjà frayé avec des non circoncis.
La différence de traitement, pour ne pas dire la contradiction flagrante, entre les deux faits montre à mon avis deux influences inégales en France, toujours présentée comme la Terre Promise de la laïcité. Mais si la France était à ce point laïque, laïciste ou laïcarde, l’Etat français aurait célébré à grand coup des trompettes de la Garde Républicaine le vote quasi-unanime de la Constitution tunisienne (islamistes compris, alors qu’ils sont légalement majoritaires), avec sa volonté d’instaurer la laïcité, pour la première fois de l’histoire dans le monde musulman !
Les ronchons diront qu’il reste interdit, dans ce texte novateur, de s’en prendre au « sacré ». J’en suis d’accord, et l’histoire n’est pas finie. Mais que la France laïque, laïciste ou laïcarde, pays en tout cas où l'on fait si grand cas de la laïcité, n’ait strictement rien à dire sur le statut du religieux dans l’Etat d’Israël, je le dis comme je le pense, voilà qui me semble à la fois inconséquent et assez répugnant.
Que des citoyens d'Israël puissent revendiquer fièrement l'idée que l'Etat d'Israël soit admis comme un « Etat Juif », voilà du rétrograde racorni qui dépasse mon pauvre entendement républicain. Que faire des Arabes israéliens ? Sont-ils des citoyens à égalité avec les autres ? Il ne faut pas confondre théocratie et démocratie.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, journaux, informations, juifs, antisémitisme, laïcité, israël, assimilation, intégration, tolérance, tunisie, constitution tunisienne, intégrisme, fondamentalisme, fascisme
dimanche, 02 février 2014
22 BALZAC : UNE DOUBLE FAMILLE (1830)
Cette nouvelle, assez brève pour intéresser par sa vivacité et assez longue pour permettre une certaine complexité, raconte, comme le titre l’indique, la double vie d'un homme. Il s'appelle Roger de Granville. Le début présente un homme âgé de la quarantaine environ, qui passe mystérieusement dans une petite rue, obscure et humide en toute saison, tous les jours, à heures à peu près fixes. L’une des maisons est habitée par une femme assez vieille et une jeune fille très jolie, qui s’applique studieusement à ses travaux de broderie. Le tableau respire la gêne et la pauvreté. Leur vie est très difficile.
L’homme aperçoit un jour un « papier timbré » sur la table. Il revient spécialement en pleine nuit pour poser sur la table, par une fente dans la vitre, une bourse pleine, qui sauve momentanément les deux femmes de la saisie. De fil en aiguille, ils font connaissance, se plaisent et se promènent ensemble, sous le regard de la vieille madame Crochard. Pour elles, il restera longtemps « monsieur Roger ».
On retrouvera Caroline Crochard sous le nom de « de Bellefeuille », douillettement et confortablement installée dans un bel appartement, nantie de deux enfants. Roger passe régulièrement la voir. Elle l’attend fiévreusement, en état de dévotion amoureuse. Sa mère est logée ailleurs, à l’abri du besoin. Fin de la situation n°1.
Balzac opère alors ce qu’on appelle au cinéma un « flash-back ». Nous découvrons un Roger de Granville juvénile et promis au plus bel avenir, vu qu’il est dans les bonnes grâces de gens importants. Son père, le « seigneur » de Granville le convoque à Bayeux : il veut lui faire épouser une demoiselle de la meilleure société, et surtout nantie d’une superbe dot.
Il le prévient toutefois que la mère de la donzelle, la veuve Bontems, est une effroyable bigote, qui plus est entièrement soumise à la « direction de conscience » telle que l’envisage le redoutable et, osons le dire, intégriste abbé Fontanon. Le fils découvre sa promise, et Balzac nous avertit d’emblée : « Granville commit alors l’énorme faute de prendre les prestiges du désir pour ceux de l’amour ». Si l’amour est aveugle, le désir l’est, semble-t-il, tout autant.
Il serait d’ailleurs intéressant de rapprocher Une Double famille de La Peau de chagrin, ce roman qui établit une équation impitoyable entre l’expression ou la force du désir et la durée de la vie, étant posé que plus l’individu modère ses désirs, plus longtemps il peut espérer vivre, comme le prouvent les cent deux ans du vieux marchand qui donne la peau à Raphaël. Mais les excès raccourcissent-ils l’espérance de vie ? Les Rolling Stones prétendraient à bon droit être une preuve du contraire. Seuls les cyniques survivent à toutes leurs intempérances, peut-être ?
Quoi qu’il en soit, le résultat ne se fait pas attendre : catastrophique ! Granville, très pris par ses hautes fonctions, laisse la bride sur le cou à son épouse pour aménager, décorer et meubler son hôtel particulier. Je crois que Balzac s’est payé un plaisir de gourmet raffiné en décrivant l’intérieur de l’héritier « de Granville » comme l’antithèse pure et simple de l’univers grand-bourgeois et aristocrate (les deux étroitement mêlés) qui figurait son rêve ultime.
Pour résumer, Madame a élaboré une lugubre caverne, mais où les pierres, les objets, les couleurs, les matières seraient systématiquement dépareillés. Je vois l’ensemble sur un fond marronnasse, pour situer visuellement. Granville, inutile dès lors de le préciser, a beau faire à sa femme, ponctuellement, un enfant par an, il finit par ne plus supporter la vie, d’où la mine terrible que Balzac décrit au tout début du récit, quand il se met à passer dans la rue de madame Crochard, et la double famille, clandestine celle-là, qu’il décide de fonder.
L’auteur renoue ensuite avec la descendance de Caroline : l’histoire se finit en effet dans l’amertume exécrable de Roger de Granville. Un soir, il rencontre Horace Bianchon le médecin dans une vilaine rue. Celui-ci lui parle d'une pauvre femme qu'il soigne dans la maison dont il sort : son fils lui a mangé sa fortune en vin et en femmes, et la pauvre s'est laissé faire.
Le comte tressaille en apprenant qu'elle se prénomme Caroline, puis il plante là Bianchon stupéfait après lui avoir déclaré : « Quant à Caroline Crochard, reprit-il, elle peut mourir dans les horreurs de la faim et de la soif, en entendant les cris déchirants de ses fils mourants, en reconnaissant la bassesse de celui qu'elle aime : je ne donnerais pas un denier pour l'empêcher de souffrir, et je ne veux plus vous voir par cela seul que vous l'avez secourue ...».
Ses enfants légitimes ont embrassé de très belles carrières : une fille est comtesse de Vandenesse, un fils Procureur du Roi. Tiens justement, Eugène rend ce soir à son père une visite inopinée, au désagrément du vieillard, mais c'est pour lui apprendre qu'un jeune homme vient d'être arrêté chez un de ses amis, ayant « commis un vol assez considérable » : il « s'est réclamé de vous, il se prétend votre fils ». Apprenant qu'il s'appelle Charles Crochard, n'ayant plus aucun doute, il part pour l'Italie en laissant à son fils le magistrat assez d'argent pour régler cette affaire à sa guise.
L'histoire s'achève sur quelques considérations peu encourageantes au sujet du mariage et du choix d'une épouse : « Le défaut d'union entre deux époux, par quelque cause qu'il soit produit, amène d'effroyables malheurs ». On peut à son gré trouver Balzac terriblement cruel, effroyablement pessimiste, ou simplement lucide et réaliste. Rayer la mention inutile.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)






