mardi, 25 décembre 2018
1/14 : VOLCANIQUES
Après roulage et polissage par la mer.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
lundi, 24 décembre 2018
MON ART (presque) ABSTRAIT
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
samedi, 22 décembre 2018
OBJET INNOMMABLE
Pour les évacuations difficiles. Innommable, mais il paraît quand même que ça porte un nom : "furet".
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
jeudi, 20 décembre 2018
PRISE DE CONSCIENCE ?
EN FAIT, L'ÉCOLOGIE EST UNE POTICHE.
Vraiment ? Vous y croyez, vous, à ce qu'on raconte ? Selon Le Monde (daté 18 décembre, suite à la "COP 24" de Katovice), il faudrait croire que les populations sont convaincues qu'il est indispensable de procéder à la désormais fameuse "transition écologique" et que, si ça coince, c'est la faute aux "politiques", aux gouvernements, aux Etats : « Le philosophe Dominique Bourg souligne la distorsion entre la prise de conscience des populations et l'inertie politique » (ce n'est pas Le Monde qui parle, c'est juste annoncé en une, mais c'est renforcé par l'éditorial, qui dénonce la pusillanimité des Etats). Ma foi, je suis comme les Normands de Goscinny et Uderzo.

Pour ce qui est des gouvernants, je crois que c'est incontestable : sans même parler de la Pologne, de la Chine ou de l'Inde encharbonnées, de Donald Trump ou de Bolsonaro, pour dire en quelle considération notre président tient la cause de l'écologie, il a suffi d'un problème de politique intérieure (non négligeable, c'est certain) pour qu'Emmanuel Macron, sacré champion de la cause écologique (mais c'était avant la démission de monsieur Hulot), envoie à Katovice un sous-fifre avec mission de représenter la France, et encore, pas pendant toute la durée de la conférence. Avec la "déception" générale à l'arrivée (n'en déplaise à madame Sylvie Goulard).
Mais je me dis que si les gouvernants se permettent cette grande désinvolture à l'égard du climat, c'est certes parce que leurs pays sont engagés dans la grande compétition économique mondiale (les producteurs de pétrole ne tiennent pas à voir se tarir la manne procurée par l'or noir), mais c'est sans doute aussi parce que, politiquement, ils auraient du mal à "vendre" l'argument écologique à leurs populations, plus soucieuses – et on les comprend ! – de préserver ou d'améliorer leurs conditions matérielles d'existence que de sauvegarder la nature.
Prenons les gilets jaunes : qu'est-ce qui a mis le feu à la sainte-barbe du navire France ?

C'est la taxe dite "écologique" sur les carburants. C'est vrai qu'il faut faire payer les émissions de CO2 par ceux qui les fabriquent, mais il fallait être totalement ignorant, inconscient et irresponsable pour déguiser en argument écologique une vulgaire taxe envoyée dans les gencives de populations déjà mises en difficulté par ce que les nécessités quotidiennes et les dépenses contraintes leur coûtent chaque mois. Macron aurait voulu griller la cause écologique dans l'esprit des populations qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Pas la peine de rappeler le sort finalement fait à l' "écotaxe" de notre Ségolène nationale. Politiquement, l'écologie est bien une "potiche" avec une plante verte pour faire joli dans le décor, mais tellement recollée, raccommodée et rafistolée que plus personne n'est prêt à parier un kopeck sur son avenir. De profundis, l'écologie "politique". L'écologie n'a aucune chance si elle se fait parti politique, elle en garde quelques-unes si elle se fait SOCIÉTÉ.
Car la vérité de l'urgence écologique est là. Jean Jouzel, ancien président du GIEC, cet organe qui rassemble les résultats des recherches de je ne sais plus combien de climatologues, laissait percer son inquiétude, à la clôture de la "COP 24". Il faut impérativement, selon lui, faire en sorte que le climat ne se réchauffe pas de plus d'1,5° dans les années à venir, sous peine d'irréversibilité catastrophique du processus. Pour cela, il faut réduire la production de gaz à effet de serre. Pour cela, la plupart des gens pensent qu'il faudrait se tourner vers les énergies renouvelables.
Voilà qui est bien parlé, disent certains, mais d'abord, avez-vous pensé à l'empreinte carbone laissée par la fabrication d'un panneau photovoltaïque ? Par l'usinage des énormes pièces métalliques des éoliennes ? Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire qu'à s'obstiner à produire (et consommer) toujours plus d'énergie ? Les responsables continuent à seriner que, pour faire disparaître le chômage, il faut toujours plus de croissance : lâcher tous les freins au "dynamisme de l'économie".
C'est précisément là que rien ne va plus. Les optimistes ont beau faire des sourires à la "croissance verte", cette idée a priori pas si folle apparaîtra tôt ou tard pour ce qu'elle est : une fumisterie. Car la croissance, ça signifie toujours plus d'énergie pour produire toujours davantage de biens. Or, qui dit "énergie" et "production" dit prédation des ressources en énergies et en matières premières : le serpent se mord la queue. Le mécanisme reste à l'œuvre.
Il ne faut pas se faire d'illusion : l'humanité actuelle est revenue à l'époque préhistorique lointaine où chaque clan de néandertaliens ou de sapiens survivait de pêche, de chasse et de cueillette. Voilà ce qu'on appelle "économie de prédation". Aujourd'hui, notre système (économie de production-consommation) a rejoint la préhistorique économie de prédation , en mille fois pire. Car ce qui était viable quand un tout petit nombre d'humains prenait à la nature – et tout à la main, s'il vous plaît, ce qui limite les prouesses de tous les Stakhanov, qu'ils soient de simples hommes ou des machines géantes – ce qu'il lui fallait pour assurer sa pérennité (et pas plus, faute de savoir le conserver et le stocker) est devenu un fléau, quand sept (bientôt neuf) milliards d'humains pratiquent la prédation à grande échelle et à grands coups de mécanocratie aveugle, en dépassant outrageusement les limites du nécessaire, un fléau qui est une vraie menace pour la survie de l'espèce.
On lit ici ou là, on entend aussi de plus en plus souvent des slogans du genre : "Faites quelque chose pour la planète !". Mais elle s'en tamponne, la planète : ce n'est pas elle qui est menacée, c'est l'ensemble des mammifères bipèdes qui s'agitent dessus. "Gaia" (Isabelle Stengers et quelques autres) est totalement indifférente à ce qui peut leur arriver. Elle en a vu bien d'autres, et, quand l'humanité aura disparu de sa surface, elle continuera son existence, ni plus ni moins que comme avant, jusqu'à son absorption dans la "géante rouge" que sera devenu le soleil, dans quelques milliards d'années. S'il y a une solution à trouver, ce n'est pas pour elle : c'est pour nous. Ce qui nous paraît nécessaire et suffisant, à nous autres pays riches, est décidément trop : nous sommes non seulement en train de vider notre garde-manger, mais aussi de le détruire, le garde-manger.
Et la solution, elle n'est certainement pas dans l'innovation : elle est dans le renoncement. Ce que tout le monde appelle "transition écologique" (je mets les guillemets), ça va dans le sens de l'innovation. Ce qui veut dire que ceux qui soutiennent cette perspective ne contestent rien du modèle économique en vigueur, qui est précisément cet insatiable prédateur et accapareur qui est la cause de tout le mal, sous l'apparence séduisante et menteuse du confort, de l'abondance et de la facilité. Et ça veut dire qu'ils n'ont rien compris au phénomène actuel. Pour eux, c'est un modèle incontestable et toujours valide. Cela veut dire qu'ils en sont restés au bon vieux schéma qui consiste à "aller de l'avant" (c'est l'industrie triomphante, c'est Renault-Billancourt, ou c'est le poilu en pantalon rouge qui part à l'assaut sous les balles).
« Ciel ! ce sont les machines,
Les machines divines,
Qui nous crient "en avant"
En langue de savant. »
Guy Béart, Le Grand chambardement (1968).
Alors le renoncement, maintenant. Pour donner une chance à l'humanité de survivre encore quelques centaines d'années (?), elle est là, la solution : renoncer aux facilités. Je veux de la lumière : j'appuie sur un bouton, et la lumière est. Je veux laver ma chemise : j'appuie sur un bouton, et ma chemise est propre. Je veux laver mon assiette : j'appuie sur un bouton, et mon assiette m'est rendue nickel. J'ai un peu froid chez moi : j'appuie sur un bouton, et l'atmosphère se fait agréable et tempérée. J'ai un peu trop chaud en été : j'appuie sur un bouton, et une fraîcheur de bon aloi s'installe. Je dois impérativement aller de Lyon à Molinet ou Strasbourg en voiture : j'actionne le démarreur (une variante du bouton), et j'arrive bientôt à destination.
Voilà exactement la raison pour laquelle nous autres humains (« Frères humains qui après nous vivez, N'ayez le cœur contre nous endurci »), nous épuisons les ressources qui nous permettent aujourd'hui de vivre agréablement, mais plus pour longtemps. Voilà en réalité à quoi il faut convaincre les populations qu'elles devront renoncer si elles tiennent vraiment à ce que la vie humaine reste envisageable sur terre et à ce que leurs lointains descendants puissent continuer à ne pas avoir très envie de mourir, vu les conditions de vie. Il faut leur dire qu'elles n'ont pas fini d'en baver ! On comprend devant quel mur politique sont placés les responsables : convaincre je ne sais combien de milliards de citoyens de renoncer aux avantages matériels dont ils bénéficient déjà (pays "avancés"), ou dont ils rêvent et se sont fait un programme d'existence (les autres pays, encore plus de milliards de personnes).
Mais qui est prêt à renoncer aux commodités que l'épanouissement économique (et géopolitique) de l'Occident lui a finalement procurées, le plus souvent après d'âpres luttes sociales ? Moi-même, je n'ai guère de sympathie pour cette perspective, bien que (parce que) je sois loin d'être le plus gros prédateur. On fait briller de mille feux l'euphémisme de la "transition écologique" pour ne pas effaroucher les populations.
Comment celles-ci prendront-elles des discours de vérité quand on leur annoncera qu'il faut se serrer la ceinture ? Quand on leur expliquera qu'en réalité, la seule vraie "transition écologique" consiste en un appauvrissement généralisé ? Quand on leur dira que, pour que les générations à venir aient une chance de survivre, il va falloir qu'elles vivent avec moins de confort ? On vient d'en avoir un petit échantillon sur les ronds-points du territoire français à cause d'une petite taxe sur les carburants. Parce qu'on ne sortira pas de cette autre vérité : chaque mois, il faut arriver à la fin du mois.
Alors on pourrait se tourner vers les plus authentiques, les plus gros, les plus gras prédateurs, non ? Bêtement, on a envie de se dire qu'elle est là, la solution. J'imagine le scénario. Là non plus, ce ne sera pas facile, et d'autant plus difficile, compliqué, voire insurmontable que là, il s'agit de s'attaquer au siège du vrai pouvoir. S'attaquer aux populations, ça pose déjà problème. Alors s'attaquer aux puissants, on comprend très vite quelle sera l'issue de la bataille.
A part ça, tout va bien : la COP 24 se termine en pet de lapin ; la production de gaz à effet de serre a battu son propre record l'an dernier ; et sur 577 députés, 491 étaient absents le 30 mai 2018, jour où a été rejetée l'interdiction du glyphosate (il n'y a pas que le climat, il y a aussi la chimie) par l'Assemblée Nationale. Et l'on n'a jamais autant parlé d'environnement, d'écologie, de "gestes pour la planète".
Si j'étais linguiste, je m'inspirerais du célèbre titre de John Langshaw Austin, Quand Dire c'est faire. Il mettait en évidence les caractéristiques des "énoncés performatifs", ces mots qui déclenchent une action. J'appellerais l'antithèse radicale entre discours écologique et réalité de la lutte pour l'environnement un énoncé contre-performatif : l'environnement, c'est comme l'amour, plus on en parle, moins on le fait. Allez, ne parlons plus de l'environnement, du changement climatique, de l'urgence écologique : laissons advenir ce qui doit advenir.
Non, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, journal le monde, cop 24, katovice, dominique bourgtransition écologique, goscinny uderzo, donald trump, emmanuel macron, sylvie goulard, gilets jaunes, changement climatique, france, société, politique, écotaxe, jean jouzel, giec, climatologie, croissance verte, gaia, isabelle stengers, énoncés performatifs, jl austin, quand dire c'est faire, glyphosate, round up, monsanto, pesticides
mercredi, 19 décembre 2018
PHOTOGRAPHIE
Dans la série "Mon art abstrait".
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
lundi, 17 décembre 2018
GILET JAUNE ET POLITIQUE
Les intellos de tout poils, sociologues, historiens, philosophes, politologues et tutti quanti, continuent à "décrypter" le mouvement des gilets. Mine de rien, ça les fait jubiler, car voilà-t-il pas que ça leur donne une visibilité inhabituelle. Ils ont enfin l'impression d'exister. Je veux dire : d'exister parce que les médias éprouvent un urgent besoin d'enregistrer leur parole. Ils sont tout fiérots d'être ainsi courtisés et d'avoir ainsi l'occasion d'expérimenter leur "charisme" et de mesurer "in vivo" leur influence.
Le point commun de ces gens est que le système auquel ils appartiennent est d'accord pour admettre qu'ils produisent du "SAVOIR". De quelque côté qu'on se tourne, il y a de la connaissance comme s'il en pleuvait. Et en même temps, j'ai la très nette impression qu'il n'y a jamais eu autant d'ignorance de la société sur son propre fonctionnement.
J'entends M. Machin pérorer sur la notion de "représentation". J'entends M. Truc s'étendre longuement sur le concept d'"organisation". J'entends M. Bidule exposer ses doutes sur la crédibilité d'un mouvement qui n'a toujours pas élu ou désigné de "comité de grève", qui n'a encore rédigé aucun tract synthétisant les revendications, et qui dénie aux personnalités "émergentes" le droit de les représenter. J'entends M. Tartempion plaquer sur le dit mouvement le modèle qu'il a laborieusement élaboré en étudiant l'histoire des mouvements sociaux, des insurrections populaires et des révolutions depuis l'âge de pierre.
Pour moi, tous ces gens très savants adorent sodomiser les diptères et capillotracter la réalité pour mieux la couper en une infinité de tout petits tronçons d'images de la réalité qu'ils s'efforcent ensuite de recoller en se débrouillant pour que ces images finissent par former un tableau et par ressembler à l'idée (cohérente, forcément) qu'ils s'en sont faite. Les politiciens se joignent à eux pour faire entrer cette réalité dans le moule que les grandes écoles ont collé dans leurs grosses têtes, et pour faire dire enfin au mouvement des choses qu'ils connaissent et sur lesquelles ils aient enfin l'impression d'avoir prise. Rien ne déplaît davantage à un politicien que de ne pas pouvoir se choisir un "interlocuteur crédible" digne de lui (c'est-à-dire à qui il ne puisse pas bourrer le mou).
Je ne suis pas si savant et je ne vais pas si loin. Je crois que le mouvement des gilets jaunes reste, pour tous les observateurs et commentateurs, une surprise et, en tant que tel, qu'il leur paraît inadmissible, incompréhensible. Qu'est-ce qu'il y a de si incompréhensible dans l'espèce d'émeute à laquelle on assiste depuis un mois ?
Je n'affirme rien, pensez donc, je pose seulement une question. Et si le mouvement des gilets jaunes n'avait strictement aucun rapport avec une ACTION, quelle qu'elle soit ? Et si le mouvement des gilets jaunes (si c'est un mouvement) avait des chances de n'être qu'une RÉACTION à une AGRESSION ?
Je me demande en effet si les gilets jaunes ont une sorte d'ébauche d'intention ou de volonté de se muer en mouvement politique. Les revendications sont si diverses, hétéroclites, hétérogènes et disparates, qu'y voir une forme d'expression politique relève à mon avis de l'exploit intellectuel, c'est-à-dire de l'acrobatie de cirque.
Et je me demande donc si ces manifestations n'expriment pas, tout simplement, la colère provoquée seulement par la situation économique et sociale qui est faite à la population des gens ordinaires par un système ultralibéral totalement sourd, aveugle et indifférent aux souffrances qu'il engendre. Est-ce que ce n'est pas le sursaut des fins de mois difficiles, trop difficiles et de plus en plus difficiles ?
Le système, qu'est-ce que c'est ? C'est la privatisation de tout, c'est l'Etat qui sous-traite ("externalise") de plus en plus de ses missions, c'est le rétrécissement et l'affaiblissement des services publics, c'est un modèle de société de moins en moins redistributif, c'est le creusement d'inégalités de plus en plus profondes entre une petite frange de gens ultra-riches et le marécage où pataugent plus ou moins la majorité des citoyens, et j'arrête ici ma liste, parce que.
La majorité silencieuse n'a pas l'habitude de s'exprimer en public, n'a pas l'habitude de manifester dans les rues ou aux ronds-points et péages et a peut-être aussi perdu l'habitude d'aller mettre son bulletin dans l'urne aux échéances. Les gilets jaunes, si mes interrogations ne sont pas trop aberrantes, disent simplement à Emmanuel Macron : « On n'en peut plus, monsieur le président ». C'est l'ensemble du système économique qui s'est mis en place depuis quarante ans – auquel Macron veut adapter la France à marche forcée – qui produit la situation qui produit les gilets jaunes. Et c'est le même système, qui se moque éperdument des injustices de plus en plus graves qu'il autorise, qui produit les Orban, Trump, Bolsonaro et leurs semblables.
Non, la plupart des gilets jaunes ne font pas de politique. Ils constatent seulement qu'ils vont vers le pire, du fait d'un système économique qui leur laisse de moins en moins de place. Et ils le disent très fort. Trop c'est trop, monsieur Macron ! Serez-vous, monsieur Macron, le premier électeur d'une Le Pen en France ? Voulez-vous à ce point le malheur du pays ?
Voilà ce que je dis, moi.
Note ajoutée le 18/12 : voilà, la Commission du "débat public" est maintenant impliquée dans l'organisation d'une Grande Concertation Nationale qui doit durer trois mois. C'est parti pour une grande partie de pêche. Le but de la manœuvre ? Noyer le poisson.
Toujours le 18/12 : suite au commentaire positif de "RN" sur ce billet, j'ajoute la précision suivante : c'est M. Gilles Legendre, Président du groupe LREM (Sénat ou Assemblée, peu importe), qui a déclaré exactement sur la chaîne "Public-Sénat" : « Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons, et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite, mais dont nous portons tous la responsabilité, moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir été trop intelligents, trop subtils, trop techniques dans les mesures de pouvoir d'achat. » Merci, M. Legendre, pour cette expression parfaite et immaculée de la cause principale de la haine qui vient de se faire entendre sur les ronds-points pour les gens de votre espèce qui tous, je n'en doute pas, pensent strictement la même chose que révèle votre aveu : l'arrogance de ceux qui savent, de ceux qui ont, de ceux qui peuvent. Vous êtes une illustration archétypale de ce que je ne sais plus qui nommait : LA BÊTISE DE L'INTELLIGENCE.
12:09 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : gilets jaunes, emmanuel macron, france, société, marine le pen, front national, rassemblement national, politique
dimanche, 16 décembre 2018
STATISTIQUE ET GILET JAUNE
On entend des choses merveilleuses sur les ondes. Tiens, l'autre jour (je n'ai pas noté quand), il y avait deux "spécialistes", des "experts", bref, des chercheurs en je ne sais quoi, autour d'un micro, pour débattre d'une grave question : le pouvoir d'achat a-t-il augmenté ou baissé ? Peu importe le contenu du débat, je retiens seulement qu'ils étaient d'accord pour dire une chose : selon l'INSEE, le niveau de vie a légèrement augmenté, même en tenant compte de l'inflation. Ah, l'INSEE a parlé, circulez y a rien à dire, prosternons-nous.
Là où j'ai commencé à rire et à me payer la fiole des deux discoureurs, c'est quand ils ont établi, d'un commun accord, une distinction tranchée entre les chiffres fournis par l'oracle INSEE et la "perception" que les gens ordinaires ont de la réalité dans laquelle ils baignent 24 h. sur 24. C'est clair : les gens ordinaires sont des ignorants, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vivent concrètement, ils sont incapables de mesurer leur pouvoir d'achat, ils ne savent même pas ce qu'ils mettent dans leur "panier de la ménagère". Les gens ordinaires vivent à côté de leurs pompes. Ce qu'ils perçoivent est faux, c'est du "ressenti", c'est, disent les savants-de-chiffres, "subjectif". C'est la statistique qui a raison. Eh bien non !
Je pensais à la Grèce au plus vif de la crise et aux propos tenus à l'époque par Brice Couturier sur France Culture, où il se félicitait de l'évolution des chiffres de l'économie grecque, qui laissait espérer que ce pays sortirait bientôt de l'épouvantable marasme dans lequel l'irresponsabilité économique des citoyens et de leurs responsables politiques l'avait plongé. Il lisait les chiffres sur son papier, il ne voyait pas la multiplication des suicides, il ne voyait pas le malheur quotidien de la population, il ne voyait pas l'amputation criminelle des retraites : les Grecs sont en train de crever la gueule ouverte, mais la Grèce va bientôt pouvoir de nouveau emprunter de l'argent sur les marchés. Ne pas confondre les Grecs et la Grèce. Alléluia !
L'écart entre les chiffres et le "ressenti" est une terrible chose, quand on est du côté du "ressenti". Je suis du côté du "ressenti". Moi, je SAIS que mon pouvoir d'achat a baissé : je rogne ici et là, je m'interdis ceci, je renonce à cela, je me restreins aujourd'hui dans des domaines qui ne me posaient pas problème hier. Le savant-de-chiffres aura beau me gueuler dans les oreilles que mon "ressenti" n'est pas vrai, je sais que j'ai raison, je sais qu'il me ment, même si je suis dans l'incapacité de le lui prouver. Il peut m'abreuver d'arguments : je sais qu'il ne sait rien de MA réalité. Je sais que ma réalité n'a rien à voir avec la sienne. La vérité statistique se situe par principe hors de l'expérience de chacun.
Je ne sais pas ce que l'INSEE met dans le "panier de la ménagère", mais j'aimerais bien savoir, car je me demande vraiment comment il s'y prend, dans sa cuisine, pour trouver une hausse là où je vois tous les jours une baisse. Et j'aimerais bien savoir avec précision quelle méthode il utilise pour aboutir à son résultat positif, quelles équations, quelles péréquations, quelles corrections de trajectoire, quelles opérations chimiques.
Le problème, entre lui et moi, c'est que je n'ai pas l'expérience concrète de la moyenne qui lui sert de boussole. Ma singularité n'a rien à voir avec sa "moyenne". Dans ses chiffres, je figure quelque part sous forme d'"écart" ou de "variable". Raison pour laquelle j'ai forcément tort à l'arrivée. La grille de lecture dont se sert le statisticien est un "lit de Procuste", vous savez, ce bandit de l'antiquité qui coupait ou étirait les jambes de ses victimes pour adapter leurs mesures à celles de son lit. Le statisticien m'allonge ou me raccourcit à son gré. Et ce n'est pas agréable. Il n'est, tout simplement, pas acceptable, quand les gens ordinaires exposent leurs problèmes de fin de mois, qu'ils s'entendent rétorquer qu'ils ont tort parce que la statistique. Je ne rappellerai que pour mémoire le mot de Churchill : « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même trafiquées ».
Le "ressenti" est la vérité de "la France d'en bas", la statistique est la vérité de "la France d'en haut". C'est cela qui les rend irréconciliables par principe. C'est comme ça que s'impose le mensonge qui fait mal à la démocratie.
C'est aussi cela que signifie le gilet jaune : quoi qu'en disent les savants-de-chiffres, les statistiques sont l'illustration parfaite du mensonge d'en haut. Le statisticien n'est rien d'autre qu'un bonimenteur. J'exagère, mais je le fais exprès.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : statistiques, insee, chiffres du chômage, pouvoir d'achat, niveau de vie, churchill, lit de procuste, crise grecque, institut national de la statistique et des études économiques, gilets jaunes, france d'en heut, france d'en bas, france culture, brice couturier
samedi, 15 décembre 2018
CE QUE ME DIT LE GILET JAUNE
Je prie le lecteur éventuel de m'excuser : je republie ce billet quelques jours après. Je sais : ça ne se fait pas. Mais il se trouve qu'entre-temps j'ai procédé à des ajouts conséquents. Je me suis demandé s'il ne faudrait pas le répartir sur deux jours, parce que ça commence à faire un peu long (2508 mots), mais bon, c'est au lecteur éventuel de voir et de dire. Je me suis efforcé de faire apparaître les additions en bleu, mais étant revenu souvent pour corriger, enlever ou ajouter, je n'ai plus une idée très nette de l'état originel de ce texte, n'en ayant pas conservé le "princeps". Il est donc probable que j'en ai oublié. Bon, est-ce que c'est grave, docteur ?
Journalistes, commentateurs professionnels, intellos, voire politiciens, tout le monde pense quelque chose du mouvement des gilets jaunes. Et que ça te dissèque l'événement, et que ça te décortique ses significations multicouches et que ça te propose des analyses plus pertinentes les unes que les autres. Au point qu'on ne sait plus où donner de la cervelle pour enregistrer le Niagara des propos.
En face, je veux dire dans la citadelle tenue par les troupes de choc du "team manager" de la "start-up nation" Emmanuel Macron, on est tétanisé, on pète de trouille et on ne sait plus quoi faire. Entre parenthèses, il y en a un qui doit se sentir soulagé d'avoir quitté le rafiot et de ne pas avoir à gérer la situation – je veux dire à manier le baril de poudre –, c'est notre merdelyon Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur. Et il y a un Raminagrobis qui est en train de ronronner près du poêle en s'affûtant tranquillement les griffes dans l'attente des élections européennes : le "Rassemblement National".
Comme tout le monde, j'ai évidemment ma petite idée sur la question. Dans la bouche des "gilets jaunes", pour dire vrai, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'ai même entendu tout et son contraire. J'ai même entendu l'un d'eux parler de "complot sioniste" (je crois que c'était un "fesse-bouc live"). Autant dire n'importe quoi, et mieux vaut ne pas se demander de quelle matière est faite la cervelle de l'auteur de la formule.
J'ai aussi lu de très savantes analyses du phénomène, où les auteurs y vont allègrement avec le "name dropping", où l'on retrouve toutes sortes de penseurs, théoriciens ou philosophes, et toutes sortes de "grilles de lecture". Je ne me hasarderai pas à de telles altitudes : je suis un citoyen parmi d'autres, et je resterai à hauteur d'homme ordinaire. Je veux juste dire ici ce que je crois qu'il faut retenir.
Je passe sur les appels à "Macron démission" et autres slogans comminatoires. Ce qui s'est passé, selon moi, est la réaction normale de toute une population à l'application féroce du programme voulu et déjà mis en oeuvre par Macron. Que veut ce monsieur ? Je crois qu'il veut que la France reste dans le peloton de tête des nations du monde, et c'est tout à son honneur, du moins apparemment. Mais à quel prix ? Mais dans quel monde ? Mais avec quelle méthode ? C'est là que ça coince salement. Monsieur Macron semble ne connaître qu'une "mondialisation heureuse". Quant à la méthode, rien d'autre que la cravache.
Or Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées que Macron a poussé à la démission en clamant en public : « C'est moi le chef ! », et qui vient de publier Qu'est-ce qu'un Chef ?, vient de déclarer (France Culture, bien sûr) qu'un chef, ça commence par concevoir (le but, la stratégie, la tactique, ...), puis il prend des décisions (il donne des ordres), mais ensuite, il a pour obligation de convaincre « les yeux dans les yeux » ses subordonnés. Car quand il dira « En avant ! », il faut que ça suive derrière. Et cela n'est possible que s'il a su inspirer confiance à toute sa "chaîne de commandement". Et pour cela, dit-il, « il faut aussi aimer les gens qu'on commande ». De Villiers aurait voulu donner un coup de poing dans la figure à quelqu'un (suivez mon regard), il ne s'y serait pas pris autrement : coup pour coup.
33'38"
A cet égard, on peut dire que monsieur Macron n'est pas un chef. Il ne suffit pas d'avoir le menton : encore faut-il avoir les épaules, la rigueur morale et le savoir-faire.
La stature "jupitérienne" et "verticale" qu'il a prétendu se donner suffisait, pensait-il, à le revêtir de l'autorité nécessaire pour tout faire passer, avec passage en force si nécessaire. Après le "petit caporal" (Sarkozy) et le sous-chef de bureau (Hollande), les Français ont élu Peter Pan, l'enfant-roi qui prend ses désirs pour des réalités. Sarkozy y allait au bulldozer (carte judiciaire de la France, RGPP, fusion des RG et de la DST, intervention en Libye, ...). Hollande, incarnation parfaite de l'indécision et de l'appel désespéré à la "synthèse", entre autres babioles que ses thuriféraires tiennent mordicus à porter à son crédit, aura attaché son nom à une réforme scandaleuse qui a déclenché une guerre civile "de basse intensité" : l'instauration du mariage homosexuel.
Macron, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est tout à fait clair, il l'a dit en 2015 à un journaliste (je ne sais plus si c'est Jean-Dominique Merchet ou Marc Endeweld, invités mercredi 5 décembre sur France Culture dans un numéro passionnant de l'émission Du grain à moudre d'Hervé Gardette, série "colère jaune") : « Je veux en finir avec le modèle social français ». Pourquoi ? La réponse est évidente : le modèle social français, c'est plein de sacs de sable dans les rouages de l'économie ultralibérale.
Pour Macron, le sable, ici, est haïssable, juste bon pour faire du béton ou pour se dorer le cuir : il faut mettre de l'huile, ce qui veut dire déréglementer à tout va, pour "libérer les énergies". En français : lâcher la bride à la "libre entreprise" pour qu'elle puisse courir grand train. Le Graal d'Emmanuel Macron, ressemble à un paradis, mais c'est un Eden réservé au plein épanouissement entrepreneurial. La grande affaire, c'est d'adapter la France au monde tel qu'il est, c'est-à-dire à la concurrence généralisée, à la compétition sans limite. Traduction : entrer dans la guerre de tous contre tous, et dans la vente aux enchères inversées de la force de travail, où c'est celui qui demande le salaire le plus bas qui emporte le désormais exorbitant droit de travailler, et d'être un peu (à peine) rémunéré pour cela, le critère étant le salaire minimum garanti au Bangla-Desh, les travailleurs du monde entier étant appelés à admettre cette nouvelle réalité des rapports sociaux – je veux dire : à se serrer toujours plus la ceinture. Car la France d'Emmanuel Macron (je veux dire l'image qu'il s'en fait dans sa trop grosse tête), c'est une machine efficace, productive, compétitive, concurrentielle et (surtout) rentable. Vive le Bangla-Desh libre !
Ce qui va avec, c'est, par exemple, tout le modèle anglo-saxon des relations sociales : primauté absolue de l'individu (Thatcher disait qu'elle ne savait pas ce qu'est une société : elle ne voyait que des "collections d'individus"), et remplacement sauvage de la Loi, surplombante et à laquelle tout le monde sans distinction est contraint de se soumettre (cf. les travaux d'Alain Supiot, moi j'appelle ça une arme contre les injustices et les inégalités) par le Contrat, ce mode de relation entre les gens où peut enfin s'épanouir pleinement ce que préfèrent en général les puissants : le rapport de forces. Les corollaires de ce modèle sont inéluctables : 1 - une forme inquiétante de darwinisme social, où ne survivent que les plus costauds ou les plus malins ; 2 - la montée exponentielle des inégalités au sein des sociétés.
Qui manifeste ? On commence à en avoir une idée. Beaucoup de gens n'avaient jamais fait entendre leur voix dans la rue, ne s'étaient jamais exprimés en public. C'en est au point que je me demande si ce n'est pas ça que les journalistes ont l'habitude de désigner sous l'expression générique "MAJORITÉ SILENCIEUSE" : des gens "sans voix" qui se font entendre, aucune théorie ne l'a prévu ou théorisé. Il faudrait aussi leur demander s'ils votent régulièrement aux élections, car je me demande aussi si on ne trouve pas dans leurs rangs beaucoup d'abstentionnistes. Je me demande si, parmi les gilets jaunes qui occupent les ronds-points et les péages, on ne trouve pas bon nombre de ceux qui ont renoncé à s'exprimer par la voie des urnes, parce qu'ils ont le sentiment que, de toute façon, c'est plié d'avance et que ça ne sert à rien. Je crois qu'ils ont raison : les types au pouvoir, aujourd'hui, ils sont tous pareils.
Dans le fond, ce qui se passe aujourd'hui nous rappelle que Macron a été porté au pouvoir par l'immense espoir d'un authentique changement dans la façon de faire de la politique et de diriger le pays. Ce qui se passe aujourd'hui traduit, je crois, le sentiment des Français de s'être une fois de plus fait rouler dans la farine : rien n'a changé dans les mœurs politiques françaises. Et cela signifie que Macron est un encore plus gros menteur que Chirac, Sarkozy, Hollande et compagnie. Et qu'il n'est certainement pas un "meneur d'hommes".
Un des aspects les plus étonnants selon moi du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'on entend monter un puissant chant des profondeurs : nous voulons plus de justice sociale. Mais attention, pas de ces petites inégalités catégorielles et sociétales dénoncées par ce qu'il est convenu d'appeler des minorités tatillonnes et punitives (femmes, homosexuels, juifs, noirs, arabes, musulmans, ...), mais la grande injustice économique que constitue la confiscation des richesses par une minorité de rapaces insatiables, au détriment de l'énorme majorité des citoyens ordinaires. C'est l'économiste de l'OFCE Mathieu Plane qui parle d' « affaissement généralisé du niveau de vie » (je ne sais plus quel jour récent autour de 13h10 sur l'antenne de France Culture) : je peux dire que je le sais par expérience.
Quand j'entends des intellos estampillés, des journalistes institutionnels (tiens, au hasard, Christine Ockrent, que j'ai récemment entendue parler dans le poste) ou des irresponsables politiques appeler les gilets jaunes à la concertation et au débat, quand j'entends Daniel Cohn-Bendit les inciter à présenter des candidats aux élections européennes à venir, je reste confondu de stupéfaction : ces gens-là n'ont strictement rien compris à l'événement qui leur pète à la figure, et ils n'ont aucune idée de la réalité de l'existence quotidienne du commun des mortels. Je suis frappé par ce refrain obstiné du mouvement, qui réclame davantage de justice sociale.
Les revendications hétéroclites, les manifestants qui refusent d'avoir des représentants, tout cela a une signification : ce qui se manifeste avec brutalité sous l’œil gourmand des médias, ce n'est pas une catégorie bien définie, c'est tout simplement LA SOCIÉTÉ. Qui n'en peut plus. Les Français d'en haut peuvent bien parler du "vivre ensemble", de "refaire société" ou de "retisser l'unité nationale" (Edouard Philippe, hier), ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifient les mots qu'ils prononcent. Ils ne savent pas ce que c'est, une "société" : ils ont les moyens d'acheter les services dont ils ont besoin. Ils parlent de "solidarité", mais dans leur tête, c'est bon pour les autres. Ils ont fait sécession, comme le disait Christopher Lasch dès 1994 dans La Révolte des élites. Et comme l'écrivait à peu près à la même époque Le Monde diplomatique : "Les riches n'ont plus besoin des pauvres".
Une des idées à peu près sensées qui me soit parvenue, c'est sous la plume d'Alain Bertho, anthropologue (mais je ne lui en veux pas) : si des gens ordinaires, "intégrés" et sans casier judiciaire sont venus en découdre avec l'ordre établi (avec la correctionnelle sur la ligne d'arrivée), ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer, c'est qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs.
Il n'y a personne en haut lieu, quelles que soient toutes les déclarations la main sur le cœur, pour consentir à leur parler vraiment, à les prendre en compte, à tenir compte dans la réalité et très concrètement de leurs problèmes, à prendre des décisions qui leur rendent la vie moins difficile. Les gilets jaunes ont parfaitement compris qu'ils n'ont plus personne en face à qui parler. Ce qu'il faut, ce n'est certainement pas un "Grenelle" de plus. Non, pas de discussion, pas de concertation, pas de négociation, pas de dialogue, pas de "conférence sociale". Rien de tout ça. Les gilets jaunes n'ont aucun programme, aucune ambition politique, aucune proposition, et pour une raison simple : ils subissent, ils ont de plus en plus de mal à "joindre les deux bouts", et ils en ont assez. Il y a peut-être une revendication commune, et une seule, c'est de ne plus avoir autant de mal à finir le mois. C'est juste ça qu'ils disent. La demande serait au moins à prendre en considération, non ?
Il y a peut-être aussi un appel aux responsables politiques (les responsables économiques sont définitivement inatteignables en l'absence de lois et règlements capables de limiter leur pouvoir) pour qu'ils prennent enfin les moyens d'être moins impuissants à agir sur le réel, dans le dur de la vie concrète des gens. Quand on est chargé de faire la loi, il s'agit de se donner les moyens de la faire appliquer envers et contre tout. Je ne suis pas sûr que la majorité parlementaire actuelle en ait la volonté (je crois même que c'est le contraire, à voir sa composition sociologique). Et je me dis que, même si elle en avait la volonté, elle serait épouvantablement entravée pour faire passer celle-ci de la virtualité conceptuelle dans la réalité sonnante et trébuchante.
Ce qu'il faudrait faire ? Tous les gens en "haut-lieu" le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : poser des limites à la voracité des puissants, corriger les inégalités en redistribuant plus équitablement les richesses produites et instaurer un système économique favorisant la justice sociale. Comment ? Les irresponsables le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : imposer des règlements à la finance et aux échanges économiques, et puis revenir à l'authentique impôt progressif, celui où tout le monde contribue au budget de l'Etat, en fonction de ses moyens. Plus je possède, plus je suis redevable. J'entendais Cohn-Bendit dire que, dans les années 1920, Ford concevait une échelle des revenus allant grosso modo de 1 à 7, et il semblait scandalisé (mais sans en tirer les conséquences) qu'elle s'étende aujourd'hui de 1 à 3000. Ce fait ahurissant devrait paraître totalement inadmissible aux yeux des gens raisonnables.
Le surgissement des gilets jaunes dans le paysage n'a selon moi pas grand-chose de politique : son origine se situe dans la mécanique qui produit l'appauvrissement du plus grand nombre. Les gens ordinaires n'en peuvent plus de sentir le nœud coulant se resserrer sur leur cou. Les difficultés rencontrées au quotidien par les gens ordinaires pour mener une vie normale ont une cause principale qui surpasse toutes les autres : les conditions concrètes faites à la grande majorité par le char d'assaut ultralibéral. C'est la mécanique implacable du système économique à la sauce ultralibérale qui a produit le gilet jaune.
La seule chose qui serait en mesure de calmer amertume et colère face aux difficultés croissantes de la vie quotidienne, ce serait qu'il annonce un vaste programme de redistribution des richesses qui soit plus juste. Mais c'est ce dont il ne veut à aucun prix.
Emmanuel Macron n'a plus rien à dire aux gens ordinaires.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une fois faite cette analyse, reste une question : comment on fait pour changer le système ? Et là, c'est loin d'être gagné.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalistes, politique, france, gilets jaunes, emmanuel macron, gérard collomb, ministère de l'intérieur, macron démission, nicolas sarkozy, françois hollande, macron peter pan, macron l'enfant-roi, carte judiciaire de la france, rgpp, renseignements généraux, dst, dgsi, mariage homosexuel, france culture, du grain à moudre, hervé gardette, jean-dominique merchet, marc endeweld, économie ultralibérale, margaret thatcher, alain supiot, la gouvernance par les nombres, justice sociale, darwinisme social, christine ockrent, daniel cohn-bendit, christopher lasch, la révolte des élites, journal le monde, le monde diplomatique, alain bertho, impôt progressif, ford, team manager, start up nation
vendredi, 14 décembre 2018
LE REVOLVER DE CHERIF CHEKATT
L'attentat de Strasbourg est une belle saloperie offerte par l'islamisme à la France, mais je me suis quand même demandé s'il fallait vraiment distinguer islam et islamisme : pour moi, il faut être aveugle pour ne pas voir que tous les islams – du plus pacifique au plus haineux – sont par nature dans l'islam, et sont donc inséparables les uns des autres : ici, le pluriel et le singulier se confondent, n'en déplaise aux tolérantistes.
Cherif Chekatt a été abattu (les flics ne sont pas des pipes en plâtre dans un stand de tir forain). On peut regretter qu'il ne soit plus en vie (bien "cuisiné", il aurait pu dire le pourquoi du comment). Mais ce qui est certain, c'est que, pour la revendication tardive de l'attentat par Daech, il y a du mou dans la corde à nœuds. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand j'écoute les informations, je ne les vois pas, mais je les entends.
Et à ce propos, j'ai entendu trois choses qui sont trois vraies informations : 1 - l'arme de Cherif Chekatt datait de 1892 ; 2 - elle est de calibre 8 mm. ; 3 - les victimes ont été atteintes pour l'essentiel par des "tirs à bout touchant". En croisant ces trois éléments, j'arrive à la conclusion (je ne suis pas un spécialiste, mais il m'est arrivé de réfléchir à la question) que l'arme utilisée par le "terroriste" est un vulgaire revolver d'ordonnance "modèle 1892" (toujours classé, si je me souviens bien, comme arme de guerre – avec quelque raison, comme on peut le voir dans le cas présent).

Car si cette arme n'est certes pas une "pétoire", elle y ressemble diablement aujourd'hui, vu ses performances balistiques (un journal parle de "puissance de tir", mais est-ce la même chose ?), d'une affligeante médiocrité, selon les spécialistes (surtout si le gars ne s'est pas entraîné suffisamment). La munition, en particulier, ne supporte pas la comparaison avec les cartouches 9 mm. du P08 Luger ou les 7,63 mm du C96 Mauser.
Je conclus de tout ça que, si Cherif Chekatt était un "soldat" de l'organisation terroriste Daech, ça voudrait dire que celle-ci n'a plus les moyens d'armer convenablement ses activistes. Je ne sais pas comment Cherif Chekatt a pu dégoter ce tromblon, mais visiblement, il la jouait "petit bras", et ses chances de survie étaient minces. Il a fait du dégât, c'est certain, et je pense aux victimes, mais après une attaque aussi rudimentaire et (apparemment) mal préparée, l'homme ordinaire peut se dire, peut-être, que le pire n'est pas forcément à venir. Et que, après tout, les services de l'Etat ne fonctionnent pas si mal.
Note ajoutée le 17 décembre : il semblerait que ce billet soit dans le vrai à 100%, si j'en crois les informations fournies par de grands organes de presse depuis l'événement. Les meilleurs connaisseurs de ces questions d'armurerie ne comprennent pas par quelle aberration ...
13:30 Publié dans DANS LES JOURNAUX, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : attentat de strasbourg, cherif chekatt, daech, terrorisme, revolver modèle 1892, tir à bout touchant, armes, islam, strasbourg
lundi, 10 décembre 2018
CE QUE ME DIT LE GILET JAUNE !
Journalistes, commentateurs professionnels, intellos, voire politiciens, tout le monde pense quelque chose du mouvement des gilets jaunes. Et que ça te dissèque l'événement, et que ça te décortique ses significations multicouches et que ça te propose des analyses plus pertinentes les unes que les autres. Au point qu'on ne sait plus où donner de la cervelle pour enregistrer le Niagara des propos.
En face, je veux dire dans la citadelle tenue par les troupes de choc du "team manager" de la "start-up nation" Emmanuel Macron, on est tétanisé, on pète de trouille et on ne sait plus quoi faire. Entre parenthèses, il y en a un qui doit se sentir soulagé d'avoir quitté le rafiot et de ne pas avoir à gérer la situation – je veux dire à manier le baril de poudre –, c'est notre merdelyon Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur.
Comme tout le monde, j'ai évidemment ma petite idée sur la question. Dans la bouche des "gilets jaunes", pour dire vrai, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'ai même entendu tout et son contraire. J'ai même entendu l'un d'eux parler de "complot sioniste" (je crois que c'était un "fesse-bouc live"). Autant dire n'importe quoi, et mieux vaut ne pas se demander de quelle matière est faite la cervelle de l'auteur de la formule.
J'ai aussi lu de très savantes analyses du phénomène, où les auteurs y vont allègrement avec le "name dropping", où l'on retrouve toutes sortes de penseurs, théoriciens ou philosophes, et toutes sortes de "grilles de lecture". Je ne me hasarderai pas à de telles altitudes : je suis un citoyen parmi d'autres, et je resterai à hauteur d'homme ordinaire. Je veux juste dire ici ce que je crois qu'il faut retenir.
Je passe sur les appels à "Macron démission" et autres slogans comminatoires. Ce qui s'est passé, selon moi, est la réaction normale de toute une population à l'application féroce du programme voulu et déjà mis en oeuvre par Macron. Que veut ce monsieur ? Je crois qu'il veut que la France reste dans le peloton de tête des nations du monde, et c'est tout à son honneur, du moins apparemment. Mais à quel prix ? Mais dans quel monde ? Mais avec quelle méthode ? C'est là que ça coince salement. Monsieur Macron semble ne connaître qu'une "mondialisation heureuse". Quant à la méthode, rien d'autre que la cravache.
Or Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées qui vient de publier Qu'est-ce qu'un Chef ?, vient de déclarer (France Culture, bien sûr) qu'un chef, ça commence par concevoir (le but, la stratégie, la tactique, ...), puis il prend des décisions (il donne des ordres), mais ensuite, il a pour obligation de convaincre « les yeux dans les yeux » ses subordonnés. Car quand il dira « En avant ! », il faut que ça suive derrière. Et cela n'est possible que s'il a su inspirer confiance à toute sa "chaîne de commandement".
33'38"
A cet égard, on peut dire que monsieur Macron n'est pas un chef. Il ne suffit pas d'avoir le menton : encore faut-il avoir les épaules et le savoir-faire.
La stature "jupitérienne" et "verticale" qu'il a prétendu se donner suffisait, pensait-il, à le revêtir de l'autorité nécessaire pour tout faire passer, avec passage en force si nécessaire. Après le "petit caporal" (Sarkozy) et le sous-chef de bureau (Hollande), les Français ont élu Peter Pan, l'enfant-roi qui prend ses désirs pour des réalités. Sarkozy y allait au bulldozer (carte judiciaire de la France, RGPP, fusion des RG et de la DST, intervention en Libye, ...). Hollande, incarnation parfaite de l'indécision et de l'appel désespéré à la "synthèse", entre autres babioles que ses thuriféraires tiennent mordicus à porter à son crédit, aura attaché son nom à une réforme scandaleuse qui a déclenché une guerre civile "de basse intensité" : l'instauration du mariage homosexuel.
Macron, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est tout à fait clair, il l'a dit en 2015 à un journaliste (je ne sais plus si c'est à Jean-Dominique Merchet ou à Marc Endeweld, invités mercredi 5 décembre sur France Culture dans un numéro passionnant de l'émission Du grain à moudre d'Hervé Gardette, série "colère jaune") : « Je veux en finir avec le modèle social français ». Pourquoi ? La réponse est évidente : le modèle social français, c'est plein de sacs de sable dans les rouages de l'économie ultralibérale.
Pour Macron, le sable, ici, est haïssable, juste bon pour faire du béton ou pour se dorer le cuir : il faut mettre de l'huile, ce qui veut dire déréglementer à tout va, pour "libérer les énergies". En français : lâcher la bride à la "libre entreprise" pour qu'elle puisse courir grand train. La grande affaire, c'est d'adapter la France au monde tel qu'il est, c'est-à-dire à la concurrence généralisée, à la compétition sans limite. Traduction : entrer dans la guerre de tous contre tous, et dans la vente aux enchères inversées de la force de travail, où c'est celui qui demande le salaire le plus bas qui emporte le droit de travailler. Car la France d'Emmanuel Macron (je veux dire l'image qu'il s'en fait dans sa trop grosse tête), c'est une machine efficace, productive, compétitive, concurrentielle et (surtout) rentable.
Ce qui va avec, c'est, par exemple, tout le modèle anglo-saxon des relations sociales : primauté absolue de l'individu (Thatcher disait qu'elle ne savait pas ce qu'est une société : elle ne voyait que des "collections d'individus"), et remplacement sauvage de la Loi, surplombante et à laquelle tout le monde sans distinction est contraint de se soumettre (cf. les travaux d'Alain Supiot, moi j'appelle ça une arme contre les injustices et les inégalités) par le Contrat, ce mode de relation entre les gens où peut enfin s'épanouir pleinement ce que préfèrent en général les puissants : le rapport de forces. Les corollaires de ce modèle sont inéluctables : 1 - une forme inquiétante de darwinisme social, où ne survivent que les plus costauds ou les plus malins ; 2 - la montée exponentielle des inégalités au sein des sociétés.
Qui manifeste ? On commence à en avoir une idée. Beaucoup de gens n'avaient jamais fait entendre leur voix dans la rue, ne s'étaient jamais exprimées en public. C'en est au point que je me demande si ce n'est pas ça que les journalistes ont l'habitude de désigner sous l'expression générique "Majorité silencieuse". Il faudrait aussi leur demander s'ils votent régulièrement aux élections, car je me demande aussi si on ne trouve pas dans leurs rangs beaucoup d'abstentionnistes.
Un des aspects les plus étonnants selon moi du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'on entend monter un puissant chant des profondeurs : nous voulons plus de justice sociale. Mais attention, pas de ces petites inégalités catégorielles et sociétales dénoncées par ce qu'il est convenu d'appeler des minorités tatillonnes et punitives (femmes, homosexuels, juifs, noirs, arabes, musulmans, ...), mais la grande injustice économique que constitue la confiscation des richesses par une minorité de rapaces insatiables, au détriment de l'énorme majorité des citoyens ordinaires. C'est l'économiste de l'OFCE Mathieu Plane qui parle d' « affaissement généralisé du niveau de vie » (je ne sais plus quel jour autour de 13h10 sur l'antenne de France Culture) : je peux dire que je le sais par expérience.
Quand j'entends des intellos estampillés, des journalistes institutionnels (tiens, au hasard, Christine Ockrent, que j'ai récemment entendue parler dans le poste) ou des irresponsables politiques appeler les gilets jaunes à la concertation et au débat, quand j'entends Daniel Cohn-Bendit les inciter à présenter des candidats aux élections européennes à venir, je reste confondu de stupéfaction : ces gens-là n'ont strictement rien compris à l'événement qui leur pète à la figure, et ils n'ont aucune idée de la réalité de l'existence quotidienne du commun des mortels. Je suis frappé par ce refrain obstiné du mouvement, qui réclame davantage de justice sociale.
Les revendications hétéroclites, les manifestants qui refusent d'avoir des représentants, tout cela a une signification : ce qui se manifeste avec brutalité sous l’œil gourmand des médias, ce n'est pas une catégorie bien définie, c'est tout simplement LA SOCIÉTÉ. Qui n'en peut plus. Les Français d'en haut peuvent bien parler du "vivre ensemble", de "refaire société" ou de "retisser l'unité nationale" (Edouard Philippe, hier), ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifient les mots qu'ils prononcent. Ils ne savent pas ce que c'est, une "société" : ils ont les moyens d'acheter les services dont ils ont besoin. Ils parlent de "solidarité", mais dans leur tête, c'est bon pour les autres. Ils ont fait sécession, comme le disait Christopher Lasch dès 1994 dans La Révolte des élites. Et comme l'écrivait à peu près à la même époque Le Monde diplomatique : "Les riches n'ont plus besoin des pauvres".
Une des idées à peu près sensées qui me soit parvenue, c'est sous la plume d'Alain Bertho, anthropologue (mais je ne lui en veux pas) : si des gens ordinaires, "intégrés" et sans casier judiciaire sont venus en découdre avec l'ordre établi (avec la correctionnelle sur la ligne d'arrivée), ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer, c'est qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs.
Il n'y a personne en haut lieu, quelles que soient toutes les déclarations la main sur le cœur, pour consentir à leur parler vraiment, à les prendre en compte, à tenir compte dans la réalité et très concrètement de leurs problèmes, à prendre des décisions qui leur rendent la vie moins difficile. Les gilets jaunes ont parfaitement compris qu'ils n'ont plus personne en face à qui parler. Ce qu'il faut, ce n'est certainement pas un "Grenelle" de plus. Non, pas de discussion, pas de concertation, pas de négociation, pas de dialogue, pas de "conférence sociale". Rien de tout ça. Les gilets jaunes n'ont aucun programme, aucune ambition politique, aucune proposition, et pour une raison simple : ils subissent, ils ont de plus en plus de mal à "joindre les deux bouts", et ils en ont assez. Il y a peut-être une revendication commune, et une seule, c'est de ne plus avoir autant de mal à finir le mois. C'est juste ça qu'ils disent.
Ce qu'il faudrait faire ? Tous les gens du "haut-lieu" le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : poser des limites à la voracité des puissants, corriger les inégalités en redistribuant plus équitablement les richesses produites et instaurer un système économique favorisant la justice sociale. Comment ? Les irresponsables le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : imposer des règlements à la finance et aux échanges économiques, et puis revenir à l'authentique impôt progressif, celui où tout le monde contribue au budget de l'Etat, en fonction de ses moyens. Plus je possède, plus je suis redevable. J'entendais Cohn-Bendit dire que, dans les années 1920, Ford concevait une échelle des revenus allant grosso modo de 1 à 7, et il semblait scandalisé (mais sans en tirer les conséquences) qu'elle s'étende aujourd'hui de 1 à 3000. Ce fait ahurissant devrait paraître totalement inadmissible aux yeux des gens raisonnables.
Le surgissement des gilets jaunes dans le paysage n'a selon moi pas grand-chose de politique : son origine se situe dans la mécanique qui produit l'appauvrissement du plus grand nombre. Les gens ordinaires n'en peuvent plus de sentir le nœud coulant se resserrer sur leur cou. Les difficultés rencontrées au quotidien par les gens ordinaires pour mener une vie normale ont une cause principale qui surpasse toutes les autres : les conditions concrètes faites à la grande majorité par le char d'assaut ultralibéral.
La seule chose qui serait en mesure de calmer amertume et colère face aux difficultés croissantes de la vie quotidienne, ce serait qu'il annonce un vaste programme de redistribution des richesses qui soit plus juste. Mais c'est ce dont il ne veut à aucun prix.
Emmanuel Macron n'a plus rien à dire aux gens ordinaires.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une fois faite cette analyse, reste une question : comment on fait ? Et là, c'est loin d'être gagné.
Ajouté le 11 décembre : et ce n'est pas le propos tenu hier soir par le président qui va me faire changer d'avis.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : journalistes, politique, france, gilets jaunes, emmanuel macron, gérard collomb, ministère de l'intérieur, macron démission, nicolas sarkozy, françois hollande, macron peter pan, macron l'enfant-roi, carte judiciaire de la france, rgpp, renseignements généraux, dst, dgsi, mariage homosexuel, france culture, du grain à moudre, hervé gardette, laurent cappelletti, jean-françois amadieu, économie ultralibérale, margaret thatcher, alain supiot, la gouvernance par les nombres, justice sociale, darwinisme social, christine ockrent, daniel cohn-bendit, christopher lasch, la révolte des élites, journal le monde, le monde diplomatique, alain bertho, impôt progressif, ford
mardi, 04 décembre 2018
LA TRISTESSE AU MUR DU CIMETIÈRE
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie
vendredi, 30 novembre 2018
QUELQU'UN
29 Novembre 2018

6 août 2010 (87 ans)
Je suspends quelque temps l'activité de ce blog.
09:02 | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 25 novembre 2018
UNE MUSIQUE, DEUX CHANSONS
Le style est différent, le "message" est différent, mais la musique de l'une de ces chansons semble être inspirée de l'autre – à moins que les deux aient repris un "traditionnel". Disons qu'il y a au moins de drôles de ressemblances dans la mélodie, ainsi dans les strophes de quatre octosyllabes. A part que la guitare de Neil Young en rajoute dans le saturé (il nous en met plein les oreilles), et le chanteur dans la grimace. Bizarre dans une chanson pleine de bons sentiments, et dédiée à la Terre-Mère et au respect de la nature.
Neil Young
"Oh mother earth"
Oh, Mother Earth, with your fields of green
Once more laid down by the hungry hand
How long can you give and not receive
And feed this world ruled by greed
And feed this world ruled by greed.
Oh, ball of fire in the summer sky
Your healing light, your parade of days
Are they betrayed by the men of power
Who hold this world in their changing hands
They hold the world in their changing hands.
Oh, freedom land Can you let this go
Down to the streets where the numbers grow
Respect Mother Earth and her healing ways
Or trade away our children's days
Or trade away our children's days.
Respect Mother Earth and her healing ways
Or trade away our children's days.
***
Ici, le chanteur ressemble à ce qu'il chante : un peu déglingué, comme la ville dont il parle ("Saleté de cité !"). Mais les Pogues sont autre chose qu'un "groupe ordinaire" : il y a un drôle de vieux à la guitare, et puis ça sait s'amuser, comme le montre la vidéo. Et je ne parle pas de l'enthousiasme du public, qui connaît la chanson (d'une belle couleur bien glauque) par cœur et ne se gêne pas pour "accompagner" le groupe à sa façon.
The Pogues
"Dirty old town"
Dreamed a dream by the old canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old town Dirty old town
Cats are prowling on their beat
Spring's a girl from the streets at night
Dirty old town Dirty old town
Saw a train set the night on fire
I smelled the spring on the smoky wind
Dirty old town Dirty old town
Shining steel tempered in the fire
I'll chop you down like an old dead tree
Dirty old town Dirty old town
Dreamed a dream by the old canal
I kissed my girl by the factory wall
Dirty old town Dirty old town
Dirty old town
09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, the pogues, neil young, oh mother earth, dirty old town, shane mcgowan
jeudi, 22 novembre 2018
LES BEAUTÉS CACHÉES ...
... DU CAPITALISME.
Ou : "QUAND L'ACTIONNAIRE GOUVERNE LE MONDE".
Dans la série : "Des nouvelles de l'état du monde" (n°69).

On a tout dit de Donald Trump, Docteur Folamour du capitalisme américain, éléphant dans le magasin de porcelaine de la géopolitique mondiale. Je ne vais donc pas l'invectiver, d'abord parce qu'il adore ça et que ça le fait rire, que ça le renforce et que ça confirme ses électeurs dans leur choix ("si on nous attaque, c'est qu'on nous en veut de réussir, ça veut dire qu'on a raison contre tout le monde"), ensuite et par conséquent que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je préfère me contenter d'évoquer la réforme fiscale qu'il a mise en place depuis son arrivée spectaculaire au pouvoir.
Je ne suis pas fiscaliste, je ne peux que m'informer de choses et d'autres, et de temps en temps par la lecture du journal Le Monde, (eh oui, je sais, je ne devrais pas, mais c'est entre plusieurs autres sources, car je m'efforce de "recouper"). Et je suis tombé dernièrement sur une "chronique" lumineuse à force de pédagogie et de clarté. Une chronique signée Stéphane Lauer, dans le numéro daté du 20 novembre. Je savais déjà un peu tout ça, mais là, j'ai vraiment eu l'impression de comprendre ce qui se passe dans le panier de crabes de la nouvelle économie, je veux dire celle qui fait de la satisfaction de l'actionnaire une priorité quasi-totalitaire. J'avais déjà évoqué cette "beauté cachée" du capitalisme actuel le 20 mai de cette année ("L'actionnaire gouverne le monde", à lire ici, où l'on verra qu'il est déjà question de Carlos Ghosn).
Alors la réforme fiscale de l'Oncle Picsou américain (bien réel, hélas : pique-sous, et il ne se trompe pas de poche, il aime seulement les plus que riches) ? Très simple : vous diminuez les impôts. Mais attention, vous ne la jouez pas "petits bras", vous n'y allez pas à la petite cuillère : au char d'assaut. On ne fait pas dans l'étriqué : le programme, c'est une réduction de 1.500 milliards de dollars sur 10 ans. Autant de moins dans le sac du budget de l'Etat américain. J'avoue que j'ai du mal avec les grands nombres, mais ça m'impressionne quand même.
Bon, c'est vrai, ce n'est pas complètement irrationnel dans le principe, et l'intention peut sembler louable. Mais c'est aussi très hypothétique, car ça revient à placer son espoir de réussite dans les bonnes intentions de tout un tas d'acteurs économiques, puisqu'on attend d'eux qu'ils développent l'investissement, qu'ils augmentent les salaires et qu'ils favorisent assez la croissance pour qu'à l'arrivée le budget trouve un nouvel équilibre grâce aux « recettes fiscales additionnelles », « les multinationales acceptant de rapatrier leur trésorerie sur le sol américain ». Limpide, mon cher Watson !
Mais à l'arrivée qu'est-ce qu'on trouve, en réalité ? Stéphane Lauer appelle ça un "sugar rush", injection du genre "qui-donne-un-coup-de-fouet-momentané", mais dont l'effet ne dure pas. En français, je propose de traduire par "effet d'aubaine". Car ce qui se passe, c'est que les entreprises, n'ayant pas des perspectives de rentabilité assez "attrayantes" (j'imagine qu'au-dessous de 15%, le taux de profit – "résultat net" – est jugé insuffisant), n'ont pas construit les usines attendues, modernisé leurs machines, ou embauché du monde.
Alors qu'est-ce qu'elles ont fait de cette trésorerie "améliorée" ? Je cite Stéphane Lauer : « les entreprises préfèrent utiliser leurs ressources financières pour rémunérer leurs actionnaires ». Vous avez bien lu : "rémunérer leurs actionnaires". Et comment cela se passe-t-il ? Elles rachètent en Bourse leurs propres actions et, sitôt rachetées, les détruisent (Lauer dit "annulent"), ce qui diminue évidemment leur nombre et fait automatiquement monter la valeur de chaque action restante (« le profit étant réparti sur un périmètre plus restreint » ; traduction : "le gâteau est toujours le même, mais on a éliminé pas mal de convives"). C'est de l'arithmétique. Demandez-vous pourquoi Wall Street s'est rarement aussi bien porté que depuis l'avènement de Donald Trump.
L'actionnaire, lui, en redemande. Pensez, 28% d'augmentation de ses revenus attendus cette année (1.300 milliards, selon les calculs de Goldman Sachs) : « Apple, Microsoft, Cisco, Alphabet (Google) et Oracle ont ainsi consacré 115 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions depuis le 1er janvier ». L'auteur ajoute que Bush (George W.) avait fait la même chose en 2004, avec le même résultat.
En face de l'actionnaire, il y a tous les autres (ceux qui n'ont pas, ou si peu). Selon une officine (Tax Policy Center), la classe moyenne y gagne royalement 76 dollars par mois du fait de la baisse d'impôt. Attention, c'est une moyenne. Quant au travailleur, réjouissons-nous : les entreprises ont consenti (mais sous forme de prime) à orienter vers sa poche un "pactole" correspondant à « 7% de ce qu'elles ont empoché ». Pendant ce temps, l'actionnaire, ce mal-aimé, ce malmené, a dû se contenter de 57% (cinquante-sept pour cent). Une misère ! On lui fait confiance pour clamer à l'injustice qui lui est faite : être obligé de partager ! Et avec des petits, des malpropres !
Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait, le budget de l'Etat américain ? Rassurons-nous, ne nous dit pas Stéphane Lauer : « Alors que l'économie américaine est en quasi-surchauffe, les comptes publics se dégradent à une vitesse vertigineuse ». Résultat : les USA, qui avaient emprunté 546 milliards de dollars en 2017, emprunteront en 2018 la modeste somme de 1.300 milliards. Après avoir constaté un peu plus haut que : « Une telle dérive est totalement inédite en période de prospérité », l'auteur ajoute, avec une sorte d'effarement inquiet : « Du jamais vu depuis la crise financière de 2008 ».
"Totalement inédite", "Du jamais vu"... « Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau ! », disait Baudelaire. Il est pas beau, le "monde meilleur" ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, stéphane lauer, capitalisme, donald trump, docteur folamour, oncle picsou, carlos ghosn, renault-nissan
mercredi, 21 novembre 2018
SIX AUTRES PETITES FORMES
MON ART ABSTRAIT : cinquante nuances de bistre.
(voir ici même au 18 novembre)

Ça a quelque chose de bacillaire, non ?





RECETTE IDENTIQUE
Prenez des feuilles de papier quadrillé 5x5 mm.
Munissez-vous de tubes de colle néoprène d'une marque bien connue.
Collez vos photos sur le papier.
Attendez une quarantaine d'années.
Décollez impeccablement vos photos.
Observez.
***
Est-ce de l'art ?
Pas évident.
Bon, oui, c'est vrai, le résultat est surprenant.
Et alors ?
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 18 novembre 2018
RECETTE POUR SIX PETITES FORMES
MON ART ABSTRAIT






LA RECETTE
Prenez des feuilles de papier quadrillé 5x5 mm.
Munissez-vous de tubes de colle néoprène d'une marque bien connue.
Collez vos photos sur le papier.
Attendez une quarantaine d'années.
Décollez impeccablement vos photos.
Observez.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 13 novembre 2018
8/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
MAUDITE SOIT LA GUERRE !
On fait grand cas, dans certains milieux, des monuments aux morts portant des inscriptions qualifiées d' "antimilitaristes" ou, à la rigueur, de "pacifistes". Mais quand je regarde la liste des 16.148 photos que j'ai collectées depuis quarante et quelques années, j'ai beau écarquiller les yeux, j'ai beau prendre une loupe, j'ai du mal à suivre. Il faut au moins un microscope pour en extraire quelques-unes. Quant aux monuments portant l'inscription définitive "Maudite soit la guerre !", je ne pense pas qu'il y ait besoin des doigts de deux mains pour en faire l'inventaire.
Sans prétendre les avoir tous repérés, j'en ai dénombré quatre. Sur 36.000. Vous avez bien lu : QUATRE monuments français aux morts de 14-18 déclarent publiquement leur haine de la guerre. Quatre : Cazaril-Laspènes, Equeurdreville, Gentioux (le plus renommé, avec son petit garçon tendant le poing), Saint-Martin-d'Estréaux. Si certains m'ont échappé, merci de me le signaler. A noter que l'historienne Annette Becker, qui en inventorie 3 (TROIS), omet la plaque ci-dessous (modeste, il est vrai) dans son inventaire des monuments "antimilitaristes" : une "plaque" est-elle un "monument" ? Pour répondre positivement, je me réfère à mon vieux Gaffiot (quasiment un pléonasme aujourd'hui) : « Monumentum 1. Tout ce qui rappelle qqn ou qqch, ce qui perpétue le souvenir : CIC. Cat.3, 26; Dej.40; Verr.4, 11 ; 4, 26 ; 4, 73, etc. ». Oui, une plaque est bien un monument, c'est Cicéron qui le dit..
Cazaril-Laspènes (Haute-Garonne) : autour de 75 habitants en 1914, 17 au recensement de 1991. J'ai lu quelque part que, statistiquement, les communes françaises ont perdu en moyenne 4% de leur population. Peut-on se fier à ce chiffre ? Pour la localité à l'époque, le taux monte à 8%.
Equeurdreville (Manche). 147 morts (5.765 habitants en 1911).
Gentioux (Creuse) : 63 (58, selon une autre source) noms gravés, 1109 habitants en 1911 (2,55% des vivants).

Saint-Martin-d'Estréaux (Loire). 1.648 habitants en 1911, 64 noms gravés (3,9%). Je note quand même qu'on a pris soin de faire graver une croix de guerre couronnée de lauriers.
QUATRE, en tout et pour tout, ça ne fait pas lourd de dégoût et d’écœurement, après une saignée de quatre ans. Pas assez même pour en faire des exceptions, tant c'est infinitésimal. Bon, on peut en ajouter quatre autres, où l'on trouve gravées des expressions approchantes : Avion ("Tu ne tueras point"), Château-Arnoux ("La guerre est un crime", dans le poème de Victorin Maurel), Dardilly ("Contre la guerre, à ses victimes, pour la fraternité des peuples"), Marlhes ("Non, plus jamais, jamais la guerre, Le monde a faim de paix", mais la plaque se trouve dans une église). Et puis un cinquième, connu sous le nom de "Picarde maudissant la guerre", situé à Péronne. Et puis un sixième, qu'on peut voir à Les Barthes, où je crois voir une Marianne brisant un fusil. Franchement, j'aurais préféré ne pas avoir fait le tour de la question avec cette modeste dizaine.

Avion (Pas-de-Calais). Sculpture de Emile Fernand-Dubois.
Stupeur qui désarme la déesse guerrière (une femme superbe à peine vêtue d'un pagne), saisie d'effroi en découvrant l'amas des restes humains sur le sol (des poings fermés, si j'ai bien déchiffré : je ne suis pas passé à Avion ; certains y voient des « mains crispées »).
« C’est le seul monument aux morts du Pas-de-Calais à dénoncer clairement la barbarie de la guerre. Ce geste politique n’est pas vraiment de bon ton à l’époque, et d’ailleurs l’inauguration se déroula fort modestement dans la grisaille de décembre en l’absence des autorités habituelles (représentant de l’État, de l’armée, hommes politiques). » (Commentaire piqué sur le site "Mémoires de pierre", qui parle d'un sous-préfet fort mécontent.)

Château-Arnoux (Basses-Alpes)
"Que la guerre est un crime". Victorin Maurel fut instituteur, pacifiste déclaré. Il fit de la politique, fut élu maire de la ville, qu'il s'efforça de moderniser.

Dardilly (Rhône) : « Contre la guerre. ».
Marlhes (Loire).
Péronne (Somme).
Œuvre de Paul Auban, reprise ou matrice (je ne sais pas) de L'Epave, sculpture installée dans un square à Nantes, où la mère maudit les flots qui ont rejeté sur le rivage le corps de son fils, jeune marin.
Les Barthes (Tarn-et-Garonne).
Je pense ne pas délirer : Marianne brise un fusil. Je n'ai pas vu le monument in situ.
Je ne fais pas figurer ici des monuments considérés comme pacifistes par des associations ou groupements (par exemple l'ALAMPR, association laïque des amis des monuments pacifistes du Rhône) : c'est être pacifiste à bon compte, tant c'est indirect et sous-entendu. Je ne suis pas d'accord : quand on est "anti"-guerre, il faut donner à voir aux autres un signe de la chose (pour Cabu, qui n'aimait pas du tout les militaires, ce fut l'adjudant Kronenbourg). Je crois que montrer le deuil des femmes, des enfants, des parents, des vivants est insuffisant pour mériter d'être qualifié de pacifiste. Je crois aussi qu'il ne suffit pas de graver sur le monument "Pax" (tout le monde est pour la paix, personne n'est vraiment pour la guerre) ou "La commune de X à ses enfants".
A ce compte-là, j'ai dans mes réserves des centaines de photos de tels monuments "pacifistes". Encore faut-il que l'opposition à la guerre soit exprimée explicitement. Pour les quelques œuvres que je montre ici, combien d'autres portent "A nos héros" ? Combien de "morts pour la patrie" ? Ci-dessous le monument de Sainte-Foy-lès-Lyon (j'espère qu'il a été nettoyé depuis la photo).

Je me rappelle, dans les années 1970, avoir attendu sur une place le défilé du 11 novembre à Sainte-Foy, en compagnie d'Hélène, Pierre, Marie-Christine et les enfants, au défilé des officiels de la commune, en tête desquels les drapeaux et les bérets militaires des anciens combattants. Sur le panneau que je portais j'avais écrit en très gros la phrase "Maudite soit la guerre" (il y a une photo, introuvable pour l'instant). La réaction avait été plutôt d'interrogation bienveillante. Nous avions visiblement surpris, et nous avions bien discuté après le dépôt de la gerbe. Le monde actuel prouve tous les jours que nous avions raison en principe, ... mais tort en réalité. Aujourd'hui, les moulins à vent, pour mon compte, c'est : "Non merci !".
Même le monument de Quinsac (Gironde), où le sculpteur Gaston Schnegg a inscrit en effigie le visage terrorisé de son propre fils Pierre (mort au Chemin des Dames en avril 1917, son corps jamais retrouvé), au-dessus d'un coq dressé devant le soleil levant, déclare : « A la mémoire glorieuse des soldats de Quinsac morts pour la France ». Vous êtes sûr que vous avez dit "pacifiste" ?

Non, sauf grossière erreur de ma part – et même si c'est dur à entendre –, le réel pacifisme qui eut cours dans la société française dans les années 1920 et 1930 (auquel on doit au moins en partie la défaite de 1940), ne connut quasiment aucune traduction concrète – en dehors des quelques exceptions exceptionnelles ici présentes – dans la conception et l'édification des monuments dédiés aux morts de 1914-1918. Il est probable que les forces pacifistes du pays ont eu du mal à se faire entendre, entre les calculs politiques, la volonté des autorités et l'influence militaire, lorsqu'il a fallu élever les 36.000 tombeaux aux morts de la Grande Guerre.
S'il fallait dénombrer les monuments français explicitement pacifistes ou maudissant la guerre en les rapportant au nombre de secondes dans une heure, cela ferait UNE seconde (10 sur 36.000, ça fait 1 sur 3.600). Bon, on peut se dire que le pacifisme en pantoufle préfère mettre en valeur l'arbrisseau rabougri de l'exception, pour mieux ne pas voir la forêt en pleine santé du sort le plus commun, le plus énorme. C'est comme la recette du pâté d'alouette : un énorme cheval, une pincée d'alouette. On se console comme on peut.
Voyons les choses en face : les monuments pacifistes restent une goutte d'eau claire dans l'épaisseur d'un océan rouge en furie. A peine un granule de rêve et d'espoir dans la grosse et profonde marmite du diable.
Je clos ici la présente série. Rendez-vous au bicentenaire.
Prière de ne voir qu'une pure coïncidence dans le fait que ce billet est publié un 13 novembre. Je n'ai qu'une pensée au souvenir du Bataclan et des terrasses : « Maudite soit la guerre ! ».
09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maudite soit la guerre, monuments aux morts 14-18, monuments aux morts pacifistes, cazaril laspènes, équeurdreville, gentioux, saint martin d'estréaux, histoire, guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, antimilitarisme, annette becker, dictionnaire gaffiot, photographie, tu ne tueras point, picarde maudissant la guerre péronne, paul auban l'épave, alampr, saint-foy-les-lyon, quinsac, gaston schnegg, chemin des dames, morts pour la france, site mémoires de pierre, queutchny, alain choubard, 13 novembre, bataclan, avion 62, château-arnoux 05, dardilly 69
lundi, 12 novembre 2018
7/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
7
QUELQUES HOMMES 3
DES HOMMES QUI TOMBENT
Dans le désordre : Barbâtre (Vendée), Belmont-de-la-Loire (Loire), Céaux (Manche), Craon (Mayenne), Dombasle en Argonne (Meuse), Le Temple sur Lot (Lot-et-Garonne), Marcillac Lanville (Charente), Maynal (Jura), Tréguennec (Finistère), Vis-en-Artois (Pas-de-Calais), Sainte-Tulle (Basses-Alpes, dites "de Haute Provence"), Labastide-du-Temple (Tarn-et-Garonne). Quelques-uns parmi les soixante-cinq monuments aux morts que j'ai collectés sur ce thème.
Note : je constate, en furetant de nouveau sur l'internet depuis quelques semaines (en prévision), qu'on trouve à peu près tous les monuments que l'on cherche, et même qu'on ne cherchait pas ou auxquels on ne pensait pas. Quand j'ai commencé ce qu'il faut bien appeler une quête, pendant l'été 1976, il n'y avait rien, ou presque. Aujourd'hui, on a tout ou presque à sa disposition. J'imagine que, en dehors des apports de l'informatique et du numérique, l'approche du centenaire n'est pas pour rien dans cette espèce de prolifération. Je note aussi que, depuis mes premières photos dans les années 1970 et 1980, des monuments aux morts, qui semblaient abandonnés tant leur aspect laissait à désirer, ont pris un sacré coup de jeune. J'imagine là aussi que ces soins nouveaux ont quelque chose à voir avec le centième anniversaire. Et j'espère que tout le monde a ressenti, hier à 11 heures, la même chose que moi en entendant les cloches sonner à toute volée.










09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie, 11 janvier 2015, charlie hebdo, cabu, antimilitarisme, marco panella, partito radicale, théodore monod, j'ai vu le loup le renard le lion, les soldats seront troubadours, creys-malvile, aguigui mouna, lanza del vasto
dimanche, 11 novembre 2018
6/8 MES 11 NOVEMBRE
6
MON MONUMENT AUX MORTS
DE 1914-1918
POUR UN CENTENAIRE DIGNE
Dans un assez grand désordre :
Aast 64, Abainville 55, Abancourt 59, Abancourt 60, Abaucourt sur Seille 54, Abbaretz 44, Abbecourt 60, Abbenans 25, Abbeville 80, Abbeville Saint Lucien 60, Abelcourt 70, Abère 64, Abidos 64, Abilly 37, Abitain 64, Abjat 24, Ablain Saint Nazaire 62, Ablainzevelle 62, Ablancourt 51, Ableiges 95, Ablis 78, Ablon 14, Ablon sur Seine 94, Aboncourt 57, Abondance 74, Abondant 28, Abos 64, Abreschviller 57, Abrest 03, Abriès 05, Abscon 59, Abzac 33, Accolans 25, Accolay 89, Accous 64, Achenheim 67, Achères 78, Achères la Forêt 77, Acheville 62, Achicourt 62, Achiet le Grand 62, Achiet le Petit 62, Achy 60, Acigné 35, Aclou 27, Acq 62, Acqueville 50, Acquin 62, Acy en Multien 60, Adainville 78, Adast 65, Adelans 70, Adervielle Pouchergues 65, Adinfer 62, Adon 45, Adriers 86, Affoux 69, Affringues 62, Agassac 31, Agde 34, Agen 47, Ageville 52, Agnetz 60, Agnez les Duisans 62, Agnicourt et Séchelles 02, Agnières 62, Agnières en Dévoluy 05, Agnin 38, Agnos 64, Agny 62, Agon Coutainville 50, ..............................................................................
Le long paysage de monuments aux morts, ce long cortège funèbre, que je présente ici résulte d'un choix. J'aurais bien voulu pouvoir faire figurer ici l'intégralité des photos que j'ai amassées sur le disque dur de mon ordinateur, mais la démesure de l'ambition n'a pas tardé à me sauter à la figure. Rendez-vous compte : seize mille cent quarante-huit photos !!! Et pourtant, 16.148, c'est tout de même très peu : ce n'est pas la moitié des 36.000 monuments qui ont été édifiés sur le territoire français entre 1920 et le début des années 1930 (si l'on excepte de rarissimes localités dépourvues en 1914 d'hommes en âge de combattre ou qui ne déplorèrent aucun tué). Alors, vous pensez bien, le presque-rien qui figure ici n'a rien d'un inventaire.
On l'aura compris en lisant la liste ci-dessus : je suis parti du village qui l'inaugure (la liste) dans l'ordre alphabétique, et à partir de là j'ai égrené ceux qui venaient à la suite. Et je me suis arrêté à Agon Coutainville (Manche). Une bonne soixantaine (65, si j'ai bien compté), c'est-à-dire si peu que rien : une goutte de sang dans un océan rouge en furie. Derrière chacun de ces monuments, la béance à jamais incolmatable des absents. Des absents sans nombre, qui se retrouvent là, dont il faudrait prononcer le nom, lui aussi sans nombre (entre 1.400.000 et 1.700.000 Français, selon les dénombrements).

Nécropole de Douaumont (Meuse).
Derrière chaque croix bien blanche, il faut voir un corps bien ancré dans le sol, deux bras à l'horizontale et une tête bien droite. Imaginez à quoi ressemblerait ce champ si chaque croix s'animait soudain (un faible écho au « Debout les morts ! » lancé par l'adjudant Jacques Péricard à ses hommes le 8 avril 1915). Combien, ici, si quelqu'un sait (mais attention, en comptant l'ossuaire) ? Et qu'est-ce qu'ils diraient, si toutes les croix s'animaient ?
Sachant que dans beaucoup de localités, à lire la liste des morts, on voit que des familles ont été décimées, et parfois rayées de la carte, on aura peut-être une idée du massacre avec la reproduction ci-dessous de la première page d'un vieux Code Postal (1995) : les 65 villages énumérés plus haut sont loin d'occuper la totalité de cette page, qui ne compte pas moins de 158 noms de communes. Il en reste 93.
Et il reste encore 246 pages et 732,5 colonnes comportant chacune entre 50 et 60 noms de localités. Il faut une imagination dévorante pour se faire une minuscule idée de l'énormité innommable de la chose.
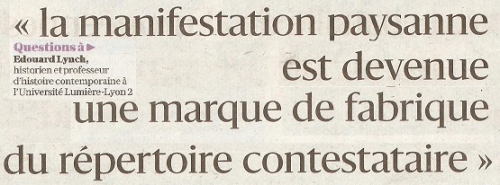
Oui, la Première Guerre Mondiale a bien été la première Shoah de l'histoire du monde (je fais exprès d'utiliser le mot hors du contexte habituel).

Le désordre alphabétique du champ de bataille (je n'ai pas dit "le champ d'honneur") ci-dessous, qu'observeront les connaisseurs à la lecture de ce billet, n'est imputable qu'à ma totale incompétence en informatique : je ne comprends pas la logique du système que j'utilise, alors je me suis débrouillé comme j'ai pu : au début, on peut commencer par la fin de la liste, mais après, c'est beaucoup plus flou. Un indice : la photo en bleu-blanc-rouge a été prise à Abscon (59). La toute première à Agon Coutainville (50). Et la toute dernière, en bas à droite, à Ablancourt (51).



En fait, j'ai une très longue histoire avec les monuments aux morts. Plus exactement depuis le jour d'été où, en 1976, quelque part autour du plateau du Larzac, j'ai, pour la première fois de ma vie, lu tous les noms gravés dans la pierre. Plusieurs familles étaient frappées plusieurs fois : jusqu'à cinq fois le même nom de famille. Je n'avais jamais eu l'idée de lire les noms des morts. La lecture m'a réveillé en sursaut. C'est peu de dire que ce fut un choc. Derrière chaque nom, de la chair humaine ravagée. Il faut dire que j'avais fait mon service militaire (en fait de "militaires", les bidasses étaient surtout les bonniches de l'institution, puisque affectés aux basses besognes : je n'ai jamais été exercé au "combat", à part juste deux ou trois séances de tir en douze mois), et que je venais de participer à la "Marche pour la démilitarisation", partie de Metz et arrivée à Douaumont (voir ici aux 7 et 8 novembre). Et Douaumont, c'est déjà un choc.
Laurent Gauthier, le frère de ma grand-mère paternelle, était mort dans les premières batailles de la guerre. Et le beau-frère de celle-ci – René Chambe, alors sous-lieutenant – avait cherché à tout prix à la consoler en lui faisant espérer que Laurent était prisonnier (« Pour Laurent, j'ai écrit dix fois qu'il ne faut pas s'inquiéter outre-mesure. C'est même très bon signe ce silence (souligné dans le texte de la lettre de René Chambe à sa belle-soeur). Il est sûrement prisonnier. Combien de prisonniers ne peuvent écrire !! »), avait nourri mon imagination des épopées que ses livres exaltaient (René Chambe : Au Temps des carabines, Guynemer, ....). J'étais donc sensibilisé. Réceptif. Motivé. Né presque trente ans après l'Armistice, je n'ai toujours pas digéré le fleuve de sang depuis ce jour d'été de 1976.


Carte postale envoyée le 29 novembre 1918 [mais où est mentionné au recto "22 novembre, 10 H du matin", jour de l'entrée des troupes françaises dans Strasbourg] par René Chambe à sa mère : « Strasbourg !!!
Notre corps d'armée y est entré le premier ! Vous devinez, ma chère Maman, notre joie. Si vous aviez vu le délire de la population !!! Mais je ne peux entreprendre de vous le décrire ici. Dans 2 ou 3 jours, j'enverrai un long récit à Suz. [Suzanne] de ce moment splendide. Elle vous le transmettra aussitôt.
Voici en attendant une vue de la sombre et légendaire cathédrale. Je suis venu ici aujourd'hui pour quelques instants et repars pour l'endroit où nous habitons ... tout près des Oberlé !
Ma chère Maman, un grand baiser bien affectueux. A bientôt une lettre.
René Chambe ».
J'ai commencé par me lancer dans une course photographique tant soit peu obsessionnelle et dispendieuse, et j'arrêtais la voiture dans chaque village jamais traversé pour immortaliser le monument du lieu. Une quête désespérée, quand j'ai pris conscience de l'immensité démesurée de la tâche : 36.000 communes, j'ai compris que je n'étais pas de taille. Avec mon maigre butin de 450 clichés (il faut faire les kilomètres, je n'ai pas compté), j'ai enfin admis l'évidence : il était illusoire de croire que je pouvais épuiser la question en parcourant les routes de France. Diverses hypothèses m'ont traversé l'esprit. Et puis l'internet est arrivé.
Alors je me suis mis à collecter comme un fou les images, principalement sur le site "MemorialGenWeb", réserve alors qui me semblait inépuisable, malgré la qualité aléatoire et, disons-le, souvent médiocre des clichés des militants : il n'est pas évident de se présenter dans une commune à la meilleure heure avec la meilleure lumière (et puis le format). Les photos trouvées chez Alain Choubard ou Queutchny sont en général beaucoup plus parlantes, car plus soignées et plus "généreuses". C'est vrai, j'y ai passé des heures, et des heures, et des heures.
Aujourd'hui, mon vivier (si l'on peut dire !) de monuments aux morts comporte exactement 16.148 références. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, car chaque mairie ou presque a un site internet, et a à cœur de présenter, au nombre de ses édifices remarquables, LE monument aux morts. Je ne sais pas si c'est un "progrès" : la documentation est devenue simplement très accessible. Oui, 16.148 : une masse tellement énorme que, pour espérer en donner une idée infinitésimale, j'en suis réduit à proposer 65 pauvres représentations presque désincarnées : des pierres sculptées et gravées portant chacune une part infinitésimale de l'infinité des noms des morts. Les 65 premières références de ma réserve. Ce serait dérisoire si ...
Oui : une goutte de sang dans un océan rouge en furie.
« Oui mais jamais au grand jamais
Leur trou dans l'eau n'se refermait.
Cent ans après, coquin de sort,
Ils manquaient encore. »
Tonton Georges (ou presque).






09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, 11 novembre, commémoration, soldat inconnu, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie, shoah, debout les morts, jacques péricard, nécropole douaumont, agon coutainville 50, alain choubard, queutchny 14-18, bajus 62, auchel 62, georges brassens, rené chambe, général rené chambe, michel beirnaert
samedi, 10 novembre 2018
5/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
5
QUELQUES HOMMES 2
***
DES VEILLEURS
ARRY (Somme). Sculpture de Louis Le Clabart.
CANCHY (Somme). Sculpture de André Joseph Géraud ABBAL.

MIREBEAU-SUR-BEZE (Côte-d'Or). Sculpture de Paul Auban.
SAINT-DOMINEUC (Ille-et-Vilaine). Sculpture d'Albert Bourget.
COTIGNAC (Var).
Le monument de Cotignac est assez particulier : le sculpteur (Jean-Louis Lhomme, le bien nommé) semble proposer, vu de face, un simple obélisque bien lisse, alors qu'en réalité, l'essentiel (le bonhomme entier) se trouve au verso (je préfère ne pas mettre la photo que j'ai prise : elle date de bien avant le décapage, sans doute opéré dans la perspective du centenaire : c'est plus présentable).

09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie
vendredi, 09 novembre 2018
4/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
4
QUELQUES HOMMES 1
***
DES COMBATTANTS

LA CAVALERIE (Aveyron). Il y avait là un célèbre camp militaire qui a diablement fait parler de lui il y a quarante et quelques années. Le plateau où est située la localité s'appelle le Larzac.

SAINT-JEURES (Haute-Loire) : « On ne passe pas ! ».

MEXIMIEUX (Ain). Les couleurs de certains clichés ont très mal vieilli.

BRIOUDE 43.

HERM (Landes). Le grenadier d'Ernest Gabard. Ce n'est pas moi qui ai pris cette photo.
09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie
jeudi, 08 novembre 2018
3/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
3
J'ai gardé de l'amitié pour une autre photo prise pendant la même marche Metz-Verdun de 1976. Une photo moins "signifiante" d'un certain côté, bien que ce ne soit pas sûr, mais qui fait revivre un personnage que j'ai beaucoup aimé, moi qui n'ai jamais vraiment habité Paris. Un personnage qui fut une personnalité, clochard magnifique, candidat cycliste à la mairie de Paris, harangueur de foule. Je veux parler d'Aguigui Mouna. Je ne dirai rien de la carriole poussée par le camarade Dupont (son vrai nom, et André, son vrai prénom), ni de ce qui était inscrit sur ses flancs, ni des gamins véhiculés, ni ...

Je l'avais retrouvé le même été, toujours sémillant, autour de la centrale de Creys-Malville (un surgénérateur en construction, contesté, puis abandonné), tenant compagnie, face aux gendarmes mobiles, à Lanza del Vasto. Mouna était un indécrottable idéaliste, pacifiste, antinucléaire, anarchiste, etc., capable d'entonner ex abrupto le célèbre refrain du trio Leclerc-Vigneault-Charlebois : « Quand les hommes vivront d'amour, Il n'y aura plus de misère, Les soldats seront troubadours, Mais nous, nous serons morts, mon frère » (2'27" ci-dessous), et dans la foulée de faire scander par les gens attroupés : "Les-soldats-troubadours-Les-soldats-troubadours !".
Aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut de ce qui, rétrospectivement, peut apparaître comme un entêtement dans la rêverie éveillée et le monde enfantin de la paix universelle réalisée. Je ne me prive pas d'en penser ce que je veux. Je suis devenu un peu réaliste. Et j'ai cessé de rêver d'un paradis.
09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie, 11 janvier 2015, charlie hebdo, cabu, antimilitarisme, marco panella, partito radicale, théodore monod, j'ai vu le loup le renard le lion, les soldats seront troubadours, aguigui mouna, lanza del vasto, creys-malville
mercredi, 07 novembre 2018
2/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
EN MONTANT A DOUAUMONT

2
Il m'est arrivé de regretter d'avoir été antimilitariste. C'était à l'époque où il y avait encore un service militaire. De militaire, d'ailleurs, il ne restait que le nom, puisque les exercices proprement militaires (à part les exercices de tir deux fois dans l'année et monter la garde devant le portail endommagé du hangar où dormaient les "Alouettes III", à Corbas) s'étaient faits rares à l'époque, sans doute faute de budget suffisant, et que la hiérarchie se creusait la tête pour trouver un peu d'occupation à "la troupe". Il y a cependant quelque chose que je ne regrette nullement, c'est d'avoir participé un jour à une grande marche européenne non violente pour la démilitarisation (c'était à peu près comme ça que ça s'appelait).
J'étais sorti de mes douze mois moralement amoindri, mais j'étais enfin dans la "vie active". Le rendez-vous de départ était donné dans un parc de Metz, un jour de juillet ou d'août 1976, l'arrivée étant fixée environ une semaine après, quelque part autour de Verdun. Je me souviens d'avoir croisé ou rencontré bien des gens étonnants, parmi lesquels un flamboyant Italien du nom de Marco Panella, leader à l'époque du Partito Radicale ; un homme à la mine humble et grave qui s'appelait Théodore Monod, qui n'arrêtait pas, m'avait-il semblé, de torturer son couvre-chef, un genre de chapeau de marche assez mou ; un Cabu attentif qui ne cessait de griffonner ce qu'il voyait ; bref : du beau monde.

Théodore Monod et son chapeau.
Il est vrai que s'agissant d'antimilitarisme, on peut dire que Cabu représente à jamais la quintessence de la chose. Il n'aurait pas pu imaginer ne pas être présent sur les lieux mêmes de cette "manif" unique en son genre (celle de l'année suivante, "Haguenau-Landau", fut un innommable n'importe quoi). Monod était plus pacifiste qu'antimilitariste, si cette distinction dit quelque chose à quelqu'un.

J'ai à peu près tout oublié, en ce qui concerne les détails. Il me reste cependant de cet événement si éphémère, et après tout dérisoire, un souvenir qui a gardé la compacité du granit. Je veux parler de la lente montée par une route forestière vers la nécropole de Douaumont. Verdun, la grande bataille de 1916 (février à octobre), où l'Allemand Falkenhayn avait l'intention de "saigner l'armée française". A l'arrivée, selon les décomptes, 20.000 morts en moins pour l'Allemand, auquel Pétain a cependant dit fermement : « On ne passe pas !». Et qui a fait exactement ce qu'il fallait faire pour cela ("Voie sacrée" et toute l'action concrète de masse que ça impliquait). Mais à quel prix ?
Tant de gens marchant gravement, dans un silence absolu (on n'entendait que le bruit des chaussures sur le bitume, c'était une intense et unanime communion), en direction du symbole absolu de l'absurde don de soi exigé de tous ces hommes de France envoyés là, autrefois. C'était très beau. La chose avait un aspect grandiose : pas un mot, pas un slogan, pas un "message". Seulement la manifestation d'un chagrin définitif, d'un deuil irréparable, d'un respect total devant le "sacrifice". J'ai oublié la déception à l'arrivée, l'accès interdit à la nécropole, les gendarmes en rang et les "beaufs" coiffés de bérets rouges qui nous attendaient à l'entrée, rigolards et avinés. Oui, sincèrement, seuls me restent cette marche sereine, ce silence accompli, cette gravité résolue.
J'avais juste, en levant bien haut mon appareil, pris cette photo.

J'ai repensé à cette marche silencieuse un certain dimanche 11 janvier 2015. C'était pour Charlie Hebdo.
09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie, 11 janvier 2015, charlie hebdo, cabu, antimilitarisme, marco panella, partito radicale, théodore monod
mardi, 06 novembre 2018
1/8 VOUS AVEZ DIT "CENTENAIRE" ?
1
On s'est acheminé tout doucement vers un drôle de centenaire, et puis voilà que, tout par un coup, nous y voilà. Il va de soi que j'honorerai le 11 novembre dignement, mais à ma manière. Je n'ai pas fait que collecter, sur internet et en grand nombre les photos de monuments aux morts. J'avais commencé bien avant, en allant de village en village, au hasard de pérégrinations solitaires ou familiales, m'arrêtant à chaque fois à proximité de l'édifice, qu'il fût le plus humble ou le plus grandiloquent. Il me semble que la photo inaugurale de ce très long compagnonnage fut prise à Creissels (Aveyron) en 1976, à moins que ce ne soit à Rivière-sur-Tarn (idem). Tout ça pour vous dire la permanence de la préoccupation.
En attendant le jour fatidique, anniversaire si l'on veut, où les officielles sonneries "Aux morts" retentiront partout en France et où toutes les cloches de toutes les églises de France sonneront à toute volée comme le 11 novembre 1918 à 11 heures, je voudrais dresser ici ma modeste haie d'honneur au plus gigantesque cortège funèbre auquel la France a jamais assisté dans toute son histoire, qui fut en même temps le premier suicide historique de l'Europe et la première extermination industrielle de masse de sa jeunesse masculine.

Voici donc quelques trop rares clichés cueillis année après année, auxquels j'ai mêlé deux réalisations remarquables. J'ai choisi, pour l'occasion, de montrer, non pas l'exaltation de l'héroïsme patriotique, mais des images du deuil et de la douleur. Un reflet infinitésimal d'un malheur qui reste définitivement unique en son genre.

PLEHEDEL (Côtes-du-Nord, entre Paimpol et Saint-Brieuc). On ignore, apparemment, le nom du sculpteur.
LODEVE (Hérault). Sculpture de Paul Dardé.

MONTFAUCON (Haute-Loire). Sculpture de Gaston Dintrat.

PLOUHINEC (Finistère). Sculpture de René Quillivic (voir Plozévet plus bas).

PONT-CROIX (Finistère). Sculpture de René Quillivic (idem).

TENCE (Haute-Loire). Sculpture de Chastenet de la Ferrière. Le monument n'est plus, comme ici, devant la mairie et en plein centre, mais relégué au fin fond du Chatiague (où avait lieu, dans les autres fois, le marché aux veaux, tous les mardis, avec le père Digonnet à la pesée).

PLOZEVET (Finistère). Sculpture de René Quillivic, habitant de la localité, qui avait pris un de ses voisins (Sébastien Le Gouil qui a perdu ses trois fils) pour modèle (confidence de l'homme faisant le bedeau ce jour-là). La pierre de 9 mètres de haut dressée à son côté, a été extraite du sol de la commune, qui a perdu 200 jeunes hommes dans la guerre (sur une population de 4699 hbts. en 1911).
CAMPAN (Hautes-Pyrénées). Sculpture d'Edmond Chrétien.
09:00 Publié dans MONUMORTS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, monuments aux morts, photographie
vendredi, 02 novembre 2018
CLIMAT : L’ACTUALITÉ ENFONCE LE CLOU
Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°68).
Et puis voilà, c'est au tour du vénérable et renommé WWF de tirer la sonnette d'alarme : d'après l'ONG "militante" (c'est ce qu'on dit), ce sont 40% des vertébrés qui ont d'ores et déjà disparu de la surface de la Terre depuis les années 1970. Je me dis juste qu'ils ont mis un sacré bout de temps à s'en apercevoir : l'information figurait en toutes lettres (en plus grave) dans le célèbre article du Monde (vous vous rappelez, 15.000 scientifiques, etc.) daté du 14 novembre 2017 !

Cinquante semaines pour assimiler la chose, il faut le faire. Un cri d'alarme qui laisse définitivement rêveur sur l'efficacité supposée des cris d'alarme. On se dit en effet qu'il ne sert à rien de crier si c'est juste pour occuper un créneau d'information parmi la multitude des créneaux d'information. Un clou chasse l'autre.
***
Et puis c'est au tour de l'OMS de dénoncer la surmortalité des enfants du fait de la pollution : 600.000 par an. Je me souviens en effet des trajets forcés le long de l'avenue du Châter à Francheville à pousser la poussette sous la gueule des énormes pots d'échappement des poids lourds interdits de tunnel de Fourvière, et qui empruntaient cet itinéraire de déviation. Rien d'étonnant à ce que les enfants soient les premières victimes. Les gaz d'échappement des moteurs de camions, je crois que c'est à Sobibor que les nazis s'en servaient : il ne fallait pas longtemps, dans le fourgon spécialement branché, pour obtenir le résultat attendu.
Bon, on se dit qu'à l'air libre, les vents dispersent mieux les miasmes que dans ces atmosphères confinées. On se rassure comme on peut : comme dit Günther Anders, l'humanité n'a plus besoin de Hitler pour s'autodétruire : « Bref, le monde des instruments nous met au pas d'une façon plus dictatoriale, plus irrésistible et plus inévitable que la terreur ou la supposée vision du monde d'un dictateur ne pourrait jamais le faire, n'a jamais pu le faire. Aujourd'hui, Hitler et Staline sont inutiles » (L'Obsolescence de l'homme, II, éditions Fario, 2011, p.204, chapitre "L'obsolescence du conformisme, 1958").
Je n'invente rien et ce n'est pas moi qui le dis : aujourd'hui, Hitler et Staline sont inutiles. La folie technique qui saisit plus que jamais l'humanité a pris le relais pour faire le même job. Sous l’œil vigilant du Comité d'Ethique. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincu qu'Hitler et Staline ne sont pas des monstres ou des aberrations rendues possibles dans des systèmes devenus fous. Je suis au contraire convaincu qu'Hitler et Staline sont des aboutissements logiques, qu'ils ont été produits par une conjonction de facteurs où l'appétit de pouvoir et la puissance technique jouent les premiers rôles.
Et que notre "morale" moralisatrice a inscrit dans ses "valeurs sacrées" bien des "trouvailles" de l'un et de l'autre, mais qu'elle les a habillées (nommées) autrement, pour pouvoir continuer à condamner ces épouvantails comme figures de l'horreur absolue (une preuve flagrante dans l'eugénisme, que la médecine actuelle pratique sans états d'âme : combien d'anormaux arrivent aujourd'hui à terme ? Je pose juste la question.).
Et cela permet de comprendre pourquoi sont arrivés au pouvoir, à la demande du corps électoral, plusieurs Hitler au petit pied (Bolsonaro étant le dernier en date) désireux de se débarrasser au plus tôt des garanties qu'offre l'état de droit. Le "populisme" porté démocratiquement au pouvoir est un aboutissement logique : ce qu'on appelle "populisme" est lui aussi le produit d'une conjonction de facteurs au centre desquels on peut placer le mépris de toutes les élites pour le "peuple" concret et la tyrannie exercée par l'économie triomphante.
***
Et puis c'est au tour de France Culture de dénoncer l'action des lobbies, mardi 30 octobre, dans l'émission "La grande table" (animée par l'implacable douceur d'Olivia Gesbert avec ses questions doucereuses et très exactement conformes à l'air du temps). Stéphane Horel, "journaliste indépendante d'investigation et documentariste" vient de publier Lobbytomie. Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie (La Découverte, 2018, après Happycratie, de je ne sais plus qui, ça devient une mode. Lobbytomie, le titre est sans doute choisi par l'éditeur : je ne dis pas bravo, je préfère le sérieux à l'expression choc).
La dame a eu une grosse demi-heure pour exposer en détail une petite partie des petites et grosses ignominies que les "groupes de pression" commettent – en usant de moyens considérables – dans la discrétion feutrée des couloirs, des antichambres et des cabinets pour qu'aucun dommage ne soit causé aux énormes profits des grosses et très grosses entreprises. Quelles que soient les conséquences sur l'air, l'eau et les sols, et accessoirement la santé des populations.
Je reprocherai juste à madame Horel de ne pas citer une seule fois le nom de Naomi Oreskes qui, avec Erik Conway, avait publié en 2012 une bible irremplaçable, au titre limpide quant à lui, sur le même sujet : Les Marchands de doute, qui jetait une lumière crue, entre bien d'autres réalités scandaleuses, sur les pratiques douteuses de certains "scientifiques" capables de vendre (cher) leur signature pour entretenir la controverse, même sur des questions recueillant un large consensus de la communauté scientifique sérieuse. Le doute profite à l'empoisonneur. Et entretenir sciemment le doute contre toute évidence pour éviter ou retarder les décisions désagréables est un métier à temps plein et grassement payé.
N'a-t-on pas entendu très récemment (ces derniers jours) le nouveau ministre de l'agriculture demander à tous les opposants au glyphosate d'apporter la preuve de la nocivité des pesticides ? Pensez-vous qu'il oserait demander aux industriels de la chimie agricole, avant d'autoriser leurs produits, de prouver leur innocuité ? Que nenni, voyons ! Ne rêvons pas.
***
Quoi qu'il en soit, depuis quelque temps, les choses s'accélèrent et tout le monde semble s'y mettre. Tout au moins en France. D'un côté, je me dis que c'est plutôt bon signe ("coquelicots", "marches pour le climat", ...). D'un autre côté ...
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wwf, world wildlife fund, ong, biodiversité, disparition des vertébrés, journal le monde, 15.000 scientifiques, oms, günther anders, l'obsolescence de l'homme, france culture, lobbies, émission la grande table, olivia gesbert, stéphane horel, lobbytomie, happycratie, éditions la décrouverte, naomi oreskes erik conway, les marchands de doute, sobibor, avenue du châter, francheville 69340, francheville rhône

























































































