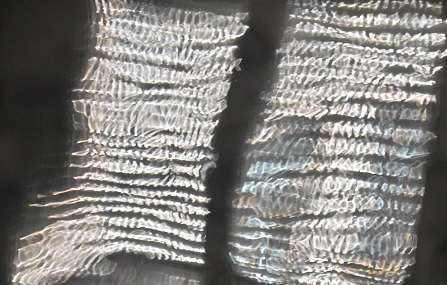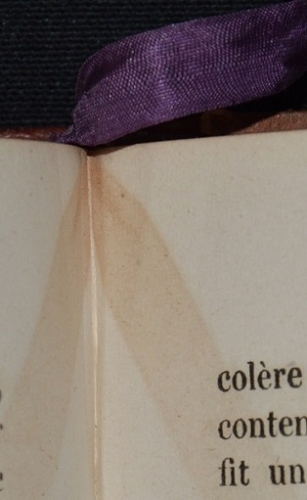dimanche, 23 septembre 2018
ÉTAIN
MON ART CONTEMPORAIN
Faites couler de l'étain fondu dans une casserole d'eau portée à température.
Observez le résultat.
C'est cuit.
« Ithyphalliques et pioupiesques,
Leurs insultes l'ont dépravé ;
A la vesprée ils font des fresques
Ithyphalliques et pioupiesques ;
Ô flots abracadabrantesques,
Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé !
Ithyphalliques et pioupiesques,
Leurs insultes l'ont dépravé. »
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, arthur rimbaud, le cœur supplicié, le cœur du pitre
samedi, 12 mai 2018
PHOTOGRAPHIE
Voilà, c'est fini, le coup d’œil dans le rétroviseur. C'est fini, le petit retour sur ma petite collection de petites considérations sur la façon dont le vaste monde marche aujourd'hui.
En fait, si j'ai remis en ligne des propos tenus ici depuis 2011, c'est que je viens de passer par des moments pas drôle [oups ! pardon : pas drôles]. Je n'en dirai évidemment rien ici, parce que ça ne regarde que moi et ceux qui savent. La vie reprend son cours, presque comme avant. Pour mon petit compte personnel, je trouve néanmoins intéressante la relecture, de façon compacte et en continu, de ces trente et un billets choisis parmi ceux que j'ai consacrés, en six ou sept ans, à l'observation de l'état du monde, dans ses diverses modalités : politique, économique, écologique, sociologique, philosophique, climatologique, etc. Et cela renforce une impression qui reste d'habitude fragmentaire et fugitive, parce que liée à une circonstance, à un moment ou à un contexte particuliers : s'il n'y a pas de "convergence des luttes", comme le scandent les incantations de quelques poignées de rêveurs endurcis, il y a indéniablement convergence des facteurs d'alarme. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui faire entendre (visuellement) le tocsin. Ci-dessous un détail photo du tocsin (fabriqué en Chine).
Contrairement à une première et fausse impression, cette photo est d'une netteté impeccable. Ce qui m'intéresse ici, c'est justement le contraste entre le caractère fuyant des ombres sombres, qui sautent aux yeux tout en semblant vouloir échapper au regard, et la géométrie parfaite des orbes dont on devine les cercles concentriques, autour d'un centre qui est là, mais restera le grand absent définitif.
Je ne me fais guère d'illusions, comme on peut s'en douter, sur le retentissement qu'un tel tocsin peut avoir sur la marche du monde.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie
samedi, 10 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 7/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE VII
A visiter l’insu,
on est couvert de vie.
L’effort d’avoir, avec son origine,
la peau du corps d’appui,
c’est tout au bord de la limite.
C’est peut-être ici,
l’art qui fabrique,
l’œil qui recuit l’idée par plaques,
avec ses faux abords,
– et le vrai du recours,
c’est la grâce.
Il vient, le murmuré,
le trémulé du temps,
le vibré d’anche avec ses ailes.
Il laisse un nom plus corporel,
un arbre à nuit :
ça pousse en bord,
désigné court de trace.
L’envers de son,
ça s’appelle,
ça bat du cœur dans un trou.
Le bruit qui dort,
est-ce qu’il fait limite ?
Dans le bondé du cœur désert,
on entend ça,
c’est la foule en couleur.
STRETTE
L’enfant, s’il joue la comédie,
C’est du sommeil intense,
C’est la vie profonde.
Il nage en clair dans le trou d’os :
C’est la foudre occipitale.
Regarde en lisière,
c’est un visage en gravité
qui fait du devenu à force de brisure.
Pris dans le rut des choses,
Il use un corps sexé contre les autres âmes.
Il a creusé dans les contours,
Il apprend le spectacle.
Le devenu, c’est la fabrique,
La main du corps pénible
Où dormait la formule.
Dans le vibré de soi,
Car il faut du beau,
De la vie-vite en source pleine.
Au fond du trou de deuil,
Couché en chien de force,
Il a cousu la voix minuscule,
Avec son fleuve amer.
Le chien d’ailleurs défend ses yeux.
Je vis dedans,
La voix cousue en cœur.
Couvert de vie,
Avec les nerfs complices,
C’est le nom du désordre,
Avec du sel entre les vies.
L’enfant reconstitue le poids de la matière,
Le cœur des formes.
Le pur de langue,
C’est lui le respiré.
Dans la cour du vrai,
C’est perspicace, le courant pur.
On fait du fruit,
On a de l’invisible.
Où est la douane occipitale ?
On fait constat de poésie,
Le besoin digne au fond d’ici.
On sort d’avoir.
On est le désert d’eau,
L’animal avec son rêve.
Tourné vers ce qu’il pense,
Le visage a fait l’insu de soi.
Il reste en trou,
Avec son grave.
A quoi la forme sert,
Dans le bruit dur,
Au fond d’ici ?
Encore un dernier corps,
Pour faire la route ?
Couvert de vie,
Le nom dépose en trace,
Autre lieu sûr.
Travail en bord, travail en tige,
Ça vient à la fabrique,
Il y a du construit.
Dans l’hiver de la personne,
Ça continue à creuser,
Ça vient se dire.
On est en vif,
En fort de forme,
Le soi du sexe.
Ce qui se rit en sombre,
Avec travail extrait de soi,
La lèvre à morsure, c’est la joie.
Le nom fait son être,
Ça fait le beau dans le visage.
Il a traduit le pur de langue.
Il y a du sanglot sur l’écran.
C’est là le respiré, la frontière.
Combien on perd,
A retenir le lourd de l’air.
En corps de vie,
A bout de traces,
Qu’est-ce qui résonne ?
A coups de creux,
le corps fait sombre.
Il fait du beau,
Avec lumière.
Il y aura le format d’homme.
On est encore en soi,
Dans le front bas,
Ou bien la boule à fruit.
La voix d’en bas,
Le rameur long,
C’est ça l’hiver de parole ?
Le captif a fait du sourd,
Avec des trous plein le sujet.
Coule en portrait,
Ce qui éprouve.
As-tu ton assaut ?
Alors fais ton pire,
Avec le cœur ficelé,
La couleur de faux.
Et puis c’est la cour du vrai,
Dans la cloche à plongeur.
Est-ce qu’il fait si froid,
Dans l’appel,
Qu’on l’entend pas ?
Il est pris dans la parole.
Il s’est noué, le respiré.
Si ça voulait dire ?
En dur de chose,
Il faut du respiré dedans,
Ça tient du noyau.
Il est dessus la fracture,
Ça coule en hésité,
Le noir de geste.
L’hiver de la figure,
Le soi du cri d’avant,
C’était quand, la torture ?
On ne sait plus :
Ça fait du beau, le vent vivant.
Au noir de vrai, ça se dépouille,
L’insu de soi qui foisonne.
Saignement, mouriture,
Il fait le jus, c’est la trace.
Le soi, c’est pris dans l’image.
Il traîne en louche.
Il est correct.
Il a sa fatigue :
Il a mal à son vrai.
Si c’est dodu, la formule,
Qui est cet autre ?
Allons à moi, corps de frousse.
Allons à coups de moi,
Dans le ténu, vers l’otage,
Couvert de vie,
Tout seul avec son bruit.
Il bat a coups de cœur
L’insu de la personne.
Est-ce que c’est ça,
La forme des choses ?
Est-ce qu’on s’y trouve ?
On fait du cœur avec son bruit.
On l’a trouvé le complice.
C’est ici la fabrique,
La peau des limites,
L’effort au fond d’ici.
Il coule en murmuré,
L’arbre à nuit,
A coups de bruit.
Alors il peut dormir,
Ouvert, avec la peau des limites.
Dans le trou d’os,
C’est la foule en couleur,
Qui découle.
Tout au bord.
CODA
C’est dans le dur de moi :
Je bats à coups de bruits
Mon cœur défait du pire.
Dans le couteau de moi,
Ça fait de la peau pure.
C’est dans le gros de ça
Qu’on sent le sel qui coule.
C’est fort de goût, le sûr.
Dans le cousu,
Je suis le ruminé complice,
Le réservoir inclus.
La photo dépolie,
Ça fait une entrée double.
Je me disjoins, je sors.
Je cherche un bruit : le pur.
La fenêtre à venir.
Je livre au corps secret
Mon verre avec ma lèvre.
Hésité jusqu’au noir,
J’ai convaincu l’air pur.
Dans l’induit, ça passe outre,
Et ça verse au concert.
Le décousu, le dû,
L’œil aime à son insu.
Dans le moi que je dis,
Ça reste tu, ça dort.
Tu entends les coups sourds,
La voix au fond d’ici,
Le cœur en bout de bruit.
C’est dans le tu qu’on est.
Vers tu, ça se complique :
Elaboré le pur.
Le moi de la fabrique
A fait son dû, parole.
L’insu du soi d’avant,
Il a de quoi porter.
Il a le devenu,
Celui qui part en bloc.
Complet de mes fantômes,
Je suis le murmuré.
Corps étrange à la source,
Je fais de l’étranger.
Ma langue, à coups de bruits,
Cherche ailleurs à combler,
C’est l’autre avec ses robes,
C’est l’autre densément
Je comprends la coulure :
Elle émerge le jour.
Le sédiment du ciel,
C’est l’autre voix du corps.
J’ai dans le pur le noir,
La condition des formes.
Le mur est toile en dur.
Des corps peints, des contours,
En court ça se dessine.
Ce sera bleu, qui chante.
En dépoli, sorti,
En étranger de bruit,
Ça s’émancipe en traits.
C’est donné, la tournure.
C’est cœur d’abois, le dire.
Reste à signer l’air pur
Avec les doigts d’après,
Compteurs des grains du fruit.
Il est dans le donné,
Le sorti, le complice,
Celui qui naît déçu.
Il a du droit, des preuves.
Il ira vers le brut,
Conduisant clair ailleurs,
Limite ouverte à suites,
Bruit d’avenir voulu.
Il a vu ce qu’il vit.
Il sait, pour la forêt :
C’est le fort du secret
Qui s’alimente au doute.
Dedans, c’est du construit,
Avec du vent vibré,
Le bleu entre les tempes.
Il sédimente en fruits.
POSTLUDE
C’est au fort de toi que je donne
Le cru, le pauvre, avec des ouvertures.
Avec toi, qui me déplaces,
J’apprends le dru, le très formé,
Le fort lisse avec ses avens.
Qui j’ai voulu, c’est dans l’aveu,
Ce toi, ça vient du cœur du fond.
Dans le poids du travail ourdi
(c’est un réseau de voix rusées),
c’est devenu le vrai, ce ventre,
le compris de la source.
Avec le noir devant,
Le nénuphar est une antenne,
Et je comprends ce qui s’efforce,
C’est en deçà que je bourgeonne.
Très confondu avec mon livre,
Je te fais des mains croustillantes.
FIN
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
vendredi, 09 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 6/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE VI
Avec le moi d’ici,
en remettant
le temps d’avant
qui se déchire,
je t’ai refait le déroulé,
le temps d’avoir du sens,
comme un sas de vent
avant soi la cassure.
Tout mon secret,
la rue d’après,
le venin vite,
tout le support,
ça fait confort.
Le noir de corps
frappe au décor.
La rue d’après,
ça rend sourd.
On se tait en couleur,
sac de soi,
la vie par plaques.
Volute au mur de mal.
La vie rutile.
Dans le corps intérieur,
le noir se ferme,
c’est en lui-même.
Au cœur de gris avec cadavre,
on fait papier d’accord.
C’est en dépouille,
ce qu’on sait du semblable.
C’est l’hiver, ou la personne ?
L’impur de voir
a fait sa goutte,
une eau creuse,
avec surface.
Vêtu de l’œil,
pour la similitude,
on a la volupté sans frais.
Bar de nuit,
citron-fraise,
un coup dur.
Après la suie, la promenade.
La vie foisonne.
Dans le fruit direct,
on a trouvé du vertige,
ça coule en peur
avec les autres tiges.
J’ai vu mon corps cousu,
ma tête en cerisier,
en fruit direct.
Dans la moisson,
c’est peur de l’engrenage,
avec vie de forme,
hissé la tige en dur
jusqu’aux traces à pourquoi.
J’ai la couleur en cru,
le noir en papier fort,
malgré la trace
dans la cloche à pourquoi.
On suivait l’acte,
respect d’encore,
de ventre fait,
ça se balance
avec mort de vie,
en fruit direct.
Le fort se met en fruit.
C’est l’hiver en personne.
C’est déduit des contours.
Il a sa silhouette.
Il parcourt la nuit,
beaux yeux gris,
la frontière en peau peinte.
Le pour de quoi devient du corps.
Après l’afflux,
ça fait complice.
C’est en vie qu’on foisonne,
et c’est l’hiver de la personne,
en fruit direct.
On a du lourd de soi,
en bout de branche.
Insulte à devenir.
Quand je serai complet,
le pouvoir dense.
La douleur, mais en vrai,
capable à supporter.
En parcourant de nuit,
on comprend l’engrenage.
La trousse à nourriture.
J’ai le devis d’angoisse.
Hiver, hiver,
il vit dans la personne.
C’est secret, la pourriture.
C’est deviné, le jus.
J’ai tout trié.
Tombeau en fruit direct.
Dans la peur,
j’ai pris le respirable.
La montagne à jalousie,
la fabrique à formule.
C’est en parcours de nuit
qu’on fait de la dépouille.
Il fait du couteau dans l’orgueil,
il a son dominé, sa volupté.
Il tend ses traces
avec respect du vent.
On saura recevoir
le nerf du cœur.
Il ne dira que pour les gouttes.
C’est un sang qui passe.
Quand tu te réduis à l’impur.
A raturé en retour.
C’est du tendu,
à coups de rire.
Visage en plis dans l’eau drôle.
Tu fais ton dieu par mégarde.
Le nettoyé se livre au premier corps.
Tu te retournes, mais ça obéit.
A la façon du trou qui porte,
tu sens qu’on a mal à son vrai.
Quel odieux dieu,
l’hiver de la personne.
Dans son sable,
l’otage a pris le geôlier.
On se nomme en abstrait.
Le soi, c’est métaphore.
Le corps, ça va se dire.
Il s’inhumait en plaisir,
avec vertige impérieux,
le fort correct avec fatigue.
Décision de l’aimer.
Amour ce qui touche,
à collision d’affronts,
à frivolités fortes.
Qui tu retiens,
dans ton courage à risque ?
Alors la terreur.
Pris conscience en frousse.
C’est en lui.
Quand tu me tiens,
c’est la formule.
Qui est cet autre ?
La trace est en embuscade.
Tendu à coups de rire,
c’était en force,
le coup parti.
Ce fut un coup d’aile,
il est tout seul dans son voyage.
Il se porte en otage,
sable autant que sablier,
ça coule en délité,
il dit son vertige.
Qu’est-ce qu’il est ténu,
le fil du frein !
C’est venu dans l’apparence.
Avec ses taches.
Tourné vers après.
Vaguement lâche.
Mais c’est dans la cage,
le craint qui sévit.
L’hiver en poche.
Où elle va, la personne ?
Couvert de vie,
tout seul avec son bruit.
Il fait son cœur.
Très lourd de traces,
on vient de loin,
on cherche à devenir.
Il est approché.
C’est en touchant,
dans son langage,
qu’il a formé.
Couvert de vie,
on a du mal à devenir.
Il faut aussi la surface,
la saveur, la plage.
On accumule en abstrait.
Qu’est-ce qu’on apprenait ?
Dans la formule au sable,
c’est obéir au présent.
On se tient court de front.
C’est cousu dans son hiver.
C’est un horizon,
un éternel.
Dans l’étranger, ça respire.
Le bruit du cœur,
ça fait son poids.
J’entends la vie venir.
Elle devient seule.
Mais en entier.
En sable pour les traces.
C’est en soi, la personne.
Couvert de vie,
aux frais des pendules.
L’écran des gouttes
accumule en abstrait.
Le bruit de tout, le cœur,
on veut ce qui se brûle.
Dans le seul de soi,
ça consume.
C’est consommé, le sable.
Qu’est-ce qu’on prend ?
L’eau des traces,
lourd à vitesse,
le sec de cendre.
Accroché à ses traits,
on reste en coin de table.
Rideau de gouttes,
on voit avec les dents
l’insu de la personne.
Il bat dans sa pendule,
le bruit avec son cœur.
Il broie du seul.
Le bibelot fait son travail.
Pas dans le drôle en force,
mais dans le mur de quoi,
avec citerne occipitale.
Etre avec ses ratés,
à cette vitesse,
c’est court de front.
De l’âme en récusé
à l’aigre de la bouche,
il dort en creux.
Dénoncé en faux-corps,
l’enchevêtré désir.
C’est le surplus fabriqué,
avec la liqueur froide.
Il bat son bruit avec son cœur,
ça fait plus d’ombre,
et ça revient, appartenu.
Dans l’insu de sa personne,
l’œil qui pique.
Le faux-corps fait son geste.
Il fait ligament de soif
(on dira que c’est désir).
Entre les poussières,
le bruit de la vitesse.
L’ailleurs de soi,
c’est doux, mais ça bégaie.
Il fait du cœur, mais de loin.
Il bat dans son horloge,
le cœur qui sait que rien.
Il croit que ça débute.
Qu’est-ce qui compte ?
Il croit au temps qui part.
Est-ce que c’est mal ?
Il y a du mal.
Qu’est-ce qu’on perd ?
Il fait la digression,
on ne saura rien
des péchés de la mère.
A quoi on a mal ?
Qui est le donateur ?
Il se rend à son temps,
c’est promis sans presser.
L’instant s’ajoute à lui.
Ne parlons pas de vie normale.
Moins aboli que le présent,
il se donne un longtemps.
Avec du bois de soi,
il fait comme on doit faire.
Ai-je un esprit ?
Corps dans sa coque,
le regard fait son vide.
C’est le désert d’hiver.
Le dévolu se tasse.
On oublie ce qu’on a,
on n’a pas ce qu’on doit.
Au premier bout des traces,
il a du lourd d’effort.
Il se déplace.
Il nage animal avec son jour.
C’est du reclus en déposé.
Il fait masse.
Il fait dire.
On n’a pas la place.
On marche entre les corps.
Dans les sons de soi,
ça fait du fort.
Il ne dit pas pourquoi
ça fait du désir.
On ne sait pas
si c’est pénible.
Il y a du construit.
Qu’est-ce qui se prépare ?
On est dans les habitudes,
ou bien c’est la forme des choses ?
Est-ce que c’est mal ?
Dans le su, le fruit de soi,
le dit n’est pas le cru.
L’insu se défait,
il devient double.
Il fait un autre,
un refrain vague.
Il sort en buée,
en lignes creuses.
Il voudrait faire ou devenir.
Dans le dépôt des traces,
on voit celui qui va,
on ne sait pas le moi qui veut.
Alors le vu devient tordu,
un corps en vague,
avec un vide.
On n’explique pas.
Dans ce qu’il dit,
il ne sait pas.
On fait des plans,
de l’autre en construit,
de l’ailleurs défini.
Si c’est mal, ce qui sera,
on ne sait pas.
L’insu, c’est ce moi trouble,
avec désir à dire.
Si ça résiste à l’après,
c’est moins pénible.
On a cru,
ça fait du reste.
Si tu dis quoi,
tu fais du reste.
Dans ton habit en entier,
tu fais du lourd.
Lent sur le sens,
tu ne sais pas tout.
Qu’est-ce qu’on croit ?
Il faut du beau.
Est-ce qu’on s’y trouve ?
Avais-tu cette ombre ?
C’est ça que tu deviens.
Tu fais le choix des choses,
comme un loup dans les choix.
As-tu le corps en moins ?
Veux-tu vraiment ce visage,
en ailleurs qui convient ?
Le tir à balle,
c’est encore du repentir,
ou bien ça venge.
La vie en clou,
dans le corps terminé.
Est-ce que tu dois quelque chose ?
En autre quoi,
c’est l’art,
ça fait du beau.
L’insu de soi,
dans l’urgent,
c’est le beau du complice.
On sait d’avant
ce qui blesse à découvert.
Quand tu fais ta joie,
respire.
Sorti de mon sac,
je prends l’amour,
j’anticipe.
Il y a long devant,
c’est la course.
Dans sa voix apprentie,
il s’est posé.
Couvert de vie,
ça monte au vertige,
avec droit au désir.
Si tu te dis,
ça fait complice,
ça retient l’eau de l’autre.
Il bat son cœur avec son bruit.
L’aire à repos,
le blanc de la couture.
Il a du cuir en surface.
Il dit pour quoi faire ?
Ce n’est pas un numéro,
ça existe en durée.
Il fait du bruit avec sa peur.
Couvert de vie,
son arbre boit d’avance
à même il est, le courant d’heure.
Dans le noir, il conduit.
Si ça disloque,
il donne en fourre-tout
les mots qu’on exige.
Il fait du cœur avec son bruit.
C’est mesuré.
Dans le noir du fruit,
c’est là qu’il dort.
Il fait corps.
Il fait beau.
Il a du fort en devenir.
Tout en nuit,
dans le froid, ça hésite.
Il a du noir.
Ailleurs, c’est la limite.
Il bat de l’heure
autour du trou.
C’est libre d’aile.
Labeur extrusif.
Il y a du fort dans ce trouble.
L’idée, elle est en bruit,
ça fait du lourd de traces.
Elle est en cœur dans le battu,
la vie complice.
Tout en fond, c’est la cuve,
avec sons vigoureux.
C’est de la voix qui s’étale,
ça se promène en soi,
le corps de forme.
L’idée, elle bat,
elle compte,
elle est venue en noir
nager dans le précis des traces.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
jeudi, 08 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 5/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE V
Le corps du vide,
à bout de traces,
ça résonne.
Il y en a qui nage,
et la citerne efforce.
Avoir été celui,
c'est un dépôt sous l'écorce.
Dans le regard à la coque,
on a du fort qui passe.
Pas de sable avec pierre,
aucun recours dans le jour d'os.
On sait qu'on marche,
et dans le cru du désert d'eau,
on sait qu'on vide
à coups de masse
le corps de dune,
racine de ruines
au bout du vent qui coule.
En dépôt dans le vague,
un alphabet se déplace.
Le pur de langue
se donne en respiré.
Né en cage,
dans le passé.
Trouvé vide,
en bout de jour.
Déplacé dans son vague,
à coups de creux.
Le travers est pénible.
L'effondré reste en désir.
Il faut progresser.
Vers il paraît, ça veut dire.
Il faut du beau.
Dans la cour du vrai,
le corps fait son ombre.
L'avais-tu, ce qui devient ?
Le souvenu, le tir à balle,
c'est de l'ailleurs à repentir.
On a fondu ensemble.
Les sons du sombre,
on a compris la danse.
La voix partie en fleur.
On a l'autorité des traces.
En devenu d'hiver,
la foule ambiante.
Pourquoi plus ?
Si tu mens à la source,
la vie divise.
Si j'ai l'hiver en consumé,
je fais la force,
je mets le doute,
à court d'ombre.
Pourquoi l'entier ?
A fond dans le mordu,
baiser calculé au plus juste.
Il y a du beau,
qui fait lumière.
Ce qui est à jeter,
du bord du monde.
Ce qui résiste,
inflammation,
non la crête du vague,
ni le cadavre en action.
Ce qui pousse au regard.
Il y a la poussée.
Il y a le format d’homme.
C’est un récipient,
ça va s’ouvrir.
Il a l’air métallique.
Le corps de citerne,
avec un cou de sang.
Sous le discours,
la forme du visage.
Le trou savant.
Le fond de vérité.
La cour du vrai
ne fait pas d’éclat
dans le détenu.
Ce qu’il détient
fait de l’œil.
L’hiver de parole.
On ne sait pas que ça se voit.
C’est là comme un front bas.
On sait qu’on va mentir.
C’est l’hiver de parole.
On emporte avec soi
l’accessoire de soi.
Besoin désir,
envie d’envie.
On tourne en travail,
on ne peut pas atteindre.
On va mentir à volonté.
On va confondre.
On n’est pas en sécurité.
Qu’est-ce qui hésite,
dans le propre nom ?
Tu couches les mots,
tu brosses, tu brocantes.
Tu vas dans l’assoupi
combler le spectateur.
Tu te vois à l’écran.
Mais c’est du formel.
Alors tu hivernes.
C’est du sommeil à gros,
c’est plein d’insectes,
avec travail de grouillement.
Ton âme était trop nue.
La couverture à plis,
ou bien le sac d’embrouilles,
ou bien la foule à bruit.
Cousu avec parois,
le couloir fait son corps.
Ma voix, c’est un bras mort,
un couloir liquide,
on voit beaucoup dormir,
avec du froid,
le dos fait des épaules.
Rien ne court.
J’ai l’hiver de parole.
Je suis l’outre.
Je sais tourner.
Je n’avertis pas quand je tombe.
Dans le froid, ça débute.
Je suis pour la vacuité.
En cours de possible,
la porte m’ouvre.
Où je serais,
si je n’étais pas sourd ?
Je suis tout en étreinte,
en vigilant,
dans le captif,
le cru furtif.
Ma foule obtuse,
en pur de langue,
a fait ses trous dans le sujet.
Tu fais du temps,
la vie dans la couleur,
ça coule en portrait.
Envers moi, tu éprouves.
Qui t’a suivi ?
Dans l’hiver de parole,
c’est là, le front bas.
Qui est rapace ?
Qu’est-ce qui console ?
On est en foule obtuse,
en force feinte.
Le cœur courant,
la ficelle à bas prix.
On joue l’hiver en fond sonore.
La voix est cartonnée.
C’est un travail de son.
L’effort au pire.
La flaque de faux.
L’hiver a la parole.
C’est du dédain,
le cœur ficelle,
la farce en seul.
Gare à tant pis,
la cour du poétique,
le fort du vrai,
ça découle avec sang.
Cousu dans la parole,
l’albatros vit seul.
En train de boire à son sommeil,
il forme un vide,
un corps de silhouette de soi
sur fond de chanson.
Avec le corps mineur,
il trime, il fait du contenu.
Rien sur le vivre,
rien en matière à défiler.
Dans l’hiver de parole,
il fait du trop.
Encore avec le sien,
la ficelle à bas prix,
il fait du menti,
de la voix cartonnée.
On a du clandestin,
peu musical,
pas courageux destin.
Amant, ce qui se fait,
à la voix, les coups sourds.
Au fond d’ici,
c’est la ficelle,
le froid de la parole.
Dans le couru du vent,
on fait du sec.
On devient mort,
le même à respirer.
Le cousu d’os,
la foule obtuse.
La cour du vrai,
dans la cloche à plongeur.
C’est qu’il fait froid,
au fond de la parole.
Le menti serti dans du vrai,
le creux de la famine.
Il fait du froid dans ma parole,
je mendie à cause de ça.
Je fais mon minuscule.
Dans le couloir des sons,
c’est la voix voulue
qui manque à mon appel.
C’est au pourtour,
le filet d’encre,
la voix couleur.
Vrai comme un soi
qui vient avec.
Le sourd de veille
se fait rapace.
Le bec de voix
cherche un désir.
On a peur du fond,
dans le menti du corps.
Il est en train de souvenir.
Hiver ivre en parole.
Qu’est-ce qui est fertile ?
Le tu de la figure ?
Le vent qui fait le respiré ?
Le pur de langue ?
Dans le cousu du minuscule,
toute la matière.
La voix sinue en marge.
On a du corps en trop,
et c’est la vie rapide.
Autour du trop,
ça reste à dire.
Un peu de peau
dans le vibré de vivre.
Le corps mineur
est fort de feinte.
L’induit de soi
dans l’oubli couche
fait son retard de cœur.
Tordu de soi,
le cousu coule
en voix couleur.
Là dans la force,
il a du trop, le poétique.
Dans le désert de foule,
un clown avide.
On ferme en cloche
un corps mendiant
qui se dévide.
On cherche en roche.
Entre les frères en peu,
surgit le vide.
C’est juste un cortège,
qui fait la voix
dans le nu du pourtour.
Avec son mort en couche,
c’est le total d’hiver
qui se plie en parole.
L’honneur du pauvre,
c’est dans le tu du cœur,
la ficelle à respire.
Pour le rien du vide.
C’est toi la farce.
Non à dormir,
non à mentir en voix,
non à tension de la figure
autour du trop qui siffle.
A la couleur du feint,
le vu du mort en couche
devient douleur du confus terminé.
Et ça s’entend, le contenu,
avec le thème en corps de voix.
Tout vient autour,
et ça s’amuse.
Dans le central à poudre d’os,
il fait son temporal.
C’est trop tard pour l’avantage.
Dans le froid d’aile, avec vertige,
le lourd a cassé.
Si c’est du vivre sur du rien,
le soi, c’est clandestin.
C’est devenu loquace, on dit,
le pur de langue en dur de chose.
Il fait le respiré du beau,
avec muscle à terre entière.
Il est réduit au corps interne.
A la vitesse du poétique,
il se mime, tiré de son destin
jusqu’au désert de foule.
Le fou de silence, l’auteur de quoi,
dans le triste de la figure,
l’hiver de pauvre, en minuscule,
avec du creux pour immerger
l’intestin clos, corps à plongeur.
Le petit sourd a la raison,
c’est son éternité rapace.
Dans le noyau du fond d’ici,
coule en cousu la voix d’ici.
L’insecte en mineur de fond
(c’est le scolyte avec rayons),
il fait musique d’effort,
il fait travail, il entrevit son corps.
Il doit du son de soi au poétique.
Avec lampyre en grappe,
autour des noms fusés du vide,
il attend la fracture à parole,
ce qui découle en hésité,
le fil de voix de soi où ça résiste.
La vie foisonne,
et c’est l’hiver de la personne.
A la volée de voir,
il faut des gestes.
On a furieux,
le grand vivant.
On se retient de foi.
On dresse un doigt.
La vie fait ses racines.
A la volée, les joncs.
Faut voir le travail des ruines.
Tout autre communique.
Déboîté, le furieux.
La vie se dresse,
et c’est le geste de personne.
Il court le vivant,
racine en vase,
il suit la fuite,
et c’est inextricable,
hiver de la personne.
Il y a trop.
On s’y marche.
C’est gluant défait.
Il fait ventouse,
un pied noir.
Coulé en foi dans sa glu,
le corps désert.
Il fait hiver,
revu en cru.
Qui veut quoi que je fais ?
Que veut qui que je nomme ?
Que peut quoi que je dise ?
Un signal à savoir.
Un silence d’œil.
Un coup de permanence.
La mue d’ignorance.
Le gel.
Le noir de geste.
Est-ce qu’on sait quoi,
quand on scrute ?
Tu veux voir volonté ?
C’est quand, la racine ?
Quand ça moissonne,
c’est en bruit.
C’est dans l’hiver, le fruit,
la couleur pauvre,
le donné.
Dans le pris du plaisir,
ça fait cloison.
La vie foisonne,
et c’est l’hiver de la personne.
As-tu vécu ?
C’est en murmure.
J’ai mon cadavre en pire.
C’est dans le tu
qu’on foisonne.
Avec hiver en face.
Avec savoir qui interroge.
C’est dans le tu de la foison
qu’on vit en cri.
Comment les gens ?
Quand on entend,
ça fait énorme.
C’est dans le tu de toi
que j’attends de savoir.
Quoi franchir ?
On fait cœur,
on fait bruit.
J’ai du cri avec mort d’avenir.
Du cru de moi,
qui attend, su, le soi,
le tu de toi,
l’hiver de la personne.
La vie de moi murmure.
C’est quand je crois à quoi ?
Dans le défait de moi,
ça reste en racine.
Il y a du fort,
ça fait du beau,
construit de vent vivant.
On me vit comme un comme,
c’est de l’interrogé.
A la vue d’écriture,
on a dit ce qu’on sait.
S’il fait du ventre,
c’est dans son propre noir.
Il reste près du tu,
l’insu de soi qui le foisonne.
Si j’ai le noir du mal,
ça fait mur.
Le moi de la dépouille,
le corps du vrai,
la soie de la personne
qui coule en croix,
la vertu du vrai noir,
l’instant d’encore avec l’écrit.
Mouru sans voix,
si c’est le manifeste,
avec l’encouru
(si c’est le risque de l’insu),
ça fait son tort malgré le soi.
C’est moi qui coule en tu,
c’est dur de gris d’en avoir plus.
Avec savoir,
le papier reste.
Il a du corps vorace.
En gros d’amour,
ça frappe au vivant,
ça veut que ça revienne,
en savoir plus.
Si j’ai voulu le quoi,
c’est le rien qui renvoie.
Dans la cour du vrai,
ça joue du cœur,
ça devient mur de mal.
J’ai dur de ventre,
à court de court,
l’imminent fait centre,
et je le suis.
Ma courroie d’air,
c’est dans le fissuré.
En cru d’insu,
en envie d’ire,
j’ai dépourvu l’impire,
le quoi du grand,
quand meurt de soi
l’insecte ou le grossir.
Avec le court de la cassure,
j’ai du malgré dans l’injure,
j’ai fait le douloureux.
Avec le toi de moi,
le rabais de front bas,
le sas que j’insupporte,
on a défenestré le vent.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
mercredi, 07 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 4/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE IV
Le comédien, en corps d’enfant,
meurt à la plume,
acculé à l’hilarité.
Le prédateur attend,
dans son lieu sûr,
le bout du compte.
En retenu, en succédé,
le devenu de l'infraction
comprend le legs
avec son dépôt nul.
C'est un oiseau d'hilarité
qui se tient devant le vide.
Sous l'aile, avec dédain,
l'aliment vraisemblable du secret.
On n'y va pas au précipice.
Avec du lourd dans l'idée,
le nom veut léguer son lieu sûr
au fond d'ici.
Avec la mémoire,
on fait un corps-type,
émergé du mort-né.
Couvert de vies en essayage,
le prédateur a fait concret,
des bruits de table.
C'est un banquet.
Il met fin à l'éternité.
On entrera dans les contours.
Le trou de tout,
c’est pas de l’appétit.
On fabrique en devenu,
ça fait de l’émergé,
la partie chaude en apparence.
L'enfant joue au devenu.
Mais il n'a pas la source.
Comptoir de vain,
des tas de vies.
Ca coagule, pris dans la masse.
On est en gel dans la fabrique.
Le lourd avec des ailes
a voulu dire
avant de consommer.
Dans le trou d'os,
l'occipital d'apparence,
banquet de vies à retourner
avant le quand d'éternité.
Dans le corps-type en écriture,
on a fourni le chaud.
C'est l'appétit de bruits.
On vient pour consommer
le courant dur,
l'hiver de la personne.
Avec jamais,
le retourné de l'essayage,
autour du trou.
Est-ce qu’on a vu le vent,
tiré l’escroc de soi,
escorté la limite ?
Le corps d’escorte ?
Qui sera le fils,
s’il nage en vrai
dans le trou d'os ?
Il erre entre les morts nés.
A court de vie,
il se désigne, il se nomme.
Mais il s'est trompé de foule.
Il a tenu dans son gel
le lourd avec les ailes.
Il est devenu, sans avoir,
le vent d'à-peu-près.
Voyage après le désert d'eau,
il nage en corps
dans le trou d'os,
la tanière occipitale
avec ivresse opératoire.
C’est le couvert de vie
qui reste en devenu.
Avec la soif dans le sourire.
Il imprévoit d’être plus loin.
Il court au fond d’ici.
Il s’amuse.
Travail en bord,
suspendu aux marges.
On attend d'être invité.
Silhouette en suie,
avec trous dans les contours.
Format de vie,
mais celle qu'on cache.
Travail en tige,
avec temps d'incubation.
Vrillé dans le courant dur.
La pierre à souche,
et la formule à faire,
ça fait beaucoup d’écriture.
C’est arrivé en bord,
le pur de langue,
le dur mort en délivré.
On a tenu à devenir.
Travail dedans la nuit,
dans la couleur du corps,
on est le visité de son vivant.
Dans le damier organique,
il déduit le trop-perçu.
Avec le caractère qui finit,
c'est le pourquoi du rien
qui se souligne au fond d'ici.
Dans l’après du parcours,
qui va compter ?
Travail en suie,
avec vie déclarée.
On perpétue la précédente.
Le prédateur voit bien,
la silhouette est vernie,
ça brille avec surface.
Dans le travail en proie,
la personne a fait forme.
Avec le corps complet,
le toit de tuile,
on se reçoit dans le trou d'os.
La joie d'ici est suspendue.
Le bras s'oriente,
l'effort déplace,
ça devient du visage,
tout un travail d'écorce.
Ce n'est plus vague,
ça veut dire.
Au fort des lignes,
on a du mal.
Il y a du construit,
avec des traces.
Le devenu fait son ailleurs.
Le soir convient.
As-tu cette ombre ?
On fait le choix des choses,
Avec idée entre les traces,
On n'est pas né à condition.
C'est tout de suite autrement,
le défi dans les apparences.
On entre avec muscle.
On comprendra.
Muni du semblant,
on se bascule en soi,
on met la forme,
avec travail.
La voûte est ronde.
Les couleurs sont confondues.
Avec la vie, la correctrice.
Imaginons la peur,
en corps coulé,
corps copulé,
ciseau des tectrices.
C'est un ciel.
Le dos du lent
retourne à son portique.
Il a du froid dans l’effort.
Il fait avec son moi,
monument d’imparité,
le nageur dans l'eau drôle.
La force est contenue
dans le trou d'os.
On ne savait pas qu'il faisait.
La courbe d’huile est en retard.
Au fond de la citerne en quoi,
si ce n'est pas le sec de l’énergie...
Je ne dis pas ce qui devient.
Je m'éclos. C’est mon aventure.
J'entends la forficule.
Tour du sommeil
en quarante-cinq lampes.
Le corps se vide.
A bout de traces,
le bord en boule.
Derrière le trop d'hiver,
on a des jours.
Il a mouru, le corps des traces.
Il a raison, l'effort sans masse.
Il a pris le dépôt en marche.
Il s'habitue, il se déplace.
Avec le vide en laisse,
dans son hiver avec la coque.
En vide, il est le souvenu.
Il est d'ici, le désert dur.
La cour du vrai
dépose en alphabet
le respiré de la frontière.
Entre deux vagues de lignes,
j'ai le ciel creux,
avec sa dune en place.
L'effort de corps
se voudrait vague.
Le mal déplie les habitudes,
on confond l'horizon avec plus tard.
On monte à bord des formes.
A travers, ça dérive.
Au bout du corps sans masse,
le désert d'eau,
le mort sans trace.
Au bord du construit,
on dérive, on répare.
Dans la pendule,
ça fait du cœur
au fond d'ici.
A bord des traces,
on se déplace avec effort.
L'hiver du vent,
au bout du temps d’ici,
résonne en suie
dans le courant de la personne.
Ai-je un noyé ?
C'est non, dit le regard en torse.
On est venu,
la dune en marche,
sans laisser le corps
dans son désert d'écorce.
Corps dans sa coque.
Il nage avec son jour,
dans son désert d'hiver.
Corps pris dans sa cosse.
Il faut monter à bord
pour marcher dans les traces.
Corps dans sa suie,
avec progrès, pour la musique.
Le dévolu, avec sa place,
inscrit son vide.
Il reste un son sans masse,
un doigt de plaisir sans voix.
Dans l'autre cas,
on creuse en vif
dans les contours.
Avec le vif, on fait du songe.
Il faut du fort.
La forme en douce,
un corps de fort,
projet défait,
dessin libéré de quoi ?
Je dors en frousse,
le cœur court après moi,
j'existe en douce.
A force d'ombre,
en vision crise,
je compte en clair,
à la chaux vive.
J'ai du final
dans les nageoires.
Trouver le trou dans l'origine,
ça ne délivre pas du grave.
Il y a du gel.
On ne sait pas ce qui se nomme.
Le caractère est trou,
à travers du pénible.
Un os de forme.
On se répare.
Il faut du beau.
Comme un loup de visage,
dans le choix des choses,
on se doit un ailleurs,
le temps a trouvé son ombre.
Autour de l'os de forme,
voir comment ça danse.
On voit, à fleur de son,
le capturé, le tu, le coi.
La flore occipitale
vient de source chaude.
Les poissons courts,
en trébuché de soi,
font de l'ivresse.
Ils jouent avec la conscience.
On est au confin.
S'il y avait du déplaisir,
on sait que ça bascule.
Autour de l'os de forme,
on s'entraîne à consentir.
On est le devenu, le divisé,
le possesseur de quoi,
le trébuché du tour à tour.
Dans la cour du vrai,
le soi du sexe, avec désir,
et le trouvé, avec son doute,
incite au corps.
De l'effondré aux habitudes,
il y a du construit.
Qu'est-ce qui se répare ?
Rendez-vous en fin de ruine.
Il faut du beau,
la ruine est un caractère.
On fait le choix des choses
avec un corps qui se devient.
On fait du repentir
avec le dos dur,
mais le visage apprenti.
Friture dans la cour du vrai.
Courir en moins,
dans le sec de nage,
la fleur occipitale.
On danse avec le tu,
le dit de moins,
ce qui rit en sombre.
Depuis la capture,
on a cueilli.
On a gardé le son des traces.
Dans la pensée, on a des chances.
A la surface, on voit le fond triché,
la couleur molle en conséquence.
Trait dur, cœur court,
la parodie défait, refait
le coup de l'ombre,
la ruine en cours.
Il fait le destiné,
le mort en contre,
un tour de forme avec du digne.
Mais il faut plus de libre.
En répété, en prolongé,
on a grossi la solitude.
Dans son respect,
travail tiré de soi,
ça consiste en deux lèvres,
la joie.
L'introuvé, dans sa cache,
depuis le corps du vif,
la sonde à cris,
attend sa forme.
L'arrêt du son,
friture en ligne,
à fond l'effet.
C'est toi le double
à court d'acquis.
Vis ton mortel
en fort de trace.
Ton résistant se porte
avec du trapu dans les pointes.
La frontière à bout d'acte,
la tour de vie touche au bord,
la boussole en pierre.
Avec la mort nocturne,
l'étrangère en bruit,
il reste un lien.
Je me respire en suie,
un ornement du nu
qui se retient au mur d'après.
Tu comprends pur
le choix des choses.
Avec odeur de vie.
Donne ton nom en entier,
avec urgent,
le blanc s'accroche.
Mû par son nom,
le mort en suspendu.
C’est son être qui rit dans l’encore.
En eau drôle,
à refrain de fabrique,
l'oiseau s'éparpille.
En alouette à voix,
l'envers du vent s'aiguise.
Il s'agit de serrer du soi-même.
Il s'agit de fatigue,
au bord du courant dur.
Je regarde occipital.
Le seul blotti qui prend son être,
c'est un peut-être avec du temps.
L'assourdi part en souffle,
il appartient au coi,
l'introuvé thoracique,
il sait le tu,
il attend dur.
Le droit d'y voir,
dans le désert de forme.
Dans l'effondré,
c'est la dérive.
Le réparé fait sa carcasse.
Il faut du beau,
peut-être du visage.
C'est dans le désert d'eau,
la flore occipitale.
Le temps maintient le ciel
en ordre vague.
Dans son hiver,
le fond des traces
n'a pas la force.
Trouble-moi,
dit son ombre.
A coups de forme,
on est monté.
Jusqu'en lumière,
on a joué.
Dans l'acquis du non-dit,
le muscle fait semblant.
Il faut que l'autrement du mort
progresse en sorte de matière.
L'indécis reste libre,
mais ce n'est pas un monopole.
A court de chair,
le digne se défait.
Il y a du construit.
Un courant dur traverse.
Le fort est basculé,
le songe a suivi son réel
à court de chair.
Dans le mécanique des contours,
on a trouvé de quoi.
Le pur de langue,
c'est le respiré.
Il a trouvé en dur
le quoi des choses.
Il voulait de l'insu,
du tu, de l'étranger.
Il restait des liens.
Le pur de langue,
c'est un muscle.
Avec le beau de l'ordre vague,
il faut du fort.
Il a le respiré.
Le dur de mort,
en terre entière,
avec des noms,
il a l'envers,
avec poème en peur.
Le pur de langue,
il a tout fabriqué.
Avec sa peur.
Entre deux fatigues,
sans se regarder.
Il a tout son temps, le thoracique.
Dans le seul du profond,
le dur de soi résonne.
Un cœur monnaie courante.
Dans l'hiver de la parole,
on se retient d'amour.
Le désert d'eau,
le cœur de libre,
la ficelle à bas prix.
Qu'est-ce qui répond ?
Le regard ? Le reflet ?
La voix blanche ?
On voit l'intime.
Mais dans l'écran,
l'actif de vie,
c'est le confort qui déborde.
Au promené,
le corps extrême a débranché.
Pourquoi l'intense ?
Le délivré.
Le cours de l'air
ne fait pas nul.
Pour un ouvert,
combien de fissurés ?
A moitié eau,
le paysage en tort.
A fleur de flaque,
le débranché.
Dans la fenêtre,
un sommeil fort.
Qui tu vois dans la foule ?
Avec redit de la parole,
j'ai fait l'intense.
On est rebelle.
Vêtu d'extrême,
le devoir onirique.
On fait du corps
comme on branche un sommeil.
Là où le pied d'espace,
au cœur de moi,
franchit le sec.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
mardi, 06 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 3/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE III
Où suspendre l'abandon ?
Le vase olivâtre et vain ?
Il est lucide.
Il a quelqu’un sur la chair
(il dit à vif),
c'est la vive à tendresse.
Le comédien se fait servir.
Il se sert.
Il consiste à flotter.
L'enfant consiste en soif.
Reconstitué, posé moineau,
il fait le fil de lame.
Il joue à l'abandon.
Il vaut mieux l'automne.
Il veut un front.
Le trou de nage occipital.
Pétri violent,
le dos d'armure.
La corde à loin.
Il boit à la citerne,
au fond du lieu.
Il joue ses illusions.
Il a besoin du comédien.
Ca serpente en lucide.
Mais pas avant la vie.
C’est quand, la prochaine ?
L'illusion encore vierge.
Pas longtemps.
Ca peut mourir avant,
en attendant la bouche.
On a beaucoup nié,
en espérant la chair,
celle qui fuit.
On a pétri avant de dire,
avant la bouche à mots,
les frottés à la chair,
pour grossir la foule.
S'il dit c'est vain,
ça fait violent,
tout lent à revenir.
Pour les diverses mères,
en équilibre à la seconde,
ça fait de l'appétit.
Des bouts d'hiver,
des corps d'ennui.
L'intime est vide.
L'enfant dans le violent,
construit du désordre.
Il joue à l'ennui.
Le comédien connaît le mieux.
La foule inclut son corps,
sa dérive en bord de vie,
son déni, son désaxé.
Pour celle que je connais
(l'ivresse à dénoyer),
il a fallu du sel,
de l'eau violente.
Le vrai d'hiver,
c'est le corps médiocre,
le bord du vide.
Pour celle que je connais,
il faut pétrir.
J’ai vu sur ses mains d'ennui,
les traces de l'équilibre,
mais sans vertu.
On n'a qu'un corps salé.
Dans le cours de l'ordre,
j’ai deviné le caustique.
Dans le corps nu du vide,
j'ai trouvé le violent d'ennui.
Pour celle que je connais
(c'est le mieux pour un bord),
j'ai respecté cet hiver.
Celle que je connais
meurt en appétit.
Elle fait de son corps un bruit.
Un son d'artère avec des noms.
Le nombril est ouvert.
Le ciel est atteint.
Le temps se retient.
L'équilibre a rejoint le violent.
Les mains sur le vide,
j'ai dit aux diverses chairs
un poème d'ennui.
Pour celle que je connais,
j'ai redressé le corps,
dénoyé d'avoir bu.
Dans le cours violent,
sur le fil de lame,
j'ai redressé l'hiver de parole.
Un peu d'ordre entre les vides,
avec les diverses claires.
Tout près du bord et du déni.
Ce n'est pas pour l'intime,
l'étang salé avec ses morts.
Le trou de nage occipital
flanque son enfer dans le médiocre.
Il est né cassé.
L'enfant reconstitué
revient du comédien au corps.
Avec les mains du vide,
il a dénoyé,
compté jusqu'au nul,
après avoir bu son caustique.
Il faut laisser.
Le cou se casse.
L'ordre est petit.
La bouche a fondu ses lettres.
On a pétri violent.
Je n'ai pas vu la poésie.
Avec ses façons de fontaine,
ça coule en tort.
Il faut d'autres sillages.
D'autres sortes.
Nager dans l'eau drôle,
ça fait du sang de soi.
Il faut compter la tête.
Je n’ai pas cessé l'aurore.
Le trou de nage est dégrisé
avant d'avoir la vie.
Couchée dans son langage,
l'herbe à force
et la terre à figure.
Avant d'avoir la mienne.
Couvert de vie.
La vie est vraisemblable.
J'ai acheté le don d'errer,
ça fait barrière,
mais ça guide.
Le creux de la matière,
le poids des formes,
les impressions de vertige.
Je déferai mon infini.
Entre deux drames,
j'essaie des ventres.
J'entasse les moyens.
J'ai la raison.
Couvert de vie,
j'ai la lisière.
Rien de continu,
c'est par instants,
j'entasse, j'attends.
J'erre entre les moyens.
Ce n'est pas bête, l'inaction.
A partir du moment,
c'est le premier marasme.
Le vers vibre, inoculé.
Je tourne autour du spasme.
Je prends l'écoute.
La vie est vraisemblable.
C'est l'existence.
C'est l'âpreté.
La colonie des bêtes.
On s’est fait en soif.
Pris dans l'instant,
c'est en soi ferme.
Dans la cour de vrai,
soumis au cœur,
les appétits.
On s’est fait vraiment.
On a couru.
C'est perspicace.
Pas de confident.
Autour de la vie pire,
on a défait mon infini.
Après tout, l'appétit,
pourquoi le poids fait mal ?
Infirme à l'autre bout.
Le courant dur,
c'est qu'on affirme.
On écoute en carré,
la douane occipitale.
En prélevé sur le vertige,
on fait de la raison.
On en tire un propos.
C'est pour mieux faire.
Il y a des dégâts,
mais on a l'écoute.
On pourrait peser,
mais c'est mal.
Le temps, on le voit pas.
Ca fait la poésie.
Une sorte de dégât.
L'idée du bonheur.
L'œil en barrière
gère le moi,
c’est secret.
Il y a la raison.
C'est un métier.
Constat de nuit.
Plus libre en horizon.
La douane occipitale
a besoin de ses ruines,
pour garder son vertige.
Mais c'est invisible.
J'ai proposé la poésie.
J'ai écouté la fête avec le moi.
J'ai deviné les solitaires.
Avec le front de rien,
ça ne veut plus.
On fait entendre.
Je demeure en besoin.
C'est quand j'écoute,
que je prends la raison.
C'est quand tout le monde a,
que je déduis.
Ca fait constat de nuit.
Comme un métier.
Je vis en dire.
Si tout le monde a.
J'ai le fruit marin,
le besoin digne,
dans le dégât.
C'est l'idée du bonheur.
Tout le monde est en ça.
La poésie, c'est à midi.
Toute en vertige.
Quand la frontière est dans le moi,
le solitaire est poursuivi.
A la façon du fruit,
c'est dit.
Le métier de l'horizon,
l'appétit couvert de vie.
Un métier pour l'apparence.
Il ne veut plus, le solitaire.
Il demeure,
encore un peu détruit.
Le métier d'idée
ne sort pas du secret.
Au bord d'avoir,
on veut saisir la caresse,
même en seul.
Tout le jaloux du moi,
il fait un vent, du c'est-à-dire.
Courageuse en faute,
la foule accède au mal.
Le moi fallu
cultive un corps
au fond d'ici.
Tout le moral du faux
cultive un moi,
dans son jadis perdu.
Il paraît clair
quand c'est puni.
Mais il revient.
Dans le quoi du jaloux,
c'est en faute.
Il a du calme avec métier.
L'accroupi aquatique,
c'est du corps incompris.
On est dans le perdu.
Le c'est-à-dire du jeu,
on le corrige en vent.
Ca devient comment faire
pour avoir la caresse.
Tout le perdu du quoi
se tait dans la foule,
dans le moi triste.
Tout le puni devient pourquoi,
et le moral accède au vertige.
Je tiens l'idée de cette solitude.
Dans le jaloux du faux,
on a le désert d'eau.
Le comédien s'attroupe.
L'enfant reconstitue.
Le trou de nage occipital
cultive un horizon.
Il pense avec,
mais pas assez longtemps.
Cousu en clair
sur le corps du puni,
le calme a perdu moi.
Tout en jadis,
l'encore du jeu de soi
vadrouille en pénitence.
C'est un désert.
La foule accède au seul.
C'est l'attroupé qui s'enfuit.
Dans la cour de vrai,
ça vient du corps caresse.
Au fond d'ici,
je rends la science au solitaire.
Dans son désert appris,
le vent n'est pas facile.
Il faut le tri moral des sortes,
- j'entends la science.
Je prends avec.
Au fond d'ici,
le c'est-à-dire.
L'idée, si je la rends,
je reste au fond d'ici.
Assis dans le désert de foule,
dans l'accident moral,
solitaire avec du vertige.
Autoportrait en science.
Il fait du vent,
de l'hôpital de sens.
Avec son animal,
la vie du premier corps,
la vie de l'existence.
Serpent de suie,
le visage a dû parvenir.
Odeur de panse,
au fond d'ici.
Premier sens du sommeil.
A qui doit-on se repentir ?
Au bord du mauvais rôle,
j'ai la coulée.
La vie dormie,
c'est le visage,
du côté qui sait.
J'ai la vie sans.
J'apprends le temps,
le vent dans l'animal.
Traduit du premier quoi,
le vers vibre
avec le soi du rêve.
Longtemps seul,
mon vertige.
Pour qu'il soit en désert,
il va à ce qu'il pense.
La foule accède au vent.
Le rêve a pris.
Sous la morale en tuile,
la route à mots.
Une sorte de poésie.
Je lui dois un visage.
Celui qui vit.
Trou dans l'écume,
indice de bois,
structure en surface.
Travail en suie
dans le soi pâle.
L'insu du sale,
il fait sa silhouette,
trou des contours.
Visage en sommeil,
à qui dois-je ?
Le douanier des traces
a le sens du péché.
On erre entre les gestes.
Silhouette en suie.
Au fond d'ici.
Le trou dans les contours.
Il est sonore, cet âge,
et le langage en sort,
avec du requinqué,
pour la vieillesse.
Un peu en lumière,
on fait tranquille.
Dans la misère adverse,
ça manque en figure.
Ce sera la vie grave.
Le trouble a du sens.
Planté de trous,
franchi d’armures et chevaux,
dans la vitesse de l'eau,
le douanier des traces.
Mais il faut débrouiller.
Dans le trou de l'image,
la forme fait.
La mère adverse
a la vie grave.
Le trou dans l'eau
n'a rien à déclarer.
Comme un théâtre,
où le voilà visage,
voici celui qui doit.
C'est trop de forme,
avec trop d'ombre.
Qu'est-ce qui se tait ?
Pas la lumière,
ni le profond.
Dans le profond du vrai,
ça murmure,
le trou du sens,
il se refait.
Voilà le doux,
c’est du facile,
s’il fait son climat.
Le comédien fouille
entre ses tempes.
L'enfant reconstitué
traduit la cour du vrai.
Le douanier de trace
- le corps de nage occipitale -,
fabrique en langue
un lieu pour soi.
Du conscient trouble.
On sait à quelle vitesse ?
Et si je communique ?
Le corps est corrigé.
L'animal est prêt
(le dingo des tropiques
vit en société
et n'aboie jamais).
Il n'est pas dans l'hiver,
le temps du vrai de soi.
Il est au fond d'ici.
La vitesse du cou,
dans le trou de nage,
c'est le corps du sang.
L'occipital fait route.
Dans le perdu mimé,
le temps du trop,
avec sa poésie
- c'est le verbe être.
Tiré de son destin,
avec la peau qui pique,
dans la citerne autour.
Je marche en bord,
couvert de suie,
j’attrape un fond d'ici,
mais ce n'est pas la forme,
avec l'encore du temps,
le trop animal qui fragmente.
Il sort de son avenir
du compliqué.
C'est du visage en creux,
de la vitesse en traits.
Face à la mère adverse,
combat à l'intérieur du nom.
L'aliment de l'abandon.
Le désert d'eau,
le territoire en sec.
On tourne en biais.
La poudre émet les traces.
Ce qui survit
se crée sans avenir.
Le loup des choses en tort
erre entre les formes.
L'enfant cassé en blanc
devient musique.
Le comédien attrape un corps
entre ses tempes.
Il consiste en trop.
Couvert de vie,
le prédateur.
C'est la vie mitoyenne.
Celle qu'on a,
la cerclée en dedans.
Là où on est semblable,
on devient l'aliment,
dans la vie vraisemblable.
L'idée, c’est dans le corps désert,
la minute à secret,
le territoire aux traces.
La lutte a vidé les noms,
déposés en lieu sûr,
loin de leur amertume.
Vite au grenier du sens,
on revient des contours,
le prédateur en bloc,
douanier des traces,
Il est le visité.
On fouille en nage occipitale
la citerne à froid sûr,
la stèle de vie-vite.
Dans l'aliment du corps secret,
on a déposé l'amertume.
Le travail au secret
dans le vide avec lourd.
L'ami dédain,
le complice en angoisse.
Du mal avec l'autre.
Et le travail en suie.
Pourquoi tout le givre en oiseau ?
Le travail d'aile avec corps,
on suit le prédateur.
On veut vider les noms de leur combat.
Le témoin dépose ses minutes.
Lieu sûr au fond d'ici.
La vie sort de son legs.
Infraction par les aliments.
Couvert de vie,
le nom se tient en aile,
avec tout son travail de corps.
09:03 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
lundi, 05 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 2/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE II
Pour y monter,
passer par l’infirmité.
Mais pour trouver la mère,
détacher une à une
les ventouses.
Brûler sa propre cendre.
Le ventre céramique
a vernissé la cicatrice.
L’objet de l’art,
c’est la vie-vite.
Il reste en doute,
mais c’est ouvert.
Il reste en sursaut
le corps de la matière.
Alors c’est du présent,
pris en soi-même.
La poésie comme on fera
sera dans la photo
comme un ventre où ça brille.
On claquera des dents
si ça refuse de s’ouvrir.
Bien avant la naissance,
on a ressemblé.
On prendra part ailleurs,
on fera soi la profondeur.
On aura dit la vie-vite
qu’on a trouvé dans l’organique
l’âme instinctive.
L’infirmité,
sursaut de la matière,
aura trouvé sa mère.
Dans l’urne assouvie,
la cendre aura brûlé,
verni le visage
(ou bien verni sans le visage),
y compris la dorure.
On rassemble soi-même,
frivole à force de transmis.
Veux-tu ratisser ?
Il y a trop de feuilles.
Est-ce que tu peux haïr ?
Sois cher,
montre-toi.
Garde-toi bien,
grandis, nourris ton être.
Continue à faire.
Tout est petit dans le jardin.
Crois quand tu dis.
Avec le fond du noyau,
enterre le reste.
Le geste est sombre.
La nuit a peur.
On te dit d’avoir peur.
La nuit massive aussi.
Tu offres le geste :
garde la pulpe.
Tu te nourris,
tu respires.
Sois cher.
La vie résout.
Une sorte de poésie
a l’air de s’inventer.
On passe en éternel
tout ce qui fait hurler.
Cœur de forge,
où ça coule en dur.
L’épilogue du père et de la mère,
hors de leur propre détresse,
c'est leurs tempêtes et leurs cruautés.
Si tu es en paix à regarder le monde,
tu gardes les regrets
(c'est déjà beaucoup à supporter).
Encore un ventre,
avec des os.
Maladie en hiver.
On est dans un couloir,
on est en cage.
En tout cas c’est un crime.
On s’afflige.
On est flou.
Il y a des larves,
pour qu’on aille à la pêche.
C’est en sommeil, la main.
Le jeu pudique, le lendemain.
Un espace à chercher.
Qu'est-ce qui nous fait ?
On pousse, on geint, on demeure.
Est-ce malgré soi ?
On frotte.
On attend l’amer,
le lucide.
Qu’est-ce qui me tient ?
Je marche ensemble.
Coiffé courtois,
je nage occipital.
Barbe en rocher,
bourgeon de dune.
Le bouquet mou.
Je vis en tiède,
je tiens un bout.
Le bon de l’œuvre,
c’est la mare écoulée.
Le fardeau vole,
et le vol est spectacle.
Quelqu’un dans l’assemblée,
dans sa tanière occipitale,
se fait à ma place.
Ce qui me coiffe,
c’est le fardeau.
Qu'est-ce qui me tient ?
Dans l'assemblée où je marche,
je suis ensemble.
Les dunes épointées,
leur courtoisie courante,
la mare occipitale,
ça bourgeonne en bouquets mous.
Je vis en tiède.
Sous le fardeau,
j'ai le spectacle.
En bout de compagnie,
je tiens des mots fermés,
ceux qui n’ont pas servi en corps,
mais ça germe.
Derrière les volets,
les corps merveilleux.
Dans la mare occipitale,
le dytique et la notonecte
font des fruits.
Qu’est-ce qu’on entend ?
Le ver dans le fruit,
la fièvre à la viol-vie cuite.
On est dans le soi d’ici à là-bas.
Le gobelet un peu fébrile.
Le creux du soi d’ici.
Le dévidoir de centimes.
Tout en fantaisie perdue.
Le creux de joie d’ici.
La compagnie qui signifie.
Le ver dans le fruit d’ici.
Il dit le quotidien.
Il perd de vue.
Il parle de palissades,
de chantiers éteints.
Qu’est-ce qui sert ?
Ce qu’on entend ?
La vie prépuce ?
L’ankylose ou la perte ?
En compagnie du corps,
on dévide les centimes.
C’est le chantier,
le fruit véreux,
le quotidien.
Pas de paroles :
les mots sont,
les sons phrasent.
Qu’advient-il quand on peut ?
S’il faut rester pour être,
ça devient dur de tenir.
Ou alors on l’a bien connu.
On est le rendez-vous.
Le carnet à souche.
La pierre à formule.
L’action en compagnie.
C’est un palier avec des choix.
Le pénible est connu.
On fait des traits.
On confond. On étale.
On fait erreur.
Dans la cour close,
ça souffle.
Rendez-vous en compagnie.
On fait des progrès.
On se plaint.
On additionne.
La formule, on fait pas semblant.
Dans la citerne occipitale,
la pierre a souffle.
Qu’est-ce qu’on veut ignorer ?
Il est clos, pierre à pierre.
Il n’est pas en courage,
il est en songe.
Il fait du trait
sur le palier du choix.
S’il confond,
il a dur à tenir.
Il a du songe.
Il défend la formule.
Il a perdu le souvenir.
Déjà la mare occipitale.
La nage d’ignorance.
Il a beau signer l’air
de la main qui affronte.
Le rendez-vous,
la pierre à souche.
Feu la formule.
La fabrique à songe,
ou l’action cannibale ?
C’est en progrès.
Je fais des traits.
J’ai confondu les souffles.
Je n’étais pas en courage.
Dans la citerne occipitale,
le trou de nage,
pour être en libre.
La forficule en finit
(travail de nuit) :
elle agite en vain sa pince,
à quand le trou d’oreille ?
Pour le souffle à venir,
c’est un palier.
On compte entier
le corps pénible.
On ignore à quoi tend
le signal aparté.
Ma force attend le parricide,
mais ne lèvera plus la main.
C’est l’hiver à la formule.
Il a intérêt, le destin !
C'est l'hiver de parent.
C’est part en part l’hiver.
Le fer à souche.
Il suffit qu'il soit
(distance à parcourir)
pour devenir quoi ?
En plein courant,
le fond de cale,
si c’est possible.
A soi parent,
l’hiver de forme.
En plein contrat,
le rideau front.
L’effort vibré d’encore,
rendu à la distance,
si c’est possible.
On atteint en frisson,
on recompte les gouttes.
On a mis des anneaux.
Quelque chose de fort,
le droit de se détacher.
Laissant le rêve en goût,
c’est loin à parcourir.
Un brin de mèche,
en fort de soi,
- le fort du goût, le rêve -
a parcouru la main de brèche.
Est-ce que ça montre
par quel fond c’est devenu partout ?
Et ça montre si c’est possible.
Si c’est quel soi qui rit,
quel caractère en cri,
quel mètre on a couru.
On vibre en main très longue,
on fait l’effort de recompter.
On est devenu si.
A condition d’encore.
En plein parent,
c’est devenu le goût :
on apprend le possible.
La misère à mesure,
le poids de la méduse
en plein sombre.
D’ailleurs et d’ombre,
au demeuré du corps,
l’enfant reconstitué.
D’ailleurs et d’orifice,
le corps en médusé.
Le soi parent panache,
le moi qu’il dit en braille
a quelque chose de fort.
D’ombre et dépossédé,
à soi maturité,
le plein du fond en détaché,
avec le toi dans la surface.
Il tombe en fleur,
l’enfant médusé.
Le toi reconstitué
a quelque chose de fort.
Juge impossible.
Dans le soi sombre
avec parent dépossédé,
en source pleine.
Le jour en fraude,
corps en surface,
et l’orifice en source pleine.
Le jour en demeuré
panache avec blessure
dans le fond de soi sombre.
L’enfant reconstitué
la brasse en vue de guérison
du corps momentané,
avec la source pleine.
D’ailleurs et d’orifice,
on entend les fleurs franches
et l’arrivée de la surface en clair.
D’ailleurs et d’eau coulée,
la guérison arrive en source,
et donne à l’ombre, en demeurée,
le baiser d’orifice
la mélodie attentive.
Dans le sombre où je déteste,
je peine au corps médusé.
Mais en fidèle ailleurs,
le corps prétexte a fait fleur.
Dans le cri des orifices,
l’enfance au demeuré
se blesse au blanc,
le baiser, l’ombre en surface,
le fond en fraude.
Reconstitué sans bagage,
l’enfant surface a repeint l’officine.
Quelque chose de fort s’en détache.
Je suis le cours de ce complice,
l’inégal relief souterrain,
les contours du moment,
l’infirmité des sons dans la façade.
Il y a de l’aimable.
C’est une infirmité à vivre.
Pas tout à fait un crime.
Comme une fabrique.
Vécue pour la sonorité
la flamme est dans les plis.
Corps fendillé.
Une lourdeur compliquée,
un pétrole à profondeur.
C’est un souterrain à conduire.
Pas exactement une aubaine.
Presque une offrande.
On compte les fleuves.
C’est minuscule.
Et jamais en façade.
C’est une secousse à deuil,
pas forcément de la mémoire.
Une sorte d’amphore.
Une figure en façade.
Un genre de chien à l’intérieur
(qui est le thylacine ?
où l’otocyon se conçoit-il ?).
C’est un format de l’existence.
Jamais plus de deux
à comparaître.
Jamais plus d’un fleuve dans le deuil.
Comment porter ?
Combien offrir ?
La naissance incurve.
C’est un autre souci qui fonde.
Dans le trou de mon deuil,
j’entends claquer la voix façade,
la voile enfreinte au neuf du corps.
Jamais je n’ai.
Si je porte, j’entends.
Si j’ai voulu, c’est la mémoire.
Il y a de l’ailleurs dans l’autre.
En habit de voix,
ce sont les chiens.
Ils ont le deuil en souterrain,
la porte des contours.
C’est ce moi forcené ?
Je suis le nain lardé,
à coups de coups,
dans le matin vibré ?
Un kriss en lame nue,
à nu de voiles ?
On confie sa vie,
et puis on la dispute.
Et puis on la confisque.
L'autre souci,
en grotte occipitale,
nage en marin dans la citerne.
Le marmot nain
consiste à définir.
On ne sait pas combien il faut un autre.
C'est le rire de l'existence.
Un bras fort dans l'eau drôle.
La lame est ronde.
Quelques points du passé.
Du descendant à la défense.
Du fou d'amour
au processus de danse.
De la concubine au bonheur.
On dort dans le souci.
C'est le nain forcené qui cogne.
On a des vies à convoyer.
Entre gargouilles, on se convie.
Le bonheur est introuvé.
Encore demain je suis.
Je vis dedans.
C'est un fou, c’est la demande.
Le matin, il consiste.
C'est dans l'autre souci
qu'on serait fort de rire.
Mais est-ce que les yeux sont en voile ?
On s'est forcé à savoir.
Pourtant, dans le profil de chat,
ça s'entrelace en autre.
Il y a du travail.
Le lieu s'énerve au passage.
Il est en existence.
Pourquoi on est réduit à la vie ?
L'occipital aussi ?
Je suis matin,
avec du froid.
Couvert de vie,
le comédien.
Le marmot nain syllabe.
Avec le grain du lieu,
ça fait un bruit de sans défense.
J'ai midi cousu.
C'est le complice.
J'ai la pilosité,
l'énervement.
De profil, le lieu en carcasse.
A son tour d'ignorer
le pourquoi de l’emballage.
Couvert de vie,
le courant dur,
comme un complice.
Je possède l'hiver du lieu :
c'est l'ignorance.
On a cousu le corps en cage.
C'est un délai physique.
Toujours trop court,
le vrai ne saigne pas.
J'ai la fonction du trait,
couvert de vie,
le front dans les coutures.
En possédé,
j'ai le profil.
Le trou de nage occipitale,
c'est la carcasse,
avec la même excuse.
En séparé dans le trop court,
je fais du vrai malgré.
Ensuite on a donné.
Dans l'eau de mer,
le comédien sans illusions.
Ca serpente dans ses illusions.
Il pense au prochain.
Commence à pétrir violent.
A se frotter la poche à air.
A coups de torsions,
dans les méduses,
l'enfant reconstitue.
Il fait la faille.
C'est dans son désert d'eau.
Il faut un moteur.
Il a pétri violent.
Il joue au moineau,
à l'envolée.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
dimanche, 04 mars 2018
MON PRINTEMPS DE LA POÉSIE 1/7
LIVRE TRADUIT D'UN PUR DE LANGUE I
Je ne suis pas poète. J'avais pourtant donné quelques courts extraits d'un ouvrage que, faute de mieux, j'avais appelé "poétique". Cet ouvrage, achevé en 2003, était le distillat d'une épreuve morale qui a creusé en moi des ravines et labouré le champ de ce que j'étais pour y semer un grain que j'ignorais alors. Enracinée dans la mort de quelqu'un, cette écriture a vu naître celui que je suis devenu. Son caractère expérimental n'échappera, je pense, à personne (sachant ce que je pense, en matière d'art, de tout ce qui ressemble à de l'expérimental : on n'est pas à une contradiction près). Elle a eu l'honneur d'assez "déconcerter" (c'est le terme qu'il avait employé dans la lettre qu'il avait pris la peine de m'envoyer) le défunt Paul Otchakovsky-Laurens pour que ce grand éditeur de poésie s'abstienne avec courtoisie de la publier. Ce manuscrit, je le donne à partir d'aujourd'hui dans son intégralité. Sans illusion. Sans état d'âme. Comme un état de fait.
Techniquement, la composition de l'ensemble repose sur un pari sonore : priorité aux consonnes. Et sur le corollaire de ce pari : l'éviction aussi totale que possible des "e" muets. Je précise que cet aspect formel est moins le résultat d'un choix qu'il ne s'est imposé, comme s'il avait fallu donner aux mots la rudesse d'un flot tourmenté, à l'image de mon âme à ce moment. Quant au titre, il s'est donné tel quel, de lui-même. Il en résulte peut-être une musique âpre à l'oreille, mais comme on proteste contre un destin : on sait que c'est en vain et on le fait quand même. Le tout, du moins est-ce ainsi que je me raconte l'histoire, est moins fait pour être lu que pour être parlé.
Le corps du texte se déroule en continu sur soixante-quatorze pages, auxquelles s'ajoutent une dizaine d'autres, pour la "strette", la "coda" et le "postlude". L'ensemble a été ici segmenté – au hasard – en sept (trop) longs tronçons à peu près égaux.
****************************************************
Besoin désir ?
Ou bien envie d’envie ?
Envie d'ouvrir,
mais c'est compris :
il faut attendre.
Une envie faite à réfléchir.
On entend, ça gronde.
On absorbe, en raideur,
le démarré de quoi ?
L’autorité, ça sait,
et c’est toujours ailleurs.
C’est déjà dans un ordre.
J'affiche un air,
quelqu'un d’ailleurs saura.
Imprimé à contrebande.
Un peu, pas tout à fait.
C’est un peu sincère.
On se garde à point.
On calcule avec nombres
(y compris celui des gravats).
Ça fait des plans, des empilements,
des tas de conditions.
Alors, par quoi commencer ?
Quand on voulait, c’était ouvrir,
c'est pas le mien, peut-être.
Construit à cause.
Un peu blindé, la pierre à souche.
Du vrai qui sait qu’on meurt.
Avec l'envie d'aller,
d'en prendre un autre.
On n'en manque pas.
Mais c'est sans preuve.
Qu'est-ce qu'on a donc ?
Envie d'éveil.
Je crois l'avoir.
Alors je pousse encore,
mes tisons font la fièvre,
mais j'ai donné sans preuve,
j’en suis réduit.
C'est que s'il faut que oui,
on sort de soi,
ça ne prend pas.
Hors du somnolé, on se confie.
On s'expose en envie.
Quelque part, quelqu’un sait ?
Mais quand même il faut.
C'était l'envie. Qui est là ?
Lui aussi, ça doit rester.
Il faut que oui.
Tout retenu dans le pli,
perché tout près.
Sans forcer la main,
sans faire esprit.
Voilà, ça vient se dire.
Pas trop de peine.
Qui vient symboliser ?
Qui fait priorité ?
C'est l'envie.
Mais du coup, ça fait tout.
Tout vient ensemble.
On a pas mieux.
Trier, ça éternise.
Avec le temps,
ça fait du vent.
On a voulu savoir,
mais c’est au saut du lit.
Et pour savoir un peu,
on fait du doute.
Dans le clair du dessin.
C'est l’attention, avec du mou.
Est-ce que ça rend heureux ?
Envie d'ouvrir, allez,
quelqu'un qui fasse.
Si on peut pas, alors quoi ?
Etrange et bas, le sûr se tait.
Je dis les bribes.
Mais l’entier ne cesse pas.
Le temps vient après tout ça.
J’entends l’existence.
C'est en forme de fin,
dans le conflit, on entre en parole.
On n’est peut-être pas.
Ecrit à l’endroit fort,
transparent sur l’opaque.
Sans repentir, entre la forme et la fin.
En action pure de langue,
forme à tout prendre.
On fait de la personne,
en vie, du foisonné.
C'est le cœur contre,
on doit s’y rendre.
La formule est en presque.
Ce n’est pas là, le diverti.
Qu'est-ce qu’on a ?
Ce n’est pas net.
Pourtant c’est fort aimé.
Mais dans ce cœur,
on se repasse le plat d’idée.
Qui veut ouvrir ?
Qui se fait en dedans,
avec des trous de formes ?
Il faudra bien nommer.
Laisser partir.
D’après moi, ça se fait.
Quand j'ouvrirai, ça servira ?
Qui a voulu, en conscience ?
Ce qu’on laisse à deviner,
ça se donne en peur enivrée.
Visage en roue voilée,
en vérité sur quoi ?
C’est rapiécé,
comme un visage.
Pas de mais.
Rien que la glace.
Pour la galerie,
ça se rassemble,
le coup de pouce est à la peine.
C’est à la source. Ca brille.
On s’incline.
Un avenir ou deux.
Il faudra, tu devras.
A peine entré, c’est là qu’on va.
On a repris le cours,
ceux qui prétextaient.
On dévide.
Quand on aura vu, on rejoindra.
Dans deux temps, ça peut jouer.
Tout dépendra des comédiens.
On appuie à peine.
C’est lent.
On attend, pour l’exprimer,
les témoins oculaires.
On attend, pour agir,
la nécessité, les analyses.
Il ne faut pas dormir.
On entrevoit : ça mûrit,
beaucoup à la fois.
Il n’est pas en secret.
On essaie d’apercevoir :
qui se dérobe ?
Tout le monde accroché.
Au cœur du lieu, ce serait pur.
Au lieu du coeur, ce serait dur.
Qu’est-ce qu’on refuse ?
Si on demande un délai,
l'angoisse aura changé,
la fermeture est annoncée.
Il faudra défaire et laisser.
Si ça décompose,
on comprend quoi ?
Un visage à montrer.
Un seul en apparence ?
C'est la vie grosse,
un tour de soif.
Qui ravitaille en apparences ?
On sent la durée suspendue.
On est pour la joie.
Tout tombe,
tout se redresse,
les mots, les attirails.
Et puis, avec superbe,
on choisit son métier.
Parce qu’il faut gagner,
ce serait ça, la vertu.
Les prémices de vieux.
Les frissons qui vont avec.
On se libère de rien,
rapport à tout ce qui précède.
Qui a tout donné ?
C’est quoi le sacrifice ?
Mouture fine.
Voilà qu’il s’éveille en cuir.
Il ouvre les placards.
Il verse un peu de conscience
dans son cadavre de nuit.
Il entre en souvenir.
Ce qui tombe en premier,
ça joue dans le courant.
Mais ça se tient.
Tout n’est pas rose :
c’est la lisière.
Mais ça sent clair.
Il est vêtu.
Cela prouve, évident.
Il faudra bien sortir.
Il a fait des enfants.
Il se délivre avec les yeux :
quand il les ferme,
il n’est pas dans l’obscur,
c’est la vie profonde.
C’est du sommeil intense.
En habit de surmenage,
il a mis son visage en gravité.
Le visage est brisé.
Il a plaisir en grimace,
il a fontaine de traits.
Il renouvelle son identité.
Tu es gâté,
soyeux.
Tu creuses,
tu photographies.
Tu jettes les cris par la fenêtre.
Tu ne fais pas la guerre.
Tu fais des tartines.
Tu ne sais pas quoi devenir.
Un voyage, un visage, un ordre ?
Dire par quel moyen :
mais on risque un racontar,
tu seras aveugle ou saoul.
Pas de chef de physionomie.
Tu vois l’avenir se remplir de ça.
Tu retournes à l’entrée, au salon,
où boivent les enterrés.
Tu ne sais pas comment finir.
Pour trois quarts d’humanité,
l’amertume.
Tu regardes.
Tu ne sais pas comment t’en tirer.
Je vois le cœur.
J’ai la césarienne.
J'envie les désirs des mort-nés.
Il y a une sorte de poésie.
On pénètre en rétro,
c’est le propre corps.
On est sonneur de quoi,
le corps dehors ?
Un peu de monticule,
un petit bord :
on mourra propre.
Je suis né sans effets,
pourquoi il est fait, ce ventre ?
J'envie les désirs des mort-nés.
Impuissant par la mère,
quoi remuer ?
Avec un peu sa honte,
sous la surface en chair.
Entre deux, de très loin,
les corps s’assemblent,
mais sans virer au gai.
Entre deux, j'ai vécu à cent francs.
Avouer, décider, se tromper :
comment se fabriquer ?
Comment s’extraire ?
J’envie les désirs des mort-nés.
J'enterre ma honte.
J’ai décidé de me tromper.
Je n’ai pas trop de honte.
Je ne suis pas forçat.
Je ne suis pas sourd.
J’envie les désirs des mort-nés.
Complots d’opérette,
parturitions d’opérette.
Je nais de force.
Je peux fabuler.
C’est une sorte de poésie.
Je fabrique en vie propre.
Avec la frontière du corps,
dire adieu au corps maternel.
Est-ce qu’on est sûr ?
Qui fabrique la vivante,
l’entrée dans la matière ?
On se trompe en espoir ?
Alors c’est l’obstruction ?
Qu’est-ce qui est vivant,
hors du corps maternel ?
Les envies des mort-nés.
La fuite, l’utérus des pensées.
On se force à fabriquer.
C’est vraiment du désir ?
On s’extrait de la matière,
malgré la parturiente ?
Rien de plus obstiné.
Tout un effort,
la vie faite à l’extrusion.
Il y eut une pensée,
il y eut un problème.
Ce fut le jour du temps,
le sourd consume.
Avec sens et joyeux d’avoir,
le monde adonne.
Un jour loin.
L'exception éphémère
(on a compris dedans,
c'est l'effet-mère).
Elle a pu s'oublier
(la vraie qui se renonce,
avec la clé de la semence).
La poésie des profondeurs.
On accepte seulement.
Qui se prend pour ?
Où ça s'installe ?
L’éternité pouvait.
On a douté.
Un écroulement.
Alors c'est la vie-vite.
Il fallait un ventre.
On fait du refus,
mais à moitié.
En-four-né cuit à point.
On ouvre les dents.
On comprend comment c’est,
avec le face-à-face.
La porte claque,
on refait l’auparavant,
la vie profonde,
vite organique.
La vie-vite,
en-four-née.
Oh qui dira les torts,
si la vie-vite ?
On reprend tout,
mais à la diable.
Rien ne ressemble.
Quelle est la poésie ?
L’infirmité en sursaut ?
La matière en tort ?
L’instinctif insu ?
Une âme extraite animale
n’a plus à penser.
Forme des dents,
le vent du centre.
On fait complet
avec le sang du ventre.
Avant la profondeur,
on doutait du sérieux.
L’infirmé s’use en silex
à chercher son âme.
La poésie semble au refus.
Et s’il fallait assouvir ?
Devenu l’urne-mère,
cendre à transmettre,
dorure incomprise.
La poésie, après l’impossible,
c’est quand on creuse en trop,
ça lave en souterrain l’enfance.
Il fallait un ventre.
On eut le refus.
En-four-né, la vie s’ouvre.
L’homoncule cuit à point.
On fera semblant de comprendre.
On ressemble à la photo,
qui n’est pas l’âme.
On l’a pris ailleurs,
l’air de la profondeur.
On l’a trouvé avant naître,
on transmet en vie-vite.
La poésie de reproduction
fabrique sa honte.
On opercule, et c’est trop tard.
Reste l’infirmité,
le sursaut de la matière.
Il n’y a pas à penser,
ni à savoir.
Le ventre ne s’ouvre pas,
quand on ne prend pas part.
Dans l’urne-mère,
ça brûle.
Les dents claquent,
on se transmet les torts.
A qui revient la profondeur ?
L’âme instinctive a mal.
Qui s’est moqué de l’utérus ?
Avant la naissance,
le doute a ratissé,
pas à pas, un pas vide.
On a trouvé l’organique,
mais c’est ailleurs.
Le lieu de poésie
reste en photo.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, printemps des poètes
mercredi, 15 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
12/12

Note sur la série qui s'achève :
Ces douze perles de chèvre (les chèvres, a égalité avec les huîtres - quoique dans une autre palette de couleurs et une autre consistance -, ne sont-elles pas orfèvres en matière de perles ? A quand la fable "L'huître et la chèvre", monsieur de La Fontaine ?) avaient été déposées dans un tiroir, où l'oubli a pris le temps de les conserver en l'état, autrement dit de les momifier. On me dira ou non si j'ai eu tort ou non d'ouvrir cette oubliette et d'extraire ces "perles" de leur formol, pour la présente exhumation : il n'est pas sûr que le golem puisse reprendre vie, si tant est qu'elle fut un jour en lui. Ma foi, cela fut, alors pourquoi pas encore une fois ?
Merci à la foire aux Tupiniers du Vieux Lyon, dont j'ai utilisé la couverture d'une plaquette parue en je ne sais plus quelle année.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
mardi, 14 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
11/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
lundi, 13 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
10/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
dimanche, 12 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
9/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
samedi, 11 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
8/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
vendredi, 10 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
7/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
jeudi, 09 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
6/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
mercredi, 08 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
5/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
mardi, 07 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
4/12

Note sur le dessin du cadre :
L'accoucheur humain n'aide à naître que de l'inachevé : il aura beau façonner et pétrir, l'œuvre échappera toujours.
L'être ainsi advenu, s'il est sage, fera semblant d'avoir été voulu.
09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
lundi, 06 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
3/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
dimanche, 05 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
2/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
samedi, 04 novembre 2017
HAÏKUS DU PEU D'EXISTENCE
1/12

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, haïkus
lundi, 25 septembre 2017
ECRITURE
Quand la lumière en vient à l'écriture, ...
... ce n'est pas la photo qui est floue, ...
... c'est un ailleurs qui rend visite.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie
dimanche, 02 juillet 2017
NUAGES
L'étranger
- Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?
- Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
- Tes amis ?
-Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
- Ta patrie ?
- J'ignore sous quelle latitude elle est située.
- La beauté ?
- Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
- L'or?
- Je le hais comme vous haïssez Dieu.
- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages !
Charles Baudelaire
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, charles baudelaire, baudelaire petits poèmes en prose
mercredi, 05 avril 2017
POÉSIE MARINE
Poésie "marine", certes, mais pas celle qu'on pourrait croire.
Je n'ai aucune envie de commenter les actualités. Je tente en ce moment, on l'aura peut-être remarqué, de me nourrir de substances moins ignobles, quoique plus inactuelles.
Photographie Frédéric Chambe.
*************************************************
Ode à l'angirolle.
Toi, l'auguste palan
Frappé sur la pantoire
Capelée à son mât de tréou,
Tu en portes fièrement la vergue !
(presque) François-Edmond Pâris.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, françois-edmond pâris, capitaine de vaisseau pâris, marine le pen, front national
mercredi, 22 mars 2017
SURNOM : "LE BEAU MOUSQUETAIRE"
Si le signet voulait s'éterniser,
il demanderait d'avoir une ombre.
Mais le temps seul a le droit d'exaucer.
L'ombre est la trace,
un fantôme d'existence.
Photographie Frédéric Chambe.
On trouve dans les Mémoires du duc de Saint-Simon maintes anecdotes. Beaucoup permettent au lecteur d’aujourd’hui de voir en couleur cette époque qui, du fait de l'écoulement du temps, lui apparaîtrait en noir et blanc, de façon presque abstraite. La mésaventure qui atteignit indirectement M. de Saint-Aignan est assez distrayante pour retenir notre attention. C’est M. de Ségur, alors dans sa jeunesse, qui est à l’origine de l’affaire. L’auteur le présente ainsi (on est à la veille d’une guerre en Italie) :
« Le roi fit donc partir les officiers généraux. Tallard, qui en fut un, avait fait de l’argent des petites charges que le roi lui avait données à vendre en revenant d’Angleterre, entre autres le gouvernement du pays de Foix, que la mort de Mirepoix avait fait vaquer, à Ségur, capitaine de gendarmerie, bon gentilhomme de ce pays-là, et fort galant homme, qui avait perdu une jambe à la bataille de la Marsaille [Marsaglia, 4 octobre 1693].
Il avait été beau en sa jeunesse, et parfaitement bien fait, comme on le voyait encore, doux, poli et galant. Il était mousquetaire noir, et cette compagnie avait toujours son quartier à Nemours pendant que la cour était à Fontainebleau. Ségur jouait très bien du luth ; il s’ennuyait à Nemours, il fit connaissance avec l’abbesse de la Joie, qui est tout contre, et la charma si bien par les oreilles et par les yeux qu’il lui fit un enfant. Au neuvième mois de la grossesse, madame fut bien en peine que devenir, et ses religieuses la croyaient fort malade. Pour son malheur, elle ne prit pas assez tôt ses mesures, ou se trompa à la justesse de son calcul. Elle partit, dit-elle, pour les eaux, et comme les départs sont toujours difficiles, ce ne put être que tard, et n’alla coucher qu’à Fontainebleau, dans un mauvais cabaret plein de monde, parce que la cour y était alors. Cette couchée lui fut perfide, le mal d’enfant la prit la nuit, elle accoucha. Tout ce qui était dans l’hôtellerie entendit ses cris, on accourut à son secours, beaucoup plus qu’elle n’aurait voulu, chirurgien, sage-femme ; en un mot, elle en but le calice en entier, et le matin ce fut la nouvelle.
Les gens du duc de Saint-Aignan la lui contèrent en l’habillant, et il en trouva l’aventure si plaisante, qu’il en fit une gorge chaude au lever du roi, qui était fort gaillard en ce temps-là, et qui rit beaucoup de madame l’abbesse et de son poupon, que, pour se mieux cacher, elle était venue pondre en pleine hôtellerie au milieu de la cour, et, ce qu’on ne savait pas, à quatre lieues de son abbaye, ce qui fut bientôt mis au net.
Monsieur de Saint-Aignan, revenu chez lui, y trouva la mine de ses gens fort allongée ; ils se faisaient signe les uns aux autres, personne ne disait mot ; à la fin il s’en aperçut, et leur demanda à qui ils en avaient ; l’embarras redoubla ; et enfin, M. de Saint-Aignan voulut savoir de quoi il s’agissait. Un valet de chambre se hasarda de lui dire que cette abbesse dont on lui avait fait un si bon conte était sa fille, et que, depuis qu’il était allé chez le roi, elle avait envoyé chez lui au secours pour la tirer de là où elle était. Qui fut bien penaud ? ce fut le duc qui venait d’apprendre cette histoire au roi et à toute la cour, et qui, après en avoir bien fait rire tout le monde, en allait devenir lui-même le divertissement. Il soutint l’affaire comme il put, fit emporter l’abbesse et son bagage, et, comme le scandale en était public, elle donna sa démission, et a vécu plus de quarante ans depuis, cachée dans un autre couvent. Aussi n’ai-je presque jamais vu Ségur chez M. de Beauvillier, qui pourtant lui faisait politesse comme à tout le monde ».
On trouve dans un ouvrage excessivement savant des informations sur "Mlle de St-Aignan", qui, étant "abbesse de la Joie près de Nemours", aurait selon une certaine Mme Desnoyers, écrit des lettres "à M. de Ségur, surnommé le Beau mousquetaire". Ce qui renforce le soupçon que Saint-Simon est bien informé. L'histoire en devient d'autant plus plausible. Et, comme disent les Italiens : si non è vero, ben trovato.