vendredi, 26 décembre 2014
DU SHIMMY DANS LA VISION

Saint-Genis-Laval, 2005.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, saint genis laval, lyon
dimanche, 21 décembre 2014
CAP AU NORD
TOURISMES NORDIQUES

L'usine (Honningsvag, île de Magerøya).

Le supermarché (latitude 66°66'). C'est encore pire au cap Nord. Là, je n'ai pas eu le courage d'immortaliser.

La supérette.

Le petit commerce.
**********
Message strictement personnel :
Joyeux anniversaire, M. !
Youp là boum et haut les cœurs !
Mais non, ce n'est pas si grave !
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, cap nord, norvège, cercle polaire, honningsvag, mageroya, peuple sami
samedi, 20 décembre 2014
CAP AU NORD
COULEURS DE CIELS NORDIQUES.



09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, cap nord, norvège, suède
mardi, 16 décembre 2014
LES PYRÉNÉES EN 2005




09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, photos pyrénées, araignées, toiles d'araignées, randonnées pyrénées
lundi, 15 décembre 2014
UN PAON A LA CGT ?

Le paon fait le beau devant sa cour. J'ignore s'il s'appelle Thierry et quelles sont ses responsabilités syndicales.

C'est bien connu : après avoir exhibé un minois avenant, l'individu montre son cul.
Photos prises au Parc de la Tête d'Or. C'était avant la "Plaine Africaine".
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, syndicalisme, syndicats ouvriers, cgt, thierry le paon, lyon, parc de la tête d'or, plaine africaine
samedi, 13 décembre 2014
LYON EN 1992 2/3

Il était une fois la montée de la Grande-Côte...

Ce qu'on appelle encore "les pentes".

Parce que, quand on parle de la Croix-Rousse, il ne faut pas confondre "les pentes" et "le plateau".

Mais c'était dans les "autres fois" (comme disaient les "yonnais", les vrais de vrais) : on l'appelait à raison "la colline qui travaille".

L'étape intermédiaire.

C'est tellement mieux, hein, la ligne droite ?

L'immeuble qui fait l'arrondi entre les rues J.-B. Say (à g.) et des Pierres Plantées (à d.), avec son délicieux jardin suspendu à l'arrière (n'est-ce pas, madame Tupinon ?), possède, juste sous l'avancée du toit, une fenêtre d'où la vue sur la Grande Côte était absolument imprenable. Pour la "vraie vie", il fallait attendre le soir. Je le sais : j'ai habité là.
Non, pas de nostalgie. Juste des moments remarquables.
Cette montée, Nizier du Puitspelu (Clair Tisseur de son vrai nom) l'appelait autrement, comme le prouve son "Littré" à lui.

Sur la page de titre de l'édition originale, on aperçoit une des deux flèches de la bien nommée église Saint Nizier.
09:00 Publié dans LYON, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, photographie, croix-rousse, montée de la grande-côte, le colline qui travaille, canuts, c'est nous les canuts, nizier du puitspelu, clair tisseur, église saint nizier
jeudi, 11 décembre 2014
VANITÉ
On est bien peu de chose, allez.

Je confirme l'information parue dans la presse : c'est bien au "Lambda" que la suture sagittale rencontre la suture lambdoïde. A son corps défendant.


Mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller.
Reprenons avec Boris Vian : « Quand j'aurai du vent dans mon crâne, Quand j'aurai du vert sur mes osses. P'tête qu'on croira que je ricane, Mais ça s'ra une impression fosse » !
09:10 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, crâne, mort, tête de mort, vanités
mercredi, 10 décembre 2014
QUELQUES VÉGÉTAUX EN 1993





Je sais, on me demandera si le lichen est vraiment un végétal.
Mais l'arbre ?


Ce qui s'appelle coincer la bulle.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, nature
mardi, 09 décembre 2014
LA TÉGÉNAIRE EN 1993




Quelques générations de tégénaires, et l'on voit le résultat.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, araignée, tégénaire, toile d'araignée
lundi, 08 décembre 2014
CHOSES VUES EN 1993

En allant vers la Bretagne, le temps d'un pique-nique (si quelqu'un peut me dire où se situe ce vieux lavoir ...).

Une momie au château de Combourg.

A Corbeyssieu. Pour les initiés : le cagibi.

A Messimy.

Aux Saintes-Maries.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
samedi, 29 novembre 2014
PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...
C'est à Lyon.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon
mercredi, 26 novembre 2014
PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...
C'est à Lyon. Les habitués reconnaîtront.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse
mardi, 25 novembre 2014
PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
lundi, 24 novembre 2014
PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie
dimanche, 23 novembre 2014
PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...
C'est à Lyon.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse
samedi, 22 novembre 2014
PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...
C'est à Lyon.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon
mercredi, 05 novembre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE
Je répare ici une injustice : quelques artistes de la photo ont été évincés des lieu et place qui leur revenaient dans l'ordre alphabétique, et ce pour la raison ô combien futile de quelques vaines vitupérations tonitruées à l'encontre de M. Arcon, depuis les profondeurs d'un crétinisme assumé et revendiqué. Qu'on se rassure, l'art contemporain s'en est déjà remis.
Pour le choix des clichés, c'est toujours mon goût personnel qui en assume tranquillement le total arbitraire.

EDWARD S. CURTIS

FRANK HORVATH

FELIX TOURNACHON, DIT "NADAR"

CHARLES NÈGRE
La tête supportant le haut-de-forme est celle d'Henri Le Sercq, autre photographe. La gargouille est signée Viollet-le-Duc.

ALFRED STIEGLITZ
samedi, 01 novembre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

JEANLOUP SIEFF
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, jeanloup sieff, femme nue
vendredi, 31 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

AUGUST SANDER
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, photographe, august sander
mercredi, 29 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

BERNARD PLOSSU
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bernard plossu
lundi, 27 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

Allez, j'avoue, ma préférée entre toutes, elle est signée
JOSEF KOUDELKA.
Je dirais bien pourquoi, mais mon commentaire ne saurait se hisser à la hauteur de ce monument de force, d'humour, de simplicité, de familiarité, de noblesse, de légèreté, de mystère ...
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, roumanie, josef koudelka
samedi, 25 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

BOB HUDAK
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bob hudak
vendredi, 24 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

ERNST HAAS
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, ernst haas
mardi, 21 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE
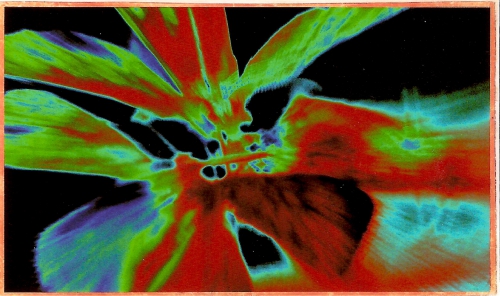
PAUL EDWARDS.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, paul edwards
lundi, 20 octobre 2014
UN ALBUM EGOÏSTE

EDWARD SHERIFF CURTIS
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens, indiens d'amérique, amérindiens, canyon chelly, navajo








