vendredi, 03 novembre 2023
TOUCHE PAS A "MA RAINEY" !
Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime le jazz (entre autres). Comme un nombre plus que respectable de mes contemporains, et depuis 1966, pour replacer dans le temps. J'y suis entré par La Rage de vivre, ce merveilleux livre où Milton "Mezz" Mezzrow raconte sa vie, aidé pour tenir la plume du journaliste Bernard Wolfe. Ceci pour dire que mes premières amours en la matière appartenaient à cette sorte particulière de musiciens : ceux qui vivaient, jouaient ou faisaient les 400 coups dans la ville de Chicago, entre 1920 et 1935.
Beaucoup d'entre eux avaient migré de la "crescent city" qui a nom La Nouvelle Orléans, mais en transportant dans leurs bagages toute la musique, telle qu'elle se pratiquait dans ce Sud profond : King Oliver, Louis Armstrong, Jimmy Noone, Johnny Dodds, Kid Ory et toute la pléiade des génies qui faisaient le bonheur, alors presque exclusif, des Noirs, et qu'on retrouve au fil des pages du livre de Mezzrow.
Je n'ai jamais cherché à savoir si l'auteur de La Rage de vivre racontait des carabistouilles, et je m'en contrebalance : après dévoration du bouquin en bonne et due forme, j'ai embrayé sur les achats de disques de tous les souffleurs et tapeurs hautement recommandés de l'époque. Voilà mon baptême du jazz tel qu'il a duré plusieurs années, avant que je me rende compte, au fil de mes fréquentations, de mes lectures et de mes soirées au Hot Club et au B.C.Blues (les Lyonnais de ma génération n'ont pas besoin d'explications) avec les copains et les copines, que le jazz avait une histoire, et que les formes avaient diantrement évolué au cours de celle-ci.
Mais pour en rester à mes premiers pas dans le jazz, Mezzrow ne parle pas de Ma Rainey, mais il parle, et en quels termes, de Bessie Smith qui, je me souviens, lui passait la main dans les cheveux en riant, parce que ses ondulations faisaient comme des vagues qui lui donnaient le mal de mer. La voix de Ma Rainey est, si c'est possible, plus âpre, plus "rough", plus "roots" que celle de Bessie, encore que ça se discute. Toutes deux se sont connues, elles sont à peu près de la même génération, elles ont fait les mêmes tournées. La première ("Mother of the blues") en plus austère, la seconde ("Empress of the blues") en plus "prenante". C'est plutôt elle que l'histoire du jazz et du blues a retenue, même si elle reste dissimulée derrière les silhouettes écrasantes d'Ella, Sarah, Helen, Dee Dee et toutes les autres voix médiatisées ou invitées dans les festivals. Il reste que Ma Rainey demeure une grande artiste, un monument.
Or, voici ce que je découvre, horrifié, dans un supplément du Monde daté 01-02 novembre 2023 (ci-dessous).

Je lis bien "Ma Rainey". Je n'en crois pas mes yeux. J'ai rogné l'image de M. Langergraber publiée par Le Monde, j'ai recadré la légende, mais le matériel est garanti d'origine. Voilà une guenon qu'un cerveau malade a baptisée du nom d'une des femmes noires les plus admirables des Etats-Unis, une des femmes qui ont le plus compté dans la naissance et l'histoire du jazz et du blues. Ben merde !!!

Gertrude Pridgett "Ma" Rainey, 1886-1939.
Passons sur la guenon "ménopausée". Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'insupportable dans cette manie qu'ont certains (scientifiques ? Vous êtes sûr ?) de vouloir à n'importe quel prix conférer à l'animal une dignité personnelle qui, en l'élevant au-dessus de lui-même, lui fait usurper un statut de quasi-humain qu'il n'a jamais songé à réclamer. Et qui se trouve humiliante, dégradante, infamante pour la personne humaine qu'elle implique — d'une insigne valeur — et qu'on a dépossédée de son nom pour le jeter dans un zoo.
J'attends que Madame Christiane Taubira, dont tout le monde a en mémoire les diatribes véhémentes, hautaines et péremptoires, descende dans cette arène pour rétablir l'ordre des valeurs, elle qui fut, il y a quelques années, traînée dans la boue dans un torchon journalistique où une telle comparaison animalière se voulait une charge politique haineuse.
Bon, on dira que je pars en guerre contre les moulins à vent. Possible. Dans ce cas, qu'on veuille bien ne considérer ce billet que comme un mouvement d'humeur manifesté en réaction à une saloperie ordinaire.
08:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jazz, blues, milton mezz mezzrow, bernard wolfe, la rage de vivre, jazz nouvelle orléans, jazz chicago, louis armstrong, king oliver, jimmy noone, johnny dodds, kid ory, ma rainey, bessie smith, mother of the blues, journal le monde, christiane taubira, lyon jazz, b.c. blues, hot club de lyon, musique
mercredi, 24 avril 2019
CE QUE ME DIT LA CATHÉDRALE (fin)
Ajouté le 25 avril : ce texte a pris de telles dimensions par rapport à son premier état que je crois préférable, pour que le lecteur puisse se faire dès le départ une idée de l'esprit dans lequel je l'ai écrit, de faire figurer en tête le dernier paragraphe, celui qui sert de conclusion.
Tout ça, en fait, c'était pour dire que la France d'aujourd'hui et les Français d'aujourd'hui ne méritent pas Notre-Dame de Paris, et qu'ils n'ont pas les moyens, non seulement de faire quelque chose de comparable (c'est aveuglant d'évidence), mais d'assurer l'entretien correct de l'édifice. Ce monument qui les dépasse de tellement haut au-dessus d'eux qu'ils ressemblent à des poulets qui grattent le sol mais des poulets qui, contre toute vraisemblance, tentent, par leurs discours, de se faire passer pour des aigles. Ceux qui ont fait Notre-Dame travaillaient pour Dieu, c'est entendu, mais je retiens surtout qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était destiné à quelque chose (ou quelqu'un, mais pas forcément) de plus grand que leur petite personne : ils savaient qu'ils ne verraient pas de leur vivant l'accomplissement de l'œuvre, mais ils y allaient bravement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien au-dessus de nos petites personnes, même pas d'idée de la France, dont les Français ne sont plus à la hauteur.
SUR CE QU'EST DEVENUE LA FRANCE
Suite et fin du post-scriptum.
Mais je ne suis cependant pas complètement américanisé, et certains brillants emblèmes du rayonnement de la culture américaine n'ont jamais franchi mon seuil : d'abord, aussi incroyable que cela paraisse, je n'ai jamais mis les pieds dans un fast-food ; ensuite, je me refuse à laisser entrer chez moi jusqu'à l'ombre du moindre de ces "nouveaux objets connectés" que l'industrie ne cesse de produire ; enfin, aussi loin que ma mémoire remonte, je n'ai jamais prêté le moindre orteil de mon intérêt à tout ce qui s'appelle "super-héros", "Marvel" et compagnie. Ce sont des exemples.
Autant la potion magique confectionnée par Panoramix pour la tribu de Gaulois préférée des Français me fait sourire (ah, les molaires des Romains en suspension après les uppercuts magistraux d'Astérix !) parce que tout ça ne se prend pas très au sérieux (Astérix n'est pas un super-héros, il n'est une figure ni du Bien ni du Mal), autant les divers super-pouvoirs inventés par les scénaristes américains (attention, ne pas confondre Batman, Spiderman, Superman, Captain América, Silver Surfer et toute la kyrielle : chacun tient à sa spécialité) m'indiffèrent.
Cet imaginaire-là me laisse de marbre, à cause de l'insupportable bloc de sérieux dans lequel tous ces personnages sont pris. Le fait que ce soit le support d'une propagande de bas étage n'y est pas pour rien. L'engouement de beaucoup de Français pour ce genre est révélateur d'une migration des mentalités du pays hors de nos terroirs. Et puis, j'ai vu un certain nombre de mauvais, très mauvais, exécrables films américains, et même de "navets au carré" (je me rappelle avoir payé ma place et être resté atterré au visionnage de Porky's).
En revanche, je connais un peu (je ne suis pas un "connaisseur", mais j'ai beaucoup fréquenté les salles "Art et essai") le cinéma français, et je garde de pas mal de films le souvenir d'images fortes. Les vieux Gabin (Pépé le Moko, Le Jour se lève, Gueule d'amour, La Belle équipe, La Grande illusion, etc.), Les Visiteurs du soir (Alain Cuny enchaîné  appelant "Anne", "Dominique et Gilles", Jules Berry en diable furieux à la fin, ...), il y en aurait tant que je préfère renvoyer aux films, par exemple, de Bertrand Tavernier, en particulier à son merveilleux Voyage à travers le cinéma français, véritable déclaration d'amour, et à l'argumentation serrée. Je reconnais donc la qualité, mais je sais aussi où se trouve la "force de frappe". En terme de proportions, la France est bien lilliputienne par rapport au Gulliver américain. La France a quelque chose à dire, mais sa voix ne "porte" pas.
appelant "Anne", "Dominique et Gilles", Jules Berry en diable furieux à la fin, ...), il y en aurait tant que je préfère renvoyer aux films, par exemple, de Bertrand Tavernier, en particulier à son merveilleux Voyage à travers le cinéma français, véritable déclaration d'amour, et à l'argumentation serrée. Je reconnais donc la qualité, mais je sais aussi où se trouve la "force de frappe". En terme de proportions, la France est bien lilliputienne par rapport au Gulliver américain. La France a quelque chose à dire, mais sa voix ne "porte" pas.
Côté télévision, pourquoi les Français se sont-ils agglutinés pendant des années autour du feuilleton télévisé "JR" ? Comment se fait-il qu'ont fleuri à la télévision française des émissions dont le concept a été inventé par les Américains (toute la télé-réalité vient de là), avec une audience incroyable ? Où est né le concept de "série télévisée" (bon, c'est un avatar du "feuilleton" bien de chez nous, mais) ? Ce n'est pas pour rien qu'a émergé le concept de "soft power". Bon, tout le monde s'y est mis, mais c'est comme dans la boxe : il y a plein de catégories, et on sait qui est l'indéboulonnable champion toutes catégories. Et on est bien obligé de reconnaître que la grande majorité des Français est américano-centrée.
Autant de preuves que les Français ont commencé depuis longtemps à voir le monde avec des yeux américains. Inutile d'évoquer la cascade des innovations technologiques que nous devons à leur industrie et dont nous ne saurions nous passer, moi compris, si j'excepte quelques menues babioles, et qui sont devenues le paysage quotidien hors duquel nous ne saurions pas vivre.
Et si on se tourne vers le champ géopolitique, comment ne pas admettre, là encore, que l'Europe vit depuis plus d'un demi-siècle à l'abri du "parapluie américain" et que la France a fait partie intégrante de l'OTAN, bien à l'abri, comme une sorte de protectorat américain ? De Gaulle a eu la stature pour tenir tête et s'en retirer, mais il a suffi, quelques décennies plus tard, d'un petit bousilleur du nom de Sarkozy, lui-même très américano-centré (trottant dans Central Park vêtu d'un T-shirt NYPD entouré de ses gardes du corps), pour voir la France rentrer au bercail sans contrepartie, "pieds nus, en chemise et la corde au cou". Politiquement, la France et l'Europe sont indissolublement liés à l'Amérique, comme un vassal à son suzerain.
Et pas besoin d'être un géopoliticien professionnel : c'est bien à la stratégie américaine que nous devons certains événements qui se sont produits à l'est de l'Europe depuis une dizaine d'années. En serions-nous là si les USA n'avaient pas poussé à la roue pour que l'OTAN accueille en son sein la Géorgie (pour l'empêcher, Poutine lui a soustrait par la force l'Abkhazie et l'Ossétie du sud) ? S'ils n'avaient pas été pour quelque chose dans la demande de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne, voire à l'OTAN, provoquant d'une certaine manière la main-mise de la Russie de Poutine sur la Crimée et la poussée "sécessionniste" dans le Donbass ? Et je comprends Poutine : comment tolérer qu'une menace armée puisse venir camper à proximité de sa frontière ? Et l'Europe est restée impuissante : elle a suivi Oncle Sam.
Les Russes auraient-ils réagi par la violence s'ils n'avaient perçu dans la stratégie américaine une volonté d'encerclement plus étroit de leur pays (voir les pays baltes) ? Et sous l'influence de quel allié puissant l'Europe a-t-elle intégré en procédure accélérée des anciens du Pacte de Varsovie dans l'Union Européenne ? Qu'a fait l'Europe, France comprise ? Elle a obtempéré à l'ordre des choses américain. Vivre avec l'idée qu'il faut toujours se méfier de la Russie, faire de Poutine un méchant diable et non pas un partenaire possible, voilà bien un exemple où l'Europe et la France ont adopté sans discuter le point de vue américain (voir l'assentiment des Européens aux sanctions voulues par les Américains, qui n'ont aucune envie de voir sur ce terrain une Europe indépendante, alors même qu'elle a besoin du gaz russe).
Ce n'est donc pas par les seuls produits de consommation et par nos façons de les consommer que nous sommes devenus américains (j'aurais pu évoquer l'apparition des fast-foods – White Tower, autour de 1928, il me semble – et bien d'autres trouvailles qui ont mis à mal les traditions alimentaires françaises, au moins autant que leur dévastation par les pratiques de la grande distribution, concept lui-même importé des USA). L'américanisation de nos divertissements, de nos existences matérielles et de nos orientations géostratégiques ne sont que de tout petits aperçus d'une vassalisation beaucoup plus vaste de l'Europe par la grande "puissance industrielle".
Mais je n'ai pas envie de m'attarder aujourd'hui sur les dégâts commis sur les mentalités françaises et européennes par les multiples inventions intellectuelles et sociétales sorties du ventre de la "nouvelle idéologie américaine" :
— "politiquement correct" au motif que toute minorité a le droit qu'on ne lui "manque pas de respect" et qu'on n'attente pas à sa "dignité" (frontières entre "communautés" de plus en plus jalousement gardées, archipellisation (Jérôme Fourquet) des sociétés) ;
— l'organisation des dites minorités en vue d'influer à leur profit sur l'organisation de la société tout entière grâce à des lois obtenues par "lobbying" ;
— les ravages des "gender studies", fondées par Judith Butler, elles-même inspirées principalement par deux "déconstructeurs" bien français : Michel Foucault et Jacques Derrida ("déconstruire", c'est s'acharner à prouver qu'aucune institution humaine ou convention sociale n'est "naturelle", ce qu'on sait depuis la naissance de la première société, mais ça permet à chaque particularisme, voire chaque individu qui se juge brimé de crier à l'injustice et de déclarer fièrement à la face de l'ordre existant : « De quel droit ? », de se proclamer victime, de demander compensation et de contraindre la collectivité tout entière à satisfaire sa demande de faveur particulière, sous prétexte d' "égalité") ;
— la transposition abusive en France de la question noire telle qu'elle se pose exclusivement dans les Etats d'Amérique du fait de la traite négrière transatlantique, et de façon particulièrement aiguë aux Etats-Unis (bizarrement, l'histoire de l'esclavage des noirs par les noirs – qui persiste – et par les arabes fait beaucoup moins de bruit) ;
— importation de l'individualisme le plus effréné en lieu et place de la "vieille" société française, où le rôle de l'Etat est prépondérant pour assurer la cohésion du corps social, etc. Notre président Emmanuel Macron est lui-même tout imprégné de l'idéologie américaine, avec sa conception purement managériale de l'Etat et de l'administration. Une idée "française" ne peut exister comme objet spécifique que si elle est la base d'un projet collectif largement mobilisateur. On en est loin.
En un mot : l'Amérique s'est insinuée dans tout ce qui conditionne et produit nos façons de voir le monde, et c'est tout notre mode de vie qui a été modifié en profondeur par les importations massives de tout ce qui est américain, marchandise concrète et autres. Au point que je ne suis pas sûr qu'on puisse encore parler de "civilisation européenne". En revanche, si l'on peut parler de "civilisation américaine", je me demande si on ne doit pas l'attribuer à sa seule "puissance de feu" dans tous les domaines (militaire, financier, culturel, idéologique, ...).
Nos yeux, nos oreilles, nos cerveaux, nos pays eux-mêmes, sont, depuis la fin de la guerre, plongés dans un bain d'Amérique. Non, il n'y a pas de "petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur" : nous sommes devenus américains, exactement comme les Gaulois sont devenus romains, la puissance romaine a simplement été remplacée par la puissance américaine. Si la civilisation est inséparable de la puissance (ça se discute), alors nous vivons dans la civilisation américaine. Pourquoi, après tout, serait-il si difficile de reconnaître, à la suite de Régis Debray, que "nous sommes devenus américains" ? On a le droit de s'en accommoder, et hocher la tête avec résignation, mais c'est un fait et une réalité.
Tout ça, en fait, c'était pour dire que la France d'aujourd'hui et les Français d'aujourd'hui ne méritent pas Notre-Dame de Paris, ce monument qui les dépasse de tellement haut au-dessus d'eux qu'ils ressemblent à des poulets qui grattent le sol mais des poulets qui, contre toute vraisemblance, tentent, par leurs discours, de se faire passer pour des aigles. Ceux qui ont fait Notre-Dame travaillaient pour Dieu, c'est entendu, mais je retiens surtout qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était destiné à quelque chose (ou quelqu'un, mais pas forcément) de plus grand que leur petite personne : ils savaient qu'ils ne verraient pas de leur vivant l'accomplissement de l'œuvre, mais ils y allaient bravement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien au-dessus de nos petites personnes, même pas d'idée de la France, dont ils ne sont plus à la hauteur. Qui est prêt à travailler pour quelque chose de plus grand que soi ?
Bon, assez causé pour aujourd'hui.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : américanisation de la france, france américanisée, consumérisme, mcdonald, jazz, musique de jazz, la revue nègre, joséphine baker, jim crow, racisme, ségrégation raciale, guerre de sécession, nordistes, sudistes, milton mezz mezzrow, mezzrow la rage de vivre, bix beiderbecke, louis armstrong, frères lumière, lyon, régis debray, debray civilisation, le chanteur de jazz, john ford, le massacre de fort apache, john ford rio grande, lford la charge héroïque, la dernière séance eddy mitchell, 58 minutes pour vivre, jean gabin, pépé le moko, le jour se lève, la belle équipe, les visiteurs du soir, alain cuny, claude chabrol, bertrand tavernier, voyage à travers le cinéma français, sarkozy, nypd, otan, de gaulle, abkhazie, ossétie du sud, géorgie, crimée, vladimir poutine, géopolitique, géostratégie, ukraine
mardi, 23 avril 2019
CE QUE ME DIT LA CATHÉDRALE
Ajouté le 25 avril : ce texte a pris de telles dimensions par rapport à son premier état que je crois préférable, pour que le lecteur puisse se faire dès le départ une idée de l'esprit dans lequel je l'ai écrit, de faire figurer en tête le dernier paragraphe, celui qui sert de conclusion.
Tout ça, en fait, c'était pour dire que la France d'aujourd'hui et les Français d'aujourd'hui ne méritent pas Notre-Dame de Paris, et qu'ils n'ont pas les moyens, non seulement de faire quelque chose de comparable, mais d'assurer l'entretien correct de l'édifice. Ce monument qui les dépasse de tellement haut au-dessus d'eux qu'ils ressemblent à des poulets qui grattent le sol mais des poulets qui, contre toute vraisemblance, tentent, par leurs discours, de se faire passer pour des aigles. Ceux qui ont fait Notre-Dame travaillaient pour Dieu, c'est entendu, mais je retiens surtout qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était destiné à quelque chose (ou quelqu'un, mais pas forcément) de plus grand que leur petite personne : ils savaient qu'ils ne verraient pas de leur vivant l'accomplissement de l'œuvre, mais ils y allaient bravement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien au-dessus de nos petites personnes, même pas d'idée de la France, dont les Français ne sont plus à la hauteur.
SUR CE QU'EST DEVENUE LA FRANCE
Post-Scriptum.
En guise de réponse sur l'américanisation de la France, de ses mœurs et de son esprit.
Un lecteur bien intentionné me fait remarquer qu'à son avis, l'américanisation de la France dont je parle concerne exclusivement, dit-il, "le consumérisme". Je me permets d'être en complet désaccord avec cette estimation, que je trouve à la fois indulgente pour nos "amis" américains et erronée. Je suis parti autant de convictions anciennes que d'une lecture récente. Je pense depuis très longtemps que toute la culture qui s'exprime sur le territoire national est très largement et en profondeur inspirée de ce qui se passe outre-Atlantique, et ce depuis fort longtemps.
C'est la culture américaine sous toutes ses formes qui est devenue un produit d'exportation massif et puissant, au point de s'être universalisée jusqu'à faire pendant un temps du burger McDo une sorte d'étalon monétaire permettant de comparer les pays. Tous les pays du monde sont, chacun à sa manière, affectés par la culture américaine. La seule culture universelle aujourd'hui est la culture américaine. C'est pour notre malheur, mais c'est comme ça.
Pour ne prendre que l'exemple du jazz, cela remonte aux années 1920. Le jazz a débarqué en France avec les Américains en 1917. Les années qui ont suivi la guerre ont vu se déclarer un véritable engouement pour cette musique, par exemple autour de ce qui s'appelait alors la "revue nègre", dont le clou du spectacle s'appelait Joséphine Baker. C'était à la fois le jazz et la culture des noirs américains qui motivait l'intérêt croissant des Français, pour lesquels tout cela était d'une nouveauté radicale.
Mais le jazz à Paris n'avait pas la même place qu'à New York, où il était frappé du stigmate "coloured" : les Français, au contraire des noirs américains, ignoraient ce que voulait dire "Jim Crow", base de la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Certains ont beau dire, il n'y a jamais eu de ségrégation raciale de ce genre sur le territoire français. Demandez aux nombreux jazzmen noirs américains pourquoi ils ont adoré venir jouer dans les clubs et les caves parisiens.
C'est sûr, l'histoire des noirs dans les deux pays n'a strictement rien à voir, même si des agités du bocal n'auront jamais fini de dénoncer l'esprit arrogant et colonialiste de la France. Inutile de nier l'histoire du colonialisme à l'européenne, mais il est foncièrement différent de l'esclavagisme aux Etats-Unis et de la ségrégation qui a suivi. Les états du Nord et du Sud se sont même livré une guerre sans merci à cause de ça. Il n'y a jamais eu en France de guerre entre Françaçis à cause de l'esclavage, ni de place réservée aux blancs dans les bus ou de robinet d'eau réservé aux noirs.
Cela dit, le jazz est bien une musique américaine, et il a conquis sans coup férir l'Europe, qui l'a accueilli avec enthousiasme. Et je n'ai pas peur de dire qu'à cet égard, je me sens moi aussi un peu américain : après avoir lu, au milieu des années 1960 (j'étais ado), en version "poche" achetée en gare de Perrache avant de partir pour l'Allemagne, La Rage de vivre, où "Mezz" Mezzrow (aidé du journaliste Bernard Wolfe) raconte son existence souvent bien malmenée, mais passionnante, je me suis littéralement jeté sur les disques signés par les innombrables noms qui apparaissent dans le livre (à commencer par le génial Bix Beiderbecke et sa bande de bras-cassés alcooliques, Bessie Smith, Louis Armstrong, Jimmy Noone, je n'en finirais pas, je les reconnaissais presque tous à l'oreille). Le jazz a fait ma conquête. On peut dire qu'avec le jazz, l'Europe s'est américanisée. Et moi avec.
On pourrait dire la même chose à propos du cinéma. Bon, oui, c'est vrai, il y a un vrai cinéma français. Je dirai que c'est normal : les frères Lumière sont bel et bien de France (et même de Lyon), mais quelle est la place de celle-ci dans le monde ? Vers quels pays vont les principales recettes ? Et surtout, vers quels films vont en priorité une majorité de Français, en dehors des belles surprises (de succès et de finance) ? Pas besoin de répondre, je suppose.
Même sur le plan industriel : voici ce qu'écrit Régis Debray dans l'irréfutable Civilisation (Gallimard, 2017, sous-titre : "Comment nous sommes devenus américains" !) : « 1925, la Metro Goldwyn Mayer rachète les parts du Crédit Commercial de France de la société Gaumont. Confirmation du transfert de l'usine à rêves de Paris vers Hollywood. » (p.86). En 1926, le monopole de fabrication du film vierge est abandonné par Pathé à Kodak. Et en 1927, le producteur américain du Chanteur de jazz, premier film parlant de l'histoire, déclare : « Si cela marche, le monde entier parlera anglais ».
Il ne croyait pas si bien dire, et voyait clairement le cinéma américain comme un instrument au service de la puissance, ce qu'il est devenu. Conclusion : dès les années 1930, la puissance des capacités de production a changé de continent. Le tableau de la France américaine par Régis Debray est absolument imparable. Je ne suis pas un fanatique du monsieur et de ses œuvres, mais franchement, il ne dit pas beaucoup de bêtises. C'est plutôt l'attitude qui m'agace, la posture adoptée par le personnage. Je lui reprocherais volontiers l'espèce de consentement à la faillite, mais aussi la position de surplomb absolu qu'il adopte, en vieux sage venu de Sirius, qui voit les choses de façon tellement globale qu'elle s'en trouve a priori incontestable, comme si son point de vue avait trouvé un moyen de ne jamais être pris en défaut. J'imagine que la base de son attitude est : "On ne va pas contre l'histoire". Son dernier chapitre ne s'intitule-t-il pas "Pourquoi les "décadences" sont-elles aimables et indispensables ?". Passons.
Moi-même, je dois avouer que je revois avec plaisir, de loin en loin, la trilogie de John Ford sur la cavalerie américaine (Le Massacre de Fort-Apache, Rio Grande, La Charge héroïque, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres) et je regardais volontiers La Dernière séance, la mémorable émission télé d'Eddie Mitchell consacrée au cinéma américain. A cet égard, que je le veuille ou non, je suis américanisé.
Et cela alors même que je reconnais crûment ce cinéma comme rouleau compresseur de la propagande américaine (je me rappelle, dans 58 minutes pour vivre – eh oui, j'ai vu ça, j'avoue – une réplique du pilote qui vient, après moult péripéties, de poser son Boeing en catastrophe : « C'est un vrai char d'assaut, cet avion américain », je suis à peu près sûr que ce n'est pas la citation exacte, mais c'est l'ambiance). Le problème, c'est que c'est très bien fait, parce que tout est conçu avec maîtrise pour produire un effet précis : c'est un cinéma efficace, un cinéma de professionnels. Alors que même certains films français de bonne qualité ne sont pas toujours exempts de couleurs "franchouillardes".
Demain, suite et fin du "post-scriptum".
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : américanisation de la france, france américanisée, consumérisme, mcdonald, jazz, musique de jazz, la revue nègre, joséphine baker, jim crow, racisme, ségrégation raciale, guerre de sécession, nordistes, sudistes, milton mezz mezzrow, mezzrow la rage de vivre, bix beiderbecke, louis armstrong, frères lumière, lyon, régis debray, debray civilisation, le chanteur de jazz, john ford, le massacre de fort apache, john ford rio grande, lford la charge héroïque, la dernière séance eddy mitchell, 58 minutes pour vivre, jean gabin, pépé le moko, le jour se lève, la belle équipe, les visiteurs du soir, alain cuny, claude chabrol, bertrand tavernier, voyage à travers le cinéma français, sarkozy, nypd, otan, de gaulle, abkhazie, ossétie du sud, géorgie, crimée, vladimir poutine, géopolitique, géostratégie, ukraine
dimanche, 07 janvier 2018
JE L'AI RETROUVÉ ...
... MON "MINOR SWING".
Et pour cela, je remercie Sylvain. Car c'est à Sylvain que je dois cette retrouvaille : plus au fait que moi (et plus consommateur) des virtualités de recherche offertes par l'internet, le numérique, le smartphone et toute cette famille d'outils-machins, d'outils-bidules et d'outils-trucs (il est moderne, lui), il a eu besoin d'une dizaine de minutes (quand même, et un 25 décembre, s'il vous plaît !) pour trouver ce que je cherchais depuis trois ou quatre décennies (pas 24/24, n'exagérons rien). C'était le "Minor swing" donné en public par Django Reinhardt à Bruxelles en 1948 (disques Vogue), et aucun autre. C'était donc ça ! Bon, "Minor swing", tout amateur de Django qui se respecte connaît ça. J'en ai quant à moi entendu un bon petit nombre de versions (n'exagérons rien), mais pour moi, c'était celle-là. Je dis plus loin pourquoi.
Ah, celle-là, j'ai pourtant essayé de la dénicher, achetant ici ou là un CD ou deux, mais sans pouvoir mettre la main dessus. Jusqu'au coffret de 25 CD "Chant du monde", où l'on trouve plusieurs "Minor swing". Résultat des courses : jamais le bon, même sur le 26° CD "Django live" ! Déconcertant, presque écœurant de facilité : suffit d'avoir le bon abonnement et les bonnes « applis ». On se demanderait presque si ça vaut le coup de chercher : la mémoire immédiate de presque tout compense-t-elle la transmission de presque plus rien ? Archivage total d'un côté, Alzheimer de l'autre : on y gagne, c'est entendu, mais on y perd forcément aussi. Tout est fait pour qu'on ne s'en rende pas compte, mais l'un ne va jamais sans l'autre.

Un cube élégant et bien noir avec 25 CD
(et une grosse molaire en carton creux au milieu pour meubler aux dimensions du cube).
Des tas de "Nuages" (LE tube) et de "Place de Broukère",
mais pas mon "Minor swing".
Le même coup que Chopin autrefois, quoique dans une autre modalité : l'Etude opus 25 n°11 (sur 78 tours) dont j'avais repu jusqu'au-delà de la satiété les oreilles de ma grand-mère, quand j'avais huit ans, grâce au Teppaz dont elle me laissait user – inconsidérément – au 39, cours de la Liberté (troisième étage avec ascenseur).
La plaque de porte du grand-père, au 39 cours de la Liberté.
Je m'en étais gavé au point de pouvoir me réciter chacune des innombrables notes, mais bon Dieu, c'était qui, le génie de qui était sortie cette fulgurance ? La question, sur le moment, ne m'avait pas effleuré, peu m'importait même l'interprète : seule la musique. C'est le hasard d'une villégiature printanière et enneigée dans une ancienne ferme de Tence (Haute-Loire), vingt-cinq ans plus tard, qui l'avait remise sur mon chemin.
Il m'a alors suffi de l'entendre et de rester figé sur place au premier son reconnu, en attendant la « désannonce » du morceau entendu par hasard au transistor, pour que soient mis – d'une part – fin à la douloureuse interrogation, et – enfin ! – un titre et un nom d'auteur sur l'enchantement éprouvé jadis et précieusement gardé en mémoire : une main gauche en acier qui assène ses certitudes péremptoires et carrées, pendant que la main droite égrène la joie perlée de ses cascades cristallines. Non, cela ne s'oublie pas.
Pour mon "Minor swing", rien de tel, à part ce que j'avais encore dans l'oreille : j'en savais l'auteur, j'en savais le titre, mais impossible de remettre la main sur LA version, faute de savoir où et quand. Ce qui me manquait : l'élan irrésistible, l'enthousiasme immédiat. Là encore, en un mot : la fulgurance. Il faut dire que la "djangologie" ("Djangology" est de 1934, sauf erreur) est une science bien compliquée, tant on a ici à faire à un individu original, spécifique et particulier (comme souvent dans le jazz), qui donne l'impression de traverser sa propre célébrité avec une souveraine désinvolture et qui a, au gré de ses haltes nomades (mais au fond, pas si nomades que ça), laissé de multiples traces sonores d'un même morceau. L'embarras du choix (mais pas tant que ça en fin de compte), car avec youtube, j'ai eu mon overdose de la version de 1937, peut-être l'originale, mais combien moins coruscante.
Qu'est-ce qu'elle a donc de plus que les autres, la version de 1948 à Bruxelles ? Notez qu'on la trouve aussi sur youtube, en fait, mais reléguée dans les profondeurs du classement : 2139 vues au 4 janvier, bien qu'installée en 2014, donc il y a plus de trois ans, et je trouve injuste que ce ne soit pas, précisément, un "tube". Ce qu'elle a ? Un truc tout simple, et c'est ce que j'avais oublié : ça se passe en public ! Est-ce que ça suffit à expliquer l'effet magique produit par l'entrée de Django par rapport aux autres versions ? Sans doute pas.
Ce qui est sûr, c'est que dans aucune autre version, après la courte intro, sa guitare ne donne à ce point l'impression de bondir vers le soleil ; que dans aucune autre version Django ne fait entendre un tel tranchant dans les attaques ; et que dans aucune autre version l'ensemble du solo n'atteint une telle élégance vestimentaire. Bref : un solo véritablement sous le coup de l'inspiration. Une minute et des poussières pour avoir une idée de la perfection. Jouissif et frustrant, comme le sont tous les instants définitifs qu'on a la chance de vivre et le désespoir de ne plus jamais pouvoir revivre à l'identique.
Cette version, je l'ai eue en ma possession dans les autres fois (comme on disait à Lyon) : client régulier de "La Clinique du tourne-disque", rue Joseph Serlin, juste en face des murs alors tout noirs du vieil hôtel de ville (l'atelier se trouvait au sous-sol, les bacs étaient au rez de chaussée), j'y laissais de bonnes parts de mon argent de poche et, parmi beaucoup d'autres emplettes, j'avais trouvé là quelques vinyles (on disait "33 tours") avec une photo noir et blanc du maître gitan prise entre deux bandes blanches pour les informations.
Celui-ci en l'occurrence : en haut "Django Reinhardt", en bas "Concert à Bruxelles 1948". En plus petit, le logo des disques Vogue, avec la mention "10ème anniversaire". Le temps a zappé ces détails en même temps que les applaudissements à la fin. On pouvait y entendre aussi un air sur une danse norvégienne de Grieg, un revigorant "place de Brouckère", et d'autres morceaux dont je ne me souviens pas. Je l'ai vu à 40 euros sur un site de vente : à ce prix-là, je préfère ne pas prendre le risque vinyle : on ne sait jamais.
On me dira : "Mais sachant cela, comment as-tu osé te séparer de ce joyau ?". A cette question pertinente, je réponds par avance : "Je sais, je n'aurais pas dû". Je ne me rappelle pas dans quelle circonstances ce disque m'a quitté. Mais cette fois, je ne le lâche plus d'une semelle virtuelle, promis. Attention, c'est parti pour 2'30".
Note : "La Clinique du tourne-disque" présentait un choix fort éclectique, puisque je m'y suis procuré, parmi bien d'autres 33 tours, un vinyle dont la pochette s'ornait d'un Louis Armstrong complètement à poil, la trompette et son mouchoir blanc à la main (de dos, qu'avez-vous failli penser ?), et un Jean-Sébastien Bach des Sonates et Partitas pour violon seul joués par un certain Jean Champeil, violon solo de l'orchestre Lamoureux (entre autres), sous le label Vega. Le soliste étant ce qu'il est, c'est-à-dire honnête mais pas inoubliable, le cadeau extraordinaire que m'a offert ce disque, en plus de la musique, demeure le fac-similé de la partition originale de la main de Bach, sur papier bible. De la main de Bach, y compris la chaconne !!! Celui-là, je me demande pourquoi, est resté collé à mes semelles, même par grand vent. Ci-dessous les cinq premières portées de l'Everest des violonistes.

09:04 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, jazz manouche, django reinhardt, hubert rostaing, quintette du hot club de france, django minor swing, django reinhardt concert bruxelles 1948, louis armstrong, jean-sébastien bach, chaconne, sonates et partitas pour violon seul, disques vega, jean champeil, orchestre lamoureux, disques chant du monde, disques vogue, tourne-disque teppaz, docteur frédéric paliard
vendredi, 27 mai 2016
LA RAGE DE VIVRE
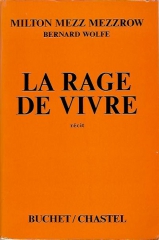 Ma parole, ça devient une manie : je suis en train de lire des livres que j’ai déjà lus dans le passé, parfois lointain. Cette fois, c’est un ouvrage un peu particulier : La Rage de vivre, de Milton Mezz Mezzrow. Le titre original est "Really the blues". Allez comprendre : c'était peut-être plus "vendeur" sous ce titre ?
Ma parole, ça devient une manie : je suis en train de lire des livres que j’ai déjà lus dans le passé, parfois lointain. Cette fois, c’est un ouvrage un peu particulier : La Rage de vivre, de Milton Mezz Mezzrow. Le titre original est "Really the blues". Allez comprendre : c'était peut-être plus "vendeur" sous ce titre ?
Je suis tombé dans le jazz par hasard, et je dirai par chance. Un peu tard si l’on veut : je prenais le train pour passer l’été en Allemagne, et je cherchais un bouquin sur le présentoir de la gare, juste avant de partir. Il me fallait quelque chose pour ne pas m’ennuyer. C’est peut-être le titre qui m’a « interpellé ». C’est comme ça que j’ai fait la rencontre de Mezzrow et de La Rage de vivre. L’auteur a été aidé par Bernard Wolfe, sans doute un journaliste. C’était en Livre de poche.
Ce n’est pas exactement un livre sur le jazz, c’est plutôt le récit d’une vie avec le jazz. Le récit d’une aventure personnelle, avec ses hauts et ses bas, ses méandres. Parce que, quand on en sait un peu plus sur l’auteur, clarinettiste et saxophoniste de son état, au moins quand il fut au faîte de sa « carrière », on découvre un instrumentiste de niveau très moyen, un compositeur potable, mais aussi un idéologue (ça semble bizarre), voire un intégriste, un fanatique intolérant du style « New Orleans » d’origine.
Ici, une composition du bonhomme : Swinging with Mezz.
Mezzrow est donc un blanc qui raconte sa vie, et on peut dire qu’elle n’est pas piquée des hannetons. Très jeune, il goûte à la prison, et c’est là que se détermine sa vocation : il sera musicien noir. Car en taule, il découvre ce que c’est que la musique « nègre », dans laquelle il s’engouffre avec enthousiasme, tant elle insuffle à ceux qui la font et à ceux qui l’écoutent l’impression de vivre intensément et de vibrer comme il convient : le rythme, la joie, l’absence de contraintes, l’échange complice entre instrumentistes qui parlent le même langage, voilà le credo dont Mezz Mezzrow ne se départira jamais.
J’avais été littéralement envoûté par le livre, mais j’ai une excuse : j’étais alors un complet néophyte. C’est par cette porte que je suis entré dans le jazz, comme un adepte, un fidèle, un homme pieux, soucieux de veiller sur ce qui n’était pas encore pour moi les cendres des ancêtres, mais le corps bien vivant d’un être dans la force de l’âge.
Dans un premier temps, j’ai été littéralement fondu de ce jazz que Mezzrow avait croisé dans les caves, boîtes et autres speakeasies de Chicago, et qu’il rendait de façon le plus souvent trépidante et passionnée, parfois pathétique, quand il se sentait tomber au fond du trou. Au point que j’avais appris par cœur les noms de tous les instrumentistes cités dans La Rage de vivre. Et comme j’ai, paraît-il, un peu d’oreille, quand je me fus procuré mes premiers disques (Clarence Williams, Louis Armstrong, Bix Beidebecke, …), j’étais capable d’identifier les trompettes, cornets, clarinettes, pianos qui sévissaient à Chicago dans les années 1920-1930.
Cette fièvre a duré ce qu’elle a duré, évidemment. J’ai eu le sentiment, à un moment, de tourner en rond dans un bocal et le livre de Mezzrow a fini par m’apparaître comme un dogme, une sorte de catéchisme laborieux. Le style New Orleans à la sauce Chicago a commencé à devenir étouffant : on ne peut éternellement se confire dans le culte des reliques. L’horizon s’est élargi rapidement à 360° : j’allais au Hot Club de Lyon de Raoul Bruckert, écouter Alan Silva agiter ses chaînes ou racler son violon, Sunny Murray grimacer à la batterie, Grachan Moncur III s’époumoner à son trombone, Beb Guérin corriger son piano. Cela s’appelait le free jazz. J’en suis aussi revenu.
De l’histoire du jazz, j’ai conservé quelques balises, et du livre de Mezz Mezzrow, deux leçons : il n’était peut-être pas un musicien exceptionnel, mais le récit de sa vie, y compris les quatre ans qu’il a passés enchaîné à l’opium, est à lui seul un témoignage formidable sur une époque des Etats-Unis (en particulier la séparation des races), sur une force de caractère finalement estimable, sur un style de musique qui, essaimant et se diversifiant en une multitude de manières de faire, est devenu un genre planétaire à part entière.
La deuxième leçon qui reste vivante à mes oreilles, c’est que le jazz reste pour moi, prioritairement, une musique de petit nombre. Le prêche de Mezzrow comportait ce qui m’est resté comme une vérité : il est vital que les musiciens soient en mesure de réagir les uns aux autres, ce qui suppose que la partition ne soit pas trop écrite. J'en veux pour exemple ce "Waiting for Benny", que le guitariste Charlie Christian, avec ses copains, enregistre peut-être sans le savoir, en attendant que le patron, Benny Goodman, veuille bien se pointer (6'40", désolé pour l'écran noir). Jouer du jazz, c'est d'abord se faire plaisir en jouant de la musique ensemble.
Oui, je suis allé écouter Duke Ellington, avec Wild Bill Davis à la batterie. Mais dans un grand orchestre, tout le mérite revient à l’arrangeur, et les musiciens deviennent des exécutants, voire des tâcherons. Bien sûr, Ellington lançait son Johnny Hodges, son Cootie Williams, son Harry Carney, son Paul Gonsalves, mais ils venaient briller un instant en façade sur un fond rigide, fixé, même si d’une fois à l’autre le chef modifiait telle ou telle partie. Ce qui compte à mes yeux, c’est que les musiciens gardent la possibilité d’interagir, de réagir à une « proposition » qui change la trajectoire. C’est que chaque concert garde la possibilité que se produise, à un moment, une étincelle, un événement qui rendra celui-ci inoubliable.
La Rage de vivre marqua un tel moment. De cela, merci, monsieur Mezzrow.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, new orleans, style chicago, milton mezz mezzrow, hot club de lyon, raoul bruckert, mezzrow la rage de vivre, mezzrow really the blues, swinging with mezz, hugues panassié, jazz hot, free jazz, duke ellington, johnny hodges, cootie williams, clarence williams, louis armstrong, harry carney, paul gonsalves
mardi, 06 mars 2012
LA SAINTE TRINITE DES ECOLOGISTES
Aujourd’hui, le « Fils ».
L’écologiste, aujourd’hui, présente de multiples visages. L’écologiste est devenu, en quelque sorte, un « Janus multifrons ». Parmi ces fronts multiples, il y en a quelques-uns qui ont le don, sinon de me courir sur le haricot, parce que, dans le fond, « ça m’en touche une sans faire bouger l’autre » (je cite le raffiné JACQUES CHIRAC en personne), du moins de laisser absolument intact mon scepticisme naturel.
Bon, c’est vrai que la société dans laquelle nous sommes immergés ne fait aucune place à l’écologiste. C’est injuste, mais c’est comme ça. Ça oblige celui-ci à rester souple. Mais là, ce n’est plus la souplesse du yoga, c’est du contorsionnisme. Je propose d’identifier, dans la nébuleuse écologiste, trois archétypes. Appelons-les, par exemple et au hasard, le « Père », le « Fils » et le « Saint-Esprit ».
Aujourd’hui, penchons-nous, sérieusement et tendrement, sur le « profil » du « moine-ermite », en qui le « Père » a mis toutes ses complaisances (traduction par le chanoine CRAMPON de la scène du baptême par Jean-Baptiste).
Comme dans les Evangiles, ce sera donc le « Fils », celui qui est « descendu sur terre », ou plutôt qui est « retourné à la terre ». Mes bien chers frères : « Tu retourneras en poussière », est-il dit quelque part. Comme il est dit ailleurs : « Ashes to ashes, Dust to dust, When the women don’t, The liquor must ».
Cette aimable phrase ouvre une version ancienne de Did’nt he ramble, par LOUIS ARMSTRONG et son groupe (le « hot seven »?). Je veux bien traduire en français, pour ceux qui ignorent le karakalpak et le monégasque : « Des cendres aux cendres, de la poussière à la poussière, si ce n’est pas les femmes, c’est l’alcool qui s’en chargera ». Amen.
Pour l'écologiste retourné à la terre, l’important, c’est de vivre « en accord avec ses principes », mais quand même pas jusqu’à la crucifixion. Ça veut dire, sans couper tous les ponts avec la société honnie, où l’on compte peut-être encore des amis, des parents. On achète et retape donc une vieille crèche dans un coin perdu. On en fait un lieu agréable et convivial. Le soir, comme il fait frais, on allume une belle flambée dans la belle cheminée. Avec des allumettes achetées à l’épicerie du bourg. Ça va plus vite que deux Solex, euh non, deux silex. C'est benêt, je sais, mais ça se veut une fine allusion au « retour à l'âge de pierre », dont la bouche des anti-écolo est pleine.
L’écologiste est rejoint par quelques autres. Cela finit par former un « éco-village » (vérifiez, ça existe). Perdu au milieu de nulle part. Mais avec l’électricité. Pour la lumière quand il fait nuit, bien sûr, mais il faut pouvoir aussi rester en contact avec les autres « éco-villages » par internet. On est « modernes ». On a peut-être souscrit un abonnement « i-phone » si la « couverture » le permet. On a une forme de vie vraiment collective, tout simplement inimaginable en ville.
On cultive un sympathique potager qui fournit les légumes « bio ». On est peut-être végétarien, mais pas forcément. Certes, les paysans installés dans les alentours ne s’y sont pas encore mis, au « bio », mais à force d’en discuter avec eux, ils y viendront forcément. En attendant, ils aspergent leurs terres de saloperies, tout autour du potager « bio ». Il y a même l’eau courante. Sans doute fournie par Véolia ou Suez. Et puis, au cas où, on ne sait jamais, il y a un hôpital à distance raisonnable, une pharmacie, voire un supermarché.
Cela fait déjà quelques rudes concessions au système : on reste à part peut-être, mais pas trop loin quand même. De toute façon, difficile d’accoster à une île déserte dans un pays entièrement « civilisé », cartographié, quadrillé, n’est-ce pas.
Cela fait des concessions (des « contorsions » si l’on veut), mais en même temps, ça vous met, comme disent les conformistes, « en marge » de la société. C’est un « choix de vie », certainement. La distance ainsi prise avec, disons, le « monde connu », sans être infranchissable, est une séparation, et il faut la vouloir pour l’accepter. C’est évidemment une « cote mal taillée ».
Car il y a un cordon ombilical presque impossible à couper, c’est tout simplement le progrès technique : on est né et on a grandi dedans. Essayez de vous passer d’appuyer sur le bouton électrique quand vous rentrez chez vous, tiens. Pour voir ! Tant il est vrai que pour revenir à l’âge de pierre, il faudrait se dépouiller de tous ces choses qui, au cours du temps, se sont mises à nous entourer, au point de devenir indispensables. Indissociables même.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques chirac, écologie, écologiste, politique, environnement, sainte trinité, bible, évangiles, louis armstrong, jazz, hot seven, véolia, suez
samedi, 03 mars 2012
L'ECOLOGIE, C'EST VERT DE TERRE
Ce n’est pas parce qu’il y a désormais un « parti politique » dédié à l’écologie et à la défense de l’environnement, que l’état physique et moral de la planète a cessé de se dégrader. On pourrait même dire que, maintenant que les « verts » se sont constitués en « parti » (gaussons-nous, mes frères), c’est-à-dire en chose flasque inopérante, on va pouvoir enfin s’occuper de défendre l’environnement. Sans eux, surtout. Car il ne s’agirait pas que les gens qui ont à cœur de sauver leur petit bout de planète voient des « écologistes » venir leur marcher sur les arpions.

Nous sommes d’accord : EVA JOLY n’est une bonne candidate écologiste à la présidentielle, qu’elle se mette de face ou de profil. J’imagine que si elle posait de dos à la façon de LOUIS ARMSTRONG pour la pochette d’un vieux 33 tours vinyle que j’avais aperçu dans les bacs de La Clinique du tourne-disque, rue Joseph-Serlin, c’est-à-dire complètement à poil, son corps ressemblerait sans doute (de loin et dans le brouillard, au crépuscule) à celui, impressionnant, du trompettiste et chanteur.

EVA JOLY EN 1505
PORTRAIT PAR ALBRECHT DÜRER
Mais ce n’est pas parce qu’EVA JOLY ne ressemble pas à l’idée qu’on se fait des candidats à la présidentielle et des trompettistes de jazz qu’il faut cracher sur l’écologie. J’ai, quant à moi, été un écologiste à l’époque où la société se mettait l’index sur la tempe en disant « toc-toc » chaque fois qu’elle assistait à des actions menées au nom de la défense de l’environnement.
Je ne sais pas si l’expression « pylône de Heiteren » va dire quelque chose au lecteur. Pour situer dans le temps et dans l’espace, ça se passait avant la pose de la ligne à haute tension qui partait d’une modeste installation industrielle située dans un modeste patelin du nom de Fessenheim.
Ça vous revient, maintenant ? Cela pose un homme, n’est-ce pas ? Je suis rapidement devenu beaucoup moins écologiste, quand je me suis dit qu’il aurait fallu se mettre à militer. Et ça, c’est plus fort que moi : je ne peux pas. Et Fessenheim ne sait plus quoi faire du fric que lui rapporte la centrale.

Pour être militant, il faut être militaire (la seule différence consiste en l’uniforme, et encore, il y a des militants, on les dirait sous les drapeaux), et ça, c’est au-dessus de mes forces. Il y a les œillères à se mettre, la discipline à se soumettre, la réduction du monde à opérer en l’une, toute petite, de ses parties. Tout militant réduit le monde à la dimension de son obsession. Tiens, ça pourrait faire un bon proverbe bantou, non ?
Travailler à faire triompher une « cause », quelle qu’elle soit, c’est rendre le monde plus étroit, et en même temps, se donner à soi-même la dimension démesurée du monde et de tous ceux qui « y croient ». Et j’ai perdu très tôt toute aptitude à la croyance, au point que ceux qui « y croient » me paraissent au mieux pitoyables, au pire dangereux.
Depuis le « pylône d’Heiteren » et la centrale nucléaire de Fessenheim, il faut pourtant bien dire que la situation globale de l’environnement naturel ne s’est pas améliorée, loin s’en faut. Tiens, savez-vous que dans l’Etat de Coahuila, au Mexique, région aride s’il en est, certains gros entrepreneurs n’ont rien trouvé de mieux que d’élever 300.000 vaches laitières, qui produisent annuellement 7.000.000 de litres de lait ?
Pour fabriquer des prairies en zone quasi-désertique, on tire en masse la flotte du sous-sol. Mais il faut savoir que celui-ci est naturellement riche en arsenic. Ensuite, c’est mathématique : vu la surexploitation agricole de la ressource, la baisse du niveau des nappes phréatiques fait monter le taux d’arsenic dans l’eau que les gens boivent.
Résultat, il a fallu couper une jambe à MANUEL SUNIGA : « L’arsenic dans mon sang a d’abord affecté l’ongle de mon pied, puis ma jambe est devenue noire ». En plus, les vaches mexicaines sont des pisseuses de lait de la race Holstein.

LA PISSEUSE VOUDRAIT REVOIR SA NORMANDIE
Je ne vais pas parler de la déforestation, du réchauffement climatique, de l’empoisonnement des sols par les industries « agro-alimentaires », de l’empoisonnement de l’air et de l’eau, des conséquences de l’usage des somnifères sur la durée de vie (voir la presse, ces derniers jours).
Je fais seulement observer que l’évolution vers un monde de plus en plus radicalement invivable (et pas seulement en restant dans le registre environnemental) s’est faite envers et contre tout, posément, pas à pas, implacablement. L’action des écologistes, de ce point de vue, débouche sur un échec retentissant. Cuisant si vous voulez.
Les écologistes sont la petite cuillère qui a pour ambition de vider la mer. Ou alors, pour reprendre un petit conte que j’ai beaucoup entendu ces temps-ci, ils sont le colibri qui se démène comme un malade pour aller jeter sa goutte d’eau sur l’incendie qui fait rage. Je ne crois ni à la petite cuillère courageuse, ni au colibri sauveur.
Je ne suis pas non plus de ceux qui traitent les écologistes de « khmers verts » (je crois bien que c’est GERARD COLLOMB, le « grand-maire » de Lyon) ou d’ « ayatollahs de la nature ». Il y a bien, parmi eux, des tendances à vouloir faire régner une sorte d’ « ordre naturel », à vouloir régenter la vie des autres. Mais si l’on veut faire l’inventaire de toutes les vocations policières qui ont aujourd’hui le vent en poupe, on n’a pas fini. En tout cas, le poids qu’ont pesé les écologistes dans la marche du monde depuis quarante ans, c’est « peau de balle et balai de crins ».

C’est très logique. Le « petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur », c’est rigolo, ça fait plaisir, ça fait même rire. Mais dans le monde réel, il n’y a pas de potion magique. La logique veut – car nous sommes dans le monde capitaliste – qu’une complicité de nature fasse de l’argent et du pouvoir des alliés indéfectibles.
A cet égard, l’accès de NICOLAS SARKOZY, l’ami du Fouquet’s et du yacht de BOLLORÉ, à la présidence n’a rien d’incompréhensible. Si c’est particulièrement caricatural, c’est aussi pleinement logique. Même le très écologiste JACQUES CHIRAC n’avait pas beaucoup d’amis qui fussent pauvres. C’est d'ailleurs pour ça que, après avoir sans discontinuer, squatté les palais de la République (et je ne compte pas les entourloupes autour du château de Bity), il est en train de finir ses jours dans le luxueux appartement de la famille HARIRI.
L’écologie, c’est sûr, il y a à boire et à manger, à prendre et à laisser. Il y a de la chèvre et du chou. On ne peut pas tout avoir. A chaque jour suffit sa peine. Après la pluie le beau temps. On va le payer. Je ne vous le fais pas dire. Ainsi soit-il.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre...
* NOTE-A-BENNE : j'espérais ici même, le 1 mars, que l'humain resterait à jamais hors de la brevetabilité, c'est-à-dire hors de l'appropriation privée. Il faut croire que je suis encore un grand idéaliste, autrement dit, un naïf. Les laboratoires du monde entier, en réalité, sauf le Généthon, sont lancés dans une concurrence effrénée pour des séquences synthétiques d'ADN humain. Du vendable qui rapporte. Le champion de ce type de recherche s'appelle JOHN CRAIG VENTER. A suivre aussi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, politique, eva joly, eelv, louis armstrong, élection présidentielle, nicoalas sarkozy, ump, vache holstein, mexique, réchauffement climatique, déforestation, bolloré, hariri, jacques chirac, ruth stegassy, france culture
lundi, 30 janvier 2012
LA BIBLE, C'EST TRES SURFAIT !
Je vais vous dire : la Bible, c’est très surfait. Il y en a qui en font des montagnes, qui ne s’en séparent jamais, qui l’ont apprise par cœur, qui sont prêts à se faire tuer pour elle, qui consentent même, pour elle, à devenir des assassins. Vous me direz que pour le Coran, c’est la même chose. Je sais.
Oui, on m’avait dit : « Lis la Bible, tu trouveras la vérité ». Même à Stockholm, tu te rends compte, il y a une bible (en anglais) dans la table de toutes les chambres de l’hôtel. Remarque, quand tu vas à l’Infirmerie Protestante, tu t’aperçois aussi qu’il y a une bible (en français) dans le tiroir de la table. Mais bon, c’est des protestants, ça n’excuse pas, mais ça explique. Il faut être indulgent.
« The Good Book », ça c’est le titre d’un disque fameux de LOUIS ARMSTRONG. Il chante et joue des classiques bibliques et gospels. Mais là, c’est pas pareil, c’est de la musique. Parce que les nègres, ils ne plaisantent pas avec ça, la musique. Pour beaucoup d’entre eux, ce n’est pas un ornement de façade, c’est une personne à respecter. De l’ordre du sacré, si vous voulez. Autant que la Bible elle-même, c’est dire.

LOUIS, alias SATCHMO (= BOUCHE EN FORME DE SACOCHE)
A cet égard, après tout, peut-être que je suis un peu nègre sans le savoir. Je ne serais pas le premier blanc : CLAUDE NOUGARO (« Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau ») et NINO FERRER ( le capitaine Nino de Corto Maltese en Sibérie, de HUGO PRATT : « Je voudrais être noir ! ») m’auraient précédé. Bon, il se trouve que j’ai la peau pâle, et que finalement ça me convient.
Mais c’est vrai que quand, par hasard, tu entres dans une église catholique (en France) pendant la messe, tu te rends compte que les chrétiens de cette espèce ignorent puissamment ce que c’est, la musique. J’ai parfois l’impression qu’ils la méprisent, même. Vous les entendez, ces chants las et lamentables, avachis, asthmatiques, exténués ? On dirait des bêtes étiques, faméliques, voire cachectiques, qu’on mène à l’abattoir se faire découper en lanières, stade ultime avant la farine animale.
Les nègres ? Ecoute-les un peu, pendant un office, quand le pasteur, pris d’enthousiasme, psalmodie en improvisant les paroles, soutenu par les répliques ferventes de l’auditoire. Ma parole, c’est sûr, tu perdrais presque l’habitude de ne pas croire.
C’est sûr qu’à Frontonas, malgré tout, pour le Credo et le Gloria, les phrases (en latin) étaient chantées alternativement par les filles des premiers rangs à droite et par les hommes assis en demi-cercle derrière l’autel, dans le chœur. C’était aussi de la musique, c’est vrai, mais bon. Rien à voir. C’est plus tard que j’en suis venu à SISTER ROSETTA THARPE et MAHALIA JACKSON.
Je me dis que peut-être, s’il y avait eu, dans nos églises bien catholiques, une goutte d’enthousiasme dans les cantiques, comme dans les gospels endiablés chantés par les nègres dans leurs offices, le catholicisme en France n’aurait pas ce visage triste, blafard, souffreteux, livide et, pour tout dire, cadavérique. Et que je serais peut-être encore croyant, va savoir. Bon, c’est peut-être surestimer l’importance de la musique.
Bon, alors, la Bible, le livre de la vérité ? A force de me l’entendre dire, j’ai fini par y mettre le nez. Eh bien, j’ai vu. Et je conclus que c’est très exagéré. Il n’y a sans doute pas plus de vérités dans la Bible que de mensonges. La preuve :
« Il y a trois choses qui me dépassent,
et même quatre que je ne comprends pas :
la trace de l’aigle dans les cieux,
la trace du serpent sur le rocher,
la trace du navire au milieu de la mer,
et la trace de l’homme chez la jeune fille ».
(Proverbes, XXX, 18, traduction du chanoine CRAMPON)
Si, si, c’est dans la Bible. Moi qui ai un mal de chien à me rappeler les blagues, vous savez, celles qui font marrer tout le monde à la fin du repas, celle-là, je la connaissais, mais avec une variante. Ce n’était pas l’aigle, mais le nuage, qui passait dans le ciel sans laisser de trace. Bon, on ne va pas épiloguer. L’aigle ou le nuage, le serpent, le bateau, je veux bien. Mais la jeune fille ? Est-ce que c’est sérieux ? Moi, j’ai plutôt l’impression que le gars qui a écrit ça me prend pour une bugne.
Prenez-la pucelle, prenez-la déjà un peu ou carrément usagée, qu’est-ce que ça veut dire ? Que lorsque l’homme ressort de la jeune fille après sa petite affaire, c’est comme si rien ne s’était passé ? Est-ce que ça signifie que l’orifice féminin est aussi inconsistant que l’air dans le ciel ? Aussi fuyant que l’eau de la mer ? Je laisse de côté le rocher, parce que … ça ne fait pas très réalistequand on examine posément la question. Quoi qu'il en soit, la Bible semble faire du féminin quelque chose qui n’est pas grand-chose.
Et puis franchement, pour l’engin masculin, c’est exactement la même chose : sans vouloir verser dans le vulgaire, y reste-t-il accroché quelque chose de l’antre féminin qu’il vient de visiter, en dehors des éventuels bocons, morpions, cirons, flocons et autres moutons, après la douche ? Dans ce cas, pourquoi seule la jeune fille est-elle citée ? N’y a-t-il pas quelque misogynie à la stigmatiser elle seule ? Et puis, est-ce qu’il n’y aurait pas, par hasard des traces autres que les visibles ?
C’est vrai que, dans certaines circonstances, la trace laissée par l’homme dans la jeune fille finira par se voir, au bout de quelque temps (9 mois environ). Mais en dehors de ça, si quelqu’un peut m’expliquer la possible signification théologique, il est le bienvenu. S’il faut avoir Bac + 12 pour lire la Bible, ça augure mal de sa compréhension par les masses croyantes.
Une petite mention en passant pour les « madrasas », où les Pakistanais, Indonésiens et autres musulmans apprennent le Coran par cœur dès le plus jeune âge. Je signale que "taliban" vient de "taleb", qui veut dire "étudiant" (j'imagine qu'il étudie en tout et pour tout le Coran). Ça vaut les sectes protestantes. En pire. Tous ces gens qui, ayant appris par cœur des centaines, voire des milliers de pages qu’ils se récitent en boucle dans leur disque dur, moi ça me flanque la frousse. Parce que ça suppose que, tant que tu ne fais pas la même chose, tu restes leur ennemi.
Et les plus atteints, donc les plus dangereux, c’est ceux qui s’en tiennent une fois pour toutes à la lettre. J’ai connu un étudiant qui s’était fait embrigader dans les témoins de jéhovah, et qui n’en démordait pas : quand on lit la bible, on n’a strictement aucun besoin de lire quelque autre livre que ce soit. Je te dis pas l’étendue de sa culture générale.
Cet autre, qui s’appelait Taoufik, il était pourtant intelligent, avide d’apprendre, et c’est vrai qu’il en savait plein, des choses. Et puis un jour, il est arrivé, et il a déclaré fièrement que le Coran rend absolument inutiles, donc condamnables et combustibles, tous les autres livres. Il s’était laissé pousser la barbe.
C’est exactement ce principe qui a guidé le calife OMAR, en 642, quand il ordonna de détruire les 700.000 volumes que recelait la bibliothèque d’Alexandrie : « Si c’est dans le Coran, on n’en a pas besoin. Si ça n’y est pas, ce sont autant d’impiétés ».
Finalement, la Bible, c’est très surfait. Je n’avais déjà pas très bonne opinion des méthodistes, adventistes, mormons, quakers, témoins de jéhovah et autres sectes inventées grâce à la trouvaille que fut, chez les protestants, le lien direct établi spontanément entre Dieu et son croyant.
L’appellation qui remporte tout mon suffrage, c’est l’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. C’est les mormons, ça, à vue de pied de nez ? Mais, comme dirait BRASSENS : « Moi mon colon celle que je préfère, c’est la guerre de 14-18 ». Chacun de ces protestants est à lui tout seul une petite entreprise qui ne demande qu’à prospérer, à s’étendre, à se répandre. « Allez, enseignez toutes les nations », qu’il dit, l’autre. On n’a pas fini d’en chier, avec les guerriers de dieu, les missionnaires, les prosélytes.
Bon, c’est vrai qu’ils n’en sont pas encore, les protestants, comme certains autres, à faire tenir leur pantalon avec une ceinture explosive au milieu des « infidèles », si possible des femmes et des enfants. Mais, la bombe en moins, c’est kif-kif bourricot.
Bon, on m'a dit qu'il n'y avait pas que ça dans la bible. Je la rouvrirai peut-être, mais à une autre page, en espérant tomber sur un passage plus rigolo. En tout cas, moi, je suis bien content d’être immunisé.
Voilà ce que je dis, moi.
NOTE A BENNE : je sais, on va me dire que je plaisante avec des choses sacrées, que la bible est le plus grand best-seller de tous les temps, et patali et patala. Que voulez-vous, je ne peux pas demander à ma mère qu'elle me refasse. Elle se fait vieille.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sainte bible, musique, gospel, negro spiritual, bible, prosélytisme, coran, protestantisme, protestant, louis armstrong, claude nougaro, nino ferrer, corto maltese, hugo pratt, catholique, nègre, credo, gloria, sister rosetta tharpe, mahalia jackson, chanoine crampon, bibliothèque d'alexandrie, georges brassens, mormons, église de jésus christ des saints des derniers jours, christianisme, islam
vendredi, 05 août 2011
JAZZ : JAMAIS SANS MA DROGUE
Connaissez-vous MILTON MEZZROW, dit « MEZZ » MEZZROW, (ou « MEZZ » the prezz, pour « président ») ? Il a écrit La Rage de vivre, mauvaise traduction de Really the blues, qui est en fait un livre d’entretiens avec BERNARD WOLFE. Quand j’ai lu ce bouquin, pris au hasard sur un présentoir de la gare de Perrache, au début d’un été passé en Allemagne il y a bien longtemps, j’en suis resté marqué. « MEZZ » MEZZROW fut un clarinettiste de jazz américain, un blanc, à l’époque (il est né en 1899) où le jazz était une affaire presque exclusivement noire.
MEZZ MEZZROW fut, disons-le, un petit musicien de jazz. Sa clarinette a un son un peu étriqué, rien à voir avec JOHNNY DODDS, par exemple. Il a laissé quelques compositions agréables, dont "Really the blues". Je me souviens d'un bon morceau, construit dans les règles de l'art. Cela s'appelait "Swinging with Mezz". PANASSIÉ s'appuya sur lui pour lancer le New Orleans Revival dans les années 1940.
Si je suis devenu un vrai fondu de jazz, ne cherchez pas ailleurs que dans La Rage de vivre. L’auteur vous fait vivre dans tous les lieux de Chicago, puis de New York, où se faisait la musique, vous fait rencontrer tous les musiciens qui comptent, de BIX BEIDERBECKE à LOUIS ARMSTRONG (« Vache bagarre, Mezzie ! », ça, c’est après le dramatique contre-ut, à la fin de « Them there eyes »), en passant par JIMMY NOONE (qui jouait à l’Apex club) et l’impératrice du blues, BESSIE SMITH.
Il fut un temps lointain où je connaissais par cœur la composition de tel orchestre, où il me suffisait de trois secondes pour reconnaître TOMMY LADNIER ou SIDNEY DE PARIS. Bref, un vrai connaisseur. Cela a changé. C’est en passant devant un magasin de jouet que MEZZROW comprend ce qui sépare hermétiquement le jazz de la musique classique : il observe dans la vitrine un automate représentant un orchestre classique. Tous les musiciens bougent en cadence, sous la direction d’un petit personnage qui tient une baguette. Il y a là quelque chose de militaire. C’est raide, c’est compassé. Rien à voir donc.
Pour dire combien le jazz forme une autre planète, il raconte l’arrivée de LOUIS ARMSTRONG dans l’orchestre de KING OLIVER, dans les années 1920. Avant d’attaquer le premier morceau, il demande au chef : « C’est dans quelle tonalité ? ». Réponse du vieux : « Tu écoutes et tu te débrouilles ! ». ARMSTRONG, c’est déjà une autre époque : la musique est quelque chose qui s’écrit. Les anciens jouaient A L’OREILLE. Pas besoin de solfège. Pas besoin de fixer la ligne du contre-chant. Le vrai jazz, c’est celui où les musiciens s’écoutent mutuellement, discutent les uns avec les autres, en musique, s’apostrophent, se répondent, se provoquent. Un bon musicien, ici, c’est celui qui est doué pour donner la réplique.
Je me souviens d’un concert donné il y a des années dans la salle de l’Opéra. Quelle idée bizarre d’ailleurs, d’autant que la salle avait été remplie, pour une bonne partie, par les invitations d’une banque à ses bons clients : ce n’est pas fait pour former un public de connaisseurs. Or, pour qu’un concert de jazz soit bon, le public de connaisseurs est absolument indispensable. Parce qu’il sait apprécier la moindre trouvaille, la moindre saillie, et que ses réactions incitent (ou non) les musiciens à insister dans les interactions.
Au programme, en première partie, DANIEL HUMAIR, dont la batterie écrasait le piano de RENÉ URTREGER et la contrebasse, je crois, de PIERRE MICHELOT. Mais moi, j’étais venu pour quelqu’un d’autre : MARTIAL SOLAL en personne, qui jouait en duo avec, il me semble, JOHNNY GRIFFIN. Et ce duo fut un vrai régal. Pas la peine de redire que SOLAL est un immense virtuose du piano. Et GRIFFIN est un cador du saxophone.
Mais ce qu’il faut retenir, c’est la malice du pianiste dans ses introductions, qui amenait souvent sur le visage du saxophoniste un rien de perplexité, parfois un rien d’angoisse. Visiblement, MARTIAL SOLAL s’amusait, il jouait avec les nerfs de son partenaire en changeant plusieurs fois de tonalité avant d’en venir au thème qui servait de base au morceau. Après chaque, il venait au micro pour récapituler la liste des titres qu’il avait cités en cours de route.
Parce qu’il faut dire que si, à la base, il part sur « I can’t give you anything but love », il est en mesure de faire apparaître successivement six ou sept autres thèmes, mais comme des sortes de fantômes. Inutile de dire que cette subtilité exige en face des oreilles habituées. Inutile de dire qu’elle passait, par rapport au public de ce soir-là, dans une stratosphère inaccessible. Plaisir d’initié, quoi !
Le problème du jazz, c'est qu'il a une histoire. Je ne vais pas la refaire. HUGUES PANASSIÉ, qui fonda la revue Jazz Hot, ne voulait pas démordre de la Nouvelle Orléans, incluant à la rigueur le style Chicago. THELONIOUS MONK, un génie musical du 20ème siècle, toutes musiques confondues, lui paraissait une monstruosité. Et je ne parle évidemment pas du Free Jazz.
Aujourd'hui, on est, comme pour tout le reste, sortis de l'histoire. Le jazz s'apprend dans les écoles de jazz, voire dans les conservatoires. Fini, l'aventure. C'est devenu un métier, si ce n'est même, comme pour tout le reste, un hypermarché, où chacun peut assembler à sa convenance les produits qu'il trouve tout prêts sur les rayons. Il y en a pour tous les goûts, on peut choisir son enclos, on peut même manger son herbe dans plusieurs enclos, à condition que ce soit successivement. Et même ça, ce n'est plus vrai.
Car on a même effacé les frontières, comme l'exige impérieusement notre époque de "métissage culturel" et de "créolisation du monde" : MICHEL PORTAL est capable de passer du concerto pour clarinette de MOZART à un groupe de jazz où il tient, par exemple, la clarinette basse. Et le célèbre KEITH JARRETT est capable d'enregistrer Le Clavier bien tempéré de JEAN-SEBASTIEN BACH, puis de produire une petite merveille de jazz comme Poinciana (dans l'album Whisper not), avec ses vieux complices GARY PEACOCK et JACK DE JOHNETTE. Et je vous parle des meilleurs. A qui se fier, désormais, mon pauvre monsieur ?
10:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jazz, mezz mezzrow, la rage de vivre, bix beiderbecke, louis armstrong, jimmy noone, bessie smith, blues, tommy ladnier, king oliver, daniel humair, martial solal, thelonious monk, new orleans, michel portal, mozart, jean-sébastien bach, keith jarrett, gary peacok, jack de johnette



