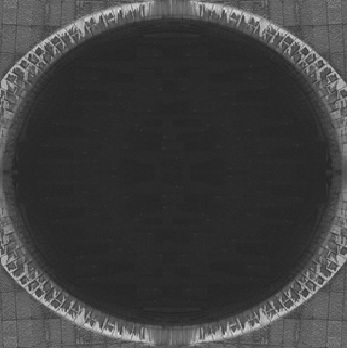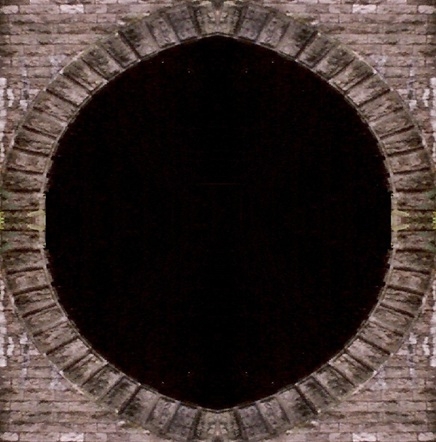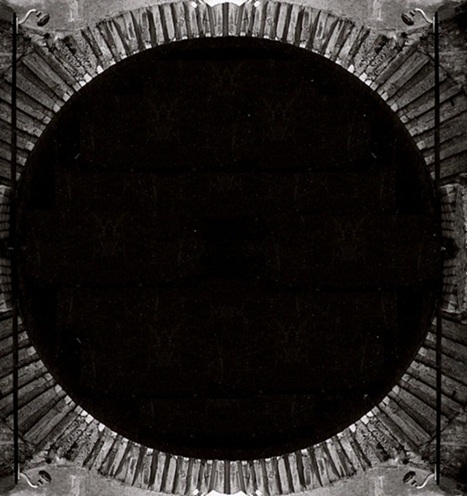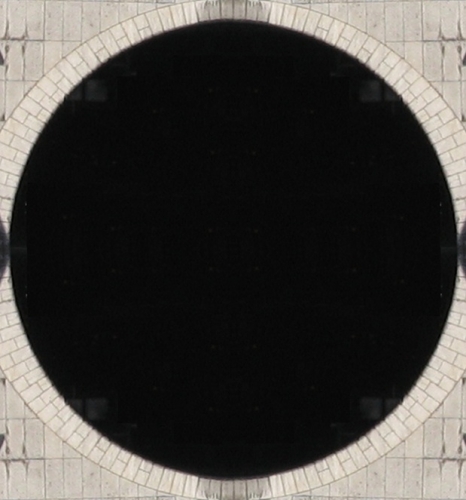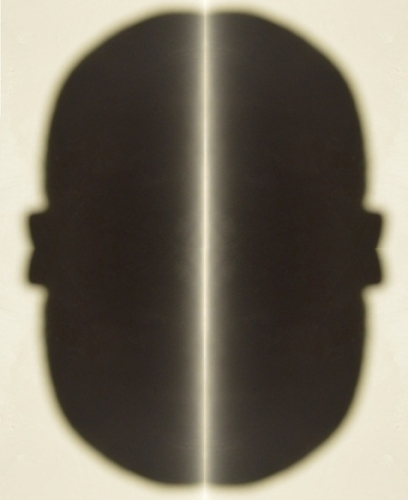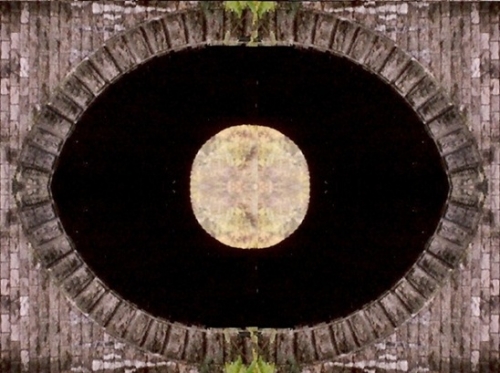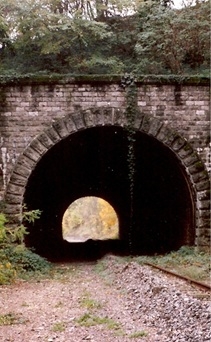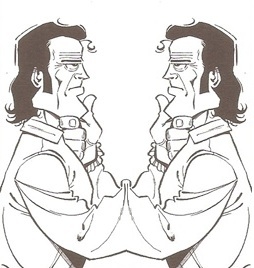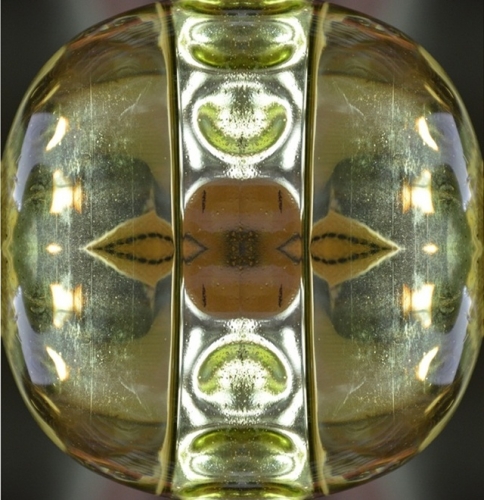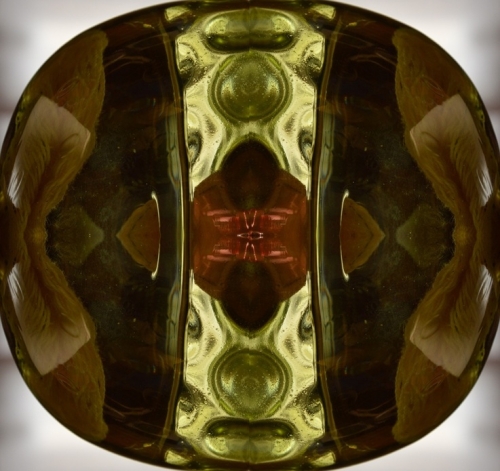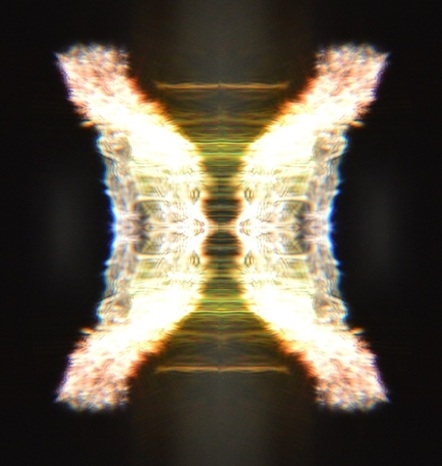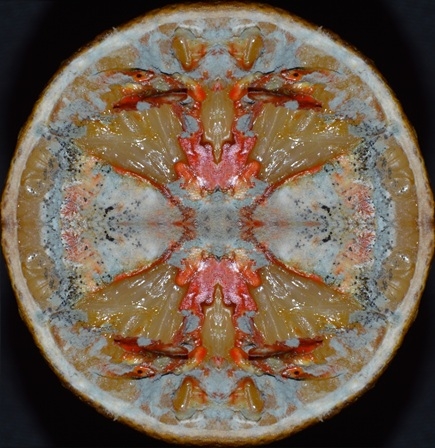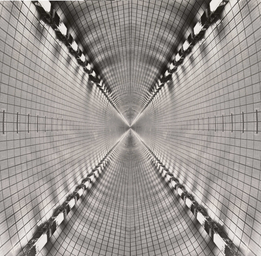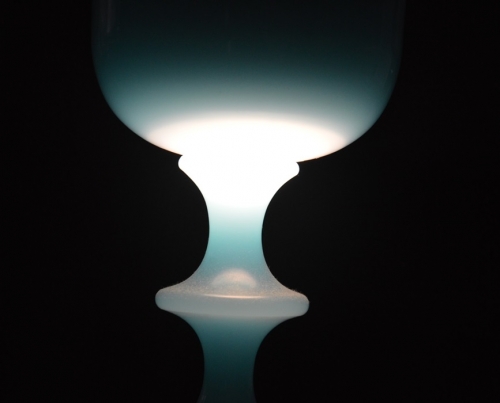« Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi !
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible,
Le plaisir vaporeux fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote : Souviens-toi ! – Rapide, avec sa voix
D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !
Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,
Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !),
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! »
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal.
***
Avec en prime une très vieille chanson.
J'ai bien peur cependant que la présente "modeste proposition" n'ait guère de chances d'aboutir un jour prochain, et ce pour des raisons diverses et variées, à commencer par de probables désaccords des plus hautes autorités en la matière, mais aussi en raison d'obstacles intempestifs, comme le tourbillon des planètes ou les caprices des changements d'heures estivaux et hivernaux.