samedi, 03 juin 2017
JOURNALISTES MAL AIMÉS
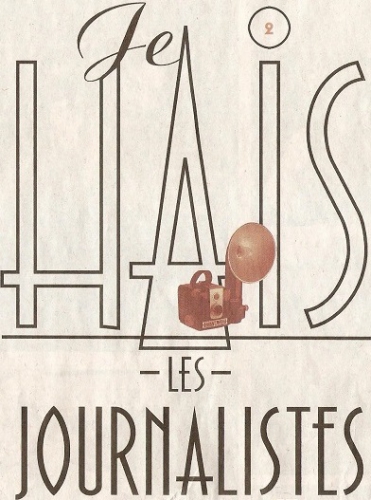
Titre - de taille démesurée : toute la moitié supérieure de la page !! Le Monde a les moyens de gâcher du papier. - de l'article de Michel Dalloni, paru dans le supplément "l'époque" du Monde des 7/8 mai 2017. On notera le choix "vintage", pour l'illustrer, du Brownie flash de Kodak. Comme dirait Brigitte Fontaine : "J'fais un genre".
Non, monsieur Dalloni, je ne hais pas les journalistes. Et je ne suis pas d'accord non plus avec le "chapeau" de votre article : « Sale temps pour les journalistes. Accusés d'être les suppôts du système, conspués par les politiques, délaissés par les lecteurs, ils ne font plus rêver. Mais pourquoi tant de haine ? ». J'avoue que "ils ne font plus rêver" m'a fait bondir.
Car si la profession fait rêver des lycéens qui ambitionnent de l'exercer (ce qui est votre cas, puisque vous commencez par cette confidence : « Toute ma vie j'ai rêvé d'être un reporter. »), je vous apprends que je n'achète pas Le Monde pour rêver mais exclusivement pour m'informer, et j'espère n'être pas le dernier dinosaure à considérer ainsi le rôle de la presse. L'insupportablement futile M, le magazine que Le Monde vend avec le numéro du samedi (j'imagine que la raison de son existence est purement financière, vu la place de la publicité), donne à craindre que nous autres dinosaures avons du souci à nous faire pour notre pitance. Je n'en reviens toujours pas de ce qu'un "journal de référence", puisse envoyer des journalistes pour rendre compte des défilés de mode ou des événements sportifs : comment peut-on tomber si bas ? Je sais, je ne suis pas "mainstream".
A la rigueur, parfois, j'apprécie une analyse, et même, pourquoi pas, une page "débats", un commentaire, à la condition que l'information reste première. J'estime aussi tout à fait regrettable l'invasion des pages du Monde par les illustrations (photos ou autre), qui ne font que flatter la paresse. Alors, ne nous trompons pas de débat. Individuellement, les journalistes font le boulot qu'on leur demande de faire, en général plutôt bien, même si, comme partout, il y a des "brebis galeuses".
Non, si je dis souvent du mal de la presse, des journaux que je lis et de ceux qui y écrivent, ce n'est pas aux individus que j'en ai. Si j'avais à m'en prendre à quelqu'un, ce ne serait pas à une personne en particulier, mais plutôt à une entité forcément plus abstraite : celle qui fabrique les conditions d'exercice de la profession. En termes plus connotés Karl Marx : à l'infrastructure plutôt qu'à la superstructure.
A mesure qu'on gravit les étages de l'édifice qui organise la profession journalistique, les questions se font de plus en plus pressantes et fondamentales. Qui est chef de service ? Qui directeur de la rédaction ? Qui éditorialiste ? Qu'est-ce qui les fait nommer à leur poste ? Qui propriétaire ? Quels rapports entre la société des rédacteurs et celui-ci, je veux dire le degré d'assujettissement des contenus à la stratégie de celui-ci (disons pêle-mêle : Bolloré, Bergé, Lagardère, Drahi, bref, tous ceux qui ont de l'argent et voudraient bien influencer) ? Qui décide des sujets ? Qui donne le dernier feu vert à la publication des articles ? Ceux-ci sont-ils retouchés par le rédac-chef ? A quelles conditions grimpe-t-on dans la hiérarchie ? Je n'oublie pas que je figure aussi parmi les payeurs, puisque l'oxygène de l'argent de l'Etat maintient plusieurs titres en état de survie artificielle, au nom du pluralisme et de la "liberté d'expression" qui, en l'occurrence, a bon dos. Je dirais plutôt qu'il faut à tout prix maintenir l'apparence (le mythe) de la pluralité : nous vivons dans un régime fictif de "liberté de la presse".
Encore deux questions, indiscrètes celles-là : 1 - Par qui sont financés les instituts 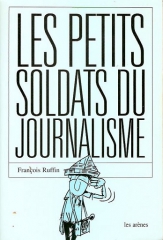 de formation des futurs journalistes ? 2 - Quels professeurs forment les futurs journalistes ? Je ne connais que le CFJ, et encore : par le biais du livre Les Petits soldats du journalisme, de François Rufin, qui avait peut-être quelques comptes à régler, mais dont la charge était étayée par des faits convaincants. Si j'en crois l'auteur, les apprentis apprennent surtout à servir la soupe. Rufin l'a d'ailleurs payé d'un long ostracisme, et ce n'est que depuis peu que sa conception du "vrai" journalisme s'est vue récompensée (succès de son film "Merci patron"). C'est donc l'ensemble de ces conditions, et non pas les seuls individus qui sont envoyés au charbon, qui doit faire l'objet des jugements les plus sévères.
de formation des futurs journalistes ? 2 - Quels professeurs forment les futurs journalistes ? Je ne connais que le CFJ, et encore : par le biais du livre Les Petits soldats du journalisme, de François Rufin, qui avait peut-être quelques comptes à régler, mais dont la charge était étayée par des faits convaincants. Si j'en crois l'auteur, les apprentis apprennent surtout à servir la soupe. Rufin l'a d'ailleurs payé d'un long ostracisme, et ce n'est que depuis peu que sa conception du "vrai" journalisme s'est vue récompensée (succès de son film "Merci patron"). C'est donc l'ensemble de ces conditions, et non pas les seuls individus qui sont envoyés au charbon, qui doit faire l'objet des jugements les plus sévères.
Contrairement à ce qu'écrit Michel Dalloni, ce que je reproche aux journalistes n'est pas qu'ils soient des « suppôts du système » : j'aurais plutôt tendance à les plaindre,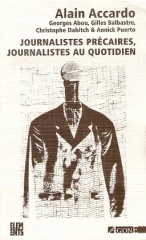 puisque, s'ils veulent gagner leur croûte, ils sont obligés de se soumettre aux ordres de la hiérarchie. Pour être édifié là dessus, il suffit de lire "Journal d'un JRI" de Gilles Balbastre, publié dans Journalistes au quotidien, d'Alain Accardo (le JRI ou journaliste reporter d'image, est le pauvre gars qu'on envoie filmer l'inondation, l'incendie, le lieu du crime, enfin bref toutes les images, si possible spectaculaires, à même de faire grimper l'audience : il me faut du saignant, coco).
puisque, s'ils veulent gagner leur croûte, ils sont obligés de se soumettre aux ordres de la hiérarchie. Pour être édifié là dessus, il suffit de lire "Journal d'un JRI" de Gilles Balbastre, publié dans Journalistes au quotidien, d'Alain Accardo (le JRI ou journaliste reporter d'image, est le pauvre gars qu'on envoie filmer l'inondation, l'incendie, le lieu du crime, enfin bref toutes les images, si possible spectaculaires, à même de faire grimper l'audience : il me faut du saignant, coco).
Ce qu'il faut reprocher au journalisme tel qu'il est pratiqué, c'est donc d'abord le cadre professionnel dans lequel il évolue. Mais il y a plus rédhibitoire : la presse est aujourd'hui pieds et poings liés entre les griffes de la logique ultralibérale, qui guide la marche du monde aujourd'hui. Je sais bien que l'argent est le nerf de la guerre, mais je crois qu'une véritable presse d'information n'a pas à se demander comment satisfaire les "attentes des lecteurs". En tant que lecteur, la seule façon de me satisfaire, c'est de m'informer de ce qui se passe en France, en Europe et dans le monde. Que les choix d'une rédaction se fassent en fonction de ce que les rédacteurs pensent être les goûts des lecteurs me semble une erreur grossière. Une déviance.
Plus avilissant encore pour la profession, ce sont les images des invraisemblables grappes de journalistes, photographes, cameramen et preneurs de sons qui courent s'agglutiner autour de l'événement et des personnes qui le font : Sarkozy paradant à cheval devant le bétail journalistique entassé sur une charrette tirée par un tracteur, lors d'un déplacement en Camargue, reste à cet égard un sommet de ridicule (et d'humiliant).

C'est la concurrence féroce que se livrent les organes de presse (écrit, audio, télé, web) qui produit ce ridicule, dont les limites sont même pulvérisées par les chaînes d'info en continu, avec des envoyés qui moulinent du vent en attendant que se passe la chose attendue.
Non, je ne hais pas les journalistes. Mais j'estime qu'on ne peut pas, à la fois, m'informer et me vendre un produit. Si j'ai de la haine, c'est à l'égard de ce qu'il faut bien appeler le "système" marchand dans lequel ils sont pris.
Mais là, on est dans l'insoluble. Un système condamné. Personne ne reculera. La logique de système est plus forte que tous les efforts des individus qui y sont pris.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journaux, lournalistes, journal le monde, presse quotidienne, michel dalloni, brownie flash kodak, information, vincent bolloré, pierre bergé, arnaud lagardère, patrick drahi, françois rufin, revue fakir, cfj, centre de formation des journalistes, les petits soldats du journalisme, film merci patron, alain accardo, journalistes au quotidien, gilles balbastre, journal d'un jri, nicolas sarkozy
mercredi, 15 juin 2016
LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT …
… OU LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI
3/3
Dans le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme, un mot m’a frappé parce qu’il apparaît à plusieurs reprises : c’est le mot « révolte », qui devrait selon lui fournir une sorte de guide moral à la pratique des métiers de la presse. Il s’insurge contre le fait que les jeunes journalistes qui entrent dans les écoles spécialisées (CFJ-Paris, ESJ-Lille, …) sont dressés à rendre compte du réel sans aucun recul, à s’en tenir au fait brut et à s’interdire tout commentaire et toute analyse.
A faire comme si la réalité décrite était naturelle, donnée une fois pour toutes et immuable. Combien de fois se fait-il rabrouer par les enseignants pour être sorti de ces clous-là, et s’entend reprocher de n’être pas assez « fun » ou « léger », et trop « intello », mais félicité quand il corrige au moyen d’une « somme de poncifs » (p.252) ?
On peut ne pas être d’accord avec lui : la révolte ne saurait être érigée en principe. Il suffit de décrire la réalité du bagne de Cayenne en 1923 dans une série d’articles retentissants pour qu’une prise de conscience s’opère. Le célèbre « porter la plume dans la plaie » d’Albert Londres, ça ne veut pas dire passer son temps à porter des jugements sur ce qu’on voit et clamer qu’on en est scandalisé. Cela veut dire rendre compte avec précision et exactitude de la réalité.
Le journaliste n’a pas à vouloir faire partager sa révolte à son lecteur : la réalité qu’il met en mots doit se suffire à elle-même, le grotesque ou l’insupportable d’un personnage ou d’une situation, correctement formulés, n’ont pas besoin de l’appui péremptoire de celui qui écrit. Et je dois dire que cet aspect du livre me fatigue.
C’est ainsi que Ruffin aurait utilement pu se contenter de montrer comment de très nombreux articles sont écrits dans l’urgence (délais très courts exigés) ce qui est en soi un très mauvais signe. Même chose en ce qui concerne la copie qu’il faut « pisser » à jet continu : « produire » est un Graal. Même chose pour la futilité des sujets que le « petit soldat » est obligé de traiter : Ruffin cite un Edmond, de RFI (Radio France Internationale), qui fait le siège pendant des mois du directeur de la FAO, et une fois l’entretien obtenu, se voit imposer par ses chefs « une interview sur la pluie et le beau temps » (p.230).
En revanche, le point fort de ce livre est de s’appuyer sur une base bibliographique d’une solidité à toute épreuve : les auteurs ne manquent pas pour ajouter une critique méthodique et, souvent, universitaire, à celle, disons plus « spontanée » de Ruffin. Il cite, entre trente auteurs, Serge Halimi (Les Nouveaux chiens de garde), Yves Roucaute (Splendeurs et misères des journalistes), des thèses, des enquêtes sociologiques, etc. La documentation personnelle et l’observation in vivo sont irréprochables.
Ce qui ressort avant tout, au sujet de l’exercice de la profession, c’est son extrême précarisation au fil du temps, et j’imagine que ça ne s’est pas arrangé depuis 2003. C’est ainsi qu’un journaliste en exercice a enchaîné plus de 20 CDD, avant de se voir éjecté au moment de signer le fameux CDI tant promis. Et ce n’est pas le seul exemple cité par François Ruffin. Cette situation éminemment fragile fait du journaliste un jouet manœuvrable à merci entre les mains des pouvoirs qui s’exercent au sein des rédactions.
Il faut savoir qu’à la date de publication, le taux de « journalistes précaires » (titre d’un livre du sociologue Alain Accardo) dépassait les 50%. Combien de journalistes sont aujourd’hui assez assurés de leur poste pour bénéficier de l’indépendance d’esprit et de la liberté suffisante pour choisir leur sujet et écrire leurs articles comme ils l’entendent ? Cette organisation du métier, tout à fait méconnue, devrait susciter une méfiance accrue de la part des lecteurs.
Mais le pire de tout ce qu’on découvre dans le livre de François Ruffin, même s’il se défend de tout règlement de compte, c’est l’image que son livre donne du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), cette école d’élite dont sortent les grands noms qui brillent aujourd’hui au panthéon de la profession : Pierre Lescure, Laurent Joffrin, Patrick Poivre d’Arvor, Franz-Olivier Giesbert, Paul Amar, etc.
C’est en effet une élite : « Deux mille journalistes, en tout, sont issus du Centre entre 1947 et 2002. Deux petits milliers, à peine. Une goutte d’eau dans l’océan des 32.758 titulaires d’une carte de presse. Mais cette frange-là compte dans les supports qui comptent : plus de cent à l’AFP, une soixantaine au Monde, quarante à Libération, une trentaine à TF1, cinquante à France 2, une vingtaine au Figaro, à L’Express, à Europe 1, etc. Et dans leurs entreprises, ces diplômés stagnent rarement à la base » (p.14). Et c’est cette élite qui, jouant les interfaces entre les sphères du pouvoir (politique, industriel, financier, etc.) et les structures hiérarchiques des journaux (tous médias confondus), formatent en direction des populations consommatrices les représentations du monde qu’il convient qu’elles adoptent. C’est cette élite qui donne à la vie du plus grand nombre le sens qui sert le mieux les intérêts du tout petit nombre qui en profite.
La situation dans laquelle se trouve le CFJ en 2003 est assez particulière. L’école a déposé le bilan, et doit s’adapter aux « nouvelles nécessités ». Les bailleurs de fonds qui ont permis au CFJ de perdurer posent évidemment leurs exigences.
On ne s’étonnera donc pas que les futurs employés des entreprises de presse soient formatés selon le cahier des charges fixé par eux. Cela fonctionne comme tout système : l’investisseur (Dassault, Lagardère, Drahi et Cie) achète un médium (journal, magazine, radio, télé, web) qu’il fait fonctionner grâce à une équipe de rédaction qu’il paie, composée de journalistes qui auront été formés par une école au financement de laquelle ils contribuent.
On ne s’étonnera donc pas que les murs de l’ « indépendance » des journalistes soient de plus en plus lézardés, d’autant plus qu’ils sont battus en brèche par les chantages éventuels des annonceurs, qui n’aiment pas qu’un rédacteur se permette dans un article de contredire les bienfaits d’une marchandise vantée par l’encart publicitaire avec lequel il voisine.
Bref, sale temps sur la planète « Journalisme ». Comme le dit le titre d’un livre de Bernard Morrot, cité par Fraçois Ruffin : France, ta presse fout le camp (L’Archipel, 2000). De profundis clamavi ad Te, Capital. Le vrai journalisme, celui qu'on idéalise (Albert Londres !...), contredit par sa nature même, de plus en plus, l'évolution irrésistible de la société spectaculaire-marchande. On sait à peu près quelles salades les marchands se proposent de nous vendre. Quant à eux, ils savent exactement de quel genre de journalistes ils ont besoin pour bonimenter le bon peuple : il suffit de les obliger, en les précarisant, à venir quémander leur pitance dans la main des bailleurs de fonds.
Les Petits soldats du journalisme : que voilà un petit livre diablement utile pour vous désenchanter de la lecture de la presse ! Ma foi, malgré ses aspects contestables, François Ruffin y propose un vrai travail de bon journaliste !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, journal le monde, journal libération, journal le figaro, paris match, dassault, lagardère, patrick drahi, centre de formation des journalistes, albert londres, pierre lescure, laurent joffrin, patrick poivre d'arvor, franz-olivier giesbert, paul amar, l'express, alain accardo, journalistes précaires, serge halimi le monde diplomatique, les nouveaux chiens de garde, yves roucaute splendeurs et misères des journalistes
mardi, 14 juin 2016
LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT …
… OU LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI
2/3
Donc, dans ses Pointes sèches, Philippe Meyer laissait entendre, par la phrase que j’ai citée hier, que la profession journalistique actuelle était essentiellement moutonnière, puisqu’il proposait qu’elle adoptât pour saint patron le personnage rabelaisien de Panurge. Précisons que, dans le Quart livre de maître Alcofribas, Panurge est celui qui se contente de mettre en lumière, en dramatique et en burlesque, la nature moutonnière du mouton.
Dindenault, ce marchand méprisant et imbu de lui-même, lui vend une bête hors de prix (« trois livres tournoys », soit le prix de quatre ou plus), sans se douter une seconde de l’intention du pendard qui contrefaisait l’idiot pour mieux provoquer sa perte (« Jamais homme ne me feist desplaisir sans repentance, ou en ce monde, ou en l’aultre », déclare-t-il ensuite à Frère Jean). Dindenault et ses moutons périssent noyés misérablement.
Car c’est l’un des prodigieux effets de la mise en concurrence, si chère au cœur des djihadistes du libre-échange : tout le monde copie tout le monde, puisque tout est mesuré, pesé et calibré à l’aune de la sacro-sainte audience. Dans Les Petits soldats du journalisme, François Ruffin raconte en détail les dégâts que produit une telle conception mimétique du métier, une conception qui oriente impérieusement la façon dont les écoles de journalistes l’enseignent aux futurs praticiens.
Et ce sont ces troufions taillables et corvéables à merci, employés dans des entreprises de presse possédées par les cadors et tycoons de l’entreprise, de l’économie et de la finance (Bolloré de Canal+, Lagardère de Elle, Paris-Match et quelques autres, Dassault du Figaro, Drahi de Libération, Bergé-Niel-Pigasse du Monde, et combien d’autres ?), qui confectionnent inlassablement, jour après jour, les images et les mots dont il faut que les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs des différents médias se convainquent qu’ils nous disent le monde tel qu’il est de façon authentique et véridique.
Quelles sont les caractéristiques des métiers actuels (selon le médium pratiqué) du journalisme, selon François Ruffin ? Je viens de parler de la première : l’uniformisation de l’information provoquée par le mimétisme, lui-même induit par la concurrence féroce que se livrent des médias en proie à la frénésie de la course à l’audience. Résultat : tous les canaux d’information racontent les mêmes choses, d’où l’effet de masse provoqué par ce rétrécissement saisissant de la réalité du monde : « Le ratage, c’est de ne pas publier la même chose que les autres au même moment », déclare Georges Abou, cité par l’auteur (p.78), intervenu dans le livre de Sylvain Accardo Journalistes au quotidien (Le Mascaret, 1995).
Ruffin conclut : « C’est un réel réduit à une peau de chagrin que nous offrons à l’opinion » (p.67). Il ne s’agit plus de raconter le monde, mais de « satisfaire » un « besoin ». Il faut servir au public ce que les journalistes « pensent que "leur public" a envie d’entendre » (p.131), c’est-à-dire servir la soupe : « On s’intéresse d’abord au lecteur : de quoi veulent-ils qu’on parle ? De quoi parlent-ils avec leurs amis ? C’est ça qui doit faire la une du lendemain » (p.134, un rédac-chef adjoint du Parisien).
« Tonalité identique chez un cadre du groupe Prisma : " On met dans le journal ce que le lecteur souhaite avoir" » (ibid.). L’auteur va même jusqu’à parler de « dictature du lectorat ». Moi j’appelle ça la servilité de la presse envers les préoccupations les plus futiles et les plus basses que ses responsables imaginent et cultivent chez les lecteurs, avec une seule obsession : vendre, créant un vortex où le pire ne peut qu’appeler le pire. Voilà ce que les écoles de journalistes donnent comme consignes aux jeunes. Voilà ce que les journaux offrent au lecteur comme représentation du monde tel qu’il est. Il s’agit de satisfaire le consommateur avant de lui raconter et expliquer ce qui se passe dans le monde.
Même le « journal de référence » s’y est mis. J’ai récemment été halluciné que Le Monde consacre deux grandes pages à l’interview de Satan Ibrahimovic : c’est ça, la « référence » ? Soyons sérieux. Inutile de dire ce que j’ai fait de ces deux pages : elles ne s’en sont pas remises. Qu’un tel personnage puisse même faire débat au sein de la rédaction du Monde (chronique « Ainsi parlait Zlatan Ibra » de Benoît Hopquin datée 14 juin 2016) est proprement ahurissant.
Si la presse française est en crise grave, c’est peut-être aussi à cause de cette logique mercantile, qui tire la qualité de l’information vers le caniveau. La population est-elle à ce point décérébrée que les journaux renoncent à ce point à l’instruire correctement sur les parties les plus nobles de la réalité ? Après tout, ce n’est pas impossible. Si c’est le cas, c’est très mauvais signe.
Un autre trait dominant de la presse quotidienne : rester constamment à l’affût de l’événement. Que seraient le tâcheron, que serait le soutier de l’information dans le « fil AFP » ? François Ruffin décrit les journées des étudiants du CFJ (Centre de Formation des Journalistes), passées à attendre l’événement : on ne sait jamais, il faut être prêt, il faut rester vigilant et pouvoir réagir à tout instant. Résultat : on s’ennuie, on tue le temps autour de la machine à café.
Au surplus, garder la truffe dans le gazon de l'événement, c'est le meilleur moyen de s'interdire tout analyse d'une situation, de porter un regard tant soit peu critique et distancié sur le monde. C'est le meilleur moyen de ne rien comprendre à ce qui se passe. Un événement chasse le précédent. Cette presse-là est une presse de l'oubli permanent, une presse de sable mouvant, une presse de conduit d'évacuation du réel.
Pauvres apprentis journalistes, vraiment.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, journalisme, journalistes, presse quotidienne, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, philippe meyer pointes sèches, françois rabelais, quart livre, alcofribas nasier, moutons de panurge, panurge frèere jean des entommeures, vincent bolloré, canal+, arnaud lagardère, paris match, serge dassault, journal le figaro, patrick drahi, journal libération, bergé niel pigasse, journal le monde, sylvain accardo, journalistes au quotidien, journal le parisien, zlatan ibrahimovic, agence france presse, centre de formation des journalistes

