vendredi, 15 mars 2019
UN PORTRAIT DE MACRON ...
...PAR UN "AMI QUI LUI VEUT DU BIEN"
J’ai découvert les coulisses du métier de journaliste dans le livre de François Ruffin, Les Petits soldats du journalisme (Les Arènes, 2003). Ce n’est certes pas un livre neutre : il rue dans les brancards, il est impitoyable avec les règles, les méthodes et, disons-le, l’idéologie inculquées par le CFJ (Centre de Formation des Journalistes, Paris) aux étudiants qui se voient un avenir dans la presse écrite ou audiovisuelle. J’avais embrayé sur Journalistes au quotidien d’Alain Accardo, qui décrivait la précarité grandissante des journalistes, et souvent la futilité des missions confiées par leur N+1, je me souviens en particulier du passage concernant les JRI (Journalistes Reporters Image, qui travaillent pour la télé, la grande dévoreuse de spectaculaire, et qui sont parachutés sur le terrain dès qu'il y a une inondation, un glissement de terrain, un tremblement de terre, etc.).
J’avais trouvé désagréable en plusieurs occasions le ton du livre de Ruffin, à commencer par une agressivité déplacée : il a beau soutenir je ne sais plus où que ce qui le guide c’est d’abord l’enquête, il ne peut s’empêcher de mordre, et c’est parfois pénible. Ce qui atténue le désagrément, c’est qu’il se considère comme plus ou moins minable et raté, mais selon lui, c’est ce qui le rapproche de « La France d’en bas », à laquelle n’a jamais appartenu Emmanuel Macron, son ancien condisciple à La Providence à Amiens, qu’il présente comme imbu de lui-même et jamais effleuré par le doute sur ses espoirs, ses aptitudes et ses possibilités.
 François Ruffin a écrit Ce Pays que tu ne connais pas (Les Arènes, 2019) pour dresser un portrait en pied de celui qui est devenu président de la République, un livre qu’il présente quelque part comme un « uppercut au foie », oxymore amusant pour qui s’intéresse un peu au « noble art » de la boxe (sauf erreur, « upper » veut dire « vers le haut »), mais bon. Les « bonnes feuilles » publiées dans Fakir (n°88, janvier-avril 2019) sont intéressantes à plus d’un titre.
François Ruffin a écrit Ce Pays que tu ne connais pas (Les Arènes, 2019) pour dresser un portrait en pied de celui qui est devenu président de la République, un livre qu’il présente quelque part comme un « uppercut au foie », oxymore amusant pour qui s’intéresse un peu au « noble art » de la boxe (sauf erreur, « upper » veut dire « vers le haut »), mais bon. Les « bonnes feuilles » publiées dans Fakir (n°88, janvier-avril 2019) sont intéressantes à plus d’un titre.
En premier lieu, Macron y est dépeint comme un garçon qui a été dorloté dans un cocon de langage par sa grand-mère Manette. Macron se meut en effet dans l’univers des mots plus aisément qu’un poisson dans l’eau, comme si, pour lui, prononcer un mot donnait l’existence à un objet ou à un être qu’il tient dans sa main.
Ce rapport aisé au langage explique sans doute pourquoi le président s’est révélé un orateur doué dès sa campagne électorale, et qu’en matière de discours, il laisse sur place sans effort ses deux prédécesseurs, qui n’étaient pas des tribuns, tant le premier était sommaire et le second pitoyable. A part ça, il faudrait quand même que quelqu’un dise à Ruffin qu’Oulipo (de Queneau, Le Lionnais et quelques épigones, Perec, la recrue majeure, ne venant qu’ensuite) ne veut pas dire « Ouvroir de littérature poétique ». Passons.
Le revers de la médaille est évidemment le rapport que le bonhomme Macron entretient avec le granit de la réalité, auquel son front ne s’est jamais heurté. Car en deuxième lieu, l’élève brillant, qui a été admiré par beaucoup de camarades et même par des professeurs (l’un d'eux humilie sa propre fille en parlant à la table de famille de « ce garçon exceptionnel ») accomplit un parcours semé de pétales de rose, un peu comme sur un petit nuage, comme s’il avait toujours été entouré de louanges, de caresses et de courtisans. C'est peut-être comme ça que le pouvoir s'apprend, mais cela induit un rapport pour le moins "feutré" et distant avec la réalité commune et partagée avec le plus grand nombre. Son front porte le signe de l'élite.
C'est à cause de ce parcours lisse et préservé des intempéries, Macron ne s’étant jamais colleté avec les duretés de la vie, qu'on ne voit pas comment il pourrait trouver des solutions à celles du monde : « Toute votre adolescence se déroule, dirait-on, sous les hourras et les vivats ! Sous un concert d’applaudissements permanents ! ». Ce n’est certes pas le cas de François Ruffin : « … j’ai connu ça, des années durant, la médiocrité, la nullité, le sentiment de n’être rien et de ne rien valoir … ». Mais il en fait un argument : « J’en tire une force, de toutes ces faiblesses : l’empathie. Dans les blessures des autres, j’entends mes blessures ».
J’ai tendance à lui faire crédit de cette affirmation : les voix fêlées de Bessie Smith et Billie Holiday, deux fracassées de la vie, m’émeuvent davantage que les virtuoses et rayonnantes de plénitude Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan. L’empathie est l’enfant de la souffrance. L’empathie ne s’apprend pas dans les livres : elle découle de la vie. Les premiers de la classe, ceux qui n’ont jamais été mis en difficulté, ne peuvent pas savoir ça, tout simplement parce qu’ils ne l'ont jamais ressenti. La dure réalité du monde a la consistance d'une abstraction dans l'esprit de Macron, pour qui elle n'est qu'un ensemble de données chiffrées et d' "objets de dossiers à traiter".
En troisième lieu, François Ruffin met le doigt sur ce qui fait la plus grande faiblesse d’Emmanuel Macron à son avis (et au mien). Bénéficiant de toutes les facilités, dont celle de la parole, il séduit et fascine, mais il n’y a pas grand-chose derrière. Et les gogos gobent. Ainsi témoigne Jean-Baptiste de Froment, ancien "collègue" au lycée Henri IV: « Au départ, on était impressionnés car il était très à l’aise, il était assez bon en name dropping culturel. Puis les premières notes sont tombées et là on s’est dit "c’est du pipeau". Il parlait très bien, singeant le langage universitaire à la perfection, mais c’était au fond assez creux ».
Comment fait-il, ayant raté l’entrée à Normal Sup’, pour être qualifié d’ancien « normalien » dans les magazines, voire « normalien d’honneur » par le journaliste Alain-Gérard Slama ? Mystère. Toujours est-il que cette « erreur » ouvre bien des perspectives sur un aspect crucial de la personnalité du président : le bluff, cette poudre magique faite pour les gogos intrinsèques. La même « erreur » est commise par plusieurs organes de presse qui font de Macron un titulaire de doctorat, alors que son supposé maître de thèse, le fameux Etienne Balibar, « n’en conserve "strictement aucun souvenir" », ulcéré par le culot de l’homme qui invoque indûment son nom.
Quant au patronage philosophique de "saint Paul Ricœur" sous lequel s’est placé publiquement Macron, il est, selon Ruffin, complaisamment amplifié : « Qu’avez-vous fait pour ce philosophe ? De l’archivage, un peu de documentation, les notes de bas de page, la bibliographie mise en forme ».
La philosophe Myriam Revault-d’Allonnes (membre du fonds Ricœur, s'il vous plaît) remet impitoyablement les choses en place : « Il en tire un bénéfice totalement exagéré. Ricœur était sensible à la notion de solidarité. Or, chez Macron, le conservatisme est assimilé à l’archaïsme supposé des acquis sociaux et le progressisme à la flexibilité et la dérégulation économique. Ce n’est ni un intellectuel, ni un homme d’Etat, mais un technocrate, certes intelligent et cultivé, mais représentant une pensée de droite libérale assez classique ». Emmanuel Macron ? Pas un homme d’Etat, mais un technocrate de droite. Du bluff, on vous dit.
Son culot lui fait introduire son livre Révolution par cette phrase incroyable : « Affronter la réalité du monde nous fera retrouver l’espérance ». Il faut oser, quand on est resté constamment bien à l’abri des réalités du monde et de ses vicissitudes.
Je fais volontairement abstraction du flot de commentaires de François Ruffin, qui disent davantage sur lui-même que sur la tête qui lui sert de punching-ball : expression souvent agressive ou caricaturale, jugements dont le lecteur se fout comme de l'an quarante et qui transforment le combat politique en jeu de fléchettes ou en tir aux pipes forain. Toutes ses rancœurs et diatribes sont carrément inutiles et n'apprennent rien à personne. Je n'ai strictement rien à faire de ses états d'âme, quand il laisse le désir d'épanchement de son moi envahir son métier de journaliste. Il vaut mieux décrire à la façon d'un scientifique ou d'un journaliste, il ne sert à rien de lancer des piques, qui disqualifient finalement le discours qu'on voulait critique.
En revanche, tout ce qui relate des faits ou des témoignages de première main est impeccable. Quand Ruffin se contente de faire son métier, le propos est imparable, car les faits se suffisent à eux-mêmes. Je passe sous silence les deux dernières parties de ces « bonnes feuilles » : « Au contact, le candidat – 2017 » et « Monsieur Thiers startupper, le président – 2019 », tout cela étant largement connu, du fait de la médiatisation servile qui fait d’Emmanuel Macron un point fixe national (un point de fixation ?) depuis son élection. A la réflexion, je ne lirai sans doute pas le livre de Ruffin.
Il reste que la France, en 2017, s’est mise entre les pattes d’un homme dangereux, dont le projet, raconté par un autre journaliste (je ne sais plus si c'est Jean-Dominique Merchet ou Marc Endeweld, le 5 décembre 2018 sur France Culture) avant l’accession de Macron à la présidence, est d’en finir une bonne fois pour toutes avec le système de protection sociale français, sans parler des intentions présidentielles de cravacher le pays jusqu'au sang, jusqu’à ce que tout le monde, de gré ou de force, soit enfin entré dans la féroce compétition économique qui ravage la planète et l'humanité. Et tant pis pour les attardés, les paresseux, les Gaulois, les impotents ! Ils sont attendus de pied ferme dans les "ténèbres extérieures".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal fakir, françois ruffin, journalistes, éditions les arènes, cfj, centre de formation des journalistes, jounalistes au quotidien, alain accardo, jri, journaliste reporter image, france d'en bas, france d'en haut, emmanuel macron, lycée la providence amiens, jésuites, françois ruffin ce pays que tu ne connais pas, président de la république, élection présidentielle, oulipo, raymmond queneau, françois le lionnais, georges perec, ouvroir de littérature potentielle, bessie smith, billie holiday, jean-baptiste de froment, alain-gérard slama, étienne balibar, paul ricoeur, myriam revault-d'allonnes, france culture, france, société
samedi, 03 juin 2017
JOURNALISTES MAL AIMÉS
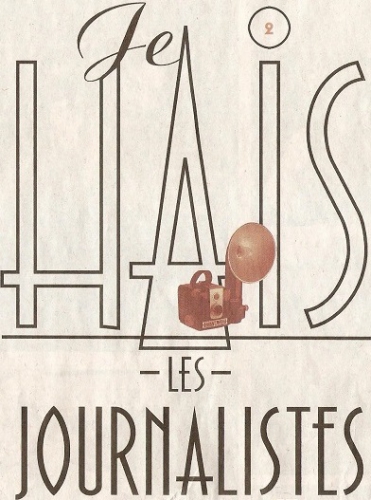
Titre - de taille démesurée : toute la moitié supérieure de la page !! Le Monde a les moyens de gâcher du papier. - de l'article de Michel Dalloni, paru dans le supplément "l'époque" du Monde des 7/8 mai 2017. On notera le choix "vintage", pour l'illustrer, du Brownie flash de Kodak. Comme dirait Brigitte Fontaine : "J'fais un genre".
Non, monsieur Dalloni, je ne hais pas les journalistes. Et je ne suis pas d'accord non plus avec le "chapeau" de votre article : « Sale temps pour les journalistes. Accusés d'être les suppôts du système, conspués par les politiques, délaissés par les lecteurs, ils ne font plus rêver. Mais pourquoi tant de haine ? ». J'avoue que "ils ne font plus rêver" m'a fait bondir.
Car si la profession fait rêver des lycéens qui ambitionnent de l'exercer (ce qui est votre cas, puisque vous commencez par cette confidence : « Toute ma vie j'ai rêvé d'être un reporter. »), je vous apprends que je n'achète pas Le Monde pour rêver mais exclusivement pour m'informer, et j'espère n'être pas le dernier dinosaure à considérer ainsi le rôle de la presse. L'insupportablement futile M, le magazine que Le Monde vend avec le numéro du samedi (j'imagine que la raison de son existence est purement financière, vu la place de la publicité), donne à craindre que nous autres dinosaures avons du souci à nous faire pour notre pitance. Je n'en reviens toujours pas de ce qu'un "journal de référence", puisse envoyer des journalistes pour rendre compte des défilés de mode ou des événements sportifs : comment peut-on tomber si bas ? Je sais, je ne suis pas "mainstream".
A la rigueur, parfois, j'apprécie une analyse, et même, pourquoi pas, une page "débats", un commentaire, à la condition que l'information reste première. J'estime aussi tout à fait regrettable l'invasion des pages du Monde par les illustrations (photos ou autre), qui ne font que flatter la paresse. Alors, ne nous trompons pas de débat. Individuellement, les journalistes font le boulot qu'on leur demande de faire, en général plutôt bien, même si, comme partout, il y a des "brebis galeuses".
Non, si je dis souvent du mal de la presse, des journaux que je lis et de ceux qui y écrivent, ce n'est pas aux individus que j'en ai. Si j'avais à m'en prendre à quelqu'un, ce ne serait pas à une personne en particulier, mais plutôt à une entité forcément plus abstraite : celle qui fabrique les conditions d'exercice de la profession. En termes plus connotés Karl Marx : à l'infrastructure plutôt qu'à la superstructure.
A mesure qu'on gravit les étages de l'édifice qui organise la profession journalistique, les questions se font de plus en plus pressantes et fondamentales. Qui est chef de service ? Qui directeur de la rédaction ? Qui éditorialiste ? Qu'est-ce qui les fait nommer à leur poste ? Qui propriétaire ? Quels rapports entre la société des rédacteurs et celui-ci, je veux dire le degré d'assujettissement des contenus à la stratégie de celui-ci (disons pêle-mêle : Bolloré, Bergé, Lagardère, Drahi, bref, tous ceux qui ont de l'argent et voudraient bien influencer) ? Qui décide des sujets ? Qui donne le dernier feu vert à la publication des articles ? Ceux-ci sont-ils retouchés par le rédac-chef ? A quelles conditions grimpe-t-on dans la hiérarchie ? Je n'oublie pas que je figure aussi parmi les payeurs, puisque l'oxygène de l'argent de l'Etat maintient plusieurs titres en état de survie artificielle, au nom du pluralisme et de la "liberté d'expression" qui, en l'occurrence, a bon dos. Je dirais plutôt qu'il faut à tout prix maintenir l'apparence (le mythe) de la pluralité : nous vivons dans un régime fictif de "liberté de la presse".
Encore deux questions, indiscrètes celles-là : 1 - Par qui sont financés les instituts 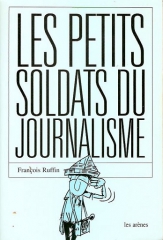 de formation des futurs journalistes ? 2 - Quels professeurs forment les futurs journalistes ? Je ne connais que le CFJ, et encore : par le biais du livre Les Petits soldats du journalisme, de François Rufin, qui avait peut-être quelques comptes à régler, mais dont la charge était étayée par des faits convaincants. Si j'en crois l'auteur, les apprentis apprennent surtout à servir la soupe. Rufin l'a d'ailleurs payé d'un long ostracisme, et ce n'est que depuis peu que sa conception du "vrai" journalisme s'est vue récompensée (succès de son film "Merci patron"). C'est donc l'ensemble de ces conditions, et non pas les seuls individus qui sont envoyés au charbon, qui doit faire l'objet des jugements les plus sévères.
de formation des futurs journalistes ? 2 - Quels professeurs forment les futurs journalistes ? Je ne connais que le CFJ, et encore : par le biais du livre Les Petits soldats du journalisme, de François Rufin, qui avait peut-être quelques comptes à régler, mais dont la charge était étayée par des faits convaincants. Si j'en crois l'auteur, les apprentis apprennent surtout à servir la soupe. Rufin l'a d'ailleurs payé d'un long ostracisme, et ce n'est que depuis peu que sa conception du "vrai" journalisme s'est vue récompensée (succès de son film "Merci patron"). C'est donc l'ensemble de ces conditions, et non pas les seuls individus qui sont envoyés au charbon, qui doit faire l'objet des jugements les plus sévères.
Contrairement à ce qu'écrit Michel Dalloni, ce que je reproche aux journalistes n'est pas qu'ils soient des « suppôts du système » : j'aurais plutôt tendance à les plaindre,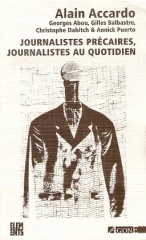 puisque, s'ils veulent gagner leur croûte, ils sont obligés de se soumettre aux ordres de la hiérarchie. Pour être édifié là dessus, il suffit de lire "Journal d'un JRI" de Gilles Balbastre, publié dans Journalistes au quotidien, d'Alain Accardo (le JRI ou journaliste reporter d'image, est le pauvre gars qu'on envoie filmer l'inondation, l'incendie, le lieu du crime, enfin bref toutes les images, si possible spectaculaires, à même de faire grimper l'audience : il me faut du saignant, coco).
puisque, s'ils veulent gagner leur croûte, ils sont obligés de se soumettre aux ordres de la hiérarchie. Pour être édifié là dessus, il suffit de lire "Journal d'un JRI" de Gilles Balbastre, publié dans Journalistes au quotidien, d'Alain Accardo (le JRI ou journaliste reporter d'image, est le pauvre gars qu'on envoie filmer l'inondation, l'incendie, le lieu du crime, enfin bref toutes les images, si possible spectaculaires, à même de faire grimper l'audience : il me faut du saignant, coco).
Ce qu'il faut reprocher au journalisme tel qu'il est pratiqué, c'est donc d'abord le cadre professionnel dans lequel il évolue. Mais il y a plus rédhibitoire : la presse est aujourd'hui pieds et poings liés entre les griffes de la logique ultralibérale, qui guide la marche du monde aujourd'hui. Je sais bien que l'argent est le nerf de la guerre, mais je crois qu'une véritable presse d'information n'a pas à se demander comment satisfaire les "attentes des lecteurs". En tant que lecteur, la seule façon de me satisfaire, c'est de m'informer de ce qui se passe en France, en Europe et dans le monde. Que les choix d'une rédaction se fassent en fonction de ce que les rédacteurs pensent être les goûts des lecteurs me semble une erreur grossière. Une déviance.
Plus avilissant encore pour la profession, ce sont les images des invraisemblables grappes de journalistes, photographes, cameramen et preneurs de sons qui courent s'agglutiner autour de l'événement et des personnes qui le font : Sarkozy paradant à cheval devant le bétail journalistique entassé sur une charrette tirée par un tracteur, lors d'un déplacement en Camargue, reste à cet égard un sommet de ridicule (et d'humiliant).

C'est la concurrence féroce que se livrent les organes de presse (écrit, audio, télé, web) qui produit ce ridicule, dont les limites sont même pulvérisées par les chaînes d'info en continu, avec des envoyés qui moulinent du vent en attendant que se passe la chose attendue.
Non, je ne hais pas les journalistes. Mais j'estime qu'on ne peut pas, à la fois, m'informer et me vendre un produit. Si j'ai de la haine, c'est à l'égard de ce qu'il faut bien appeler le "système" marchand dans lequel ils sont pris.
Mais là, on est dans l'insoluble. Un système condamné. Personne ne reculera. La logique de système est plus forte que tous les efforts des individus qui y sont pris.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journaux, lournalistes, journal le monde, presse quotidienne, michel dalloni, brownie flash kodak, information, vincent bolloré, pierre bergé, arnaud lagardère, patrick drahi, françois rufin, revue fakir, cfj, centre de formation des journalistes, les petits soldats du journalisme, film merci patron, alain accardo, journalistes au quotidien, gilles balbastre, journal d'un jri, nicolas sarkozy
mercredi, 15 juin 2016
LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT …
… OU LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI
3/3
Dans le livre de François Ruffin Les Petits soldats du journalisme, un mot m’a frappé parce qu’il apparaît à plusieurs reprises : c’est le mot « révolte », qui devrait selon lui fournir une sorte de guide moral à la pratique des métiers de la presse. Il s’insurge contre le fait que les jeunes journalistes qui entrent dans les écoles spécialisées (CFJ-Paris, ESJ-Lille, …) sont dressés à rendre compte du réel sans aucun recul, à s’en tenir au fait brut et à s’interdire tout commentaire et toute analyse.
A faire comme si la réalité décrite était naturelle, donnée une fois pour toutes et immuable. Combien de fois se fait-il rabrouer par les enseignants pour être sorti de ces clous-là, et s’entend reprocher de n’être pas assez « fun » ou « léger », et trop « intello », mais félicité quand il corrige au moyen d’une « somme de poncifs » (p.252) ?
On peut ne pas être d’accord avec lui : la révolte ne saurait être érigée en principe. Il suffit de décrire la réalité du bagne de Cayenne en 1923 dans une série d’articles retentissants pour qu’une prise de conscience s’opère. Le célèbre « porter la plume dans la plaie » d’Albert Londres, ça ne veut pas dire passer son temps à porter des jugements sur ce qu’on voit et clamer qu’on en est scandalisé. Cela veut dire rendre compte avec précision et exactitude de la réalité.
Le journaliste n’a pas à vouloir faire partager sa révolte à son lecteur : la réalité qu’il met en mots doit se suffire à elle-même, le grotesque ou l’insupportable d’un personnage ou d’une situation, correctement formulés, n’ont pas besoin de l’appui péremptoire de celui qui écrit. Et je dois dire que cet aspect du livre me fatigue.
C’est ainsi que Ruffin aurait utilement pu se contenter de montrer comment de très nombreux articles sont écrits dans l’urgence (délais très courts exigés) ce qui est en soi un très mauvais signe. Même chose en ce qui concerne la copie qu’il faut « pisser » à jet continu : « produire » est un Graal. Même chose pour la futilité des sujets que le « petit soldat » est obligé de traiter : Ruffin cite un Edmond, de RFI (Radio France Internationale), qui fait le siège pendant des mois du directeur de la FAO, et une fois l’entretien obtenu, se voit imposer par ses chefs « une interview sur la pluie et le beau temps » (p.230).
En revanche, le point fort de ce livre est de s’appuyer sur une base bibliographique d’une solidité à toute épreuve : les auteurs ne manquent pas pour ajouter une critique méthodique et, souvent, universitaire, à celle, disons plus « spontanée » de Ruffin. Il cite, entre trente auteurs, Serge Halimi (Les Nouveaux chiens de garde), Yves Roucaute (Splendeurs et misères des journalistes), des thèses, des enquêtes sociologiques, etc. La documentation personnelle et l’observation in vivo sont irréprochables.
Ce qui ressort avant tout, au sujet de l’exercice de la profession, c’est son extrême précarisation au fil du temps, et j’imagine que ça ne s’est pas arrangé depuis 2003. C’est ainsi qu’un journaliste en exercice a enchaîné plus de 20 CDD, avant de se voir éjecté au moment de signer le fameux CDI tant promis. Et ce n’est pas le seul exemple cité par François Ruffin. Cette situation éminemment fragile fait du journaliste un jouet manœuvrable à merci entre les mains des pouvoirs qui s’exercent au sein des rédactions.
Il faut savoir qu’à la date de publication, le taux de « journalistes précaires » (titre d’un livre du sociologue Alain Accardo) dépassait les 50%. Combien de journalistes sont aujourd’hui assez assurés de leur poste pour bénéficier de l’indépendance d’esprit et de la liberté suffisante pour choisir leur sujet et écrire leurs articles comme ils l’entendent ? Cette organisation du métier, tout à fait méconnue, devrait susciter une méfiance accrue de la part des lecteurs.
Mais le pire de tout ce qu’on découvre dans le livre de François Ruffin, même s’il se défend de tout règlement de compte, c’est l’image que son livre donne du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), cette école d’élite dont sortent les grands noms qui brillent aujourd’hui au panthéon de la profession : Pierre Lescure, Laurent Joffrin, Patrick Poivre d’Arvor, Franz-Olivier Giesbert, Paul Amar, etc.
C’est en effet une élite : « Deux mille journalistes, en tout, sont issus du Centre entre 1947 et 2002. Deux petits milliers, à peine. Une goutte d’eau dans l’océan des 32.758 titulaires d’une carte de presse. Mais cette frange-là compte dans les supports qui comptent : plus de cent à l’AFP, une soixantaine au Monde, quarante à Libération, une trentaine à TF1, cinquante à France 2, une vingtaine au Figaro, à L’Express, à Europe 1, etc. Et dans leurs entreprises, ces diplômés stagnent rarement à la base » (p.14). Et c’est cette élite qui, jouant les interfaces entre les sphères du pouvoir (politique, industriel, financier, etc.) et les structures hiérarchiques des journaux (tous médias confondus), formatent en direction des populations consommatrices les représentations du monde qu’il convient qu’elles adoptent. C’est cette élite qui donne à la vie du plus grand nombre le sens qui sert le mieux les intérêts du tout petit nombre qui en profite.
La situation dans laquelle se trouve le CFJ en 2003 est assez particulière. L’école a déposé le bilan, et doit s’adapter aux « nouvelles nécessités ». Les bailleurs de fonds qui ont permis au CFJ de perdurer posent évidemment leurs exigences.
On ne s’étonnera donc pas que les futurs employés des entreprises de presse soient formatés selon le cahier des charges fixé par eux. Cela fonctionne comme tout système : l’investisseur (Dassault, Lagardère, Drahi et Cie) achète un médium (journal, magazine, radio, télé, web) qu’il fait fonctionner grâce à une équipe de rédaction qu’il paie, composée de journalistes qui auront été formés par une école au financement de laquelle ils contribuent.
On ne s’étonnera donc pas que les murs de l’ « indépendance » des journalistes soient de plus en plus lézardés, d’autant plus qu’ils sont battus en brèche par les chantages éventuels des annonceurs, qui n’aiment pas qu’un rédacteur se permette dans un article de contredire les bienfaits d’une marchandise vantée par l’encart publicitaire avec lequel il voisine.
Bref, sale temps sur la planète « Journalisme ». Comme le dit le titre d’un livre de Bernard Morrot, cité par Fraçois Ruffin : France, ta presse fout le camp (L’Archipel, 2000). De profundis clamavi ad Te, Capital. Le vrai journalisme, celui qu'on idéalise (Albert Londres !...), contredit par sa nature même, de plus en plus, l'évolution irrésistible de la société spectaculaire-marchande. On sait à peu près quelles salades les marchands se proposent de nous vendre. Quant à eux, ils savent exactement de quel genre de journalistes ils ont besoin pour bonimenter le bon peuple : il suffit de les obliger, en les précarisant, à venir quémander leur pitance dans la main des bailleurs de fonds.
Les Petits soldats du journalisme : que voilà un petit livre diablement utile pour vous désenchanter de la lecture de la presse ! Ma foi, malgré ses aspects contestables, François Ruffin y propose un vrai travail de bon journaliste !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, journal le monde, journal libération, journal le figaro, paris match, dassault, lagardère, patrick drahi, centre de formation des journalistes, albert londres, pierre lescure, laurent joffrin, patrick poivre d'arvor, franz-olivier giesbert, paul amar, l'express, alain accardo, journalistes précaires, serge halimi le monde diplomatique, les nouveaux chiens de garde, yves roucaute splendeurs et misères des journalistes

