mercredi, 11 novembre 2020
MAUVIGNIER : HISTOIRES DE LA NUIT.
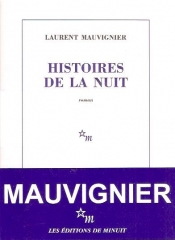 Je viens de lire Histoires de la nuit, le pavé de Laurent Mauvignier publié par les éditions de Minuit en septembre dernier. J’avais entendu quelques commentateurs en parler, et plutôt en bien. J’avais aussi prêté une oreille pas trop malveillante aux piliers du Masque et la Plume, qui n’en disaient pas trop de mal. Obtempérant à ces injonctions douces, je me suis donc plongé dans Histoires de la nuit.
Je viens de lire Histoires de la nuit, le pavé de Laurent Mauvignier publié par les éditions de Minuit en septembre dernier. J’avais entendu quelques commentateurs en parler, et plutôt en bien. J’avais aussi prêté une oreille pas trop malveillante aux piliers du Masque et la Plume, qui n’en disaient pas trop de mal. Obtempérant à ces injonctions douces, je me suis donc plongé dans Histoires de la nuit.
Inutile de le cacher davantage : je suis resté partagé. D’un côté, une écriture en forme d’orfèvrerie finement ciselée ; de l’autre, une impression de froideur intense qui se dégage de personnages enfermés en eux-mêmes malgré les interactions. D’une part, un extraordinaire travail de reconstitution de plusieurs trajectoires de vie. De l’autre, un fait divers particulièrement atroce, dont l’auteur étire démesurément le récit sur plus de six cents pages alors que la durée d’horloge des faits se limite très classiquement à vingt-quatre heures.
Mais il faut faire les présentations : Christine, l’artiste qui est venue s’exiler dans une campagne perdue après avoir divorcé d’un mari qui lui a laissé pas mal de pognon ; Patrice Bergogne, le paysan laborieux qui a repris la ferme familiale, qui passe régulièrement par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel quand il se met à sa comptabilité ; Marion, la femme dont Patrice est resté très amoureux après tout ce temps de mariage, qui travaille dans une imprimerie de la localité voisine, et qui est lasse de cet homme ; Ida, la fille préadolescente du couple, qui va tous les matins jusqu’à l’arrêt pour prendre le bus scolaire et qui en descend tous les soirs. Voilà le tableau de départ.
Quelque chose cloche depuis quelque temps : Christine reçoit des lettres anonymes et, qui plus est, glissées sous la porte de la maison. C’est pour ça qu’elle est à la gendarmerie, grâce à l’obligeance de Patrice, qui a laissé pour un moment le travail à la ferme et qui l’attend sur le parking. Le gendarme est affable et compréhensif, mais dispose de trop peu d’éléments pour intervenir.
Mauvignier a pris un parti de précision maniaco-chirurgicale dans l’écriture : il ne nous épargne pas le plus petit recoin de la vie intérieure de chacun des personnages, que dis-je : du moindre méandre de leur cheminement. L’ambition de l’auteur est de nous donner l’impression qu’il ne nous laisse rien ignorer du tréfonds de leur âme. Cette volonté de « transparence » bute néanmoins sur le bloc de mystère que constitue tout être humain.
Car dans la longue entreprise de dévoilement que s’est assignée l’auteur, celui-ci doit faire intervenir des agents extérieurs. Comptons pour rien les deux collègues de travail de Marion que Patrice a invitées en secret pour fêter le quarantième anniversaire de sa femme, encore admiratives de la façon dont elle a cloué le bec du chef dans la journée, qui finiront la soirée de fête terrorisées et blotties l’une contre l’autre.
Les vrais agents extérieurs, les vecteurs du cauchemar que s’apprête sans le savoir à subir la petite communauté, ce sont les trois frères, Denis, Christophe et Bègue. Un nommé Barzac les a informés qu’il a retrouvé Marion. C’est la main du hasard (du destin ?) qui les a – enfin ! – remis sur la trace de celle par la faute de qui, pensent-ils, Denis a passé des années en prison. Pour Bègue, qui est le raté de la famille, méprisé mais protégé, ce fut l’asile psychiatrique. C’est grâce à la ténacité de Christophe que le lien fraternel a été maintenu.
Et c’est probablement Christophe qui a minutieusement, longuement élaboré le plan d’attaque. La soirée de la vengeance a été précédée d’une longue approche pour repérer la disposition des lieux, noter les habitudes des habitants de ce hameau (« Les Trois filles seules »), les horaires des uns et des autres, la présence du chien Radjah, enfin tout ce qu’il faut pour éviter qu’un imprévu fasse foirer l’expédition (l’arrivée inopinée des deux collègues de Marion sera vite neutralisée par le savoir-faire de Christophe).
A partir de l’arrivée de deux (puis trois) frères, Laurent Mauvignier instaure un climat de menace diffuse. Sans savoir de quoi il retourne, le lecteur, égaré par la mort du chien de Christine et par la séquestration de celle-ci sous la garde de Bègue, comprend progressivement que ce n'est pas pour Christine, mais pour Marion que les agresseurs ont fait irruption dans la vie paisible et monotone du hameau.
C’est par des allusions successives et savamment dosées que s’opère alors le dévoilement du passé de Marion : adolescente sans foi ni loi, faisant la pute à l’occasion, elle a traîné son corps et sa vie dans toutes sortes d’endroits peu recommandables, avant de s’enfuir très loin et de refaire sa vie à La Bassée où elle réserve ses déchaînements aux seules soirées « karaoké » entre filles, dans une boîte de la région.
Mauvignier manie à merveille une forme de sadisme littéraire, où la lenteur très concertée de la narration, à peine entrecoupée par de courtes séquences de dialogues, fait peser une angoisse de plus en plus lourde, et où le lecteur attend fébrilement la page suivante en espérant que. Mais l’art du conteur parvient sans cesse à repousser le dévoilement à plus tard.
C’est sans compter sur Bègue, chargé de surveiller Christine dans la maison voisine. Christine a compris le fonctionnement de ce garçon psychologiquement instable et vulnérable. Elle insinue dans son esprit le ver de l’humiliation : ses deux frères ne le méprisent-ils pas pour le reléguer à la garde d’une femme ? Mal en prend à Christine : Bègue pète les plombs et, après avoir laissé l’artiste pour morte, quitte précipitamment les lieux pour rejoindre ses frères, complètement affolé.
Bon, je ne dirai rien de la suite, sauf peut-être à évoquer le rôle final inattendu que Mauvignier fait jouer à Ida, la fille de Patrice et Marion. Je me contenterai de saluer l’art magistral de l’écrivain ainsi que sa capacité à mettre en œuvre, avec une constance jamais prise en défaut, une méthode qui parvient à mettre le lecteur dans un tel état de tension et ce, de la première ligne jusqu'à la dernière. Pour la méthode, j’ai parfois pensé au Faulkner du Bruit et la fureur, mais je le dis sans insister. Certains étourdis penseront peut-être à l'Ulysse de James Joyce, mais je le dis tranquillement : ça n'a rien à voir. Quant au lecteur, il lui faut une certaine dose de masochisme pour suivre le chemin tant soit peu tortueux, rocailleux et cruel sur lequel l’auteur l’a attiré.
Je laisse à d’autres le soin de juger si ce livre mériterait le Goncourt.
Voilà ce que je dis, moi.
Note sur le style : j'ai parlé d'orfèvrerie, mais je ne crois pas me tromper en prévenant le lecteur qu'il ne faut pas qu'il s'attende à savourer ici ce qu'on appelle des « belles phrases », vous savez, de celles qui ronflent comme le moteur d'une belle voiture. Je n'en ai trouvé aucune. Histoires de la nuit ne donne pas dans la « belle écriture ». Le langage est celui des personnages. Dès lors, il faut accepter de la part du narrateur la recherche exclusive de l'efficacité. Une fois accepté ce parti pris, tout coule de source — y compris, en quelques occasions, l'entorse aux règles de la pureté de la langue : on trouve en effet à la page 37 : « ... des arbres dont on entend les feuilles et les branches bruisser dès que le vent vient de la bonne direction ». Oui, je sais, c'est vraiment chercher la petite bête, mais ça me chiffonne toujours l'oreille. Le Petit Larousse Illustré 2002 l'admettait déjà : « BRUISSER v.i. Bruire – REM. Bruisser tend à supplanter bruire dans ses formes défectives ». S'il n'était que de moi, j'imposerais « La ville bruit de rumeurs ». Mais ma foi, il faut subir ce qu'on ne peut empêcher et ne pas être plus royaliste que la "vox populi". Tant pis.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, laurent mauvignier, mauvignier histoires de la nuit, éditions de minuit

